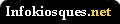A
Autoréductions italiennes 1970
mis en ligne le 2 juillet 2008 - Pierre-Georges Randal , Yves Collondes
AVANT-PROPOS
Les textes qui suivent ont le mérite de combler, à leur mesure, un des non-dits de l’histoire européenne que l’on apprend en classe, un de ces moments terriblement révolutionnaires que les pouvoirs en place préfèrent faire oublier. Ici, aussi, on rencontrera des lacunes : le point de vue est très situé, ce sont des opéraïstes qui parlent, et par exemple on ne rencontrera pas de réelle remise en question du système de logement contemporain, avec ses tours de banlieue composées d’appartements individuels en périphérie des grandes mégapoles.
Cependant, ces textes montrent aussi combien les époques se suivent sans se ressembler. Les tentatives d’autoréduction que l’on connaît aujourd’hui sont souvent bien isolées, et vécues par les employés des magasins concernés, ou par les voisins des maisons occupées, comme des agressions, des actes parasitaires menés par quelques corporations surexcitées ou autres enfants de bourgeois en mal d’aventures. Nous ne vivons plus cette espèce d’entente populaire implicite, qui faisait que les actes de réappropriation révolutionnaires étaient compris, suivis ou soutenus par une grande partie de la population.
Est-ce que les gens ne savent plus danser ensemble ? Certains regardent-ils trop la télé pendant que d’autres rêvent trop à jouer les avant-gardes d’une révolution de professionnels ? Nous trouvons donc ici des outils pour nous souvenir à quoi ressemble une organisation collective « socialisée », c’est-à-dire des actions menées par plusieurs univers, rassemblés autour d’envies, de questions de survie et de formes de lutte communes. Mais il nous reste à penser comment retrouver cette communauté d’imaginaires et de façons de vivre susceptibles de renouer avec une culture populaire qui, dans l’individualisme et les querelles de chapelle, fait aujourd’hui cruellement défaut.
Ferdinand Cazalis pour Séditions, mai 2008.
LE MOUVEMENT DES OCCUPATIONS DE MAISONS
Si le mouvement des autoréductions a pu se développer à une échelle de masse, c’est qu’il existait en Italie des luttes d’usines particulièrement fortes et permanentes. Mais c’est aussi parce qu’à la différence de l’Angleterre, où les ouvriers restent souvent enfermés au seul niveau de l’entreprise, au shop floor, les conflits sortent de l’usine. Ils investissent le terrain social grâce à la force qu’ils ont conquise dans l’usine, et reprenant toutes les contradictions de la société capitaliste, les reportent en usine pour relancer le combat. Les conseils d’usine ont servi directement par exemple pendant les autoréductions au rassemblement des quittances d’électricité.
Mais, avant de parvenir à l’autoréduction, les prolétaires ont parcouru un long cycle de luttes sur le terrain social. Les comités de quartiers qui ont propulsé l’autoréduction se sont construits à partir de 1969. La question du logement a permis cette socialisation, – cette massification – des luttes, comme disent les Italiens. En juillet, Nichelino, commune de la banlieue industrielle de Turin, avait été occupée, les ouvriers refusant de payer les loyers. Un an plus tard, via Tibaldi à Milan, prolétaires et étudiants occupaient des appartements libres. En 1974, à la rentrée des vacances, au moment où les luttes pour l’autoréduction des transports et de l’électricité commencent, des dizaines de familles occupent des appartements et des maisons via delle Cacce à Turin, dans un des ghettos où logent les ouvriers de Mirafiori Sud. Le mouvement finira par entraîner six cents familles dans l’occupation.
C’est le plus vaste mouvement d’occupation jamais vu à Turin. Mais c’est à Rome que le mouvement de lutte sur la question du logement s’est manifesté avec le plus d’ampleur. C’est là aussi que les occupations de maisons ont mené aux affrontements les plus violents avec la police, particulièrement dans le quartier de San Basilio [1].
ROME : UNE LONGUE TRADITION DE LUTTE
Les luttes sur la question du logement remontent à Rome à l’immédiat après-guerre. Pendant les opérations, il se produit un afflux de prolétaires venant du Latium méridional ou du sud de l’Italie. Ceux-ci seront pour la plupart des « travailleurs intermittents » voués aux bas salaires. Mais une loi fasciste restée en vigueur [2] interdit aux immigrés l’accès de la ville historique. C’est là que sont installés des auberges de fortune, des centres d’hébergement municipaux, ancêtres des cités dortoirs.
Durant la période suivante, celle de la « reconstruction nationale », c’est le PCI qui organise les luttes de masse, les grèves générales qui paralysent toute la ville. L’objectif est l’emploi et la construction de logements pour les travailleurs. Parfois même, des chômeurs encadrés par les militants du Parti prennent en charge la construction de routes, d’égouts, débarrassent les gravats. Cette forme de lutte est théorisée comme un exemple « d’autogestion » susceptible de former « les agents sociaux capables de diriger le travail et de le contrôler ». La ligne politique du PCI est alors claire : dans une cité comme Rome, dominée historiquement par les couches moyennes des administrations et par le fascisme, et en l’absence d’une classe ouvrière vraiment importante, il faut miser sur les banlieues, sur les « marginaux », sur les travailleurs temporaires, si l’on veut construire un poids politique capable de contrebalancer la droite. Malgré la précarité du travail, et la présence d’un sous-prolétariat, la banlieue romaine va devenir une forteresse rouge imperméable aux infiltrations de la droite. Phénomène qui se vérifiera électoralement mais aussi dans des manifestations dures. La population de cette « ceinture rouge » est surtout constituée des ouvriers du bâtiment, des rares industries existantes, des chômeurs, des petits artisans chassés dans la périphérie au moment de « l’éventrement » du centre historique.
Les heurts avec la police sont violents, comme en témoigne la grève générale de décembre 1947 durant laquelle la police n’hésite pas à tirer sur les manifestants, tuant un ouvrier du bâtiment au chômage.
L’échec de l’insurrection à la suite de l’attentat manqué contre Togliatti, secrétaire du PCI, marque le début d’un reflux progressif qui conduira aux défaites dans les grandes usines du Nord vers 1955. Le rôle organisateur du PCI va décroissant. Les grèves générales contre le chômage et pour l’amélioration des services ne parviennent plus à paralyser la capitale. Rome accentue durant ces années son caractère de ville essentiellement tertiaire (administrations centrales, services publics, commerce) ; le secteur industriel se réduit au bâtiment et à de petites usines. Parallèlement, la capitale devient un lieu de passage de la main d’œuvre qui, du sud, va vers le nord, et surtout un pôle d’immigration régionale et extra régionale. L’urbanisation sauvage se développe ; les bidonvilles apparaissent et la spéculation immobilière fait ses premières armes avec succès. En même temps qu’il distend ses liens directs avec l’organisation des luttes, le PCI va être amené à préciser sa stratégie d’une « voie parlementaire au socialisme » ; il commence à se poser le problème de l’environnement urbain et de l’organisation de l’espace social. Il étudie la question de la « rente foncière » et découvre dans l’oligopole le « latifundium urbain » (notamment le Saint Siège qui se taille la part du lion). Le problème du logement se trouve alors subordonné à la question d’un développement urbain équilibré, lié lui-même à une lutte d’ensemble contre la rente foncière. Selon une logique toute réformiste qui sépare dans le processus d’accumulation du capital rente et profit, pourtant liés, la rente est alors interprétée comme le frein parasitaire au développement de la ville, du pays, et comme seule responsable des poches d’arriération. Le PCI engage alors la bataille au niveau communal et parlementaire contre la concentration de la grande propriété, contre les « latifundia urbaines » tenues pour responsables de la pénurie du logement. C’est dans ce cadre là qu’il tentera de canaliser le mouvement populaire encore fort dans les banlieues.
En 1950-51 se produisent les premières occupations de maisons dans les quartiers comme Primavalle, Laurentino, Pietralata. Les Consulte Popolari créés à ce moment là sont des organismes de masse unitaires PCI-PSI. Ils rassemblent diverses associations et comités s’occupant du logement. Dans une première phase, leur composante locale de base est essentiellement prolétaire. Au niveau central, on trouve plutôt le personnel politique du PCI (conseillers municipaux, parlementaires). L’axe essentiel est d’obtenir de l’État le blocage des loyers ou davantage d’investissements dans le secteur de la construction publique. Avec bien peu de succès puisque de 51 à 55, le pourcentage de l’aide publique tombe de 25 à 12% du total. Les Consulte Popolari interviennent en outre auprès des autorités locales pour résoudre les problèmes les plus urgents (évacuation des logements dangereux, attribution de logements aux familles expulsées, etc.).
Les formes de luttes sont le plus souvent des manifestations, des délégations, des pétitions qui servent de débouchés aux occupations spontanées qui se multiplient vers 1955, date à laquelle les Consulte les organisent directement pour la première fois.
Presque toutes les occupations de cette époque sont dirigées contre l’Institut pour la Construction Économique et Populaire (IACP). Les logements édifiés par cet organisme public, sorte d’office des HLM italiennes, jouxtent en général les quartiers de l’époque fasciste. Principalement les quartiers Goridinai, Tiburtino III, San Basilio, Primavalle, Tor Marancio. Ces zones populeuses abritent les prolétaires entassés dans des conditions infectes ; clientélisme et corruption vont bon train. C’est ainsi que les inscriptions sur les listes d’attente pour bénéficier d’un relogement dépendent entièrement des partis du centre et de la Démocratie Chrétienne. Les occupations organisées par les Consulte ne sont pas conçues comme des actes d’appropriation mais comme des moyens de pression sur les pouvoirs publics : le problème de leur défense n’est donc pas posé. La ville et son administration ne sont pas considérées comme des ennemies, mais comme des alliées contre la spéculation. En général, ces occupations se terminent par une intervention sans ménagement de la police qui expulse tout le monde, et par une manifestation de protestation devant le Capitole, où sont exigés des crédits pour permettre aux pouvoirs publics d’intervenir. À San Basilio et Pietralata, il arrive que le rapport de force soit favorable aux occupants et que la lutte réussisse. Les Consulte organisent également vers cette époque des grèves de loyers : les termes échus ne sont pas payés aux pouvoirs publics afin de les obliger à améliorer ou à créer des services (écoles, routes, égouts). Durant toute cette période, le PCI réussit en fait à offrir à ces luttes un débouché parlementaire.
Pourtant, en 1956, l’expérience du centre gauche et la loi Sullo contre la spéculation foncière échouent. La ligne du parti va alors osciller entre des propositions technocratiques (contre-propositions, critiques des organismes existants) et des interventions populistes et démagogiques sur les situations d’abus les plus criantes autour desquelles tables rondes et pétitions se succèdent. Mais aucune lutte générale n’est lancée pour appuyer une intervention législative visant à réformer l’urbanisme. Les Consulte changent progressivement de nature : ils se mettent à rassembler « tous les citoyens » qui s’intéressent au problème du logement, des services, des transports, des parcs. Ils perdent leur connotation de classe. Les luttes qui se conduisent encore prennent un tour « civil ». Il y a bien encore des blocus des rues et des places, comme lorsque les familles expulsées des logements démolis pour la construction des installations olympiques manifestent en 1958. Quelques grèves de loyers comme celle de Via Grottaperfetta en 1964. Mais ces luttes ont perdu une grande partie de leur importance et, à la veille de 1969, elles ne sont plus organisées.
Au cours des années 1960, parallèlement à la transformation de l’appareil productif et à l’accentuation des flux migratoires, la pénurie de logements à loyers modérés devient le problème numéro un. La mainmise du grand capital financier sur les terrains à bâtir continue de plus belle, tandis que la part des investissements publics dans le secteur des HLM passe de 16,8% pour tout le pays en 1960 à 6,5% en 1965, et à 7% en 1968, 5,1% en 1969 et 3,7% en 1970 ! Rome qui est devenue la ville charnière entre le Sud et le triangle industriel du Nord gonfle démesurément. Le reste du Latium se vide et se désagrège, tandis que la lointaine banlieue sud ouest vers Latina, Pomezia Aprilia, se congestionne complètement. La construction privée s’oriente vers les logements de « standing » ; l’augmentation des loyers devient vertigineuse et nourrit la spéculation à son tour.
Avec l’échec de sa lutte contre la rente foncière, la politique du PCI se replie sur la demande d’une rééquilibration des pouvoirs publics. Après 64-65, le PCI ne parle plus d’une « politique de l’urbanisme » ; la seule politique cohérente qui est menée est celle d’une pression pour l’assainissement de la banlieue (canalisation des égouts et recouvrement, etc.). Pour le reste, la lutte est abandonnée à un niveau sectoriel et ce sont des organismes de masse interclassistes qui la mènent de façon syndicale. C’est à ce moment là que se forme l’UNIA (Unione Nazionale Inquilini e Assegnatori = Union nationale des locataires et des gens sur liste d’attente) qui offre ses conseils juridiques aux citoyens en butte aux propriétaires. Les initiatives se limitent à des pétitions, à des manifestations pour faire pression sur la commune, sur l’IACP, et obtenir la résorption des bidonvilles, ainsi que l’augmentation de logements sociaux.
69-75 : UN NOUVEAU CYCLE DE LUTTES URBAINES
C’est en 1969 que se produit l’explosion résultant des tensions accumulées durant toutes les années précédentes. À Rome, 70 000 prolétaires parqués dans des ghettos et dans des conditions catastrophiques ont en face d’eux 40 000 appartements vides qui ne trouvent pas d’acquéreurs ou de locataires en raison du coût des loyers. L’Association des Entrepreneurs du bâtiment romain reconnaît elle-même qu’il s’agit là d’une « marge de manœuvre indispensable ». Le climat politique général créé par les luttes ouvrières et étudiantes exerce alors une grande influence dans le déclenchement d’un nouveau genre d’action : il ne s’agit plus d’une occupation symbolique servant de moyen de pression supplémentaire dans le cadre d’une négociation au sommet. Cette dernière est refusée et les occupations prennent l’allure d’une prise de possession violente qui traduit confusément la volonté des prolétaires de prendre les biens nécessaires à leurs besoins. Ces luttes vont avoir pour conséquence de démystifier l’État qui était présenté comme « médiateur » dans la prestation des services pour tous les citoyens. Elles mettent le doigt sur la nature de classe de l’État et de l’administration communale, et concrétisent une extension directe de la lutte de l’usine vers la société.
Cette volonté exprimée de s’emparer des maisons sans attendre le bon plaisir des patrons, ni les investissements qui suivent les avatars du profit, marque une « socialisation » de la lutte, c’est à dire une défense et une récupération du salaire réel. Il manque certes à ces premières occupations d’un nouveau genre une participation directe des ouvriers d’usine en tant que tels. Pourtant, elles apporteront un autre élément, que les luttes ouvrières n’ont pas encore : celle d’une organisation autonome des luttes. Les occupations spontanées de Tufello en été 69 rassembleront un groupe de militants du PCI, du PSIUP (équivalent alors du PSU) et des catholiques de gauche qui formeront la première forme de soutien organisé de ces luttes. Après l’intervention de la police et l’évacuation des appartements, 120 autres logements voisins sont immédiatement occupés, puis 220 dans le quartier Celio. Le nombre monte à 400 les jours suivants. Par choix délibéré, les appartements appartiennent tous aux pouvoirs publics, mais sont abandonnés et libres depuis longtemps. Cette solution offre en effet de meilleures chances de succès et met des bâtons dans les roues aux opérations de l’IAPC entreprises avec la complicité tacite des représentants syndicaux qui siègent en son sein.
Dans le quartier Celio se constitue un Comité d’Agitation de Banlieue, structure centrale qui regroupe des militants et des occupants, élue par les différentes assemblées d’occupants. Un gros effort est fait pour aboutir à une prise en main de la lutte par chacun et pour former des cadres de mouvement, objectif qui ne sera que très partiellement atteint, en raison de l’éparpillement et de la division des prolétaires des bidonvilles.
En septembre, 200 appartements sont occupés via Pigafetta dans un quartier d’Ostie ; ils font partie d’un bloc d’immeubles abandonnés, propriété des chemins de fer. Le mot d’ordre avancé est : « Réquisition des logements ! », car il doit être possible d’appliquer la loi de réquisition pour calamité publique en faveur des bidonvilles.
Le PCI, pour la première fois en contradiction avec sa ligne précédente, condamne cette forme de lutte, se borne à demander l’inscription sur les listes d’attente, et prétend que les occupations de logements appartenant aux pouvoirs publics dressent contre les occupants ceux qui sont déjà inscrits sur ces listes. C’est de là que part le processus de rupture entre le PCI et le nouvel organisme de masse ainsi qu’avec les militants communistes qui en faisaient partie. Désormais, les occupations se feront en secret et les seuls à en être avisés à l’avance seront les parlementaires qui étaient déjà en position de fronde avec le Parti, et qui constitueront le noyau fondateur du quotidien Il Manifesto.
Les objectifs de ces occupations se précisent aussi : les occupants réclament que la commune réquisitionne les logements libres aux constructeurs et qu’elle les loue à un loyer proportionnel au salaire, à la portée donc de tous les travailleurs. Le Comité d’Agitation des Banlieues (CAB) organise une manifestation de trois à quatre mille habitants des bidonvilles devant le Capitole. Il repousse la proposition du PCI d’envoyer une délégation et fait prendre la parole à des dizaines de gens des bidonvilles. Devant la pression qui se manifeste dans les banlieues, le PCI doit organiser en octobre une occupation de trois cents appartements. L’opération échoue. Le 18 novembre, les Consulte, cette fois-ci avec le CAB, organisent trois cents occupations avenue Prati di Papa. Mais le jour suivant, lors de la grève générale sur la question du logement, les manifestants interdisent au PCI de défiler avec ses banderoles en tête du cortège. Les mots d’ordre sont durs : « Ou vous nous donnez les logements, ou bien nous les prenons nous-mêmes ! » Le CAB organise sur la lancée l’occupation de cinq cents nouveaux appartements construits en pleine campagne pour les fonctionnaires des ministères romains. L’État, comprenant alors que la prochaine étape sera l’occupation de maisons privées, organise la contre-attaque. Quinze cents CRS en tenue de combat interviennent. Après une bataille qui dure toute la nuit et la matinée suivante, vingt prolétaires sont arrêtés. L’assemblée décide d’abandonner les appartements indéfendables, et négocie en échange la mise en liberté des arrêtés.
Pour éviter de stagner, le CAB cherche alors à coordonner son action avec les autres groupes qui mènent une intervention sur les logements. La nuit du 10 mars, après un long défilé dans la ville, les objectifs d’abord envisagés étant gardés par la police, cent soixante familles occupent huit immeubles de luxe rue Serpentara, quartier de Val Melaina. La matinée suivante, la police intervient et fait évacuer. Les occupants ne se dispersent pas. Traversant la ville avec les matelas, le mobilier, ils viennent s’installer place du Capitole. Pendant plus de dix jours, ils campent, se réchauffent par des feux au pied des statues de Michel Ange, et nouent des liens de solidarité avec les étudiants, les ouvriers de l’extrême gauche. Le syndicat fait l’objet d’attaques continuelles, et son aide est refusée. L’épreuve de force avec la commune échoue toutefois. Par lassitude, les occupants finissent par abandonner la place. Il y aura d’autres occupations par la suite, mais elles se solderont par des échecs. L’expérience du CAB touche à sa fin. Le PCI et les Consulte parviennent à liquider ces premiers éléments d’autogestion de la lutte, car ils obtiennent des résultats dans leurs négociations avec les pouvoirs publics. Même si ces résultats ne sont pas toujours extraordinaires, ils sont loin d’être négligeables. Il faut dire que la situation objective s’y prête bien. Ainsi, dans le quartier de Nuova Ostia, les promoteurs ne parvenaient pas à vendre les appartements en raison des prix et des loyers trop élevés. La spéculation avait échoué et leur coûtait des milliards de perte sèche. Les conseillers municipaux libéraux impliqués dans l’affaire se mettent d’accord avec le PCI : la commune, à la suite de l’occupation de ces immeubles, en fait l’acquisition pour y reloger les habitants des bidonvilles contre des loyers modérés, payant la différence aux promoteurs !
Le CAB ne survécut pas au déclin du mouvement étudiant, aux attaques du PCI et des Consulte, ainsi qu’aux dissensions internes qui mirent aux prises le Manifesto et le PSIUP [3] sur les élections des instances dirigeantes de ce mouvement. Aussi, à la fin du printemps de 1970, le cycle de luttes qui avait donné naissance à cet organisme paraît-il bien irrémédiablement clos.
Lorsqu’un an plus tard la lutte repart, elle sera animée surtout par les groupes extra parlementaires et également par l’UNIA, fondée par le PCI, qui, pour ne pas perdre tout contrôle de la situation, lancera une grande occupation symbolique en octobre 1971. La crise qui suit 1969 avec une augmentation galopante du coût de la vie n’arrange pas la question du logement qui reste à Rome un problème aussi brûlant. D’autre part, les groupes ont choisi la voie d’une socialisation de la lutte pour construire leur organisation. À Milan, l’occupation réussie avenue Mac Mahon amène à la préparation de la grande occupation Via Tibaldi (1970).
Le 26 mars 1971, sur la vague de ces occupations milanaises, trente familles de San Basilio occupent avec des militants de Potere Operaio deux immeubles dans la commune voisine de Casal Bruciato. Rapidement, trois cent cinquante familles s’y joignent. Malgré l’intervention de l’UNIA et du PCI qui veulent organiser une délégation centrale à Rome, les occupants se préparent à résister activement à la police, ils élisent des délégués d’immeubles et dressent des barricades. Lors de l’assaut donné par trois mille policiers, les heurts sont très violents : vingt arrestations sont opérées. La bataille gagne les rues avoisinantes, certains cherchent refuge dans une section locale du PCI qui leur ferme la porte au nez. À l’assemblée suivante, malgré des divergences d’appréciation sur la suite de la conduite à tenir, il est décidé de continuer à occuper. La nuit même, Potere Operaio organise l’occupation de cent autres appartements. Là encore, la police intervient et expulse très violemment. En juin, Potere Operaio, Lotta Continua et Il Manifesto organisent simultanément des occupations dans les quartiers de Centocelle et Pietralata. La police fait évacuer mais, cette fois-ci, selon les exigences des occupants, sans violence. Une assemblée tenue sur le champ décide une nouvelle occupation de soixante dix/quatre vingt familles au quartier Magliana. La police arrive immédiatement, illumine la rue comme de jour : les heurts sont violents, des voitures sont incendiées, des CRS tirent des rafales de mitraillette et organisent la chasse à l’homme toute la matinée suivante.
Pour répondre à l’occupation des groupes, l’UNIA et le PCI organisent une occupation monstre de dix mille personnes. Mais elle est symbolique. Le syndicat négocie et s’engage à obtenir six mille logements « pour Noël », dont on ne verra jamais la couleur, et seuls les occupants qui sont des « clients » fidèles de l’UNIA trouveront à se reloger.
En fait, il a manqué à toutes ces occupations depuis 1969 la possibilité de durer. D’autre part, elles n’ont encore aucun lien organique avec les luttes d’usines ; leur protagoniste, outre les forces politiques des groupes de l’extrême gauche, est le « prolétariat » toujours prêt à l’émeute. Ce ne sera plus le cas lors de l’hiver 73 et du printemps 74.
LES OCCUPATIONS MASSIVES DE L’HIVER ET DU PRINTEMPS 1974
La période de l’hiver et du printemps 1974 aura été celle où le coût de la vie augmente à la cadence de 1,4 à 2,1% par rapport au mois précédent. Le 5 décembre 1973, les pâtes augmentent ainsi de 25% d’un coup. D’autre part, dans une ville comme Rome, où le loyer arrive à représenter en fait 50 % du salaire, on comprend facilement l’enjeu des luttes sur le logement. En janvier 1974, il y a déjà deux mois que des immeubles sont occupés dans le quartier de Magliana :
Les quatre cents appartements que les patrons préféraient ne pas louer de peur que leurs nouveaux occupants ne participent aux luttes de l’autoréduction (commencées à Rome depuis 1972, [4]), sont actuellement entièrement occupés par des travailleurs. Parmi ceux-ci, il y a 26 ouvriers et 51 travailleurs du bâtiment, 30 artisans (tailleurs et menuisiers), 71 employés des services (hôpital, garage), 14 chômeurs, 9 ménagères, 15 retraités et invalides. Ces travailleurs proviennent de tous les quartiers de Rome.
Tiré du journal Magliana en lutte,
du comité de quartier de Magliana, février 1974.
Mais c’est à partir du 15 janvier 1974 qu’on entre dans la phase ascendante du mouvement : en trois mois, plus de quatre mille appartements vont être successivement occupés, principalement à l’initiative des groupes autonomes de quartier et de Lotta Continua. La réaction de l’État et des propriétaires sera dans tous les cas extrêmement violente : intervention systématique des carabiniers pour expulser les occupants, ce qui sera chaque fois l’occasion d’affrontements impliquant parfois tout un quartier. De plus, pendant toute cette période, il sera fait un usage systématique de bandes fascistes qui tenteront par des provocations continuelles, même parfois des tentatives d’infiltration, de casser le mouvement. Enfin, dans le cas d’occupations directement organisées par des ouvriers d’usine (et particulièrement par l’Assemblée Autonome de la Fatmé), la répression s’accentuera : arrestations de quelques « leaders » ouvriers, exclusion du conseil d’usine des délégués qui appuient les occupations à l’initiative du PCI.
À la mi-mars, ces actions marquent le pas devant le déchaînement de la violence de l’État. Les occupations d’églises sur lesquelles les groupes et particulièrement Avanguardia Operaia comptaient pour maintenir le mouvement sur pied cessent au bout de quelques jours. Le PCI peut saluer la fin de la lutte. L’Unita, sous le titre : « Une dangereuse diversion », écrit le 8 mars :
Il y a des priorités à respecter en ce qui concerne l’attribution de logements à ceux qui sont inscrits sur la liste d’attente ainsi que la réalisation des autres services sociaux. C’est pourquoi le type d’occupations qui a lieu en ce moment, en raison des objectifs qu’elle se fixe, représente une tentative de fourvoyer le mouvement de lutte réel, et ne parvient pas à masquer l’aventurisme d’une tactique qui oscille entre la tentative d’entraîner des quartiers entiers dans la « guérilla » et des tractations avec les institutions démocratiques tant décriées. Cette tactique a été isolée par la grande majorité des travailleurs, des habitants des bidonvilles, des banlieusards, qui forme un front de lutte toujours plus fort, plus responsable et plus vigilant.
Ce cycle d’actions présente des ressemblances avec celui qui avait eu lieu en 1970-71 : spontanéité, dimension de masse attestée par la forte participation des femmes. Il présente néanmoins deux nouveautés importantes : la participation ouvrière directe dont nous avons parlé, et surtout le fait que les logements occupés ne sont plus la propriété des pouvoirs publics, mais appartiennent à toutes les entreprises immobilières de moyenne dimension. Ces dernières forment à Rome le cœur de la spéculation immobilière (notamment de l’ACER : l’association des promoteurs entrepreneurs romains).
Les autres propriétaires lésés ont été des groupes immobiliers liés à la Fiat, à la Banca Nazionale del Lavoro. On saisit là d’ailleurs l’entremêlement parfait de la rente foncière et du profit. L’IRI et la Fiat ont opéré de gros efforts de reconversion pour répondre à des commandes massives de services sociaux (transports en commun, construction) et il est parfaitement artificiel de séparer ces grandes entreprises du tissu spéculatif des moyennes entreprises [5]. Les prolétaires ne s’y sont pas trompés qui ont frappé les deux à la fois. Les techniques répressives mises en œuvre par l’État qui ont permis de voir les limites politiques et organisationnelles des occupations, en sont aussi la preuve.
Le mouvement des occupations à Rome est arrivé à l’occupation des biens privés et non plus seulement des biens dépendants des pouvoirs publics. Toute la dynamique habituelle des occupations s’en est trouvée modifiée. Les syndicats et le PCI n’ont pas pu jouer le même rôle médiateur qu’auparavant. Il ne s’agissait plus d’une prise de gages pour renforcer leur position dans les négociations (relogement, inscriptions sur les listes d’attente), mais d’une appropriation directe qui refusait le côté symbolique qu’avaient eu les occupations précédentes. De ce point de vue, les occupations du printemps 1974 ressemblent beaucoup plus aux formes d’organisation des prolétaires de la banlieue de Santiago, ou aux occupations, par le Comité de Moradores à Lisbonne, de palais pour les transformer en hôpitaux et faire fonctionner immédiatement des services de santé gratuits.
En ce sens, le mouvement d’occupation de maisons à Rome marque un saut par rapport au reste des actions déjà entreprises à Milan par exemple, ou à Venise.
À Milan en effet, où les occupations de maisons datent de 1969 et sont organisées souvent par l’Unione Inquilini (l’Union des locataires), les logements dépendant des pouvoirs publics (de l’IACP notamment : I’Instituto Autonomo Case Popolari) ont tous été occupés et distribués. Il faut donc s’attaquer aux logements privés avec les mêmes problèmes qu’à Rome [6].
La lutte de San Basilio à Rome, en septembre, qui a coûté un mort au mouvement révolutionnaire, a marqué un pas en avant et a été suivie de toute une série d’occupations victorieuses.
LES EVENEMENTS DE SAN BASILIO A ROME EN SEPTEMBRE 1974
San Basilio se situe à Rome au cœur des quartiers « rouges ». Ses habitants ont été de toutes les batailles : occupations de maisons, grèves de loyers, centres sociaux investis pour les transformer en dispensaires populaires (1971), blocus des avenues qui coupent le quartier et qu’il est impossible de traverser aux heures de pointe, enfin luttes pour la création d’écoles. Dès 1972, un propriétaire du quartier, pour empêcher des occupations répétées, était obligé de faire blinder les portes de ses immeubles. C’est également dans ce quartier que les habitants de Rome ont été les premiers à pratiquer les autoréductions d’électricité. Il existe à San Basilio une tradition antifasciste et antipolicière très solide. Les expéditions punitives organisées par la police pour rechercher de fantomatiques voleurs donnent lieu à des ripostes. En 1970, les réunions électorales du candidat démocrate chrétien ne peuvent pas s’y tenir. En 1973, enfin, la population soutient très activement la révolte des prisonniers de l’établissement de Rebiddia ; ce dernier formant le seul service public réalisé dans le quartier depuis des années !
D’autre part, la zone industrielle s’est développée tout près de San Basilio. D’importantes luttes contre les nuisances et la pollution permettent une réunification du « prolétariat » marginalisé des ghettos avec la classe ouvrière.
Au début de septembre 1974, cela fait onze mois que cent quarante sept familles occupent des immeubles appartenant à l’IACP (Instituto Autonomo delle Case Popolari). Le jeudi 5 septembre, la police fait irruption dans le quartier et fait évacuer les immeubles via Fabriano, et huit immeubles via Montecarotto.
Le vendredi matin, la population du quartier s’organise et bloque la grande voie d’accès, la Tiburtina. Des affrontements très violents ont lieu jusqu’à l’après midi et contraignent la police à abandonner les expulsions, qui n’ont été que limitées.
Samedi matin, tandis qu’une délégation se rend à la préfecture et auprès de l’IACP, la police revient pour continuer les expulsions, mais se retrouve devant une forte mobilisation du quartier et de tous les quartiers de Rome. La police est un peu plus nombreuse, mais la détermination des manifestants est visiblement plus forte. La délégation, qui était partie sans trop se faire d’illusions, voit les portes s’ouvrir devant elle. La police semble s’effacer. Lotta Continua demande et obtient une trêve jusqu’au lundi soir à 19 heures. Cette organisation croit avoir gagné et organise imprudemment un défilé de victoire dans les rues du quartier. Le lendemain, dimanche, les CRS reviennent en force devant les immeubles qu’ils n’avaient pu évacuer. Ils pénètrent sans ménagement dans les immeubles, piétinant tout ce qui leur tombe sous la botte, jetant les meubles par les fenêtres, ouvrant les réfrigérateurs, les pillant, s’offrant un petit-déjeuner. Ils pissent devant les femmes et les enfants, puis lancent des grenades lacrymogènes à l’intérieur des appartements à hauteur d’homme.
Bien que surpris, les prolétaires ne tardent pas à réagir. Prévenus par téléphone, des militants affluent des différents quartiers de Rome et harcèlent violemment les forces de l’ordre toute la matinée. Le comité de lutte pour le logement de San Basilio appelle une assemblée populaire sur la place centrale de San Basilio pour 18 heures. À 18h30, la police charge le rassemblement et lance des centaines de grenades lacrymogènes à hauteur de visage. Les gens formés en manifestation se regroupent à la hauteur du carrefour, entre les rues Fiuminata et Fabriano. Via Fabriano, de l’autre côté des immeubles occupés, un peloton de CRS cherche le contact avec les prolétaires. Mais, lorsqu’il doit reculer, un autre peloton qui est derrière, en face des manifestants, se met à tirer à feu nourri. L’une des balles touche mortellement Fabrizio Ceruso, 19 ans, militant du comité ouvrier de Tivoli, qui meurt lors de son transfert en ambulance à l’hôpital. Lorsque, à 20 heures, la nouvelle de sa mort est connue dans le quartier, toutes les lumières s’éteignent, sauf sur le carrefour, où la police est restée en position. Vers 19h30, un expert fait un rapport au palais de justice.
Ce médecin prétendra avoir contrôlé les armes de tous les policiers (alors que ceux-ci sont plus d’un millier !) et n’avoir constaté aucune anomalie ! Tout San Basilio est dans les rues. Les policiers de nouveau sortent leurs armes, mais, cette fois, ils ont l’amère surprise de sentir que le plomb vient de la direction opposée. Huit policiers sont touchés grièvement, dont un commissaire. Le vent a tourné. Un inspecteur, pour freiner la débandade des policiers, leur affirme qu’un camion automitrailleur va venir, mais rien n’y fait ; ils ont perdu la bataille.
L’occupation militaire, qui avait duré quatre jours, prend ainsi fin. Le lendemain, les négociations pour reloger dans les mêmes conditions les cent quarante-sept familles de San Basilio, les trente de Casal Bruciato et les quarante de Bagni di Tivoli commencent. Elles aboutiront très vite, tant la détermination du quartier a fait peur.
Il faut dire que les autoréductions d’électricité viennent de commencer, et que l’État italien ne tient sans doute pas à se retrouver avec plus de cinq mille occupations de maisons, comme au printemps 1974 à Rome.
Les « accords » se multiplient. Le mouvement des occupations était déjà massif à Naples, Salerne et Turin. Le 27 novembre, les sept cents à huit cents familles qui occupaient gagnent : trois cent soixante huit familles obtiennent un appartement dans les quinze jours, trois cent vingt cinq dans les trois mois et les cent trente autres en 1975 [7]. Elles obtiennent également la garantie que le loyer ne dépassera pas 12% de leur salaire, ce qui est très proche de la revendication initialement posée : pas de loyer au dessus de 10% du salaire !
Le 3 novembre, un accord obtenu à Salerne contraignait l’IACP à accorder immédiatement un logement aux occupants et à ceux qui étaient sur les listes d’attente [8].
Les réformistes, gênés par les événements de San Basilio, présentèrent les affrontements comme la conséquence d’une « guerre entre les pauvres », comme des luttes « désespérées » d’habitants des taudis et des sous prolétaires qui « n’ont rien à voir avec les traditions démocratiques du mouvement ouvrier ». Mais, dans le cas de San Basilio, comme durant le printemps 1974, les enquêtes effectuées sur la composition sociale des occupants montrent qu’il ne s’agit pas seulement de marginaux ou de gens habitant dans les taudis ou la « zone », mais d’ouvriers, d’employés, de petits artisans, de prolétaires effectuant des travaux précaires. Ces luttes ont par ailleurs pu mettre en crise la structure du secteur du bâtiment public. Là où, en effet, la politique réformiste du PCI n’avait jamais réussi à venir à bout de la spéculation, la lutte ouverte a commencé à le faire. Le grand capital, et en particulier la Fiat, inquiet des conséquences sociales et politiques de ces luttes, a réclamé une rationalisation du secteur, de façon à éliminer cette poudrière permanente. L’Unita, durant les affrontements, avait écrit qu’à Rome la ligne ultra-gauche des comités de l’autonomie ouvrière était en train de passer parmi les forces de la gauche extra-parlementaire (discret appel du pied à Lotta Continua ou au Manifesto pour contrôler davantage la situation ?). Mais sans la détermination des habitants du quartier qui se sont décidés à gérer directement leur propre lutte et à sortir des sentiers battus des occupations symboliques, qui se laissaient toujours expulser à un moment ou à un autre par la police, il est probable que les luttes pour le logement et les luttes de quartiers auraient subi un coup d’arrêt.
APRES SAN BASILIO
Le mouvement des occupations se poursuit au printemps 1975 essentiellement dans deux grandes villes : Naples et Milan. Dans la première, en février, plus de mille appartements étaient occupés, essentiellement dans le quartier de San Erasmo et Don Guanella. Le mouvement réclamait un loyer ne dépassant pas 10% du salaire. Il repoussait la « solution » proposée par le PCI et qui consistait à accorder une « aide » de 30 000 lires par famille [9].
À Milan, l’Unione Inquilini et le comité de quartier Ticinese, l’un des quartiers historiques du centre de la ville, avaient lancé les occupations de maisons particulières via de Amicis, exigeant la réquisition de plus de mille sept cents logements privés dans le centre. Le 4 avril 1975, via Populi Uniti, c’était au tour des logements d’un promoteur démocrate-chrétien d’être occupés. En mai 1976, le nombre de maisons occupées ouvertement – nous ne parlons pas ici des squattérisations sauvages comme il y en a à Paris ou à Londres – dépassait la centaine. Les retards de paiement de loyers, habituellement de 1 à 2%, ont grimpé à un niveau « politique » (20%) ; le déficit qui a touché l’office des HLM italien était de l’ordre de 5 milliards de lires en 1974 [10].
À partir de l’automne 1975, le mouvement des occupations s’est enrichi d’un nouveau type d’appropriation communiste de la ville : des groupes de jeunes prolétaires des quartiers se sont installés dans des usines désaffectées et les ont transformées en centres de rencontre, de vie et de combat.
LES ACHATS POLITIQUES
Entre le 1er septembre et le 5 septembre 1974, alors qu’à Turin, il y a déjà plus d’une semaine que l’autoréduction du prix des transports [11] a commencé, l’Italie vit à l’heure d’une vaste comédie : les pâtes, cet aliment de base des ménages populaires italiens, ont disparu des magasins. Pourquoi ?
Le gouvernement est revenu sur une première décision, prise à la fin du mois d’août, d’augmenter le prix des pâtes, et tarde à annoncer sa décision définitive ; en attendant, les commerçants stockent pour ne pas avoir à vendre à bas prix, provoquant la colère des ménagères ; on voit même à Naples des débuts « d’émeutes de la faim ». C’est qu’au même moment, on apprend que l’inflation s’élève depuis le début de l’année à 18 %, ce qui constitue un record dans l’Europe des Neuf. Dans ce contexte, la fixation des prix apparaît de plus en plus aux ouvriers comme un geste politique, destiné à reprendre sur le territoire la part du salaire qu’ils ont arrachée aux patrons dans les usines. Pourquoi ne pas imposer, alors, un « prix politique », un prix ouvrier des denrées de première nécessité ?
DU BOYCOTTAGE...
Au mois de juin, déjà, à Venise et à Maestre, des ménagères avaient entamé les premiers mouvements de boycottage des magasins les plus chers. Au supermarché Cadoro, dans le Villagio San Marco, l’un des derniers quartiers prolétaires de Venise, le prix du riz ordinaire tombe de 280 lires avant le boycottage à 230 lires ; en fait, sur quatorze produits de première nécessité, valant avant leur action 8 000 lires, les ménagères imposent 1000 lires de réduction. Un comité des prix se forme avec les ménagères dont le premier objectif sera de contrôler collectivement l’évolution des prix, et qui interviendra au cours de l’année dans une dizaine de supermarchés et de coopératives dans Venise et dans Maestre ; ce comité, sur sa lancée, prendra tout naturellement l’initiative des autoréductions, quand le mouvement s’étendra à la Vénétie, et continuera la lutte bien après les accords gouvernement syndicat.
… A L’APPROPRIATION COLLECTIVE
Mais quand, comme à Milan et sa grande banlieue, le tissu des relations sociales qui pouvaient exister à Venise a cédé devant le remodelage capitaliste des quartiers qui isole et renferme chacun chez soi, le mouvement de contestation des prix ne partira plus des ménagères, mais des ouvriers d’usine ; car ce qui va faire, en Italie, l’originalité d’un tel mouvement, c’est sa spécificité proprement ouvrière. Il ne s’agit pas de « consommateurs », en quête d’un nouveau mode de consommer [12], mais d’ouvriers, se battant pour leur revenu, et reconnus comme tels par une bonne part de la classe ouvrière, comme nous allons le voir.
Des noyaux d’ouvriers décidés vont choisir la seule forme de lutte capable de faire céder les supermarchés : l’appropriation collective, violente s’il le faut, remettant en cause le respect de toute propriété privée ; sans qu’il s’agisse pour les ouvriers d’un vol, comme l’affirmait un tract distribué lors d’une de ces actions : « Les biens que nous avons pris sont à nous, comme est notre tout ce qui existe parce que nous l’avons produit. [13] »
Organisée deux fois à Milan, l’appropriation ne s’est pas encore généralisée en Italie ; mais la brèche ainsi ouverte, l’écho qu’elle a rencontré chez les ouvriers laisse espérer des développements prometteurs ; après tout, comme le faisait remarquer un des protagonistes de cette action directe, « les occupations d’autoroute ont mis trois ans avant de s’imposer en Italie », le récit diffusé par le journal Contro Informazione montre bien l’accueil que de telles appropriations peuvent recevoir auprès des consommateurs d’un supermarché :
« À l’Alfa Romeo, qui est restée un secteur d’avant garde dans le Milanais en ce qui concerne les nouveaux types de lutte, les camarades qui faisaient référence à l’autonomie ouvrière ont soutenu la nécessité d’étendre après les transports les autoréductions au gaz, à l’électricité et aux produits de première nécessité. Cette indication a commencé à faire son chemin dans la tête de pas mal d’ouvriers, y compris de ceux du PCI. Et le samedi, un point de rendez vous a été fixé, et on est parti sur l’objectif. Ceux de l’Alfa et des petites usines de la zone Sempione avaient choisi comme objectif un quartier populaire, Quarto Oggiaro. Pourquoi Quarto Oggiaro ? Pour la composante sociale qu’on y trouve, ouvriers des grandes et petites usines et sous-prolétaires qui sont directement touchés par le problème de l’augmentation des prix. De plus, 50 % des habitants y pratiquent la grève des loyers. La chose a été bien organisée, et tout a été fait pour garantir aux camarades un maximum d’impunité, ainsi qu’aux gens qui rentraient « faire des achats ».
Un retraité est sorti, le chariot plein de vivres et il a dit en milanais : « Ils ont raison ceux là, on ne peut pas vivre avec 75 000 lires par mois », et il s’en est allé à la maison avec son chariot.
Les gens n’ont même pas respecté le mot d’ordre syndical qui voulait qu’on paye la moitié environ du prix des produits. Ils ont compris que même cette attitude n’est plus possible, et l’opinion selon laquelle il faut prendre les choses sans attendre l’intervention du syndicat est en train de prendre racine chez les prolétaires et les ménagères exploités du quartier, refusant la logique du contrat : « Je te donne une chose et tu m’en donnes une autre. » Les produits que les gens ont pris étaient tous de première nécessité : huile, viande, sucre, pâtes, toutes ces choses, et pour certains, pour aider à digérer le tout, une bouteille de whisky. La presse bourgeoise a tenté de donner de l’importance à la bouteille de whisky, sans signaler le fait que la plupart des produits « achetés » par les ouvriers venus là étaient tous de première nécessité. »
Le même jour, au supermarché SMA, via Padova, à Milan, une opération similaire se déroule, menée par des militants du PCMLI [14]. Mais onze travailleurs sont arrêtés parmi lesquels figurent deux membres d’un conseil d’usine et trois ménagères. La revue Italie nouvelle [15] signale bien à ce propos que les ouvriers « n’ont pas soutenu une défense du style : « Je n’étais pas là, ou je passais par là ». Le caractère politique de la défense va entraîner une forte mobilisation et un grand nombre de conseils d’usines vont prendre position en faveur des accusés ; un million de lires sera recueilli à Milan par le « secours rouge populaire », et malgré l’accusation de « vol qualifié » et « d’incitation au pillage », sept des inculpés seront acquittés, les quatre autres étant condamnés à des peines de prison avec sursis pour « résistance et violence à particulier ». L’accusation ne s’était pourtant pas fait faute de citer des articles de l’Unita, journal du PCI, qui décrivaient les accusés « comme une toute petite minorité condamnée par l’ensemble de la classe ouvrière ». Mais le mouvement de protestation populaire vient démentir ces assertions et la justice doit lâcher ses proies.
LES JEUNES PROLETAIRES
Même ce qu’il est convenu d’appeler la délinquance est devenu, en Italie, un phénomène aux implications politiques : on a pu dire que ceux qui alimentent quotidiennement la rubrique des faits divers dans les journaux turinois, sont justement ces 15 000 jeunes que Fiat aurait dû embaucher s’il n’avait mis en « casse integrazione » une grande partie de ses ouvriers. Plus concrètement, des actes d’appropriations, menés à Milan et à Rome, contre des boutiques de disques ou de vêtements, ont été revendiqués politiquement par les jeunes qui les ont commis. En témoigne le texte de ce tract, laissé, par un groupe de jeunes, lors du pillage d’un magasin de disques, à Rome, le 14 novembre 1975 :
« L’achat politique n’est pas un délit, c’est une pratique juste du prolétariat. Vendredi 13, nous, jeunes prolétaires, nous nous sommes organisés pour reprendre ce dont nous avions besoin, payant les produits à leur juste prix (même si cela, les journaux bourgeois l’ont ignoré). À 18h30, deux groupes sont entrés au magasin Stanta à Talenti ; pendant qu’une partie d’entre nous se réappropriaient les produits exposés, les autres incitaient les gens à en faire autant. Quelques gardiens, valets empressés des patrons, ont alors assailli quelques jeunes prolétaires, armés de barres de fer, mais ils ont reçu une juste riposte de la part de nos camarades.
» Les achats politiques font partie de la lutte qui voit les prolétaires s’organiser aujourd’hui dans les quartiers pour l’autoréduction des quittances et des charges, dans les usines pour l’autoréduction des cadences, dans les écoles avec la lutte contre les coûts et contre la sélection.
» La campagne journalistique de ces derniers jours fait partie d’une tentative de criminaliser ce type de lutte qui sort des canaux normaux et institutionnels dans lesquels on tente de renfermer les revendications prolétaires. Révisionnistes et opportunistes sont en première ligne avec leur pratique de délation qui de tout temps les a caractérisés. En particulier le PCI, qui a aujourd’hui un rôle fondamental comme garant de l’ordre social.
» Contre la criminalisation de la lutte, contre l’attaque des patrons et la délation des réformistes et des opportunistes, généralisons ce type de lutte, organisons nous pour tout nous réapproprier ! »
[1] Toutes les grandes villes d’Italie ont connu des mouvements d’occupations, de grèves des loyers. Nous avons choisi de mettre l’accent sur Rome. Pour les mouvements à Naples et a Milan, on lira les articles très documentés d’Antonino Drago et Enrico Cardillo : Le nuove lotte per la casa a Napoli, et de Massimo Todisco : Le lotte sociali a Milano.
[2] Cette loi favorise tellement l’industrie du bâtiment qu’elle ne sera abrogée qu’en 1962 et après des luttes mémorables. Nous sommes redevables de l’analyse qui suit aux articles de M. Marcelloni sur San Basilio, parus dans le quotidien Il Manifesto du 13 septembre 1974, et Case romane dans Contro Informazione n°3 & 4, pp. 10-18.
[3] PSIUP : Partito Socialista Italiano d’Unita Proletaria, fondé en 1964, dissous en 1972. La majorité a rallié le PCI, le reste le PSI, ou a formé le PDUP (Partito d’Unita Proletaria).
[4] Voir la brochure à paraître prochainement chez Séditions, NdE
[5] Comme en témoignait un fonctionnaire de la Commune de Rome, dont l’interview parut dans Contro lnformazione, dont voici un extrait (sur les rapports entre les banques et les promoteurs) :
« Au niveau de la construction également doivent exister des collusions et des appuis politiques qui commandent l’avalisation du prêt. D’autre part, chose plus intéressante, les banques interviennent à divers niveaux sur le territoire. Il y a les branches liées au Vatican, qui ont suivi et suivent encore avec un extrême intérêt les avatars du plan régulateur, et qui financent toutes les plus grosses spéculations. En ce sens, le discours que fait le PCI à propos du capital avancé et du capital arriéré sur la base des critères de la rente foncière et de la rente parasitaire, est complètement erroné, car on est justement en présence d’une intervention du capital financier dans la spéculation. Allez distinguer après cela si la filiale de la Fiat qui intervient sur ce marché fait œuvre de capitalisme avancé ou arriéré !
C’est précisément cette interpénétration qui a empêché une action réformatrice cohérente en Italie. La loi 865 en est un exemple : elle devait opérer une rupture ; elle est restée lettre morte. Elle prévoyait l’expropriation aux tarifs agricoles des terrains et en confiait la responsabilité aux communes. De fait, à part Bologne et encore en partie, je ne connais pas de situations où elle ait été appliquée. »
[6] Cela donne une bonne idée de l’ampleur des luttes urbaines et de l’arrière terrain qu’elles forment pour les pratiques d’autoréduction. En automne 1976, à Milan, I’Unione Inquilini évaluait à 5 000 le nombre de familles occupant plus de quarante édifices. Même chose à des degrés divers à Venise, Vérone, Turin, Florence, Caserta, Potenza, Avellino, Bolzano. Selon Aurélio Cipriani, l’un des trois conseillers de l’extrême gauche qui participent à la municipalité de gauche mise en place après les élections régionales : « Il n’existe pas seulement un mouvement d’occupations, mais un bien plus vaste mouvement sur le logement. Ce qui signifie que, derrière la bataille des sans logements qui mènent des occupations, il y a 20 000 familles, rien qu’à Milan, qui pratiquent l’autoréduction des loyers dus à l’Office des HLM (l’IACP), qui refusent les expulsions, qui pratiquent l’autoréduction du téléphone. La dernière note d’électricité distribuée ces jours ci par la poste a déjà été contestée et autoréduite par 12 000 Milanais. »
[7] Voir Lotta Continua du 27 novembre 1974.
[8] Voir Il Manifesto du 3 novembre 1974.
[9] Cf. Le nuove lotte per la casa a Napoli, A. Drago et E. Cardillo, p. 10O.
[10] Cf. Massimo Todisco, Le Lotte sociali a Milano, p. 76.
[11] Voir la brochure à paraître prochainement chez Séditions, NdE
[12] Même s’ils remettent aussi en cause ce modèle là.
[13] Parti Communiste Marxiste Léniniste Italien
[14] Italie-nouvelle, n°5-6 : « Défaite du régime dans le procès des supermarchés », mars avril 1975.
[15] Rosso, n°4 : « Pour nous, c’est une appropriation », novembre 1975.
)
Ces textes sont extraits de deux chapitres du livre d’Yves Collondes et Pierre-Georges Randal "Les autoréductions" (éditions Christian Bourgois, Paris, 1976).
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (2.5 Mo)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (1.7 Mo)