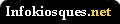L
Lordstown 1972 ou les déboires de la General Motors
mis en ligne le 27 mai 2009 - Pomerol & Médoc
« Terminée en 1970, l’usine de Lordstown, qui possède les machines les plus modernes et les plus sophistiquées, avait été conçue comme un modèle du genre. Au lieu de cela, elle est devenue le “Woodstock” de l’industrie : cheveux longs et tenues hippies y sont de rigueur, et l’absence totale de discipline rend impossible le bon fonctionnement de la chaîne. En choisissant cette petite localité de l’Ohio, loin de Detroit et de ses habitudes en matière de construction automobile, la General Motors espérait rassembler une main d’œuvre jeune et totalement nouvelle. Elle l’a eue... »
L’Expansion
I.
Inaugurée en juin 1970, l’usine où l’on monte la voiture « super-compacte » Vega est revenue à plus de 100 millions de dollars à la General Motors (GM). La nouvelle unité de fabrication d’une conception ultramoderne et bourrée d’innovations technologiques, devait permettre de faire face à la crise que traverse l’industrie automobile américaine face à la saturation du marché et à la concurrence étrangère. Elle se trouve à Lordstown (Ohio). Selon le directeur général de Chevrolet, dont la division prenait en main l’usine, celle-ci représentait « un niveau de qualité qui n’a encore jamais été atteint, en matière de fabrication, dans ce pays ni probablement dans le monde entier ». Il ajouta que les 8.000 employés de Lordstown étaient « très attachés à cette usine ». « C’est la voie de l’avenir », observait, après une visite, un analyste boursier dans le Wall Street Journal.
Que Lordstown soit devenu « la voie de l’avenir », c’est ce que nous nous proposons de montrer ici. Nous n’irons cependant pas jusqu’à prétendre que notre point de vue corresponde aux espérances des habitués de Wall Street ! En février 1972, les ouvriers à Lordstown votent à 97% une grève pour riposter aux mesures de réorganisation et aux suppressions d’emploi décidées par la division montage de la GM (GMAD), qui a remplacé la division Chevrolet à la tête de l’usine. Mais les ouvriers dont l’âge moyen est de 24 ans n’avaient pas attendu la décision de grève pour passer aux actes. Et quels actes ! Selon le New York Review du 23 mars 1972, « Dès avant ce vote, les usines de Lordstown s’étaient acquises une triste célébrité : changements de direction, licenciements, sanctions disciplinaires, augmentation des défauts de fabrication, protestation des ouvriers contre l’accélération des chaînes de montage, coulage des temps, absentéisme élevé, accusations répétées de sabotage. La direction affirme que les ouvriers ont rayé les peintures, détérioré les carrosseries, les sièges et les tableaux de bord des voitures, et elle a offert 5.000 dollars de récompense à toute personne qui donnerait des renseignements sur un incendie qui s’est déclaré dans les circuits électriques de la chaîne de montage elle-même. » Le New York Times précise le tableau : « La production a été sérieusement désorganisée sur la chaîne de montage la plus rapide du monde... GM estime que la perte de production s’élève à 12.000 voitures Vega et à quelque 4.000 camions Chevrolet, pour une valeur d’environ 45 millions de dollars. La direction a dû fermer l’usine à plusieurs reprises depuis le mois dernier après que les ouvriers eurent ralenti les cadences et laissé passer des voitures sur la chaîne sans effectuer toutes les opérations. »
A.B. Anderson, le directeur de l’usine, a déclaré : « Il y a des blocs moteurs qui sont passés devant 40 hommes sans qu’aucun d’eux ne fasse son travail. » La direction a également accusé les ouvriers d’actes de sabotage, d’avoir cassé des pare-brise, des lunettes arrière, d’avoir lacéré des garnitures, tordu des bras d’indicateurs de direction, mis des rondelles dans les carburateurs et cassé des clés de contact.
« Au cours des dernières semaines, une aire de stationnement d’une capacité de 2.000 voitures a fréquemment été remplie de Vegas, qui avaient dû être retournées à l’usine pour des réparations avant même d’avoir été expédiées aux concessionnaires. Ces deux dernières semaines, les ventes de Vegas sont tombées de moitié. » [1]
En septembre 1971, donc avant la prise en main de l’usine par la GMAD, les ouvriers de la carrosserie avaient déclenché une grève sauvage. Le mécontentement n’avait donc pas pour unique cause le changement de direction.
Les gadgets automatiques et autres robots qui peuplent l’usine n’ont pas voulu être en reste et ont apporté leur contribution à la fête. Selon le Wall Street Journal, « les pistolets automatiques de peinture, au moment où ils doivent “se rappeler” si la voiture à peindre est un coupé, une limousine ou un break, ont tendance à s’affoler et à envoyer de la peinture dans toutes les directions, sur les vitres des voitures et sur tout ce qui se trouve à proximité. Une machine auxiliaire, qui avait pour tâche de présenter les pièces aux robots Unimates, est tombée en panne à maintes reprises par “surmenage des pièces maîtresses”. La GM eut même la malchance de vendre au magazine Car une Vega défectueuse. Après examen des défauts de la voiture, les ingénieurs de Chevrolet diagnostiquèrent une “erreur de montage” due à un ordinateur, la voiture (qui avait une boîte automatique) ayant été montée avec la suspension avant du modèle à boîte manuelle à trois vitesses. » [2]
Les faits rapportés ici, bien qu’ils aient pris une ampleur particulière à Lordstown et que la publicité faite par la GM à cette « usine modèle » ait contribué à les faire connaître, ne sont pas limités à une seule usine. Il s’agit d’un phénomène qui touche l’ensemble de l’industrie automobile américaine. Et même un peu plus.
Le sabotage n’a pas été inventé à Lordstown. C’est une vieille tradition ouvrière, qui revient fort à la mode ces derniers temps, il permet, ici, de se détendre les nerfs en assouvissant une petite vengeance, et, là, de se gagner un peu de repos en attendant les réparations. Mais aux États-Unis on commence vraiment à sortir de l’ère du bricolage !
II.
L’usine de montage de la Vega, qui devait être la solution au marasme de l’industrie automobile américaine, s’est en fait présentée comme l’illustration exemplaire des problèmes fondamentaux de la production marchande. Les déboires de la General Motors à Lordstown préfigurent de façon concentrée et limitée la crise future du système capitaliste. Cette crise se présentera sous la forme d’impasse dans les domaines économique, technique et humain. Nous ne nourrissons pas d’illusions sur les faibles chances d’une contagion de tout le système à partir d’un foyer très limité, mais nous croyons que les mêmes causes produiront les mêmes effets.
Rien ne peut garantir que des actions radicales ne seront pas finalement récupérées par le système et digérées par des réformes. Aucun volontarisme ne peut aller contre. C’est à travers la récupération et son dépassement que la vieille taupe révolutionnaire progresse et ressurgit.
« Les révolutions bourgeoises, comme celles du 18e siècle, se précipitent rapidement de succès en succès, leurs effets dramatiques se surpassent, les hommes et les choses semblent être pris dans des feux de diamants, l’enthousiasme extatique est l’état permanent de la société, mais elles sont de courte durée. Rapidement, elles atteignent leur point culminant, et un long malaise s’empare de la société avant qu’elle ait appris à s’approprier d’une façon calme et posée les résultats de sa période orageuse. Les révolutions prolétariennes, par contre, comme celles du 19e siècle, se critiquent elles-mêmes constamment, interrompent à chaque instant leur propre cours, reviennent sur ce qui semble déjà être accompli pour le recommencer à nouveau, taillent impitoyablement les hésitations, les faiblesses et les misères de leurs premières tentatives, paraissent n’abattre leur adversaire que pour lui permettre de puiser de nouvelles forces de la terre et se redresser à nouveau formidable en face d’elles, reculent constamment à nouveau devant l’immensité infinie de leurs propres buts, jusqu’à ce que soit créée enfin la situation qui rende impossible tout retour en arrière... » (Marx, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte)
Le peu d’intérêt des consommateurs pour les achats de voitures et l’importance croissante de la concurrence des constructeurs étrangers, dont les propres marchés sont saturés, ont mine la santé de l’industrie automobile. « Depuis le lancement de la Vega, l’industrie automobile américaine a été le secteur le plus déprimé d’une économie de dépression. 1970 fut une année désastreuse pour les fabricants d’automobiles. La production fut la plus basse enregistrée depuis 1961 ; elle était inférieure d’un tiers à celle de 1965, année record ; d’un cinquième par rapport à 1950. 955 marchands de voitures neuves firent faillite, soit un sur 28... Même l’abolition de la taxe sur les voitures ne parvint pas à stimuler les bénéfices pendant la seconde moitié de 1971... Mais en dépit de cette subvention, les constructeurs d’automobiles ne purent guère accroître leurs programmes de production. Ils n’achetèrent que peu de matières premières supplémentaires et embauchèrent très peu d’ouvriers. Leur prudence s’est avérée sage, les ventes de voitures en 1972 étant jusqu’à présent restées décevantes. En février, le ministère du Commerce a calculé que les projets d’achat de voitures ont baissé de 8,4% par rapport à l’année dernière et de 4,4% depuis le mois d’octobre... » [3] Les bénéfices de l’ensemble de l’industrie automobile sont médiocres. La proportion de capital par employé n’a pratiquement pas augmenté ces dernières années.
Quant à la Vega, c’est encore un échec. Gerstenberg, nouveau président de la GM, déclarait quinze mois après son lancement qu’elle n’avait pas encore subi « l’épreuve du marché que nous lui souhaitons ».
Marchandise pilote, l’automobile crève de son succès même. Son abondance rend sa possession dérisoire. Elle perd simultanément sa valeur de moyen de transport et sa fonction de prestige. Le consommateur qui avait cru pouvoir se procurer liberté et puissance « à peu de frais » se retrouve prisonnier du premier embouteillage venu et impuissant face au plus trivial problème de stationnement. Fétiche en perte de vitesse, l’automobile n’est plus qu’un piètre engin de transport. L’on croit acheter un carrosse et l’on se retrouve comme Cendrillon, une fois l’enchantement passé, avec une vulgaire citrouille. La puissance financière des firmes, même jointe à celle de l’État, ne peut payer le fantastique développement des équipements collectifs qu’exige leur expansion. En cas de récession économique, elle est dans les premières touchées.
Ce qui est remarquable, ce n’est pas qu’il devienne plus difficile de vendre des voitures, c’est que l’on continue à en vendre. Leur manque de qualités personnelles se trouve compensé par les tares grandissantes du système. Dérisoirement, l’automobile accorde un peu de tranquillité à la sortie du travail, elle permet de s’échapper de la ville pour le week-end.
Nous ne prenons pas de grands risques en prédisant que la question de la gestion de l’industrie automobile ne posera pas beaucoup de problèmes lors de la révolution. On arrêtera la production. Le nombre de véhicules en circulation permet de régler tous les problèmes de transport en attendant que l’on mette au point des engins moins misérables et les unités de production automatisées où ils seront fabriqués. La simple utilisation rationnelle des automobiles (optimum de passagers par véhicule, minimum de temps de stationnement, distribution des engins en fonction des capacités des routes : les 2 CV en ville, les DS sur autoroute), associée à la réduction du temps de transport nécessaire pour la plupart des gens, permettra de mettre en réserve la grande majorité des véhicules. Cela réduira la pollution, ainsi que le nombre des embouteillages et des accidents. Peut-être retrouvera-t-on le plaisir de la conduite et de la vitesse. La fabrication des pièces de rechange et la réparation des engins n’occupant qu’une très faible partie des efforts de la société, les anciens serviteurs de l’industrie défunte trouveront ailleurs des occupations plus agréables et plus utiles.
Selon Ford, l’augmentation de la productivité dans l’industrie automobile, qui était de 4,5% par an de 1960 à 1965, est descendue à 1,5% pour la seconde moitié de la décennie. Cette baisse est liée à la stagnation des techniques de production. N. Cole, de la GM, estime que « dans notre branche, les possibilités de progrès technologique sont moindres que par le passé ».
Cette impossibilité de progresser est-elle due à des raisons purement techniques et scientifiques ? Certainement pas : toutes les connaissances qui permettraient d’automatiser à fond la production des automobiles, et de bien d’autres marchandises, existent ; mais elles ne peuvent pas être mises en application parce que les rapports de production freinent le développement des forces productives.
Il y a vingt ans, Norbert Wiener, le fondateur de la cybernétique, considérait que les usines entièrement automatisées pourraient être construites en l’espace de quelques années à partir de principes théoriques déjà élaborés. Après avoir montré comment les deux dernières guerres mondiales avaient permis d’importants développements technologiques à partir de découvertes auparavant inutilisées, il imagine l’impact d’un nouveau conflit de grande envergure qui exigerait à la fois le maintien de la production industrielle et une mobilisation importante dans l’infanterie. « Nous sommes aussi avancés déjà dans la voie du développement d’un système unifié de machines à commande automatique que nous l’étions pour le radar en 1939... Le personnel d’habiles amateurs de radio, de mathématiciens et de physiciens, qu’on avait si rapidement convertis en ingénieurs électriciens en vue de la construction du radar, est toujours disponible pour la tâche, très voisine, de la construction de machines automatiques... La période d’environ deux ans qu’il a fallu pour utiliser le radar sur le champ de bataille avec un degré élevé d’efficacité serait à peine dépassée par la durée d’évolution de l’usine automatique. » [4]
Wiener décrit de façon théorique, mais en rentrant dans les détails, ce que pourrait être une usine automatique centrée sur un ordinateur. Il cite l’usine d’automobiles et la chaîne d’assemblage comme des cas particulièrement favorables à l’application de ces techniques.
Le capitalisme s’est révélé incapable d’effectuer cette révolution technique. Il existe bien sûr des machines automatiques très perfectionnées et même de grands ensembles de production qui excluent presque toute intervention humaine. L’automation concerne des industries en expansion qui peuvent investir les capitaux nécessaires Elle exige que la forme des marchandises produites ne varie pas trop souvent et que les ventes soient assurées. Les « spécialistes » estiment que seulement 8% de la production américaine, en se basant sur le nombre de travailleurs employés, est automatisable.
Certains idéologues essaient de faire passer cette faiblesse pour le comble de la bonté : « La sagesse empirique réside peut-être – en France – dans une certaine lenteur des “conversion”’ qui ménage à la fois les finances et les hommes. Quand Renault a créé l’usine de Flins, il aurait pu réduire de 88% le nombre des ouvriers (tout au moins dans une partie de l’usine) en poussant au maximum concevable l’automatisation des chaînes. Renault a bien fait ; mais ses partenaires du Marché commun auront ils autant de scrupules ? Un bienfait est toujours coûteux. » (Devaux, Automates, Automatisme, Automation)
Si Lordstown est l’usine automobile la plus moderne du monde, et si les dirigeants de la GM n’ont pas eu les scrupules de Renault, elle est loin d’être une usine automatique. « Certaines tâches d’OS ont été confiées à des machines, mais il est très rare que celles-ci présentent un progrès technique important ou transforment de façon révolutionnaire la nature des tâches restantes... Le directeur général de Chevrolet a écrit que la machine à souder automatique “évite à l’ouvrier le maniement des pesantes pinces à souder” mais aussi – ce qui est sans doute plus proche du fond de sa pensée – qu’on a “mécanisé” des secteurs qui, normalement, risquent d’être des sources de défectuosités dues aux insuffisances humaines. D’ailleurs, on ne peut attendre d’un ouvrier qu’il fasse à la main cent grosses soudures à l’heure... Les machines qui ont le plus d’impact sur le travail des ouvriers sont celles qui servent à rendre plus rigide l’organisation de la production et à redécouper le travail pour l’adapter au rythme rapide de la chaîne de montage. Les ingénieurs de la GM sont particulièrement fiers de leur technique d’intégration des opérations. Une de leurs grandes ambitions était “d’utiliser la technologie de l’ordinateur” afin de rendre le travail de chaque ouvrier “plus facile à accomplir et, en même temps, plus précis”, il revient moins cher d’augmenter la précision et la cadence du travail de production que de remplacer les ouvriers par des robots plus rapides : les machines remplacent plutôt les vérificateurs et les surveillants que les ouvriers non qualifiés. » [5]
On le voit, l’automatisation ne concerne pas l’ensemble du processus de production. La machine remplace rarement l’ouvrier, elle sert plutôt à encadrer et à rythmer son travail. On fait effectuer par des automates ce qui freine la vitesse de fabrication. Cela permet d’augmenter les cadences. Le travail est plus con et plus pénible ; l’ouvrier est mieux enchaîné à son poste de travail et mieux contrôlé. « Les ordinateurs chargés du réglage se comportent comme leurs homologues humains de toujours, en plus inexorables. Par exemple, l’ALPACA (Assembly Line Production and Control Activity) “donne à chaque ouvrier le temps qu’il faut pour accomplir sa tâche”. » [6] Dans une interview parue dans le New York Times du 23 janvier 1972, le président de la section syndicale de Lordstown déclare : « C’est la chaîne la plus rapide du monde. Les gars n’ont que 40 secondes pour faire ce qu’ils ont à faire. La direction fait ses calculs et nous dit qu’elle n’a ajouté au travail qu’une seule petite chose. Sur le papier on peut croire que l’ouvrier a assez de temps. Mais quand on n’a que 40 secondes, la moindre chose qui vient s’ajouter peut vous tuer. » [7]
La GM trouve déjà que Lordstown lui est revenu trop cher. L’industrie automobile ne peut pas se payer l’automation. L’importance des capitaux à engager est sans commune mesure avec le coût des usines actuelles et s’opposerait de toute manière à un renouvellement rapide des modèles. La transformation technologique en profondeur exclut le renouvellement de l’apparence des marchandises. Les nécessités de la rotation du capital s’opposent à des investissements à long terme.
Le capital ne se contente plus de transformer les hommes en robots, il ravale les robots au rang de gadgets. Que cette opération prenne des aspects coûteux et grandioses (projet Apollo, 250 fois le prix de Lordstown), ou carrément sinistres (bombardiers sans pilotes), ne la rend que plus dérisoire !
Le capitalisme aurait peu de chance de survivre à un développement massif de l’automation. Wiener lui-même ne se faisait pas trop d’illusions : « Il est évident que ceci produira un chômage en comparaison duquel les difficultés actuelles et même la crise économique de 1930-1936 paraîtront une bonne plaisanterie. » [8] Le chômage, l’effondrement des prix, puis le changement radical et massif des hommes dans le processus de production, par le passage des tâches d’exécution à des tâches de conception, effondreraient le système. L’automation exige la fin du salariat, de la production marchande, et donc l’avènement du communisme.
Le capitalisme est actuellement sauvé d’une telle crise par son inertie. Il y a une différence qualitative entre l’automation de quelques secteurs, qui peuvent reconvertir leurs travailleurs et écouler leurs marchandises, parce qu’ils sont précisément en expansion, et qui de plus freinent la baisse du taux moyen de profit de l’ensemble du système par la baisse de leur productivité particulière, et une automatisation généralisée. Mais cette baisse du taux moyen de profit n’a pu et ne pourra être combattue que par une augmentation générale de la productivité. L’automation est une nécessité autant qu’un péril pour le capitalisme.
Ne pouvant augmenter suffisamment la productivité du travail par le développement du machinisme, les entreprises tentent d’y remédier en intensifiant et en rationalisant l’effort de leurs employés. Cela ne se limite évidemment pas à l’industrie automobile. Ces mesures par exemple touchent de plus vu plus les employés de bureau.
Malheureusement pour eux, les patrons se heurtent à une main-d’œuvre de moins en moins docile. Cette résistance s’est exprimée depuis la fin des années 60 par une augmentation des grèves sauvages et des arrêts spontanés de travail, mais aussi par l’absentéisme, le « turnover » et le sabotage larvé.
L’absentéisme : il s’est développé en particulier parmi les travailleurs à la chaîne. À la GM, chez Ford et chez Chrysler l’absentéisme a doublé en dix ans. Il est de 5 à 10% en moyenne. 5% des absents le sont sans motif à la GM. Ford a dû embaucher des étudiants à temps partiel pour remplacer les travailleurs (10%) qui sont absents les lundis et les vendredis.
Les ouvriers américains ne sont pas les seuls à avoir pris l’habitude d’allonger leurs congés. Dans un article du Monde (08.10.71) sur la situation sociale italienne, on pouvait lire : « À ces maux s’ajoute l’absentéisme, devenu la maladie chronique d’une partie du personnel italien. On estime que, par roulement, sept travailleurs sur cent sont absents chaque jour dans la métallurgie et la mécanique au nord de l’Italie, la proportion passant à 12% dans la région de Naples. Le taux d’absentéisme aurait progressé de 15 à 20% en quelques mois. »
Le « turnover » : les travailleurs ont la bougeotte et changent facilement d’emploi, ou, après avoir amassé une certaine somme d’argent, s’arrêtent de bosser pour un moment. Le taux des départs chez Ford a été en 1969 de 25%. Des ouvriers partent en milieu de journée sans même prendre leur paye.
Ces comportements sont surtout le fait des jeunes, mais les jeunes générations ne se calmeront certainement pas beaucoup en vieillissant. D’après Malcolm Denise, directeur du personnel chez Ford : « L’ouvrier d’usine des années 70 renâclera de plus en plus devant le rythme et le travail uniformes des chaînes de montage. »
La peur de perdre son emploi n’a pas joué à Lordstown : « Dans beaucoup de cas, les pères des jeunes ouvriers de l’automobile travaillent dans les industries de l’acier et du caoutchouc et ont vu leurs emplois menacés par les difficultés causées à leurs usines par la concurrence étrangère. Mais la menace du chômage et les pressions exercées par les parents, la presse et les élus locaux, n’ont à ce jour que peu d’effet sur les jeunes ouvriers “gauchistes” (en anglais : militant) qui ont engagé la lutte contre GM en octobre dernier. » [9] La direction a organisé des séances de « sensibilisation » pour calmer les travailleurs, mais en vain.
« Mais que faire ? Ni les ouvriers, ni les syndicats, ni les managers n’en ont idée. Les syndicats avaient misé tout d’abord sur la réduction de la durée du travail. Lors de la négociation du contrat 1970, l’UAW avait demandé à Ford et à Chrysler d’étudier la possibilité d’une semaine de 40 heures en quatre jours. Chrysler notamment s’était montré intéressé par la formule, dans l’espoir de réduire non seulement l’absentéisme, mais l’instabilité de son personnel. Mais, après huit mois de négociations, le projet fut abandonné : la grande entreprise, dépendant de milliers de fournisseurs, n’était pas capable, semble-t-il, de s’adapter à un autre rythme que la semaine de cinq jours.
« Alors Chrysler essaya autre chose. Un programme de “job enrichement” (enrichissement du travail) fut lancé en janvier 1971. Théoriquement, il s’agissait de « donner la possibilité aux employés de Chrysler, à tous les niveaux, d’être fiers de ce qu’ils font et des produits qu’ils fabriquent ». Dans chaque usine, un comité d’enrichissement du travail se mit en quête de suggestions et d’améliorations des conditions de travail. Mais sur les résultats à long terme, le scepticisme l’emporte. Écoutons Douglas Fraser, vice-président de l’UAW et dirigeant du syndicat Chrysler : « Au début, on a eu l’impression que ça marcherait, mais la question est de savoir combien de temps ça va durer. Est-ce que l’ouvrier devra dire, tous les mois, “alors, mon enrichissement ça vient ?”. » [10]
La bureaucratie syndicale est pourtant pleine de bonne volonté et cherche à se montrer raisonnable. L’U.A.W, parle de négocier une réduction de la semaine de travail « qui ne porte pas préjudice a l’utilisation rationnelle des équipements de la compagnie ». Selon Douglas Fraser, on ne peut pas se permettre n’importe quoi : « Chez Volvo, on dit qu’ils ont entrepris de briser la chaîne et de la remplacer par des petites équipes de production. Ce n’est pas parce qu’ils font ça chez Volvo qu’on peut en faire autant aux États-Unis. Là-bas, ils sortent dix ou quinze voitures à l’heure. Si nous travaillions à cette cadence, nos voitures coûteraient 25.000 dollars. Donner un travail plus satisfaisant aux ouvriers tout en maintenant nos rythmes de production, voila de quoi ce pays a besoin. À nous de trouver la solution. »
Les trusts automobiles, malgré les difficultés qu’ils ont avec leur personnel, estiment que des transformations profondes de l’organisation du travail ne sont pas rentables. Les seules branches industrielles où l’on peut envisager d’en finir avec le travail à la chaîne sont celles où l’on est prêt à payer plus cher pour une meilleure qualité technique, et elles sont rares. Si l’on doit augmenter le coût de production pour vendre plus, il est en général plus intéressant de faire porter l’effort sur la publicité ou le renouvellement de l’apparence des produits que sur la qualité technique. Les exceptions concernent surtout des équipements industriels. Pour l’automobile, il n’y a peut-être que Volvo, qui puisse, en raison de son image de marque particulière (robustesse...) s’engager dans cette voie.
Les remèdes apportés par le capital à ses ennuis sont la répression, la pénalisation des fautes, une surveillance accrue et le renforcement de la discipline.
Pour maintenir leur taux de profit, les constructeurs cherchent à s’implanter à l’étranger. La GM a décidé de construire ses futures usines de Vegas dans une région du Québec où règne le chômage. [11]
Ce n’est pas d’aujourd’hui que les firmes américaines exportent massivement des capitaux qui leur rapportent des profits élevés. Mais l’exportation d’usines automobiles et la réimportation de voitures correspondent à un phénomène plus récent : une partie croissante des biens de consommation utilisés par la population américaine est fabriquée à l’étranger. Les USA continuent à vendre plus de biens d’équipement industriel qu’ils en achètent, mais pas suffisamment pour compenser leurs achats de matières premières et de biens de consommation. Depuis 1971, leur balance commerciale est déficitaire. Les profits réimportés de l’étranger ne comblent ce déficit que dans une faible mesure.
Cela tient au fait que la productivité aux États-Unis a progressé plus lentement qu’en Europe et au Japon, alors que les salaires y restent très supérieurs à ceux de ces pays. La supériorité technologique des Américains (ordinateurs, espace...) et ce qu’il reste de l’écart de productivité font surtout sentir leurs effets sur les biens d’équipement. Cet avantage peut évidemment s’évanouir si les Américains se laissent rattraper. Tôt ou tard, il faudra augmenter sérieusement la productivité. On en revient à l’automation.
En attendant, le capitalisme américain continue à importer des profits en exportant massivement des capitaux dans certains pays sous-développés. Il cherche aussi à signer des contrats avec les pays dits communistes où ses biens d’équipement peuvent s’échanger contre des matières premières. L’incapacité des bureaucraties à accumuler le capital de façon autonome vient consolider l’impérialisme américain.
Celui-ci ne se vexera certainement pas des reproches que lui font bien injustement les petits Stalines locaux. Selon Kim Il Sung : « Il faut que nous soyons des hommes qui haïssent l’idéologie de la classe exploiteuse méprisant et détestant le travail, qui considèrent l’aversion pour le travail comme une chose très honteuse et le travail comme une chose sacrée et la chose la plus honorable et qui aiment à travailler. Alors seulement, on pourrait dire qu’ils sont des hommes ayant l’idéologie communiste. » [12] D’ailleurs, Allende, le petit dernier de la famille, nous précise ce qu’il faut entendre par « classe exploiteuse », en parlant des grèves dans les mines de cuivre : « Ceux de Chiquicamata agissent comme de véritables banquiers monopolistes, demandant de l’argent pour leur poche sans se préoccuper en rien de la situation du pays. » [13]
L’offensive idéologique du capitalisme occidental porte sur la même question et a le même but. Simplement, il se montre plus prudent ; il n’en est que plus obscène.
Syndicalistes et journalistes, patrons et ministres, se précipitent pour pouvoir « regarder en face le douloureux problème des OS, ces laissés-pour-compte de la croissance. Chacun doit pouvoir s’épanouir dans son travail. Il faut en finir avec les tâches répétitives. » Puisque d’après l’UAW « les ouvriers plus âgés considèrent le travail comme une vertu et un devoir, mais non les jeunes, et leur point de vue doit être pris en considération », et puisque, selon J. Godfrey, de la GMAD, « parmi les gars qui n’aiment pas le travail à la chaîne de montage, il y en a qui, tout simplement, n’aiment pas le travail, où qu’on les mette », on doit se montrer réformiste. Tout ce baratin illustre la décomposition d’une société qui a sapé par le développement fantastique de la productivité ses propres fondements. On s’autocritique, on promet de se corriger, mais on ne veut pas discuter de la seule question sérieuse : l’abolition du travail.
La critique de ces messieurs se concentre sur le caractère répétitif des tâches. L’ennemi des humanistes, ce n’est pas le capital, facteur de progrès, mais l’horrible répétitivité. Il faut donner au bon peuple de la variété et il sera heureux.
Il est exact que le travail à la chaîne soit à la fois pénible et répétitif, mais il est faux de dire que le simple fait d’être répétitif soit pénible en soi. Il y a des travaux qui ne sont pas répétitifs et qui sont plus pénibles que le travail à la chaîne. Il y a des activités – faire l’amour, faire de la balançoire – qui sont répétitives sans être pénibles. Si le travail de montage est pénible, ce n’est pas d’abord parce qu’il est répétitif mais parce que c’est du travail.
Ce qui caractérise le travail à la chaîne c’est que l’activité de l’homme y est directement dominée, organisée, rythmée par celle de la machine, incarnation du capital. Contrairement à de nombreux travailleurs, l’OS perd la possibilité de participer à la gestion de sa propre aliénation. Son activité est asservie au capital, non seulement dans ses buts, mais aussi dans sa forme même. Il perd l’illusion de la liberté, mais aussi la liberté de se faire des illusions. Il sait que si son travail est pénible, ce n’est pas parce que ses collègues sont paresseux, ou que son chef est un incapable, mais parce que sa vie est colonisée par le capital.
La critique bourgeoise du travail à la chaîne ne propose comme solution que la participation des travailleurs à la gestion de leur propre aliénation Ce réformisme est une résurgence de celui que Marx critiquait déjà chez Proudhon : il « propose à l’ouvrier de faire non seulement la douzième partie d’une épingle, mais successivement toutes les douze parties. L’ouvrier arriverait ainsi à la science et à la conscience de l’épingle. » (Misère de la Philosophie)
Mais Lordstown, ce n’est pas seulement la manifestation de l’incapacité du capital à affronter les problèmes fondamentaux que lui pose son propre développement, c’est aussi l’apparition de la réponse communiste aux questions qu’il ne sait pas résoudre.
III.
« Lorsque le doigt montre la lune,
l’imbécile regarde le doigt. »
Le bourgeois, ou son frère le bureaucrate, écarquille les yeux et tente de discerner une solution dans les conséquences que l’action des travailleurs pourrait entraîner sur l’organisation du travail. Il ne voit pas que cette solution se trouve tout entière dans la révolte même, dans l’activité déployée par les ouvriers contre l’organisation du travail, c’est-à-dire contre le capital. La programmation de son cerveau lui interdit de concevoir que l’activité puisse prendre le pas sur la chose. Il ne peut imaginer que des variations dans la manière dont la chose. Il ne peut imaginer que des variations dans la manière dont la chose domine l’activité.
De même que le travail n’est utile que parce qu’il met en action le capital et lui ajoute de la valeur, les révoltes ouvrières n’ont d’intérêt que par les effets qu’elles peuvent entraîner sur le capital. Au lieu de regarder ce que font les ouvriers, les idéologues bourgeois essaient d’imaginer ce que les ouvriers voudraient obtenir. On ne voit dans l’activité prolétarienne au plus qu’un facteur de perturbation ou de modernisation du système, jamais l’esquisse de son dépassement.
Bien sûr, la révolte des travailleurs est obligée, provisoirement, de s’aliéner dans des victoires ou des échecs partiels, donc de modifier le système au lieu de le détruire. Même lorsqu’elle prend des formes sauvages, elle ne peut finalement l’éviter ; c’est là-dessus que les syndicats, négociateurs de la marchandise force de travail, fondent leur survie.
Mais le mouvement prolétarien ne peut être réduit à ses conséquences immédiates et partielles. L’activité ne peut jamais être réduite à son produit direct. Le travail lui-même non seulement est à l’origine de tel ou tel objet, mais encore assure la production et la reproduction des classes sociales.
Ils ne font rien, ils ne disent rien.
Que veulent-ils ? Rien...Cela s’est passé en juin dernier dans une entreprise moyenne de construction mécanique de la région parisienne. Entreprise sans histoires, au personnel plutôt jeune et peu organisé syndicalement. Un lundi matin, une grève éclate dans un atelier et se propage. Le soir, l’usine est arrêtée, mais le mouvement n’atteint pas l’encadrement. Celui-ci, au contraire, est surpris ; il n’a pas senti venir la grève. D’ailleurs, les visages des protestataires sont détendus, et la journée s’achève sans qu’aucune revendication ne soit déposée.
Situation inchangée le lendemain matin. Les effectifs sont là, au complet, bavardant, jouant aux cartes. La direction, perplexe, prend contact avec les représentants du personnel et les presse de définir l’objet de la grève. En vain : aucun thème revendicatif n’apparaît.
Le mercredi, les ateliers prennent un air de fête. Les grévistes y improvisent des saynètes, sortes de psychodrames involontaires, où la vie et les petits travers de l’entreprise sont joués avec bonhomie. Le patron est mis en scène sans insolence...
Le jeudi, la direction, désemparée, croit débloquer la situation en annonçant une prime de vacances de 300 F. Cette bonne nouvelle tombe complètement à plat. Les grévistes n’ont rien demandé et ne désirent rien d’autre, semble-t-il, que de laisser les machines au repos.
La semaine se termine sans autre péripétie, et le lundi suivant tout le monde est à son poste, sans complexe. La direction ne saura jamais quel démon a saisi l’entreprise.
Et le plus extraordinaire est que cette histoire est vraie.
Le Management, décembre 1972.
Aujourd’hui, dans ses luttes, le prolétariat, même s’il est obligé de se contenter de réformes, commence à montrer qu’il n’est plus réformiste. L’on assiste à cette chose extraordinairement significative : des gens se mettent en grève et ensuite, parfois plusieurs jours après, commencent à formuler des revendications. [14]
L’activité communiste ne peut être la conséquence d’une réorganisation, d’une démocratisation ou d’une autogestion même très poussée des conditions de travail. Elle ne se substitue pas au travail. Elle n’est pas une modification des activités productives actuelles sous le coup ou à la suite d’une révolution. Elle surgit au sein même du vieux monde sous la forme subversive d’une lutte contre l’organisation dominante de la vie. Ses aspects « primitifs » sont le sabotage, le pillage, la grève insurrectionnelle... Elle devra dépasser au cours de son développement cette phase de négation. Elle ne le fera pas parce qu’en vieillissant elle serait devenue raisonnable, mais poussée par les conséquences de ses propres actes, en vertu de sa propre logique et de nouvelles tâches à effectuer. Elle est la révolution même.
La lutte des travailleurs de Lordstown est communiste parce qu’elle s’en prend au capital et parce qu’elle est déjà profondément différente du travail.
Sa première caractéristique est la spontanéité. Cela ne veut nullement dire qu’elle était bordélique, sans plan et inorganisée. L’opposition entre spontanéité et organisation relève de la pensée bureaucratique qui est bien placée pour pouvoir reconnaître la réalité de la spontanéité, mais voudrait cependant se réserver le monopole de l’organisation.
Ce qui manquerait aussi aux travailleurs, c’est la conscience. Selon un délégué CFDT : « Ce ne sont pas les OS les plus abrutis par le travail qui sont capables de remettre en cause les rapports de production, mais ceux à qui, malgré leur travail, il reste suffisamment de possibilités de réflexion pour permettre une prise de conscience. » [15] Il n’y a pas que le travail qui abrutit, le syndicalisme aussi. La conscience n’était pas plus absente à Lordstown que l’organisation. Simplement il ne s’agissait pas d’une conscience idéologique, mais d’une conscience liée à une situation et à des possibilités d’action.
Ce qu’ont fait les ouvriers de Lordstown était directement déterminé par la conscience qu’ils avaient de leur situation, de leurs intérêts et des risques à prendre. En cela ils se niaient comme prolétaires et comme salariés. L’aliénation du travailleur consiste en ceci que son activité est soumise à une logique qui lui est étrangère. Il est agi autant qu’il agit. Sa position ressemble à celle du rameur qui, à fond de cale, fait se mouvoir la galère mais ne peut décider ni de sa destination, ni même de l’énergie à dépenser en fonction d’une estimation personnelle des nécessités de la navigation.
Dans la lutte, l’ouvrier redevient maître de lui-même et reprend le contrôle de ses propres gestes. Le caractère sacré de « l’outil de travail », le sérieux oppressant de la réalité de l’usine s’effondre. Avec le sabotage proprement dit, mais plus généralement avec tout ce qui s’en prend directement à l’organisation du travail, la joie réapparaît dans les bagnes du salariat. Cette joie peut aller jusqu’à une saine et lucide ivresse lorsqu’il s’agit d’une activité collective et organisée. La panique qui s’empare des gardes-chiourme et de la direction ne peut que l’attiser ; l’impuissance a changé de camp !
Voici une description de ce qui s’est passé en 1968 dans une usine automobile proche de Detroit : « On commença à voir dans certaines parties de l’usine des actes de sabotage organisé. Au début, c’étaient des fautes d’assemblage ou même des omissions de pièces à une échelle bien plus grande que la normale, si bien que de nombreux moteurs étaient rejetés à la première inspection. L’organisation de l’action entraîna différents accords entre les vérificateurs et quelques ateliers d’assemblage, avec des sentiments et des motivations mélangés chez les ouvriers concernés – certains déterminés, d’autres cherchant une sorte de vengeance, d’autres encore participant seulement pour se marrer. Toujours est-il que le mouvement se développa rapidement dans une ambiance très enthousiaste...
« À la vérification et aux essais, au cas où le moteur aurait passé la chaîne sans que des défauts de fabrication s’y glissent, un bon coup de clef à molette sur le filtre à huile, sur une couverture de bielle ou sur le distributeur, arrangeait toujours les choses. Parfois même les moteurs étaient simplement rejetés parce qu’ils ne tournaient pas assez silencieusement...
« Les projets conçus lors de ces réunions innombrables conduisirent finalement au sabotage à l’échelle de toute l’usine des moteurs V8. Comme les six cylindres, les V8 étaient assemblés de façon défectueuse ou endommagés en cours de route pour qu’ils soient rejetés. En plus de cela, les vérificateurs, à l’essai, se mirent d’accord pour rejeter quelque chose comme trois moteurs sur quatre ou cinq qu’ils testaient...
« Sans aucun aveu de sabotage de la part des gars, le chef fut forcé de se lancer dans un exposé tortueux, qui lui troubla même un peu les sens, en essayant d’expliquer aux gars qu’ils ne devaient pas rejeter des moteurs qui étaient de toute évidence de très mauvaise qualité, mais sans pouvoir leur dire carrément. Toutes ces tentatives furent vaines car les gars y allèrent au toupet : ils lui affirmèrent sans relâche que leurs intérêts et ceux de la compagnie ne faisaient qu’un, c’était leur devoir d’assurer la fabrication de produits de première qualité...
« Un programme de sabotage rotatif au niveau de toute l’usine fut élaboré pendant l’été peur gagner du temps libre. Lors d’une réunion, les ouvriers prirent des numéros de 1 à 50 ou plus. Il y eut des réunions similaires dans d’autres parties de l’usine. Chaque ouvrier était responsable d’une certaine période d’environ 20 minutes pendant les deux semaines à suivre et, lorsque sa période arrivait, il faisait quelque chose pour saboter la production dans son atelier, si possible quelque chose d’assez grave pour arrêter toute la chaîne. Dès que le chef envoyait une équipe pour réparer la “faute”, la même chose recommençait dans un autre endroit-clé. De cette manière l’usine entière se reposait entre 5 et 20 minutes par heure pendant un bon nombre de semaines, à cause soit d’un arrêt de la chaîne, soit de l’absence de moteurs sur ladite chaîne. Les techniques-mêmes employées pour le sabotage sont très nombreuses et variées, et j’ignore celles qui furent employées dans la plupart des ateliers...
« Ce qui est remarquable dans tout cela, c’est le niveau de coopération et d’organisation des ouvriers à l’intérieur d’un même atelier et aussi entre les différents ateliers. Tout en étant une réaction au besoin d’action commune, cette organisation est aussi un moyen de faire fonctionner le sabotage, de faire des collectes, ou même d’organiser des jeux et des compétitions qui servent à transformer la journée de travail en une activité plaisante. Ce fut ce qui se produisit à l’atelier d’essai des moteurs...
« Les contrôleurs, au banc d’essai des moteurs, organisèrent un concours avec les bielles qui nécessitait que des vigies soient postées aux entrées de l’atelier et que des accords soient conclus avec les ouvriers de la chaîne de montage des moteurs, par exemple pour qu’ils ne fixent pas entièrement les bielles de certains moteurs pris au hasard. Quand un vérificateur sentait des vibrations douteuses, il criait à tous de dégager l’atelier et les ouvriers abandonnaient aussitôt leur travail pour se mettre à l’abri derrière les caisses et les étagères. Ensuite, il lançait le moteur à 4 ou 5.000 tours/minute. Celui-ci faisait toutes sortes de bruits et de coups de ferraille pour finalement s’arrêter ; dans un grand claquement sec, la bielle baladeuse crevant le carter était projetée d’un seul coup à l’autre bout de l’atelier. Les gars sortaient alors de leurs abris en poussant des hourras et on marquait à la craie sur le mur un autre point pour le vérificateur. Cette compétition-là se prolongea pendant plusieurs mois, entraînant l’éclatement de plus de 150 moteurs. Et les paris allaient bon train.
« Dans un autre cas, tout commença par deux gars qui s’arrosaient par un jour de chaleur avec les jets d’eau utilisés dans l’atelier des essais. Cela se développa en une bataille rangée de jets d’eau dans tout l’atelier qui dura plusieurs jours. La plupart des moteurs étaient soit ignorés, soit simplement approuvés en vitesse pour que les gars soient libres pour la bataille, et dans de nombreux cas les moteurs étaient détruits ou endommagés pour s’en débarrasser rapidement. Il y avait en général dix ou quinze jets d’eau en action dans la bataille, tous avec une pression d’eau comparable à celle d’une lance à incendie. Des jets d’eau giclaient de partout, les gars riaient, criaient et couraient dans tous les sens : dans cette atmosphère, il y en avait bien peu qui étaient d’humeur à faire leur travail. L’atelier était régulièrement inondé jusqu’au plafond et tous les gars complètement trempés. Bientôt, ils apportèrent toutes sortes de pistolets à eau, tuyaux d’arrosage et seaux, et le jeu prit les proportions d’une foire énorme pendant des heures. Un gars se promenait avec le bonnet de bain de sa femme sur la tête, au grand amusement du reste de l’usine qui n’était pas au courant de ce qui se passait dans l’atelier des essais...
« Le conflit constant avec la rationalisation bureaucratique s’exprime tous les jours d’une façon dramatique à la sortie. La plupart des ouvriers qui ne travaillent pas à la chaîne principale d’assemblage ont fini leur travail, se sont levés et sont prêts à partir cinq bonnes minutes avant la sirène. Et avec 30 ou 40 contremaîtres en chemise blanche d’un côté, et 300 ou 400 gars de l’autre, les gars commencent tous ensemble à imiter le bruit de la sirène en hurlant, et se précipitent vers les pointeuses en écrasant littéralement les contremaîtres, pointent en vitesse et sont déjà sortis de l’usine lorsque la sirène, la vraie cette fois, se mêle à leurs cris. » [16]
Les ouvriers opposent à l’organisation capitaliste du travail non pas une nouvelle organisation du travail, mais l’organisation de leur lutte et de leurs jeux. Ils s’en prennent au cloisonnement entre ateliers et introduisent la liberté de circulation et de contacts entre les hommes à l’intérieur de l’usine.
La direction de Berliet tenait récemment à rappeler à ses employés que « les cortèges dans l’entreprise sont interdits ». Elle ajoutait : « Ne sont pas considérés comme exercice normal du droit de grève, les arrêts inopinés et répétés aboutissant à une désorganisation de la production, ainsi que les restrictions volontaires de travail pour freinage de la production. »
Avec le sabotage, le rapport de domination du capital sur le travailleur est renversé. Alors que dans le travail, la marchandise est un instrument d’asservissement pour l’ouvrier, il la remet à sa place d’objet que l’on utilise.
Il ne faut pas se leurrer sur le caractère destructeur que revêt l’activité communiste telle qu’elle sort des flancs du capitalisme. Elle est déjà productrice d’usage. Le sabotage détruit de la valeur marchande (c’est-à-dire fait perdre de l’argent), en s’attaquant à l’usage que l’on peut faire d’une marchandise (pièce utile dans la voiture), mais il produit de la valeur d’usage pour l’ouvrier puisqu’il permet de gagner du temps libre, de faire pression sur le patron.
Ceux qui reprochent au sabotage d’être une activité destructrice lui font un mauvais procès. Toute activité productrice est aussi destructrice. Tout acte de production est aussi acte de consommation : on ne fait que transformer de la matière. Sur l’utilité des destructions, le capital n’a pas de leçon à donner. Il ne se gêne pas pour amortir des machines et des installations industrielles sur de très courtes périodes de temps, pour polluer la planète et s’offrir de petites guerres de temps en temps. Il n’hésite pas à sacrifier de la valeur d’usage sur l’autel de la valeur marchande, ce qui le gêne dans le sabotage c’est qu’il se passe exactement le contraire. [17]
Les ouvriers pour qui l’outil de travail n’est plus une chose sacrée qu’il ne faut surtout pas détourner de sa fonction première, ceux qui n’acceptent plus de sacrifier leur vie devant des fétiches sauront, le moment venu, utiliser au mieux les instruments que leur aura légués le capital. Ils sauront remettre en marche tout ce qui sera nécessaire pour assurer les tâches révolutionnaires : se vêtir, se nourrir, s’abriter, s’armer... vivre.
Une telle activité se distingue radicalement de l’ensemble des moyens par lesquels on canalise et on dévalue l’énergie du prolétariat. De même que le prolétariat peut parler théoriquement à travers certains actes, de même certains actes peuvent ne plus être que du baratin. Les processions du 1er Mai ne sont plus que les restes fossilisés des émeutes spontanées par lesquelles le prolétariat du 19e siècle imposait son existence. Par les grèves d’avertissement et autres formes de débrayage bidon, on n’agit plus directement pour imposer sa volonté, on cherche à montrer son mécontentement, à s’exprimer. Plus récemment, on a vu l’occupation d’usines se transformer en protection de l’outil de travail grâce à la bienveillance des syndicats.
Certains bureaucrates extrémistes ont pu aller jusqu’à essayer de récupérer le sabotage. Le mot d’ordre maoïste « Il est juste de saboter » n’exprime rien d’autre. Le sabotage n’est plus une réponse à une situation concrète mais une chose bonne en soi. Le sabotage du fétiche cède le pas au fétichisme du sabotage.
La colère des tisserands qui s’en prenaient aux métiers Jacquard, voleurs de travail, était aussi justifiée subjectivement que celle des OS qui en ont marre de travailler, mais ils avaient tort historiquement. Aujourd’hui l’histoire ne peut que donner raison aux prolétaires qui refusent de sacrifier leur vie pour une production imbécile, de même elle ne peut qu’applaudir sans réserve ceux qui se livrent au pillage. Notre époque voit l’air et l’eau devenir des marchandises, alors que toutes les denrées nécessaires à la vie humaine pourraient être gratuites. Les usines et les bureaux regorgent de gens dont les efforts ont des conséquences néfastes !
La rencontre entre d’une part le mépris du travail manifesté par les jeunes générations, et d’autre part le développement des forces productives qui justifient ce mépris n’est pas le fruit du hasard. Le degré d’accumulation atteint par le capital l’amène à concentrer tous les regards sur le spectacle du consommable. Le travail, origine du capital-marchandise et détour pour se le procurer, se trouve dévalorisé.
Les possibilités historiques emprisonnées sous la forme marchande se vengent !
Nous ne nourrissons pas d’illusions sur la classe ouvrière américaine. Il lui reste encore beaucoup à apprendre. Pour vaincre, le prolétariat devra se constituer en parti politique ou plutôt antipolitique et affronter l’appareil d’État bourgeois.
C’est un signe de maturité de la révolution moderne qu’elle ne se manifeste pas d’abord au niveau politique. Elle se montre supérieure en cela aux insurrections prolétariennes du passé qui se heurtaient à l’appareil d’État sans avoir suffisamment sapé les lois de l’économie marchande. Le problème de la révolution sociale n’est nullement de s’emparer de l’État bourgeois, ou de constituer son propre État afin de transformer l’économie d’en haut. Si par le passé le prolétariat a pu être tenté d’agir par l’intermédiaire d’un pouvoir politique, ce n’est pas un signe de force mais de faiblesse.
Le prolétariat doit se servir de sa position dans la production, c’est là son point fort, pour vaincre l’État bourgeois. Il ne s’agit pas de retomber dans le vieux mythe de la grève générale : effondrement de l’État par paralysie de l’économie. Il faudra saboter activement le mécanisme de l’échange et du salariat, abolir les barrières entre les entreprises afin de dégager les forces humaines et matérielles du carcan économique. Elles pourront s’orienter ainsi vers la liquidation définitive de l’appareil d’État bourgeois et de ses instruments de répression.
Aux États-Unis, ceux-ci commencent déjà à se voir miner de l’intérieur. Le goût du sabotage et de l’indiscipline a gagné les forces militaires. Les soldats de « l’armée de la drogue » au Vietnam ont montré qu’ils étaient pas prêts à mourir sagement dans un combat qui n’était pas le leur. L’US Navy, bastion du conservatisme, commence à ressentir le contrecoup, et de la guerre du Vietnam, et du problème noir. Émeutes raciales, sabotages et actes d’insubordination se succèdent sur les navires de guerre américains. Même si cette indiscipline prend souvent la forme d’un conflit racial entre noirs et blancs, étant donné les conditions dans lesquelles elle s’exerce, elle a une importance considérable pour la révolution. Les marins sauront bien refaire leur unité contre leur véritable adversaire, dans d’autres circonstances. D’ailleurs, le magazine allemand Stern sous-titre un article sur cette question : « L’arrogance d’officiers de marine blancs provoque les plus graves émeutes raciales de la marine US. » Il ajoute que le nombre d’incidents en un mois menaçait la capacité d’initiative de la flotte. Pour protester contre la discrimination raciale, des marins noirs et blancs ont contraint le capitaine du porte-avions Constellation à revenir au port (Stern, 25.01.73).
La répression s’est abattue sur les auteurs de ces actes. De nombreux marins ont été condamnés à des peines disciplinaires. D’autres ont été licenciés.
Les émeutes sur les navires de guerre, les sabotages de Lordstown, et en écho le bavardage réformiste, montrent avec éclat que le spectre du communisme rôde aujourd’hui dans les sanctuaires de l’aliénation. On ne l’en fera pas sortir en l’aspergeant avec l’eau bénite des réformes !
Autant le retour de la révolution sociale paraissait improbable il y a seulement quelques années, autant c’est le rafistolage du vieux monde qui est en passe de devenir, aux yeux des prolétaires comme aux yeux des classes dirigeantes, une entreprise bien hasardeuse.
[1] Article du New York Times traduit dans Informations Correspondances Ouvrières (mars-avril 1972).
[2] « Automation et OS à la General Motors », paru dans le New York Review du 23 mars 1972, traduit dans Les Temps modernes parmi d’autres articles sur des sujets proches (septembre-octobre 1972). L’article est bien documenté et s’appuie fréquemment sur d’autres écrits parus en Amérique sur Lordstown. La tentative d’analyse reste au niveau « intellectuel de gauche ».
[3] « Automation et OS à la General Motors », op.cit.
[4] Norbert Wiener, Cybernétique et société, 10/18, 1962 [1950], notamment le chapitre « Première et seconde révolution industrielle ». Au-delà de la question de l’automation,
l’ensemble du livre a un intérêt théorique certain.
[5] « Automation et OS à la General Motors », op.cit.
[6] « Automation et OS à la General Motors », op.cit.
[7] « Automation et OS à la General Motors », op.cit.
[8] Norbert Wiener, op.cit.
[9] Article du New York Times traduit dans Informations Correspondances Ouvrières (mars-avril 1972).
[10] « Comment s’est arrêtée la chaîne la plus rapide du monde » de Jim Wargo, L’Expansion (mars 1972).
[11] « La GM investit beaucoup plus à l’étranger qu’aux États-Unis, particulièrement en Asie du Sud-Est. L’été dernier elle a pris une participation dans la firme japonaise Isuzu. Quelques semaines plus tard, elle annonçait qu’elle acquérait une usine de montage en Malaisie et qu’elle espérait faire de la fabrication en Thaïlande. Elle est d’ores et déjà implantée en Corée du Sud et demande à pouvoir importer en franchise de douane des pièces fabriquées aux Philippines. Un des objectifs ultérieurs de la politique asiatique de la GM serait, selon des concurrents japonais inquiets, de “pénétrer ce marché (chinois) de 750 millions de consommateurs en passant par Tokyo”. (Les Chinois utilisent déjà de coûteux matériels de terrassement fabriqués par la GM et acheminés par un associé Italien.)...
« Il existe une autre source d’expansion rentable : la réimportation vers les États-Unis de voitures (comme les “Buick” Opel de la GM) fabriquées à l’étranger par des filiales ou des firmes associées. Entre août 1970 et août 1971, durant la première année de la Vega et la période où le pays était le plus inquiet de la rivalité entre voitures étrangères et voitures “subcompactes” américaines, les “ré-importations” des trois grands de l’automobile américains augmentèrent de 78% ; ce qui représente un taux à peine inférieur à celui réalisé par les ventes aux États-Unis des constructeurs japonais, et un taux sept fois supérieur à celui réalisé par les Européens. » (New York Review)
Sur les causes et conséquences du déficit de la balance commerciale américaine, cf. L’Expansion (décembre 1972) : « L’Amérique vieillit ».
[12] Kim Il Sung, « Théorie de la construction économique du socialisme » édité et diffusé gracieusement par le PSU !
[13] Allende, Le Monde du 21.01.73. Les Français n’ont aucune raison de se montrer jaloux, G. Marchais a montré qu’il était le digne successeur de M. Thorez. Dans une conférence de presse sur le financement du programme commun de la Gauche, il a déclaré : « Les ouvriers travailleraient d’avantage s’ils avaient un gouvernement dans lequel ils ont confiance. » (Le Monde, 24.01.73)
[14] Une des meilleures façons de châtrer démocratiquement une grève est de la noyer dans la recherche, la discussion et la formulation de revendications. Nous ne saurions trop recommander les grèves où aucune revendication n’est avancée. Cela permet de s’occuper d’autre chose, de profiter pleinement de ce que représente un arrêt de travail. On dégage la grève, acte de force et de plaisir, de la gangue mystificatrice de la négociation et de l’ennui qui l’entoure.
Il n’y a nul besoin de formuler des revendications pour qu’elles soient satisfaites Le patron pour faire reprendre le travail, c’est une nécessité pour lui, doit essayer de contenter son personnel. Seulement, à l’inverse du cas habituel, c’est lui qui est en position de demandeur, lui qui ne connaît pas les cartes de l’adversaire, lui qui doit se mouiller et faire des propositions.
L’expérience montre que dans une telle situation les directions paniquent, bafouillent, se ridiculisent et commencent à se montrer plus généreuses. Dans la guerre sociale, il faut mettre l’incertitude à son service.
[15] Cité par L’Expansion (mars 1972), il exprime le crétinisme militant. Lorsque nous nous en prenons au syndicalisme, nous ne voulons pas dire qu’il faut ranger l’ensemble des syndiqués ou même des délégués dans le camp des imbéciles ou des contre-révolutionnaires. Il y a de nombreux travailleurs qui tout en utilisant la forme syndicale n’en sont pas prisonniers.
Nous empruntons cette note sur la conscience à P. Guillaume (postface à Les Trois sources du Marxisme) : « J’observe un joueur de tennis et je vois que ses coups sont insuffisamment appuyés, qu’il ne construit pas assez son jeu, qu’il ne perçoit pas ou ne sait pas répondre à la stratégie de son adversaire par une autre stratégie, qu’il se contente de renvoyer la balle comme il peut. Ma conscience n’est ni juste, ni fausse, elle est abstraite, dénuée d’efficacité, et déterminée par ma situation de spectateur. La “conscience” qu’a le joueur est d’un type totalement différent, elle inclut entre autres la perception immédiate de la fatigue, des capacités physiologiques, sensorielles, de perception et de réflexe, etc. Sa conscience est un moment de son jeu, indissociable de son jeu. » « ... Notre discussion aboutira non pas à lui apporter la conscience, mais à élaborer un langage dans lequel nos expériences deviennent communicables. »
[16] « Le contre-planning dans l’atelier » paru dans Radical America, traduit dans Informations Correspondance Ouvrière (mars-avril 1972). [Republié in Rupture dans la théorie de la révolution. Textes 1965-1975, Senonevero, 2003.]
[17] Le coût direct de la guerre au Vietnam s’est élevé suivant le Pentagone à 137 milliards de dollars ; ce chiffre ne rend pas compte de l’usure normale du matériel et de l’entretien de plusieurs bases qui ont servi dans la guerre... Le projet Apollo n’a été que de 26 milliards de dollars. Tout cela reste relativement faible lorsqu’on sait que le PNB des États-Unis s’est élevé en 1972 à 1.152,1 milliards de dollars.
)
Biblio complémentaire
OJTR, Le militantisme, stade suprême de l’aliénation
Un monde sans argent : le communisme
Sur Lordstown et bien d’autres épisodes de la guerre sociale :
John Zerzan, « Un conflit décisif. Les organisations syndicales combattent la révolte contre le travail », Échanges, 1975, republié in Rupture dans la théorie de la révolution. Textes 1965-1975, Senonevero, 2003. [si-si, Zerzan, celui-là même qui a viré débilo-primitiviste]
Martin Glaberman & Seymour Faber, Travailler pour la paie. Les racines de la révolte, Acratie, 2008.
Sur la situation contemporaine dans l’industrie automobile, lutte de classe comprise, des articles réguliers dans la revue Échanges, par ex. « République tchèque : l’industrie automobile moteur de l’accumulation du capital et des luttes de classes ? », n°118, 2006, ; « Exacerbation de la concurrence dans le secteur automobile mondial », n°119, 2006.
Nanni Balestrini, Nous voulons tout, le Seuil, 1973 [roman suivant le parcours d’un prolo du sud de l’Italie, monté taffer dans le nord industriel et se retrouvant activement pris dans la révolte ouvrière qui a sérieusement secoué Fiat et Turin en 1969]
Marcel Durand, Grain de sable sous le capot, Agone, 2006 [un ancien OS de Peugeot à Montbéliard raconte la vie à l’atelier]
Infos régulières sur des révoltes ouvrières et autres humeurs offensives dans le bulletin trimestriel Dans le monde une classe en lutte, sur les sites internet http://dndf.org/ ou http://cettesemaine.free.fr/spip/.
Quelques bouts du paysage contemporain : 750.000 salariés en France bossent directement ou indirectement pour la fabrication des bagnoles, 700.000 pour « l’usage » automobile (assureurs, garagistes, distribution carburants, etc.), 1 million dans le transport (routiers, construction des routes, flics, etc.). Plus de 60 millions de véhicules sont construits par an dans le monde.
Avec « ze crise », 8.000 ouvriers devraient dégager en 2009 en France, en plus de la disparition de la quasi-totalité des postes intérimaires. Mais bien sûr, les constructeurs français virent avant tout dans leurs usines étrangères : Brésil, Slovaquie, Espagne. Au niveau mondial on parle de trois millions d’emplois potentiellement supprimés. Sans parler de toutes les mesures de chômage partiel. Chez les équipementiers, les grèves se multiplient depuis l’automne 2008, bloquant régulièrement l’ensemble de la filière. Les 9 & 10 avril 2009, les salariés du sous-traitant Rencast détruisent la production destinée (en flux tendu) à Renault et PSA : les quelques tonnes de pièces mécaniques ont été remises au fourneau, hop hop.
Entre 2000 et 2007, 20.000 emplois avaient déjà été supprimés chez les constructeurs, 15.000 chez les équipementiers. Cela permet de relativiser ce qu’est « la crise » : c’est toujours la crise quand il s’agit de restructurer.
Il est par ailleurs notable que l’ensemble des « indicateurs » tend à révèler que, depuis dix ans, la conflictualité au travail a augmenté (après une baisse continue depuis les années 80) : tant ce que l’administration appelle les « journées individuelles non travaillées » pour ne pas dire « journées de grève », mais aussi le refus des heures sup, le débrayage, l’usage de la pétition, la manif, le recours aux prud’hommes, l’absentéisme (en 2005 en France, les 250 millions de journées non travaillées ont coûté 7 milliards d’euros)... Ce dont les « enquêtes » ne parlent que très peu : le recours au sabotage, la réapparition des pratiques du saccage et de la séquestration – et l’autonomisation face/contre les syndicats, ces éternels cogestionnaires de l’exploitation...
Et vive la sociale !
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (666.2 ko)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (2.4 Mo)