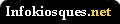P
Paranormal Tabou
et autres textes sur les violences intracommunautaires
mis en ligne le 27 avril 2015 - Collectif
PARANORMAL TABOU
Now that you’re out of my life I’m so much better
You thought that I’d be weak without you but I’m stronger
I know what you did. It makes me sick. I’m going to tell.
Ce texte écrit par l’unE d’entre nous a été anonymisé de façon à pouvoir être lu et utilisé par touTEs.
Celleux qui connaissent l’histoire (du moins une de ses versions) et celleux qui en font partie – si tant est que cette distinction ait un sens dans le cas présent – ne manqueront pas de reconnaître les
personnes, les lieux et les faits évoqués. Le texte leur est bien sûr destiné ; mais il a aussi vocation à
soulever dans nos milieux, dans nos communautés, des questions que nous jugeons importantes et urgentes. C’est la raison pour laquelle il nous a semblé crucial de le rendre semi-anonyme : il n’est
pas interdit d’essayer de se l’approprier...
Je suis Gaston et je brise le tabou. Ca fait
presque deux ans que j’ai rompu avec Pétunia.
Depuis ce temps, elle a beaucoup parlé, et
de « confidences » en « confidences », elle a
réussi à ce qu’une partie de la communauté
ne m’adresse plus la parole, ne me salue plus
en manif, m’enlève de ses amiEs Facebook,
à ce qu’on m’exclue de rencontres trans à
Taboulouse puis du bar La Menuiserie, dans la
ville où je vis, sans que personne, jusqu’à très
récemment, ne vienne me demander quoi que
ce soit. Que s’est-il passé entre Pétunia et moi ?
Manifestement, je suis la dernière personne
capable de répondre à cette question, puisque
l’on se passe volontiers de ma version pour
conclure (hâtivement ? arbitrairement ? non,
« féministement »...) que je suis un Agresseur et
elle une Victime. Est-il possible que cette catégorisation binaire se soit imposée si facilement parce que je suis trans Ft* et elle fem cisgenre ?
Parce que certainEs auraient pris l’habitude,
paresseuse intellectuellement et politiquement
dangereuse, de penser la violence comme
induisant nécessairement deux pôles (Agresseur,
Victime) constitués en identités fixes ? – Et à qui
revient-il alors de distribuer les rôles, sinon à la
personne qui parlera la première ? Est-il possible qu’il subsiste, dans nos milieux féministes et queer, quelque chose comme une essentialisation du féminin et du masculin ; se peut-il
aussi que certainEs oublient parfois de réfléchir pour suivre le vent où qu’il aille ? Qu’on n’hésite pas longtemps avant de mettre en œuvre l’exclusion d’une personne récemment arrivée dans le milieu, ignorant les conséquences sur sa vie sociale, communautaire, et militante, lorsqu’une autre proclame qu’il en va de sa « survie », et que cette autre dispose d’une petite cour d’admirateurs/trices toujours prêtEs à lui obéir ?
L’exclusion systématique et sans appel, nullement inscrite dans une quelconque démarche sur le long terme, alors même que je témoignais
d’une volonté de conciliation et de médiation.
Et pourquoi m’exclure ? Au fond, personne ne
savait. Bienvenue dans un monde « féministe »,
un monde où les choses ont du sens, bienvenue
dans les deux dernières années de ma vie.
2010-2012 : TRANSPHOBE
J’ai rencontré Pétunia en février 2010, je l’ai
quittée en mars 2011. Elle a été la première personne à me demander si je préférais qu’on me parle au féminin ou au masculin. Je suis tombé
amoureux d’elle en une nuit ; en une nuit elle
m’a appris que j’étais trans, elle m’a expliqué ce
que c’était que transitionner. Je ne savais pas
que c’était possible. Elle m’ouvre la porte d’un
nouveau monde ; et dès le lendemain je rencontre quelques unEs de ses amiEs trans.
Sous son contrôle, je change de pronom
(elle est là pour me corriger quand je me
« trompe » et laisse échapper quelque adjectif au féminin). Dès la première nuit passée ensemble, elle m’informe que « ce serait pratique pour [elle] si je portais un binder ». Je ne
sais pas ce que c’est un binder mais je n’ose
pas lui dire. (Heureusement, deux jours après
notre rencontre, elle m’emmène à la Bouffe
TPG, où Luke parle de son binder. Je ne sais
toujours pas comment acquérir la chose mais
au moins je sais de quoi elle parle. Il s’agit donc
de compresser mes seins sous un débardeur en
nylon ultra-serré pour ne pas trop la gêner.) Elle
m’explique que tel mec trans est moche depuis
qu’il prend de la testo (« T’en prendras pas, toi ?
Tu resteras beau.. »), tel autre nul parce qu’il n’a pas encore fait son coming out auprès de ses parents (« Et après il s’étonne que sa mère
l’appelle "ma puce"... ») : en quelques heures de
monologue elle définit pour moi les contours
de la transmasculinité acceptable, et moi je
n’en perds pas une goutte, fasciné. Ce premier
discours est suivi d’une centaine de rappels à
l’ordre dans les premiers mois de la relation.
Le discours le plus présent est un discours
anti-testo : apparemment son ex s’est mis à
marcher devant elle dans la rue dès lors qu’il a
commencé les hormones. J’intègre sans broncher cet interdit, comme l’injonction au binder.
Emerveillé d’avoir accès à toutes ces « informations », je ne me rends absolument pas compte
de ce qui est en train de se passer. Je ne vois
pas que le dispositif mis en place lui permet
de contrôler ma transition de part en part. Elle veille d’ailleurs à ce que je n’aie aucunE interlocutRICE trans : jamais je ne rencontre une
personne trans qui ne soit son amiE/amantE,
avec qui elle n’ait aucune histoire « compliquée ». (La première fois que ça m’est arrivé, c’était en juillet 2011, quelques mois après que
je l’ai quittée, et cette rencontre a marqué la
première étape de ma prise de distance vis à vis
du discours transphobe de Pétunia que j’avais
totalement intériorisé.) Parce que c’est elle qui
décide où je vais, où je ne vais pas. À qui je
parle, à qui je ne dois surtout pas parler. Elle
m’a prévenu « contre » certainEs personnes
de la communauté qui sont aujourd’hui mes
amiEs. Mais j’anticipe... Je n’en dirai pas plus ici sur la main-mise qu’elle avait sur ma transition et sur tous les trucs transphobes que je
l’ai entendue dire. C’est suffisamment humiliant.
Jamais je n’aurais eu l’idée de déballer tout ça
publiquement si Pétunia n’avait pas réussi à
m’exclure de certains espaces trans. Si les personnes par lesquelles je suis exclu depuis mai 2012 n’étaient pas TOUTES trans. Au nom d’un
« réflexe féministe » irréfléchi, artificiellement
plaqué sur une situation qui ne relève pas de la
grille d’analyse hétérosexuelle, une confrérie de
chevaliers trans tout dévoués à sa protection, à
sa « safety » comme ils m’ont dit, ont brisé toute
solidarité trans avec moi, acceptant une logique
sécuritaire et transphobe : réveillez-vous, bande
de galants ! Vous vous faites arnaquer...
En prenant le pouvoir sur ma transition,
Pétunia m’a rendu hyper vulnérable : je me
croyais le plus chanceux du monde, en réalité
j’étais à sa merci. Lecteur/trice, si tu es trans,
tu vois peut-être de quoi je parle, si tu es cisgenre, multiplie par 100 le degré d’emprise que
tu imagines dans ta tête. Et je ne connaissais
strictement personne dans la communauté. Il
était relativement facile pour elle de s’assurer
que je n’aurais accès à aucun discours autre
que le sien. D’ailleurs tous ces mécanismes de
contrôle ne sont nullement dissimulés. Pétunia
me dit limpidement qu’elle n’a pas envie que je
parle à telle personne, que j’aille à tel événement sans elle. J’obéis.
J’ai su plus tard qu’elle parlait à mes amiEs
de « notre transition », et de « notre opération ».
Aujourd’hui, ça me met hors de moi (Cisgenre,
multiplie la colère par 1000). Incapable de
dépasser la honte de m’être laissé traiter comme
ça, je n’en ai parlé à personne avant juin 2012.
J’avais envie d’en parler pendant les rencontres
trans à Taboulouse en mai 2012, mais Pétunia a
veillé à ce que j’en sois exclu – depuis notre rencontre jusqu’à maintenant, elle a tout fait pour empêcher que je communique avec des personnes trans. Aurait-elle des raisons d’avoir peur de
ce que je pourrais dire ? Aurait-elle des raisons
de craindre des alliances, des solidarités ? Ces alliances, elle a admirablement oeuvré pour les empêcher, prenons un moment pour apprécier comme elle n’a pas manqué de complices.
Merci les trans ? Je mets tout le monde dans le
même panier ? Ou Pétunia capture-t-elle tout le
monde avec le même filet... ?
La plupart des amiEs qui la « protègent »
sont des trans Ft*. La plupart de ses amiEs sont
en fait ses domestiques. Elle dispose d’elleux
comme bon lui semble – comme elle dispose
alors de moi : à cette époque, dans les premiers
temps de notre relation, je me retrouve à faire
les sous-titres d’un film pour elle (gratuitement),
ainsi que de nombreuses courses et autres « services » qu’elle exige de moi. Mais que ne ferais-je pas par amour... Et puis sa vie est si trépidante, il faut la comprendre, elle est une « star », elle a
des « fans », une vraie vie quoi... À côté moi, il ne
m’arrive pas grand chose, au fond. Je pourrais
aussi bien ne pas exister que le monde ne s’en
apercevrait peut-être même pas. Elle dit m’aimer,
m’adorer, moi je me sens comme un personnage
dans le film de sa vie, comme un être secondaire, dont la valeur est quasi-nulle comparée à la sienne. Ce sentiment structure très fortement notre relation depuis le début.
Cet ex qu’elle méprise tant, qu’elle a bombardé de transphobie (et d’homophobie) pendant les premières semaines de notre relation, et
auquel elle me compare en permanence, surtout
quand il s’agit de me dire quel trans je dois être
ou devenir, cet ex lui demande un jour de cesser
de lui écrire des mails. En effet, la veille, avant
de prendre un avion, elle a fait une crise de panique, et persuadée qu’elle allait mourir, elle nous a envoyé, à lui comme à moi, un mail qui nous annonce sa mort imminente, dans une sorte de poème en prose qu’elle nous demande « d’envoyer à des éditeurs/trices ». Sur le moment, je n’ai pas prêté attention à cet événement. Pourtant je me
rappelle la rage dans laquelle cette demande formulée par son ex (de ne plus lui écrire de mail) l’a plongée. À ma connaissance, elle n’a jamais arrêté de lui écrire des mails.
Bien sûr, elle n’a jamais pu me contrôler totalement. Quelquefois je ne me laissais pas faire, je la repoussais, je posais mes limites : c’était alors des « violences » que je « commettais ». Résister
à son emprise, c’était l’agresser. C’est ainsi qu’au
bout de quelques mois de relation, elle a commencé à m’accuser de « violences » (tour à tour sexuelles, psychologiques, physiques). En septembre 2010, elle fait de moi son Agresseur. Elle
commence à me dire que j’ai franchi ses limites
à plusieurs reprises pendant qu’on baisait. Je lui
présente immédiatement des excuses sincères et
lui propose qu’on en parle ensemble.
LOVE THE WAY YOU LIE
C’est comme ça qu’a commencé la destruction de mon propre sens de moi-même. Pétunia m’oblige à adhérer au mot près à la
fiction qu’elle a construite. J’obéis. À cette
période, n’ayant toujours pas réussi à nouer des
liens solides au sein de la communauté (c’était
impossible, Pétunia me surveillait 24/7), je me
débattais seul contre la transphobie massive
qui s’était déclenchée dans mon école après
mon coming out (j’habitais, j’habite toujours
à l’internat), tentant de mettre fin à des « amitiés » avec des personnes qui me conseillaient de ne pas « mutiler mon corps de femme » alors que je voulais me faire opérer du torse... Il était
impensable pour moi de nier le « ressenti » de
quelqu’unE qui disait avoir « subi » des violences. Le piège se referme sur moi. J’intègre l’identité d’Agresseur comme une composante
essentielle de ma subjectivité.
Pétunia parle de moi comme d’une « personne masculine » et se définit elle-même comme une « personne féminine ». Par conséquent, je la « domine » – et il se trouve que
quand on baise, c’est moi qui la frappe, la pince,
la mords, l’insulte.. : tout ce qu’elle a demandé
depuis le début de notre relation, ce qu’elle
a dit aimer, adorer de février à septembre est
re-qualifié de « violences sexuelles », parce que
le BDSM serait d’après elle une « domination
structurelle ». (Bien sûr, je ne l’ai jamais entendue assumer de telles positions publiquement .) Reviennent sans cesse dans son vocabulaire : la dichotomie Agresseur/Victime, les Violences et
le verbe Subir. On n’en sort pas, et pour cause : ce discours est conçu pour m’empêcher d’exister. Face à ses accusations, je ne peux que me
taire, m’excuser. Quand j’essaie de riposter, de
formuler qu’il est injuste de qualifier ce qu’elle
me reproche de « violences sexuelles », elle
enrage, menace de « révéler » aux amiEs féministes de mon école que je suis un « Agresseur ».
Ces menaces achèvent de me rendre fou. Je
parviens de moins en moins à penser par moi-même quelque chose de moi-même : Pétunia est devenue ma (mauvaise) conscience. Elle
ne parle jamais de mettre fin à la relation. Elle
m’ordonne de « réparer ». De la réparer elle,
parce qu’elle a perdu pied peu à peu. Elle me
fait peur. Je continue à lui obéir. Je dois « regagner [sa] confiance », ce qui implique en premier lieu : cesser de vivre ma propre vie. Ne jamais
rien lui refuser. Lui appartenir absolument.
Psychologiquement brisé, amoureux, sous
emprise, j’ai passé deux ans à me creuser le
cerveau, à remuer mes souvenirs, à m’excuser
encore et encore des « violences » que j’étais censé avoir commises, deux ans à ne pas savoir quoi penser de moi-même, à m’isoler peu à peu de certainEs amiEs parce que je n’arrivais pas
à leur parler, sous prétexte que je ne devais pas
« nier son ressenti ». Mieux valait, apparemment,
nier ce que je savais être la vérité, au risque de
disjoncter, coincé dans un état mental et émotionnel paradoxal, où ce qui s’est passé ne s’est
pas passé – puisque c’est ce que Pétunia ressent
qui s’est passé. Dire « elle ment » faisait de moi
un monstre : ça, j’étais le premier à le penser.
Alors que j’accepte d’être « coupable »,
d’avoir commis ces violences, que je m’en excusais chaque jour, Pétunia avait pris le contrôle de ma vie. Je ne pouvais rien faire qui ne soit « violent » pour elle. Passer du temps avec mon frère ?
C’était une façon de lui faire comprendre que je
ne l’aimais plus. Avoir des amiEs ? Même chose.
Aller en cours ? Je la « négligeais ». Lui demander de partir de chez moi ? « Violence ». Toucher un journal dans son appartement sans lui avoir demandé la permission ? « Violence sexuelle » (Oui oui !) Fonder avec des copines un collectif féministe dans mon école, et commencer à
répondre par l’autodéfense aux attaques sexistes
et transphobes qui s’y multiplient ? Ce n’est pas
« légitime » puisque je suis un Agresseur. Tout ce
que je fais sans qu’elle l’ait voulu est « violent » : m’endormir avant elle est violent. D’accusation en accusation, de crise en crise, je me retrouve complètement emprisonné dans une relation
dont je ne veux plus et dont je ne suis pas capable de m’extraire, parce qu’elle m’en empêche. Chantage au suicide, pression continuelle, accusations de plus en plus graves, envahissement de
mon espace, prise de pouvoir sur tous les aspects
de ma vie, y compris mes relations amicales,
mes études (arrêtées pendant deux ans), ma transition, ma façon de dépenser mon argent, mes lectures, les mots que j’utilisais, les tatouages que je (ne) me faisais (pas), mes projets personnels,
militants, professionnels, et autres : rien ne m’appartient plus. Plusieurs fois j’essaye de mettre fin à la relation ; il en est tout simplement « hors de question ». Elle vient alors chez moi en pleine
nuit, m’appelle 52 fois en une soirée, menace
encore de se buter ; et tout ça c’est de ma faute,
puisque c’est moi qui ai « commis des violences ». Bien sûr, il arrive qu’elle se montre calme, conciliante, prête à m’écouter – en particulier
quand nous ne sommes pas seulEs. Elle reconnaît alors que quelque chose ne va pas, qu’elle est « trop possessive », elle promet de faire des efforts. Je me fais croire dans ces moments qu’il
y a encore une chance pour que ça s’arrête. Mais
ça recommence toujours. Chaque fois plus vite
que la fois précédente. Je suis à bout de nerfs.
Pendant ce temps, j’ai fait mon coming-out
dans ma famille et ça s’est extrêmement mal
passé. Le seul qui continue à me voir (bravant l’interdiction de mes parents), mon petit frère, Pétunia le considère comme transphobe parce qu’il m’appelle sa sœur, ce dont je me fous éperdument. Elle
s’arrange tout de même pour le séduire, parce
qu’elle a compris qu’elle ne pourrait pas m’en
séparer. Elle me dit souvent qu’elle est jalouse de
la relation que j’ai avec lui – nous sommes très
proches -, tout comme elle est jalouse des gens
(et parfois des livres) que j’aime.
J’ai décidé de me faire opérer en avril.
Pétunia ne supporte pas que je conçoive ce projet
comme le mien : elle a son mot à dire sur tout, la
date, le choix de la chirurgienne, les personnes
auxquelles j’en parle. Elle corrige mes mails en
anglais sans que je lui demande quoi que ce soit,
et m’oblige à décaler l’opération d’une semaine,
afin que la date convienne à son agenda personnel. Les crises sont quotidiennes et son pouvoir sur moi a atteint un degré d’absurde qui ne fait pas sens, même pour moi, et même en connaissant le contexte : je dois lui donner une bonne raison pour qu’elle m’autorise à lui lâcher la main au cinéma ; je dois lui faire un câlin le matin avant
d’aller pisser ; elle me suit plusieurs fois dans la
rue, se cache dans les toilettes de mon internat
pendant des heures en m’envoyant des textos.
Elle m’empêche de dormir la nuit. Notre relation
est une suite sans fin de conversations improbables - où elle soutient que si je fais les courses et la cuisine pour nous deux depuis près d’un an, c’est bien le signe que je la « domine », que je l’« incapacite » (et c’est parti pour un petit coup de safe et de triggering [1]), où elle affirme qu’il est violent pour elle de m’entendre parler de mon frère étant donnée la relation qu’elle entretient avec le
sien... Ces conversations, et ses « crises » de plus
en plus fréquentes, sont entrecoupées encore de
moments d’accalmie, de « bonheur » insensé...
Ces moments se font de plus en plus rares, mais
je les vis si intensément qu’il m’est alors impossible de les voir pour ce qu’ils sont : l’autre versant du dispositif de contrôle, la petite friandise occasionnelle qui parachève l’emprise de Pétunia sur
ma vie. Je donnerais n’importe quoi pour un de
ces petits moments... Pour que cela dure un peu
plus longtemps la fois prochaine... Je m’y accroche désespérément. Mais les nerfs me rattrapent. Avec le recul je vois quelle était sa maîtrise de la situation : la parenthèse merveilleuse arrivait
systématiquement au moment où je n’en pouvais presque plus, au moment où j’allais craquer, exploser, partir. Mais je reste, elle me retient
toujours. Elle a toutes les techniques pour me retenir. À ce moment il ne se passe absolument rien d’autre dans ma vie : je n’ai tout simplement pas de vie en dehors de Pétunia.
LA « MÉDIATION »
Un jour, j’arrive à obtenir que nous passions une semaine sans nous voir. À la fin de la semaine j’ai rassemblé assez de forces pour
arrêter la relation. J’ai pris une décision difficile : je ne veux plus qu’elle m’accompagne aux Etats-Unis pour mon opération. Les billets d’avion
sont pris depuis longtemps, mais peu importe : je ne veux plus qu’elle vienne. J’en suis sûr. La peur au ventre, je me prépare à le lui annoncer. Mais au moment de se voir, elle me propose une
« médiation » pour discuter des « violences que
j’ai commises », avec deux de ses amiEs. Ce sont
des personnes que j’apprécie, Bob et Bonnie, je
leur fais plutôt confiance et je me dis que leur
présence évitera peut-être la crise que je redoute.
Je me rends donc à cette « médiation » plein
d’espoir. Je veux en finir, retrouver tout ce dont
elle m’a dépossédé. Cette fois, c’est la bonne...
Hélas, la « médiation » est une grosse blague.
Pétunia déballe des accusations sans queue ni
tête, elle raconte absolument n’importe quoi,
invente des histoires, en déforme d’autres.
Lorsque je rétorque que ce n’est pas la réalité,
ses amiEs me demandent gentiment de fermer
ma gueule. Ainsi, je suis accusé de violence
physique parce qu’un jour, alors qu’elle ne voulait pas partir de chez moi et restait dans mon lit depuis 72 heures, je l’ai physiquement foutue dehors, ainsi que ses affaires. Cependant Pétunia
ne dit pas que je lui avais demandé de partir, elle
ne dit pas non plus que c’est un schéma récurrent dans notre relation depuis des mois (elle ne part jamais quand nous avions convenu qu’elle partirait, mais plusieurs heures ou plusieurs jours
après, une fois qu’elle m’a poussé à bout) : elle
raconte simplement que je l’ai « brutalisée », « violentée ». Tout est dé-contextualisé, ce qui est « vrai » est habilement sélectionné dans le réel de façon à ce que je passe pour un être dangereux et
agressif, et à ce que soit passé sous silence tout
ce qui permettrait d’identifier ses propres comportements comme des comportements abusifs et violents. Manifestement ses amiEs n’y voient
que du feu. Pourtant j’explique, entre deux sanglots, que Pétunia distord la réalité, que c’est une manipulation : ielles me demandent à nouveau de me taire, visiblement choquéEs.
Problème du discours qu’elle a construit : elle ne souhaite pas que la relation s’arrête, alors que j’en ai exprimé clairement le désir
dès les premières minutes de la « médiation ».
Apparemment ses amiEs sont assez à la masse
pour ne pas y voir une contradiction, ou même
le signe qu’elle est en train de se foutre de leur
(notre) gueule. À la masse, ou sous emprise ?
Toujours est-il que nos « médiatRICEs » acceptent
que Pétunia puisse me parler seule à seul : elle
se met à pleurer, me supplie de ne pas la quitter,
et je ne parviens pas à maintenir ma décision.
Je lâche l’affaire. À ce moment Bob est parti,
Bonnie est encore là, à quelques mètres de nous.
Pétunia lui adresse un large sourire. Elle annonce
à Bonnie que j’ai changé d’avis : finalement, je
ne la quitte pas. Elles se font un long câlin, j’ai
le temps de penser à partir en courant. On prend
le métro pour rentrer chez moi... Et tout recommence. Merci la « médiation ». Qui n’a servi qu’à une chose : m’empêcher de quitter Pétunia.
RUPTURE
Quelques jours plus tard, j’arrive enfin à la
quitter pour de bon. Enfin, pour de bon.. Elle
continue à venir chez moi, à m’écrire, m’appeler. Elle s’introduit plusieurs fois dans mon école, soi-disant pour utiliser internet (elle
connaît mes codes et continue à les utiliser
malgré mon désaccord). Elle me fait croire que
j’ai l’obligation, en tant qu’Agresseur bien sûr,
d’avoir telle et telle conversation avec elle.
Ça ne mène à rien. Elle tente de nouveaux
chantages, m’annonce limpidement qu’elle
m’espionne, qu’elle a des « soupçons » quant à
ma vie sexuelle (en particulier, la hantise que
je devienne pédé – hantise exprimée de façon
récurrente, et qu’elle avait aussi avec son ex).
Je suis encore complètement amoureux d’elle,
et encore sous emprise. Je ne m’en dégage que
très lentement, on continue à se voir.
Elle m’appelle à l’aide tous les jours, m’envoie des textos d’amour haineux, menace de se jeter par la fenêtre. « Je vais me tuer, te tuer ou me convertir à l’islam. » No comment. Je viens
la voir dans son appartement, dont elle ne sort
plus. Plusieurs de ses amis, des trans Ft*, font
la même chose. On n’y est jamais ensemble.
Il faut la nourrir, s’occuper d’elle. J’obéis. Elle
me rend responsable de son état, m’accuse de
l’avoir détruite, tout en réclamant ma présence
à ses côtés. Elle appelle « violence » tout mot
qui sort de ma bouche. Je pleure tout le temps
quand je suis avec elle. Il me faut du temps pour
me sortir ses accusations de la tête quand je
finis par partir. Et puis de moins en moins de
temps. Un jour elle fait une crise de tremblements dans la baignoire, et pris de panique j’appelle une de mes amies qui n’habite pas
très loin. Celle-ci arrive en moins de dix minutes : Pétunia l’accueille tout sourire, et nous passons une très agréable soirée. En moins
d’une minute, elle s’est métamorphosée, elle ne montre plus une extrême vulnérabilité mais un visage serein, lumineux, épanoui. Je n’y comprends rien mais je suis si heureux de la voir
comme ça. À peine mon amie partie, ça recommence. Elle me reproche d’avoir appelé mon amie, et à peu près tout ce que j’ai dit ou fait
pendant la soirée. Ce soir-là je ne parviens pas à
partir, elle m’oblige à passer la nuit avec elle, et
m’empêche de dormir. Le lendemain elle essaie
de m’empêcher de partir, elle pleure, supplie. Ça arrive encore souvent. Je ne m’arrache de chez elle qu’avec difficulté.
Elle insiste pour qu’on regarde ensemble une vidéo porno de nous, tournée deux mois avant la rupture (c’est la dernière fois qu’on a baisé). Je refuse. C’est une scène BDSM. Je l’ai tournée sans m’en sentir vraiment capable, Pétunia m’a convaincu que c’était la seule solution. Pendant le tournage, j’ai franchi une limite : je
lui ai demandé deux fois si elle voulait que je la
frappe au visage. On avait prévu ensemble que
je lui poserais la question à un moment précis.
Ce que je fais. Elle dit non. J’insiste en reposant
la question : « Tu es sûre ? » J’entends alors un
feu vert : « Vas-y ». Je donne le coup. Trop fort.
Elle me dit tout de suite que ça ne va pas, je
m’excuse sur le champ et je demande à ce qu’on
arrête la scène. Elle m’oblige à finir la scène.
C’est cet événement qu’elle qualifie d’agression sexuelle : le fait de lui avoir demandé deux fois si elle voulait que je la frappe au visage,
de sorte que son premier « non » n’a pas été
entendu, et que le coup était donc de trop. Le
seul contenu qu’elle m’ait jamais donné. À part
bien sûr le fait que « le BDSM est une domination structurelle », ce qui lui permet de re-définir comme des « abus sexuels » presque tout ce qui s’est passé entre nous sexuellement : claques,
morsures, insultes, jeux de rôle, etc. Pourtant, si
j’ai pu franchir des limites – et il est certain que j’en ai franchi -, je n’ai jamais demandé à baiser alors qu’elle n’avait pas envie. Pas une seule
fois. Elle m’en faisait d’ailleurs le reproche, et
elle pouvait insister longtemps pour qu’on baise
quand je ne voulais pas. Et elle se plaignait
très souvent que je ne la baisais pas assez, y
compris après qu’elle a commencé à m’accuser
de violences sexuelles. Donc quand elle tente
de m’obliger, après la rupture, de regarder la
scène avec elle, je refuse. Et cette fois je résiste
jusqu’au bout. Elle qualifie mon refus de « violence sexuelle ». La boucle est bouclée ? Je suis un Agresseur donc je suis un Agresseur. Quoi que je fasse, quoi que je dise. Et si je ne la baise
pas, c’est parce que je « deviens pédé comme
son ex » ? Je n’ai jamais vu la vidéo, Pétunia
ne m’ayant jamais donné les codes d’accès et
insistant pour que nous la regardions nécessairement ensemble, ce que je ne souhaitais pas. Mais je sais qu’elle l’a montrée à certainEs de
ses amiEs. Sans leur dire qu’elle m’affirmait, à
moi, qu’il s’agissait d’une « agression sexuelle » : pas d’un dérapage de baise ou d’un franchissement de limite, mais bien d’une « agression
sexuelle ». Elle leur disait simplement que je la
baisais bien, que j’étais « son meilleur top ». Fou
rire nerveux ? Toujours pas ? J’ajoute ici qu’en
termes de rupture de contrat relativement aux
scènes porno, Pétunia n’a pas du tout tenu
compte, depuis la rupture, de ce dont nous
avions convenu ensemble pendant la relation
concernant la diffusion des vidéos en question.
En avril 2011, je vais me faire opérer aux
Etats-Unis. Pétunia est dans l’avion puisque nous
avions pris les billets ensemble. Assise à côté de
moi, elle m’accable de reproches pendant des
heures. Je suis complètement tétanisé. À l’aéroport, nos chemins se séparent. Les jours suivants, elle essaie de savoir où je loge en contactant mes amiEs restéEs en France, mais celleux-ci ne lui donnent aucune information. Elle ne me trouve
pas. Je me fais opérer sans elle.
De retour en France, la situation a empiré. Le
chantage au suicide s’intensifie. Régulièrement,
elle m’appelle en pleine nuit, je grimpe sur un
Vél’Hippo et je fonce chez elle. Mai, juin. Le
temps passe. Je l’aime toujours. D’autant que je
me suis échappé de la relation dans ce qu’elle
avait de plus étouffant. Loin d’elle, je me fais
toujours croire que ça pourrait s’arranger, et je
lui dépose des cadeaux dans sa boîte aux lettres. Je pense tout le temps à elle. On se voit un peu. Elle inspecte à chaque fois mes mains,
mes bras, à la recherche de nouveaux tatouages
(je ne suis pas censé en faire). Elle invente aussi
des théories sur le deuil qu’elle doit faire de mon
ancien corps, de mon ancien torse. Elle parle
d’écrire un bouquin là-dessus. De mon côté, je
continue à m’excuser pour les « violences » que
j’ai « commises ». Elle s’oppose à ce que j’aille
aux rencontres transbipédégouines de Seymar
en juillet, parce qu’ « elle ne sera pas là pour me
surveiller ». J’y vais quand même. J’y rencontre
pour la première fois de ma vie des personnes
trans qui n’ont aucune relation avec Pétunia.
En septembre 2011, je suis un peu moins sous
son emprise, les choses commencent à bouger
dans ma tête. Ça prend du temps. Je parle un
peu de la relation, à quelques amiEs bien choisiEs. Plusieurs rencontres me permettent de commencer à relativiser la place de Pétunia dans les milieux féministes/queer, de me détacher un peu de l’image qu’elle a construite - en particulier sur internet, puisqu’elle est la reine des réseaux sociaux : c’est de cette façon que
je l’ai connue en 2010, c’est comme ça qu’ont
commencé mon admiration, ma fascination et
mon amour pour elle. Sauf qu’en vrai, elle n’est
pas la reine du féminisme... Quoi qu’en pensent celleux qui la suivent, la servent, et mangent du pain dans sa main, comme je le faisais moi-même il n’y a pas si longtemps.
En septembre 2011, je reçois « par erreur » des textos de cul destinés à ses amants. On se voit de moins en moins. Chantage au suicide,
menaces de mort... Un jour elle me dit qu’elle
voudrait « m’enchaîner au fond de l’océan,
pour que personne ne m’aime et que je n’aime
personne ». C’est le genre de choses qu’elle
exprime constamment : elle ne supporte pas
l’idée que je puisse construire des relations avec
d’autres personnes, quelles qu’elles soient. Elle
m’espionne sur Facebook, surveille tout ce que
je fais, m’accuse d’être devenu pédé quand une
photo apparaît sur mon mur : je suis sur la plage
avec un ami. « Tu m’humilies, tu fais du public sex », me dit-elle. On passe Noël 2011 ensemble, chez elle, avec sa famille. Elle profite de
ma vulnérabilité (je suis encore en rupture
avec ma famille qui fête Noël sans moi) pour
me contraindre à lui en être reconnaissant. Le
lendemain de Noël, elle me dit qu’elle ne veut
plus me voir. Tant que je n’aurais pas « travaillé
sur moi-même », et « réfléchi aux violences que
j’ai commises », il est trop douloureux pour elle
de maintenir cette relation. Pour la première
fois, c’est elle qui demande à ce qu’on s’éloigne. Ça me fait un choc. Au début je suis très déprimé mais au bout de quelques semaines
je commence à respirer plus librement que je
n’ai respiré depuis deux ans ; je vois de nouvelles personnes qui n’ont rien à voir avec elle. Je sens quelque chose se défaire, mais encore trop lentement. C’est la période où je commence à
remarquer que je ne suis jamais sûr de savoir si
c’est moi ou Pétunia qui pense dans ma tête.
En février 2012, elle me renvoie tous les
textos que je lui ai envoyés en février 2010, à
chaque fois le même jour, à la même heure.
Les textos se terminent par un ajout : « JE TE
HAIS ». Elle recommence à m’appeler la nuit,
des dizaines de fois d’affilée. Un jour, je reçois
un message de Geneviève, une personne avec
qui j’ai eu une relation deux ans auparavant, que
Pétunia n’a jamais connue : elle a reçu des menaces de mort sur internet, et devine qu’il s’agit d’une personne qui me connaît.. Parce que les messages parlent de moi. Geneviève m’envoie des captures d’écran. Je suis terrifié. Pétunia lui a envoyé un message par heure pendant une semaine. Elle dit qu’elle me hait, que ma voix
résonne dans sa tête et qu’elle voudrait me tuer,
tuer Geneviève. J’appelle Pétunia qui confirme
qu’elle est l’auteure de ce harcèlement. Quand
j’exprime en sanglotant la crainte qu’elle ne s’en
prenne réellement à quelqu’unE que j’aime, elle
me dit que je « mérite le pire ». J’appelle mon
petit frère, je lui interdis de répondre à Pétunia
si elle l’appelle. J’ai peur qu’elle le prenne pour
cible parce qu’illes ont une relation un peu ambiguë. L’été 2010, pendant mon absence, illes se sont vus touTEs les deux. Pétunia a demandé à mon frère de lui montrer les mails qu’il recevait
de moi. Il n’a pas pensé à refuser. Elle lui a fait
une crise de jalousie parce que j’avais dû écrire
à mon frère « je t’aime plus que tout ». Amusé,
mon frère m’a raconté cet épisode dans son
mail suivant.
À partir du mois de février, on ne se voit plus.
Je ne réponds plus à ses appels. Ça me coûte
énormément. Mais je tiens bon. Elle m’envoie
des textos à chaque fois qu’elle rêve de moi.
On se croise deux fois en manif. Lentement, je
retrouve la capacité à penser à partir de moi-même et de mes propres souvenirs. Je me dis toujours que je l’aime. Je n’arrive pas vraiment à penser ma vie en dehors d’elle. Mais en mars 2012, je commence une relation avec quelqu’unE. Cette personne est totalement extérieure à la communauté. Avant de baiser, je me sens obligé de lui dire que « mon ex m’accuse de violences sexuelles », sous la forme d’un Terrible
Secret gravissime et indicible. Contrairement à ce que je craignais, cette « confession » ne change rien entre nous. Je me sens un peu
ridicule avec mon Terrible Tabou, et ça me fait
du bien. Je commence à en parler autour de
moi. Aux copines du collectif féministe de mon
école, dont je redoutais plus que tout la réaction – parce que Pétunia avait menacé tant de fois de leur « révéler » que « j’étais un agresseur
sexuel ». À ma grande surprise, elles ne me
regardent pas différemment. Comme si j’étais le
même qu’avant ? Moi, l’Agresseur ?
EXCLUSIONS : LE PRIVÉ EST PRIVÉ, LE LOCAL EST
LOCAL, LE FÉMINISME À LA POUBELLE ?
Mai 2012 : ce sont les rencontres trans à
Taboulouse. J’y vais avec un copain, en stop.
Sur le chemin, le copain parle au téléphone avec
l’une des personnes du TGV, le squatt où ont lieu
les rencontres trans. Il dit qu’il est avec moi et je
sens que ça pose un problème. Ne sachant pas
que c’était nécessaire, je n’ai pas prévenu de mon
arrivée.. Le copain m’informe qu’ « il n’y a plus
de place au TGV ». Je préviens alors mon grand
frère, qui habite Taboulouse ; celui-ci peut m’accueillir. Ça me fait bien chier d’aller chez cet être insupportable mais bon, « il n’y a plus de place au TGV » (énoncé absurde pour qui connaît le
TGV). Sauf qu’on arrive à Taboulouse à 3 heures
du matin, beaucoup trop tard pour déranger mon frère, et qu’on finit par atterrir tous les deux au TGV, où bien sûr il y a de la place pour dormir. C’est louche, mais je ne soupçonne pas du tout
que ces circonstances ont un lien avec les accusations de Pétunia : à ce moment, j’ignore encore qu’elles se sont propagées. L’accueil est glacial. Je m’endors comme une bûche et au réveil,
je me demande bien pourquoi tout le monde
m’ignore (à l’exception de deux ou trois personnes inconnues qui me saluent). Je fume clope sur clope en attendant que les ateliers commencent, les conversations s’arrêtent quand je m’approche, je me sens de plus en plus mal et j’envisage de partir, mais je sais que Luke et Jerry doivent arriver (ce qui constitue alors une perspective
réjouissante). Luke se pointe enfin, je lui dis bonjour, il me répond à peine. Toujours à mille lieues de comprendre la situation, je me dis qu’il est vénère contre quelque chose, mais quoi ? Quand
il repasse devant moi, je lui demande donc « ça va ? ». Enfin, il m’explique ce qui se passe :
« – On va pas te parler, tu sais.
- Pourquoi ?
- Tu sais pourquoi.
- À cause de Pétunia ?
- À cause de ce que tu as fait à Pétunia. Mais tu es le bienvenu ici. »
Il m’a parlé comme à de la merde. En me
regardant comme de la merde. Et en m’accusant implicitement – mais de quoi ? Je ne le saurai jamais. Il ne le sait pas lui-même, probablement. Un amant de Pétunia, hypnotisé par ses mensonges, fait de moi de la merde en m’empêchant de parler. Parce que bien sûr illes baisent ensemble ! Pour autant ce schéma ne lui rappelle rien ?
Bizarrement, je ne me suis pas senti particulièrement « bienvenu » dans cet espace, et j’ai pris le premier train pour ma ville. Chose étrange, dans le train je reçois un texto de Luke déplorant
mon départ, avec un lapsus énorme : il écrit « cet espace est aussi le sien ». Toujours chialant, je lui envoie un message que j’ai encore du mal à digérer aujourd’hui, et j’en viens à m’excuser
d’être venu à Taboulouse (dans cet espace trans qui clairement ne m’appartenait pas autant qu’à Pétunia..). J’écris une ânerie comme « je suis désolé de n’avoir pas pris la responsabilité des
violences que j’ai commises », répétant mot
pour mot ce que disait Pétunia. Et j’y croyais,
tellement j’étais embourbé dans la prison de
merde qu’elle avait construite autour de moi. Et
comment aurais-je pu ne pas y croire, puisque
touTEs les autres y croyaient ?
C’était avant de découvrir qu’il y avait encore
d’autres « autres », et même des autres que
Pétunia n’impressionne nullement, des autres
sceptiques qui ne lui font pas confiance a priori
quand elle accuse un transboy de violences
sexuelles... En rentrant dans ma ville, je ne dis
presque rien à personne, et je m’enferme dans
un tabou mental qui recommence à me bouffer
la vie. Je me demande comment réparer « le
Mal que j’ai fait ». Je ne cesse de chialer sur mon
Vél’Hippo. Je comprends qu’il n’y aura pas de
répit. Je suis entaché. C’est fini pour ma gueule.
Quelques semaines plus tard, on m’invite
à rejoindre un groupe Facebook qui annonce
l’ouverture d’un bar, La Menuiserie, et demande
de l’aide pour les travaux. Puis, je suis exclu du
groupe Facebook. Intrigué par ce petit manège,
je demande des explications au créateur du
groupe et futur patron du bar, qui n’est autre
que Bob, de la « médiation ». Il me répond
que Pétunia a été « très claire » à ce sujet : je
ne dois pas me pointer pendant les travaux.
Ce qui permet à Pétunia d’être « très claire »
(outre l’emprise évidente exercée sur Bob), c’est
qu’elle est très impliquée dans le projet depuis le
début. Je suis un peu surpris que Bob me parle
comme ça, parce qu’à peine quelques semaines
auparavant on prenait des cafés ensemble. De
nouveau, je n’ai droit à aucune solidarité trans,
et ne suis considéré que comme une « personne
masculine » agressive, violente, à exclure. Ainsi,
Pétunia ne m’aura pas dans les pattes (pratique,
pour continuer les « confidences »), et en même
temps, elle veille à ce que le lien entre nous perdure. M’exclure c’est continuer à me contrôler.
Evidence qui n’avait pas encore fait son chemin
jusqu’à mon cerveau grippé !
Un jour de juin, je suis avec des copain/ines féministes, dont des vieilles tortues (sans vouloir les stigmatiser), qui n’ont pas juré allégeance à Pétunia et qui ont bonne mémoire.
Apprenant mon exclusion de La Menuiserie, et
les accusations de Pétunia, ielles proposent que
l’on se réunisse pour en parler. Quelques jours
plus tard, c’est mon grand coming out en tant
qu’Agresseur dans le salon d’une des tortues. Là
encore, mon Indicible Tabou ne semble pas les
troubler outre mesure. Ces tortues en ont-elles
vu d’autres ? Ou les faits que je raconte sont-ils si
peu traumatisants, que je suis bien le seul à les
prendre au sérieux en tant qu’« agressions » ?
Ce qui fait réagir les tortues, c’est plutôt ce
que je dis sur Pétunia ; ensemble on commence
à mettre au jour tous les mécanismes de pouvoir qu’elle a installés.
TORTUES
Alors que je raconte une des deux situations
que Pétunia a qualifiées de « violences physiques », l’une des tortues me dit : « tu étais dans une situation d’autodéfense ». Ici je vais être très précis. Pétunia a cité, pendant la « médiation » avec Bob et Bonnie, deux situations où elle considère que j’ai commis des « violences physiques ».
Première situation : Pétunia est chez moi
depuis plusieurs jours alors que je lui ai demandé
de partir. Elle utilise toutes formes de pressions
pour rester. À chaque fois, « nous » convenons
d’un moment où elle partira. Puis, elle fait une
nouvelle crise et refuse de partir. Je suis coincé
avec elle dans ma chambre d’internat. Cette
situation s’est déjà produite de nombreuses fois.
Son argument récurrent : je n’ai « rien à faire »
chez moi, donc l’envie d’être seul signifie que je
ne l’aime plus. Cette fois-ci, à bout de nerfs, je
l’attrape (elle est sur mon lit, dont elle ne bouge
pas) et je la fous dehors, en hurlant « mais casse-toi, fous le camp, merde, casse-toi ». Elle se débat, essayant de rester dans la chambre,
on tombe ensemble sur le lit, je me relève le
premier, je la plaque sur le lit pour mieux l’attraper puis je la pousse dehors. J’ai clairement le dessus dans la lutte physique qui nous oppose. Elle me frappe et elle me griffe mais globalement je n’ai pas de mal à expulser son corps
hors de ma chambre. Je referme la porte derrière elle. Puis j’attrape ses affaires, je rouvre la
porte et je les balance dans le couloir.
Deuxième situation : je suis chez Pétunia et
je souhaite partir, elle n’est pas d’accord pour
que je parte. Elle se place dans l’encadrement
de la porte pour m’empêcher de passer. À ce
moment-là de notre relation, elle m’accuse déjà
de « violences » et je me considère déjà comme
son « Agresseur ». J’essaie de passer la porte et
j’y parviens. Je me lance à toute vitesse dans
l’escalier (Pétunia habite au sixième étage).
Pétunia se jette sur mon dos, s’accroche à moi.
Je la décroche et je la repousse, elle tombe par terre. Je continue à descendre les escaliers. Pétunia court derrière moi, et à nouveau elle
se jette sur moi, à nouveau je la repousse. Je
sors de l’immeuble. Je cours dans la rue. Je
l’entends crier derrière moi « Gaston, reviens,
j’ai pas mes clefs ! ». Je m’arrête. Je reprends
mon souffle. Je comprends qu’elle s’est enfermée dehors. Il fait nuit, elle n’a peut-être même pas son portable sur elle. Je reviens lentement
vers elle. Je lui tends mon portable sans rien
dire. Elle le prend, elle me dit qu’elle appelle
Bob. La première chose qu’elle lui dit (d’une
voix toute tremblante, qu’elle n’avait pas l’instant d’avant) : « Gaston vient d’être violent avec moi ». J’attends qu’elle ait fini sa conversation, je reprends mon portable et je me casse.
Pendant la poursuite dans l’escalier, ses lunettes ont perdu une branche. Pendant des mois et des mois, Pétunia continuera de porter ses lunettes cassées. Nombreuses ont été les personnes qui le lui ont fait remarquer, ou qui lui ont demandé ce qui s’était passé. Pétunia dira
qu’elle s’est faite agresser, qu’elle ne veut pas
en parler.
Le fait que Pétunia considère ces deux
situations comme des « violences physiques »
signifie donc que je ne devrais pas me défendre quand elle m’agresse, en demeurant dans mon espace contre ma volonté, ou en se jetant
sur mon dos. Cela signifie que pour elle, je ne
suis pas un sujet, je n’existe pas comme une
autre personne en face d’elle. Que pour elle, je
n’ai pas de limites, je suis entièrement soumis
à son pouvoir qui devrait s’exercer de manière
illimitée, sans jamais rencontrer la moindre
résistance. Voilà exactement ce qu’elle m’a fait
croire : quand j’existe comme un être indépendant d’elle, comme un être libre, je l’agresse. Elle justifiait cette inégalité de valeur et de liberté entre nous par le fait que j’étais une « personne
masculine » et elle une « personne féminine ».
J’avais tellement bien intériorisé son système
de pensée que je culpabilisais à l’infini chaque
fois que je lui criais dessus, chaque fois que je
faisais un geste trop brusque, et lorsqu’il m’arrivait de taper dans un meuble lors d’une dispute, j’y pensais pendant une semaine : comment
me purger de cette « violence masculine » qui
m’habite ? Comment faire pour en préserver
Pétunia ? Pendant ce temps, de son côté, la
violence n’avait aucune limite. Quand elle me
disait que je méritais le pire, qu’elle souhaitait que je meure, et qu’elle voulait me tuer, je pensais recueillir les fruits de la violence que
j’avais semée, et je culpabilisais encore plus. Il
n’y avait aucune issue tant qu’elle imposait les
catégories dans lesquelles je devais penser la
situation (Victime/Agresseur ; personne féminine/personne masculine), comme elle avait imposé les cadres dans lesquels je devais
penser ma transition.
Alors que je répète niaisement ce que m’a dit Pétunia sur la non-hiérarchisation des violences et le critère du « ressenti des dominéEs », une tortue me dit : « il faut hiérarchiser les violences ». Là encore, je serai très précis. Quand
Pétunia dit que je fais (ou dis) quelque chose
« sans son consentement », elle ne veut pas dire
que je fais (ou dis) quelque chose après qu’elle
m’aurait demandé de ne pas le faire (ou dire),
mais que je fais (ou dis) quelque chose sans
lui avoir demandé si elle voulait bien que je le
fasse (ou dise). Ainsi tout ce que je fais (ou dis)
peut être défini comme une violence, tant que je
suis en vie. C’est-à-dire que Pétunia qualifie de
« violence » : le fait que j’emploie un mot qui ne
lui plaît pas (quand j’ai commencé à employer
le verbe « switcher », elle s’est sentie violentée) ;
le fait que mon corps entre en contact avec
le sien sans que je ne l’aie fait exprès (ce qui
peut arriver, notamment dans les transports en
commun, ou encore quand on dort ensemble
dans mon lit qui est un lit simple) ; le fait que
je touche un objet dans son appartement sans
lui avoir demandé (en l’occurrence : un poster
au mur, et une autre fois : un journal posé sur
la table). Vers la fin de notre relation (et après
la rupture), tel un vampire, je devais lui demander la permission avant d’entrer chez elle, alors même que la porte était grande ouverte et que
je me trouvais debout sur le seuil parce qu’elle
m’avait ouvert la porte d’en bas avec l’interphone, et que j’avais pris l’ascenseur (sans lui
demander son consentement). Je devais aussi
lui demander la permission d’aller aux toilettes
(elle ne refusait jamais), de prendre une douche
ou un bain (elle refusait très souvent ; au bout
d’un moment, lui demander si je pouvais prendre un bain est devenu une violence). N’ayant pas reçu de scénario que j’aurais pu apprendre
par cœur, j’étais condamné à dire et faire des
choses violentes : tout ce que Pétunia n’a pas
prévu est potentiellement violent. Je ne sais
pas comment définir la violence. Mais je pense
que mon histoire en dit long sur les usages qui
peuvent être faits du dogme de la « non-hiérarchisation des violences », et sur la nécessité de réintroduire la possibilité de dire « telle chose n’est pas si violente », sans nier pour autant que
la personne l’ait mal, ou difficilement vécue. Ne
pas poser ces questions, c’est laisser la place
à ce « féminisme » du Ressenti, du Safe, et du
Triggering que Pétunia a mobilisé dans notre
relation, et qui, au-delà de sa bêtise politique, a
toutes les chances de se retourner contre nous
touTEs, et en premier lieu contre celleux d’entre
nous qui sont perçuEs, considéréEs ou définiEs comme masculinEs : par exemple les trans (Ft* et Mt*) ou les butchs (trans ou cis).
...Ces conversations, et beaucoup d’autres,
tournent dans ma tête en continu pendant les
jours qui suivent : je rassemble toutes mes forces,
et le mur construit par Pétunia dans ma tête se
fissure. Je vois ! Enfin ! Ce qu’il y a de foutage de
gueule à m’appeler « personne masculine », et à
déduire de cette « masculinité » que je suis violent,
quels que soient les faits, « structurellement », dès
lors que c’est ainsi que Pétunia le « ressent »...
Le « ressenti » ! Quelle immense arnaque, qui a
permis à Pétunia de passer d’une rhétorique du
point de vue à une rhétorique de la Vérité. Mais
si je suis dominéE ! Ne dis-je pas, par définition,
toujours la Vérité ? Comment, je ne suis pas juste
dominéE ! Comment je suis la patronne, comment je suis la star ! Mais enfin ne suis-je pas une Victime ? Taisez-vous ! Taisez-vous ! Qu’on
leur coupe la tête ! Comment violente ? Mais,
vous dis-je, je suis dominéE ! Et c’est ainsi que
s’écrivent les plus belles pages de mon histoire :
à coup de ressenti.
Les semaines suivantes, je continue à discuter avec les tortues. Ensemble on déconstruit aisément les différents discours de Pétunia et
sa clique de protecteurs trans : l’impératif du
« Safe », la dichotomie « personnes masculines »/ « personnes féminines », la conception du BDSM comme une « domination structurelle » impliquant que tout franchissement de limite
dans ce cadre constitue une agression sexuelle.
Ou encore les deux règles d’or : ne pas nier un
ressenti, ne pas hiérarchiser les violences. Je
comprends de mieux en mieux comment elle a
réussi à m’enfermer dans une prison mentale.
Me forcer à prendre au sérieux le moindre de
ses caprices parce qu’elle parlait de « violences » à tout bout de champ, sans jamais parler de mettre fin à la relation, jusqu’à ce que je sois complètement bloqué dans une « identité » de
coupable qui me définissait de part en part, et
définissait par avance tout ce que je pourrais
être ou faire. Je vois de plus en plus clair dans
son jeu. Peu à peu ce n’est plus la version de
Pétunia qui sort de ma bouche quand je parle
aux tortues.
Fin juin, un (ancien) ami bavarde, et
transforme mon histoire avec Pétunia et mon
exclusion de La Menuiserie en un ragot si appétissant, qu’il ne manque pas de se retrouver sur Facebook le lendemain. Ulcéré, je romps tout
contact avec cet être stupide, après l’avoir un
peu insulté par mail. Je ne voulais pas que
d’autres personnes s’emparent de cette histoire,
indépendamment même des usages qu’elle en
feraient. Ici mon histoire est instrumentalisée
dans un discours misogyne, anti-féministe et
mensonger.
Pétunia tombe sur les Facebook-gossips et
elle m’appelle. Je décroche. Ca fait plusieurs
mois qu’on ne s’est pas vuEs, plusieurs mois
que sa campagne mensongère et transphobe
bat son plein. Morceaux choisis :
– à propos des fuites sur Facebook : « tes amiEs me mettent en danger »
– à propos de La Menuiserie : « Toi tu n’as pas accès à ce lieu. D’autres personnes sont invitées parce qu’elles ne me font pas me sentir en danger et ne m’empêchent pas d’avoir accès à ce lieu. Que je sois ou non dans le bar, c’est pas safe pour moi que tu y sois. »
– à propos des espaces en général : « C’est un entitlement [2] hallucinant que tu croies avoir droit à des espaces où moi je suis. Il s’agit de ma sécurité dans ces espaces. »
- quand je réplique que je suis trans et que
j’ai besoin de ces espaces : « Si tu veux faire
partie de ce monde qui est le mien, il ne fallait pas faire les choses qui font que je ne me sens pas en sécurité. »
(Je prenais des notes pour me retrouver
moi-même au milieu de tous ces discours : ces
phrases sont exactes au mot près.)
Quelques jours après ce coup de téléphone,
La Menuiserie s’ouvre au public, en grande
pompe. Je suis exclu mais rien n’est officiel :
seulEs Bob et Pétunia sont au courant. Les
tortues me parlent d’une association féministe
basée dans une ville à 700 km de la mienne,
Oxygène, qui pourrait prendre en charge une
« médiation » entre Pétunia et moi, afin d’en finir
avec les exclusions. On y réfléchit.
Le 13 juillet 2012, à trois heures du matin,
j’envoie à Pétunia un texto demandant qu’on se
voie pour parler. Elle accepte, me donne rendez-vous une demie-heure plus tard au centre-ville. On passe la nuit entière à discuter. Et à s’embrasser. Se dire qu’on s’aime. Pour la première fois,
elle reconnaît clairement qu’elle a eu des comportements abusifs, et c’est même elle qui me rappelle certains faits que j’avais effacés de ma
mémoire : « je t’empêchais de dormir ». Elle fait
mine de déplorer mon exclusion (qui, bien sûr,
selon elle n’en est pas une..) des rencontres trans
de Taboulouse en mai, et refuse aussi de parler
d’ « exclusion » pour La Menuiserie. On prévoit
ensemble que je contacterai Oxygène pendant
l’été, et de reparler du partage des espaces en
septembre. Quand on se quitte le lendemain,
elle propose de me faire visiter La Menuiserie. Je
refuse. Elle insiste. Je tiens bon.
Pendant l’été, je suis dans une autre ville,
loin de Pétunia et de La Menuiserie. Bob m’a
envoyé un mail absurde, où il m’a assuré qu’il
avait envoyé les mails précédents sans l’accord
de Pétunia, comme ça, spontanément. Pour
autant Bob ne revient pas sur mon exclusion. Je
me détache progressivement de ces histoires.
En juillet, en août, en septembre, je reçois des
textos de Pétunia : elle me dit que je lui manque,
qu’elle m’aime. J’ai gardé ces textos dans mon
portable. Récemment, je les ai montrés à Bob.
Je contacte Oxygène. J’apprends que
Pétunia a appelé avant moi, pour prendre rendez-vous pour moi. C’est louche ? C’est sa manière habituelle de procéder. Elle considère
que je dois régler mon problème avec ma violence, alors que pour moi, désormais, ce sont des démarches qui visent à rompre l’emprise
qu’elle a encore sur moi. J’ai rendez-vous le 21
septembre avec Oxygène.
ON NE NAÎT PAS BEYONCÉ, ON LE DEVIENT
Septembre 2012 : je change de posture. Je
m’autorise à dire qu’elle ment. Tant de choses
se débloquent dans ma tête. Les tortues m’apprennent plein de techniques d’autodéfense. J’arrête les lamentations stériles. Je me pré-
pare à combattre les dispositifs mis en place par
Pétunia, à en finir réellement avec le Terrible
Tabou. Quelques jours avant ma rencontre avec
Oxygène, Pétunia m’envoie des textos d’amour.
On a prévu de se voir après le 21 septembre,
jour de mon rendez-vous avec Oxygène. Je
comprends qu’elle redoute ce rendez-vous. Et
pour cause. De ma discussion avec Oxygène, il
ressort que Pétunia instrumentalise son statut
autoproclamé de « Victime » pour me nuire. Je
vois les choses clairement. La continuité entre le pouvoir qu’elle avait sur moi pendant la relation et cette façon de contrôler ma vie sociale et
communautaire. La façon dont elle a retourné
les outils féministes contre eux-mêmes. Les
choses se révèlent à mon regard, enfin.
Ce même jour, le 21 septembre, j’entre en
contact, via une des tortues, avec une personne
impliquée dans La Menuiserie, Raphaëlle, qui
ignorait tout de mon exclusion par Bob et Pétunia.
Raphaëlle m’apprend que Pétunia a déversé
ses mensonges à d’autres personnes tout en
les enfermant dans la confidentialité. Ainsi
s’expliquent, bien sûr, les regards noirs, touTEs
celleux qui me fuyaient (et que j’ai moi-même
fuiEs, tout honteux que j’étais), qui m’enlevaient
de leurs amiEs Facebook. Facebook : un élément récurrent, j’imagine, dans la campagne de Pétunia (c’est « triggering » pour elle de me voir apparaître sur Facebook, m’a dit Bob). Pourtant,
remarquons qu’elle ne m’a pas bloqué, et que je
peux accéder à son Mur, où elle me laisse régulièrement des messages : pour mon anniversaire en octobre 2012, elle a posté quarante de « nos » chansons et écrit « happy birthday little boy ».
De la même façon que pour mon exclusion de
La Menuiserie, ce qu’elle appelle sa « sécurité »
ne consiste pas à ne pas avoir de contacts avec
moi, mais à contrôler ma mobilité, mes relations
et mes pensées.
22 septembre : les tortues entrent en contact
avec Bob pour négocier un partage des espaces entre Pétunia et moi à La Menuiserie. On annonce ma venue au bar le 26 septembre,
pour un événement a priori féministe, queer
et révolutionnaire. Bob s’y oppose et refuse de
rencontrer les tortues, en mon absence et en
l’absence de Pétunia. Il se fout de notre gueule,
en répétant qu’il ne s’agit pas d’une exclusion ! Il
dit clairement qu’il ne veut ni ne peut outrepasser la volonté de Pétunia. Au même moment,
celle-ci m’envoie des textos faussement perplexes, auxquels je ne réponds pas : elle fait semblant de ne pas savoir que les tortues ont
contacté Bob, et que j’ai l’intention de venir à La
Menuiserie le 26 septembre.
Mais de la discussion avec Oxygène, il est
ressorti que je devais rompre tout contact avec
Pétunia. Une des tortues l’appelle donc pour
lui signifier qu’elle doit cesser de m’écrire et de
m’appeler. Première réaction de Pétunia : « Oh
non ! Je ne pourrai plus parler avec lui ! » Au
même moment (mais je ne le sais pas encore),
elle commence à m’accuser de viol.
Parce que l’évènement qui se tient le 26
septembre à La Menuiserie est organisé par des
TaboulousainEs amiEs avec certaines tortues,
nous les contactons. Ielles refusent de s’impliquer ou même de prendre position contre mon exclusion. L’unE, Dom’, dit ne pas se sentir
« concernéE par les embrouilles [de ma ville] »
(ce qui ne l’empêchera pas, quelques jours plus
tard, de colporter le ragot auprès d’une personne de ma ville non informée de la situation), l’autre fait allusion à « ce que Pétunia a vécu ». Il devient clair que les « confidences » de Pétunia
(Violence, Victime, Agresseur, Sécurité) leur
sont parvenues. Ces confidences ont-elles vraiment quoi que ce soit de confidentiel ?
Je ne viens pas à La Menuiserie le 26 septembre. Le lendemain, Pétunia m’appelle à cinq heures du matin. Je ne réponds pas. Mais
au réveil j’ai très peur. Que s’est-il passé dans
la nuit ? J’angoisse, et je préviens les tortues.
L’unE d’elle appelle Pétunia, pour lui signifier
une nouvelle fois qu’elle ne doit pas essayer
d’entrer en contact avec moi. Cette démarche
(je pose une limite par l’intermédiaire d’une
tortue) constitue pour elle une « violence ».
Septembre, octobre : les tortues continuent,
avec constance, à demander à Bob et aux membres du so-called « collectif » La Menuiserie qu’une discussion ait lieu, sans moi et sans Pétunia, pour aboutir à un partage féministe et équitable de
l’espace. Pétunia bloque tout. Bob (mais ce sont
les mots de Pétunia qui sortent de sa bouche, j’ai
connu ça...) qualifie cette démarche de violente
en tant qu’elle transgresse les limites posées
par Pétunia (à savoir, que personne, sauf Bob et
Pétunia, ne doit savoir que je suis exclu de La
Menuiserie). Il n’y a donc aucune perspective
de gestion collective de la situation du côté de
Pétunia et de La Menuiserie. Par conséquent,
nous annonçons que je serai présent dans le
bar le 13 octobre. Si Pétunia ne se sent pas en
sécurité dans un espace où je suis, libre à elle
de ne pas venir. En revanche, si elle vient alors
qu’elle estime être en « danger », moi-même et
les tortues ne saurions en être tenuEs pour responsables. Je l’ai appris plus tard : Pétunia essaie de faire annuler le concert du 13 octobre. Mais, pour la première fois, Bob refuse d’accéder à sa
demande. Pendant deux jours, elle envoie des
textos à l’une des tortues : il est question de sa
« survie », de sa « sécurité ». Nous répétons calmement qu’elle peut ne pas venir au concert. À chaque étape, je reste en contact avec Oxygène.
ON NE NAÎT PAS MENUISIER, ON LE DEVIENT
Le 13 octobre, je passe la soirée à La Menuiserie pour la première fois, avec les tortues. Quelques regards noirs, mais à peine...
Personne n’a l’air d’être au courant de la situation, en fait. Pétunia n’est pas là. Derrière le bar, Bob et Bonnie semblent ne pas remarquer ma présence. Au bout de deux heures, je vais moi-même chercher mes verres au bar. Je n’ai pas à avoir honte. C’est à elleux d’avoir honte. Cette transgression n’échappe pas à Raphaëlle qui
a rejoint nos discussions : alors que je traverse
le bar en souriant, elle me lance avec humour
« Tu prends la confiance ou quoi ? » Hourra, vive
l’autodéfense féministe et vive les tortues. Après
le concert, la soirée est pourrie mais je me sens
tellement bien !
Dans la semaine qui suit, les tortues
envoient un mail à Bob et à Pétunia pour donner
mon calendrier : je serai à La Menuiserie les 20,
21, 30 et 31 octobre. Notre proposition de discussion reste ouverte. Pas de réponse. Tout se passe bien le 20, au-delà de mes espérances.
L’ex de Pétunia vient me saluer, ce que j’interprète alors comme une victoire sur Pétunia et ses dispositifs de contrôle. D’ailleurs, elle n’est
pas là. Elle n’est plus venue à La Menuiserie
depuis que j’y ai mis les pieds le 13 octobre.
Le 21 octobre, je reviens à La Menuiserie
dans le cadre d’une activité militante. L’accueil
froid par Bob et Bonnie, qui m’ignore délibérément alors que je lui demande une éponge pour nettoyer les tables, m’exaspère sérieusement. Devenu powerful, je n’ai aucune raison d’accepter qu’on me traite comme si je me trimballais une pancarte avec écrit « violeur » sur le dos. Je n’ai aucune raison non plus de préserver le
Tabou. Je me retiens de leur hurler à la gueule.
Le soir-même, en discutant avec des tortues,
je me rends compte qu’aller librement à La
Menuiserie ne suffit pas. Il faut que je diffuse
ma version des faits. Tant que Pétunia sera la
seule à parler, les gens continueront à la
croire. D’autant que j’ai appris, le 6 octobre par
Raphaëlle, que Pétunia parlait de « viol ». Sans donner aucun fait, aucun récit, puisque comme chacunE sait, le viol c’est l’Ultime Tabou, et
c’est pas dans les milieux féministes qu’on va
se mettre à en parler... Abracada Viol Viol Viol,
et débarrassez-moi de cet ex qui aurait trop de
choses à dire, si seulement vous l’écoutiez...
Mais puisqu’on ne m’écoute pas...
Je pense de plus en plus à balancer un texte.
Ce qui m’arrête : la peur de nuire à Pétunia. Car
ça n’a jamais été mon intention, ni celle des tortues. Nous sommes restéEs bienveillantEs et féministes. Nous n’avons jamais voulu publiciser la situation, mais la gérer collectivement. Si
ce texte paraît aujourd’hui c’est bien parce que
toutes ces démarches ont échoué. J’hésite encore
à balancer le texte... Mais le 29 octobre, l’une des
tortues reçoit un mail de Bob, une aberration, un
non-sens politique : KitKat Labougie, le performer
trans que je voulais aller voir à La Menuiserie le
30 (un ami de Pétunia qui a manifestement rejoint
la confrérie des hypnotisés) ne souhaite pas que
des personnes « accusées d’abus sexuels » soient
présentes pendant sa performance, je suis donc
prié de ne pas me pointer. En revanche, si je souhaite assister à sa performance en compagnie d’autres personnes accusées d’abus sexuels, je peux en formuler la demande à KitKat Labougie
afin qu’il organise une séance privée. En lisant ce
tissu d’inepties, je m’exclame pour la première
fois : « Je l’aime plus ! » (Pétunia). Nous concoctons une réponse cynique (bravo à La Menuiserie pour cette entreprise de fichage et de filtrage des Indésirables), qui ne sera jamais envoyée... parce
que deux jours plus tard, nous recevons un autre
mail de Bob.
Coup de théâtre : Bob se sent manipulé
par Pétunia. Il désire nous rencontrer, bravant
ainsi l’interdiction posée par Pétunia. Nous nous
voyons début novembre. Parce qu’il ne s’agit pas d’une médiation, rien ne justifie plus mon absence. Je suis avec deux tortues. Bob dit les
mêmes choses que moi. Il dit que Pétunia ment,
manipule, fait pression. Quand une tortue lui
demande de quels faits il est question quand
Pétunia parle de « viol », il n’a aucune réponse à
apporter. Elle lui a bien dit que je l’avais violée,
mais de quoi parle-t-elle ? Il ne sait pas.
Il ne sait pas ! Il ne sait pas ! J’ai un peu de
mal à garder mon sang froid. Tout ça pour ça...
C’est si minable. Je me sens mal. Je raconte
à Bob tout ce que j’ai vécu, il n’a aucun mal à
me croire, car ce que je dis « résonne » avec ce
qu’il connaît de Pétunia. Je lui montre les textos
envoyés par Pétunia cet été, pendant qu’elle
prétendait se protéger du « danger » que je
représentais pour elle. Cette rencontre avec Bob
me décide à écrire un texte. Combien de Bob ?
Combien de personnes qui croient les mensonges de Pétunia parce qu’elle est « féminine »,
parce qu’elle chiale, parce qu’elle leur fait du
chantage au suicide (je compte au moins neuf
personnes auxquelles elle a fait du chantage au
suicide), parce qu’elle leur paralyse les neurones à coup d’invocations au « safe » ? Combien de personnes qui se disent ses « amiEs » alors qu’elles ne sont pas capables de lui dire STOP ?
Pétunia considère comme une agression tout ce
qui n’a pas été décidé par elle. C’est pourquoi
elle raconte désormais que La Menuiserie soutient un violeur.
WAKE UP, DONNIE
Fin novembre, je croise Emilie dans un
espace militant. C’est une hétéra cisgenre plutôt
extérieure à la communauté. Or, j’ai remarqué
que Pétunia avait propagé ses accusations dans des milieux militants hétéro-gauchistes. Et je sais que Emilie m’a enlevé de ses amiEs
Facebook. Je vais donc limpidement lui poser
la question : « M’as-tu enlevé de tes amiEs
Facebook à cause des mensonges que raconte
Pétunia à mon sujet ? ». C’est bien la raison,
confirme Emilie.
J’essaie de parler avec elle. Surprise : en
dehors des milieux queer, Pétunia n’hésite pas
du tout à parler de « l’oppression des hommes sur
les femmes » pour obtenir le soutien des hétéras
contre moi ! Emilie me parle d’une « nana qui
a subi une violence » – bonjour l’hétérosexisme – et elle dit aux tortues que Pétunia est « sa copine ». Bah Émilie... Change de copine !
La campagne de Pétunia ne s’est pas du tout arrêtée. Ses accusations de viol continuent à se répandre. Mais je suis de moins en moins peiné quand je perds des amiEs Facebook, ce qui continue à arriver puisque Pétunia fait du chantage au suicide pour que l’on me supprime sur Facebook (incroyable mais vrai !). Novembre,
décembre : ça va quand même nettement
mieux. Je me sens réellement capable d’en finir
avec cette histoire, de la dépasser, de la mettre
derrière moi. Même si j’ai du mal à m’affranchir
du désir de l’entendre dire, elle, qu’elle a menti,
je me sens de plus en plus puissant, légitime,
je redeviens un sujet. Parfois je me surprends
à penser : c’est quoi mon problème dans la vie
déjà ? Parce que je deviens capable d’oublier
cette histoire pendant plusieurs heures. Et ça fait du bien ! Tellement de bien !
Il m’arrive toujours d’errer sur son blog en
rentrant de soirée, et j’y trouve, début décembre, un texte datant du 3 novembre 2008, soit plusieurs années avant notre rencontre, dans lequel elle décrit les « mécanismes » et les « rouages malsain » d’une relation qu’elle vit à ce moment-là. Elle parle de « chantage affectif », de « codépendance », de « manipulation ».
Elle écrit : « je suis une professionnelle du sabotage je connais toutes les techniques / pour te
faire mal / et te faire passer pour le bourreau / et même pour finir par y croire ». Son blog est public, ce texte y est publié depuis quatre ans.
Après une petite crise d’angoisse je décide de
tendre une dernière perche à ses alliéEs.
J’envoie cette page du blog à certaines des
personnes qui ont soutenu Pétunia dans ses
accusations de violences sexuelles, physiques,
psychologiques, puis de viol, ainsi qu’à des
personnes dont je ne connais pas la position,
ainsi qu’à Bob. Si certainEs persistent dans leur
soutien inconditionnel à Pétunia, d’autres (en
particulier des amiEs de Pétunia qui ont rompu
tout contact avec elle pour des raisons dont je
ne sais rien) demandent à en savoir plus sur la
situation actuelle. Quant à Bob, il accepte ma
proposition de prendre un café pour continuer
à discuter. Nous nous voyons, et découvrons
tout ce que nos relations avec Pétunia ont en
commun. Nous revenons aussi sur mon exclusion de La Menuiserie, et nos deux versions mises côte à côte illustrent de manière éclatante le fonctionnement manipulateur de Pétunia. Cette conversation m’aide à cesser de m’auto-mépriser d’être entré dans les mécanismes mis
en place par Pétunia. C’est ce qu’il me reste à
faire pour passer réellement à autre chose dans
ma tête. Bob sait que j’écris ce texte, et me propose de le déposer à La Menuiserie.
Quant à Luke, croyant me faire énormément de peine, il m’annonce avec mépris que « personne ne connaît [mon] existence en dehors de [ma ville] » : je suis donc bien bête de rechercher la gloire, car cette entreprise n’a vraiment aucun succès. Luke se contente de répéter les discours de Pétunia sur l’inutilité de mon être, au fond.
C’est vrai que ce n’est pas moi la « star »... Luke
préfère de loin obéir à Pétunia (et baiser avec
elle) ; moi je suis un paumé, moi je ne sers à
rien. Soit. À bientôt Luke, nous nous verrons de
l’autre côté du miroir.
Et Bonnie ! Bonnie justifie le fait d’avoir propagé les accusations de Pétunia (de manière voilée, c’est vrai, mais suffisamment précise
pour que certainEs de mes amiEs comprennent très bien où elle voulait en venir) en me disant qu’elle était « mal à l’aise » de me voir à
La Menuiserie le 20 octobre – c’est-à-dire, le
jour de la marche trans de ma ville (Bonnie est
cisgenre). C’est la fête du SAFE ? Ça me donne
envie de lui faire des grimaces, et on verra si
ça la met mal à l’aise. Apparemment, ça fait
des années que je la mets « mal à l’aise » : déjà,
pendant la « médiation », elle a été « troublée »
par mes propos (pour rappel : Pétunia mentait,
j’ai donc dit à Bob et Bonnie que Pétunia mentait) ; de plus, j’aurais fait, en 2010, des blagues sexistes qui lui ont déplu. Sauf qu’elle n’a absolument pas propagé la rumeur selon laquelle je
serais un con (et libre à elle de s’y mettre), ni la
rumeur selon laquelle j’aurais dit que Pétunia
mentait en m’accusant de violences physiques
et sexuelles. Non, elle a dit que j’étais un agresseur, et qu’il lui fallait s’éloigner de moi au plus vite (nous étions donc dans le même espace, La Menuiserie, le 20 octobre). Bonnie a participé à la mise en place d’un dispositif d’exclusion, de punition, en refusant de m’écouter pendant la « médiation », en diffusant les accusations de
Pétunia jusqu’au mois d’octobre 2012. Et ça, ça
te met pas « mal à l’aise » ? Parce qu’à ta place,
je crois que je serais plutôt embarrassé. A bientôt donc pour de jolies grimaces, dans un monde safe, dans un monde sans aucun malaise.
Aux personnes trans Ft* qui pensent avoir besoin d’obéir à une fem pour pouvoir se dire féministes, qui s’auto-flagellent d’être des « personnes masculines », s’auto-culpabilisent d’avoir accès à des « privilèges masculins » (il est vrai qu’une fois sur cinquante, c’est de pédé qu’on me traite et pas de gouine...), et finissent par devenir les proies faciles d’un « féminisme » imbécile, essentialiste et transphobe : IT’S A TRAP. De là à me penser moi-même comme un
« Agresseur » par nature, oubliant, déformant
mes propres souvenirs, que venaient peu à peu
remplacer les discours accusateurs de Pétunia,
de là à passer deux ans à être surveillé puis à
m’auto-surveiller, parce que j’avais peur, en
toute occasion, d’avoir des comportements que
Pétunia aurait qualifiés de « violents » d’une part,
et qu’elle aurait d’autre part reliés à ma « masculinité », il n’y a eu qu’un pas.
Maintenant c’est fini. J’ai retrouvé ces évidences : j’étais là, c’est ma vie, je sais ce qui s’est passé. J’ai retrouvé la mémoire. J’ai compris que le fait de m’exclure était la seule façon que Pétunia avait trouvée pour rester en contact avec moi. En aucun cas une démarche féministe, inspirée par le besoin de se « protéger »,
mais la continuation du contrôle qu’elle avait
pris sur ma vie. Et si touTEs les autres ouvraient
leur gueule comme moi ? Ou Pétunia continuera-t-elle de les en empêcher ? Je dis « les autres » parce que toute évidence je ne suis pas seul à avoir été sous l’emprise de Pétunia : j’en sais assez, par exemple, sur ses relations avec ses amiEs, avec certainEs de celleux qui ont été ses intermédiaires (et dont la plupart ont rompu
tout contact avec elle), pour deviner des mécanismes très proches de ceux que j’ai connus. Quant à ses émissaires, amis et amants trans,
ceux par qui mon exclusion m’a été signifiée : il n’est pas trop tard pour commencer à réfléchir. Bande de boulets. Et si après avoir lu ce texte vous continuez à penser que j’ai violé Pétunia :
LOL. BienheureuxSES sont les simples d’esprit.
Aux personnes de ma ville qui s’auto-kiffent
de ne pas me répondre quand je les salue, parce
qu’ielles ont entendu X dire à W que j’étais un
violeur, et qu’ielles n’ont pas du tout eu l’idée
de venir m’en parler à moi, ni d’ailleurs de
demander à Pétunia de quoi il était question – « abus sexuels », « agression sexuelle », « viol », autant de formules magiques, d’incantations, qu’il n’est manifestement pas nécessaire de
relier à un quelconque contenu pour bénéficier
de leur immense pouvoir : les gens ferment
leur gueule, prennent un air recueilli, compatissant, qu’ielles considèrent sans doute comme l’attitude féministe à observer dans les cas de « violences », et s’empressent de colporter la
rumeur, tout en promettant la confidentialité... ; aux TaboulousainEs qui ne se sentent « pas concernéEs par les embrouilles de ma ville »
(quand ces « embrouilles » sont en fait des accusations de viol, et l’exclusion d’une personne trans, et que ces « embrouilles » sont tellement celles de ma ville qu’elles ont lieu au TGV, sous
leur toit, sous leurs nez), à touTEs celleux qui
rivalisent de regards noirs et d’oeillades scandalisées quand je parais dans un lieu (faudrait-il que je m’emmure dans mon internat straight où l’on dessine des bites sur mon courrier ? merci la « communauté »...) : vous êtes nulLEs.
FÉMINISME DU RESSENTI
LE FÉMINISME AU PAYS DES BISOUNOURS : VIOLENCE DU RESSENTI, RESSENTI DE LA VIOLENCE
Par Mathias, Maïc, Kira, Flo & Gaël
Nous avons rédigé ce texte en décembre 2012. Il livre nos réflexions suite à notre implication dans la gestion de l’histoire de Paranormal Tabou. Rédigé à plusieurs mains, nous avons laissé tel quel le collage de nos écrits, sans chercher à l’harmoniser sur le fond ou la forme. Les pistes d’analyses sont donc diverses, se recoupent, se complètent, se superposent spontanément.
Les violences entre queers, partout … ou nulle part ?
Les violences intra-communautaires, et notamment celles qui émergent dans les relations interpersonnelles de type amoureuses, sentimentales ou érotiques, sont à la fois hyper-visibilisées et un véritable angle mort de nos réflexions.
Elles imprègnent profondément la communauté queer, à travers les ragots/rumeurs/gossips qui semblent nourrir en souterrain le sentiment d’existence de cette communauté. On s’en délecte, on se les raconte sous le sceau de la confidentialité, on ne fait rien de concret mais on ne rechigne jamais à faire tourner l’info, aussi déformée que possible.
Et puis quand les « affaires » de violence éclatent, elles débouchent immanquablement sur un échec de la prise en charge collective ; et chaque précédent, loin d’apporter de quelconques conclusions constructives, ne débouche que sur de nouvelles prises de positions aussi peu réfléchies. On s’est planté, on n’a rien fait, on s’est fourvoyé dans la défense d’un agresseur qui a pourri toute la communauté pendant des années ? On s’inventera alors une victime à défendre la prochaine fois, dans un « réflexe féministe » sans réflexion, tout aussi pathétique. Tant que ça reste dans le sens du vent, et que ça ne tombe pas sur ma gueule…
Entre-temps, les ateliers de réflexion sur les violences sont désertés et bien vite abandonnés, et l’on se contente de plaquer des grilles d’analyses hétérocentrées sur des relations queer, tout en prônant une éthique du safe qui vire au sécuritaire. Car c’est de cela qu’il s’agit : on détourne et on vide de sens la volonté féministe de briser le silence qui entoure les viols, et on abandonne toute réflexion sur la construction de réponses alternatives aux violences entre personnes queer. Le viol se meut en incantation qui paralyse toute réflexion, le ressenti exprimé a valeur de vérité absolue, tout est dit ! Un Violeur, une Victime, inutile d’en dire plus, le reste restera tabou − hâtons-nous de nous focaliser sur des réponses caricaturales et répressives. L’exclusion devient une option de premier choix, un outil de prise de contrôle pas interrogé, et sous prétexte de ne pas hiérarchiser les violences, chacun.e peut finalement dénoncer n’importe qui pour n’importe quoi, sans que l’on interroge le pouvoir tiré d’un tel détournement des discours et pratiques féministes − au contraire on s’auto-kiffe de telles décisions « radicales ». Et inutile de se faire croire qu’il ne s’agit que de dérives inhérentes à un fonctionnement efficace et féministe car pendant ce temps, des personnes ayant commis ou défendu des actes de violences (physiques, psychologiques ou sexuelles), continuent de bénéficier des réflexes patriarcaux de minimisation des faits, quand elles ne gravissent pas tranquillement les échelons de notre communauté.
À la recherche de la Nouvelle Star
Il serait en effet intéressant de s’intéresser, au fil des « affaires de violences », à la position occupée au sein de notre communauté par chacun des individus impliqués. Qui bénéficie tantôt d’une minimisation/négation des faits (s’ielle est accusé.e), tantôt d’une audience à toute épreuve (s’ielle se proclame en victime définitive) ? A contrario, qui n’est pas écouté.e, qui voit sa parole niée ou moquée ? Immanquablement, on ne peut que constater que celle ou celui qui est dans la place, a les bonnes relations et un statut pailleté − bref qui détient une forme de pouvoir − sera plus écouté, cru et soutenu que celui ou celle qu’on ne connait pas ou qui brille moins − et ce, indépendamment des faits. Mais peut-être est-ce plus rassurant de galoper derrière les petites stars de la communauté, des fois qu’on puisse bénéficier en retour de quelques miettes de leur aura ?
Plus t’as de pouvoir, plus tu gagnes. Décidément, c’est follement alterno.
Je suis la Victime. Preum’s
Se parer du statut de Victime et produire l’autre comme Agresseur empêche toute réflexion féministe sur la prise en charge de violences intra-communautaires et la répartition des espaces entre personnes queer. Plus aucune issue n’est possible quand les situations s’essentialisent, quand l’acte de violence (commis ou subi) devient identité (la Victime, le Violeur, l’Agresseur).
Pourtant, il serait pertinent de se rappeler que nous avons tou.te.s un potentiel de violence en nous. Comment peut-on l’oublier ?! Comment ne pas être conscient.e.s que des personnes ne vont pas bien, subissent et donc perpétuent des violences ? Et ne poussons pas des cris d’orfraie en hurlant à la « pathologisation » ! On parle bien ici d’oppression sociale qui « rend folle-fou ». En tant que queers, femmes, trans, bi.e.s, pédés, gouines, nous vivons des oppressions systémiques qui nous fragilisent et nous font violence, et l’on sait combien le cadre du « couple » (mais aussi celui de l’amitié) est un endroit privilégié d’expression d’une violence que nous reproduisons parfois. Mais ce fait n’entre jamais en ligne de compte pour parler de violences, et on n’effectue jamais de rapprochement entre pétages de plombs, oppressions subies, et reproduction de violence. Alors s’applique la lecture manichéenne hétérocentrée de la Victime − si possible fémininE, et de l’Agresseur − si possible masculinE (à la faveur des histoires d’agressions, les garçons trans et les butchs vont toujours trop loin dans leur masculinité quand les filles trans n’y renoncent jamais assez). à défaut de mec hétéro cisgenre, les butchs, les trans et les identités masculines de nos communautés font des agresseurs idéals. Pourtant, nous ne pourrons pas faire l’économie d’interroger ce déficit de crédibilité féministe des personnes masculines si nous souhaitons réellement construire des espaces queer inclusifs.
Des gens safe et des espaces sécurisés
La question récurrente quand on parle de violence dans le milieu queer n’est pas : comment canaliser les violences ? ni même, comment se remettre d’expériences violentes ? mais bien comment rendre nos espaces safe ? L’usage fréquent de termes en langue anglaise nous fait parfois oublier le sens des mots, si bien qu’il apparaît salutaire de reformuler la question. Ainsi, on a : comment sécuriser nos espaces ? La traduction montre nos dynamiques sous un nouveau jour que l’usage de l’anglais tentait tant bien que mal de cacher.
Derrière la volonté de réfléchir à nos espaces safe, nos relations safe, nos communautés safe, nos ami.e.s safe, se cache un mouvement de sécurisation de nos communautés. Certain.e.s voudraient non seulement une communauté sans agressions, sans cris, sans pleurs, sans insultes, mais en plus, ielles pensent bons d’exclure quelqu’un.e d’un espace parce que quelqu’un.e d’autre est « mal à l’aise ». Il ne faut donc plus seulement se protéger des agressions, il faut également se protéger de nos émotions et ne surtout pas les affronter. Donnez-moi de la jouissance et du plaisir, mais Ô surtout, protégez-moi de la gêne et de la colère ! Apparemment certaines émotions ne valent pas la peine d’être ressenties…
La sécurité est présentée comme un besoin vital et l’on cherche à créer des bulles hermétiques et aseptisées visant à nous protéger d’un espace straight dans lequel nous serions totalement vulnérables. Vous savez quoi ? Des espaces safe n’existent pas, pas plus que le safe sex ou les personnes safe. Le safe, comme risque zéro, n’existe pas. Vivre tue, aimer amène éventuellement son lot de souffrance et baiser son lot d’IST et autres mycoses.
Vouloir se prémunir de tout risque relationnel est une voie sans issue. Le problème avec la recherche de sécurité, c’est que plus on cherche à contrôler les risques et à s’en prémunir, plus on en a peur. C’est là tout le paradoxe : la recherche de sécurité intensifie le sentiment d’insécurité. Et après tout, c’est plutôt logique. Si tu te construis un monde parfait, propre, lisse et prévisible, tu as de grandes chances de péter les plombs si ça ne se passe pas comme prévu. L’énergie que tu as déployée pour développer ton impression de contrôle (qui n’est et ne sera jamais qu’une impression) est autant d’énergie que tu n’as pas pu mettre dans l’acquisition d’outils te permettant de gérer les imprévus. Si ce n’était pas censé se passer comme ça et que tu ne t’y étais pas préparé.e, c’est tout ton monde qui s’écroule.
Le truc avec tout ça, c’est qu’on a l’impression d’être super radicales avec nos discussions sur nos espaces safe, sauf qu’on est loin d’être originales et révolutionnaires en faisant ça… à travers cette recherche de sécurité, cette gestion des risques, on ne fait que reproduire ce sur quoi se basent les sociétés néolibérales. Au sein de ces sociétés, la recherche de sécurité vient compenser la vulnérabilité accrue qu’amène la promotion de l’individualité.
Soyons honnêtes, nous vivons dans des communautés surprotégées où des embrouilles souvent minables prennent des proportions incroyables. Nous dépensons énormément d’énergie à nous déchirer, à entretenir des drames, à gérer les espaces et les affects. Plutôt que de chercher à construire des espaces plus safe (ils le sont déjà suffisamment), il est grand temps que nous réfléchissions à la manière dont on peut surmonter les violences, désamorcer les situations, contenir les affects, et que nous nous penchions sur les outils à notre disposition pour gagner en puissance aussi bien dans straight land que dans nos interactions intracommunautaires.
Le féminisme n’est pas un dîner de gala
Il serait salutaire de garder en tête les groupes de conscience des années 1970, les
discussions sur le viol, la façon dont les femmes en venaient, en discutant non pas de leur ressenti mais de leur expérience, à identifier l’ensemble des dynamiques violentes dans lesquelles elles se trouvaient, les viols qu’elles avaient subies, les inégalités dont elles souffraient. Désormais, nous avons tellement tout déconstruit que nous nous paralysons lorsqu’on entend le mot « viol ». Plutôt que d’aider nos ami.e.s à en parler, on les confine dans le silence, parce que tu comprends, c’est pas facile quand même… Nos silences reproduisent en permanence l’idée que le viol est quelque chose de destructeur et traumatique qui nous enlève toute capacité d’agir et dont on ne peut évidemment pas parler.
Pis encore, on se cache derrière des « la parole de la victime d’abord » pour refuser d’avoir à dealer les choses, d’avoir à se confronter à des faits. Pour pas mal de personnes, quand on parle de parole de la victime, on ne parle plus de récits, on parle de ressenti. « J’ai ressenti que Machin.e m’a coupé la jambe ! » Peu importe ce que Machin.e a objectivement fait, le ressenti est là, la jambe est symboliquement coupée, l’heure est grave. On ne cherche pas à savoir ce qui s’est passé, on forme un cordon sanitaire autour de la Victime, et on désinfecte, on désinfecte, on désinfecte…
Le plus triste dans tout ça, c’est que des outils féministes et des critiques de la justice mainstream créent un système dans lequel on n’écoute ni la parole de la personne qui se définit comme victime, ni de celle qui est désignée comme agresseure. On condamne, on exclut, on ragotte ; tout ça sur du ressenti.
Il est grand temps que nous nous confrontions de nouveau aux choses qui fâchent, même si c’est difficile, même si c’est douloureux. Que nous parlions de ce qui se passe, et que quand nous le faisons, nous parlions de faits. Il est grand temps de briser les queer-tabous qui entourent la question des violences, viol compris. On veut parler d’agression ? On veut parler de viol ? Parlons-en vraiment, directement, franchement. Sans détour, sans enrobage empoisonné comme celui du ressenti.
SAFETY IS AN ILLUSION - RÉFLEXIONS SUR L’ACCOUNTABILITY
Texte traduit de l’anglais sans l’aimable autorisation de son auteure, Angustia Celeste
Nous avons choisi de traduire et d’inclure ce texte car il nous semble ouvrir des perspectives intéressantes sur la façon dont nous abordons les violences dans nos communautés. À travers ce texte, nous souhaitons avant tout requestionner nos modèles de gestions des violences et leur systématisation. Il ne peut y avoir de modèle qui s’applique à toutes les situations, et nous devrions en permanence questionner nos façons de faire et essayer de les améliorer.
UnE amiE m’a demandé d’écrire ce texte sur l’accountability [3] dans les communautés radicales étant donnée l’expérience que nous avions acquise à travers nos années de luttes contre la culture du viol. Sauf que je ne crois plus en l’accountability. Notez que ma colère et mon désespoir face à ce modèle sont proportionnels à mon degré d’implication passée. L’accountability est pour moi comme unE ex-amantE pleinE de ressentiment et je n’ai jamais connu ni l’un ni l’autre… ces 10 dernières années, j’ai vraiment essayé de faire en sorte que cette relation marche. Mais vous savez quoi ?
L’accountability dans les communautés radicales n’existe pas, car il n’y a pas de communauté : pas quand il s’agit d’agression sexuelle et d’abus. Faites un sondage un jour, et vous verrez que nous ne sommes pas d’accord. Il n’y a pas de consensus. Dans ce contexte, la communauté est un terme mensonger, fréquemment invoqué, souvent utilisé à tort et je ne veux plus en faire partie.
Je pense qu’il est temps d’arrêter de jouer à ces faux jeux linguistiques et de retourner à l’ancien modèle. Je regrette les jours où casser la gueule de quelqu’unE et le/la faire partir de la ville par le prochain train était considéré comme quelque chose de raisonnable. Au moins, c’était un échange clair et honnête. J’ai passé trop de temps aussi bien avec des survivantEs que des agresseurEs qui se noyaient sous un déluge de mots qui ne permettaient pas de guérir et qui n’étaient même pas cathartiques.
Je n’en peux plus que le langage de l’accountability soit utilisé pour créer les catégories mutuellement exclusives de « taréE » et de « victime ». Je trouve que parler de « survivantE » et d’ « agresseurE » est stigmatisant car cela ne retranscrit pas toutes les façons dont une agression est une dynamique entre des parties (bien que j’utilise ces termes ici parce que nous en avons l’habitude).
Les anarchistes ne sont pas immunisés contre les dynamiques d’abus – nous pouvons au moins être d’accord sur ça – mais je me rends de plus en plus compte que nous ne sommes pas capables de nous protéger les unEs les autres [to keep each other safe].
Promouvoir des modèles de consentement mutuel est un bon début, mais ce ne sera jamais suffisant face à la socialisation de genre et la monogamie : les mensonges de l’exclusivité et l’attrait de « l’amour » comme propriété sont bien trop forts. Les gens recherchent ces niveaux d’intensité quand l’histoire d’amour est nouvelle, que l’obsession de l’intimité est quelque chose qui leur fait du bien, puis, ils ne savent pas comment gérer quand ce moment s’estompe et que ça tourne au vinaigre...
Le truc avec le patriarcat, c’est que c’est super envahissant. Et le truc avec le fait d’être anarchiste ou d’essayer de vivre libre, farouche [fierce], et sans faux semblant, c’est que ça ne nous préserve pas de la violence. Nous ne pouvons créer aucun espace qui soit exempt de violence dans un monde aussi ravagé que celui dans lequel nous vivons. Le fait que nous puissions ne serait-ce que penser que ce soit possible ne fait que mettre à jour nos privilèges. Notre seule marge de manœuvre réside dans la façon dont nous négocions et dont nous utilisons le pouvoir et la violence.
Je veux insister là-dessus. Il n’y a pas d’espace safe au sein du patriarcat ou du capitalisme étant donnée toute la domination classiste, raciste, hétéro-normative, sexiste (etc.) sous laquelle nous vivons. Plus nous prétendrons et plus nous essaierons de faire en sorte que la sécurité [safety] puisse exister à un niveau communautaire, plus nos amiEs et nos amantEs seront trahiEs et déçuEs lorsqu’ielles feront l’expérience de la violence et qu’ielles ne seront pas soutenuEs. A l’heure actuelle, nous tenons de beaux discours, mais nous n’en voyons pas le résultat.
Le modèle actuel pose de nombreux problèmes. Les expériences très différentes d’agression sexuelle et de relation abusive sont mises dans le même panier. Les processus d’accountability encouragent la médiation plutôt que la communication directe, et puisque le conflit est évité, la communication la plus franche n’a pas lieu. La confrontation directe est une bonne chose ! L’éviter ne permet pas de nouvelles compréhensions, d’extériorisation cathartique ou d’éventuel pardon auquel les échanges face-à-face peuvent mener.
Nous avons mis en place un modèle où toutes les parties ne sont encouragées qu’à négocier la façon dont ils vont partager l’espace ou ne plus avoir à se croiser. Des demandes et des promesses impossibles sont faites et, au nom de la confidentialité, des limites sont posées sur la base de généralités. Gère ton problème mais tu n’as pas la possibilité de parler précisément de ce qui s’est passé, et vous ne devez pas vous parler touTEs les deux. Le modèle actuel crée, en réalité, plus de silence. SeulEs quelques spécialistes ont accès à des informations sur ce qui s’est passé, mais on attend de chacunE qu’ielle prenne position. Il y a peu de transparence dans ces processus.
Dans une volonté compréhensible de ne pas raviver des blessures morales ou faire plus de mal encore, nous parlons interminablement et de façon abstraite alors qu’un moment ou une dynamique entre deux personnes se retrouve cristallisé et rien ne change ni ne progresse. Les « agresseurEs » se retrouvent résuméEs à leurs pires moments et les « survivantEs » se construisent une identité sur la base d’expériences de violence, les maintenant souvent dans cet état émotionnel. La communication prudente et non-violente du modèle de l’accountability ne permet pas de guérir. J’ai vu ces processus diviser beaucoup de milieux, mais je ne les ai pas vus aider des personnes à avoir du soutien, à reprendre du pouvoir ou à se sentir à nouveau en sécurité [safe].
Le viol détruit : la perte du contrôle de ton corps, la façon dont ce sentiment d’impuissance resurgit à ta mémoire, la façon dont cela prive de toute illusion de sécurité ou de santé mentale. Nous avons besoin de modèles qui aident les personnes à reprendre du pouvoir et nous devons dénoncer le modèle actuel de rétribution, de contrôle et d’exclusion pour ce qu’il est : de la vengeance. Il n’y a rien de mal à la vengeance, mais ne prétendons pas qu’il ne s’agit pas de pouvoir ! Si nous avons recours à l’humiliation et aux représailles, soyons honnêtes là-dessus. Choisissons ces outils si l’on peut dire en toute honnêteté que c’est ce que l’on veut faire. Au cœur de cette guerre, nous devons améliorer nos aptitudes au conflit.
L’abus et le viol sont des conséquences inévitables de la société malade dans laquelle nous sommes obligéEs de vivre. Nous devons l’éviscérer et la détruire, mais en attendant, nous ne pouvons l’éviter, ni ne pouvons-nous éviter les façons dont elle affecte nos relations les plus intimes. Je sais que dans ma propre vie, et dans ma lutte pour mon émancipation, me mettre en paix avec les pires conséquences de mon combat contre le patriarcat a été un processus important. Me confronter au fait de m’être faite violer a été un élément important pour comprendre ce que cela signifiait de choisir d’être en guerre contre cette société.
Le viol a toujours été utilisé comme un outil de contrôle, brandi comme une menace de ce qui arriverait si je continuais à vivre, à travailler, à m’habiller, à voyager, à aimer et à résister de la façon dont j’ai choisi de le faire, en étant queer et en affichant un genre ambiguë. Ces avertissements n’avaient pas d’emprise sur moi. Je savais parfaitement que ce n’était qu’une question de temps, peu importe le genre de vie que je choisissais, parce que mon genre socialement assigné me met dans un risque de viol permanent. J’ai été violée au travail et il m’a fallu du temps pour réellement nommer cette agression comme un viol. Une fois la douleur, la rage et la colère atténuées, ce que j’ai principalement ressenti après que ça se soit passé, c’est un soulagement. Le soulagement que ce soit enfin arrivé. J’avais attendu toute ma vie pour que ça arrive, ce n’était pas passé loin à plusieurs reprises, et enfin, je savais ce que ça faisait et je savais que je pouvais le surmonter.
J’avais besoin de ce sale coup. J’avais besoin d’une bonne raison pour ce sentiment d’être traquée qui a émergé après le viol, le meurtre et la mutilation de mon amiE quelques années plus tôt. J’avais besoin que quelqu’unE me blesse et que je réalise que j’avais à la fois l’envie de le/la tuer et le contrôle nécessaire pour m’empêcher de le faire. J’avais besoin de chercher de l’aide et d’être déçue. Parce que c’est comme ça que ça se passe. Demandez aux survivantEs que vous connaissez, la plupart ne s’en sortent pas en ayant l’impression d’avoir été soutenuE. Nous avons suscité des attentes mais en vérité nos histoires sont toujours aussi merdiques.
J’étais en voyage à l’étranger quand c’est arrivé. La seule personne à qui j’en ai parlé a appelé la police contre ma volonté. Ils ont fouillé la scène de « crime » sans mon accord et ont prélevé des échantillons d’ADN parce que je ne m’en étais pas débarrassée. Savoir que, dans un moment de vulnérabilité, j’avais accepté de subir des pressions qui me poussaient à participer à une démarche policière contre mes convictions politiques m’a fait me sentir encore pire que le fait d’avoir été violée. Je quittais la ville peu après pour ne pas avoir à subir les pressions de mon « amiE » qui me poussait à coopérer encore plus avec la police. Le seul moyen pour moi d’avoir un minimum de sensation de contrôle durant cette période a été de prendre en main la punition de mon violeur.
J’ai réalisé que je pouvais aussi utiliser les menaces, la colère et la violence implicite comme des armes. Après ma première expérience de « soutien », j’ai décidé de faire ça seule. A ce moment, je ne pouvais penser à personne qui puisse m’aider, mais ça allait parce que j’ai réalisé que je pouvais y arriver seule. Presque n’importe où ailleurs, je pense que j’aurais pu demander à des amiEs de m’aider. La culture de la non-violence n’a pas complètement imprégné toutes les communautés dans lesquelles j’évolue. Le manque d’affinité que j’ai ressenti était dû au fait d’être de passage dans cette ville, mais je ne pense pas que s’être vu offrir une médiation plutôt qu’une confrontation constitue une expérience particulièrement unique. Dans le cas d’une agression sexuelle, je pense que les représailles violentes sont appropriées, et je ne pense pas qu’il faut qu’il y ait un consensus à ce propos. Mettre en avant des modèles qui promettent de faire des médiations au lieu de permettre la confrontation isole les personnes et les aliène. Je ne voulais pas de médiation, que ce soit à travers des voies légales ou non. Je voulais me venger. Je voulais qu’il se sente impuissant, apeuré et vulnérable de la même façon qu’il me l’a fait sentir. Après une agression sexuelle, il n’y a pas vraiment de sécurité [safety], mais il peut y avoir des conséquences.
Nous ne pouvons pas fournir un espace safe aux survivantEs. De manière générale, un espace safe n’existe pas en dehors d’amitiés proches, de quelques membres de la famille et des affinités occasionnelles. Nos modèles actuels d’accountability souffrent d’une surabondance d’espoir. Laissons tomber les fausses promesses des espaces safe. Nous ne nous mettrons jamais touTEs d’accord là-dessus. Admettons que guérir est difficile et que tout espoir d’un changement radical de comportement est illusoire quand il s’agit d’agressions. Nous avons besoin de différencier agression physique et abus émotionnel : les prendre ensemble sous le terme général de violence interpersonnelle ne sert à rien.
Les cycles de l’abus ne disparaissent pas comme ça. Ce schéma merdique est très récurrent : beaucoup d’abuseurEs ont été abuséEs et beaucoup d’abuséEs deviennent abuseurEs. Ces dernières années, j’ai regardé avec effroi le langage de l’accountability devenir un terrain facile pour une nouvelle génération de manipulateurEs émotionnelLEs. Il a été utilisé pour mettre au point un nouveau type de prédateurE anti-conformiste : cellui qui a été nourriE au langage de la sensibilité et qui utilise l’illusion de l’accountability comme monnaie d’échange communautaire.
Alors d’où vient la vraie sécurité [real safety] ? Comment la mesurer ? La sécurité vient de la confiance et la confiance est quelque chose de personnel. Cela ne peut être ni discuté ni approuvé par un tampon officiel au niveau d’une communauté. Mon amantE « safe » pourrait être ton abuseur secret et mon ex toxique et codépendantE pourrait être ton confident bienveillant et éprouvé. On ne se débarrasse pas facilement de la culture du viol, mais tout dépend du contexte.
Des personnes créent des échanges sains ou malsains en étant en relation avec d’autres personnes. Il n’y a pas, par essence, de « taréEs », de « guériEs », ou de « safe ». Ça change avec le temps, selon les circonstances et dans chaque nouvelle histoire d’amour. J’ai observé, mal à l’aise, ce glissement par lequel l’abus « émotionnel » est devenu une raison courante pour amorcer un processus d’accountability.
Le problème en utilisant ce modèle pour l’abus émotionnel, c’est qu’il s’agit d’une dynamique malsaine entre deux personnes. Alors, qui est là pour l’invoquer ? Qui est là pour brandir ce pouvoir dans la communnauté ? (Et soyons honnêtes, il y a du pouvoir dans le fait de demander à quelqu’unE de rentrer dans un processus d’accountability). Les personnes dans des relations malsaines ont besoin de pouvoir en sortir sans que ceci tourne en tribunal populaire contre cellui qui a été assez malchanceuxE pour ne pas se rendre compte d’une mauvaise dynamique ou pour ne pas avoir crié à l’abus en premierE. Ces processus accentuent souvent les jeux de pouvoirs malsains et réciproques entre les parties blessées. On pousse les gens à choisir un côté et pourtant, aucun conflit direct n’amène ce genre d’imbroglio à un début de résolution d’aucune sorte.
Utiliser les modèles d’accountability développés toutes ces années auparavant pour s’occuper de violeurEs en série dans la scène radicale n’a pas servi à grand-chose quand il a fallu aider des personnes à sortir de relations codépendantes et nuisibles. L’abus émotionnel est un terme hyper vague et dur à définir. ChacunE l’interprète différemment.
Si quelqu’unE te blesse et que tu veux le/la blesser à ton tour, alors fais-le, mais ne prétends pas qu’il s’agit de guérison mutuelle. Appelle ce renversement de pouvoir comme ce qu’il est. Il n’y a pas de problème dans le fait de vouloir reprendre le pouvoir et il n’y a pas de problème dans le fait de le prendre, mais ne fais jamais à quelqu’unE d’autre quelque chose que tu ne pourrais pas supporter que quelqu’unE te fasse si les rôles étaient inversés.
Celleux qui ont tendance à avoir recours à la violence physique pour acquérir du pouvoir doivent se voir donner une leçon dans un langage qu’ielles comprendront : le langage de la violence physique. Celleux qui sont bloquéEs dans des relations malsaines ont besoin d’aide pour examiner une dynamique mutuelle et en sortir, et non pour désigner des coupables. Personne ne peut décider qui mérite ou non de la compassion en dehors des personnes directement impliquées.
Il n’y a aucun moyen de détruire la culture du viol par la communication non-violente parce qu’il n’y a aucun moyen de détruire la culture du viol sans détruire la société. En attendant, arrêtons d’attendre le meilleur ou le pire des gens.
J’en ai marre de l’accountability et de son manque de transparence. J’en ai marre des médiations. J’en ai marre de masquer les échanges de pouvoir. J’en ai marre de l’espoir.
J’ai été violée.
J’ai manipulé le pouvoir de façon injuste dans mes relations intimes.
J’ai eu des relations sexuelles qui m’ont appris à améliorer mon consentement.
J’ai le potentiel pour être aussi bien une survivante qu’une agresseuse, une abusée ou une abuseuse. Comme nous touTEs.
Ces catégories essentialistes nous desservent. Les gens violent, mais très peu de gens sont des violeurEs lors de chaque rapport sexuel. Les gens abusent les unEs des autres : cet abus est souvent mutuel et cyclique et les cycles sont difficiles si ce n’est impossible à modifier. Ces comportements changent selon le contexte. Par conséquent, il n’y a pas d’espaces safe.
Je veux que nous soyons honnêtes sur le fait que nous sommes en guerre (avec nous-mêmes, avec nos amantEs, avec notre communauté « radicale »), parce que nous sommes en guerre avec le monde dans son ensemble et les vrilles de la domination existent en nous-mêmes et affectent beaucoup de choses que nous touchons, de gens que nous aimons et de celleux que nous blessons.
Mais on ne se résume pas à la douleur que l’on inflige aux autres ou à la violence que l’on subit.
Nous avons besoin de plus de communication directe et quand ceci n’aide pas, nous avons besoin de plus d’engagement direct dans tous ces aspects, des plus trash aux plus glam. Aussi longtemps que nous nous rendrons vulnérables aux autres, nous ne serons jamais safe à proprement parler.
Il n’y a que les affinités et la confiance gardée. Il n’y a que la confiance perdue et la confrontation. La guerre n’est pas prête de se terminer. Améliorons nos aptitudes au conflit.
[1] Est « triggering », dans le discours de Pétunia,
tout ce qui pourrait lui faire ressentir une émotion désagréable : le « triggering », c’est d’abord
ce qui la met « mal à l’aise » (le « mal à l’aise »
est aussi un concept décisif, car si tu maîtrises
bien le « mal à l’aise », tu peux tout dépolitiser,
pour revenir à des valeurs plus sûres : à savoir,
le confort et l’inconfort). Le « triggering » c’est
l’imprévu, l’inconnu, l’imprévisible et l’inconnaissable. Est « triggering » ce qui échappe à son contrôle, ou témoigne d’une volonté d’y échapper. Est « triggering » tout ce qui laisse penser ou rappelle que j’entretiens des relations avec d’autres personnes qu’elle. Par exemple : si
mon téléphone vibre, c’est « triggering » ; si je
parle « trop » d’unE amiE, c’est « triggering ».
Est enfin « triggering » ce qui suggère que je
suis une autre personne qu’elle. Par exemple :
si je n’ai pas envie d’écouter la même musique
qu’elle, c’est « triggering », si je fais une blague
qu’elle ne capte pas ou qui ne la fait pas rire,
c’est « triggering », si j’ai envie de pisser alors
qu’elle n’a pas envie que j’aille pisser, c’est
extrêmement « triggering », si j’ai sommeil alors
qu’elle n’a pas envie que j’aie sommeil, c’est « triggering », etc.
[2] Ce qu’elle appelle ici « entitlement », c’est le sentiment de légitimité des dominantEs qui croient qu’ielles sont les bienvenuEs partout, et
que tout espace leur est accessible. Autrement
dit, elle me compare à un mec hétéro cisgenre
qui estime qu’une marche de nuit féministe
non-mixte « l’exclut », parce que je souhaite
pouvoir me rendre à La Menuiserie (au premier
mail de Bob, j’ai répondu que je respecterais les
limites posées par Pétunia et que je me tenais
prêt à ce qu’elle me dicte un calendrier).
[3] Note de la Traduction : L’accountability désigne le fait d’être tenuE pour responsable de quelque chose, de prendre ses responsabilités pour quelque chose, d’assumer une faute ou une action.
)
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (2.4 Mo)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (1.9 Mo)