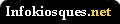Z
ZAD/NO TAV Entretien n°9
Jeanne, squatteuse enracinée - partie 1
mis en ligne le 5 octobre 2016 - Mauvaise Troupe
Lætitia, comment as-tu commencé à t’investir dans la lutte contre le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ?
Lætitia : Quand a été signée la Déclaration d’Utilité Publique (DUP), en 2008. Il y a eu une manif à Nantes, j’imaginais qu’on serait 200 personnes et j’ai été super surprise, il y avait 5000 personnes, des paysans avec leurs tracteurs et tout. En même temps j’ai été retournée, choquée par la présence des partis politiques, c’était juste avant des élections et il y avait une grosse propagande électorale. À la tribune il n’y avait que les partis qui parlaient, ils étaient hyper présents, comme les gens du Modem, habillés en orange, à distribuer des tracts par milliers. J’ai mal vécu cette grosse présence des politicards.
J’avais beau être à Nantes, la lutte contre le projet d’aéroport pour moi c’était quelque chose de très lointain auquel je ne comprenais rien, il n’y avait pas de liens. Après j’en ai su davantage par le biais des gens qui sont allés squatter aux Rosiers [1], que je croisais de temps en temps. Mais je voyais ça de très très loin. Nous on squattait à Nantes et on se disait : « Tiens, il y a des maisons vides là-bas, si les squatteurs peuvent être utiles à une lutte... » et puis les gens plus au fait de la lutte disaient que non, parce que dès que les Rosiers avaient été squattés les autres maisons vides avaient très vite été relouées par le conseil général.
Et à quel moment as-tu commencé à participer à des actions sur le terrain ?
Lætitia : Le déclic c’est surtout en 2009 avec le début des forages. Les infos sont mieux passées dans nos réseaux, via Indymedia [2], et aussi des appels qui permettaient d’aller sur le terrain. Mes ami.es qui y allaient revenaient dégoûté.es en se rendant compte que la plupart des opposant.es sur place n’essayaient pas vraiment de bloquer concrètement les travaux, à ce moment-là. Alors nous on s’est mis dans cette lutte en cherchant d’autres moyens que de se retrouver devant les flics de manière pacifique à chanter des slogans.
En fait pour le premier forage en janvier il y avait eu une opposition physique, avec le camion forcé et les carottages saisis, deux arrestations, un procès, et une bagarre du genre rugby entre flics du coin et opposants. Quelqu’un qui était grimpé au-dessus de la mêlée faisait des commentaires en mode journaliste sportif ! Mais après il y a eu beaucoup plus de flics pour surveiller les travaux, ce qui rendait plus difficile d’agir sur le terrain.
D’où l’idée en mai d’aller occuper directement la DIRO [3], où était stockée la machine pour les forages. L’action s’est organisée via une bande de potes. Enfin, on s’est rencontré.es à ce moment-là, avant on ne se connaissait pas. On formait un groupe diversifié basé sur l’idée de faire de l’action directe. C’était quelque chose qui ne faisait pas débat entre nous.
Donc on décide d’aller faire un pique-nique tranquillou dans les locaux de la DIRO. Tous les échantillons de forages étaient stockés là-bas, dans un hangar ouvert, dans des petits sacs en plastique avec des étiquettes dessus. Sur place, la question de quoi faire ne s’est même pas posée, ça a même mis des gens un peu mal : on a tout bousillé et on s’est fait une grosse bataille de boue ! C’était en journée, ce qui fait que les gens de la DIRO et tous les flics mobilisés pour protéger les forages étaient sur le terrain. Comme on a occupé les locaux, il a fallu qu’ils reviennent pour nous virer et ça a donc arrêté les travaux sur le terrain puisque les flics devaient rester avec la foreuse. Ça a suspendu le chantier pour la journée. De la même façon, les forages s’arrêtaient quand il y avait un mouvement social parce qu’il n’y avait pas assez de flics disponibles.
Dans la cour de la DIRO on avait décidé de jouer à des jeux en formant deux camps adverses, et on a continué à jouer pendant que les flics avançaient sur nous, à rigoler en disant que ça nous faisait des renforts, on n’a pas cherché à se barrer alors qu’on avait le temps et qu’on avait tout détruit. Il y a eu un contrôle généralisé, des prises de photos, mais aucune suite.
Jeanne, toi qui ne vivais pas dans la région, comment tu ressentais ce qui se passait autour de cette lutte ?
Jeanne : Lætitia me parlait des actions qu’illes menaient et à un moment j’ai eu envie de capter plus ce qui se jouait ici. Alors quand elle m’a annoncé qu’un Camp Action Climat (CAC) se préparait pour l’été 2009, je me suis dit que c’était la bonne occasion pour venir me faire une opinion par moi-même.
Lætitia : C’est à l’occasion de la préparation du CAC que je suis vraiment entrée en relation avec des gens de l’Acipa [4], parce qu’il y avait eu une grosse opposition sur les modes d’organisation, sur les objectifs et sur la présence de groupes politiciens qui a conduit à faire deux événements différents en même temps, une “Semaine des résistances” côté Acipa et le CAC côté activistes, côte-à-côte sur le même terrain. Il y avait quand même de la coordination entre les deux.
Jeanne : Moi en arrivant de l’extérieur, je pigeais pas trop les enjeux, les deux camps séparés. Clairement ma culture politique me poussait naturellement vers l’espace du CAC, je connaissais déjà des gens qui y étaient. Il y avait deux cultures politiques qui se côtoyaient mais ne se mélangeaient pas beaucoup : les gens du coin et les activistes, pour caricaturer. Quand même ce mélange me paraissait intéressant, ça faisait partie des choses auxquelles j’aspirais, de pouvoir sortir de l’entre-soi.
Lætitia : Pendant le camp il y a eu l’appel à occupation porté par les “Habitants qui résistent” mais aussi des gens de bleds autour. Il y a eu des discussions. Je me souviens de gens de l’Acipa qui étaient très très opposés à cette idée. Illes étaient très en colère, au milieu de gens, debout, à gueuler : « II faut pas faire ça, il faut pas faire ça » ! Pourtant ce sont les mêmes qui se sont retrouvés à faire le lien avec nous par la suite. En tout cas cette idée d’occupation ne faisait pas l’unanimité.
Jeanne : Je ne sais pas quels étaient leurs arguments, est-ce que quelqu’un aujourd’hui oserait se souvenir d’arguments contre l’occupation ? Illes avaient peur de se faire déborder et puis quand les choses ont avancé dans ce sens-là, illes ont fini par suivre.
Vous pouvez raconter le CAC, ce qui vous a marqué ? Est-ce que ça a changé votre regard sur la lutte ?
Lætitia : Plein de gens divers organisaient le Camp. Il y avait aussi bien les anarchistes nantais, ça c’est un peu nous, que des réseaux décroissants, écolos, quelques gens des partis : des gens avec des visions du monde assez différentes. Il y a eu plein d’échanges, quelques rencontres passionnantes, et depuis tout le monde a bougé fort. Après, les gens venus au CAC n’étaient pas tant des gens d’ici, mais des militants de réseaux plus éloignés. C’était finalement quelque chose d’assez déconnecté de la lutte locale, et en même temps ça pouvait apporter plein de billes aux gens d’ici, de réflexions et de pratiques. Ce qui m’intéressait, c’était d’y amener mes pratiques, quitte à ce que ça fasse conflit au sein du monde militant.
Jeanne : Bon, moi j’y ai appris des choses parce que je n’étais pas familiarisée avec la lutte. Aussi on a été quelques-un.es à porter des questionnements sur la non-violence et la violence, l’écologie, est-ce qu’on veut se sentir des citoyen.nes responsables, ou pas, etc. Quelque part on faisait chier le monde mais on arrivait aussi à avancer. On a dû faire un peu de provoc’, genre en cramant du plastique pour allumer des feux, ça, ça lance toujours des débats ! Blague à part, ça me semblait important de remettre en cause le côté individualisant et moralisateur d’une certaine écologie, qui a tendance à masquer les vrais enjeux.
Quelles ont été les suites de l’appel à occupation ?
Lætitia : Des gens sont restés, ont ouvert une maison un mois après, à la Gaité. C’est là qu’on a eu la réunion-bilan du CAC. Nous de Nantes, on ne les connaissait pas trop. Illes étaient prêt.es à rester, du jour au lendemain, illes étaient vachement jeunes, on n’était pas sur le même mode. Dans notre bande, certain.es commençaient à penser à s’installer, à chercher un lieu. On n’était pas dans les mêmes modes d’organisation, de vie, la rencontre a pas été super évidente, ça a été long.
Déjà on a aidé à construire la “cabane de la résistance” aux Planchettes, parce qu’on pensait qu’on avait besoin d’un lieu sur la zone pour s’organiser et se voir. Il y a eu plusieurs chantiers.
Jeanne : Après le CAC je suis rentrée chez moi régler quelques petites choses et puis je suis revenue très vite. Au début je pensais juste filer des coups de main, participer à ces chantiers. Quand même je commençais à me poser des questions. J’avais l’envie depuis un certain temps de me poser quelque part et pas mal de lassitude face à l’accumulation de luttes qui duraient quelques mois sans perspectives dans la durée.
Lætitia : Après, deux ou trois personnes se sont installées aux Planchettes, c’était à moitié une occupation parce qu’il y avait encore des locataires : des gens en galère, avec des embrouilles de santé. Dans le coin, les baux sur les maisons étaient très peu élevés mais l’entretien de la maison était à la charge des locataires. Et les travaux nécessaires étaient chers ou demandaient un travail physique que les personnes n’étaient pas en mesure de faire. Alors ils vivaient dans des maisons vraiment pourries. Ça leur allait qu’il y ait des cabanes construites à l’arrière de la maison. C’est à l’automne 2009 que ça a commencé. Ensuite les gens qui arrivaient se posaient là, le temps de trouver ailleurs, de construire, et il y a eu un mouvement d’entraide aux locataires restés aux Planchettes parce qu’ils avaient la pression d’assistantes sociales pour dégager. Ils étaient très isolés, très réacs et ne s’organisaient pas avec l’Acipa. Ils avaient plein d’embrouilles. Il y a eu de l’énergie de mise sur leur situation, avec des gens de Nantes, du milieu militant, qui venaient filer des coups de main. On s’est pas mal occupé.es de ça cet hiver-là.
Et puis, je ne sais pas comment c’est possible qu’aussi vite ça s’enflamme mais au printemps, il y a eu une flopée d’occupations, six ou sept en mai, c’est allé très vite : la Chèvrerie, le Tertre, les deux lieux au Pré Failly, Bel Air, la Saulce [5]... Ce n’était pas annoncé publiquement.
Jeanne : Le fait que des gens sautent le pas et s’installent, ça me faisait réfléchir. Je me disais « pourquoi pas ? » Ce qui se passe à ce moment et qui est vraiment fondateur de comment s’organise la zad c’est que tu pouvais débarquer ici, trouver un terrain, construire un truc et vivre peinard. Pendant trois ans ça s’est passé comme ça. T’avais pas besoin de te défendre, les flics ne débarquaient pas à chaque installation. T’arrives, tu te poses et tu fais ta vie ici. Ça a vraiment favorisé une structure de la zad très éclatée : pas besoin d’être ensemble pour se défendre, en tout cas à ce moment-là. C’est pas comme en ville où pour tenir un squat il faut être un peu nombreux.ses, être barricadé.es.
Et alors, comment s’est passée ton installation ?
Jeanne : Au début j’ai commencé à défricher un espace qui me plaisait et très vite je me suis dit que ça avait l’air bien comme endroit à vivre. J’avais vécu à la campagne quand j’étais môme, j’avais déjà fait des cabanes : elles se faisaient détruire par les chasseurs alors on construisait des pièges à chasseurs ! Ça a commencé tôt !
Depuis fin 2009, j’avais déjà passé plein de temps sur la zone : la lutte, des constructions d’autres lieux, du défrichage. J’avais déjà mes coins à champignons, j’en ai pas trouvé de nouveaux depuis. Finalement quand tu as tes coins à champignons c’est déjà que tu es installée !
J’ai monté ma cabane mi 2010, j’étais dans l’optique de construire vite : j’ai invité des potes et on a fait ça en dix jours, une grande pièce, un grand jardin. C’était un des premiers terrains occupés, je l’ai habitée toute seule sans me poser la question d’habiter en collectif.
Pour autant, je ne sais pas si je me projetais vraiment dans le long terme. Par contre, je savais que la lutte ici nécessitait beaucoup d’énergie, de temps, pour les rencontres, l’organisation, les discussions. Je n’avais pas envie de mettre trop de temps dans la construction, dans le chantier, à apprendre bien la charpente, à fignoler tout ça, mais je ne voulais pas être dans des difficultés matérielles. Avoir le confort, une certaine base matérielle ça permet de mettre de l’énergie à s’organiser parce que tu ne passes pas tes journées juste à trouver ta bouffe, te chauffer, ramener ta flotte, tes bougies... Pour moi c’était une évidence que l’habitation ne devait pas être une galère mais un espace de repos, où il fait chaud, où tu peux rentrer après des journées longues, vives émotionnellement. Ça c’est parce que je vieillis ! Dans mon premier squat on n’avait pas l’élec, je me suis dit : « plus jamais ! ». On a été plusieurs à devenir des experts en électricité parce qu’on en avait trop chié. Quand tu squattes, tu peux ouvrir ce que tu veux : nous on avait choisi une maison de maître, quatre mètres sous plafond, impossible à chauffer... une erreur de jeunes squatteur.euses. Une cabane, c’est très bien.
Et la police n’a pas réagi à ton installation ?
En fait les flics venaient mais faut voir que c’étaient les gendarmes du coin, le rapport avec eux c’était quelque chose d’un peu hilarant. À l’époque, moi, je me suis barrée pendant un contrôle : on était deux à vélo, on s’est fait arrêter et demander nos identités, nous on leur a dit qu’on n’avait pas de papiers et au bout d’un moment on est simplement remonté.es sur nos vélos et on s’est barré.es, et le flic il n’avait plus rien à faire, il s’est barré aussi. Une autre fois, on était dix à poser des banderoles à Notre-Dame... « Vos papiers ! » « Ben, non on va pas donner nos papiers » ! Et le flic : « Bon, puisque c’est comme ça on s’en va ». Et ils se sont barrés ! Ces flics de campagne n’avaient sûrement jamais été confrontés à des gens qui refusent de donner leur identité, ou en donnent une fausse, ils avaient souvent l’air démunis.
Ils ne sont pas venus quand j’ai construit ma cabane mais quelques semaines plus tard. J’étais hostile et eux étaient là à s’extasier : « Oh mais on dirait une véranda, et il y a plein de fenêtres » ! Pour les cabanes, les autorités ont mis du temps à réagir mais pour certaines, ils ont fait des procédures d’expulsion. Ça m’a valu une de mes meilleures expériences sur la zad. Pour une pote, ils ont assigné la mauvaise parcelle, elle voulait montrer ça au procès avec les photos aériennes de la Coord’ [6], parce que ça permettait de mettre fin à la procédure. Manque de bol, la personne qui avait les photos ne les a pas retrouvées. Là, Michel Tarin [7], qui est passionné d’ULM, me dit : « Qu’à cela ne tienne, rendez-vous demain matin ». On a pris un ULM et on est retourné.es prendre les photos, c’était fou, c’était la première fois de ma vie que je volais ! Ça rend dingue parce que tu vois tout d’un coup sans vraiment pouvoir rien voir, mais c’est magique. Depuis je voudrais bien faire une piste d’ULM ici. Aussi pour dire : « Voyez, l’aéroport on l’a construit nous-mêmes, on n’a pas besoin de vous. » Dans le fond, je ne suis pas contre les avions, tant qu’on les fait nous-mêmes !
Est-ce que vous pensiez aux expulsions ? Comment vous réagissiez au début des travaux ?
En fait si on s’installait c’était quand même dans la perspective que ça complique pour eux le fait de venir construire sur la zone, que ça les oblige à expulser et que l’on puisse résister. Donc tu construis avec pour ligne de mire l’expulsion. Mais tant qu’on n’avait pas de procès, on ne s’est pas concrètement posé la question de comment faire, de comment on allait résister. Cependant assez vite il y a eu des cabanes dans les arbres, des échanges de savoir là-dessus, c’est une bonne tactique pour compliquer l’expulsion, qui doit être menée par des flics spécialisés dans la grimpe.
À cette époque il y avait des petits travaux, des géomètres, des défrichages, et on n’était pas nombreux.ses sur place pour s’y opposer. Je me souviens d’un moment où il devait y avoir des géomètres sur le barreau routier : il fait 12 kilomètres de long ! Y’avait 20-30 personnes à cette période-là et on s’est réparti.es par petits morceaux, par équipes, avec des téléphones et des moyens de se donner des rencarts, pour se retrouver tou.tes et les bloquer. Ça, c’était tous les matins, pendant des jours et des jours. Il y a eu régulièrement des forages aussi. On mettait de l’énergie là-dedans, rapidement on a mis en place des réunions hebdomadaires pour s’organiser mais ce n’était pas évident, on venait de cultures politiques très diverses.
Comment vous organisiez-vous ?
Il y avait des structures comme la “cabane de résistance” où on faisait les réus, le supermarché des Planchettes où on partageait la récup’ [8], les légumes des terrains cultivés ensemble. Il y avait des réus régulières d’habitant.es, c’était pas facile, pas fluide. À un moment, on a décidé de prendre deux trois jours à réfléchir sur un mode assez différent : ne pas partir de nos envies, mais de ce dont la lutte aurait besoin, des structures qu’il nous fallait... J’en avais marre de partir de nos envies tout le temps, de l’individu, de ces engagements incertains en mode « Finalement j’ai pas envie, je suis pas là, c’est égal »... Il y a des formes d’engagement que je trouve un peu invivables, pas claires, pas très fiables. Là, c’étaient des réunions qui partaient dans l’autre sens, de la nécessité de faire certaines choses, qui se demandaient ce dont on avait besoin pour cette lutte. On a commencé à ce moment à causer journaux, site web, infotour [9].
Comment s’est passé l’infotour ?
Ça partait de l’idée de causer de cette lutte. On allait plutôt dans des lieux du milieu autonome, anarchiste. Il y avait déjà quelques comités locaux mais sur des bases très citoyennistes, c’est pas chez eux qu’on voulait aller à l’époque : on ne les connaissait pas, on se disait qu’on n’était pas sur les mêmes bases. On est parti.es parler de la situation à la zad, de lutte contre la métropolisation, sans avoir quelque chose de clair, un rendez-vous à proposer. On a parlé quand même des probables expulsions et du soutien dont on allait avoir besoin. On s’est posé la question d’aller parler avec des gens investis dans d’autres luttes territoriales où il n’y avait pas d’occupation mais on ne l’a pas fait. On a eu des bons débats parfois, avec des gens qui avaient une culture très urbaine, « Ça sert à quoi pour la révolution de planter des patates ?! » C’était vraiment intéressant parce que nous-mêmes on n’était pas d’accord entre nous là-dessus. On a rencontré pas mal de gens. Après c’est dur de dire comment l’infotour a joué sur le fait que la lutte prenne de l’ampleur.
Sur la zone, celles et ceux dont vous étiez les plus proches, ce sont sans doute les Habitants qui résistent qui avaient lancé l’appel à occupation ?
Bien sûr. Illes ont aidé pour le matos, filé des tonnes de trucs parce que les gens qui s’installaient avaient très peu de moyens matériels. Ça a même provoqué des craquages parce que ça devenait un peu trop une évidence que si tu avais besoin de quelque chose tu allais le leur demander. Illes n’avaient pas forcément l’habitude de poser des limites du genre « Ce soir je veux bien rester peinard chez moi ». Ça fait qu’illes ont souvent eu la sensation de se faire envahir. Et puis ce brassage de monde ce n’était pas toujours évident.
Et quels étaient vos rapports avec les autres composantes du mouvement ?
2010 c’est vraiment l’année où ça se construit ! À ce moment la zad était encore très déconnectée du “monde extérieur”. Les premier.es occupant.es étaient très en conflit avec l’Acipa. Quand illes avaient des réus avec des élus par exemple, on y allait ouvrir notre gueule, illes trouvaient que ça sabotait leurs discussions. Quelques personnes des assos d’opposant.es passaient quand même sur la zone, pour faire le lien, pour savoir ce qui se passait, parce que les infos ne circulaient pas par d’autres biais. Y’avait une tendance à vivre en autogestion dans son coin sans trop chercher à sortir de ça, le nez sur le nombril, à cracher sur les gens qui travaillent, qui vivent plus “normalement”. J’avais et j’ai toujours une grosse critique sur la tendance “communautariste” dans le mouvement d’occupation, dans le genre : « Nous on a raison, on est cohérent.es, le reste c’est de la merde ».
Par contre, y’avait globalement des bonnes relations avec les habitant.es du voisinage. Et ce n’était pas juste se dire bonjour, mais papoter, prendre le café ensemble, se filer des coups de main, c’était des liens assez forts parfois, des amitiés. Mais ça restait très déconnecté des bourgs autour, des gens plus loin. Et le fait de s’organiser était très lié au fait d’être ensemble à habiter sur la zad. Des gens de Nantes surmotivé.es par exemple ont été super saoulé.es assez vite après plusieurs tentatives de s’organiser avec nous depuis la ville... On était quand même plusieurs à avoir comme perspective assez forte de s’ouvrir sur l’extérieur, de s’organiser avec d’autres gens, sans trouver forcément comment le faire, comment donner de la consistance à cette intention. Ça prend du temps.
À des moments il y a eu des surprises, comme quand les huissiers sont passés la première fois, les occupant.es ont fait des affiches très alarmistes, en mode « Ça y est les expulsions commencent ! » Des gens de l’Acipa ça leur a fait péter un plomb ! « C’est pas parce que des huissiers passent que les expulsions commencent ! » Illes n’avaient pas tort. Il y a eu un appel à une assemblée générale sur la place de l’église à Notre-Dame et 80 personnes ont débarqué : on était sur le cul ! On ne savait pas qui étaient ces gens, d’où ils venaient. Cette assemblée s’est reconduite, sur la zone. Ça discutait aussi pendant des fêtes qu’on organisait, les guinguettes des Planchettes.
À l’été 2010 il y a eu aussi le pique-nique de l’Acipa. On y est allé.es en tant qu’occupant.es, faire un petit stand avec des photos de nos maisons, des textes et l’envie de rencontrer des gens. On n’y connaissait personne, on était super mal à l’aise, ça ne marchait pas fort, les gens n’en avait rien à cirer. Les prises de parole étaient déprimantes, le maire de Notre-Dame disait que ce n’était pas la peine de se battre parce que les porteurs du projet n’auraient jamais les financements, alors qu’ils étaient votés 15 jours après. L’ADECA [10] disait qu’illes se battaient pour garder un passage pour les tracteurs sous le barreau routier [11]. Tou.tes celleux qui prenaient la parole, à part les Habitants qui résistent, étaient très défaitistes. C’était à pleurer. Ou à hurler. Horrible.
Et avec les personnes dont tu te sentais proche, quel était votre état d’esprit ?
On allait régulièrement à la métropole faire des actions, envahir des bureaux, perturber des conférences. Les gens dont je me sentais plus proche à ce moment, on a toujours eu cette perspective, de se lier à d’autres gens, d’autres réseaux, d’aller du côté de Nantes, mais ça n’a rien donné de consistant. On était un groupe d’une dizaine de personnes critiques du “zado-centrisme”. On se calait le cul ensemble, on discutait et à un moment on se disait qu’on pouvait sortir un texte avec ça. On cherchait à élargir au-delà de la question de l’aéroport ou au moins à la placer dans une perspective plus large, régionale, d’aménagement du territoire. Ce sont des questions que des gens se posaient davantage à Nantes. On essayait d’avoir des problématiques qui dépassaient la zone.
Vous parliez de vous engager dans cette lutte sur des années ?
Je ne me souviens pas qu’on ait beaucoup abordé ce sujet entre nous, mais on était fort engagé.es ici, et fort engagé.es ensemble. Pour moi, la volonté du long terme, ça vient de ma vie en squat, d’en avoir marre de devoir tout recommencer tout le temps, changer de quartier, de collectif, de ville, toujours tout reconstruire. Ça fait que quand je suis arrivée ici c’était avec l’idée que si j’y mettais les pieds c’était pour au moins dix ans. J’ai toujours eu ça en tête. C’était vraiment plus facile à vivre comme ça, pour moi : de me dire que de toute façon j’étais là pour des années, ça permettait de penser des stratégies, des projets et des relations pas sur trois jours ou sur deux mois mais sur du moyen ou long terme. Bon, le problème, c’est qu’autour, y’avait beaucoup de gens qui ne se projetaient pas comme ça, et que des fois j’étais quand même un peu seule à vouloir regarder au-delà des trois semaines qui venaient.
C’est aussi à cette époque que sort le premier Lèse-Béton.
Oui, on sortait ce journal qu’on distribuait à 5000 exemplaires, dans toutes les boîtes aux lettres des villages autour, sans avoir de retour, parce que tu distribuais un canard mais rien ne te disait que des gens le lisaient ! C’est trois ans après que des gens, qu’on ne connaissait pas auparavant, nous ont dit qu’ils l’avaient lu. Des fois tu te faisais inviter à boire un café quand tu distribuais le journal, mais ça ne donnait pas lieu à des liens plus denses, des fois tu te faisais courser avec un bâton ! Tu t’activais mais tu n’avais pas les retombées, les retours de ce que tu menais... 2010 c’était comme ça.
En 2011, les choses ont changé ?
C’est l’année où c’est parti. C’était complètement fou. C’était le moment du contrat de concession à Vinci, des appels d’offres, des financements qui se mettaient en place. À l’hiver il y avait eu une enquête publique à Notre-Dame. C’étaient des moments vraiment bien, où l’Acipa appelait aussi à venir, y’avait du monde. La première fois on a bloqué l’enquête et la deuxième, comme on s’est dit qu’on n’y arriverait pas, qu’il y aurait trop de flics, on a fait une soupe, pour plutôt rencontrer du monde. Ça se passait toujours comme ça ici : la première fois ils venaient tout seuls ou avec pas beaucoup de flics et on leur mettait la misère, c’était jouissif, et la fois d’après ils étaient plein de flics et on faisait autre chose, ou on allait autre part, faire autre chose, genre bloquer des routes, envahir des bureaux, ou alors changer d’objectif et chercher à rencontrer des gens, expliquer nos points de vue...
Ça a été ça pendant des années. J’trouve ça balèze la capacité qu’on a eue de pouvoir changer de cible, d’objectif, de terrain plutôt que de se trouver impuissant.es devant les flics.
Ça faisait plus d’un an que sur la zad on s’organisait de façon collective, et il y a eu des projets d’appel public à squatter des lieux, ça a abouti au projet du Sabot en mai avec l’idée d’occupation collective au grand jour pour un projet maraîcher. Pour moi c’était super important. On n’avait jamais fait du battage autour d’une occupation, même pas un message sur Indymedia ! La situation des occupant.es était celle-ci : c’était peinard, tu t’installais et tu vivais là, tu allais faire chier les gens qui venaient pour les travaux, ou tu t’organisais pour avoir une structure de cuisine collective, ou pour faire des cabanes dans les arbres et perfectionner des techniques défensives, plein de trucs différents... C’était comme normal et anodin de prendre une nouvelle maison ou un terrain, je trouvais ça dommage ! Ça regarde tout le monde que ce soit occupé ici, cette lutte concerne plein de gens, il faut des moments où se retrouver à le faire ensemble, c’est obligé, c’est pas du ressort de l’individu qui vit ici, c’est du ressort de la lutte. C’est ça à mon avis qui était intéressant dans la manif-occupation du Sabot, c’est d’occuper ensemble, avec du monde, et pas juste celleux qui veulent vivre dans le lieu et leurs potes. C’est une année où le mouvement d’occupation a été vachement à l’initiative. L’Acipa elle ne l’était plus, ou moins. On a mené la danse, on a été très présent.es. Après cette manif-occupation, on était épuisé.es et on a appris qu’il y avait des forages à la Rolandière trois semaines plus tard.
Ce moment des forages, comment ça s’est passé avec les autres composantes du mouvement ?
À cette époque, on se voyait avec des gens de la Coord’, de l’Acipa et les occupant.es que ça intéressait : on discutait sur des sujets de fond et on se passait des infos, mais on ne discutait surtout pas de projets communs. C’était pour s’expliquer nos positions réciproques, on pouvait discuter, se prendre la tête sans enjeu de décisions à prendre. Il y avait aussi que ça devenait sûrement incontournable pour elleux de nous considérer sérieusement vu qu’on prenait grave de la place dans la lutte : ça a fait bouger des lignes, et au moins mieux comprendre des choses. On était beaucoup moins nombreu.ses qu’aujourd’hui et c’étaient des moments chouettes, et aussi nécessaires vus l’intensité des conflits et le bordel que ça foutait de toujours se tirer dans les pattes ! Par exemple, y’a une personne de l’Acipa qui a dit, une fois : « Votre article dans Lèse béton sur la question de la violence et de la non-violence ça m’a fait réfléchir ». Et quelques mois après tu le retrouves au micro, il veut parler de non-violence et il n’y arrive pas trop, il cherche un autre mot, il n’y arrive plus à dire ce mot-là. Quand même !
Ces forages, c’est là qu’on a fait les premières barricades avec un peu de monde. Je me souviens qu’avant l’action contre les forages, des représentants de l’Acipa sont passés aux Planchettes pour dire qu’il n’y avait pas moyen d’enflammer des barricades, « Le feu c’est dangereux, la population va se retourner contre nous, c’est pas possible que les pompiers viennent pour ça, etc. ». Une barricade enflammée, il y en a eu une quand même, et le soir même on se faisait offrir des centaines de pneus ! C’est comme ça, souvent, que les choses avançaient, on allait toujours un peu plus loin. Par exemple un jour y’en a qui vont à une réu de l’Acipa pour leur dire qu’une machine de chantier a été abîmée, et elleux d’interroger le sourire en coin : « Alors, vous avez mis du sable dans le réservoir ? ».
Comment faisiez-vous pour lutter contre les forages ?
Les forages, ils se sont faits mais on a été fort.es quand même. Le premier jour il s’est passé plein de choses, des gens allongés sur les routes, des barricades, des gens dans les haies, des trépieds géants en haut desquels étaient juchées des personnes pour bloquer l’accès du terrain, un lancer de troupeau de vaches sur les flics, des gens qui contournaient avec, du coup, les gaz qui se rabattaient sur les foreurs et les empêchaient de bosser. C’était cent ou deux cents personnes, avec une rare diversité tactique. Le lendemain on se sentait plus impuissant.es, parce qu’ils avaient mis en place un gros dispositif, et que les autres plans possibles ont foiré.
Quand même, la pratique d’action directe sur le terrain se généralisait ?
Il se passait des choses tous les jours. Il y avait Biotope par exemple, un bureau d’études environnementales, qui était payé par Vinci pour venir sur la zone faire des relevés. Ça voulait dire deux ou trois naturalistes qui traînaient dans le bocage et quand on tombait dessus on faisait des trucs. Ils se faisaient crever les pneus, engueuler, dégager, piquer le matos, y’a eu des actions dans leurs locaux, ça n’arrêtait pas. Aux Planchettes il y avait une boîte pour mettre des mots sur les actions qui se passaient, comme ça on savait ce qui se faisait, c’était presque tous les jours, mais sans savoir de qui ça venait. Après les forages par exemple, il y avait un message qui expliquait que des gens avaient saboté une foreuse pendant la nuit et avaient laissé un petit mot explicatif aux ouvriers, accompagné d’un pack de bières. Pas longtemps après, je me souviens d’une personne de l’Acipa arrivant avec un article de journal et le sourire aux lèvres : l’entreprise en question avait renoncé aux travaux. Plein de gens jubilaient quand il se passait des trucs comme ça, même s’ils avaient peur que ça aille trop loin, et qu’ils n’étaient pas prêts à le faire eux-mêmes. Mais dès que c’étaient des actions hors de la zone, ça donnait lieu à des dissociations bien dégueu dans les journaux de la part des assos.
Cette année-là, comme l’année précédente, on a décidé d’aller au pique-nique de l’Acipa. En un an il y avait eu toutes ces actions, en ville, contre les forages, contre Biotope, le pique-nique était très remonté. Le mot d’ordre était « Vinci, dégage ! » et ça n’est évidemment pas déconnecté de tout ce qu’on avait fait. C’était plutôt agréable parce qu’on disait ça tout le temps, « Vinci dégage », c’était un peu comme s’ils avaient repris notre mot d’ordre.
On peut dire que le temps a joué en faveur du mouvement d’occupation, non ?
Je pense en effet que ce qu’on a eu de plus précieux, et c’est encore le cas maintenant, c’est le temps. Je me rappelle que quotidiennement je me disais : « Chaque jour, chaque semaine qu’ils nous laissent en plus ici, c’est trop précieux », parce que ça avançait tellement vite ! À ce moment-là c’était vraiment fou, on s’organisait tout le temps, on avait dix mille idées chaque jour de ce qu’il fallait faire absolument ! Il y avait sûrement beaucoup moins d’énergie mise pour la vie quotidienne de la zone que maintenant. Le résultat s’est révélé pendant les expulsions en 2012. Vous n’imaginez pas combien de fois en trois ans on a parlé de réseau d’urgence, de communication sur la zone s’il fallait se retrouver vite tous ensemble au même endroit. On y a mis une énergie dingue, à plusieurs reprises, avec des répétitions générales, mais ça ne prenait pas, parce qu’il n’y en avait pas vraiment le besoin immédiat ! Le jour des expulsions ça a marché parce qu’on avait fait ce travail avant, et que cette fois c’était vraiment nécessaire : ça n’est pas sorti de nulle part.
À l’époque tu peux passer sur la zad sans voir que c’est un territoire en lutte. Est-ce qu’il y a eu une envie de rendre l’occupation plus visible ?
L’envie, oui mais on ne l’a jamais fait sérieusement. On parlait de mettre des panneaux sur le bord des routes, de la signalisation, des fois on posait des banderoles mais elles ne tenaient pas longtemps. Je me souviens de nuits à aller écrire, peindre sur les routes des grands slogans. Mais ça ne ressemblait pas à maintenant. À un moment on a décidé de se poser une fois par semaine au carrefour des Ardillières avec du café, du thé et des tracts. On invitait les automobilistes à s’arrêter. Ça a donné des moments de partage chouettes. On n’a pas tenu ce rendez-vous très longtemps. Et c’est dommage. Ce qu’on a tenu bien c’est le journal Lèse-Béton, on a sorti quatre numéros distribués à des milliers d’exemplaires. C’était une propagande massive.
Un copain disait qu’il avait eu l’impression de vivre planqué pendant cette période, dès qu’il y avait des flics ou un hélico. Tu as ressenti ça ? Ce paradoxe entre l’occupation d’un espace public et l’envie de se faire tout petit ?
Ce n’est pas tant un paradoxe qu’un rapport à la répression. Des questions d’anonymat, de sécurité, de répression en général. C’est sûr que ça referme pas mal. En même temps, il y a eu peu de procès avant 2012. Les flics ont toujours été emmerdés à venir choper des gens sur la zone, même si ça s’est fait, par exemple à la Gaité ou à la Saulce, avec un gros débarquement de flics suivi de perquisitions et de l’arrestation d’une personne. Tu sentais qu’ils venaient dans un lieu, ils n’y comprenaient rien, ils n’avaient pas les personnes qu’ils voulaient, ils montraient des photos : « Vous connaissez cette personne ? », personne ne connaissait évidemment, mais de toute façon ils n’étaient vraiment pas au bon endroit. Bon, il y avait des lieux qui étaient identifiés médiatiquement, comme la Saulce, considérée comme LE lieu des radicaux internationaux venus pour foutre le pays à feu et à sang, ça se basait sur rien du tout mais du coup, il y a eu des perquisitions là-bas.
À l’été 2011, pendant trois semaines, un camp anti-G8, le “No G”, se tient sur la zad. Tu veux en dire deux mots ?
Moi j’étais contre, laisse tomber ! On était plusieurs, qu’est-ce qu’on a bataillé ! Il faut dire qu’il y a toujours eu un grand conflit ici : d’un côté il y avait celleux qui voulaient inviter le plus de monde possible à venir occuper et qui pensaient que ça allait nous donner de la force d’être nombreux.ses. De l’autre celleux qui privilégiaient la densité, la qualité des liens et de l’organisation qu’on avait entre nous. Moi j’ai toujours dit que ce n’était pas la peine d’inviter la terre entière si on n’était pas capable d’avancer plus sur place. Le No G arrivait en plein dans ce conflit. Un camp activiste, plein de gens qui ont déboulé, des intentions qui nous paraissaient floues... En fait il y a toujours eu des arrivées de gens et ça prend vachement de temps de les accueillir, se rencontrer, fabriquer de la confiance, savoir sur quoi on va pouvoir se retrouver. Savoir se situer. Savoir ce qu’on peut partager ou pas. Alors pour moi c’est dur l’arrivée continuelle de plein de gens parce que ça ne donne pas le temps de trouver de la consistance. Je vois ça comme une fuite en avant. Je n’avais pas envie de voir arriver plus d’activistes, je cherchais plutôt le lien avec d’autres réseaux, localement, un ancrage ici. Ça m’intéressait plus d’être organisé.es fortement, d’avoir la capacité d’organiser des événements avec un peu d’ampleur, et d’inviter plein de monde seulement à des moments précis, avec des objectifs précis.
Tu avais peur que ce ne soit que des gens de passage, qui prennent plus d’énergie qu’ils n’en amènent ?
Oui, après c’est vrai qu’il y a plein de gens qui sont restés, un paquet. A posteriori c’était bien. C’est aussi avec eux que je m’organise maintenant.
C’était pendant le campement No G aussi qu’il y a eu l’action à l’aéroport Nantes-Atlantique : on est allé.es occuper l’aéroport. C’était peut-être la première action commune avec la Coord’. C’est parti en live avec les flics parce que des gens sont allés vers les bureaux. Il y a eu quelques trucs de balancés mais à peine, les flics ont blessé des personnes dont une gravement. Après ça a été des prises de tête incroyables avec l’Acipa, sur la question d’être offensifs avec les flics, peut-être aussi le moment de se rendre compte qu’on n’avait pas forcément la même vision d’une action d’occupation : on avait repeint en vert pas mal de trucs, ils devaient pas s’attendre à ça, ça allait un peu trop loin.
Tu peux raconter comment s’est faite cette recherche de lien avec d’autres réseaux que tu présentes comme un de tes objectifs principaux ?
On avait la volonté de s’adresser directement au monde extérieur. On allait aux discussions avec l’Acipa, la Coord. À Nantes, quand la ville est devenue capitale écologique, on a eu des liens avec des associatifs mais rien de bien concluant. Mais l’important c’était d’arrêter de se regarder le nombril ! On avait l’envie forte de s’ouvrir sur du local, sur les bourgs alentours. Comme on occupait pour que Vinci ne puisse pas prendre le terrain, il s’agissait de se trouver des allié.es, on n’allait pas les en empêcher aux 50 qu’on était ! Alors il y a plusieurs optiques : ou tu invites des bandes de potes d’un peu partout, les radicaux, et ça c’était moins ma perspective, ou, à un moment, tu essaies d’être ancré.es et soutenu.es localement ! Ça ne veut pas dire que je ne veux pas compter sur les coups de main des potes d’ailleurs mais qu’il y a vraiment la nécessité d’un rapport de force ici, au quotidien, et pas uniquement dans les grandes occasions. Et le “ici” ça ne veut pas dire habiter la même maison, pisser dans les mêmes chiottes, et être occupant.es, c’est tout un tas d’autres personnes avec qui on peut tisser des choses, trouver des complicités. Et puis il y a la nécessité de penser la transformation du monde au-delà de nos réseaux activistes, de faire courir plus loin des visions du monde, des pratiques.
En fait il a fallu attendre 2012 pour voir tout ça porter ses fruits, se rendre compte que plein de gens qu’on ne captait pas étaient attentifs à la zad. C’est comme lancer une bouteille à la mer, tu sais pas ce que ça va donner !
La suite au prochain épisode...
[1] Première maison occupée, en 2007, sur la zone, par des personnes issues du mouvement squat nantais en lien avec les "Habitants qui résistent" et quelques paysans en lutte (cf.chronologie). Voir la carte des lieux cités à la fin de la brochure.
[2] Réseau international de sites internet indépendants d’informations alternatives. Il en existe une version locale à Nantes.
[3] La Direction Interdépartementale des Routes de l’Ouest, dépend du ministère de l’Environnement.
[4] Association Citoyenne Intercommunale des Populations concernées par le projet d’Aéroport, voir la chronologie pour une succincte présentation des différentes composantes de la lutte.
[5] La Chèvrerie, parce que des chèvres y sont installées, les autres sont des lieux-dits sur la zone ou en bordure.
[6] Créée en 2004, la Coordination des Associations anti-aéroport regroupe une cinquantaine d’associations, partis et syndicats.
[7] Une des figures locales historiques de la lutte, il est décédé à l’été 2015.
[8] La pratique de la « récup », telle qu’évoquée ici, consiste à aller fouiller les bennes à l’arrière des supermarchés pour y récupérer la nourriture consommable mais mise au rebut du fait des logiques marchandes (date limite de consommation dépassée, emballage ou « pack de 10 » dont un élément est abîmé, etc.)
[9] Tournée de soirées d’information (dans des lieux collectifs, associatifs, publics, etc.) à propos de la lutte contre le projet d’aéroport et son monde.
[10] Association de Défense des Exploitants Concernés par l’Aéroport, voir chronologie.
[11] Voie rapide planifiée au sud du projet d’aéroport pour desservir celui-ci.
)
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (1.7 Mo)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (1.6 Mo)