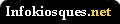C
Contester ou cogérer ?
Sur la lutte contre le barrage du Testet à Sivens, et les leçons que l’on peut en tirer pour l’avenir des luttes territoriales
mis en ligne le 23 octobre 2020 - Anonyme , Des habitant⋅e⋅s du Tarn
Aujourd’hui, l’État est l’incarnation officielle du pouvoir politique, il garantit l’ordre public et constitue le « monopole de la violence » considérée comme « légitime ». Face à lui, l’attitude des militants engagés dans les luttes territoriales (et non « écologistes », comme le disent les journalistes pour en réduire radicalement le contenu et la portée) liées aux projets d’aménagements du territoire et aux « zad » (zones à défendre) qu’ils suscitent, tend à prendre deux formes : la contestation et la cogestion.
Contester signifie mettre en doute, dénier à une institution et à ses agents le droit de gestion dont ils prétendent disposer au point, éventuellement, de les traiter en ennemis. Quand on conteste un projet d’aménagement du territoire, on se méfie de l’État, acteur du conflit qu’il s’agit de destituer symboliquement et matériellement, au lieu de lui reconnaître la légitimité dont il se pare. Il s’agit de faire sans lui et, éventuellement, contre lui. Car le dialogue ne suffit pas, il faut d’abord établir un rapport de forces. Logiquement, l’attitude contestatrice tend à élargir l’objet précis de la lutte à l’ensemble de l’ordre établi : ce n’est pas seulement contre un aéroport que l’on se bat, mais contre « l’aéroport et son monde », c’est-à-dire contre l’ensemble des institutions et des logiques qui génèrent ce genre de projet, contre le « système » et l’État qui le protège. En ce sens, la contestation tend à être radicale : elle prend les problèmes à la racine et n’hésite pas à entrer « en résistance ». Au sens fort, la contestation est tendanciellement antiétatique et subversive, voire insurrectionaliste.
La cogestion désigne au contraire une attitude de dialogue, de compromis et de coopération avec des autorités considérées non comme des ennemies, mais comme des partenaires ou, au mieux, comme des adversaires au sein d’un système auquel on adhère. Cogérer, c’est collaborer avec les institutions, participer à leur travail de gestion, estimer qu’on ne peut pas faire sans elles ou en dehors du cadre qu’elles proposent. En l’occurrence, l’État est considéré comme un arbitre neutre, une plateforme incontournable pour résoudre les conflits par la discussion. Ce n’est pas le bras armé des classes dominantes, mais la chose publique qui nous appartient tous : « l’État, c’est nous ». Il ne s’agit donc pas d’en contester le rôle et la légitimité, mais de circonscrire l’objet du litige dans une attitude d’experts ou, plus précisément, de contre-experts qui ont des alternatives à proposer. L’objet du conflit est moins le révélateur d’un « système » à abattre qu’une « défaillance » à corriger – et même quand on admet que le problème est « systémique », le sentiment qu’« il faut bien faire quelque chose » conduira à des positions cogestionnaires toutes celles et tous ceux qui ne se font plus suffisamment confiance pour faire quoi que ce soit sans les pouvoirs publics. Le problème n’est pas politique, mais technique : on ne met pas en cause la société en général, mais un projet bien précis, dans tous ses détails – et s’il est politique, c’est au sens où il faut tenir compte de « tous » les acteurs (surtout ceux qui ont un poids politicien). Plutôt que de s’opposer à l’État, il s’agit de corriger ses « dysfonctionnements » et de compléter son action, c’est-à-dire de se constituer en organes paraétatiques pour l’assister ou le ramener dans le droit chemin. Ces organes sont « paraétatiques » dans la mesure où ils sont de droit indépendants de l’État (ils ne relèvent pas de la fonction publique, mais du secteur associatif), tout en collaborant étroitement avec lui comme auxiliaires, voire en assumant les missions qu’il leur confie et que, le plus souvent, ils ne peuvent refuser en raison des subventions qui les rendent de fait dépendants de lui.
Cette attitude consistant à faire collaborer des acteurs opposés afin de désamorcer leurs conflits potentiels s’enracine historiquement dans deux types de dispositifs politiques d’ingénierie sociale : la participation des représentants des salariés à l’administration des entreprises en Allemagne (où l’on parle de Mitbestimmung, de codétermination ou de codécision) et le co-pilotage de la politique agricole française par l’État et la profession depuis la fin des années 1960. La cogestion est d’abord née dans l’Allemagne d’après-guerre et a consisté à instaurer des conseils d’entreprise, impliquant des délégués des salariés, pour assurer certains aspects de la gestion de l’entreprise (conditions d’hygiène, de mise à pied, etc.). Cette « gestion paritaire » devient obligatoire en 1976 pour les entreprises de plus de 2000 salariés et constitue le pilier de « l’économie sociale de marché » allemande. Si les délégués des salariés ne cogèrent pas l’entreprise à proprement parler (ils ne décident pas du montant des salaires), leur approbation est nécessaire pour certaines décisions. Ce type de « gouvernance décentralisée » (opposé à la corporate governance qui donne un primat absolu aux actionnaires) vise à assurer le dialogue social entre des acteurs qui n’ont pas les mêmes intérêts. En France, la notion de cogestion renvoie plutôt au partenariat qui s’est établi entre les représentants de l’État et les dirigeants de la profession agricole (en fait ceux des syndicats majoritaires) dans l’élaboration des politiques qui ont permis la modernisation de l’agriculture française, c’est-à-dire son industrialisation 1. Elle s’est concrétisée dans les « conférences annuelles » et les « mardis mensuels » qui, dans les années 1970 et 1980, ont constitué autant de rendez-vous rituels entre le ministre de l’agriculture et les présidents des organisations professionnelles agricoles. Ici aussi, il s’agissait de faire collaborer des acteurs que tout aurait pu et dû opposer, tant la modernisation de l’agriculture poursuivait des intérêts qui étaient tout sauf « paysans » – raison pour laquelle les syndicats paysans minoritaires ont en général dénoncé cette collusion entre l’État et le syndicat cogestionnaire qu’est la FNSEA.
Au sein des luttes territoriales actuelles, ce clivage se manifeste dans l’existence de deux types de composantes : les zad et les associations de citoyens. La composition de chaque lutte est bien sûr plus complexe, et il serait faux de penser que les « zadistes » sont forcément contestataires (au sens fort qu’on vient de définir) et que tous les « citoyens » sont nécessairement cogestionnaires. A Roybon, l’association cogestionnaire PCSCP (Pour les Chambarans sans Center Parcs) fait face à la zad avec ses différents comités de soutien 2. A Notre-Dame-des-Landes, la composition est plus complexe : outre la zad et l’Acipa (Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes), il y a le groupe informel « Des habitants qui résistent », hostile à la cogestion 3, ainsi que Copain44 (Collectif des organisations professionnelles agricoles indignées par le projet d’aéroport) et les « naturalistes en lutte » qui sont manifestement traversés par la tension entre contestation et cogestion. A Sivens, cette polarité a pris, on le verra, la forme bien nette de deux collectifs différents.
La catégorie de « zadiste », montée en épingle par les médias et rejetée par nombre d’occupants des zad, ne désigne aucune réalité homogène, ni socialement, ni politiquement, ni idéologiquement : le « zadisme » n’existe pas, il n’y a que des zad, c’est-à-dire des espaces occupés par des gens très divers (anarchistes, féministes, primitivistes, etc.), dont certains peuvent avoir, selon les circonstances, des réflexes tout à fait cogestionnaires. Inversement, les associations de citoyens qui regroupent les riverains et les locaux opposés au projet comptent parfois dans leur rang des éléments contestataires et même « révoltés » – en général, ce ne sont pas les porte-parole et plus on monte de la base vers le conseil d’administration, plus l’attitude cogestionnaire domine. Entre la contestation « pure et dure » et la simple cogestion, il y a en fait toute une gamme d’attitudes et de stratégies intermédiaires. Ces deux termes ne désignent pas les deux ensembles bien nets et étanches d’une dichotomie, mais les deux pôles d’un continuum entre lesquels la plupart des militants oscillent, en fonction de plusieurs facteurs : leur parcours politique et le point où ils en sont (notamment s’ils nourrissent des ambitions personnelles), la composition de la lutte et la manière dont elle évolue, le rapport de force avec les porteurs du projet et les chances de victoire, le rôle que joue l’État et le contexte politique général. Seule une infime minorité des opposants correspond clairement à l’une des deux positions que je viens de dégager : la plupart se situent dans l’entre-deux ou passent de l’une à l’autre. Il n’en reste pas moins que l’on retrouve cette polarité dans nombre des mouvements de lutte, aujourd’hui comme hier.
Dans les luttes sociales centrées sur la question de l’exploitation du travail, cette polarité a pris la forme de l’opposition entre réforme et révolution qui a clivé le mouvement socialiste à la fin du XIXe siècle. Face à la question sociale posée par le paupérisme (une forme inédite de misère touchant non les vagabonds sans travail, mais les travailleurs victimes de la nouvelle organisation capitaliste du travail), la première réaction massive fut de penser qu’une nouvelle révolution était nécessaire, une révolution sociale venant compléter la révolution seulement politique de 1789. Il s’en est suivi toute une série de tentatives révolutionnaires, s’achevant le plus souvent en bains de sang. C’est alors que le réformisme se constitue comme troisième voie entre le maintien du statu quo et le renversement révolutionnaire, prônant une nouvelle politique des petits pas en avant, la « politique sociale » qui a pour effet de désamorcer le potentiel explosif des passions politiques. Face aux révolutionnaires qui estiment qu’il faut combattre les institutions (notamment étatiques) pour renverser le système, les réformistes défendent l’idée de s’immiscer dans le jeu des institutions, et notamment des élections, afin de faire évoluer le système de l’intérieur : au lieu de prendre le pouvoir par les armes, il s’agit de le prendre par les urnes afin d’améliorer progressivement les conditions de vie et de travail. C’est peu à peu cette voie que le mouvement socialiste a prise, dans le sillage de la puissante social-démocratie allemande dont le tournant gestionnaire est consommé dès la fin du XIXe siècle, malgré le maintien d’une phraséologie révolutionnaire. Ce faisant, les dirigeants politiques et syndicaux sont entrés dans les salons du pouvoir et, même quand ils avaient à l’origine des objectifs révolutionnaires, se sont mis à jouer un rôle de médiation entre la « base » et les classes dirigeantes, c’est-à-dire d’encadrement de la contestation, de cogestion du système capitaliste et des crises (sociales et politiques) qu’il entraîne. Pour le dire avec Herbert Marcuse 4, les forces d’opposition ont dès lors été « intégrées » au système – elles se sont transformées en organes paraétatiques de cogestion du capitalisme.
A partir des années 1980, ce n’est plus dans ces termes, réforme ou révolution, que la différence de rapport à l’État pouvait être posée. D’une part, l’intégration du mouvement ouvrier a considérablement obscurci l’horizon révolutionnaire (du moins sous sa forme de révolution prolétarienne) et fait du réformisme la politique officielle des classes dominantes (dont le propos n’est plus tant de conserver que de moderniser, pour adapter la société aux exigences du capital). D’autre part, la dégradation des conditions de vie a suscité de nouvelles luttes dans lesquelles les anciennes médiations, les partis de gauche et les syndicats ouvriers, n’avaient aucune influence ou presque – et ces luttes sont devenues de plus en plus explosives, notamment autour du nucléaire. Il fallait de nouveaux outils et de nouveaux interlocuteurs pour gérer une contestation nouvelle, qui ne se situait pas sur le terrain du travail et du pouvoir d’achat, mais plutôt (au moins en partie) contre eux. Et c’est ainsi que la « démocratie participative », antidote à la démocratie directe, a été introduite en France avec toutes ses petites recettes : les « forums citoyens » ou « hybrides » (mêlant experts et riverains, politiques et associatifs, avec bien sûr quelques experts en communication), la « consultation » publique, la concertation, etc. Quant aux interlocuteurs, l’État les a cherchés parmi les naturalistes et les environnementalistes, plus enclins à la contre-expertise scientifique qu’à la lutte politique, et tout à fait disposés à siéger dans nombre d’organes étatiques (comme le Conseil économique et écologique) et paraétatiques. Ce faisant, comme l’a montré le journaliste écologiste Fabrice Nicolino à propos de Greenpeace ou du World Wild Fund 5, il les a bien sûr dévoyés, s’en servant pour calmer les ardeurs et diviser les mouvements d’opposition au saccage industriel de la nature. Au début des années 1990, lors de la lutte contre le projet d’enfouissement des déchets nucléaires, le torchon brûle entre ceux qui veulent « supprimer les nuisances » et ceux qui n’aspirent, actant la politique étatique du fait nucléaire accompli, plus qu’à les « gérer » 6.
Comment penser les rapports entre ces deux formes d’engagement : peuvent-elles, comme on le souhaite souvent la bouche en cœur, se combiner et se renforcer, à quelles conditions et jusqu’à quel point ? Quels sont les dangers de ce genre d’alliance, et peut-on s’en prémunir ? Comment les autorités tirent-elles parti de cette division, et comment pouvons nous en tirer parti ? L’histoire de la lutte contre le barrage du Testet dans la forêt de Sivens (Tarn) peut nous donner des éléments de réponse. Après une première phase de constitution de l’opposition, et de coopération étroite entre ses deux principales composantes, la violence croissante de la lutte sur le terrain a fait monter la tension entre elles. Finalement, l’État a repris la main sur le terrain en jouant la double stratégie de la carotte participative (pour la frange cogestionnaire de l’opposition) et du bâton répressif (pour ses éléments contestataires).
La cogestion se sait impuissante et suscite la contestation
L’idée d’aménager la vallée du Tescou, dans la forêt de Sivens, est un vieux projet qui remonte à la fin des années 1960 mais a longtemps buté sur l’opposition des habitants, notamment paysans. En 1969, c’est d’abord un vaste complexe touristique que les aménageurs envisagent, avec plan d’eau, hippodrome et héliport. Mais les habitants s’organisent en association de défense et l’idée est abandonnée. En 1978, un nouveau projet de barrage à finalité agricole est envisagé, sans susciter plus d’adhésion. Cinq ans plus tard, les aménageurs reviennent à la charge mais ne peuvent accéder aux terrains afin de réaliser les études préparatoires. Ce n’est qu’en 2001 qu’ils y parviendront, à la faveur du décès et du départ de certains paysans et de l’attitude plus conciliante de leurs successeurs. Et en 2009, la CACG (Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne), désignée maître d’œuvre et maître d’ouvrage délégué par le conseil général du Tarn (CG81), présente le projet de barrage au Testet qui va faire couler tant d’encre, et même du sang 7.
Une nouvelle opposition se constitue en 2011, au-delà des seuls paysans qui ne font plus front commun : c’est la naissance du Collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet (désormais « collectif-Testet »), qui regroupe des écologistes locaux (habitants sur ou autour de la commune de Lisle-sur-Tarn) et diverses associations (régionales et nationales) de défense de l’environnement (Les Amis de la terre, France Nature Environnement, Nature Midi-Pyrénées, etc.). Il se lance dans un travail, excellent dans son genre, de contre-expertise : il demande l’accès aux études (refusé par les autorités tarnaises, il les obtient en saisissant la Commission d’accès aux documents administratifs), vérifie les chiffres allégués et démonte l’argumentation des barragistes : les chiffres sont falsifiés (les besoins en irrigation, notamment, sont exagérés) et les alternatives n’ont pas été envisagées. En outre, il y a des soupçons de « conflit d’intérêt » (un élu siège à la fois au CG81, décideur, à la CACG, maître d’œuvre, et à l’Agence de l’eau Adour-Garonne, qui finance le projet). Le collectif-Testet fait aussi un travail d’information locale et propose à diverses reprises au président du CG81, Thierry Carcenac, un débat public et contradictoire qu’il a toujours refusé – de même qu’il maintient le projet malgré toute une série d’avis consultatifs défavorables, dont l’approbation était pourtant censée « conditionner » l’autorisation des travaux.
C’est qu’il y a un précédent dans les années 1990 : les mêmes acteurs (le CG81, déjà présidé par Carcenac, et la CACG) avaient un projet de barrage à Fourogue, près d’Albi, lui aussi contesté. Ils le réalisent sans respecter un arrêt du tribunal administratif de 1997, confirmé en cours d’appel en 2000, rendant le barrage illégal. Belle victoire juridique pour l’avocat de l’opposition, Bernard Viguié (dont on va réentendre parler), mais le mal est fait : le barrage est là et, comme les opposants le craignaient, il est surdimensionné et fonctionne à perte. Pour les autorités, la morale de l’histoire est qu’il suffit de passer en force ; pour les opposants, que la lutte médiatique et juridique est vaine quand on ne parvient pas à entraver les travaux, même si l’on est certain d’avoir le droit de son côté.
En 2013, le projet de barrage au Testet est approuvé par le conseil général et la préfecture signe les déclarations d’intérêt général et d’utilité publique (DIG et DUP) permettant le lancement des travaux. Au sein du collectif-Testet, les débats sont houleux : face à l’obstination des autorités et vu le précédent de Fourogue, certains estiment qu’on ne peut plus se cantonner à la stratégie purement légaliste que le collectif a toujours revendiquée, qu’il faudrait être capable d’occuper le terrain (comme cela s’est fait sur la zad de Notre-Dame-des-Landes depuis 2007 ou entre 1988 et 1993 contre le barrage de Serre de la Fare), au moins le temps d’obtenir une victoire juridique. Mais le strict légalisme l’emporte dans le collectif-Testet. Ses membres les plus activistes, dont un ancien de Greenpeace, Ben Lefetey, vont alors participer à l’émergence d’un autre collectif, complémentaire car non légaliste, dont l’intention est d’occuper le site pour bloquer les travaux. « Tant qu’il y aura des bouilles » (désormais « les Bouilles ») est fondé le 13 octobre 2013, juste après la signature de la DIG et de la DUP par la préfecture. Ce collectif fédère des militants tarnais de longue date, notamment un collectif qui venait de s’installer dans une ferme proche et dont le but était de lutter en faveur d’un territoire habitable, quelques jeunes du coin, des membres du collectif-Testet et des soutiens toulousains à la zad de Notre Dame des Landes, qui se demandaient justement où « lancer une zad » dans le sud-ouest.
A la naissance de ce nouveau collectif, il y avait une division implicite du travail militant : le collectif-Testet s’occupe du versant légal, c’est-à-dire juridique et « médiatique » (au sens des mass-médias classiques, journaux et télévision, car en ce qui concerne l’internet, les Bouilles avaient leur propre site), de la lutte, et les Bouilles de l’occupation des lieux afin d’empêcher les travaux. Cette division témoigne d’une nette différence d’esprit, quand bien même certains opposants ont longtemps milité dans les deux collectifs. C’est ce qui ressort du communiqué de fondation des Bouilles le 13 octobre 2013 :
« Considérant les ravages occasionnés par les pouvoirs en place, au premier rang desquels la colonisation des territoires par toutes sortes d’artifices, l’enfermement de la vie biologique dans une multitude de contraintes, la confiscation des responsabilités de l’organisation de la vie collective, le mouvement Tant qu’il y aura des bouilles, constitué les 12 et 13 octobre 2013 à la Métairie Neuve de la zone humide du Testet, et immédiatement en action, proclame :
1) Qu’au regard des intérêts humains dans leur ensemble, le projet de barrage du Testet ne possède ni raison d’être ni fondement légitime.
2) Que le processus qui a conduit aux arrêtés de déclaration d’intérêt général et d’utilité publique met en évidence, comme pour la plupart des grands projets inutiles et imposés, la collusion d’intérêts d’affairistes privés et publics.
3) Qu’en conséquence il est plus que temps pour toutes celles qui entendent assumer des responsabilités historiques de s’opposer au cours des choses aberrant qui affecte les paysages de nos vies.
Tant qu’il y aura des bouilles appelle donc à la tenue régulière d’une assemblée populaire sur la zone humide du Testet. Il s’agira de s’émanciper des formes de gouvernance oppressive et de délibérer des questions qui, en principe dans une démocratie, reviennent aux citoyens. »
Le point central de divergence avec le collectif-Testet est manifestement le rapport au(x) pouvoir(s), à la fois en interne et dans la société. Alors que cette question n’est pas au cœur des réflexions du collectif-Testet, les Bouilles mettent directement en cause les « pouvoirs en place », accusés de ravager les territoires, et appellent à s’en « émanciper » par un processus de démocratie directe. Ce positionnement se traduit par une tout autre organisation que le collectif-Testet : alors que ce dernier est un montage institutionnel complexe, avec un conseil d’administration décisionnaire, les Bouilles sont un « collectif informel » qui s’organise en assemblée ouverte. Un an plus tard (dans un texte d’autoprésentation daté du 19 janvier 2015), les Bouilles reviennent sur leur spécificité en précisant que ce qui les caractérise, c’est avant tout la pratique de l’assemblée :
« TQB [les Bouilles] se réunit en Assemblée Générale une fois par semaine ou presque. Les AG sont publiques et ouvertes à tou-te-s, souveraines et décisionnaires. Les décisions se prennent au consensus. Ceci signifie qu’une décision ne peut être prise au nom du collectif TQB que s’il n’y a pas d’opposition formelle. »
Et bien sûr, cette aspiration à l’autonomie se double d’une critique radicale de toute forme de collaboration avec les autorités établies :
« TQB se méfie de toute entente avec les pouvoirs du monde finissant qu’il entend destituer. Pour des raisons tactiques nous pouvons parfois les rencontrer, en aucun cas être partenaires. Si des trêves peuvent être envisagées, nos aspirations ne sont pas négociables pas plus qu’elles ne sont compréhensibles par l’adversaire. Il n’est pas de notre ressort de nous engager dans des négociations d’ordre technique ou dans tout autre processus utile au maintien de l’ordre ancien du monde du barrage. »
Dans ce même texte, les Bouilles précisent par la négative leur esprit en définissant le collectif-Testet comme « légaliste et citoyenniste ». Contre l’idée de ne jamais sortir des voies d’action légales, les Bouilles revendiquent « l’action directe non violente » ; et contre le citoyennisme qui est l’autre nom de la cogestion, les Bouilles invitent à se méfier de toutes les autorités établies, même élues. Le choix d’une autre stratégie d’action (l’occupation du terrain) que le collectif-Testet va donc avec un esprit très différent, plus subversif et radical. Du moins sur le papier, car en pratique, le caractère ouvert de l’assemblée des Bouilles en faisait un collectif hétéroclite. Si le collectif-Testet n’était pas composé que de cogestionnaires, les Bouilles ne comptaient pas dans leur rang que des esprits contestataires, ce qui a conduit certains d’entre eux, exaspérés par la confusion, à en sortir.
Le rejet de la cogestion par les Bouilles se traduit également par un tout autre langage. Focalisé sur la dénonciation du projet de barrage, le collectif-Testet parle le langage technique et chiffré des gestionnaires et des experts, alors que les Bouilles parlent le langage politique de la critique sociale. De ce point de vue, les noms que se sont donnés les deux collectifs sont évocateurs : alors que le collectif-Testet s’est donné un nom qui circonscrit son objectif (la sauvegarde de la zone humide du Testet), les Bouilles ont choisi un nom qui suggère une résistance plus générale au cours des choses : « Tant qu’il y aura des bouilles, il n’y aura pas de barrage ». Ce nom est inspiré du parler local. En occitan, les bolhas sont les terres boueuses n’ayant pas une grande valeur agricole et financière. La notion de « zone humide » est récente, elle provient de la bureaucratie écologique. Parler de bouilles, c’est regarder le Testet d’en bas, du point de vue vernaculaire de ceux qui y habitent ; parler de zone humide, c’est regarder le Testet d’en haut, du point de vue gestionnaire de ceux qui prétendent administrer « les grands équilibres éco-systémiques ».
Malgré les divergences de pratique, de stratégie et de langage, les relations entre les deux composantes de la lutte sont dans un premier temps correctes : ce n’est pas contre le collectif-Testet que les Bouilles ont été fondées, mais en complémentarité avec lui. Dix jours après leur constitution, la Métairie neuve (bâtiment appartenant au CG81 en lisière de la zad) est squattée ; l’occupation de la forêt commence alors et se poursuit malgré deux tentatives d’expulsion des occupants, par une vingtaine de miliciens cagoulés d’abord (23 janvier 2014), par la gendarmerie ensuite (27 février 2014) – tentatives qui conduisent les Bouilles à lancer des appels larges à rejoindre la forêt de Sivens pour y constituer une zad. Les déplacements d’espèces sont gênés par la présence des occupants et les travaux s’embourbent pendant l’hiver. Le 5 avril, les autorités finissent par repousser le chantier à l’automne suivant en raison d’une réglementation interdisant la déforestation en période de nidification. Au même moment, l’idée germe d’organiser un rassemblement commun sur les lieux, ce qui met en difficulté le collectif-Testet (qui s’était tenu jusque-là à l’écart des actions des Bouilles), divisé entre ceux qui estiment qu’il faut composer avec les Bouilles (qui ont quand même permis de retarder le chantier d’un an) et ceux qui estiment, comme cela a été dit lors d’une assemblée générale, que ce sont des « terroristes ». Après des discussions houleuses où les partisans de la pure légalité sont mis en minorité, la présidente démissionne et un nouveau bureau décide d’infléchir la stratégie : sans renoncer au légalisme, il s’agit de coopérer avec les Bouilles, avec demande au porte-parole de ne pas se mêler à leurs « actions illégales ». Finalement, le collectif-Testet participe au Printemps de Sivens (25 et 26 avril 2014) en tenant un stand sur un terrain privé aux abords de la zone, avec l’autorisation du propriétaire…
Face à des autorités obstinées, il fallait résister ; pour cela, il fallait composer et les deux collectifs le savaient : « l’union fait la force ». Mais l’union n’a pas duré : peu à peu, les divergences politiques de fond ont pris le pas sur le besoin stratégique de composition.
Les tensions montent de toutes parts
Après l’ajournement au 1er septembre de la déforestation par le CG81 et l’expulsion illégale de la zad le 17 mai, les occupants se donnent rendez-vous en août, pour une nouvelle phase de combat. Mais cette fois, les autorités tarnaises tiendront à ne pas se laisser ni dépasser ni paralyser : tous les moyens seront mis en œuvre pour éviter l’échec de l’automne précédent, d’autant plus que le projet de barrage est cofinancé par l’Europe, qui impose des délais rendant le chantier pressant.
Dès que les « zadistes » pointent à nouveau le bout de leur nez (rouge) en août, c’est une forêt quadrillée de gendarmes qu’ils retrouvent. La tension monte vite, des barricades se dressent et les échauffourées se multiplient. La lutte semble aussi prendre localement : l’avant-dernier week-end d’août, des centaines de familles se retrouvent pour manifester leur opposition et ce rendez-vous est reconduit avec succès les dimanches suivants, à la Métairie neuve ; des membres du collectif-Testet se lancent dans une grève de la faim pour réclamer un débat public. De son côté, la zad s’étoffe et les Bouilles se « fond » dedans, au point de s’y dissoudre et de s’y perdre un temps. Le collectif avait pris l’habitude de tenir chaque dimanche une assemblée au Testet. Or, avec la reprise de l’occupation et le début des travaux, cette assemblée s’est mise à excéder les Bouilles « historiques », impliquant non seulement des occupants de la zad, mais aussi des locaux rejoignant la lutte. De fait, l’AG des Bouilles s’est transformée en comité de coordination de la lutte sur le terrain – et les Bouilles n’auront plus vraiment de lieu de réunion ni d’action propres jusqu’en novembre.
Le 1er septembre, la déforestation massive commence sous haute protection militaire. Les opposants tentent de la freiner : les routes et ponts d’accès sont sabotés, les batailles rangées et les cabanes dans les arbres se multiplient, on fait des opérations escargots et des blocages de ronds points pour retarder l’arrivée des ouvriers et des gendarmes, des arbres sont lardés de métal ou reliés les uns aux autres pour rendre leur tronçonnage dangereux, etc. C’est le lundi 8 septembre que la résistance est la plus vive et massive : des centaines de personnes se rejoignent au petit matin pour bloquer l’accès au chantier par divers moyens (les routes sont occupées par des files de voiture garées en épi et un groupe de personnes s’enterre à un point névralgique). Le blocage fonctionne tant que les médias restent sur place, jusque vers 16h : l’assaut est alors donné et les « enterrés » sont piétinés par les forces de l’ordre…
Avec cette montée des tensions sur le terrain, les relations se dégradent entre les deux principales composantes de la lutte, le collectif-Testet et ce que l’on pourrait appeler le mouvement de résistance (les Bouilles élargies et dissoutes dans la zad). Le degré de conflictualité sur la zad tend en effet à effrayer une bonne part du collectif-Testet. Ce n’est pas le cas de tous ses membres. Malgré la consigne qui lui avait été donné six mois plus tôt de ne pas s’impliquer dans les actions impliquant l’occupation illégale de terrains privés, le porte-parole du collectif Ben Lefetey est présent sur le terrain : il participe activement à certaines AG de lutte organisées sur la zad et, le jour des enterrés, passe la journée sur la zad, au téléphone : il tente d’éviter l’intervention musclée des forces de l’ordre en faisant intercéder ses divers « contacts » (à la préfecture, dans les partis, au ministère, etc.).
Après l’échec du 8 septembre, un sentiment d’impuissance s’empare du mouvement d’opposition, qui se délite : les membres du collectif-Testet et les opposants locaux sont de moins en moins nombreux à venir sur le terrain, si ce n’est en fin de journée pour ravitailler et soutenir moralement les quelques dizaines d’occupants qui tentent malgré tout de ralentir les travaux, face à des gendarmes de plus en plus violents (l’un d’eux n’hésite pas à lancer une grenade dans une caravane pleine d’occupants). En revanche, des actions de solidarité sont entreprises ailleurs : occupation du conseil général du Tarn le 9 septembre, installation pendant une semaine d’un stand d’information devant ses portes, manifestation à Gaillac, etc. Pour sortir de l’impasse, l’idée germe d’organiser un grand rassemblement lors des vacances de la Toussaint : elle est actée le 20 septembre en AG sur la zad et une « coordination » se met en place, qui décide de se réunir tous les dimanches sur la zad et de se scinder en commissions (de fait, cette « coordination du 25 octobre » prend le relais des Bouilles). Des membres du collectif-Testet (ceux qui participaient déjà aux Bouilles) y prennent part, mais ce dernier ne s’immiscera dans la préparation de l’événement qu’au dernier moment, en s’occupant de contacter les autorités pour obtenir une autorisation (en fait, pour définir avec la préfecture un espace-temps restreint dans lequel sa présence serait légale) et organiser la circulation – tâche ingrate dont la coordination n’était pas fâchée d’être déchargée.
Entre les deux composantes, le torchon prend feu autour de la place à accorder aux « partenaires institutionnels » du collectif-Testet : les partis politiques comme Europe Ecologie-Les Verts et le Front de gauche, ainsi que le syndicat agricole Confédération paysanne. La coordination avait appelé à un rassemblement « sans drapeaux », de peur de voir partis et syndicats tenter de récupérer cette lutte qu’ils n’avaient ni lancée ni menée. Pour les prises de parole du samedi 25 octobre, elle souhaitait mettre en avant des opposants locaux, des gens ordinaires et extraordinairement impliqués. Le collectif-Testet estimait qu’il fallait donner également le micro à ses partenaires comme José Bové ou Jean-Luc Mélenchon (qui, lors d’un meeting dans le Tarn au printemps, n’avait pourtant pas évoqué Sivens). Finalement, il y aura deux podiums et quelques heurts (notamment avec Mélenchon qui, après avoir pris un yaourt dans la figure, décide de quitter les lieux avant son discours ; quant à José Bové, il prend la parole devant une banderole affirmant, pour dénoncer la cogestion citoyenne qu’il incarne : « l’État, c’est pas nous »). Mais ce jour-là, les heurts les plus violents auront bien sûr lieu avec les forces de l’ordre, présentes sur place en masse malgré l’engagement contraire du préfet et la présence de milliers de personnes (entre 5 000 et 7 000).
A ce moment-là, la tension entre contestation et cogestion apparaît déjà clairement, mais ce n’est que dans les jours suivants qu’elle affaiblit le mouvement d’opposition. Une fois de plus, c’est la montée des tensions sur le terrain qui entraîne celle entre les composantes. Le dimanche 26 octobre au matin, la préfecture annonce que « le corps d’un homme a été découvert par les gendarmes sur le site de Sivens ». Le flou extrême de cette formule vise à masquer un crime d’État. Sur place, tous les indices (une flaque de sang devant l’espace vide où les gendarmes étaient postés la veille) et les témoignages concordent déjà : vers deux heures du matin, un homme s’est écroulé suite à l’explosion d’une grenade ; quelques minutes plus tard, les gendarmes ont fait une sortie pour récupérer le corps gisant au sol. Une AG s’organise d’urgence à la zad pour informer de la situation et savoir comment réagir. Décision est prise de se rendre à Gaillac où la tension éclate entre ceux qui enragent et ceux, dont Ben Lefetey, qui cherchent à calmer la rage. Finalement, tout le monde sera gazé…
S’ensuit une semaine de tensions extrêmes où les manifestations de colère se multiplient en France, pendant que les autorités brouillent les pistes afin de gagner du temps et d’éviter l’emballement. Alors qu’elles savaient dès l’heure du crime, comme cela sera confirmé par la suite, de quoi est morte la victime, elles laissent courir de fausses rumeurs, comme l’idée qu’elle portait un sac à dos bourré de cocktails Molotov. Dans ce contexte tendu (le lundi 27, une nouvelle manifestation embrase Albi), les deux franges du mouvement réagissent de manière opposées. Alors que la « coordination » s’échine à faire savoir la vérité (les autorités ont poussé la « stratégie de la tension » jusqu’à l’homicide) et appelle à manifester, le collectif-Testet dissuade de participer aux manifestations. Son porte-parole, omniprésent dans les médias, fait le jeu des autorités : il condamne les « violences » des manifestants (une vitrine de banque cassée et quelques drapeaux français brûlés à Gaillac…) et entretient le doute en déclarant le dimanche soir : « On n’affirme pas que les forces de l’ordre ont tué un manifestant » (Libération, 27 octobre 2014). Bref, il tente de cogérer la crise en calmant la colère suscitée par le crime et le mensonge d’État. Notons que cette attitude est vivement contestée par la base du collectif-Testet : une partie des membres ne se reconnaît plus dans le discours de leur porte-parole, estimant que la violence vient d’abord de l’État et que le collectif-Testet n’a pas vocation à se poser en « juge » qui condamne une colère que Carcenac attise en déclarant :
« Mourir pour des idées, c’est une chose mais c’est quand même relativement stupide et bête. »
Durant les semaines suivantes, il y aura des débats et des démissions au sein du collectif-Testet, en raison des déficits de démocratie interne qui s’y manifestent et de l’attitude ouvertement cogestionnaire de son conseil d’administration.
Alors que la bataille fait rage autour de la responsabilité des gendarmes et des politiques dans la mort d’un jeune botaniste, le combat juridique s’accélère et prend une nouvelle tournure, qui va encore plus diviser le mouvement. Le lundi 27 octobre, les experts mandatés par Ségolène Royal en septembre rendent public un rapport qui donne raison à l’opposition, tout comme les enquêtes journalistiques publiées les jours précédents. Début novembre, l’avocat victorieux dans l’affaire de Fourogue, Bernard Viguié, prend contact avec le collectif-Testet et son avocate pour leur suggérer de verser cette pièce à conviction, fournie par l’État lui-même, au dossier de demande d’annulation de la DIG et de la DUP, déposé en octobre 2013, qui n’a pas encore été jugé sur le fond. Quelques semaines après, il apprend par les médias qu’une nouvelle procédure juridique est lancée par le collectif-Testet et ses alliés (FNE), mais qu’il s’agit d’une demande d’abrogation. Il alerte tout de suite les Bouilles et plus largement l’opinion sur la différence entre ces deux procédures, et ce qui se cache potentiellement derrière cette nouvelle action juridique : non pas une offensive afin de faire annuler le projet de barrage (officiellement suspendu depuis le 1er novembre) et condamner les responsables, mais une main tendue afin de leur préparer une « sortie de crise » honorable – ce que personne, dans le mouvement de contestation, n’avait compris tant le langage juridique est technique et suppose d’être décodé pour comprendre de quoi il retourne. Car l’annulation par la justice de la DIG signifierait que les travaux de l’automne étaient illégaux et que les opposants avaient donc le droit de leur côté, alors que son abrogation par l’administration ne remettrait rien en cause.
Sur son blog de Mediapart, Bernard Viguié multiplie les textes pour dénoncer la stratégie juridique du tandem FNE/collectif-Testet, liée selon lui au fait que FNE dépend de fonds publics. Il annonce que la demande d’abrogation sera de toute façon déboutée par la préfecture (ce sera le cas fin décembre), car elle est prématurée : pour abroger, il faut que toutes les parties soient d’accords, et donc qu’elles aient eu toutes l’assurance d’être indemnisées. Ce ne sera le cas qu’un an plus tard, avec la signature d’un « protocole transactionnel » où l’État s’engage à rembourser la gabegie du CG81. Après ce premier épisode, il y aura toute une lutte pour forcer l’avocate du collectif-Testet à verser le rapport des experts au dossier de demande d’annulation, ce qui sera finalement fait au dernier moment, sous haute pression : Viguié la met dos au mur en versant le rapport des experts au dossier en « tierce intervention », à charge à l’avocate d’accepter cette aide ou de la refuser…
Les deux composantes ont des stratégie opposées : une stratégie cogestionnaire de « sortie de crise » orchestrée par une organisation paraétatique (FNE) dont les errements sont connus 8, et une stratégie offensive visant à mettre en cause les responsables du désastre de Sivens. Ce qui n’arrange pas les choses est que, dans cette affaire, seul le collectif-Testet est habilité à « ester en justice » : il peut donc faire les choses à sa guise, en accord avec FNE mais sans avoir à tenir compte de l’avis des autres composantes de la lutte. Le second volet de l’action de Viguié a donc été de tenter de briser ce monopole en créant une nouvelle association, de droit et non de fait (comme les Bouilles) : le Comité Sivens, qui se mettra en action après la destruction de la Métairie neuve (haut-lieu de la zad) en mai 2015.
Compte tenu de sa composition instable et malgré les appels à l’unité, le mouvement d’opposition au barrage de Sivens était fragile. Les autorités ont bien sûr largement exploité cette division, de deux manières. D’une part, elles ont joué la stratégie de la tension, ce qui ne pouvait que creuser le fossé entre les branches paraétatiques et antiétatiques du mouvement (la hantise de la violence poussant dans les bras de l’État). D’autre part, elles ont coopté l’opposition cogestionnaire dans les arcanes du pouvoir, en lui proposant de participer à une procédure de « concertation » pour trouver une alternative au barrage initial. En parallèle à cette récupération de la part recyclable de l’opposition, les autorités ont pu lancer une contre-offensive pour étouffer sa frange contestataire.
La carotte de la démocratie participative
et le bâton des milices fascistoïdes
Le 26 octobre marque le début d’une situation de crise pour l’État : avec la mort d’un manifestant, le piège consistant à provoquer des affrontements pour discréditer l’opposition aux yeux d’une opinion publique hypersensible à la violence s’est retourné contre les autorités, qui au même moment perdent tous leurs arguments en faveur du barrage. Sur place, la crise se manifeste par le départ pour cinq mois des forces de l’ordre : quelques heures après leur crime, elles abandonnent le camp retranché qu’elles avaient défendu avec acharnement toute la nuit. Comment reprendre la situation et le terrain en main ? Une fois conjuré le spectre d’un mouvement de jeunesse contre la violence d’État, la réponse est double et consiste à jouer sur les divisions de l’opposition : c’est le recours à la carotte et au bâton, la carotte participative pour les cogestionnaires et le bâton fascistoïde pour les contestataires.
Quelques jours après le début de la crise, le vendredi 31 octobre, les travaux sont suspendus sine die par le conseil général qui remet le dossier dans les mains de l’État. Ségolène Royal, spécialiste des dispositifs de démocratie participative, le prend en charge en proposant tout de suite des réunions avec les acteurs du dossier (conseil général, agence de l’eau, syndicats agricoles et associations écologistes) au ministère de l’écologie. Ce faisant, les autorités ne font que suivre les préconisations de Ben Lefetey, désireux que « les travaux ne reprennent pas avant la fin de l’année » et qu’« un vrai dialogue s’ouvre enfin avec tous les acteurs pour la suite du projet », car « c’est ce qui ramènerait le calme » (La Dépêche du Midi, 31 octobre 2014). Dans le mouvement de résistance, les débats sont houleux. Certains dénoncent ce discours cogestionnaire en soulignant la naïveté qu’il y a à réclamer un « vrai dialogue » avec des autorités qui, jusque-là, ont refusé tout débat public et n’ont reculé devant aucun moyen pour étouffer la critique : « on ne négocie pas avec des assassins ». D’autres veulent au contraire s’inviter au ministère de l’écologie pour y représenter un acteur de la lutte qui n’y a pas été convié : les occupants.
Acculé, l’État cherchait à calmer la critique et à diviser le mouvement d’opposition. C’est le double mérite de la procédure de concertation, baptisée « projet de territoire », que lance Royal. Censée mettre « tous » les acteurs (en réalité seuls ceux que les autorités jugent acceptables…) autour d’une table pour définir les contours d’un nouveau projet de barrage, il s’agit d’un dispositif de « démocratie participative ». Parmi les opposants, le collectif-Testet et la Confédération paysanne (seuls invités) acceptent de « participer », ou plutôt de « jouer le jeu », car ce « projet de territoire » leur fait miroiter ce qu’ils réclament depuis le début : non seulement être écoutés par les autorités, mais surtout s’asseoir à leur table. A l’heure qu’il est, le processus est en cours malgré l’obstruction initiale des barragistes de la FNSEA.
« Participer », qu’est-ce à dire ? Derrière les injonctions à participer qui se multiplient de nos jours (en politique et en éducation, dans les entreprises et les spectacles), Joëlle Zask a montré qu’il y a des choses différentes 9. En général, il s’agit de simples mascarades, notamment quand on répond aux convocations lancées par des organisateurs de « tables rondes ». On se retrouve alors « comme le spectateur au cirque à qui le magicien demande de monter sur la scène pour lui tenir son chapeau » : on « agit docilement dans un créneau prévu d’avance ». Participer à ce genre de dispositif consiste à accepter le rôle que l’organisme convoquant nous a dévolu afin de lui apporter une légitimité. « Une participation bornée à ce que les participants s’engagent dans une entreprise dont la forme et la nature n’ont pas été préalablement définies par eux-mêmes ne peut être qu’une forme illusoire de participation ». Et c’est bien sûr le cas du dispositif de « démocratie participative » en cause ici.
Une fois l’opposition divisée, les autorités tarnaises vont favoriser le décollage d’un mouvement d’agriculteurs pro-barrage et de riverains « anti-zadiste » afin de redonner un vernis de soutien populaire au barrage, de terroriser les contestataires et de redorer le blason de l’État (et des forces de l’ordre) en le présentant comme un agent neutre s’interposant entre deux types d’extrémistes : les anti et les pro. Depuis longtemps, le mouvement d’opposition savait qu’il avait affaire non seulement aux autorités, mais aussi à une minorité de « pro-barrages » ne reculant devant aucun moyen. En septembre, un site internet apparaît pour appeler à la chasse aux « zadistes », accusés d’être tout à la fois des chômeurs et des « bobos ». Dans le même temps, un éleveur de faisans accuse les « zadistes » d’avoir ouvert de nuit sa volière. Cette accusation se révélera fallacieuse lors de l’enquête, mais le mal est fait : localement, on est convaincu que les « zadistes » sont dangereux. S’ensuit l’apparition nocturne, aux abords de la zad, de groupes d’hommes armés de bâtons faisant la « battue aux bobos » (Le Canard enchainé, 29 octobre 2014). C’est sur ces forces que les autorités vont s’appuyer pour reprendre le terrain en main, en favorisant la jonction entre les agriculteurs de la FNSEA (dont les représentants ont toujours été favorables au barrage), les quelques riverains « anti-zadistes » et les milieux locaux d’extrême-droite.
Mi-novembre, diverses institutions paraétatiques (les chambres d’agriculture et d’industrie, la FDSEA, l’association des élus tarnais, etc.) constituées en association ad hoc organisent une manifestation de soutien aux autorités tarnaises. Mais c’est à la mi-décembre, alors que la stratégie juridique de FNE suscite des soupçons dans le mouvement d’occupation, que la contre-offensive commence vraiment sur le terrain, avec une opération « manche de pioche » visant à faire un « coucou franc » aux zadistes (Libération, 25 décembre 2014). Mais les forces de l’ordre s’interposent et il n’y a pas de heurts. Les 1er et 8 février 2015, une sorte de milice bloque l’accès à la zad où devaient avoir lieu la présentation d’un livre sur la lutte et une visite botanique dans le cadre de la « journée mondiale des zones humides ». « Milice » est bien le terme approprié pour un regroupement d’hommes dont certains arborent des sweet-shirt noirs où est inscrit « soutien à la gendarmerie » et « brigade anti-peluts » (en occitan, les peluts sont les chevelus, les hippies). Cette milice n’hésite pas à agresser les opposants en les aspergeant de lisier de porc, à dérober les vivres qu’ils amenaient aux occupants et à s’attaquer à leur véhicule (notamment à celui du maire d’un village tarnais, membre de la FNSEA devenu opposant au barrage). Les forces de l’ordre sont présentes, mais laissent faire.
Ces deux journées servent de répétition générale pour l’expulsion de la zad début mars, mûrement préparée (l’État avait fait savoir qu’il procèderai à l’expulsion de la zad une fois que le conseil général du Tarn se serait prononcé sur l’avenir du projet en suspens, décision attendue le vendredi 6 mars). A partir du 1er mars, la zad est encerclée jour et nuit par les agriculteurs de la FDSEA renforcés par leurs collègues des départements voisins, et bien sûr par les miliciens locaux : le but est d’affamer les zadistes et de les couper de leurs soutiens locaux. Sur toutes les routes autour de la zad, des check point sont mis en place pour arrêter celles et ceux qui voudraient venir en aide aux zadistes, et qui sont menacés verbalement et physiquement, en présence d’une police imperturbable. Si certains véhicules ont été endommagés, il y eut peu de violences sur personne : les autorités avaient dû donner carte blanche pour effrayer, mais ne souhaitaient pas de nouveaux dérapages. A l’extérieur de la zad, tous les rassemblements de soutien sont immédiatement dispersés par la police qui quadrille la région, afin d’étouffer toute présence et toute parole publique des opposants. Dans les médias, quand ce n’est pas le silence complet (le collectif-Testet, qui avait été si présent dans les médias, participe à l’omerta générale), l’affaire est présentée comme un conflit entre « paysans » excédés et « zadistes », ce qui rend à l’État son image de force d’interposition neutre. Le vendredi matin, avant même que le conseil général ait rendu sa délibération, les forces de l’ordre expulsent les dernières dizaines d’occupants. La forêt de Sivens devient « zone interdite ». Des décrets interdisent toute présence, et les opposants sont virés manu militari quand ils reviennent en mai pour nettoyer les abords de la Métairie. Mais les barragistes ne sont pas inquiétés lorsqu’ils y montent, pendant la canicule d’été, une opération médiatique pour faire valoir l’impérieuse nécessité d’une retenue…
Dans ce contexte, le mouvement de résistance s’est demandé si la situation à laquelle il était confronté n’avait pas un avant-goût de « fascisme ». Les premiers à s’être revendiqués fascistes, les partisans italiens de Mussolini, ont d’abord eu pour rôle de réprimer violemment, au mépris de toute légalité mais avec la complicité de la police et des autorités, l’agitation sociale et les syndicats ouvriers 10. Si le terme de « milices fascisantes » semble bien approprié pour ce que nous avons vécu, alors Sivens montre comment la « démocratie participative » peut très bien se combiner, comme instrument de gestion de crise, aux méthodes fascistes : dans les médias, on invite au dialogue pendant que sur le terrain, on réduit au silence.
Epilogue politique.
Le 25 octobre 2015, la scission entre les deux composantes de la lutte éclate au grand jour, ainsi que la manière dont l’État s’appuie sur les cogestionnaires pour étouffer les contestataires. Alors que la date approche, le besoin de se rassembler sur le site se fait sentir de toutes parts, tout en suscitant de terribles appréhensions quant à la possibilité de revivre les situations cauchemardesques de confrontation aux milices. Dans les deux collectifs et au sein de la coordination des opposants, les discussions vont bon train. Finalement, un appel est lancé à se rassembler en forêt de Sivens et une délégation décide de demander l’autorisation de l’événement, croyant que les autorités n’iront pas jusqu’à interdire une marche commémorative. Mais si : elle est interdite par la préfecture au motif que les organisations d’exploitants agricoles et de riverains auraient demandé des autorisations similaires, les uns pour nettoyer la zone, les autres pour cueillir des champignons, un an jour pour jour après la mort d’un jeune botaniste devenu l’emblème du mouvement qu’ils conspuent. Tous les rassemblements sont interdits sur place, mais une offre odieuse est faite à la famille : venir se recueillir sur le site… escortée par des gendarmes. Le mouvement de résistance décide de maintenir le rendez-vous sur les lieux du crime, où une sculpture a été érigée clandestinement quelques jours plus tôt : une main sculptée dans la pierre tenant dans sa paume un globe en métal – elle sera vite détruite. Quant au collectif-Testet, il appelle à se réunir à Plaisance-du-Touch, la commune où vivent les parents du jeune botaniste assassiné. Vu l’affluence à Gaillac, la marche en forêt de Sivens est au dernier moment tolérée par la préfecture. Néanmoins, le collectif-Testet persiste à dissuader d’y aller : un spectacle plus important est prévu à Plaisance-du-Touch, où les journalistes se pressent autour des « têtes » de la liste « Nouveau Monde » (réunissant écologistes, occitanistes et Front de gauche) pour les élections régionales prévues dans six semaines…
Epilogue juridique.
Le 1er juillet 2016, le tribunal administratif de Toulouse s’apprête à rendre son jugement sur la procédure en annulation des DUP et DIG lancée par les opposants trois ans plus tôt. Bien sûr, les parties favorables au barrage demandent un non-lieu. Leur argument : comme elles sont prêtes à abroger (puisqu’elles seront indemnisées), et comme les opposants avaient aussi demandé l’abrogation en novembre 2014, tout le monde est d’accord pour abroger et il n’y a pas lieu d’annuler. Finalement, trois arrêtés sont bien annulés (dont la DUP) : c’est l’aveu que le projet était frauduleux et l’opposition, ou plutôt Lefetey (qui a intégré FNE), crie victoire. Mais en ce qui concerne la DIG, le juge prononce un non-lieu signifiant qu’il était légal de lancer le chantier. Belle victoire pour les autorités, car ce jugement les lave de toute responsabilité. Encore une fois, sans le décodage d’un juriste professionnel comme Viguié, les contestataires n’auraient pas compris que la « victoire » que les cogestionnaires chantaient n’en était pas une pour eux, qui espéraient voir les autorités criminelles traduites en justice.
La composition explosive des luttes territoriales
Les luttes contre les projets d’aménagement du territoire ne peuvent manquer de se confronter à l’État, soit qu’il porte ces projets, soit qu’il les soutienne. Compte tenu du prestige dont l’idée d’État jouit toujours pour la plupart des gens (qui l’identifient au bien commun), et de la puissance de l’État aujourd’hui, si écrasante qu’il semble impossible de l’affronter ou de la contourner, elles sont vouées à être divisées en une frange contestataire et une frange cogestionnaire, entre lesquelles la plupart des gens évoluent. Entre elles, c’est d’abord l’impératif de composition qui domine : face au rouleau-compresseur étatico-industriel, il faut faire front commun et batailler avec toutes les armes disponibles (lancer des procédures juridiques, engager le rapport de force sur le terrain, gagner le soutien de l’opinion, etc.). Avec le temps, les liens peuvent se densifier et l’union devenir durable, comme à Notre-Dame-des-Landes ou au Val Susa. Mais la composition reste instable, menacée d’exploser à tout moment. Malgré tout, le risque de trahison cogestionnaire ne doit pas détourner les contestataires du travail de composition : car ce serait renoncer à la possibilité que la lutte devienne menaçante pour le pouvoir (la menace résidant justement dans la jonction des forces sociales éparses), et se priver de la possibilité de tisser des liens avec des gens qui, dans l’entre-deux, pourraient basculer peu à peu vers une contestation plus assumée – or, au-delà du projet critiqué, l’enjeu de toute lutte est bien de faire « bouger les lignes », de transformer la perception du monde des gens ordinaires qui sont impliqués dans ces luttes territoriales. Mais s’il faut composer pour résister, il faut le faire avec lucidité, pour se prémunir des pires conséquences. C’est ce que nous rappelle la lutte contre le barrage du Testet, dont divers enseignements peuvent être tirés.
Primo.
Elle montre à quel point la cogestion seule est impuissante face à des autorités obstinées. Bien conscients de l’insuffisance de leur action, des membres du collectif-Testet vont participer à la création d’un autre collectif pour croiser le fer sur le terrain. Et c’est avec cette bataille-là que la lutte a décollé. En fait, pour que des cogestionnaires soient cooptés dans les étroits cénacles du pouvoir, il faut qu’il y ait d’abord un rapport de force sur place. Un rapport tel que les gestionnaires en place aient besoin d’auxiliaires pour gérer une protestation gênante ou incontrôlable. Bref, pour accéder au droit de cogérer les affaires, il faut faire valoir sa capacité à cogérer une contestation débordante. Comme l’a menacé Lefetey à propos du projet de territoire : « S’ils passent à nouveau en force, on sera là pour s’opposer. Il y aura à nouveau des zadistes » (Le Monde, 1er juillet 2016). Les cogestionnaires ont besoin des contestataires comme d’un épouvantail à agiter pour être écoutés ou plutôt cooptés par les autorités.
Secundo.
Ce combat rappelle que les cogestionnaires risquent tôt ou tard de se dissocier du reste du mouvement et de faire le jeu des autorités. Dès qu’un rapport de force s’établit et que la situation dérape, les autorités auront besoin de leur aide pour reprendre le terrain en main, et en feront leurs interlocuteurs. En échange, ils participeront aux dispositifs de concertation censés calmer les tensions et condamneront les « contestataires violents » (ceux qui, justement, en ont fait des interlocuteurs indispensables). Il faut donc se méfier des dispositifs de « démocratie participative » : loin d’être une alternative au système, ils lui servent de béquille en permettant, dans un même mouvement, de rendre la contestation inoffensive et de pallier le déficit de légitimité d’une classe politique discréditée.
Tertio.
Si c’est avec l’occupation que la lutte a décollé, elle s’est alors immédiatement joué sur les terrains juridiques et médiatiques. Or, les Bouilles se méfiaient de ces terrains, certains refusant carrément de parler de ce qui s’y jouait au motif que ce n’est que de la mascarade. Il en résulte que ces terrains ont été complètement délaissés – sauf à certains moments, comme lors du grand rassemblement, où il y eut des tentatives infructueuses, puis désordonnées, d’avoir une « présence médiatique » propre, au-delà du site internet. Si Lefetey a pu avoir la centralité qu’il a prise, au point de personnaliser la lutte, c’est parce qu’il s’est engouffré dans un vide. Et l’expulsion de la zad du Testet a pu se faire comme elle s’est faite pour deux raisons. D’une part, l’inaction juridique du collectif-Testet ou ses actions douteuses (comme la demande d’abrogation, qui ne pouvait être que déboutée) ont permis aux barragistes d’affirmer jusqu’au bout que le projet était légal, ce qui donnait un vernis de légitimité à leur jusqu’au-boutisme. D’autre part, le monopole médiatique concédé au collectif-Testet a fait qu’au moment de l’expulsion, les autorités n’ont eu aucun mal à bâillonner la résistance, privée de son porte-voix et de ses canaux de communication (le collectif-Testet n’a pas levé la voix). Même si l’on se méfie des médias et de la justice, il semble stratégique de ne pas complètement déléguer ces terrains-là – sinon, on facilite la répression et on sert de tremplin à une nouvelle génération de gestionnaires. Tout le problème est de les investir sans tomber dans les travers qu’ils impliquent : le spectacle, la personnalisation et la folklorisation de la lutte, le consensualisme, etc. A partir du moment où il y a bataille juridique, il semble au moins important de se donner les moyens de saisir les enjeux des diverses procédures, voire de peser sur leur choix.
Last but not least.
La lutte contre le barrage du Testet montre à quelles extrémités les autorités ont été prêtes pour réaliser ce qui n’est qu’un petit projet absurde tel qu’il s’en fait partout en France depuis des lustres. Logique : l’État est le garant d’un ordre inégalitaire que seule la croissance rend supportable – il faut donc la stimuler à tout prix. Aujourd’hui comme hier, cela implique production et consommation croissante, donc exploitation croissante des humains et de la nature (bétonisation, extractivisme, productivisme agricole, etc.) et multiplication des projets de développement. Comment dès lors penser que l’État, et les puissants qui tirent leurs privilèges de l’ordre mortifère qu’il garantit, puissent être des alliés dans la lutte contre la dévastation générale ? Faut-il aspirer à cogérer un système destructeur avec ceux qui tirent profit de cette destruction, ou tenter de le renverser ou de l’affaiblir en s’organisant autrement, sans eux et contre eux ? Les Bouilles ont misé sur la seconde option, en tentant de s’organiser en assemblée populaire de défense du territoire. Mais le caractère public des assemblées et leur ouverture proclamée à toutes et à tous ne les a pas rendues « populaires » pour autant. Pour en arriver là, encore faudrait-il dépasser l’atomisation sociale et la privatisation des existences, la résignation politique et la dépendance des individus envers le système industriel, qui scelle notre impuissance face à lui.
Comment penser les rapports, dans les luttes territoriales actuelles, entre leurs deux composantes essentielles, les forces de contestation (radicale) et les visées de cogestion (citoyenne) ? Ces deux attitudes peuvent-elles, comme on le souhaite souvent la bouche en cœur, se combiner et se renforcer, à quelles conditions et jusqu’à quel point ? Quels sont les dangers de ce genre d’alliance, et peut-on s’en prémunir ? Comment les autorités tirent-elles parti de cette division, et comment pouvons-nous en tirer parti ?
L’histoire de la lutte contre le barrage du Testet dans la forêt de Sivens (Tarn), et de l’évolution de sa composition, peut nous donner des éléments de réponse. Après une première phase de constitution de l’opposition, et de coopération étroite entre ses deux principales composantes, la violence croissante de la lutte sur le terrain a fait monter la tension entre elles. Finalement, l’Etat a repris la main sur le terrain en jouant la double stratégie de la carotte participative (pour la frange cogestionnaire de l’opposition) et du bâton répressif (pour ses éléments contestataires).
Octobre 2017.
Notes :
1 Voir Yannick Ogor, Le Paysan impossible, récit de luttes, Le Bout de la Ville, Le Mas d’Azil, 2017.
2 Voir Henri Mora, Chambard dans les Chambarans, s’opposer à Center Pars et à la marchandisation du monde, Le Monde à l’envers, Grenoble, 2011.
3 Comme ils l’affirment explicitement dans un tract reproduit dans l’excellent recueil de textes Zad partout. Zone à défendre à Notre-Dame-des-Landes, textes et images, l’Insomniaque, Montreuil, 2013, p. 25.
4 Herbert Marcuse, L’homme unidimensionnel, essai publié en 1964 et traduit en français en 1968 qui a fortement influencé la contestation dans les années 1960 et 1970, de part et d’autre de l’Atlantique.
5 Fabrice Nicolino, Qui a tué l’écologie ? Les Liens qui Libèrent, Paris, 2011.
6 Voir le tract de 1990 intitulé « Adresse à tous ceux qui ne veulent pas gérer les nuisances mais les supprimer », réédition Le Monde à l’envers, Grenoble, 2011.
7 La préhistoire du projet de barrage au Testet et d’aménagement de la forêt de Sivens est racontée par Lucien Lacoste, paysan retraité de la vallée du Tescou, dans un texte intitulé « Pour quelques euros de plus » (2012), reproduit dans le recueil Sivens sans retenue. Feuilles d’automne 2014, La Lenteur, Paris, 2015, p. 19-22. Outre ce recueil, une autre compilation de textes relatifs à la lutte a été publiée sous le titre R comme…, QuandMême !, 2015, ainsi que trois livres : Ben Lefetey, Sivens, un barrage contre la démocratie, préface de José Bové, Les petits matins, 2015 ; Grégoire Souchay et Marc Laimé, Sivens, le barrage de trop, Seuil, Paris, 2015 ; Roland Foissac, Sivens, pour comprendre, Autre Reg’Art, 2015.
8 Voir le chapitre que lui consacre Fabrice Nicolino dans Qui a tué l’écologie ?
9 Dans un livre qui n’a rien de radical : Participer. Essai sur les formes démocratiques de participation, Le bord de l’eau, Lormont, 2011.
10 Voir la brochure des Bouilles L’époque est-elle fasciste ? publiée en 2015.
Après les pyromanes, les pompiers ?
Les dessous du « projet de territoire » de Sivens
Inutile de revenir sur le projet de barrage initial et sur la manière dont les autorités tarnaises ont cherché, au mépris de tout, à passer en force pour l’imposer, jusqu’à assassiner un homme. Après la mort de Rémi Fraisse lors du grand rassemblement du 25 octobre 2014, l’État se sent obligé de prendre les choses en main et de secourir les autorités locales, trop heureuses de se débarrasser d’une patate devenue si chaude. Il en résulte un changement de tactique : alors que le Conseil Général et la Préfecture avaient jusque-là refusé le dialogue avec les opposants et tout misé sur la force brute, Ségolène Royal abat la carte de la concertation.
C’est ainsi qu’est annoncé un « projet de territoire » dans lequel les composantes citoyennes du mouvement d’opposition (Collectif Testet, Confédération Paysannne, FNE) se sont immédiatement engouffrées, en se réjouissant à l’idée d’être enfin entendues par ceux qui, auparavant, n’avaient cessé de faire la sourde oreille et de les mépriser.
Le projet de territoire proprement dit a été précédé d’un « audit patrimonial » chargé de répondre à la question « Conditions et moyens d’une meilleure gestion de la qualité du territoire du bassin versant du Tescou : Quelle stratégie pour la ressource en eau ? ». Il a été réalisé en juin 2016, sous forme d’une cinquantaine d’entretiens, par un groupe d’experts devant jouer le rôle de médiateur : le laboratoire ADEPRINA. Parmi eux, Vincent Pupin est un chercheur qui a réalisé sa thèse sur le concept de patrimoine, défini comme la « somme des attachements matériels et immatériels des personnes au lieu qu’elles habitent ». Le fait que le patrimoine de la vallée du Tescou, auquel nombre d’entre nous étions attachés, ait été détruit dans l’impunité la plus totale (une forêt rasée, une zone humide saccagée, une ferme brûlée, une stèle à la mémoire de Rémi Fraisse détruite), ne semble pas lui poser le moindre problème.
Dans sa synthèse finale, l’audit clarifie les objectifs du projet de territoire. Tout d’abord, il s’agit de redonner foi en la démocratie représentative et en l’action des élus dans un contexte de défiance envers les institutions : « L’enjeu c’est de redonner la légitimité aux élus de pouvoir mener des actions sur les territoires dont ils ont la gestion » ; « Il faut recréer la confiance avec l’État. Il est complètement décrédibilisé ». Ensuite, il s’agit de ramener la paix dans la vallée, mais cela ne remet pas en cause la participation au projet de territoire d’acteurs locaux comme la FDSEA et la mairie de Lisle/Tarn qui, au même moment persévèrent dans la stratégie de la tension [1]. Et enfin, il s’agirait de co-construire un projet de territoire « innovant et durable » qui pourrait répondre aux besoins économiques des exploitants agricoles existants tout en en installant de nouveaux et en réglant le problème global de l’eau. En somme : dépolitiser, pacifier et techniciser.
La méthode de l’audit patrimonial a été théorisée par le laboratoire de recherche ADEPRINA, promue par le think-tank “Sol et Civilisation” et commercialisée par la boite de consultants Mutadis – trois entités qui font travailler les mêmes individus sur les mêmes projets. Ces structures l’ont utilisée pour « réhabiliter les conditions de vie dans les territoires contaminés de Tchernobyl » (projet ETHOS) et aider la commission européenne à anticiper la gestion d’un accident nucléaire en réalisant un guide pour la mobilisation des acteurs (projet EURANOS). Plus récemment, un projet de « développement durable » a été mis en place en Martinique, prétendant améliorer la qualité de vie des populations autour de bananeraies où a été utilisé un pesticide organochloré qui cause des cancers de la prostate et des naissances prématurées. Le rapport invite à « bien vivre », voire « vivre mieux », sans nier la présence à long terme du pesticide pouvant être vu comme une « opportunité ».
Gilles Hériard-Dubreuil, président de Mutadis et fondateur du mouvement environnementaliste de droite Ecologie Humaine (proche de la Manif pour Tous), a voué sa carrière à théoriser et mettre en œuvre ces nouvelles méthodes de concertation. Il a récemment supervisé une enquête pour Center Parcs visant à réfléchir à l’implantation « durable » d’un centre de vacances dans le Jura. Après l’échec de Roybon, ne s’agit-il pas de rendre la déforestation et le tourisme de masse plus acceptables ? Via le projet européen COWAM, il travaille depuis une dizaine d’années sur l’implantation des projets d’enfouissement des déchets nucléaires : comment les rendre acceptables en tentant d’impliquer les populations locales dans le processus de conception.
Bien sûr, si la réalité ne colle pas avec la théorie et que la participation ne prend pas le sens souhaité, l’État peut toujours abattre l’atout : la répression et des armes de guerre pour mater les populations rétives, comme à Bure où Robin Pagès a été mutilé l’été dernier.
Ces nouvelles formes de concertation – s’ajoutant à celles déjà existantes – permettent-elles d’endiguer le développement du nucléaire, du bétonnage de nos territoires et de l’agro-industrie ou sont-elles sorties du chapeau au coup par coup tuer dans l’œuf les mouvements de contestation, pacifier les populations qui se révoltent contre des projets néfastes et faire accepter les nuisances ? Une personne auditée semble nous mettre sur la voie de la réponse : « Il faut que ce projet de territoire marche, sinon on aura la révolution partout ».
Une fois l’audit patrimonial restitué en juillet 2016, le projet de territoire démarre officiellement en mars 2017. La phase actuelle consiste en des réunions thématiques (eau, biodiversité, identité du territoire, sols) auxquelles participent des groupes composés de membres de chaque famille d’acteurs (élus, agriculteurs, riverains, associations). Un petit tour de table des personnes invitées à ces réunions donne une bonne idée de ce que l’on peut en attendre.
Les experts scientifiques (ingénieurs agronomes et chercheurs) d’ADEPRINA Vincent Pupin, Henry et Matthieu Ollagnon et Marc Valenzisi assurent la médiation. Leur stratégie est la même qu’à Tchernobyl ou en Martinique : dépolitiser, pacifier, techniciser. « Ça va, mais le feu couve sous la cendre » peut-on lire dans l’audit. A ces médiateurs de tout faire pour éviter un retour de flamme, quitte à fermer les yeux sur le conflit politique existant, sur les milices, sur l’impunité des assassins de Rémi Fraisse et des destructeurs de la forêt et de la ferme de la Métairie. Une certaine lucidité se dégage cependant de plusieurs personnes auditées : « Vous n’arriverez pas à réconcilier l’irréconciliable », « les points de vue, à mon avis, sont inconciliables ».
Bien sûr, sont invités tous les élus locaux qui ont porté sans vergogne le projet initial de barrage : de l’indéboulonnable Carcenac pour qui « mourir pour des idées est relativement stupide et bête », au bouillonnant Jacques Valax député pro-barrage qui martelait après la mort de Rémi Fraisse : « Je le dis haut et fort, c’est un projet qui est justifié, un projet à consonance écologique ».
L’actuel Préfet du Tarn Jean-Michel Mougard qui s’est appuyé sur des milices privées pour expulser les manifestants antinucléaires de Bure et celui du Tarn-et-Garonne sont bien là ainsi que toute une kyrielle de maires et de conseillers communaux dont Marylin Lherm et Pascale Puibasset, qui n’ont cessé d’envenimer les choses.
Autour de la table, on trouve aussi un certain nombre de miliciens : Philippe Jougla (président de la FDSEA) qui a coordonné le siège de la zad et Laurent Viguier (vice-president de la FDSEA) qui manie aussi bien la fourche que la batte de base-ball, comme en atteste son savoir-faire en destruction de voitures, reconnu par tous les opposants victimes de ses exactions (mais pas par la justice…). D’autres membres de la FDSEA et des JA ayant participé au blocus de la zad sont présents et même Joffrey Demetz, animateur notoire d’un site Internet flirtant avec les idées d’extrême droite, et spécialisé dans la délation, qui invitait à la « chasse aux bobos et aux pelluts ». On trouve aussi des associations du lobby pro-irrigation (Organisme Unique, Association Vie Eau Tescou).
Enfin, 16 citoyens tirés au sort sont censés rendre le processus plus démocratique. Vont-ils avoir le moindre poids au milieu de syndicalistes aux dents longues et d’élus de carrière ?
Dans une telle assemblée composée très majoritairement de pro-barrage, qu’espèrent donc obtenir la poignée de membres d’associations écologistes (Collectif Testet, FNE) ou de la Confédération Paysanne si ce n’est servir de caution démocratique à une expérience d’ingénierie sociale dont le but est d’éteindre les braises d’une contestation locale, régionale et nationale très large et dont le résultat sera d’imposer, par des moyens plus doux, un barrage au Testet ?
Une paix sans justice est un attrape-nigaud !
Participer, c’est accepter !
Pour défendre la forêt de Sivens face à ceux qui veulent aménager nos territoires :
Nous étions là. Nous sommes là.
Et, si nécessaire, nous le serons à nouveau !
Des habitant.e.s du Tarn,
tract distribué le 22 octobre 2017.
[1] En octobre 2016, après l’audit, des personnes auditionnées, Philippe Jougla (FDSEA) et Pascale Puibasset (mairie de Lisle/Tarn), mettaient de l’huile sur le feu en bloquant l’hommage à Rémi Fraisse et en couvrant une attaque au couteau dont l’auteur n’est autre que le frère de l’adjointe au maire de Lisle/Tarn.
)
À lire également, le dossier du CRAS consacré à Sivens, publié en octobre 2017 également.
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (1.2 Mo)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (1.2 Mo)