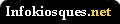E
L’effondrement, parlons-en...
Les limites de la collapsologie
mis en ligne le 22 septembre 2021 - Jérémy Cravatte
Un constat partagé ...
La sixième extinction de masse* [1] est en cours. Elle est beaucoup plus rapide que les précédentes et concerne potentiellement l’ensemble des espèces, ce qui est inédit. Plusieurs limites écologiques ont déjà été franchies (destruction de la biodiversité, concentration des gaz à effet de serre, déforestation et dévastation des sols, pollutions en tous genres) tandis que d’autres sont en passe de l’être (acidification des océans, raréfaction de l’eau douce). C’est du caractère habitable ou non de la planète dont il est désormais question. À ces limites dépassées s’ajoute celle de la raréfaction des « ressources naturelles » non renouvelables : les énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) et les minerais, utilisés pour à peu près tous les biens et services actuels (dont la production d’énergies dites renouvelables). Nous sommes sur terre depuis des centaines de milliers d’années, mais ces dépassements ne se sont enclenchés que depuis deux siècles (depuis l’expansion du capitalisme), et plus particulièrement depuis la deuxième moitié du xxe siècle – soit très récemment. C’est ce qu’on appelle la grande accélération*. Concernant les dérèglements climatiques*, dépasser une augmentation globale de 1,5 °c (à l’horizon 2100 par rapport à l’ère pré-industrielle) enclencherait un emballement climatique dont nous ne pouvons mesurer l’ampleur. De nombreuses boucles de rétroactions* existent et nous risquons de nous diriger vers une planète étuve*. Nous sommes à 1 °c de réchauffement et nous pouvons déjà observer aux quatre coins du monde ce que cela produit. Les effets ne font malheureusement que commencer. Or, les causes de ces dérèglements continuent plus que jamais d’être alimentées et la trajectoire actuelle nous mène vers une augmentation de 4 °c, 5 °c ou plus. À titre de comparaison, la différence de température entre l’ère pré-industrielle et la dernière glaciation était d’environ 5 °c. Un basculement écologique est donc en cours et il est irréversible dans plusieurs de ses aspects. Il ne s’agit pas d’une « crise » qui pourrait être suivie d’un retour à la situation antérieure. Il ne s’agit pas d’un événement instantané, ni homogène dans l’espace, ni linéaire dans son intensité. Seule l’ampleur de ces basculements écologiques peut, et doit, être réduite. Les collapsos [2] participent à forcer la prise en compte plus que nécessaire de ces constats, qui sont largement niés depuis les années 1970 au moins. Malheureusement, leur manière de présenter les choses n’aide pas forcément à être lucide sur la situation et à y réagir en conséquence.
Les limites importantes des discours de l’effondrement
Voici plusieurs définitions de « l’effondrement » utilisées par les collapsos. Elles sont particulièrement vagues :
« Baisse rapide et déterminante d’un niveau établi de complexité socio-politique. » (Joseph Anthony Tainter [3])
« Réduction drastique de la population humaine, et/ou de la complexité politique, économique, sociale, sur une zone étendue et une durée importante. » (Jared Diamond [4] )
« Situation dans laquelle les besoins de base (eau, énergie, alimentation, logement, habillement, mobilité, sécurité etc.) ne sont plus fournis à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. » (Yves Cochet [5] )
« [Terme faisant référence à] l’effondrement de notre civilisation thermo-industrielle et/ou des écosystèmes et espèces vivantes, dont la nôtre. » (Pablo Servigne et Raphaël Stevens)
« L’effondrement » défini comme tel concerne tous les aspects d’une société. Les basculements écologiques (ou une crise financière, une guerre, etc.) joueraient le rôle de déclencheur de cet effondrement généralisé.

La collapsologie est présentée à tort comme une science
La « collapsologie » n’est pas une nouvelle science [6] , c’est un discours qui utilise des sciences existantes. Ce ne devrait pas être un problème, il n’y a pas besoin d’être une « science » – avec tous les dogmes propres au scientisme – pour proposer des analyses et perspectives intéressantes et utiles.
Malheureusement, une confusion est entretenue – autant par les collapsos que par ceux qui les invitent à intervenir en tant que tels – sur la « naissance d’une nouvelle discipline scientifique transdisciplinaire ». Cette revendication de scientificité est parfois présentée comme une boutade, mais cette « boutade » est reprise et alimentée (presque) unanimement. Cela affaiblit inutilement les discours collapsos et prête le flanc aux accusations stériles de « pseudo-science ».
Premièrement, cette manière de présenter les collapsos crée une hiérarchisation de fait entre les « spécialistes » et les autres. Comme si on avait besoin de reproduire ce biais, caractéristique des sociétés occidentales, pour penser et agir sur la situation. Cela freine une appropriation large de la thématique.
Deuxièmement, cela a pour effet de donner l’impression à l’audience qu’elle prend connaissance d’une réalité objectivée (et donc méthodologiquement vérifiable) plutôt que d’un discours. Cela implique, par exemple, que des raccourcis opérés entre plusieurs phénomènes (une crise financière, une sécheresse, une famine, une guerre) tiendraient de la méthode scientifique plutôt que de l’interprétation. Comme le souligne Elisabeth Lagasse, le melting-pot opéré entre sciences naturelles et sciences sociales induit une naturalisation des rapports sociaux qui n’est plus discutée. Assumer qu’il s’agit d’interprétations à mettre en débat serait bien plus utile. En lieu et place de cela, les personnes qui critiquent ces interprétations sont régulièrement accusées d’être dans le « déni ». Cette réaction est particulièrement grave lorsqu’on prétend relever d’une démarche scientifique, qui se définit par la contradiction et par la nécessité pour l’énoncé d’être questionnable.
Enfin, cette ambiguïté nourrit le sentiment que l’effondrement généralisé est une hypothèse, un modèle qui se vérifiera ou non, un événement qui aura lieu ou non. On appelle d’ailleurs ces discours « théories de l’effondrement ». Or, la question n’est pas là. La situation écologique et sociale n’est pas une hypothèse. En alimentant cette ambiguïté, on détourne de l’essentiel et on se fait plutôt mousser avec des pronostics « d’effondrement systémique global » – logique poussée à la limite du risible lorsque des dates du phénomène sont prophétisées.
« Bon, en gros, l’effondrement au sens où je l’entends, c’est dans les années 2020. Entre 2020 et 2030, à cinq années près bien entendu, je ne suis pas Madame Soleil ni Nostradamus. » (Yves Cochet [7]
)
« Les théories de l’effondrement doivent être prises au sérieux [...]. [Mais] il n’appartient pas aux responsables politiques de trancher quant à leur pertinence ou leur probabilité. » (Cabinet de la ministre de l’environnement bruxelloise Céline Fremault [8] )
« Est-ce que vous adhérez à ces théories, en tout cas à cette étude de chiffres, qui peut mener à penser que nous sommes peut-être au début de la fin de notre civilisation ? » (Canal+ [9] )

L’approche est occidentalo-centrée
« La question est alors : quand l’effondrement atteindra-t-il l’Occident ? » (Julien Wosnitza [10] )
« L’effondrement de la civilisation occidentale » (Naomi Oreskes & Erik Conway [11] )
Les discours de l’effondrement s’inquiètent avant tout du devenir de « notre » civilisation* et ils assimilent la fin de celle-ci à la fin du monde. Pour être plus précis, ils s’inquiètent avant tout de l’avenir des classes moyennes des pays industrialisés – c’est-à-dire de moins d’une personne sur cinq dans le monde. C’est l’effondrement de « nos » modes de vie qui est mis au centre des préoccupations par les discours collapsos. Nous sommes en pleine « complainte de l’homme blanc » comme le fait remarquer Émilie Hache [12] . Cette réaction ethnocentrée est compréhensible, mais il faut l’assumer et situer ce récit. Or, les collapsos (avec certaines exceptions, comme Renaud Duterme) préfèrent le présenter comme une analyse totalisante, globalisante.
Ce qu’ils décrivent concerne déjà depuis bien longtemps une énorme partie de la population mondiale. Les personnes qui vivent ces réalités n’ont pas besoin des imaginaires post-apocalyptiques pour être lucides sur la situation, se battre et vivre. Il est d’ailleurs interpellant d’observer que ce concept d’effondrement fasse si peu sens en dehors de nos milieux aisés et en dehors de nos latitudes.
Les exemples, prospectives, anticipations et – surtout – pistes de réponses portées par les récits collapsos ne concernent quasiment que l’imaginaire lié au cadre urbain des classes moyennes blanches de l’hémisphère Nord (et parfois de la classe supérieure). Lorsque les sociétés moins industrialisées sont citées, c’est généralement pour prétendre qu’elles seront moins touchées par cet effondrement puisqu’elles seraient moins dépendantes des énergies fossiles, et donc plus résilientes*. Il s’agit d’une analyse totalement hors sol au regard des effets dramatiques des basculements écologiques sur ces sociétés (dont elles sont les dernières responsables) et de la violence actuelle du néo-colonialisme. D’autres références à « l’autre » sont utilisées dans ces discours, soit pour s’en inspirer s’il pratique d’autres manières de se rapporter à l’écosystème (utilitarisme), soit pour évoquer la solidarité s’il s’agit de la figure du/de la réfugié·e (humanisme). Dans les deux cas, la réflexion se pose toujours à partir d’un « nous » occidentalo-centré et de ce qu’il va se passer « ici ».
« [...] on peut aussi aller chercher la sagesse de ceux qui ont déjà vécu un effondrement, en se mettant par exemple au service des réfugiés. » (Vincent Wattelet [13])
Alors, bien sûr il faut partir de là où l’on est, et surtout profiter des prises de conscience supplémentaires provoquées dans nos régions par les canicules, inondations, coulées de boues, manques de pluie et de neige, crues basses, oiseaux qu’on n’entend plus, insectes qu’on ne voit plus... Ce n’est pas le fait de partir de « nos » réalités et de « nos » vécus qui constitue le problème, c’est l’approche narcissique qui consiste à faire tourner l’avenir du monde autour de cela. Le problème, c’est d’effacer la majorité des situations vécues en temps réel, sous prétexte qu’elles sont autres, alors qu’elles sont au centre des basculements écologiques en cours et à venir.
L’effondrement est une notion confuse
Étymologiquement, un effondrement fait référence à l’état d’une chose qui s’écroule sur le sol, sur le fond (du latin fundus). Une infrastructure, un bâtiment, un objet, un corps s’effondrent littéralement, physiquement. Pour le reste, l’état psychologique d’une personne, un régime politique, une société, une économie, une entreprise, il s’agit d’une métaphore (très parlante, mais d’une métaphore).
La confusion commence donc avec le terme lui-même. L’usage du pronominal – « ça s’effondre » – alimente un récit selon lequel les choses s’effondreraient d’elles-mêmes (la biodiversité, la société, la richesse), alors qu’elles se font détruire. Cette confusion portée par le terme lui-même s’amplifie avec son caractère fourre-tout. Qu’est-ce qui est en train de s’effondrer selon les collapsos ? Les écosystèmes, le capitalisme, la finance, l’économie, la « modernité », la « culture occidentale », la société, les repères, la « complexité », la démocratie libérale, l’État, la légitimité de l’État, les services publics... ? Il s’agit en fait indistinctement d’un peu tout cela à la fois dans la notion de « l’effondrement » [14] .
« Comment tout peut s’effondrer. » (Pablo Servigne et Raphaël Stevens [15] )
« Pourquoi tout va s’effondrer. » (Julien Wosnitza [16] )
« Et si tout s’effondrait ? » (Socialter [17] )
« Tout va s’effondrer, et alors ? » (Usbek & Rica [18])
Ce diagnostic erroné de la situation se justifierait par la grande fragilité des piliers de nos sociétés, par leurs profondes interconnexions et par leurs chutes potentiellement simultanées (la perfect storm*) – la « chute » d’un élément pouvant alors provoquer un gigantesque effet domino sans appel. Les grandes banques, le réseau Internet, les centrales énergétiques, les chaînes d’approvisionnement, les infrastructures de communication, les modes de transport, les stabilités politiques (entre autres choses) sont en effet fragiles et reliés par de nombreux mécanismes. Mais ce n’est pas parce que tout est lié qu’il faut tout mélanger. Ce n’est pas parce qu’il y a corrélation qu’il y a causalité. Les discours collapsos amalgament malheureusement sous ce mot valise d’effondrement des changements irréversibles – qu’on ne peut, en effet, que tenter de limiter et préparer (comme la destruction de la biodiversité et l’emballement climatique) – avec des changements totalement réversibles (comme la montée des fascismes, le transhumanisme* ou la financiarisation du monde). Naturaliser les grandes tendances actuelles est une manière de fermer les possibles, voire de prétendre à une fin de l’histoire. Nombre de collapsos et d’effondrés ont d’ailleurs le défaut de vouloir reconnaître dans chaque mauvaise nouvelle (jusqu’à des attentats) un nouveau signe qui confirmerait leur « théorie » d’effondrement généralisé, indépendamment du caractère réversible ou irréversible de ce qui l’a provoqué et de ce qui en détermine l’intensité.
De manière plus générale, les récits de l’effondrement présentent des chaînes de réactions (crises > pénuries > guerres, etc.) comme des phénomènes mécaniques alors qu’elles dépendent de facteurs socio-politiques (par définition changeants) qu’il est nécessaire de prendre en compte. Utiliser les exemples de Cuba en mettant les embargos au second plan ; de Détroit sans s’intéresser à la ségrégation urbaine ; des suicides paysans en Inde en taisant les systèmes d’endettement privés et les accaparements de terres ; de la Syrie sans parler des conflits internationaux ; de la Grèce en oubliant la Troïka ; du Venezuela sans prendre en compte la géopolitique du moment ; etc. n’est pas sérieux. S’intéresser aux réactions des populations dans ces situations difficiles, ou rappeler le rôle qu’ont pu y jouer les facteurs écologiques est pertinent. Le problème est de présenter ces situations comme des illustrations d’effondrements indépendamment de ce qui les a provoquées et/ou rendues si violentes. Par exemple, la mobilisation récurrente de l’exemple syrien pour illustrer une situation d’effondrement est assez violente, puisqu’il s’agit de comparer ce qui pourrait « nous » arriver en termes d’adaptation écologique avec des bombardements, fusillades et tortures volontaires.
« L’effondrement c’est une concaténation systémique, une chaîne de causalité au sein du système industriel, qui menace ce système de basculer dans un état inconnu qui serait un état d’anomie et de chaos. » (Agnès Sinaï [19]
)
« C’est le constat que tous les systèmes complexes, hyperconnectés (les organismes, la finance, le climat...), lorsqu’ils sont soumis à des chocs répétés, sont résilients : ils gardent leur fonction, s’adaptent, se transforment... Mais il y a un seuil au-delà duquel ils basculent, où toutes les boucles de rétroaction s’emballent, et alors le système s’effondre brutalement. » (Pablo Servigne [20] )
« L’élection de Trump c’est un symptôme de l’effondrement. » (Renaud Duterme [21] )
Cet aspect fourre-tout est présenté comme le point fort des discours collapsos, alors qu’il en constitue précisément la plus grande faiblesse. Avoir une vision globale est nécessaire, tout mélanger est contre-productif. Les visions holistiques et les pensées systémiques – qui ne compartimentent pas absurdement la réalité en thématiques ou domaines fictivement séparés (exemple : concevoir l’écologique, le social et l’économique comme des entités autonomes est un non sens) – ont heureusement toujours existé. Constater et analyser les interconnexions à l’œuvre dans nos sociétés n’a rien de neuf. Or, les collapsos prétendent innover en la matière, alors qu’ils le font de manière peu détaillée.
« Si la finance s’effondre, ça fait des effets de contagion qui font des effondrements économiques. Effondrement financier, c’est quand il n’y a plus rien dans les guichets automatiques, c’est l’Argentine en 2001. Si ça se propage à un effondrement économique par les chaînes d’approvisionnement, ben ça fait plus rien dans les magasins. Et là tu te poses des questions, est-ce qu’on souhaite ça ? Ça peut dégénérer, en chaos social, politique. L’effondrement politique c’est l’URSS en 1989, t’as un retour des mafias etc. Si on va plus loin, l’effondrement social c’est la Lybie, c’est Mad Max quoi, y’a plus d’État, y’a plus rien. Qu’est-ce qu’on souhaite, qu’est-ce qu’on souhaite pas ? [...] Le problème c’est que tout est interconnecté. Tu souhaites l’effondrement du capitalisme ? Mais si il s’effondre, il y aura d’autres choses qui vont s’effondrer parce que tout est lié. » (Pablo Servigne [22] )
Il est par exemple courant chez les collapsos de présenter la prochaine crise financière comme le déclencheur d’un « effondrement systémique global ». Une crise financière éclate lorsque la valeur d’un nombre important de titres financiers diminue radicalement et rapidement (par exemple, si on acte que des titres financiers liés aux rendements à venir du secteur automobile sont surévalués). Puisque les grandes banques ne possèdent en capital propre qu’environ 5 % du total de leur bilan (c’est-à-dire du total des engagements qu’elles ont pris), elles sont fragiles et peuvent rapidement tomber en faillite. Lorsqu’une partie de leurs actifs perd trop de valeur, les capitaux propres deviennent rapidement insuffisants pour assumer les pertes. Comme les acteurs financiers savent que d’autres ne pourront plus les rembourser (puisqu’une partie des titres financiers qu’ils possèdent ne valent plus rien ou presque), un effet de contagion commence. Dans ces cas des centaines de milliards peuvent être détruits par cette « correction » et la question qui se pose alors est : qui paie ? Les petites et moyennes entreprises par leurs faillites, les déclassés par les mesures d’austérité (avec dans ces cas des magasins qui peuvent en effet fermer en grand nombre), ou bien les plus grands actionnaires de ces institutions financières privées, dont le patrimoine accumulé est immense, qui exigent une rente insoutenable et préparent ainsi les crises ? Est-ce que la finance en ressortira renforcée (et non pas effondrée), comme c’est le cas depuis 2008, ou bien en profitera-t-on pour s’en libérer ? Selon les réponses, cela produit une société radicalement différente, beaucoup plus ou beaucoup moins résiliente*. Pourtant, les collapsos ne s’encombrent pas de ces aspects concrets lorsqu’ils parlent « d’interconnexions inextricables » ou de « predicament* » (impasse, situation verrouillée, inextricable). Ils préfèrent naturaliser ces phénomènes comme s’il s’agissait de conséquences mécaniques afin de nourrir leur récit. Ils préfèrent renvoyer à des peurs individuelles en parlant de comptes en banques vidés ou bloqués en Argentine (2001) et en Grèce (2015), comme illustrations d’effondrements financiers puis sociaux, plutôt que d’expliquer comment cela s’est déroulé, qui en a profité et quels autres scénarios étaient possibles.
« Le risque d’éclatement de bulles financières [...] constitue un autre déclencheur probable d’effondrement global. » (Auguste Bergot [23] ) « Lorsqu’une infrastructure critique du système mondialisé s’écroulera (la finance ?), toutes les autres feront rapidement de même telle une cascade de dominos. » (Yves Cochet [24])
Enfin, la confusion porte sur la notion de « civilisation thermo-industrielle* » et sa prétendue fin. Les discours de l’effondrement présentent une série de constats angoissants (à raison) puis expliquent (à tort) que cela correspond à « l’effondrement de notre civilisation thermo-industrielle* ». Cette manière de présenter les choses – qui associe une mauvaise et une bonne nouvelle (la fin du monde et la fin de cette « civilisation » destructrice) [25] – provoque, au mieux, une confusion entre les deux, au pire, un désir de trouver un peu de répit pour cette « civilisation » à laquelle le public s’identifie.
« Prendre conscience du déclin de notre système industriel, c’est affronter la mort. » (Imagine [26] )
« Quand on dit « faire tomber la civilisation », cela signifie détruire ce qui aujourd’hui fait exister la quasi-totalité des humains. » (Vincent Mignerot [27] )
Cette « civilisation » – terme qui est déjà flou – n’est jamais définie clairement, au-delà d’une dépendance aux énergies fossiles et aux infrastructures industrielles. Or, les sociétés actuelles ne se définissent pas par cette seule caractéristique thermo-industrielle mais aussi, ou surtout, par l’accumulation de capital au moyen de l’accaparement par dépossession. C’est cette caractéristique première qui oriente la manière dont la majorité des activités humaines actuelles sont menées. Pour se perpétuer, le capitalisme a besoin du colonialisme, du patriarcat et du productivisme [28]. Ensemble, ils forment les piliers de « notre civilisation », piliers qui ne sont pas en train de « s’effondrer » (et qui ne « s’effondreront » pas tous seuls) mais plutôt de se renforcer.
Il faut donc définir plus précisément les concepts que l’on utilise lorsqu’on prétend que « tout va s’effondrer ». Dire que si le capitalisme « s’effondre », d’autres aspects dont nous aimerions qu’ils soient épargnés vont s’effondrer aussi (l’agro-industrie dont une énorme partie de la population est actuellement dépendante, par exemple), c’est mal définir les choses et ajouter de la confusion. Le capitalisme est un système de surproduction basé sur l’extraction par une minorité de la plus-value fournie par le travail d’une majorité, et sur le fait que cette minorité possède les moyens de production (dont la terre). Sortir de ce rapport de production, stopper l’accaparement par une minorité, ne dit rien de la manière dont seraient réorganisées les chaînes d’approvisionnement (aux mains de quelques dizaines de multinationales aujourd’hui). Arrêter la surproduction pour se limiter le mieux possible aux besoins réels deviendrait à tout le moins une option, ce qui n’est pas possible aujourd’hui (rappelons que plus ou moins un tiers des aliments produits sont jetés avant d’arriver aux « consomm’acteurs »). La raréfaction énergétique, la destruction des sols et de la biodiversité, les pollutions, les dérèglements climatiques sont des problèmes majeurs pour s’alimenter. En quoi la fin du capitalisme augmenterait-il les problèmes plutôt que de les diminuer ?
Concernant l’utilisation des énergies fossiles, il y a une confusion entre échelle et structure. Ce n’est pas parce que les « ressources » se raréfient et que (presque) toutes les activités vont se relocaliser radicalement, que les structures organisatrices actuelles de nos sociétés vont disparaître, que le productivisme va s’arrêter. Il y a à ce propos un défaut important dans la présentation du « pic » (qui est plutôt un plateau) de production des énergies fossiles. Il est sous-entendu, et parfois présenté de manière explicite, que la raréfaction de ces énergies provoquerait l’effondrement du capitalisme. C’est une variante du vieux mythe de l’autodestruction du capitalisme par ses propres contradictions internes. La raréfaction ne provoque pas la fin de rapports de production (au contraire). Le productivisme ira jusqu’au bout, jusqu’à la dernière goutte, si on le laisse faire. Il n’y a(ura) pas de fin du capitalisme mécanique (structure), il y aura « juste » une réallocation des « ressources » disponibles (échelle) et une intensité accrue dans les rapports d’exploitation et dans l’extraction de matière. Ces confusions expliquent qu’on entende si régulièrement au sein de discussions effondrées que « le système » serait « à bout de souffle », que « le capitalisme » aurait « atteint ses limites » et qu’il serait « sur le point de s’effondrer » etc., alors que c’est tout le contraire qui est en train de se passer, il continue actuellement de s’approfondir et de s’étendre.
« Ce qui va tuer le capitalisme, c’est la géologie. » (Yves Cochet)
« Pas forcément la fin de la planète, mais la fin de notre civilisation, du capitalisme. » (Julien Wosnitza [29])
La plupart des discours de l’effondrement désarment et dépolitisent
L’appel au deuil et à l’acceptation indifférenciée
Il faut faire le bilan : quels effets ont provoqués jusqu’à présent ces discours de « l’effondrement » ? Ce n’est pas un hasard si les récits de l’effondrement paralysent tellement, si on entend autant de témoignages de personnes chez qui ils ont provoqué insomnies ou pleurs, si autant de jeunes parents font des angoisses terribles, si beaucoup d’effondrés n’arrivent plus à dialoguer avec leurs proches, etc. Psychologiser de manière paternaliste les réactions négatives à ces récits ne suffit pas. Ces effets ne sont pas uniquement dus au fait que « les gens » auraient du mal à regarder la réalité en face – ce fameux déni – ou qu’ils seraient bloqués à un stade inférieur de la « prise de conscience [30] ». Au contraire, de nombreuses personnes témoignent se sentir mieux armées une fois informées de la situation écologique. Une fois l’état des lieux établi, et même s’il est difficile, on sait où on met les pieds et on peut commencer à avancer. Il ne faut pas nier les chocs que cet état des lieux peut produire – d’où l’importance d’en parler de manière claire et non confuse – mais les réactions paralysantes proviennent, elles, plutôt du fait que les discours collapsos ajoutent à ces constats une invitation ambiguë à l’acceptation, à faire table rase de l’existant. Faire croire que « tout va s’effondrer » d’un bloc, comme un bâtiment, donner l’impression aux personnes qu’elles n’ont aucune prise sur la situation présente et à venir, c’est alimenter le sentiment d’impuissance, la croyance que nous sommes face à une impasse plutôt que face à une multitude de chemins.
« Après ça [la lecture du livre Comment tout peut s’effondrer], j’ai vécu deux mois d’angoisse et d’insomnies. Je sanglotais dans la file du supermarché. » (Amandine [31] )
Les collapsos endeuillés répondent aux effets négatifs provoqués par leurs discours en ayant recours à la psychologie. Ces réactions difficiles les confortent presque dans leur diagnostic et ils s’attribuent régulièrement le rôle de thérapeutes. La peur, la paralysie, la dépression, la tristesse, la culpabilité, la colère, et ensuite, peut-être, le pardon (sic) sont présentés comme des phases psychologiques inévitables (ou presque, en fonction des individus) de la fameuse « courbe du deuil ».
« La période de déni va varier dans le temps, selon les cas. La deuxième phase du deuil est la reconnaissance de la perte [...]. C’est le moment des funérailles lors de la mort d’une personne. La troisième phase, quant à elle, est un mélange d’agitation, d’anxiété, de fébrilité, de colère et de déprime. Comme il n’y a pas de solution en vue, on « marchande », en se disant que tout cela n’arrivera que dans trois ou quatre générations [...]. Avant la quatrième phase où l’on touche le fond, en comprenant que toute cette agitation est en réalité une forme de déni. Et un cinquième temps, celui de l’acceptation où l’on va entreprendre une lente reconstruction. » (Imagine [32] )
À nouveau, l’approche fourre-tout de l’effondrement dépolitise la question écologique appelant, dans un élan de prétendue « lucidité », à faire le deuil de choses inévitables et de choses évitables. S’agit-il de faire le deuil des services publics tout en continuant à payer des impôts, d’un climat tempéré, de la majorité des espèces vivantes, de « nos » proches, de la moitié la plus pauvre ou la plus riche de l’humanité en premier lieu, du « confort » d’un système de santé équitable ou à deux vitesses... ? À nouveau, il s’agit un peu confusément de tout cela à la fois, sans précisions.
« Renoncer à ce futur que l’on croyait tout tracé – une pension assurée, des enfants en sécurité, etc. – c’est évidemment un changement radical de perspective, avec une remise en question de notre identité. Face à ce déclin annoncé, le premier réflexe naturel consiste à refuser de voir la vérité en face. [...] ce deuil du monde d’aujourd’hui est particulièrement complexe à réaliser car nous sommes ambivalents par rapport à celui-ci – nous chérissons une large facette positive de notre société (soins de santé, modes de transport, nouvelles communications...) mais nous en détestons d’autres. » (Imagine [33])
« La seule « action », pour un humain vivant dans un pays riche, qui pourrait avoir un éventuel effet positif sur l’avenir climatique serait qu’il réduise ses revenus pour atteindre aussi vite que possible un niveau proche du RSA, que plus jamais il n’ait de revenu plus élevé et qu’il ne fasse pas appel à la sécurité sociale ou à une quelconque assurance collective lorsqu’un problème survient (santé, habitation, accidents divers). » (Vincent Mignerot [34] )
Accepter, par exemple, l’idée que la sécfurité sociale soit détruite (par sa diminution, disparition, privatisation et financiarisation) revient à renforcer le pouvoir des fonds de pension – qui pratiquent les pires « investissements » destructeurs des écosystèmes et de leurs êtres humains – ainsi qu’à diminuer radicalement la résilience* et la capacité d’agir de la majorité de la population dès à présent. Accepter qu’un changement radical de circonstances soit en cours ne devrait pas signifier accepter aveuglément plus d’injustices. Déjà aujourd’hui, qui est évacué prioritairement en prévision de tempêtes ou de catastrophes « naturelles » ? Qui est relogé et qui ne l’est pas ? Dans quelles conditions ? Quels quartiers sont prioritairement assistés ou délaissés ? Pour qui les assurances (privées, parfois publiques) fonctionnent-elles ou non ? ... Il est particulièrement violent de parler de deuil de manière indifférenciée dans une société où la majorité des personnes qui meurent jeunes sont les personnes précarisées (des deux côtés de l’hémisphère).
« Ressentir de la douleur est un cadeau, car c’est le signe de nos liens avec [l’ensemble du vivant (Nathalie Grosjean [35])]. »
« Qu’est-ce qui va se passer ? On pourra pas tout chauffer. Sans doute on va tous vivre dans une seule pièce etc., mais c’est pas confortable. Si on veut être responsable [...] il faut commencer tout de suite à se demander à quel genre de confort matériel il faut renoncer pour avoir le plus d’humanité possible dans le monde qui nous attend. Plus on arrivera à avoir un regard tendre sur ce qui nous attend – tendre ça veut dire aussi lucide – et plus on pourra avoir de la tendresse pour ses prochains, pour l’humanité, pour soi-même, plus on évitera la violence qui de toute façon nous attend. » (Anthony Brault [36] )
En Grèce, à la suite de la crise provoquée par les banques et des mesures structurelles imposées entre autres par le FMI (Fonds Monétaire International), une grande partie de la population est retournée vivre avec sa famille nucléaire, en se serrant. Suite à une mesure d’augmentation drastique des taxes sur le fioul, de nombreux ménages se sont intoxiqués en brûlant leurs meubles et le bois urbain pour se chauffer [37]. À la même période, le gouvernement facilitait législativement et fiscalement les destructions environnementales sur le littoral. Ce n’est pas demain, c’était hier. Comment les collapsos différencient-ils le deuil du pétrole abondant de l’acceptation de mesures injustifiées ? Ils ne le précisent pas, or c’est là tout l’enjeu.
« Depuis des années nous nous sommes installés dans un déni parfois flagrant de réalité. On ne peut pas travailler moins et gagner plus, baisser nos impôts et accroître nos dépenses, ne rien changer à nos habitudes et respirer un air plus pur. Non. » (Emmanuel Macron [38] )
Le fantasme d’une renaissance plutôt que le déjà-là
Pour reprendre la fameuse métaphore de l’incendie [39] , si les Colibris nous appellent à faire notre part individuellement plutôt que le nécessaire collectivement, les récits collapsos nous appellent (individuellement et collectivement) à accepter l’incendie et à préparer la renaissance qui y ferait suite. Ce qui brûle dans cet incendie (et, surtout, dans quel ordre), on n’en parle pas trop. Nombre de collapsos préfèrent faire miroiter une possible renaissance après leur effondrement, potentiellement faite de petites communautés résilientes, après qu’une majorité de la population ait été décimée [40] .
« Tout va s’effondrer. Alors... préparons la suite. » (Pablo Servigne [41] )
« Ensuite, peut-être que vers les années 2050, dans 33 ans ou 34, 35, je ne suis pas à quelques années près... et bien il y aura une période de renaissance on peut dire, avec de la culture et une civilisation authentiquement humaine. » (Yves Cochet [42] )
Les fascinations pour la fin du monde proviennent entre autres du désir d’un monde nouveau, mais ce renouveau n’advient jamais car dans la réalité les choses se font dans une continuité. Le désert, le « point zéro », n’existera pas, même avec les grandes accélérations écologiques en cours. Ainsi, par exemple, présenter le pic pétrolier* comme une fin rapide et mécanique de cette source énergétique a toujours été une erreur. Ce pic (ou plutôt ce début de plateau) est passé il y a maintenant une quinzaine d’années et on n’a toujours pas vu d’effondrement à la verticale, comme présenté sur les graphiques qui tentent d’illustrer une rupture. Présenter les choses de cette manière-là, c’est effacer les rapports de production et les mécanismes de marché à l’œuvre (dont le passage du conventionnel au non-conventionnel), c’est alimenter un imaginaire de société post-pétrole qui surviendrait subitement alors qu’il reste bien assez (trop) d’énergies fossiles à brûler avant leur épuisement pour que les êtres humains soient décimés par les effets (de plus en plus destructeurs) de leur exploitation (pollutions, réchauffement climatique et destruction de la biodiversité). Un autre exemple de ce récit de rupture est l’image de magasins vides en trois jours, puisque le pétrole « c’est bientôt fini » et que nos villes n’ont presque aucune autonomie alimentaire. Cette image est très efficace pour faire comprendre ce manque d’autonomie, mais elle devrait être présentée comme une illustration théorique utilisée en ce sens, pas comme une réalité. Les magasins ne seront pas vides en trois jours à cause d’un manque énergétique (ils le sont par contre lors de mesures restrictives volontaires), certains de leurs rayons seront de moins en moins approvisionnés. L’électricité ne va pas disparaître, les coupures se feront sporadiquement. Internet ne s’effondrera pas du jour au lendemain, une partie de la population s’en verra déconnectée avec des accès de plus en plus impayables. Les voitures ne vont pas s’envoler d’un coup, ceux qui pourront se permettre de payer du quatre euros le litre continueront de rendre nos villes invivables avec ces véhicules. Les collapsos en sont conscients, mais ce n’est pas cette continuité – et les rapports de force qui vont les traverser – qu’ils traitent, c’est un imaginaire de rupture.

Comme le souligne avec raison Vincent Mignerot, ce que nous devons traiter aujourd’hui c’est ce qui est déjà là, pas une renaissance fantasmée [43] . Il ne faut pas attendre le prétendu effondrement qui aurait tout remis à plat, ce qui compte est en train d’arriver. Comme l’explique Elisabeth Lagasse [44] , les récits de l’effondrement portent cette idée de désert, de terra nullius (« terre de personne »), qui efface les actrices et acteurs et leurs interactions. C’est un « récit sans peuple [45] ». À tel point qu’une des plus grandes références des collapsos, Jared Diamond, a opéré une réécriture de l’histoire (mais cela ne les empêche pas de s’y référer continuellement).
« Ces effondrements du passé tendaient à suivre des trajectoires assez similaires [...] : la croissance de la population forçait les gens à adopter des moyens intensifs de production agricole [...] et à étendre les zones cultivées [...] dans le but de nourrir le nombre croissant de bouches affamées. Des pratiques non soutenables entraînaient des dommages portés à l’environnement [...]. Les conséquences pour la société incluaient des pénuries alimentaires, des famines, des guerres entre trop de gens luttant pour trop peu de ressources, et des renversements des élites dirigeantes par les masses désillusionnées. En fin de compte, la population déclinait du fait de la famine, de la guerre ou des maladies, et la société perdait une part de la complexité politique, économique et culturelle qu’elle avait développée à son apogée. » (Jared Diamond [46] )
Comme le souligne Daniel Tanuro [47] , les sociétés étudiées par Diamond ne se sont pas « effondrées », elles ont été agressées (malgré le sous-titre de son livre « comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie »). Les groupes humains se transforment, mutent, sont détruits, ils ne « s’effondrent » pas. Tanuro cite le livre Questioning Collapse [48], sorti quelques années après celui de Diamond et beaucoup moins connu, dans lequel une série d’anthropologues et d’historien·ne·s reviennent sur les « oublis » et « petites » erreurs de l’auteur à succès : les habitants de l’île de Pâques avant l’hécatombe auraient en fait été dix fois moins nombreux que ce que Diamond prétend, et les raids esclavagistes ont eu un impact énorme sur leur soi-disant « disparition » ; les sociétés indiennes Pima et Hohokam ne se sont pas « effondrées » à cause de leur prétendue mauvaise gestion environnementale, mais elles ont dû quitter leurs terres suite à la destruction de l’écosystème environnant par des colons espagnols et étasuniens ; les cités Mayas ont été désertées en raison de causes sociales et politiques, et non parce que leurs habitants auraient mal compris l’agroforesterie (après plusieurs siècles de systèmes agricoles efficients) ; etc. Cette réécriture de l’histoire est dangereuse car elle permet de nier des rapports sociaux (comme le colonialisme et les résistances à celui-ci), voire de les justifier.
La naturalisation des rapports sociaux et la notion de « verrouillages »
Nombre de collapsos parlent de « verrouillages » complexes de la société actuelle (sociaux, techniques et politiques) pour justifier leur posture d’acceptation. Cela pourrait signifier, par exemple, que lutter pour exproprier et socialiser les multinationales de l’énergie (afin de les démanteler ou de les reconvertir, selon les cas) constituerait du « marchandage » (la troisième étape du processus de deuil), c’est-à-dire une forme de déni de l’aspect inextricable (verrouillé) de la situation. C’est une conviction qui peut se défendre – si l’on est convaincu·e que les changements structurels nécessaires à la (sur)vie n’adviendront pas – mais ce n’est pas du tout la même chose que de tenter une démonstration conceptuelle de ces changements comme impossibles, qu’il s’agit d’une non-option. Lorsqu’ils font cela, les collapsos doivent au moins assumer qu’ils réduisent les imaginaires et non prétendre qu’ils les ouvrent. D’autant plus que cette manière de présenter les choses nous bloque également pour concevoir comme possibles des changements de moindre ampleur (comme la réouverture de lignes de chemin de fer ou une réforme agraire, par exemple).
« Un gouvernement qui déciderait d’imposer des mesures drastiques pour limiter la hauteur de chute de l’effondrement ? Il se ferait conspuer par la population et virer aux prochaines élections [...] C’est cadenassé, il n’y a aucune solution. L’effondrement est selon moi parfaitement inévitable. Du coup que fait-on me direz vous ? Je serais tenté de dire de vivre, de se préparer à une sobriété heureuse, de faire dans le zéro déchet et le recyclage local, d’essayer de faire le moins de mal possible à la vie et aux animaux autour de soi, de préserver l’échelon du local, de cultiver ses légumes, d’apprendre de nouvelles compétences, de préparer une communauté de compétences diverses, indépendantes, interdépendantes, et résilientes. Et surtout, surtout, on n’oublie pas de s’aimer. » (Julien Wosnitza [49])
Tous ces actes proposés par nombre de collapsos et d’effondrés sont importants. Ils redonnent du sens, nous font du bien, nous permettent d’être moins déliés de l’écosystème dont nous faisons partie, diminuent nos dissonances cognitives, freinent parfois l’avancée du Marché (parfois elles l’accélèrent malheureusement en créant des marchés de niche), sont matériellement utiles pour les personnes qui peuvent les mettre en place, etc. Par contre, les présenter comme le seul horizon possible, comme les seuls gestes à notre portée au prétexte que les autres seraient inaccessibles dans ce système verrouillé [50] , c’est faux et cela réduit profondément nos imaginaires. Alimenter, par exemple, la mode du « zéro » déchet si c’est pour confortablement oublier qu’on peut (et doit) aussi agir sur l’obsolescence programmée légalisée ou sur le fait qu’Amazon jette plusieurs millions d’objets invendus chaque année, ce n’est pas être lucide. Cette manière de présenter nos leviers d’actions nourrit le sentiment général d’impuissance et dépolitise profondément la question écologique, en confondant agir à son échelle et agir sans conséquence.
Même lorsqu’on est convaincu·e que les choses sont « verrouillées », il est intellectuellement malhonnête – en plus d’être irresponsable – d’invisibiliser les interactions, conflits, solidarités, résistances existantes (et à venir) qui modifient la situation et les manières dont les basculements écologiques sont et seront vécus. Avec ou sans racisme d’État, les réponses données aux catastrophes « naturelles » comme l’ouragan Katrina sont totalement différentes. Avec ou sans austérité dans les services de lutte contre les incendies en Grèce, le monde est différent. Avec ou sans les luttes de Standing Rock [51] ou de Black Lives Matter [52] , le monde est encore différent. Verrouiller ces réalités, vivantes, mouvantes, avec un récit d’effondrement généralisé qu’il ne resterait plus qu’à accepter et à préparer en attendant la suite est l’un des pires services que l’on puisse rendre aux « générations présentes [53] ». Comme le soulignent très justement François Thoreau et Benedikte Zitouni (qui s’inspirent ici de Vinciane Despret), en faisant cela, les collapsos nous appellent à « lâcher ce qui, dans ce monde-ci, respire encore, ce qui y fait sens, sous prétexte de devoir en faire le deuil [54]. »
Les collapsos ne nient pas nécessairement cette réalité, certains font même parfois référence aux luttes (surtout celle de la ZAD – Zone À Défendre – de Notre-Dame des Landes pour le pouvoir symbolique qu’elle porte). Cependant, d’une part, ces références sont rares dans les discours collapsos (à part chez Corinne Morel Darleux [55] ou Renaud Duterme [56] ) et, d’autre part, ils présentent les choses comme si tout se valait – des petits gestes « éco-responsables » aux blocages effectifs du désastre. Cela permet peut-être à une large partie de leur public d’être en paix avec son inaction et de contenter tout le monde, mais cela empêche dans les faits d’identifier les réels freins (et non les verrous) à une limitation effective des dégâts.
Une grande partie des effets dominos ou multiplicateurs, plus ou moins décrits (sans détails) par les collapsos, est en fait le fruit de mécanismes propres aux rapports sociaux actuels – par définition modifiables. C’est une des premières fois que l’humanité expérimente une telle conjonction de « crises », et c’est surtout la première fois qu’elle peut disparaître. Tout ce à quoi nous sommes habitués (ou presque) est en train de changer, mais quand on a dit cela on n’a rien dit. Une grande partie des bouleversements actuels constitue en fait une adaptation des classes dirigeantes aux nouveaux contextes (il en est ainsi, par exemple, du choix fait par de nombreuses démocraties libérales d’augmenter les niveaux de répression sur leur population, ou encore d’augmenter la digitalisation des services publics et de la vie en général). Naturaliser ces tendances et ces rapports sociaux, en plus d’être une erreur factuelle, ne fait que nous désarmer et nous dépolitiser. Prenons un exemple léger, la fragilité d’un hôpital dépendant de ses apports énergétiques et du réseau Internet. Imaginons des machines qui peuvent s’éteindre ou dysfonctionner, des données de patients numérisées qui peuvent s’effacer, l’agenda des opérations de chirurgie enregistré sur une application qui peut devenir inaccessible. Cette évolution vers plus de fragilité est le fruit de choix qui ont été, et sont toujours, traversés de conflits. Que ce soit pour les back-ups prévus ou non, la priorité donnée aux énergies de secours ou non, le suivi individualisé des patients ou non, le renforcement possible des équipes, etc. L’histoire de nos sociétés, qui évoluent soi-disant vers toujours plus de « complexité » avant de s’effondrer, ne sont pas linéaires. Ces complexités ne sont ni extérieures ni supérieures aux êtres humains qui les produisent, mais en mouvement avec des changements, des retournements, des pas de côté. Des priorités sont faites et défaites. Prendre en compte les interdépendances existantes dans le monde est une chose, estimer que la manière dont les rapports de pouvoir interviennent dans ces interdépendances serait secondaire face à un prétendu « predicament* » (impasse, situation verrouillée, inextricable) en est une autre.
« Schématiquement, il existe trois niveaux de gravité d’un incident, d’une crise. À chacun correspond une attitude appropriée. Un, la lutte pour supprimer ou limiter les causes si cela est encore possible. [...] Deux, la mise en place de mesures d’adaptation aux effets s’ils sont inéluctables mais qu’il est possible de les atténuer [...]. Trois, l’acceptation de son impuissance à changer le cours desévénements si toute action sur les causes ou les effets est vaine [...]. L’analyse lucide [sic] est indispensable pour juger de la gravité de la crise. » (Pierre Courbe [57] )
« Ne plus prévoir et réagir, mais ressentir et s’adapter. » (Vincent Wattelet [58] )
Le propos n’est pas de prétendre qu’avec des changements structurels anticapitalistes, décoloniaux et féministes nous pourrions éviter des chocs et des situations difficiles pour énormément de personnes, et encore moins de prétendre que ce serait alors le paradis sur terre [59] . Il ne s’agit pas de proposer l’option de l’espoir, cette passion triste comme dirait Spinoza. L’espoir (qui signifie aussi l’attente) – d’un sauveur, d’une solution parfaite – empêche d’agir à partir de la réalité et n’amène qu’au désespoir. Il s’agit au contraire de prendre en compte le fait que le degré de violences et d’injustices variera énormément avec ou sans luttes, avec ou sans ces changements structurels. Il s’agit de prendre en compte qu’il n’y a pas de situation verrouillée, puisque des choix sont d’ores et déjà faits et qu’ils donnent des situations d’ores et déjà profondément différentes. Pour réutiliser l’exemple de l’industrie fossile, si toutes les décisions devaient rester orientées par et vers la maximisation de la rémunération des actionnaires (quels forages ou non, quelles déforestations, quelle production, quelles décentralisation et diversification énergétiques, quels rationnements, quels prix, quelles conditions de travail, etc.) alors nos dépendances seront bien pires et les destructions bien plus rapides et nombreuses.
Le retour du mythe « tous dans le même bateau »
Partant de leurs propres constats, la question des rapports de pouvoir et de répartition des capacités d’adaptation devrait être la plus intéressante et importante à traiter pour les collapsos. Pourtant, la plupart d’entre eux semblent peu intéressés par ce sujet, et lorsqu’ils en parlent c’est en tant que question annexe à toutes les autres. On a l’impression que les inégalités, identifiées comme une des causes de leur effondrement, n’est qu’une des pièces d’un predicament*, une des réalités verrouillées parmi d’autres. Les références à ces rapports de pouvoir restent donc rares, sauf à nouveau chez Corinne Morel Darleux et chez Renaud Duterme [60] pour qui il s’agit d’une question centrale. La plupart des collapsos préfèrent même diffuser l’idée que leur effondrement traversera toutes les classes sociales, voire que ce sont les plus nantis qui tomberont de plus haut... « Je pense qu’au moment de l’effondrement, qui interviendra pour moi plutôt avant 2030 qu’avant 2050, les riches ne pourront pas s’isoler du reste de la population et continuer comme si de rien n’était. Dans cet effondrement rapide, qui peut intervenir en quelques mois, peut être que seule l’armée tiendra plus longtemps car elle dispose d’à peu près tout : essence, nourriture, etc. Mais pas Emmanuel Macron ou Bernard Arnault, qui sont trop dépendants de l’économie mondiale. » (Yves Cochet [61] )
« [...] l’issue est sûre : alors que certains d’entre nous commencent déjà à perdre de leurs avantages (salaires, retraites, accès aux soins...), demain, même les plus riches ne pourront maintenir leur niveau de confort et de sécurité [...]. » (Adrastia [62] )
Il est illusoire de penser que l’armée est un corps qui arrête de soutenir la classe dominante autrement que temporairement, c’est-à-dire lorsqu’elle n’y trouve plus son intérêt et y est obligée par la population. Il est également illusoire de penser que les seules « richesses » pourraient être les matières premières et les ressources de base. Les plus riches ne sont pas riches uniquement d’argent, mais aussi de propriétés tangibles, de terres, de matériels industriels, de bâtis, d’influences, de soutiens mutuels qu’ils utilisent et utiliseront pour maintenir leurs privilèges. Si on laisse faire, ils seront les derniers à « ne pas pouvoir maintenir leur niveau de vie ». Pour ne citer qu’un exemple, lorsque Paris était assiégée en 1870, que la population était rationnée et que de nombreuses personnes mourraient de manquements et de maladies comme la variole, les classes les plus aisées étaient les seules à continuer de se nourrir en viande dans les restaurants chics (jusqu’à tuer les derniers animaux du zoo pour pouvoir continuer...). Quelles que soient les conditions physiques, sans changement des conditions sociales, la misère et la pénurie côtoieront toujours l’opulence et l’abondance crasses. Une population en majorité malnutrie, avec un haut taux de mortalité, qui travaillerait de manière précaire pour maintenir le « niveau de vie » des plus aisés (accès aux technologies compris, en passant) n’est pas une dystopie, c’est notre situation actuelle qui serait approfondie. Les plus riches ne s’isoleront pas complètement du reste de la population dans le sens où leurs privilèges continueront de dépendre de l’exploitation de celle-ci, mais ils s’en isoleront dans le sens où ils se « bunkeriseront » encore davantage. La répartition géographique par niveaux de richesses, les ghettos de riches et le fait que nous vivons dans des mondes totalement séparés, qui ne se touchent pas, est un phénomène généralisé et qui n’a rien de neuf. Les plus aisés ne sont pas en train de faire sécession avec le reste de la société comme plusieurs collapsos le rapportent, ils l’ont toujours fait et sont simplement en train d’amplifier le mouvement si on les laisse faire [63] . Les rapports sociaux ne « s’effondrent » pas, ils se détruisent ou se maintiennent.
Puisque l’effondrement traverserait soi-disant toutes les classes sociales, on retrouve sans surprise dans les discours collapsos d’innombrables références à un « nous » indifférencié et au vieux mythe du « nous sommes tou·te·s sur le même bateau » (et son corollaire « on aura besoin de tout le monde »). La plupart des collapsos font ainsi le choix de nier allègrement les intérêts antagonistes présents dans la société, histoire de contenter tout le monde. Or, le problème des prétendues « élites », quel que soit leur niveau d’inconscience et/ou de cynisme, n’est pas leur « déni », mais leur intérêt à ce que rien de fondamental ne change. Il ne s’agit pas d’un problème de personnes (sinon les classes ne se reproduiraient pas aussi facilement), mais de position sociale. D’ailleurs, au vu de la situation écologique et des prises de conscience massives en cours à ce sujet, diffuser et faire accepter au mieux cette fable du « nous sommes tou·te·s dans le même bateau » devient un enjeu central pour la classe dominante [64] .
« [...] quand ça marche bien, c’est qu’il y a des élus, des entrepreneurs et des citoyens qui travaillent ensemble. » (Cyril Dion [65])
Alors que plus de 80 % des « richesses » produites par la destruction des écosystèmes (êtres humains compris) et que l’émission massive de gaz à effet de serre le sont pour satisfaire 1 % de la population mondiale, ces slogans sonnent comme de l’humour noir [66] . Le rôle que joue notre organisation en sociétés de classes dans l’accélération de la destruction et dans la diminution de la résilience* collective, le rôle qu’elle joue en termes de gaspillage et donc de limitation des marges de manœuvre, est essentiel. Pourtant, d’après la collapsologie, être focalisé·e sur ces implications signifie être bloqué·e au 4 e stade de la « prise de conscience » citée plus haut (c’est-à-dire être conscient·e que tous les problèmes sont liés, mais dans l’incapacité de voir le caractère inextricable de ces liens). Si nous étions mieux éveillés, nous comprendrions qu’il s’agit d’une grille de lecture périmée et d’une question secondaire. Voilà pour la lucidité...
Et puisque nous sommes tous dans le même bateau, la plupart des collapsos et des effondrés ne manquent pas de nous rappeler que nous sommes tou·te·s un peu responsables de ce qu’il se passe (malgré que certains soient à la barre et d’autres dans la cale du bateau).
« Cessez de blâmer les gens. Les autres sont tout autant de victimes des temps que nous-mêmes, même les PDG et les politiciens. » (Paul Chefurka [67] )
« À mon sens, notre échec est notamment fondé sur le fait que, politiquement, quand ça ne marche pas nous nous défaussons toujours sur une partie adverse désignée – les politiques, le capitalisme, les industriels, les lobbys [...]. Nous [sommes] tous acteurs et même commanditaires de l’exaction écologique, puisque ce sont nos revenus, notre confort général qui sont réellement destructeurs. » (Vincent Mignerot [68] )
Les moyennes ont bon dos, elles permettent de cacher les situations (de pauvreté et de richesse) extrêmes par des formules comme « notre confort général » ou « nos revenus ». Elles permettent de faire oublier, par exemple, que la majorité de la population mondiale n’a jamais pris l’avion. Elles montrent à quel point certains « écologistes » peuvent être déconnectés de la réalité vécue par un nombre croissant de personnes. Lorsqu’on connaît le stress de ne plus trouver de distributeurs avec des coupures de cinq ou dix euros, ou le choix entre faire soigner les dents de son enfant et payer sa régularisation annuelle d’électricité, ces formules sont inaudibles. Alors, bien sûr, les flux de matières dont dépend la personne médiane d’Europe centrale ne sont pas viables et ne sont pas généralisables à l’ensemble de la planète. Bien sûr qu’il est de plus en plus insupportable de voir autant de personnes seules dans leur voiture parcourir moins de deux kilomètres (et encore plus celles qui prennent leur jet, mais elles, on ne les voit jamais alors on ne leur fait pas la morale). Bien sûr qu’il ne faut pas se déresponsabiliser, nous sommes des adultes, mais responsable et coupable sont deux choses différentes. Présenter ces dépendances et ces habitudes de vie comme des choix que nous aurions posé individuellement et collectivement, de manière libre et affranchie, est le propre du libéralisme qui tente d’effacer les rapports de force. Ces « choix », alignés sur l’objectif plus large de nous faire produire et consommer toujours plus, ne sont pas neutres et ils ont rencontré de nombreuses résistances dont il serait bon de se souvenir.
Même si l’ensemble de l’humanité devait être éradiquée à terme, nous ne serons jamais « dans le même bateau » (uniquement sur le même océan, ce qui n’est pasdu tout la même chose) si on ne modifie pas les rapports de pouvoir. Avoir des minutes d’antenne grand public, avoir accès aux colonnes de journaux à (très) large audience, et faire le choix de parler de phénomènes aussi graves sans parler des rapports antagonistes présents dans la société (qui les amplifient) est un choix qu’il faut assumer. Cette manière de présenter les choses, certes catastrophiste mais tout à fait inoffensive pour le pouvoir en place, convient parfaitement aux critères des médias mainstream (nous allons d’ailleurs probablement voir une multiplication des émissions à sensations du type C8 [69] ). D’autres parlent des limites écologiques dépassées et de leurs conséquences depuis bien longtemps, mais en tirant des conclusions et des propositions incompatibles avec l’ordre établi (Henry David Thoreau, Élisée Reclus, Simone Weil, Murray Bookchin, Ivan Illich, André Gorz – dans l’ordre chronologique).
Les réponses à côté de la plaque et les dérives réactionnaires
Comme d’aucuns le rappellent souvent, les catastrophes ce ne sont pas seulement les événements en tant que tels, ce sont surtout les réponses qu’on y apporte. À ce titre, les réponses proposées et/ou produites par la plupart des discours collapsos ne sont pas adaptées à la situation, lorsqu’elles ne sont pas tout simplement contre-productives et dangereuses. Les plus en vogue sont, principalement, (1) la création et le renforcement de petites communautés plus résilientes, (2) le courant survivaliste* et (3) le développement de nos spiritualités.
La première proposition est très importante, mais inaccessible pour l’écrasante majorité de la population sans passer par des luttes collectives (accès à la terre, dépendance à l’emploi, droits de propriété, etc.). Or, cela semble être un détail pour les collapsos. Pour récupérer les moyens d’autonomie qui nous ont été arrachés par la violence durant plusieurs siècles, on ne pourra pas se limiter à nos réseaux de néo-ruraux (à moins que l’on assume que cette proposition leur soit réservée). Le conflit reste entier pour y arriver, surtout si cette reprise d’autonomie prend de l’ampleur, mais ce « détail » reste absent des discours collapsos.
La deuxième proposition n’est pas totalement inintéressante, dans l’idée de se réapproprier des savoir-faire essentiels dont nous avons été coupés. Mais il ne s’agit pas simplement de cela quand on parle de survivalisme. Si la tendance première du phénomène est d’idéologie libertarienne ce n’est pas un hasard, c’est parce que sa manière de voir la société et de se rapporter aux autres est mue par la peur, et non pas par le désir d’émancipation. Le dernier livre des plus célèbres collapsos [70] appelle à des alliances entre ZAD et BAD* (Bases Autonomes Durables), pourtant l’incompatibilité saute aux yeux. Les ZAD sont basées sur la confrontation pour se libérer, les BAD sur la fuite pour se replier. On ne fait pas société, sécession collectivement, avec des BAD, ni même avec des réseaux de BAD. Le phénomène touche aujourd’hui un public bien plus large que les libertariens, mais cela ne constitue pas en soi une bonne nouvelle. D’une part, il s’agit avant tout d’un énorme marché en pleine expansion, et ce marché n’a rien d’écologiste. D’autre part, c’est une sphère où se croisent désormais « bobos et fachos » – comme l’explique non sans humour Alexandre Dewez dans son superbe spectacle sur le business de la fin du monde – qui offre une tribune discrète mais massive (10 000 personnes lors du deuxième salon du survivalisme qui vient de se tenir à Paris) à des individus et organisations d’extrême-droite qui, par nature, avancent de manière déguisée et ne peuvent presque jamais côtoyer un public aussi large.
La troisième proposition peut également contenir des aspects intéressants, dans les rares cas où il ne s’agit ni de charlatanisme ni de sectarisme. Prendre soin des émotions et savoir les exprimer, réapprendre à écouter son corps (esprit compris), être capable de s’arrêter pour penser et ressentir, s’approprier l’enjeu des rituels collectifs (pas ceux des gourous) est très important. Mais, de la même manière que développer nos autonomies (dont la sécurité) peut se faire en dehors du survivalisme, toutes ces choses peuvent se faire en dehors du marché en plein essor du « développement de nos spiritualités ». Le fait que cette proposition ait une place si centrale dans les discours collapsos est une illustration qu’ils sont avant tout destinés à une partie de la classe moyenne occidentale. De plus en plus de personnes qui ne savent plus comment empêcher le rouleau compresseur d’avancer, qui ont abandonné la bataille (ou ne l’ont jamais commencée) s’y réfugient. Cette proposition s’accompagne d’ailleurs du traditionnel appel au travail sur soi avant d’agir. Il s’agit d’une posture infantilisante, en plus d’être inopérante puisque c’est la pratique qui apporte la compréhension, avec ses allers-retours, et non l’inverse. Ce n’est pas la pensée magique ou les références au sacré qui répondent aux angoisses, c’est l’agir. Tout comme ce n’est pas la catastrophe annoncée qui « fait réagir », c’est le sentiment partagé d’une force collective possible. Ce n’est pas le changement fondamental de circonstances qui apportera seul, mécaniquement, un « renouveau de sens », c’est l’émancipation construite ensemble. Malheureusement, cette troisième proposition, à côté de la plaque, occupe une place particulièrement importante dans le dernier livre précité. Les auteurs nous y invitent à compléter la collapsologie (science de l’effondrement) par la collapsosophie* (sagesse de l’effondrement). Lorsque cette « sagesse » se concrétise réellement, c’est sous la forme d’analyses essentialistes* (dont les auteurs se défendent très maladroitement) et d’appels à rejoindre des dérives masculinistes du type « Nouveaux Guerriers [71] ».
Avec de telles « perspectives », on peut comprendre que les personnes restent effondrées.
« Pour affronter ces crises majeures à la fois climatiques, écologiques et économiques, et pour réaliser cet indispensable travail de deuil, les écopsychologues misent notamment sur le travail en groupe. Avec une écoute bienveillante, la mise en place de rituels collectifs, etc. » (Nathalie Grosjean [72])
« Avant d’agir, et même avant de proposer des pistes d’action, il y a encore des choses à comprendre et un chemin intérieur à faire. » (Gauthier Chapelle, Pablo Servigne et Raphaël Stevens [73] )

D’autres propositions de réponses, plus globales mais également plus rétrogrades, sont régulièrement mises en avant dans les discours collapsos et/ou par les personnes effondrées.
Il y a tout d’abord le grand retour des positions pro-nucléaires (portées entre autres par Jean-Marc Jancovici). Cette proposition, soi-disant « politiquement incorrecte », est partagée et pratiquée par le pouvoir en place. Si cela était encore nécessaire, rappelons tout de même qu’on ne sait toujours pas quoi faire des déchets nucléaires millénaires ; que les dangers d’accidents nucléaires sont immenses et qu’ils vont augmenter à mesure des dérèglements climatiques, de la montée des eaux et de la raréfaction énergétique (pour refroidir les centrales, entre autres) ; que le « bilan carbone » total de cette industrie est loin d’être aussi intéressant que les lobbys pro-nucléaires veulent nous le faire croire (besoins énergétiques pour les transports, la maintenance, etc.) ; qu’il s’agit d’une industrie privée non rentable soutenue à coups de milliards par la collectivité ; et, enfin, que l’uranium nécessaire à la production d’énergie nucléaire est une « ressource » limitée sur la surface du globe.
Il y a ensuite la proposition réactionnaire, et prétendument « taboue », de contrôle démographique (des pauvres et des très pauvres, surtout). Il ne s’agit pas ici de nier le caractère exponentiel de la courbe démographique mondiale depuis la révolution industrielle, et plus particulièrement depuis 1950 (elle suit en cela toutes les autres courbes), ni le fait que les êtres humains et « leurs » animaux domestiqués représentent aujourd’hui plus de 95 % des vertébrés présents sur Terre. Il s’agit de se demander pourquoi les angoissés de la démographie estiment presque toujours que les disparités gigantesques en termes de « pression humaine » sur les écosystèmes sont secondaires, et pourquoi ils ne proposent même pas de lutter contre les gaspillages abyssaux induits par le système de surproduction actuel. Il s’agit surtout de se demander pourquoi ils ne rappellent pas que le droit à disposer de son corps pour les femmes a démontré son efficacité face aux contrôles démographiques patriarcaux, pourquoi ils citent sans cesse la politique autoritaire de l’État chinois sans faire référence aux autres causes qui ont provoqué la baisse de natalité (comme la sortie partielle de la pauvreté) et pourquoi ils ne s’intéressent pas aux exemples voisins contradictoires [74] .
Enfin, on entend de plus en plus la proposition de rationnements et d’efforts de guerre. Il peut être intéressant de s’inspirer de certaines expériences de rationnements plus ou moins équitables qui n’auraient pas mal tourné – même si les plus riches favorisent et profitent toujours d’un marché noir dans ces situations. Mais les collapsos et autres effondrés qui parlent de rationnements donnent très peu de détails pratiques sur comment cette proposition serait appliquée, et font apparemment peu de cas du fait que le point de départ de cette merveilleuse idée est une société profondément inéquitable. Enfin, accompagner cette proposition du langage et de l’imaginaire des « efforts de guerre » (comme par exemple accepter de travailler plus), est loin d’être une bonne idée. La guerre n’est jamais menée ni par, ni pour, l’intérêt collectif.
Au-delà d’appels à s’inspirer de mesures autoritaires, plusieurs auteurs et mouvements ouvertement xénophobes nourrissent l’univers collapso. Il faut nous rendre compte que ce n’est pas un hasard si les discours de l’effondrement conviennent tant à une partie des extrêmes-droites. Présenter la (prétendue) fin de la civilisation occidentale comme l’effondrement absolu correspond parfaitement au mythe du « grand remplacement » et à l’appel aux replis identitaires. Dmitry Orlov, par exemple, présente ses cinq stades de l’effondrement (chronologiques, attention) comme suit : l’effondrement financier, suivi du commercial, du politique, du social et enfin... du culturel. Le fait que le prétendu « effondrement culturel » soit mis à la fin et soit présenté comme l’apothéose du chaos (avec, depuis lors, l’écologique) ne tombe pas du ciel. Le fait qu’Orlov soit un complotiste xénophobe (et homophobe) n’empêche malheureusement pas les autres collapsos de le citer très régulièrement (en connaissance de cause ou non, selon les cas).
« Il s’agit [pour les oligarques] de détruire les sociétés occidentales et leurs systèmesde soutien social en les inondant de parasites hostiles, souvent belliqueux, issus de cultures incompatibles. [...] Une autre [méthode des oligarques] est de supprimer [notre] tendance à [nous] reproduire en [nous] convainquant que le sexe biologique n’existe pas et en le remplaçant par un arc-en-ciel de genres, en élevant la perversion sexuelle à un statut social élevé [...] pour une minuscule minorité de gens (généralement moins de 1 % qui sont, par cause d’anomalie génétique, nées gay). » (Dmitry Orlov [75] )
Plusieurs analystes rappellent à ce propos que les discours de l’effondrement proviennent historiquement de courants conservateurs et réactionnaires, qui voyaient dans l’évolution des mœurs (ou dans la révolution sociale, par exemple) des manifestations du déclin ou de la décadence civilisationnelle [76] . Cela ne signifie bien sûr pas que tous les collapsos contemporains sont réactionnaires, au contraire, mais que leurs discours inspirent des propositions réactionnaires et – plus problématique – qu’ils s’en inspirent eux-mêmes souvent, sans les nommer comme telles. Le livre référence de la collapsologie, diffusé à plus de 40 000 exemplaires, dédie plusieurs pages à Dmitry Orlov sans aucune remarque à ce sujet [77] . Celui-ci est également inclus dans le « réseau des collapsologues » du site www.collapsologie.fr. Le collapso d’extrême-droite Piero San Giorgio est également référencé dans le dernier livre référence sans aucune remarque [78] . Ce livre relaie d’ailleurs abondamment les thèses réactionnaires du psychiatre antisémite Carl Gustav Jung sur les soi-disant « archétypes », et sur un nécessaire « retour à nos racines profondes » [79] , à nouveau sans aucune remarque concernant l’idéologie de cette source d’inspiration.
Pour terminer sur les réponses à côté de la plaque et/ou réactionnaires, mais dans un tout autre registre, les collapsos ne remettent pas en cause le rôle de l’État (à différencier des services publics, et a fortiori de la sécurité sociale née en dehors de l’État). Ils présentent plutôt son prétendu effondrement comme une des causes des malheurs à venir. L’État et ses fonctions régaliennes (police, armée, « justice ») ne sont pas en train de s’effondrer, au contraire. Les intérêts que l’État sert sont pourtant de plus en plus clairs depuis une dizaine d’années : subsides aux entreprises destructrices et réglementations pro-marché, répression des résistances à l’avancée du marché, impunité et couverture de la criminalité en col blanc, phénomène des revolving doors [80] , privatisation et destruction des services publics, en sont quelques illustrations. Il suffit d’observer comment les institutions étatiques se comportent face aux « effondrements » en cours et face aux personnes qui y répondent (des écologistes de terrain aux citoyens solidaires de personnes réfugiées). Certains collapsos se défendent du manque d’analyse politique de leurs travaux en disant que d’autres peuvent développer ce travail (ou qu’ils le feront bientôt), mais ils oublient que leurs discours produisent déjà de la politique. Dans la société en général, mais aussi plus précisément avec l’État (ou le patronat) qui en ont sollicité certains. Leur posture et le contenu de leurs discours – discours de la peur, de l’impasse, de l’acceptation, de la pacification sur le même bateau – risquent en fait surtout de servir (volontairement ou non) le développement d’une « politique de l’effondrement » qui consistera principalement en une adaptation des classes dominantes à la situation afin de maintenir leurs privilèges. Pour être plus précis, à rapports sociaux inchangés, les nouvelles donnes écologiques seront utilisées (et elles le sont déjà) pour remettre en cause des conquêtes sociales et pour accroître ces privilèges. Afin de garder les pieds sur terre, il peut être bon de lire ou relire les travaux de Naomi Klein sur la stratégie du choc et la montée d’un capitalisme du désastre [81] .
« La seule manière de nous sauver aujourd’hui, ce serait que les dirigeants [...] assument leur fonction et qu’ils nous sauvent. Je pense qu’il faut des mesures coercitives, on ne peut pas continuer à faire semblant de laisser entendre que tout est compatible avec tout [...]. Vraisemblablement, il faut effectivement s’opposer à un peu de notre liberté, à un peu de notre [sic] confort, mais c’est finalement pour avoir la possibilité de continuer à jouir d’une planète habitable. [...] Nous [sic] avons des comportements, des attitudes, qui sont létales, qui sont en train de tuer la planète [...]. » (Aurélien Barrau [82] )
« Il est bien loin le temps du déni. Nous ne sommes pas seulement en train de perdre notre bataille contre le changement climatique, mais aussi celle contre l’effondrement de la biodiversité. [...] nous allons devoir complètement changer la façon dont nous produisons, consommons et nous comportons. » (Emmanuel Macron [83])
Une autre proposition réactionnaire qui est régulièrement suggérée est l’option autoritaire. Puisque nous n’avons plus le temps, que « les gens » ne sont pas prêts et que l’ampleur du défi est énorme, répondons à « l’urgence écologique » par des « mesures fortes » (par qui, pour qui, on ne sait pas trop). Au-delà du fait que les dictatures ne sont jamais écologistes, il est bon de rappeler que notre rapport aux écosystèmes découle de nos rapports sociaux. C’est là tout l’apport de l’écologie sociale* développée par Murray Bookchin. On entend également de plus en plus d’appels à ce que l’écologie passe au-dessus de toute autre forme de considérations, voire au-dessus des clivages gauche-droite. C’est une ancienne proposition dans l’écologisme, particulièrement réactionnaire. Comme si on pouvait s’émanciper de notre rapport de domination envers le reste du vivant, tout en jugeant les autres rapports de domination secondaires. Cette proposition prétend choisir entre les problèmes plutôt que d’acter qu’ils sont interreliés et qu’ils s’alimentent. Envisager une écologie – qui est censée penser l’ensemble – comme séparée du reste n’a pas de sens. Sur la question des « nouvelles alliances » qui dépasseraient le clivage gauche-droite (insuffisant, certes, mais opérant), il faudrait préciser les intentions pour pouvoir se positionner.
« Les impératifs écologiques sont les premiers de tous les enjeux. » (Dominique Bourg [84] )
« Cette préoccupation primera désormais sur toute autre. » (Agnès Sinaï [85] ) « C’est désormais ce qui nous divise tous [le fait d’être soi-disant conscient·e ou inconscient·e de la situation écologique et d’y réagir en conséquence], bien plus que de savoir si nous sommes de droite ou de gauche. » (Bruno Latour [86])

Perspectives pour effondrés
Premièrement, refusons les instrumentalisations de la situation écologique pour justifier de nouvelles injustices et exploitations. Le mouvement des gilets jaunes n’est qu’un avant-goût de cet enjeu colossal. Il a mis à l’ordre du jour la problématique de la fin du pétrole bon marché de manière bien plus efficace que les collapsos et nous autres effondrés n’avons jamais réussi à le faire avec nos beaux discours de pénuries. Les problèmes de production, de répartition et d’accès à des ressources de base ne font que commencer, et alors que des composantes significatives de la population ont décidé d’y réagir collectivement plutôt qu’en se sautant mutuellement à la gorge, nombre d’effondrés ont réagi avec mépris.
Jusqu’à maintenant, les populations ne voient pas grand-chose se concrétiser à part des mesures coercitives qui visent la majorité sociale, et qui ne remettent pas en cause les taux de rendement inutiles et destructeurs des plus grands actionnaires. Pour l’instant, la véritable raison de ces mesures est la répartition entre le capital et le travail, pas l’écologie. Si les propositions (prétendument) écologistes se font sur des bases injustes, il n’y a aucune raison que cette majorité sociale les accepte, et tant mieux. Ce n’est pas l’écologie en tant que telle qui est irrecevable, c’est le constat d’injustice. Parler aux gens de baisse de « confort » radicale dans un monde où ce « confort » n’a jamais été aussi inégalitairement réparti, c’est préparer le terrain pour le fascisme. Cette image d’écologiste hors sol nous colle à la peau et empêche les personnes lucides sur la situation et sur leurs conditions de vie de s’y identifier, à juste titre.
Deuxièmement, positionnons-nous clairement par rapport aux propositions réactionnaires présentes dans certains discours collapsos ainsi que sur leurs « inspirations » d’extrême-droite. Comme dirait Gramsci : « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres ». En termes d’équité sociale et de limitation des basculements écologiques, les fascistesn’ont rien à proposer. Lorsqu’ils ne sont pas ouvertement climato-sceptiques, ils ne prévoient rien d’autre face au productivisme que la préférence nationale. La seule carte que certains jouent est la prolongation du nucléaire. Il faut saisir cette occasion, nous responsabiliser et les décrédibiliser en les présentant tels qu’ils sont.
Troisièmement, prenons acte de la situation écologique. Grâce aux collapsos, certains constats sont enfin pris en compte plus largement et le refus du débat sur ceux-ci devient une position de moins en moins tenable. Grâce à leur travail, des études complexes sur l’évolution des écosystèmes deviennent beaucoup plus accessibles et appropriables. Ce travail, ainsi que celui de nombreux autres auteurs et autrices, les derniers rapports du GIEC*, l’été 2018, ... expliquent en partie tous ces panneaux lucides au sein des marches climat. Avec des messages qui actent l’extinction massive en cours, nous ne sommes plus dans une écologie réservée aux personnes qui aiment « la nature », nous sommes enfin dans la conscience qu’il s’agit de bien plus (et entre autres de notre survie). Malheureusement, une réaction assez commune aux discours de l’effondrement consiste à minimiser ou relativiser la situation écologique, alors que le problème de ces discours ne se situe pas là. Il n’est par exemple pas rare d’entendre des représentants d’ONG s’accrocher à des discours dépassés qui sonnent faux (« il n’est pas trop tard », « il y a encore de l’espoir », « il faut entamer une transition énergétique à l’horizon 2050 », « il faut que nos politicien·ne·s comprennent et réagissent », « nous pouvons éviter la catastrophe », etc.). La prise en compte de cette gravité les obligerait en effet à abandonner toute une partie de leurs analyses, pratiques et propositions réformistes (quel que soit leur secteur d’intervention). Se questionner sur la manière de présenter les choses à « ses » publics-cibles est sain, mais pas de vouloir édulcorer la réalité pour coller à son programme. Pour le moment, beaucoup de structures institutionnalisées font donc le choix de n’en parler qu’en interne.
« Une telle question peut avoir un impact sur la manière dont on fait du commerce équitable Nord-Sud. Mais il s’agit d’une démarche interne que nous ne souhaitons pas imposer à nos sympathisants. Nous n’allons pas faire une campagne pour dire que c’est la fin du monde. » (Roland D’Hoop, Oxfam-Magasins du monde [87] )
En fait, nous nous trouvons face à une nouvelle opportunité d’enfin intégrer sérieusement la donne écologique dans chacune de nos luttes et de décloisonner à son tour cette « thématique » [88] . C’est ce que font plusieurs collectifs depuis le début des superbes grèves écolières pour le climat.
Enfin, quatrièmement, parlons-en. Toutes les expériences montrent que les personnes qui se sentent seules face à cela sont légion. Le problème des récits collapsos n’est pas que leurs perspectives seraient trop alarmistes écologiquement, mais qu’elles sont (en partie) erronées. Ils ratent ainsi leur pari sincère de participer à redonner du sens en ces temps difficiles. Les collapsos best sellers reconnaissent d’ailleurs le risque qu’ils induisent « d’aplatir le futur ». Ce risque ne provient pas de leurs constats, mais de leurs conclusions. Comme le souligne Chloé Leprince en faisant référence à Jean-Baptiste Fressoz cité plus haut, « on a pris le pli de regarder la catastrophe écologique à travers un prisme dont on aurait pu se passer [89] ». Ce n’est pas un hasard si les discours confus – desquels la plupart des discours collapsos participent – ont surtout du succès dans les périodes de perte de sens et de profond sentiment d’impuissance collective. Les sectes et les charlatans (à distinguer clairement des collapsos) en profitent alors pour « accompagner » les gens. Il y a ainsi un enjeu important à continuer de proposer des espaces pour échanger sur nos angoisses et envies, de proposer d’autres pistes qui fassent sens. Pour revenir sur les discours collapsos, il est très important de parler collectivement de ces constats, si possible en s’émancipant un peu de l’imaginaire et du récit de l’effondrement, ainsi que de nos « apôtres » référents comme Pablo Servigne et ses acolytes. Comme le dit régulièrement Renaud Duterme – qui adopte le terme d’effondrement mais en souligne les limites – il ne faut pas être fétichiste de la notion. Elle porte en elle une certaine efficacité dans la puissance de l’effet qu’elle produit (par rapport à « crise écologique », par exemple), mais également beaucoup de limites et de confusions inutiles. À nous de les dépasser. Certaines personnes choisissent de ne plus utiliser ce terme flou et inadapté, d’autres en font leur slogan favori. Au-delà du terme lui-même, ce qui compte le plus est la manière d’amener les choses et d’éviter d’alimenter l’équivoque sur ces sujets. Il serait par exemple utile d’arrêter d’entretenir l’ambiguïté sur le caractère scientifique des récits collapsos ; de relayer dans nos discours et propositions le fantasme d’un « après-effondrement » ; de présenter la fin de « nos » conditions de vie comme la fin du monde ; etc. [...]
Jérémie Cravatte

Glossaire pour effondrés

Accélérationnisme : Idée selon laquelle le capitalisme doit être approfondi pour être dépassé, qu’il faut en accélérer les contradictions internes (limites écologiques, impossibilités pour la main d’œuvre mal payée de consommer suffisamment, pour faire court). Cette « idée » a été un peu remise à la mode par Laurent de Sutter, professeur de droit à l’Université libre de Bruxelles.
Anomie (« absence d’ordre ») : Situation où les normes sociales n’ont plus court. Chaos. À différencier de la notion d’anarchie (« absence de pouvoir »).
Anthropocène (« ère de l’être humain ») : Période géologique caractérisée par l’influence des êtres humains sur l’écosystème terrestre. Elle a débuté avec la révolution industrielle, soit à la fin du xviii e siècle. Terme proposé en 2002 par le météorologue et prix Nobel de chimie Paul Crutzen. Les termes « Occidentalocène » ou « Capitalocène » sont parfois utilisés afin d’être plus précis. En effet, tous les « anthropos » n’ont pas vécu et ne vivent pas en déséquilibrant les écosystèmes.
Anthropocentrisme : Vision de l’être humain·e comme étant le centre de l’Univers, qui fait tout tourner autour de lui.
BAD (Base Autonome durable) : Terme survivaliste* faisant référence à un lieu d’habitat sécurisé et reculé qui est censé permettre de vivre Off the Grid (« hors de la grille », du réseau), en autarcie et / ou en autosuffisance.
Biorégion : Territoire dont les frontières ne sont pas administratives mais géographiques, définies à partir des écosystèmes. La notion a été portée par Peter Berg à la fin des années 1970. Ces territoires, opposés à la centralisation et à la hiérarchisation, correspondent plus ou moins à la taille de districts qui prennent en compte plaines, vallées, collines, bois, ruisseaux, fleuves, berges, etc.
Boucles de rétroaction positives : Phénomènes qui auto-alimentent les causes de leur effet une fois certains seuils* dépassés (exemple : le réchauffement climatique qui amène une forêt à émettre et non plus à capter du carbone, ce qui augmente à son tour le réchauffement climatique etc.). Dans le cas inverse, on parle de boucles de rétroaction négatives. On ne peut pas les prévoir toutes, même si William Steffen, Johan Rockström et leurs collègues en ont déjà identifiées 15 majeures (dont la plus connue est le relâchement des énormes quantités de méthane* contenues dans le permafrost).
Capitalisme vert : Intégration de la question écologique par le capitalisme. Dans son acception restreinte (et préférable), la notion fait référence aux nouveaux marchés ouverts par le capitalisme sur le dos de l’écologie (par exemple, le commerce de carbone). Dans son acceptation plus large, la notion fait référence aux différentes mesurettes écologistes réformistes qui ne remettent pas en cause les racines du système de production capitaliste (par exemple, le soutien aux entreprises qui diminuent leurs déchets).
Civilisation : Terme flou, hérité des Lumières, qui désigne grosso modo les traits caractéristiques d’une société donnée (terme un peu moins flou). Ces caractéristiques sont généralement d’ordre politique, économique, technique, culturel, religieux, etc. Le terme est généralement utilisé en opposition à un état (fantasmé) de barbarie.
Civilisation thermo-industrielle : Civilisation basée sur l’industrie et, plus particulièrement, sur les énergies fossiles. Certains rajoutent qu’elle se caractérise par une grande complexité organisationnelle. Il s’agit d’une notion occidentalo-centrée puisqu’elle fait référence à ce modèle de civilisation bien spécifique qui s’est imposé aux quatre coins du monde mais ne s’est pas généralisé à l’ensemble des êtres humains. Ce concept tait le trait caractéristique de cette civilisation qui est son rapport à l’accumulation de capital.
Collapsologie : Étude transdisciplinaire de l’effondrement (de l’anglais collapse) de la civilisation thermo-industrielle et de ce qui pourrait lui succéder. Néologisme inventé en 2014 par Pablo Servigne et Raphaël Stevens.
Collapsosophie : Néologisme inventé par Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle – quelques années après celui de collaposlogie*– , qui désigne cette fois-ci la sagesse de l’effondrement, le complément nécessaire à la science. C’est la « dimension intérieure » de l’approche collapso, une « ouverture plus large aux questions éthiques, émotionnelles, imaginaires, spirituelles et métaphysiques ».
Conservationnisme : Courant précurseur anglo-saxon de l’écologisme (porté entre autres par le forestier américain Gifford Pinchot au début du xx e siècle) qui se base sur la conservation, ou la substitution, d’écosystèmes et d’espèces vivantes. Ce courant est régulièrement misanthrope et opposé à la présence humaine dans ces espaces. Les conservationnistes sont, paradoxalement, enclins à intervenir pour « éviter » ou « réparer » des dégradations dans ces écosystèmes. Certains promeuvent les « paiements pour services environnementaux » afin de « valoriser » en termes marchands ces écosystèmes et ainsi motiver leur « conservation ». Les plus grandes associations conservationnistes (si on peut les considérer comme telles vu les salaires de leurs directions et leur greenwashing* actif de multinationales) sont CI (Conservation International), TNC (The Nature Conservancy), WCS (Wildlife Conservation Society) et WWF (World Wide Fund for Nature).
Convivialisme : Mouvement lancé en 2013 par le sociologue et économiste Alain Caillé, qui s’inspire d’Ivan Illich et de son concept de « société conviviale ». Les convivialistes ont pour ambition de développer une philosophie politique alternative basée sur le principe de commune humanité (non discrimination entre les humains et respect du pluralisme), de commune socialité (prendre soin du rapport social), de légitime individuation (reconnaître la singularité de chacun·e) et d’opposition maîtrisée et créatrice (le conflit est nécessaire et désirable s’il créé de la socialité). Cette nouvelle philosophie politique basée sur l’entraide serait nécessaire car le libéralisme, le socialisme et ses variantes le communisme et l’anarchisme reposeraient toutes sur l’idée de ressources infinies (ce qui n’est pas le cas).
Décroissance : Mouvement antiproductiviste et (donc) le plus souvent anticapitaliste, né dans les années 1970. Il dénonce le mythe d’une croissance infinie dans un monde fini. Les décroissants (ou les objecteurs·trice·s de croissance) luttent pour une décroissance choisie plutôt que subie. André Gorz est le premier à avoir utilisé le terme.
Dérèglements climatiques : Le réchauffement climatique produit des effets multiples qui ne se limitent pas à une hausse des températures ressenties (il peut aussi produire indirectement des phénomènes de froids extrêmes). « Changements climatiques » pourrait donc être plus englobant (bien que ce soit en effet un réchauffement qui est à l’œuvre), mais « changements » est trop neutre. « Dérèglementsclimatiques » correspond bien à ce qui est en train de se produire. Focaliser sur le climat lorsqu’on parle de basculements écologiques est dangereux car nombre de fausses solutions proposent de « régler » la question du climat sans prendre en compte, par exemple, la biodiversité (alors qu’elles s’influencent toutes deux réciproquement).
Dette écologique : Dette accumulée par les régions industrialisées envers les autres régions ou, plus précisément, par les détenteurs de capitaux envers le reste des populations (et plus particulièrement la majorité de celles vivant dans l’hémisphère sud) depuis la période coloniale. Elle se subdivise en dette du carbone, passifs environnementaux (spoliation des ressources naturelles, pollutions et destructions liées à ces exploitations, aux interventions militaires, etc.), biopiraterie (appropriation intellectuelle et matérielle des semences, plantes médicinales, etc.) et délocalisation des déchets (dont les produits dangereux). Le concept a été créé par des mouvements sociaux du sud global mais a depuis été récupéré pour une signification plus large et consensuelle : la dette écologique de « l’humanité » indifférenciée envers les générations futures ou envers la planète.
Développement durable : Oxymore apparu surtout après le rapport Brundtland en 1987 qui, comme son nom l’indique, prétend qu’un modèle développementaliste (de croissance économique) pourrait être « durable » (voire « soutenable » en anglais). Il est présenté comme l’espace de rencontre entre les secteurs fictivement séparés de l’économique, du social et de l’écologique. Ce terme absurde diffusé par les institutions a malheureusement été repris par une grande partie de la « société civile ».
Dualisme : Opposition conceptuelle entre deux notions, qui ne se vérifie généralement pas dans la réalité mais influence fortement nos conceptions : corps et esprit, nature et culture, animalité et humanité, féminin et masculin, bien et mal, etc.
Ecoféminismes : Mouvements politiques apparus dès les années 1970 (mais qui viennent de plus loin), qui font les liens entre patriarcat et domination-destruction de la nature. Deux tendances principales se distinguent, l’une matérialiste* et l’autre essentialiste*. Certaines écoféministes préfèrent parler d’essentialisme* stratégique. Susan Griffin, Donna Haraway, Yayo Herrero, Vandana Shiva, Starhawk sont des écoféministes célèbres.
Ecologie libérale : Fausse écologie qui reposerait sur la somme de choix individuels, comme si les structures collectives et les rapports de production ou de domination n’existaient pas. Cette « écologie » est la plus visible, puisque la plus relayée par le discours dominant. Du côté « alternatif », plusieurs campagnes promeuvent cette posture en expliquant aux personnes qu’elles ont le choix et qu’il ne leur reste plus qu’à faire leur petit marché dans une liste de gestes « écologistes » aconflictuels : la campagne de youtubeur·euse·s « On est prêt » ; la campagne publique « Engage, j’agis pour le climat » ; la campagne privée de Julien Vidal « Ça commence par moi », etc. Certains ne se gênent même plus pour appeler cette posture, de la « Résistance climatique ». Cela n’empêche bien sûr pas de faire des bilans auto-critiques, comme « On s’est planté », dont nous devrions tou·te·s nous inspirer.
Ecologie politique : Tendance de l’écologisme apparue, surtout dans les années 1970 (mais qui vient de plus loin), qui insiste sur la nécessité de changements structurels dans la société pour respecter les limites et équilibres écologiques. André Gorz en est un des théoriciens. À cause des partis politiques écologistes (fondés dans les années 1980 en Europe puis plus tard dans le reste du monde), d’aucuns utilisent plutôt ces termes pour désigner ces partis.
Ecologie sociale : Tendance de l’écologie apparue, surtout dans les années 1960 avec Murray Bookchin (mais qui vient de plus loin), qui conçoit les problèmes écologiques comme conséquence des dominations sociales. Elle se traduit par la proposition du municipalisme (ou « communalisme ») libertaire, concrétisé de nombreuses fois dans l’histoire. Au vu de la situation, cette pensée a regagné en écho ces dernières années.
Ecopsychologie : Branche de la psychologie, développée dans les années 1970, qui étudie les relations entre les personnes (plutôt urbains) et leurs environnements. Ces relations seraient basées sur la peur, la frustration, le désir, le plaisir, etc. L’écopsychologie gagne également en audience ces derniers temps comme réponse à la perte de sens et au besoin de reconnexion avec « la nature ».
Ecosocialisme : Courant de l’écologie politique* qui considère que les changements structurels nécessaires de notre société pour respecter les limites et équilibres écologiques doivent prendre la forme du socialisme (idéologie qui promeut la socialisation des moyens de production et l’égalité sociale). Si on prend le socialisme au sens large, on peut inclure l’écoanarchisme, l’anarchoprimitivisme, l’écologie profonde et l’écologie sociale* dans cette catégorie. Mais ce terme est généralement revendiqué par des mouvements ou personnalités trotskistes.
Effet rebond : Mécanisme décrit par l’économiste anglais William Stanley Jevons, à la fin du xviii e siècle (« le paradoxe de Jevons »), selon lequel l’amélioration de l’exploitation d’une ressource ne provoque pas une diminution de sa consommation d’autant, mais plutôt une augmentation. Par exemple, la technologie nucléaire n’est pas venue remplacer les énergies fossiles mais s’y rajouter.
Effondrement : Terme faisant référence à l’effondrement systémique global de « notre civilisation thermo-industrielle* ». D’aucuns, encore plus abstraits, le définissent comme une baisse importante et rapide de la complexité. Dans les faits, ceterme fait appel à nos angoisses collectives de basculer dans l’anomie* et de ne plus pouvoir répondre à nos besoins de base.
El Niño (« l’enfant ») : Phénomène climatique exceptionnel de températures élevées de l’eau dans l’océan Pacifique. À plusieurs reprises, ce phénomène a fortement alimenté le réchauffement climatique. *
Empreinte écologique : Tentative de mesurer « l’impact » d’un être humain ou d’un groupe, voire de l’humanité entière, sur la biocapacité de la terre (la capacité des écosystèmes à se régénérer). Cette « empreinte » est souvent présentée en hectares globaux (hag) ou en nombre de planètes « consommées » (actuellement plus ou moins 1,7 à l’échelle mondiale, 5 à la moyenne états-unienne). Historiquement, on identifie le dépassement de cette capacité à partir de la deuxième moitié du xx e siècle. Annuellement, on présente l’Earth Overshoot Day (« le jour du dépassement ») comme le jour (autour du premier août) où « on » commencerait à accumuler une dette écologique* le reste de l’année. Au-delà des débats sur les méthodes de calculs d’estimations, la présentation de cette « empreinte » sous forme de moyennes est particulièrement problématique. Une différenciation est souvent faite en termes géographiques et en nombre d’habitants (cette différenciation inclut rarement les impacts écologiques effectués sur un territoire pour en approvisionner un autre), mais jamais en termes de niveaux de patrimoine ou de revenus.
Entropie (« tour, transformation ») : Terme utilisé par le physicien allemand Rudolf Julius Emmanuel Clausius, à la fin du xix e siècle, pour désigner un degré de « désorganisation » (de dissipation) qui, plus il est grand, plus la part d’énergie inutilisable est grande. Un exemple simpliste est un verre d’eau avec des glaçons dans une pièce chauffée : l’augmentation d’entropie est l’augmentation du « désordre » dans les molécules d’eau (c’est une énergie qui est inutilisable).
Eroi ou tre (« Energy returned on energy invested » ou « taux de retour énergétique ») : Ratio entre une énergie donnée et l’énergie qu’il a fallu pour la produire. Si ce ratio est inférieur ou égal à 1, on parle alors de « puits d’énergie ». Concernant l’exploitation pétrolière, ce TRE était en moyenne à 100/1 ou plus jusqu’à la moitié du xx e siècle et est aujourd’hui à moins de 10/1 (il faut aller chercher de plus en plus profondément du pétrole qui est de moins en moins riche). Les, très diversifiées, énergies renouvelables, sont presque toutes à moins de 5/1. Et c’est bien normal, les énergies fossiles ont pris des centaines de millions d’années à prendre cette forme, il s’agit d’une source énergétique titanesque qui nous a amenés à provoquer des déséquilibres tout aussi titanesques.
Eschatologie : Discours de la fin du monde.
Essentialisme : Idée selon laquelle l’essence d’une chose précède son existence. Dans les rapports genrés, l’essentialisme signifierait que les genres féminins et masculins ne seraient pas des catégories construites socialement mais des essences.
Esotérique : Notion faisant référence à un enseignement obscur destiné aux personnes initiées, voire élues. Elle est généralement utilisée pour désigner des courants religieux et/ou sectaires.
Extractivisme : Extraction, généralement industrielle et par la force, des « ressources » de la biosphère sans réciprocité. Nicolas Sersiron parle d’extractivisme des « ressources » naturelles (par le productivisme), humaines (par le salariat ou d’autres formes plus abouties d’esclavage) et financières (par la dette). L’extractivisme s’est surtout développé à partir des colonisations.
Géo-ingénierie : Folie qui consiste à modifier le climat en intervenant dessus (et donc sur de nombreuses autres choses) par diverses technologies. Il s’agit, par exemple, d’envoyer du soufre en haute atmosphère pour tenter de refroidir la température. Les effets et rétroactions sur les écosystèmes complexes sont imprévisibles. De plus, il s’agit à nouveau d’éviter de prendre en compte les limites, et de faire comme si le climat était un « problème » qu’on pouvait traiter indépendamment des effets sur le reste (exemple : sur la biodiversité).
Giec (« Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ») : Groupe, créé en 1988, composé d’experts de plus ou moins 200 pays membres de l’ONU. Puisqu’il est le fruit des gouvernements, il ne peut faire de propositions en dehors du modèle de marché (ce qui rend cet organisme de plus en plus schizophrénique). Il a pour mission d’évaluer et de synthétiser les rapports scientifiques existants en rapport avec le climat. À chacun de ses rapports, les constats et prévisions sont pires que prévus. Pourtant, puisque ses rapports sont le résultat de compromis entre différentes positions et interprétations, les scénarios du « pire » ne sont pas ceux mis en avant. Une critique récurrente des collapsos envers le GIEC est d’ailleurs de dire qu’il ne prendrait pas en compte les boucles de rétroaction positive* dans ses scénarios.
Gated communities (« communautés fermées ») : Quartiers privatifs, sortes d’enclaves, généralement entourés d’un mur et/ou de grilles, dont les services sont financés en copropriété par des personnes aisées pour s’isoler de la pauvreté. Un de ces services de base est le dispositif de sécurité. Ces gates communities jouissent d’un statut légal particulier aux États-Unis.
Grande accélération : Caractère exponentiel des courbes de production d’énergie, de pêche, de déforestation, de démographie, de flux monétaires, de PIB, d’urbanisation, de tourisme, d’émissions de gaz à effet de serre, d’acidification des océans, de destruction de la biodiversité... depuis la révolution industrielle, et plus particulièrement depuis la deuxièmemoitié du xx e siècle. Pour des données et une visualisation graphique de cette « grande accélération », voir l’étude de William Steffen et al.
Grande extinction (ou extinction massive) : Extinction qui concerne plus de 75 % des espèces animales et végétales (océans compris) sur une durée biologique courte (quelques millions d’années maximum). Il y en a déjà eu cinq, et la sixième en cours serait la plus rapide.
Greenwashing (« écoblanchiment ») : Activité de verdissage symbolique d’une entreprise, une administration, une organisation dans le seul but de paraître écologiquement responsable. L’énergie, le temps et l’argent investi dans les campagnes de marketing en greenwashing sont généralement supérieurs à ce qui est réellement investi pour lutter contre les basculements écologiques. Le mot a été créé dans les années 1990 mais s’est surtout fait connaître, comme le phénomène lui-même, une quinzaine d’années plus tard.

Low-tech (« basse technologie ») : Techniques simples basées sur des matériaux avec le moins d’alliages possibles, réparables, transformables et le plus recyclables possibles. Les low-tech sont généralement de petites unités (en opposition aux unités industrielles) et développées de manière décentralisée (en opposition aux technologies centralisées). Philippe Bihouix, qui prend en compte la finitude des ressources dont les métaux rares (entre autres choses), a contribué à faire connaître récemment ce concept à un plus large public.
Matérialisme : Idée selon laquelle les choses sont avant tout déterminées par les conditions matérielles.
Méthane : Gaz à l’effet de serre des dizaines de fois plus puissant que le CO2 mais d’une durée de vie moindre.
Millénarisme : Mouvement religieux qui reposait sur la croyance en l’avènement d’un royaume nouveau. Il consiste en un retour aux conditions qui auraient été celles de « l’origine » des temps. Le terme est aujourd’hui utilisé de manière générique pour désigner les mouvements et/ou discours eschatologiques*.
Mycelium (« blanc de champignon ») : Partie souterraine des champignons ou de bactéries filamenteuses, constituée de ramifications (« hyphes ») qui peuvent couvrir des surfaces importantes. Son « réseau » facilite la coopération entre les plantes, les arbres et la forêt en général. Comme le souligne l’organisation belge homonyme, ce travail est aussi important qu’invisible.
Néo-malthusien·ne : Terme utilisé pour désigner (généralement de manière péjorative, mais pas toujours) les héritiers et héritières de la pensée de Thomas Malthus. Ils et elles sont considérés comme des angoissés de la démographie, même si ce courant est très diversifié et assez mal connu. La majorité ont en fait peu à voir avec les politiques nauséabondes promues par Malthus et soutiennent plutôt le droit à la contraception et à l’avortement, l’éducation sexuelle, la création de planning familial, l’amélioration des conditions de vie, le droit des femmes à disposer librement de leur corps, etc.
Néo-millénariste : Terme péjoratif désignant les discours prophétiques d’apocalypses (ou de jugement dernier) qui seraient suivis d’une venue sur terre du Messie, d’un retour aux origines.
Perfect Storm (« tempête parfaite ») : Expression désignant la conjonction « parfaite » de basculements majeurs (écologiques, financiers, politiques, etc.). C’est également le nom d’un scénario établi par le Government Office for Sciences du Royaume-Uni.
Pic pétrolier (« peak oil ») : Production maximale du pétrole conventionnel avant un déclin lié à l’épuisement des réserves disponibles. Ce n’est pas la fin du pétrole, mais la fin du pétrole facilement accessible et (donc) « bon marché ». L’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) estime que ce pic a été passé en 2006.
Planète étuve (« Hothouse earth ») : Image symbolisant le fait que la Terre a quitté sa trajectoire climatique, dans laquelle elle oscillait entre de (longues, très longues) périodes glaciaires et interglaciaires (de plus ou moins 100 000 années), pour rentrer dans une zone de plus fortes turbulences. Selon Steffen & co déjà cités, plusieurs « points de bascule » (tipping points) seront enclenchés dès l’augmentation de 2 °C (à cause desboucles de rétroaction*, entre autres), ce qui nous ferait dépasser un seuil de non-retour à partir duquel le climat planétaire ne pourra plus se stabiliser.
Predicament (« situation inextricable, verrouillée ») : Tout est dit, c’est l’impasse ! Terme popularisé par le spiritualiste « Bodhi » Paul Chefurka.
Résilience : Capacité d’un écosystème, d’un habitat, d’une population ou d’une espèce à ne pas être détruite après avoir subi une perturbation importante. Capacité à subir un choc.
Survivalisme : Terme inventé dans les années 1960 par Kurt Saxon, libertarien d’extrême-droite alors membre du parti nazi américain, pour désigner la tendance à organiser sa propre survie face à de potentielles catastrophes locales ou globales (stockage, kits et techniques de survie, abris, préparation physique, armement, etc.). S’il s’inscrivait à l’origine dans le contexte de la guerre froide (danger nucléaire, etc.), le survivalisme s’inscrit aujourd’hui dans la donne écologique et s’est popularisé à travers le monde (par de nombreuses émissions entre autres), dont la France, en surfant sur les angoisses collectives (crises financières, raréfaction des ressources, basculements climatiques, flux migratoires, etc.). C’est pour cela que certains utilisent plutôt l’expression de « néo-survivalistes » ou de preppers (ceux qui se préparent). Le sociologue Bertrand Vidal l’identifie comme un loisir de nantis qui ont le luxe de jouer à la survie. C’est d’ailleurs un marché en pleine expansion.
Thermodynamique : Étude des systèmes en équilibre thermique. Le premier principe de la thermodynamique est la conservation de l’énergie, c’est-à-dire que l’énergie ne peut être produite à partir de rien, elle peut juste être transformée en d’autres formes d’énergie. Le deuxième principe de la thermodynamique est la dissipation de l’énergie, c’est-à-dire l’augmentation d’entropie*, le fait que ces transformations produisent de l’énergie inutilisable.
Transhumanisme : Folie qui consiste à « augmenter » l’être humain·e à l’aide de hautes technologies, en termes physiques et mentaux, afin de (faire des sous et de) lui éviter le vieillissement, la souffrance, la maladie, le handicap voire la mort. Cette « mouvance » est née dans les années 1980 aux États-Unis et s’est depuis lors répandue dans le monde. Son symbole est « H+ » (courrez si vous le voyez).
Transition : Ici entendu comme un mouvement (incarné par Rob Hopkins) ayant pour objectif la transformation progressive de nos sociétés industrielles en sociétés soutenables. Il se présente comme une réponse au double défi du pic pétrolier* et des dérèglements climatiques*, en proposant de planifier des descentes énergétiques et d’augmenter la résilience* au sein de nos localités (entre autres par la permaculture). La première « ville en transition » était Totnes en 2006 (la ville d’Hopkins), aujourd’hui le Réseau des villes en transition (qui prémâche bien les étapes de création d’une initiative) compte un millier d’initiatives « officielles ».
Jusqu’à maintenant, les populations ne voient pas grand-chose se concrétiser à part des mesures coercitives qui visent la majorité sociale, et qui ne remettent pas en cause les taux de rendement inutiles et destructeurs des plus grands actionnaires. Pour l’instant, la véritable raison de ces mesures est la répartition entre le capital et le travail, pas l’écologie. Si les propositions (prétendument) écologistes se font sur des bases injustes, il n’y a aucune raison que cette majorité sociale les accepte, et tant mieux. Ce n’est pas l’écologie en tant que telle qui est irrecevable, c’est le constat d’injustice. Parler aux gens de baisse de « confort » radicale dans un monde où ce « confort » n’a jamais été aussi inégalitairement réparti, c’est préparer le terrain pour le fascisme.
[1] Les astérisques renvoient au glossaire en fin d’étude.
[2] Diminutif couramment utilisé pour parler des « collapsologues ». Le terme « collapsonautes » désigne plus largement les personnes qui « naviguent » à travers l’effondrement.
[3] Joseph Anthony Tainter, The Collapse of Complex Societies, University Press, 1988.
[4] Jared Diamond, Collapse – How Societies Choose to Fail or Succeed, Viking Press, 2005.
[5] Yves Cochet, « L’Effondrement – Catabolique ou catastrophique ? », in Institut Momentum, 27 mai 2011.
[6] Sur ce sujet, lire Jacques Igalens, « La Collapsologie est-elle une science ? », in The Conversation, 23 novembre 2017 ainsi que Vincent Mignerot, « Intuition et collapsologie », in L’Univers passe, 24 avril 2018.
[7] Interviewé par Clément Montfort dans le cadre de sa série « NEXT », saison 1, épisode 5, décembre 2017.
[8] Julien Winkel, « Les Belges de la fin du monde », in Alter Échos, n°468, novembre 2018, p. 20.
[9] Question de la présentatrice télé à un docteur en neurosciences après la présentation de Julien Wosnitza sur le plateau de l’Info du vrai Mag sur Canal+ : « La Fin du monde a commencé », 4 mars 2019.
[10] Julien Wosnitza, Pourquoi tout va s’effondrer, Les Liens qui Libèrent, 2018, p. 75.
[11] Titre du livre d’anticipation de Naomi Oreskes & Erik Conway, The Collapse of Western Civilization, University Press, 2014. La traduction française a été publiée chez Les Liens qui Libèrent.
[12] Interviewée par Alexia Soyeux dans son émission Présages : « Écologie politique et écoféminisme », 10 octobre 2018.
[13] Cité dans le numéro spécial effondrement du magazine Imagine, « Vivre en préparant la fin du monde », n° 123, septembre-octobre 2017, p. 22.
[14] Lire à ce sujet Régis Meyran, « Les Théories de l’effondrement sont-elles solides ? », in. Alternatives Économiques, 7 janvier 2019.
[15] Titre du livre de Pablo Servigne & Raphaël Stevens, op. cit.
[16] Titre du livre de Julien Wosnitza, op. cit.
[17] Titre du numéro spécial effondrement du magazine Socialter, op. cit.
[18] Titre du numéro spécial effondrement du magazine Usbek et Rica, « Tout va s’effondrer, et alors ? », n° 24, octobre-novembre-décembre 2018.
[19] Interviewée aux côtés de Renaud Duterme et Vincent Mignerot dans l’émission Arrêt sur images, « Effondrement, un processus déjà en marche », 12 juin 2018.
[20] Socialter, op. cit., p. 8.
[21] Interviewé par Paul Blanjean dans le numéro spécial effondrement du magazine Contrastes, « Une civilisation qui s’effondre ? », n°184, janvier-février 2018, p. 12.
[22] Interviewé par François Ruffin dans l’émission : « Une dernière bière avant la fin du monde », Fakirpresse, octobre 2018.
[23] Socialter, op. cit., p. 35.
[24] Ibidem, p. 17.
[25] Lire à ce sujet l’article, inutilement méprisant, de Nicolas Casaux, « Le Problème de la collapsologie », in Le Partage, 28 janvier 2018.
[26] Chapeau de l’article « Un patient travail de deuil » du numéro spécial effondrement du magazine Imagine, op. cit., p. 21.
[27] Socialter, op. cit., p. 40.
[28] L’inverse n’est pas vrai – le patriarcat, le productivisme et le colonialisme existent en dehors du capitalisme – même si celui-ci les renforce particulièrement.
[29] Interviewé dans l’émission de l’Info du vrai Mag sur Canal+, op. cit.
[30] « Bodhi » Paul Chefurka, informaticien canadien (très) spiritualiste, a présenté une « échelle de prise de conscience » reprise par de nombreux collapsos et effondrés – à ne pas confondre avec la « courbe du deuil », même si le principe est proche – et qui n’est pas sans rappeler le principe d’élus qui ont atteint l’illumination versus la masse inconsciente (« Ainsi, alors que peut-être 90 % de l’humanité est à l’étape 1, moins d’une personne sur dix mille sera à l’étape 5 » selon Chefurka). Les étapes de cette « prise de conscience » sont :
– Le sommeil profond ;
– La prise de conscience d’un problème fondamental ;
– De nombreux problèmes ; - Des interconnexions entre les nombreux problèmes et...
– De la situation inextricable qui englobe tous les aspects de la vie (le fameux predicament). Voir cet article traduit par Paul Racicot, « Gravir l’échelle de la conscience », Paul Chefurka, 19 octobre 2012.
[31] Citée par Imagine, op. cit., p. 27.
[32] Ibidem, p. 21.
[33] Ibid.
[34] Vincent Mignerot, « Quelles actions après les marches pour le climat ? », in Medium, 18 mars 2019.
[35] Ib., p. 22.
[36] Interviewé par Clément Montfort dans le cadre de sa série « NEXT », op. cit., saison 1, épisode 1, septembre 2017.
[37] Lire Roxanne Mitralias, « Austérité et destruction de la nature – L’exemple grec », in Contretemps, 16 avril 2013.
[38] Vœux 2019 du président français.
[39] Ce conte amérindien a été détourné et appelle en fait à une réaction bien moins individualiste. Lire à ce sujet Patrick Fischmann, « Et si le conte du colibri n’était pas gnan gnan... », in Reporterre, 23 octobre 2018.
[40] Une bonne partie des collapsos citent les chiffres d’entre quelques centaines de millions à 1 milliard d’individus à la fin du siècle (lesquels et où, ça ils ne le disent pas).
[41] Interviewé par Reporterre, « Tout va s’effondrer. Alors... préparons la suite », 7 mai 2015.
[42] Interviewé par Clément Montfort, op. cit.
[43] Interviewé dans l’émission Arrêt sur images, op. cit.
[44] Elisabeth Lagasse, « Contre l’effondrement – Pour une pensée radicale des mondes possibles », in Contretemps, 18 juillet 2018.
[45] François Thoreau et Benedikte Zitouni, « Contre l’effondrement – Agir pour des milieux vivaces », in Entonnoir, 13 décembre 2018.
[46] Cité par Daniel Tanuro, « L’Inquiétante Pensée du mentor écologiste de M. Sarkozy », in Le Monde Diplomatique, 18 janvier 2018.
[47] Daniel Tanuro, « Des Historiens et des anthropologues réfutent la thèse de "l’écocide" », in Europe Solidaire Sans Frontières, 17 mars 2012.
[48] Patricia McAnany & Norman Yoffee, Questioning Collapse – Human resilience, ecological vulnerability and the aftermath of empire, Cambridge University Press, 2009.
[49] Vidéo « Pourquoi tout va s’effondrer » avec Julien Wosnitza, publiée par Le 4e singe, 15 novembre 2017.
[50] Sur ce sujet, lire l’article, malheureusement méprisant, de Thibault Prévost, « Pour en finir avec l’écologie libérale », in Konbini, 16 octobre 2018.
[51] « Réserve indienne » du Dakota qui s’est soulevée victorieusement contre un mégaprojet d’oléoduc.
[52] Large mouvement afro-américain d’opposition au racisme systémique et, plus particulièrement, aux meurtres policiers sur les personnes noires.
[53] Sur ce sujet, écouter la très bonne émission de Radio Panik avec Elisabeth Lagasse et François Thoreau : « Pour en finir avec l’effondrement », 07 mars 2019.
[54] François Thoreau et Benedikte Zitouni, op. cit.
[55] Lire, par exemple, Corinne Morel Darleux, « Théorie de l’effondrement – Le système actuel de représentation démocratique opère un rétrécissement de la pensée », in Le vent se lève, 14 novembre 2018.
[56] Lire Renaud Duterme, De quoi l’effondrement est-il le nom ? La fragmentation du monde, Etopia, 2016.
[57] Article « La lucidité, tonique et sereine » dans le numéro spécial effondrement d’Inter-Environnement Wallonie : « L’effondrement en question », décembre 2017, p. 34.
[58] Cité par Imagine, op. cit., p. 22.
[59] Ceci n’empêche pas de nombreuses expériences de témoigner du fait que, même dans des situations matériellement plus difficiles, le sentiment de liberté et de vivacité peut être décuplé lorsque nos rapports au temps, aux autres et à la propriété sont en partie émancipés des dominations, lorsqu’on a prise sur notre quotidien et nos choix. Le potentiel pour cela est grand.
[60] Lire, entre autres, Renaud Duterme, « Le Fil rouge de l’effondrement, c’est l’explosion des inégalités », in CQFD, février 2019.
[61] Interviewé, aux côtés de Jean-Marc Jancovici, par Matthieu Jublin pour un dossier sur la fin du monde de LCI : « Effondrement, nucléaire et capitalisme » (3/6), 23 novembre 2018.
[62] Passage du manifeste d’Adrastia, association qui se donne « pour objectif d’anticiper et préparer le déclin de la civilisation thermo-industrielle de façon honnête, responsable et digne ».
[63] Une illustration en sont les gated communities* décrites par Renaud Duterme, op. cit., p. 90-124.
[64] Pour ce faire, elle va entre autres passer par des simulacres d’« alliance sacrée » entre destructeurs de la vie et prétendus défenseurs de celle-ci. La campagne de communication « Sign for my Future » (conçue par Publicis, Colryut, Danone, WWF, IEW, etc.) illustre parfaitement cette tendance.
[65] Dans le documentaire faussement auto-critique Après-demain qui, entre autres choses, offre un superbe greenwashing* à Danone en laissant penser que la mission de telles entreprises pourrait être modifiée sans en modifier la propriété ni la taille.
[66] Voir le rapport d’Oxfam International, « Les 1 % les plus riches empochent 82 % des richesses créées l’an dernier », 22 janvier 2018.
[67] Interviewé par le Comité Adrastia, 22 avril 2015.
[68] Socialter, op. cit., p. 41.
[69] Voir le « documentaire » La Planète est-elle (vraiment) foutue ? de la chaine C8, 12 décembre 2018.
[70] Pablo Servigne, Raphaël Stevens & Gauthier Chapelle, Une autre fin du monde est possible, Le Seuil, 2018.
[71] Sur le sujet, lire la brochure « Les Nouveaux Guerriers : du proféminisme au masculinisme ».
[72] Nathalie Grosjean, op. cit., p. 22.
[73] Pablo Servigne, Raphaël Stevens & Gauthier Chapelle, op. cit., p. 26.
[74] Sur la question démographique, lire le livre très intéressant du néo-malthusien* Joan Martinez Alier, L’Écologisme des pauvres – Une étude des conflits environnementaux dans le monde, Icaria, 2002, p. 127-138 ; Renaud Duterme, « Non, nous ne sommes pas trop nombreux », in CADTM, 24 octobre 2018.
[75] Dmitry Orlov, « Effondrement en vue pour l’oligarchie », in Le Retour aux Sources (qui a entre autres édité Jean-Marie Le Pen et évidemment le collapso d’extrême-droite Piero San Giorgio), 31 octobre 2018.
[76] Sur ce sujet, lire Jean-Baptiste Fressoz, op. cit. et Antoine Louvard, « L’Effondrement de droite à gauche », in Socialter, 30 novembre 2018.
[77] Pablo Servigne & Raphaël Stevens, op. cit., 2015, p. 187-191.
[78] Pablo Servigne, Raphaël Stevens & Gauthier Chapelle, op. cit., p. 257.
[79] Pour plus de détails, lire l’article de Daniel Tanuro, « La Plongée des "collapsologues" dans la régression archaïque », in Gauche Anticapitaliste, 26 février 2019.
[80] Principe de chaise musicale entre des fonctions dans les hautes sphères du secteur privé et dans l’administration publique régulatrice.
[81] Naomi Klein, La Stratégie du choc – La montée d’un capitalisme du désastre, Knopf Canada, 2007.
[82] Capsule vidéo Brut, 25 septembre 2018.
[83] Passage d’un discours du président à l’occasion de « l’Earth Hour », mars 2018.
[84] Interviewé par le magazine Imagine, « Comment ne pas se radicaliser quand l’enjeu devient vital ? », n°132, mars-avril 2019.
[85] Agnès Sinaï, op. cit., p. 85.
[86] Bruno Latour, Où atterrir ? Comment s’orienter en politique, La Découverte, 2017, p. 14. 33
[87] Cité dans le dossier d’Alter Echo, op. cit.
[88] À ce sujet, lire le numéro d’Agir par le Culture, « Articuler social et écologique », n°56, hiver 2018.
[89] Chloé Leprince, « Théorie de l’effondrement – La "collapsologie" est-elle juste une fantaisie sans fondement ? », in France Culture, 26 mars 2019.
)
Cette brochure a été initialement publiée en 2019 par le site barricade.be, dans une version légèrement différente. Nous l’avons remise en page pour en faciliter sa reproduction sous forme de brochure. Nous en avons amputé la bibliographie (dont le contenu se retrouve toutefois dans les notes de bas de page) ainsi que la fin de la conclusion qui est une sorte d’éventail de propositions militantes. La version originale peut être consultée ici :
barricade.be
***
Exceptée la couverture, les images sont scannées depuis Le guide de l’effondrement, des éditions Les Bandes détournées.
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (12.7 Mo)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (12.7 Mo)