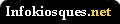L
Lutte armée aux Etats-Unis
mis en ligne le juin 2007 - Eldridge Cleaver , John Gerassi , Weathermen
John Gerassi
LUTTE ARMÉE AUX ÉTATS-UNIS
A l’opposé de ce qu’affirment les historiens libéraux, les États-Unis ont toujours été un État bourgeois répressif ― tout aussi répressif que n’importe quel pays où l’appareil gouvernemental est sous le contrôle de la classe qui possède aussi les moyens de production. Mais, à la différence de la plupart des autres États répressifs, les États-Unis ont dissimulé leur arbitraire derrière une constitution ronflante qui prétendait défendre, et même proclamer à la face du monde, les droits de l’homme et, plus spécialement, les droits particuliers des États. C’est très précisément à cause des pseudo « freins et contrepoids » mis en place par la Constitution que les historiens de ce genre ont été à même de souligner les bonnes intentions des pères fondateurs de l’Amérique et, sur cette lancée, de rechercher la grandeur dans la pratique suscitée par ces bonnes intentions. Ils ont ainsi créé le mythe de la « conception américaine de la vie » (American way of life) à laquelle tout Américain qui ne s’y est pas opposé dans l’action croit profondément et dont il se fait l’ardent propagateur. Grâce à cette croyance, généralement répandue dans la population, la classe dominante a été en mesure de revêtir son expansionnisme brutal, son renforcement et, en dernière instance, son impérialisme d’un placage de moralité d’une appréciable épaisseur ; et le peuple américain a été éduqué dans la fierté du génocide commis par l’Amérique contre les Indiens, de sa conquête du Mexique, de ses interventions répétées en Amérique latine, de son asservissement des Philippines, de son emploi de l’arme atomique contre le Japon après que ce pays eut offert de se rendre (aux conditions mêmes qui de toutes façons furent acceptées par la suite), de son soutien aux régimes fascistes partout dans le monde, de son intervention en Corée et de son invasion du Vietnam sous le prétexte qu’elles renforçaient la démocratie ― autrement dit qu’elles répandaient la moralité tout autour du globe. A l’heure actuelle, la très large majorité des Américains ne croit pas que leur pays est ou a jamais été réellement une puissance impérialiste.
Pas plus que la majorité du peuple ne croit encore que le gouvernement des États-Unis soit à blâmer des excès dont se rendent coupables des « éléments antidémocratiques » à l’intérieur du pays. A cause des fortes garanties légales assurées aux droits des États par la Constitution, on a toujours prétendu que la brutalité de la police, la corruption des gouvernements locaux, les mesures antisyndicales etc. étaient dues à des accidents locaux et non à la politique officielle. Et ce mythe a été renforcé par le fait que, dans les rares occasions où des atteintes particulièrement cruelles aux libertés civiles ont pu être portées devant la Cour Suprême des États-Unis, la liberté civile l’a souvent emporté. Ainsi, lorsque les seigneurs de la terre assassinèrent les premiers occupants pour leur prendre leurs terres ; lorsqu’ils foulèrent aux pieds le traité qui accordait aux Américains d’origine mexicaine des droits inviolables sur les territoires soumis au droit foncier espagnol du Nouveau-Mexique, de l’Arizona, du Texas et du Colorado ; lorsque les industriels engagèrent des tueurs, connus sous le nom d’hommes à Pinkerton, pour briser les premières tentatives d’organisation syndicale ; lorsque les Texas Rangers abattirent de sang-froid les rebelles ; lorsque les bandes des shérifs du Montana dynamitèrent les maisons des mineurs en grève ; lorsque la police fut à l’origine du lynchage des Noirs dans tout le Sud ; lorsque les propriétaires de filatures assassinèrent les ouvriers révoltés de Nouvelle-Angleterre ; lorsque les seigneurs du cuivre obtinrent de la police la mise hors la loi des mineurs contestataires au Colorado ; lorsque les magnats du charbon et de l’acier tramèrent l’assassinat des responsables syndicaux ; lorsque, plus généralement, la classe dominante sema, de façon répétée et délibérément cruelle, la terreur sur le peuple, on ne manqua pas de penser que tout cela ne représentait que quelques grains gâtés dans l’immense grappe qu’était l’Amérique. Aussi n’est-il pas surprenant de découvrir qu’au siècle dernier, ce furent les Libéraux, ces pseudo-défenseurs des libertés civiles, qui se firent les défenseurs d’une intervention plus appuyée du gouvernement dans les affaires particulières des États. « Le gouvernement est bon ― voyez plutôt la Constitution », ne cessaient-ils de répéter. Jamais il ne leur est venu à l’esprit, à tous ces historiens, ces sociologues, ces spécialistes de science politique qui, aujourd’hui encore, infestent les écoles américaines de leurs mythes, de leurs mensonges et de leur moralité chauvine, purement et simplement impérialiste, que la classe dominante avait le système dont elle avait besoin.
Et pourtant ce fut toujours le système qui fit de la démocratie une farce. Bien entendu, il le fait intelligemment. Il permet des désaccords verbaux. Il garantit aux gangsters le droit de refuser de se mettre en cause eux-mêmes. Il accorde une large publicité à ces intellectuels courageux qui utilisèrent les tribunaux pour défendre leur manie non conformiste. De fait, il fit grand bruit à propos des tribunaux où « chaque homme peut trouver son heure ». Mais ces tribunaux n’ont jamais été pour le peuple. Tout d’abord, ce qui touche à la justice en Amérique coûte, de toute façon, trop cher pour le peuple. Les avocats coûtent des sommes prohibitives (et les avocats d’office cherchent immanquablement à mettre au point « des compromis » ― plaider coupable pour une accusation mineure en échange d’un accord de non-culpabilité avec les autorités de l’État pour une accusation plus lourde) ; le système des cautions maintient les pauvres en prison ; les frais de justice entravent les appels : la somme qu’il faut payer pour obtenir la copie de son propre jugement, obligatoire pour tout appel, est hors d’atteinte du pauvre. De surcroît, aucun pauvre, aucun Noir ou aucun rebelle ne peut attendre de jugement équitable de la part de son jury, car les douze personnes qui y siègent ne sont jamais ses « pairs » : on les choisit soit dans l’annuaire téléphonique, soit dans la liste des propriétaires immobiliers de la région, soit dans les registres électoraux ― 90 % des cas, par conséquent, dans cette partie de la société qui a un intérêt bien établi à ce que la société demeure sans changement, ni contestation.
Toutefois, il est arrivé dans l’histoire des États-Unis que des mouvements de protestation ont gagné un tel soutien populaire que les services locaux chargés du respect de la loi ont été incapables de les écraser. Dans chacun, absolument chacun de ces cas, le gouvernement s’est lancé dans leur destruction ― avec ou sans la Constitution. L’armée américaine a été utilisée pour tirer, à Washington, sur les chômeurs anciens combattants de la Première Guerre mondiale ; les tribunaux américains pour réduire les premiers occupants du Sud-Ouest ; le Congrès américain pour briser des groupes d’immigrants à l’est. Le cas de Sacco et Vanzetti a été popularisé dans le monde entier, mais qui a entendu parler des nombreux assassinats légaux commis contre les cadres des Wobblies ? Les Wobblies (membres des I.W.W. ― Industrial Workers of the World : Travailleurs industriels du monde ― organisés en 1905 et très implantés parmi les travailleurs sans qualification professionnelle des États du Pacifique et des Montagnes Rocheuses) furent impitoyablement persécutés par le gouvernement à titre d’espions (ils luttaient contre la Première Guerre mondiale) et d’anarchistes. Il est maintenant prouvé d’après des documents officiels que le département de la Justice en est venu à poser des bombes, de façon à arrêter et faire condamner pour meurtre les dirigeants Wobblies, à susciter des expéditions de « vigilantes » (gardes civiques) qui aboutirent à l’assassinat de dizaines de Wobblies et à tuer les autres en prison tout en rangeant leur mort dans la catégorie des suicides. En fait, en chaque occasion où la classe dominante s’est sentie sérieusement menacée par un mouvement populaire, elle a eu recours à ce genre de répression violente. Sa méthode a toujours été la même, faire savoir à la police et aux services locaux chargés du respect de la loi qu’elle considérait les rebelles comme des « cibles de tir à volonté » ― et donc renforcer ainsi la répression ― d’en bas ― et se servir du gouvernement, des services fédéraux d’enquête et des tribunaux pour mener la répression depuis le sommet. Cette combinaison a été efficace jusqu’ici. Elle ne marche plus si bien aujourd’hui ― du moins, pas encore.
La raison doit en être cherchée, partiellement, dans la transformation du mouvement. Tandis que, dans le passé, les mouvements populaires des États-Unis étaient limités à des groupes sociaux particuliers (castes) ou à des secteurs de la classe ouvrière faciles à localiser, le mouvement embrasse aujourd’hui tout aussi bien la classe que les groupes sociaux. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il est nécessaire de faire un bref résumé de l’histoire du mouvement.
Le mouvement actuel a pris chair pendant l’ère Mac Carthy, au cours des années 50. Les quelques étudiants dotés de conscience civique furent, de ce fait, désappointés, en premier lieu, par la gauche américaine traditionnelle. Ce ne furent ni la déstalinisation, ni l’exposé ampoulé de Khrouchtchev, sur les crimes perpétrés par cette institution antidémocratique qu’est le « centralisme démocratique » russe qui dressèrent la jeunesse américaine contre le parti communiste ; ce furent sa lâcheté, son incapacité ou sa mauvaise volonté à mener la lutte contre les accusations forgées de toutes pièces qui furent portées contre la moindre personnalités plus ou moins « rose », que l’on soupçonnait d’avoir un organe ou de l’influence. Plus importante encore, toutefois, fut la prise de conscience par la jeunesse du fait que les libéraux américains abandonneraient toujours leurs principes lorsque leur mode de vie serait menacé. Tandis que l’éloquence empoisonnée de Mac Carthy soufflait sur les arts et les humanités libérales, atteignant et infectant leurs professeurs, leurs carrières, leurs valeurs reconnues, ces jeunes virent, incrédules au début, leurs idoles vivantes s’effondrer dans la peur, l’hystérie, la paranoïa. Combien de fois n’entendirent-ils pas leurs mentors libéraux murmurer : « il ne s’agit pas du but et des objectifs de Mac Carthy mais de ses méthodes ». Toutefois, eux, les libéraux, ne firent pas, en public, la moindre objection aux dites méthodes. Le New York Times, grand défenseur des valeurs de l’Amérique libérale, jeta à la porte ceux de ses journalistes qui refusèrent de répondre aux questions du Comité des activités anti-américaines ; les écoles Ivy agirent de même avec leurs professeurs ; les syndicats nettoyèrent leurs sièges de tout militant suspect d’idées de gauche. Et les communistes, à l’exception des dirigeants du Parti, nièrent les accusations, se glissèrent dans les caves en espérant que le vent balaierait tout cela.
Et, en fait, ce fut ce qui se passa. Mais pas parce que la gauche ou les libéraux contre-attaquèrent. Ce fut la classe dominante qui mit fin à Mac Carthy, de peur qu’il ne soit en train d’aller trop loin. Ce fut le magazine Time, qui tira la sonnette d’alarme, Eisenhower qui garda le ton et le Wall Street Journal qui défendit ses reporters contre l’inquisition.
Mais, tandis que les officiels de la gauche et ceux qui se proclamaient eux-mêmes libéraux écoutaient tranquillement leurs disques stéréo sur leurs chaînes haute-fidélité et lisaient leurs livres pleins de culture derrière leurs portes fermement verrouillées, le milieu pacifiste se mit à bouger. A la fin des années 50, son travail fit surface. C’est ainsi que, par exemple, la Société pour la réconciliation (Fellowship For Reconciliation ― F.O.R.), qui avait découvert à Montgomery, Alabama, un jeune et fougueux prédicateur noir du nom de Martin Luther King, le fit venir dans sa retraite la plus élevée de New York et lui enseigna les méthodes de la non-violence. Ensuite, au déclin de l’ère Mac Carthy, la F.O.R. et d’autres groupes du même genre lancèrent le mouvement pour les Droits civils. King, après avoir mené une action couronnée de succès contre la ségrégation dans les autobus, poussa des pointes dans toutes sortes de direction en matière de contestation, captivant l’imagination de la jeunesse blanche du Nord. Certains parmi elle s’associèrent avec d’autres étudiants qui n’étaient pas blancs et formèrent le Comité de coordination des étudiants non violents (S.N.C.C.) et se rendirent au Sud ― pour y manifester sur le tas dans des restaurants, des boutiques et des services publics où régnait la ségrégation. Le C.O.R.E., qui fut aussi à l’origine fondé par la F.O.R., commença l’agitation dans le Nord et la plupart de ses activistes étaient des Blancs. D’autres encore allèrent dans le Sud dans des groupes sans affiliation déterminée qui aidaient les Noirs à se faire inscrire et, au cours des étés 1961 et 1962 ― les étés de la Liberté numéro un et numéro deux ― la jeunesse idéaliste de l’Amérique devint militante.
Mais la droite fit de même. Des jeunes Américains, bons, innocents, pleins de bonnes intentions furent battus, emprisonnés, victimes d’attentats et, à l’occasion, tués ― et la police était du côté des tueurs (quand elle n’était pas le véritable coupable). A Washington, les représentants de la classe dominante se bornèrent à parler ou à adopter quelques lois bénignes qu’ils ne firent pas appliquer. Les Noirs s’impatientèrent. Lorsqu’ils comprirent que ni la Constitution ni le gouvernement ne souhaitaient réellement les aider à conquérir leurs droits, ils devinrent plus militants et quelques-uns d’entre eux parlèrent même de s’armer. Encore une fois, ils tentèrent de donner une survie au mythe de la démocratie américaine : ils organisèrent des partis, participèrent aux élections, formèrent des groupes de pression, manifestèrent pacifiquement, harcelèrent les libéraux du Congrès, tinrent des meetings et des rassemblements. Sans aucun profit. Washington se contenta de former de nouveaux comités où il nomma des « personnalités » noires grassement payées ; il promit des changements qui ne vinrent jamais. La plupart des étudiants blancs idéalistes croyaient aux bonnes intentions du gouvernement comme l’avaient fait toutes les générations avant eux. Pas les Noirs ; c’en était fini pour eux. Ils expulsèrent les Blancs de leurs organisations et devinrent nationalistes. Le mouvement était parvenu à la croisée des chemins.
Quelques Blancs comprirent. Ils rejoignirent une nouvelle organisations les Étudiants pour une société démocratique (S.D.S.) ou se tournèrent vers des groupes militants de gauche que n’infectait pas l’opportunisme du parti communiste. Un de ces groupes, qui se transforma bientôt en parti marxiste-léniniste, était le parti progressiste du travail (Progressive Labor ― P.L.). Son « front » étudiant, le Mouvement du 2 mai (M.2.M.) devint une des forces les plus agressivement militantes, la première à attirer l’attention sur la guerre impérialiste que John F. Kennedy menait au Vietnam. Le M.2.M. dénonça la complicité de l’Université avec le gouvernements, dévoila les recherches bactériologiques secrètes, se joignit à des grévistes sauvages et mit sur pied un système d’organisation basé sur des cellules. Mais il ne parvint pas à comprendre le nationalisme du mouvement noir, dû au réformisme des Blancs et à leur constante trahison devant la répression et non à une identification réactionnaire avec l’Afrique (encore que celle-ci existait et existe encore dans beaucoup de groupes noirs).
Sous l’influence de l’étonnante ténacité de Cuba face aux menaces et aux interventions des États-Unis (les infiltrations clandestines aussi bien que l’invasion au grand jour de la baie des Cochons), le mouvement étudiant américain devint constamment plus anti-impérialiste. Le S.D.S., largement infiltré par les membres du P.L. issus du Mouvement du 2 mai (dont la dissolution avait été décidée en 1964 pour mener à bien cette infiltration) commença à s’attaquer de plus en plus activement à l’Université. Les grèves étudiantes commencèrent en 1964 et les rassemblements contre la guerre du Vietnam devinrent chose commune. L’establishment libéral essaya de récupérer les sentiments naissants d’opposition à la guerre en organisant des teach-ins qu’ils contrôlaient et où figuraient toujours les « deux côtés » ; mais la digue était rompue. En 1964 également, les Noirs se révoltèrent à Watts et à Harlem et le sérieux du mouvement de libération noire devint évident. D’un seul coup, l’organisation fondée par la F.O.R. et Martin Luther King, la Conférence pour la direction des chrétiens du Sud (S.C.C.C.) apparut pâle et acceptable à la bonne société libérale et elle bénéficia d’une « reconnaissance » officielle, qui poussa les militants noirs plus loin à gauche, voire à des positions presque révolutionnaires. Ces Noirs n’étaient pas contre les alliances avec les Blancs ; ils n’insistaient que sur un point, à savoir que les discours sur les alliances n’aboutissent immanquablement qu’à un seul résultat ― à des discours. C’est dans l’action seulement que d’authentiques alliances se noueraient.
Quelques militants blancs le comprirent parfaitement. A l’université libre de New York, fondée par des démissionnaires de l’ancien M.2.M., des membres du Progressive Labor, qui avaient visité Cuba pendant les étés 1963 et 1964 et des militants indépendants de la Nouvelle gauche, quelques militants organisèrent un groupe de soutien au S.N.C.C. ; une des tâches de ce groupe était de se procurer des armes soit pour les passer aux Noirs, soit pour les utiliser dans des actions de diversion lors de la prochaine révolte noire. Il ne s’agissait encore que de rhétorique, mais elle était contagieuse. A la fin de 1965, l’université libre organisa le Contingent révolutionnaire (R.C.), groupe d’action militante chargé d’aider la libération noire aux États-Unis et le F.N.L. au Vietnam. Au début de 1966, le R.C. manifesta publiquement son soutien total au F.N.L., appelant les gens de gauche aux États-Unis à cesser de s’amuser à des débats et des teach-ins récupérateurs et à renoncer à parler de négociations au Vietnam. « Nous sommes pour la victoire du F.N.L. », déclarait le R.C. qui annonçait qu’à l’avenir il agirait en conséquence.
Dans le mouvement noir, au même moment, la conscience du fait que la guerre du Vietnam et le racisme aux États-Unis étaient dus à la même cause (le chauvinisme raciste des Américains, car le capitalisme n’était pas encore mis en cause, en règle générale) commençait à prendre racine. Aussi, malgré les efforts acharnés des pacifistes, des membres en titre de la IVe Internationale (le Socialist Worker Party et son groupe étudiant l’Alliance socialiste de la jeunesse ― Y.S.A.) et du parti communiste qui trouvaient tous la position du S.N.C.C. et du R.C trop radicale, la tendance était marquée. La campagne unilatérale (contre la guerre seulement) des trotskistes, anticapitalistes par la phrase et l’opportunisme de style Front populaire du P.C., ne pouvait plus l’emporter dans le mouvement. Lors de la fameuse manifestation de mars 1967 qui fit descendre un demi-million de personnes dans les rues de New York, la Nouvelle gauche se déclara communiste révolutionnaire. Au cours de la marche elle-même, le R.C. quitta l’itinéraire prévu, envahit Times Square et, suivi par une très large fraction du contingent de Harlem qui avait défilé aussi avec des drapeaux F.N.L., se heurta à la police dans la première avenue et la 42e Rue. Pour nombre d’entre nous, Blancs de gauche, qui avions pourtant été battus par la police dans le Sud et lui avions même résisté parfois, cette marche fut la première occasion de prendre l’offensive. Nous avons attaqué la police et nous nous sommes battus. Bien sûr, nous avons perdu. Mais ce n’était qu’un début.
La marche donna aussi aux Noirs leurs premiers alliés concrets forgés dans la bataille. Par la suite, l’alliance se dissolvait de par une intelligente tactique policière : les Blancs arrêtés ne furent pas battus dans les postes de police, les Noirs le furent. Mais le souvenir demeura des Blancs et des Noirs combattant côte à côte ; les membres du R.C. nouèrent et conservèrent des relations de confiance avec quelques-uns des dirigeants du S.N.C.C. L’analyse que faisait à l’époque le R.C. était une variante de la théorie de Lin Piao : les villes, disait-elle, ce sont les États-Unis, rien que les États-Unis ; la campagne, c’est le monde sous-développé que les États-Unis développent et exploitent (dans ce monde, il faut ranger la nation noire à l’intérieur des États-Unis, les zones colonisées de l’intérieur) ; la tâche des révolutionnaires américains est de rejoindre la lutte hors des villes et d’aider à les étrangler. Ainsi, en avril 1967, le R.C. créa les Corps révolutionnaires pour la paix, (R.P.C.), dont l’objectif était d’envoyer de jeunes combattants rejoindre les guerillas dans le monde sous-développé. Le lancement public des Corps sembla réveiller le gouvernement : d’une part, il prépara, à destination de la Commission des activités antiaméricaines, un dossier sur les « propagateurs de la guerilla » aux États-Unis (tous les leaders du R.C. y étaient épinglés) ; d’autre part, il donna instruction à des mouchards de rejoindre l’université libre, le R.C., et, si possible, les Corps révolutionnaires.
Ce qu’ignorait le gouvernement, c’est qu’il n’y avait pas, en fait, de Corps révolutionnaires. Quelques militants de l’université libre étaient effectivement partis pour le monde sous-développé afin d’y apprendre et peut-être d’y combattre (l’un d’entre eux, Jim Mellen qui alla en Tanzanie où il se lia étroitement avec le F.R.E.L.I.M.O. et qui est à l’heure actuelle un des dirigeants des Weathermen, quitta les États-Unis avant que le R.C. soit créé). Mais tout ce qui est ressorti de l’affaire à l’époque fut que je fus choisi pour annoncer publiquement l’initiative dans une sorte de rassemblement préparatoire au Moratoire, dans une église de l’Est Village à New York. Notre objectif était strictement propagandiste. Nous espérions que ce truc à la Mac Cluhan s’emparerait de nos idées pour les répandre dans la presse en place, à une époque où il n’y avait pour ainsi dire pas de presse « sous le manteau » aux États-Unis. Et c’est sur cette voie que les choses s’engagèrent ; l’agence United Press International transmit notre annonce dans tout le pays et nous reçûmes des lettres de volontaires potentiels de toutes sortes d’endroits, noms de gens désireux de combattre qui assuraient donc qu’ils pourraient rester clandestins par sécurité, noms qui furent utiles au mouvement par la suite. Mais, fondamentalement, le R.C. et, à coup sûr, les Corps révolutionnaires pour la paix ne faisaient qu’une propagande encore purement verbale qui visait à nous radicaliser et nous rassembler nous-mêmes autant que n’importe qui d’autre. C’était, pour nous, jeunes des classes moyennes, une façon de nous entourer de définitions tellement tranchantes de nous-mêmes que si nous ne les mettions pas en pratique ensuite, nous nous jugerions nous-mêmes foutus.
Le reste de la gauche, cependant, nous prit aussi au mot et nous devînmes de fieffés aventuristes. La rupture avec le P.L. devint inévitable et la rupture ultérieure entre le P.L. et les guévaristes contraignit le P.L. à dénoncer Cuba comme révisionniste, puis à dénoncer les Vietnamiens pour leur acceptation de l’aide russe et, enfin, à transformer le P.L. en une nouvelle version du vieux P.C. Mais tout cela se passa plus tard. A la même époque, d’autres groupes étaient en train d’évoluer, ailleurs, vers des positions « aventuristes ».
Les plus importants de ces groupes étaient sur la côte Ouest. Dans cette région, le mouvement était éclos du mouvement pour la liberté de parole, créé en 1964 sur une base semi-mystique, réformiste et apolitique. Non que tous les dirigeants de ce Mouvement n’aient pas été politisés ; certains l’étaient. Mais alors que le Mouvement s’épanouissait à Berkeley et gagnait d’autres universités, sa pointe était principalement dirigée contre le système universitaire et ses effets déshumanisants sur les étudiants d’origine bourgeoise. La relative rudesse de la répression qui s’ensuivît (condamnations à quelques mois de prison) radicalisa beaucoup des dirigeants du Mouvement et le sentiment grandissant contre la guerre unit la protestation contre le système américain d’enseignement aux mouvements contre la répression et pour les droits civiques. Jerry Rubin, par exemple, fut alors fortement influencé par le P.L. et, en sa qualité de responsable de la campagne pour Robert Scheer, qui allait devenir par la suite le principal animateur de Ramparts, tenta de mener le combat électoral sur une base très politique ; il perdit ses illusions lorsque Scheer, comprenant soudain qu’il pouvait gagner un siège au Congrès, essaya d’estomper son radicalisme originel. Rubin et divers autres militants de gauche organisèrent alors des manifestations contre le Comité des activités antiaméricaines, qui enquêtait sur la côte Ouest ; ce fut alors leur tour d’être traduits devant le Comité, au même titre que des membres de l’université libre et des militants de la première heure du P.L. qui avaient fait le voyage à Cuba. C’est aux audiences du Comité que la différence entre vieille et nouvelle Gauche devint perceptible pour tous. Les nouveaux militants n’avaient rien à cacher ; ils étaient fiers d’être des communistes révolutionnaires, ils refusèrent de faire usage du cinquième amendement, ils dénoncèrent les membres du Congrès ; aux menaces du Comité de devenir des objets de mépris, ils répondirent en criant : « C’est vous qui êtes méprisés par le peuple » et ainsi de suite. Les jeunes avocats qui accompagnaient ces jeunes rebelles s’engagèrent aussi : ils refusèrent de jouer le jeu et furent expulsés de force par les policiers fédéraux ; en agissant ainsi, ils troublèrent et discréditèrent à un tel point le Comité que les audiences furent rapportées et que plus personne ne fut accusé ce quoi que ce soit. Notons au passage qu’un de ces avocats était Beverly Axelrod qui représentait Jerry Rubin et quelques autres ; elle devint plus tard l’avocat de Huey Newton et d’Eldridge Cleaver et, devenue « noire d’honneur », contribua à consolider l’alliance entre Blancs et Noirs dans l’Ouest.
A l’époque je me rendis dans la Baie pour enseigner au collège d’État de San Fransisco ; le mouvement blanc était divisé en deux branches : l’une, très politique, au collège où je me rendais et dans quelques secteurs des autres universités : à Berkeley et San José surtout ; l’autre, totalement apolitique, dans les communautés hippies. Les hippies, dont beaucoup s’étaient installés dans le quartier Haight-Ashbury de San Fransisco, étaient les enfants du « pouvoir fleuri ». Ils voulaient qu’on les laisse seuls à jouir en paix : du paysage, de la marijuana, des uns des autres. La plupart d’entre eux avaient été élevés dans des collèges, s’étaient trouvés dégoûtés de l’esprit de compétition du système universitaire, n’avaient aucun intérêt pour l’argent, si ce n’est pour leurs besoins élémentaires, et se sentaient totalement étrangers à la frénésie « normale » des Américains pour les biens : à l’exception des disques, de pop et de rock, qu’ils écoutaient pendant des heures et des heures. D’ordinaire, un seul membre de la commune travaillait, chacun son tour, selon un système de rotation, et son salaire suffisait à nourrir toute la commune. Ils fauchaient les quelques meubles élémentaires dont ils avaient besoin, ils vendaient des journaux dans la rue, mendiaient ou faisaient de petits travaux ici ou là. Ils voyageaient en stop et, comme ils étaient si pacifiques et si amicaux, beaucoup de « gens bien » les prenaient en charge. Refusant de suivre la voie américaine, ils étaient dépourvus d’ambition, contre la guerre, contre la conscription, contre l’impôt, contre la pollution. Le P.L. et d’autres organisations ne cessaient de tenter de les endoctriner en général sans succès.
Au même moment existait, bien sûr, une organisation noire en pleine progression, très active dans la baie : le parti des Panthères Noires pour l’autodéfense. Lancé par Huey Newton, vétéran de la révolte de Watts, et par Bobby Seale (tous deux avaient organisé le programme d’études noires au collège communautaire de Merritt), le parti des Panthères Noires (B.P.P.) se limitait strictement à l’époque à un groupe d’autodéfense, cherchant à entraver l’activité de la police d’Oakland, qui était à l’époque (et est encore) une des polices les plus odieuses des États-Unis. Comme les policiers d’Oakland avaient l’habitude de tuer les Noirs qui protestaient contre le traitement qu’on leur réservait (« tentative d’évasion ») et de battre sauvagement tous ceux qu’ils traînaient en prison, Newton et Seale décidèrent de rassembler une équipe de Noirs, qui circulait en voiture dans la communauté afin de servir de témoin dans toute arrestation. Ils inscrivaient le nombre de policiers, le lieu et l’heure de l’arrestation, la description des victimes et fournissaient ensuite leurs notes de témoins oculaires à titre de preuves. Bien évidemment, les flics n’apprécièrent pas cette tactique et commencèrent à harceler les Panthères. Les Panthères décidèrent alors de s’armer, comme la loi les autorisait alors à le faire en Californie ; les flics réagirent en tirant sur les Panthères. Quand celles-ci ripostèrent, on changea la loi, et porter des armes devint, pour eux, un acte illégal.
En octobre 1967, les militants de gauche de la Baie, qui n’avaient absolument aucun contact avec les Panthères, décidèrent d’essayer de faire fermer pendant une semaine le centre d’enrôlement d’Oakland, à titre de protestation contre la guerre du Vietnam. Le premier jour, les pacifistes occupèrent le centre et furent aimablement emmenés en prison. Le lendemain, le Mardi Sanglant, les groupes les plus militants aboutirent à la conclusion que les manifestations pacifiques n’avaient abouti à rien (le centre d’enrôlement avait fonctionné comme à l’ordinaire) et décidèrent de recourir à la rébellion civile (civil desobedience) et de s’y tenir quelles qu’en soient les conséquences. La riposte de la police fut si sauvage que 145 personnes durent être hospitalisées pour blessures graves. Les flics firent une faute sérieuse : ils frappèrent tout le monde, la presse y compris. Le mercredi et le jeudi, les manifestants décidèrent d’apprendre un peu de tactique. Jusqu’alors, si l’on excepte le P.L., la plupart des mouvements de jeunes, dégoûtés par la tactique autoritaire et opportuniste du très antidémocratique « centralisme démocratique » du P.C., avaient été à l’opposé : pas d’organisation, pas d’élitisme, pas de discipline, rien que l’action spontanée. En conséquence du massacre du mardi, l’exigence temporaire d’une certaine forme d’organisation se fit jour ; aussi, les deux jours suivants, les divers groupes s’entraînèrent, étudièrent les formations et la tactique de la police, le combat de corps à corps, les premiers soins, les dispersions et les regroupements, etc. Nos divers campus étaient transformés en camps militaires, malgré les menaces de l’administration. Et, le vendredi, notre entraînement se révéla payant. Nous courûmes bien, nous contre-attaquâmes bien, nous nous battîmes bien, et nous empêchâmes le centre de fonctionner. Trois fois plus de flics que des nôtres furent hospitalisés et, ce qui était peut-être plus important à long terme, nous nous débarrassâmes de nos préjugés bourgeois concernant le fait de cogner les flics, de voler leurs armes, de violer la propriété privée. Mais ce qui constitua une réelle victoire fut que, pour se venger d’avoir été battus le mardi, les gens de la télévision firent connaître notre action par tous les émetteurs locaux.
A notre retour au collège de San Francisco, les Noirs regardaient notre action à la télévision. Quand nous regagnâmes le campus, ils étaient encore là ; et quand nous organisâmes notre « fête de la victoire », les deux dirigeants de l’Union des étudiants noirs allèrent à la tribune et y montèrent. Le dirigeant des étudiants blancs qui était en train de parler s’arrêta, interdit, et tendit le micro à l’un des noirs, qui répondit : « Non, gars. Je n’ai rien à dire. C’est seulement que nous avons vu vos types se battre aujourd’hui, nous vous avons vus vous battre vraiment contre ces porcs et nous savons maintenant que vous êtes nos frères. Et nous avons pensé que nous devions nous joindre à vous. Alors, continue, frère, continue. » Le hurlement fut énorme et l’alliance commença à se nouer. Peu de semaines après, blancs et noirs occupèrent ensemble le collège pour protester contre sa politique raciste (après une série de demandes d’entrevue laissées sans réponse, puis d’ultimatums) et l’alliance fut scellée. Plus tard encore, des groupes de Blancs pour le soutien aux Panthères Noires s’organisèrent (l’Union des étudiants noirs était, en partie, aux Panthères). Et réciproquement : par exemple, après que j’ai été relâché de prison pendant l’instruction du procès qui m’était fait pour ma participation à l’occupation du collège, je commençai à recevoir des menaces de mort anonymes ; j’en parlai à Beverly Axelrod qui, à son tour, en parla aux Panthères ; deux d’entre elles firent leur apparition, armées de fusils de chasse, pour protéger mon appartement. « Dors tranquille, frère, nous restons là », me dit l’un d’eux.
La classe dirigeante réagit avec plus de violence. Dans les semaines qui suivirent, la force de police tactique fut utilisée, pour la première fois, contre un rassemblement hostile à Dean Rusk, à San Fancisco ; les dirigeants contestataires furent arrêtés en masse, sévèrement battus après leur arrestation et aspergés de gaz Mace qui peut rendre aveugle (ce qui arriva dans un cas). Ce fut ensuite le tour des hippies d’être attaqués. Le prétexte fut fourni par une protestation pacifique qu’ils organisèrent contre les excès de vitesse des voitures dans leur communauté. Ils furent gazés au Mace, battus, battus encore après leur arrestation. On brisa les portes de leurs logements, leurs disques furent brisés sous le prétexte de rechercher de la drogue. Pendant trois jours les « émeutes de Haight‑Ashbury » firent rage ; quand cela fut terminé, il n’y avait plus de hippies : ou bien ils s’étaient transformés en Yippies (hippies favorables à la révolution organisés par Jerry Rubin et Abbie Hoffmann à New York) ou bien ils avaient totalement quitté San Francisco. Les Panthères furent en permanence victimes de rafles, de coups de feu, d’assassinats. Huey Newton fut envoyé en prison pour avoir soi-disant tué un policier avec le revolver d’un autre policier ; Cleaver fut chassé en exil, Seale sans cesse arrêté pour des coups toujours montés de toutes pièces. Les extrémistes blancs furent, eux aussi, persécutés. Beaucoup furent arrêtés à quatre heures du matin par des flics qui firent irruption dans leur appartement sans frapper. Quatre d’entre eux entrèrent de force chez moi, le revolver dégainé, et s’ils ne tirèrent pas, ce fut sans doute grâce à mon voisin qui, éveillé comme je l’étais, vint voir ce qui se passait. Quiconque était arrêté était battu.
A New York, à la même époque, le S.D.S. lança une offensive de Printemps (1968), occupa l’université de Columbia et procéda ensuite à des actions de ce genre dans tout le pays. Ensuite, les événements de France, que chacun suivit attentivement, se terminèrent : par une défaite. Pour les dirigeants du S.D.S., la raison de la défaite était claire : le seul parti de gauche organisé était le parti communiste et ledit Parti ne voulait pas de révolution. La leçon à tirer de cela n’était pas moins claire : quel que soit le nombre de victoires isolées que le mouvement puisse inscrire à son tableau de chasse, le seul moyen de l’emporter est une organisation capable, lorsque les conditions sont mûres, de mener une lutte armée pour le pouvoir. Les diverses occupations d’universités américaines prirent fin elles aussi par des défaites ; et la grande bataille de Chicago, bien qu’elle ait réussi à être un succès de télévision à cause de la stupidité des flics dans la rue, fut aussi une défaite dans la mesure où, par la suite, elle ne donna naissance à aucune force cohérente capable de poursuivre la lutte. Pendant tout ce temps, le P.L., qui avait refusé de participer à l’affaire de Chicago et qui s’opposait à toute nouvelle manifestation étudiante, injectait toutes les réunions du S.D.S. de son exigence d’une analyse de classe. Bien que, pour la plupart, les militants du S.D.S. reconnussent cette nécessité, ils n’appréciaient pas la ligne du P.L. selon laquelle le S.D.S. devait se subordonner à la classe ouvrière et ils résistaient aux propositions du P.L. de constituer une alliance ouvriers-étudiants à cause de la trop grande ressemblance existant entre la ligne du P.L. et celle que proposait le P.C. Cependant le P.L. influençait fortement le S.D.S. dans deux domaines fondamentaux : il achevait de convaincre la plupart des militants étudiants que le S.D.S. devait se restructurer en une organisation collective bien disciplinée et procéder à une analyse minutieuse de sa composition, de ses buts, de ses forces, de son influence et de sa tactique.
En décembre 1968, la première tentative d’une telle analyse globale fut présentée par un groupe de militants S.D.S., rassemblés autour de Mike Klonsky, secrétaire national du mouvement. Cette analyse, intitulée Vers un mouvement révolutionnaire de la jeunesse, déclarait que « les étudiants ne peuvent aujourd’hui et ne seront pas capables demain de réaliser seuls la chute du capitalisme » ; elle appelait à mettre un point final au mouvement pour le pouvoir étudiant qui, aujourd’hui, « doit être considéré comme relevant de l’économisme : c’est-à-dire organisant les gens autour d’une définition étroite de leur intérêt particulier en opposition à l’intérêt de la classe ». La lutte de la jeunesse, poursuivait la résolution, « s’intègre dans la lutte des classes au même titre qu’une grève ouvrière. Nous nous allions aux travailleurs en menant la lutte contre l’ennemi commun et non en assujettissant, avec un air protecteur, notre mouvement à chaque bataille syndicale. Nous nous allions aussi aux luttes de libération anti-impérialistes, en ayant conscience qu’il s’agit là de l’expression authentique de la classe ouvrière au plus haut niveau de sa conscience de classe ».
Le désaccord principal entre le P.L. et le groupe Klonsky à l’intérieur du S.D.S. portait sur la lutte des Noirs pour leur libération. Attaché à une stricte analyse de classe, le P.L. refusait de soutenir le mouvement noir en tant que tel. Le S.D.S., quant à lui, déclarait « nous devons reconnaître qu’est en train de se mener une lutte pour la libération des Noirs à laquelle nous devons nous allier. Ce combat est à la fois une lutte anticolonialiste contre le racisme et les structures du pouvoir de l’impérialisme raciste et un moment de la lutte des classes, dans la mesure où les travailleurs noirs sont parmi les plus opprimés. C’est par le racisme et sa transformation en oppression coloniale que le peuple noir est maintenu au rang de fraction la plus opprimée de la classe ouvrière. Le racisme (la suprématie blanche) ligote le peuple blanc à l’État en le coupant de la lutte de classe la plus militante ». Et la résolution ajoutait, pierre directement envoyée dans le jardin du P.L. : « nous devons nous garder de gazer la nature anticolonialiste de la lutte des Noirs pour leur libération en nous bornant à la qualifier de nationalisme bourgeois. »
La résolution fut adoptée, mais elle engendra des débats passionnés avant comme après le vote Elle fut aussi à l’origine de plusieurs nouvelles analyses importantes de la part de militants du S.D.S. L’une d’elles, destinée à avoir une grande influence sur le S.D.S., fut publiée dans les New Left Notes, l’organe du S.D.S., en date du 13 mai 1969. Intitulée Encore sur le mouvement de jeunesse, elle était l’œuvre de Jim Mellen, ancien professeur d’université, révoqué en 1964 pour avoir publiquement soutenu le F.L.N. et qui avait été ensuite un des fondateurs de l’université libre de New York, avait ensuite passé deux ans à travailler avec le F.R.E.L.I.M.O. et était revenu à Chicago pour se plonger dans les débats théoriques du S.D.S. Internationaliste inébranlable, marxiste-léniniste de longue date, Mellen était passé par une phase P.L. aux débuts des années 1960 ; il était un de ceux qui avaient formulé la théorie Lin Piao globalement avancée par le Contingent révolutionnaire. Il était devenu un des initiateurs de la formation d’un groupe orienté vers l’action à l’intérieur de S.D.S. Dans son article, Mellen tentait une analyse de classe, à partir des conditions réelles des États-Unis et non de dogmes de manuels. Sur cette voie, il découvrit que le travailleur industriel américain appartenant à un syndicat pouvait être facilement corrompu et récupéré par le capitalisme et était profondément infecté de racisme, du fait de la menace de concurrence de la main-d’œuvre noire ; il n’était donc pas capable, pour le moment présent au moins, de diriger l’avant-garde révolutionnaire. Mellen examinait minutieusement les couches secondaires de la classe les unes après les autres, soulignait les « privilèges de peau blanche » des travailleurs blancs et concluait : « l’existence d’un traitement préférentiel systématique des travailleurs blancs par rapport aux noirs, et les meilleures conditions de vie qui en résultent pour les ouvriers blancs donnent une base matérielle au sentiment que les travailleurs noirs menacent les privilèges des Blancs, et à l’idéologie raciste qui en résulte et qui est entretenue par ce sentiment de menace. C’est la façon la plus décisive selon laquelle la classe ouvrière américaine est divisée et affaiblie. Deux faits en résultent : la participation des travailleurs blancs à l’oppression de la nation noire confère un aspect anticolonialiste ― en plus de son aspect prolétarien ― à la lutte des Noirs pour leur libération. Ces deux conditions, jointes au haut niveau de conscience et de militantisme de la colonie noire, font qu’au stade historique où nous en sommes, les Noirs en lutte pour leur libération représentent l’avant-garde du mouvement ouvrier. »
Mellen analysait aussi le rôle des étudiants dans des termes passablement nouveaux. Il écrivait : « L’écrasante majorité de la jeunesse américaine (disons de 18 à 24 ans) est composée d’étudiants, de soldats et de chômeurs. De même, l’écrasante majorité est d’origine sociale ouvrière, quelque confortable, mystifiée ou bourgeoise que puisse être leur idéologie. L’écrasante majorité, en outre, est vouée à des métiers et à des positions dans la société qui la rangera sûrement dans les rangs de la classe ouvrière, quelque degré de conscience qu’elle ait des privilèges que leur offrira leur position spécifique future. J’objecterai, cependant, que ce qui donne un contenu de classe spécifique aux luttes de la jeunesse ― particulièrement dans les écoles et à l’armée ― c’est la prolétarisation du rôle que jouent les jeunes dans ces institutions. A l’armée, quelque forcé qu’il soit d’y aller et quelque impalpable que soit sa production, le soldat effectue un travail très nécessaire au capitalisme sans différence notable avec aucun autre travail ou service. Dans les écoles, la formation au travail qui ne peut être accomplie par les capitalistes particuliers est faite par cet agent du capitalisme de monopole qu’est l’État. En étudiant, l’étudiant se constitue lui-même en force de travail qualifié et, de ce fait, accomplit un travail exploité et aliéné. La nature du travail spécifique de l’étudiant donne aux luttes qu’il mène pour contrôler ou modifier ce travail un contenu de classe. Les luttes des étudiants pour briser le carcan de leur travail aliéné et pour détruire les institutions de classe dans lesquelles ils vivent font partie de la lutte des classes. » Mellen terminait sa longue analyse en déclarant que les applications dogmatiques du marxisme aux États-Unis « attribuaient une position centrale dans la lutte des classes aux travailleurs industriels », ce qui est faux, et « ne parvenait pas non plus à attribuer un contenu de classe significatif aux luttes de la jeunesse. Quand les jeunes soutiennent la lutte des Vietnamiens et des Noirs et, simultanément combattent la nature de classe des écoles, ils mènent une guerre de classe. »
L’analyse que Mellen et d’autres répandirent rapidement imprégna les cadres du S.D.S. Désappointés par le manque de conscience de classe de la classe ouvrière blanche ― frappés, en fait, par son identification réactionnaire à l’Empire américain ― avertis de ce qu’aujourd’hui, aux États-Unis, ce sont les Noirs qui ont mené les combats les plus sérieux contre cet Empire, ces cadres trouvèrent en partie l’explication du phénomène dans les « privilèges de peau blanche » dont profitaient tous les Blancs, qu’ils soient ouvriers, étudiants ou petits bourgeois. Ils conclurent aussi que, parmi les Blancs, la jeunesse était plus aliénée et, potentiellement, plus révolutionnaire parce que, chez elle, les privilèges de peau n’étaient pas encore consolidés en intérêts privés. Enfin, ils firent revivre la vieille théorie, inspirée par Lin Piao, du Contingent révolutionnaire en insistant sur le fait qu’aujourd’hui la révolution n’est pas localisée mais internationalisée, non pour de simples raisons de solidarité, mais parce que l’Empire américain ne survit que grâce à la domination qu’il exerce sur le monde non socialiste. Parmi les cadres en questions on trouvait d’anciens membres du Contingent révolutionnaire (Gerry Long), d’anciens militants du P.L. (John « J. J. » Jacobs), des dirigeants de l’occupation de Columbia (Mark Rudd) et divers membres du Comité national du S.D.S. (Bernardine Dohrn). Avec Mellen, ces cadres et leurs alliés jouèrent un rôle décisif en expulsant le P.L. du S.D.S. lors du Congrès national de juin 1969. Ils présentèrent aussi au congrès une résolution intitulée On n’a pas besoin d’un météorologiste pour savoir d’où souffle le vent. C’est sans doute la déclaration la plus importante qu’ait produite la nouvelle gauche depuis la déclaration de Port-Huron qui, en 1962, annonçait la formation du S.D.S. ; elle doit être lue et figure donc en appendice de mon article.
Ce fut un carnage pour le S.D.S. : non seulement le P.L. fut expulsé de ses rangs, mais une scission majeure se produisit entre le groupe du mouvement de la jeunesse révolutionnaire (R.Y.M.) qui refusa d’abandonner son travail d’organisation des ouvriers blancs de tout âge et ses tentatives de mettre sur pied des alliances pratiques entre blancs et noirs et fut appelé R.Y.M.-II et, d’autre part, les Weathermen (leur nom vient d’un vers du Subterranean Homesick Blues de Bob Dylan). Ces derniers orientèrent immédiatement leur axe organisationnel vers la jeunesse, et spécialement la jeunesse ouvrière ; ils accordèrent une valeur accrue à la confrontation violente, conçue comme un moyen de harceler le système et comme un facteur de recrutement par l’exemple ; ils estimèrent que leur alliance avec les Noirs ne pouvait devenir réelle qu’à partir d’une action de soutien. « Notre théorie doit découler de la pratique, mais elle ne peut se développer dans l’isolement », avait proclamé le manifeste des Weathermen ; « seule une mise en commun générale de nos expériences peut permettre une compréhension approfondie des conditions complexes de ce pays. De la même façon, seuls nos efforts collectifs vers un plan commun peuvent tester correctement les idées que nous avançons. » Ils s’organisèrent ainsi en collectifs, devenant des révolutionnaires professionnels, soumis à une discipline rigide, avec un comité central (le bureau météorologique ― Weather Bureau) et un style de vie entièrement nouveau.
Avant de décrire ce style de vie et de voir comment il a affecté le reste du mouvement, il importe de rappeler qu’à la fin de 1969, la répression avait atteint aux États-Unis un nouveau sommet. Dirigée, depuis Washington, par le ministère de la Justice, elle frappait aussi bien la gauche que les ennemis imaginaires de Nixon : les Libéraux. Parmi les victimes des attaques figure la Commission fédérale des Communications, qui reçut un nouveau responsable, l’archiréactionnaire Dean Burch et la fondation libérale, accusée par Spiro Agnew de financer des recherches révolutionnaires. Ajoutons à cela l’escalade politique de la guerre du Vietnam, les délais apportés à la déségrégation et, plus particulièrement, le procès des huit à Chicago (qui se réduisirent à sept lorsque le président des Panthères Noires, Bobby Seale, protesta à sa façon). Dans presque chacune des bases militaires, des soldats dissidents qui, jusque-là, passaient devant les cours martiales à titre de prévenus libres, furent enfermés dans des boxes ; des soldats furent arrêtés pour avoir « parlé avec déloyauté ». John Mitchell, le procureur général, reconnut que son souci principal était la contestation et le directeur de la division criminelle du ministère, Will Wilson, un Texan de la tendance Goldwater, dirigeait son tir vers la même cible : « Je pense que si l’on pouvait tous les (il s’agit des étudiants protestataires) fourrer dans des pénitenciers, on arrêterait ça (il s’agit du mouvement de protestation) », déclara-t-il. Ce fut Wilson qui prépara l’accusation au nom du gouvernement contre les huit de Chicago, bien que son prédécesseur, Ramsey Clark, ait conclu qu’il n’y avait pas matière à accusation. De même, la division des Droits civils du ministère de la Justice, dont la tâche est de s’assurer que les Noirs bénéficient de tous leurs droits légaux, reçut la directive de s’occuper plutôt des « émeutes » et des plans d’urgence en prévision de désordres futurs. Le service des relations avec les communautés du ministère qui, normalement doit faire en sorte que les canaux de communication entre les zones de ghettos et Washington restent ouverts, interrompit, lui aussi, son travail : sa tâche consista à dresser des fiches sur les fauteurs de troubles et ceux de ses hommes qui étaient chargés des groupes de jeunes se transformèrent en espions fédéraux.
L’espionnage était, bien entendu, devenu la fonction primordiale du ministère de la Justice. Le F.B.I. avait reçu de Mitchell et Nixon le feu vert pour enquêter sur les Panthères Noires et le mouvement extrémiste blanc ― ce qui avait signifié des milliers de nouveaux téléphones placés sur table d’écoute, de policiers infiltrés et de dossiers établis. L’ensemble de la Justice coordonna dès lors ses activités avec le bureau pour le contrôle des activités subversives, dont le plus récent patron, désigné par Nixon, était Otto Otepka, ancien enquêteur du sénateur Mac Carthy, qui avait été chassé du Département d’État au temps de l’administration démocrate, pour avoir organisé la fuite de dossiers, classés comme de haute sécurité, vers la sous-commission sénatoriale de la sécurité interne. Bien plus, le ministère de la Santé, de l’Éducation et de l’Assistance sociale (H.E.W.) reçut la directive d’organiser deux services de renseignements différents, tous deux destinés à espionner les étudiants ; on lui ordonna aussi de lancer une campagne de propagande contre la dissidence étudiante ; le dirigeant de cette force de propagande est Xandra Kayden qui avait fondé en 1968 les Étudiants pour une Université rénovée, organisation de droite destinée à lutter contre le S.D.S. dans les universités.
La répression contre les Panthères Noires fut et est encore bien pire. Une fois que Edgar J. Hoover, chef du F.B.I., les eut stigmatisées comme « la plus grande menace contre la sécurité intérieure du pays », la police locale décida qu’elle pourrait compter sur l’appui du gouvernement à toute mesure de répression contre les Panthères Noires. Et ils ne perdirent pas de temps pour s’y mettre. A New York, vingt et une Panthères furent accusés d’avoir comploté pour poser des bombes dans des grands magasins ; ceux qui furent pris se virent fixer une caution de 100 000 dollars, qu’aucun juge n’accepta de baisser bien que la prétendue preuve de leur délit reposât sur le seul témoignage d’agents de police. Tous les Panthères, sauf deux, furent ensuite placés dans des cellules de haute sécurité (alors qu’un seul, parmi eux, avait été arrêté auparavant, pour un motif quelconque) ; les cellules restaient éclairées vingt-quatre heures sur vingt-quatre et étaient inspectées toutes les demi-heures ; un des Panthères, gravement épileptique, resta enfermé au secret pendant sept mois avant que ses avocats puissent le faire aller à l’hôpital. Pendant ce temps, les Panthères ne reçurent jamais l’autorisation de voir ensemble leurs avocats (ce qui est une nécessité absolue dans une affaire de complot) et toutes leurs requêtes légales échouèrent, ce qui obligea même le Time Magazine à déplorer que les trente-cinq juges différents auprès desquels les avocats des Panthères avaient fait appel « les aient, de fait, présumés coupables avant le procès ».
En décembre, à Los Angeles, trois cents flics armés de fusils de chasse, de fusils AR-15, de grenades lacrymogènes, de sacoches d’explosifs (dynamite), d’un hélicoptère, de béliers, de voitures de transport blindées et de haches de démolition spéciales (jet-ax) attaquèrent le quartier général des Panthères. Douze Panthères leur tinrent tête pendant quatre heures et quarante-cinq minutes, avec des pistolets et des fusils jusqu’à ce que les munitions leur fassent défaut. Ils se rendirent alors, furent arrêtés et la caution leur fut refusée sur l’accusation de tentative de meurtre contre des policiers. Mais au moins, à Los Angeles, les douze étaient-ils vivants. A Chicago, une descente de police du même genre, effectuée au milieu de la nuit, surprit les Panthères endormies ; les flics ouvrirent le feu immédiatement et, à travers la porte, tuèrent Mark Clark, un cadre, puis, dans son lit pendant qu’il dormait, Fred Hampton, qui devait succéder au responsable de la direction, David Hilliard, si celui-ci était emprisonné ou tué. En dépit des preuves accablantes de cet assassinat des deux Panthères par les flics (les photos de la police furent si mal truquées que la presse elle-même se rendit compte de la falsification ; les trous de balle dans la porte avaient été faits de l’extérieur et non de l’intérieur ; les trous que les policiers affirmaient avoir été causés par le tir des Panthères se révélèrent être des traces de clous), en dépit des protestations de la bonne société libérale (entre autres l’ancien juge de la Cour Suprême et ambassadeur Arthur Goldberg), ce furent les survivants des Panthères de Chicago qui furent accusés de meurtre, et non la police.
Mais ces actions policières ne sont que les plus dramatiques de ce qui est devenu monnaie courante. Dans le New Jersey, la police fit une descente dans une fabrique de vêtements qui appartenait à des Noirs et dont les profits allaient aux Panthères ; sous le prétexte de rechercher des revolvers, ils détruisirent totalement pour une valeur de 20 000 dollars de machines. Dans toutes les villes où les Panthères distribuent de la nourriture aux enfants des ghettos, les flics ont fait des descentes dans les églises et les locaux où les repas avaient lieu, détruisant le matériel et jetant la nourriture. Voici le bilan : vingt-huit Panthères ont été tués par la police, cent sont en prison et cinq cents en liberté sous caution, attendent leur procès. Et, partout, le racisme de la Justice américaine s’étale maintenant ouvertement et officiellement. A San José, Californie, le juge de première classe Gerald S. Chargin dit à un garçon mexicain de dix-sept ans, accusé d’avoir fait l’amour avec sa sœur de quinze ans, qu’il devait plaider coupable pour éviter les poursuites (sa sœur et lui rejetaient l’accusation, disant qu’ils avaient dormi dans le même lit parce qu’ils n’avaient qu’une couverture pour deux). Lorsque le garçon eut suivi ses conseils, le juge lui déclara : « vous avez le devoir de vous suicider. Nous avons le devoir de vous renvoyer au Mexique. Il est possible qu’Hitler ait eu raison. Dans notre société, les animaux doivent être détruits. » A San Francisco, un policier s’était enivré hors de son service ; furieux parce que sa petite amie avait résisté à ses avances pendant une sortie, il déclara : « Je veux tuer un bounioule aussi foutument dégueulasse que je pourrai me le mettre sous la dent » ; en essayant de garer sa petite voiture dans un garage du ghetto noir, il érafla un autre véhicule, se mit en colère et tua George Baskett. Le flic, Michaël O’Brien, fut défendu par une des sommités du barreau américain, Jake Ehlich, qui déclara au jury, entièrement blanc, que tous les Noirs et tous les jeunes du S.D.S. avaient pour but de « détruire notre gouvernement... nos foyers, nos enfants, deux cents années de démocratie américaine, et notre drapeau et tous ceux qui le défendent ». Son client s’en tira non coupable.
Les Noirs ont, bien sûr, toujours été maltraités par la justice américaine ― avec moins de cynisme toutefois dans le Nord, autrefois. Mais ce n’était pas le cas pour les Blancs et la répression accrue à leur encontre, bien qu’ils l’aient attendue depuis longtemps, les a traumatisés. Depuis l’été 1969, presque tous les porteurs de cheveux longs, arrêtés, ont été systématiquement battus en prison. Les Blancs qui ont des activités politiques sont couramment arrêtés pour trafic de drogue, que la police cache elle-même chez eux. Quand les policiers ont fait irruption dans mon appartement de San Francisco, ils avaient avec eux un sac de marijuana. Quand, plus tard, j’ai été arrêté à Chicago, j’ai été battu toutes les nuits, pendant douze nuits, avec des tuyaux de caoutchouc, sur les côtes principalement. Pour un gauchiste, être arrêté pour la drogue est dangereux. John Sinclair, par exemple, a été condamné à dix ans de prison, théoriquement pour avoir eu en sa possession deux cigarettes de marijuana, en fait parce qu’il dirigeait les Panthères Blanches. Pendant plus d’un an, la police a fait des descentes impromptues chez les militants d’extrême-gauche ; aujourd’hui, conséquence de la loi « anti-crime » de Nixon, la police a le droit de le faire légalement. Les téléphones de toute la gauche sont fliqués, la plupart des maisons et des appartements aussi ; et quiconque franchit la frontière d’un État pour se rendre à une manifestation est susceptible d’être arrêté pour « complot » en vue d’une émeute. C’est sur cette accusation que les huit de Chicago furent arrêtés ; leur procès fut une farce au cours de laquelle le juge n’accepta aucune des objections de la défense, reçut toutes celles de l’accusation, refusa de laisser venir à la barre les témoins de la défense (y compris l’ancien procureur général Ramsey Clark) et écarta tout ce qui tendait à prouver que c’était la police, et non les accusés, qui avait provoqué les émeutes. Qui plus est, la plupart des inculpés ne se connaissaient pas les uns les autres avant le procès ; mais, selon la loi américaine, cela n’a pas d’importance ; ce sont leurs intentions qui comptent. La justice fut bafouée de façon tellement flagrante que le chef du bureau de Washington du New York Times, Tom Wicker, à l’ordinaire représentant insipide de l’establishment libéral, réagit avec désespoir : « Est-ce que le pays légal de l’Amérique va observer tout cela en silence, en faisant confiance à la Cour Suprême pour rectifier les erreurs bien plus tard, si elle le fait jamais, et après seulement que d’indescriptibles préjudices auront été portés à des individus, après de nouvelles démonstrations de ce qu’est ce genre de « justice » devant une jeunesse, où nombreux sont ceux qui croient que les idéaux américains sont une supercherie. »
Mais les chances qu’a la Cour suprême de rectifier ces excès reconnus sont minimes. Tout d’abord, la Cour subit de fortes pressions pour qu’elle se conforme aux vœux de l’administration. Ensuite, Nixon ne nomme à la Cour que des racistes sudistes. En dernier lieu, l’administration Nixon cherche à jeter la suspicion sur les membres de la Cour qui croient le plus en la justice ― et spécialement sur William O. Douglas qui a publiquement stigmatisé le manque de démocratie des États-Unis. Dans un livre récent, Sujets de Révolte (publié en février [1970]), Douglas déplore, par exemple, que l’Amérique soit devenue « l’État de la prospérité sens-dessus-dessous ». « Les chemins de fer, les lignes aériennes, les compagnies de navigation reçoivent tous des subsides ; et les portes de ces sociétés ne sont jamais défoncées la nuit par la police. » Les grandes sociétés et le gouvernement « font naître de concert un climat de conformisme qui fait de toute idée oppositionnelle une idée non américaine... Le F.B.I. et la C.I.A. sont les coupables les plus notoires, mais des étoiles de moindre grandeur brillent aussi : le téléphone de tout service fédéral ou de tout service d’État est douteux. Chaque salle de conférence peut être vraisemblablement considérée comme fliquée. Chaque téléphone d’ambassade est un micro ouvert. Certains hôtels de Washington ont des chambres spécialement conçues, avec un système d’enregistrement et même des glaces sans tain, qui permettent de prendre sur magnétophone ou de filmer les occupants. » Et le juge de la Cour suprême conclut : « Georges III fut le symbole contre lequel nos fondateurs firent une révolution que l’on considère maintenant comme éclatante et glorieuse... Nous devons comprendre que l’Establishment d’aujourd’hui est le nouveau Georges III... Là où les griefs s’amoncellent et où les porte-parole élus représentent l’Establishment, la violence peut être la seule réponse effective. »
Les Weathermen, bien sûr, sont totalement d’accord. Mais l’analyse des mouvements anciens aux États-Unis leur enseigne qu’à moins d’adopter le style de vie des révolutionnaires, les révolutionnaires blancs risquent d’être récupérés ― et l’ont toujours été en fait ― à cause de l’abondance des privilèges de peau blanche. De fait, depuis que, l’année dernière, la répression s’est faite plus lourde aux États-Unis, les groupes intellectuels se sont évanouis. Les excuses qu’ils présentaient étaient nombreuses : nous devons repenser soigneusement nos théories ; nous devons attendre la dépression qui radicalisera les travailleurs ; nous devons organiser les masses ; nous ne devons pas nous laisser isoler par un aventurisme qui éloigne les masses, etc. L’analyse des Weathermen exclut de telles rationalisations : la classe ouvrière profite trop des privilèges de peau blanche pour constituer une avant‑garde ; les jeunes constituent la force qui possède le plus grand potentiel révolutionnaire, parce que leurs privilèges ne sont pas institutionnalisés et parce qu’ils sont le secteur le plus aliéné de la classe ouvrière blanche ; la parole seule ne transformera pas les hommes de gauche en révolutionnaires, seules l’action plus la parole le feront ; et encore n’est-ce pas assez puisqu’un jeune blanc peut toujours se replonger dans son abondance illusoire de privilégié à peau blanche. Toujours, à moins qu’il ne se plonge totalement dans la révolution, non seulement par les idées mais par tout son style de vie. Même alors, disent les Weathermen, il peut encore choisir à rebours à moins qu’il ne reçoive l’aide de ses camarades lors de ses moments de faiblesse. Cela signifie qu’il doit vivre, travailler et combattre au sein de collectifs.
Les Weathermen disaient bien le fond de leur pensée. Ils organisèrent des collectifs dans douze villes de première importance, non pas d’élégants centre bourgeois comme Los Angeles et San Fransisco, mais dans des villes ouvrières, rudes et dures : Detroit, hicago, Pittsburgh, Milwaukee, Cleveland, Colombus (Ohio), Brooklyn. Douze personnes physiques, hommes ou femmes groupées par affinités, vivant dans une seule pièce. Le Bureau météorologique (Comité central) donne l’exemple : entraînement physique, karaté, formation politique, sessions de critiques et d’autocritique, discipline rigoureuse dans le combat et hors du combat. Tout est social, rien est privé, disent-ils. Sexe, doutes, peurs, renoncements, désirs - tout doit se passer au grand jour. Avoir tels sentiments ou telles faiblesses n’est pas un péché mais le produit normal d’une société corrompue qui nous a tous modelés. Les produire au grand jour pour qu’on en discute en communauté est le seul moyen de les surmonter. Les Weathermen sont des êtres sociaux, leur tâche n’est pas seulement de former des cadres de l’armée révolutionnaire qui écrasera un jour le capitalisme national ;ils doivent aussi aider à construire l’homme socialiste dans le combat. Dans quelques collectifs, les weathermen prirent du L.S.D. pour aider à faire surgir leur paranoïas, les complexes, les problèmes intérieurs de leurs membres. Cela marcha. Cela permit aussi de déceler tout agent infiltré par la police. Les autres collectifs adoptèrent la même méthode. Les faiblesses furent révélées, les militants comprirent leurs responsabilités, leurs côtés forts. Un ancien professeur de vingt-neuf ans, d’habitudes très universitaires, Shim’ya Ono, se colleta avec sa propre immaturité et apprit à accepter comme chef de la collectivité une fille de dix-sept ans, à obéir à ses ordres et à ne jamais discuter les directives du Bureau pendant le combat, même lorsqu’elles émanaient de « J.J. » qui n’avaient que vingt et un ans. Des intellectuels de gauche apprirent à vivre sans rien qui leur appartienne, à tout partager, à renoncer à la vie privée (ce qui devint une règle non seulement pour des raisons psychologiques et sociales, mais aussi pour des motifs de sécurité). Les jeunes femmes apprirent à oublier le goût bourgeois en matière d’habillement et à mettre ce qui était le plus pratique. Tous abandonnèrent les conceptions monogames, ancrées de longue date, comprirent que les relations personnelles basées sur la dépendance n’étaient pas seulement dangereuses dans la bataille, mais corruptrices dans la formation des valeurs.
Il est dur d’être un Weatherman ; il est encore plus dur de se battre comme l’un d’entre eux. La première action d’envergure des Weathermen fut prévue pour octobre à Chicago. Ils espéraient que des milliers de gens viendraient et comptaient sur au moins un noyau dur de mille personnes habituées au combat de rue, que l’on aurait alors intégrées à de nouveaux collectifs. Tout l’été, ils recherchèrent des appuis ― et passèrent d’interminables heures à débattre avec les gens d’autres mouvements qui taxaient d’aventurisme leur objectif proclamé de démolir le Loop (le quartier riche de Chicago) : « S’il s’agit d’une lutte à l’échelle mondiale, si les Weathermen ont raison sur ce point fondamental, à savoir que la lutte fondamentale du monde actuel est la lutte des peuples opprimés contre l’impérialisme américain, alors il est clair que rien de ce que nous pouvons faire dans la mère patrie ne peut être aventuriste. Rien de ce que nous pouvons faire, car il s’agit d’une guerre qui est déjà engagée et dont les termes sont déjà définis », expliquait en septembre Bill Ayers, membre du « Bureau météorologique ». Carl Davidson, ancien dirigeant du S.D.S., répliqua : « Les erreurs aventuristes sont commises lorsque les révolutionnaires suivent une ligne d’action qui les isole du peuple, montre leur manque de confiance dans le peuple, révèle leur mépris du peuple et les conduit éventuellement à se substituer au peuple. » Les Weathermen rétorquèrent que le peuple n’est pas fait des seuls ouvriers qui vous ignorent et vous combattent, mais des jeunes, des Vietnamiens, des Dominicains, des Congolais, etc.
Finalement, le jour vint : 8 octobre 1969 à Chicago. Où était l’Armée rouge prédite par les Weathermen ? Il n’y avait pas des milliers de manifestants, pas même le chiffre de base de mille. Tout juste cinq cents membres des collectifs, effarés et gênés, que la police surpassait en quantité à raison de dix contre un, avec en plus la Garde nationale dans le voisinage et prête à répondre à tout appel : « Bon, cria un dirigeant Weathermen, vous savez pourquoi nous sommes venus et aussi ce que nous avons promis de faire. Ce n’est qu’un début. Il dépend de nous maintenant que ce soit ou non la fin. Alors allons-y. » Et ils chargèrent. Le combat fut probablement le plus dur de toute l’histoire de la nouvelle gauche. Des milliers de policiers, usant de gaz lacrymogènes et de matraques puis de revolvers contre un groupe de gosses blancs, déchaînés mais strictement disciplinés, protégés par des casques, des bottes, des coquilles protectrices, utilisant des tuyaux de plomb et des chaînes. La ville regardait avec stupeur les Weathermen, qui chargeaient timidement d’abord, puis de plus en plus résolument, se dispersaient, se regroupaient, se dispersaient et partaient de leur champ de bataille pour gagner le Loop où ils firent ce qu’ils avaient dit, brisant les fenêtres et détruisant les magasins. Plus de deux cents Weathermen furent arrêtés, huit furent blessés par balles (il n’y eut pas de morts) ; et pourtant, le lendemain ils étaient de retour. Cette fois-ci, le coup principal devait être porté par des femmes de l’organisation. Il n’y en avait que soixante-cinq, encerclées par cent cinquante flics. Les filles étaient plus effrayées que la veille car elles se sentaient plus isolées. Bernardine Dorhn dit alors aux femmes : « La peur que les gens ressentent dans cette manifestation doit être offerte en contrepartie de la faim, de la peur, des souffrances que connaissent les Noirs, les Métis, les Jaunes dans ce pays et dans le reste du monde. » Elle les emmena alors hors du parc Grant, à travers l’hôtel Hilton, jusqu’aux barrages de police. Les Weatherwomen se battirent bien et terrassèrent beaucoup de flics, mais elles furent arrêtées. Pourtant, elles étaient là à nouveau le jour suivant, et ainsi de suite la semaine durant. A la fin, deux cent quatre-vingt-quatre se trouvaient en prison, avec des cautions fixées à un million de dollars.
Mais la force des Weathermen grandissait. Vaincus, ridiculisés et même dénoncés comme contre-révolutionnaires pour leur aventurisme, ils gagnèrent d’abord le respect des jeunes de la classe ouvrière, puis leur attention. Dans la mesure même où les collectifs continuaient le combat, leur influence suivait la même courbe. En outre, une autre de leurs tactiques sembla s’avérer payante, mais à la longue. Ce fut la tactique des « bris de barreaux » dans les écoles. Les collectifs Weathermen occupaient des écoles supérieures fréquentées par les ouvriers, barricadaient les portes, expliquaient les raisons de leur action, corrigeaient tout professeur qui tentait de s’opposer à eux et ensuite menaient la bataille contre la police qui encerclait l’école. J’ai rencontré une fille qui avait été assez impressionnée par cette opération pour vouloir rejoindre les Weathermen. Je lui demandai si elle ne pensait pas qu’une telle tactique violente n’était pas de nature à provoquer un retour de flamme fasciste. Elle me répondit : « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par fasciste. Tout ce que je sais est que je veux faire un certain nombre de choses qui ne font de mal à personne et que je ne peux les faire et vous savez pourquoi mes parents m’en empêchent, mon école m’en empêche, la police m’en empêche. Mes copains garçons doivent se couper les cheveux ; nous ne pouvons pas fumer ce qui ne fait de mal à personne mais eux peuvent boire et quand ils le font, ils se cognent dessus. Mon vieux, je veux seulement foutre en l’air cet endroit, me débarrasser de toutes ces limaces et être sûre que personne n’enverra jamais mes amis mourir au Vietnam ou n’importe où ailleurs. » « Ça ne te fait rien de n’avoir rien qui t’appartienne, à toi seulement ? » lui demandai-je. « Nom de Dieu, non, je ne veux pas avoir de choses à moi ; tout ce que cela vous fait c’est que vous en voulez encore plus. Ce n’est pas pour cela que nous sommes au Vietnam ? Parce que les salopes qui dirigent ce bordel de pays en veulent plus, et plus, et toujours plus ? » Elle se rendait à Flint, Michigan, où les Weathermen tenaient un congrès national, le 27 décembre dernier. Elle avait quatorze ans.
C’est ce genre de recrue que les Weathermen recherchent surtout. Les jeunes des collèges bourgeois peuvent toujours se réadapter dans le système ; pas les évadés des écoles supérieures. Les Weathermen, qui considèrent leurs collectifs comme des organisations préparatoires au Parti, espèrent que de la lutte surgira éventuellement le type de cadres capables de diriger un authentique parti révolutionnaire, parachevé par une Armée rouge apte à mener la lutte armée contre le système. Ils sont encore à leurs débuts pas plus de deux mille en mars 1970. Les contradictions de l’organisation sautent aux yeux, particulièrement aux yeux des militants. Pour les autres courants de gauche, le militantisme des Weathermen est une menace et ceux qui sont les plus acharnés à les attaquer sont les dirigeants du R.Y.M.-II ou les anciens intellectuels de gauche. Dans la plupart des cas, ces anciens gauchistes et ces extrémistes de fauteuil devraient se sentir menacés ; mais en fait, comme ils n’ont absolument aucune intention de compromettre leur mode de vie pour une révolution qui aura toujours lieu demain, il y a un certain illogisme dans la rigidité des Weathermen, cette rigidité que formule ainsi l’ancien universitaire Shin-ya Ono : « Pour nous, « mouvement populaire », il n’y a que deux possibilités : ou bien nous fonçons pour devenir des soldats de la guerre révolutionnaire mondiale, ou bien nous retombons chacun dans nos trous bourgeois et devenons des porcs anticommunistes. » Il est évident qu’une telle politique de l’ou bien-ou bien élimine des dizaines d’organisateurs, de propagandistes de collecteurs de fonds, qui sont tout à fait révolutionnaires et peuvent jouer un rôle décisif pour préparer le terrain aux soldats rouges.
L’influence principale des Weathermen ne se mesure pas, cependant, au nombre de magasins qui ont été dévastés, au nombre de porcs (flics) qui ont été expédiés à l’hôpital, au nombre de révolutionnaires de pacotille qui ont été dénoncés mais plutôt au climat qu’ils ont créé aux États-Unis. Jouant peut-être le rôle des Narodniks dans le contexte américain, les Weathermen sont les principaux responsables de l’escalade des contre-attaques que mène le mouvement contre la répression croissante. Non seulement un nombre grandissant de membres du mouvement travaille désormais plus opiniâtrement et plus longuement, dans des entreprises de plus en plus souvent collectives, mais encore la lutte armée est en train de passer de plus en plus dans le fonds commun. Et pas sous la forme de simples sabotages mais sous celle d’attaques directes contre les troupes du système : la police. Quelques-unes des actions entreprises ont fait l’objet de publicité : par exemple, le dynamitage, suivi de graves dégâts, des docks de l’United Fruit, des bureaux de deux banques (Marine Midland et Chase Manhattan), de la Standard Oil, de la R.C.A. et de la General Motors, des bâtiments de l’Office fédéral et de la Cour criminelle, du centre de Recrutement de Whitehall (qui a été tellement endommagé que le gouvernement a renoncé à l’utiliser), de l’usine nucléaire de Rocky Plant (qui ne sera remise en état de marche que dans un an), de l’usine de munitions de Hanover, de trois usines de la General Electrics à New York. Ce ne sont là que les exemples les plus spectaculaires des sabotages devenus courants aux États-Unis. Presque tous les jours, aux États-Unis, une usine de guerre ou une entreprise qui participe directement à l’activité de l’impérialisme américain est endommagée ou temporairement mise hors d’état de fonctionner. De plus, les flics sont attaqués dans la plupart des grandes villes. A New York, jusqu’à ce jour, sept bombes ont éclaté dans des voitures de patrouille de la police. En Californie, une douzaine de flics ont été tués. A Harlem, le Front de libération des Noirs (B.L.F.) a proclamé que « l’état de guerre existe entre l’Amérique noire et les forces et institutions oppressives des Blancs ». Ses membres canardent les policiers tous les jours. Même lorsque aucune organisation, aucun groupe n’y participe, le recours à la contre-attaque se répand dans tonte l’Amérique. Les manifestants étudiants ne se contentent plus de se battre contre la police jusqu’à ce qu’ils soient arrêtés. Ils recourent à la tactique de l’attaque surprise et, immanquablement, ils attaquent les symboles de l’oppression et de l’exploitation en cours ; par exemple, en février dernier, à Santa Barbara, Californie, des étudiants contestataires ont incendié le siège local de la Banque d’Amérique, la première banque mondiale. Interrogé sur les motifs de cette action, un étudiant répondit : « Parce que c’était le plus grand truc capitaliste des environs. »
Il est, de toute évidence, à l’heure actuelle, impossible de dire si le sabotage et l’extension de la lutte armée contribueront à la chute du capitalisme américain. De toute évidence aussi, la vieille gauche est hostile à une telle tactique. Le P.C. des États-Unis, par exemple, a condamné les attentats à la bombe comme étant « soit l’œuvre de malades mentaux, soit l’œuvre directe de provocateurs policiers ou de groupes de fascistes qui visent à discréditer la protestation contre la guerre qui balaye le pays. » Les Weathermen sont, bien entendu, convaincus que le sabotage et la lutte armée aident les mouvements de libération du monde entier et contribuent de ce fait, indirectement du moins, à la défaite de la mère patrie. Ils sont en train de convaincre beaucoup de gauchistes extérieurs à leur organisation. La déclaration rendue publique par les auteurs des attentats de New York était, par exemple, sur la ligne même des Weathermen. Elle affirmait :
« Pendant cette semaine de protestation contre la guerre, nous avons placé des explosifs dans les bureaux de la Chase Manhattan, de la Standard Oil et de la General Motors. Les gardiens de ces trois immeubles et les agences d’information de toute la ville ont été prévenues par téléphone de trente à soixante minutes à l’avance, de façon à garantir que les immeubles seraient vides de monde.
La guerre du Vietnam n’est que la preuve la plus manifeste de la façon dont le pouvoir qui règne sur ce pays détruit le peuple. Les trusts géants de l’Amérique ont désormais étendu leur emprise sur le monde entier, contraignant les économies tout entières de pays étrangers à une dépendance totale à l’égard de la monnaie et des marchandises américaines.
Chez nous, les mêmes trusts nous ont transformés en consommateurs déments, dévorant un nombre croissant de cartes de crédit et d’appareils ménagers. Nous exerçons des métiers sans intérêt, d’énormes machines polluent notre air, notre eau et notre nourriture.
Le nom de Spiro Agnew est connu de tous, mais ce sont des hommes rarement à l’avant-scène comme David Rockefeller, de la Chase Manhattan, James Roche, de la General Motors, Michaël Haiden, de la Standard Oil, qui dirigent le système derrière la scène.
L’empire s’effondre au fur et à mesure que les peuples du monde entier se dressent pour contester sa puissance. A l’intérieur, le peuple noir mène une révolution depuis des années.
Et enfin, au cœur même de l’empire, les Américains blancs sont eux aussi en train de porter des coups pour la libération de tous. »
En fait, beaucoup de Weathermen sont devenus des lanceurs de bombes. Opérant par groupes de quatre à neuf, ils ont quitté leur organisation et créé leurs propres cellules clandestines, sans contact entre elles, tant pour des raisons de sécurité que pour ne pas compromettre par leurs actions l’organisation mère de formation de cadres. Une de ces cellules s’était apparemment installée dans une élégante propriété de la 11e Rue Ouest, à Greenwich Village (New York). Le 6 mars 1970, une explosion détruisit la maison, tuant trois de ses occupants. Dans les décombres, la police trouva de grosses quantités de dynamite et de détonateurs ; elle affirma que la maison servait de laboratoire clandestin. Un seul des corps put être identifié : celui de Theodore Gold, 23 ans. Quelques jours plus tôt, Gold avait déclaré à un ami intime : « J’ai fait des tas de choses excitantes, clandestines, et je sais maintenant que je n’ai pas peur de la mort. » Gold était un Weatherman.
MANIFESTE DES WEATHERMEN
On n’a pas besoin d’un météorologue
pour savoir d’où souffle le vent.
Bob DYLAN
I. ― Révolution internationale
« La contradiction entre les Peuples révolutionnaires d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine et les impérialistes dirigés par les États-Unis est la contradiction principale du monde contemporain. Le développement de cette contradiction favorise la lutte des Peuples du monde entier contre l’impérialisme américain et ses laquais. »
Lin Piao
Vive la victoire de la guerre du peuple !
On nous demande : quelle est la nature de cette révolution dont vous parlez ? Par qui et pour qui sera-t-elle faite ? Quels sont ses buts et sa stratégie ?
La constatation décisive qu’il faut faire pour répondre à cette question est la suivante : la lutte principale qui se déroule dans le monde contemporain oppose l’impérialisme américain et les luttes de libération nationale qui sont menées contre lui. Là est l’essentiel des problèmes politiques du monde entier : parce que l’impérialisme américain est de loin le plus puissant, tout autre empire, tout petit dictateur dépend, à long terme, de lui, qui a unifié toutes les forces réactionnaires du monde, s’est allié avec elles et les protège. Aussi, lorsque nous examinons toutes les autres forces et tous les autres phénomènes, de l’impérialisme soviétique ou de l’impérialisme israélien jusqu’aux « luttes ouvrières » de France ou de Tchécoslovaquie, nous déterminons qui sont nos amis et qui nos ennemis selon qu’ils aident l’impérialisme américain ou combattent pour sa défaite.
La tâche primordiale de la lutte révolutionnaire est de résoudre la contradiction principale en faveur des peuples du monde. Ce sont les peuples opprimés du monde qui ont créé la richesse de cet empire ; c’est à eux qu’elle appartient. Le but de la lutte révolutionnaire doit être de contrôler et d’utiliser cette richesse dans l’intérêt des peuples opprimés du monde...
...L’abondance relative qui existe aux États-Unis dépend directement du travail et des richesses naturelles des Vietnamiens, des Angolais, des Boliviens et des autres peuples du tiers monde. Les United Airlines Astrojets tout entiers, les Holiday Inns tout entières, les automobiles Hertz tout entières, votre appareil de télévision, votre voiture et votre garde-robe appartiennent déjà, dans une large mesure, aux peuples du reste du monde.
Par conséquent, toute conception de la « révolution socialiste » qui se limite aux perspectives du peuple travailleur des États-Unis et qui refuse de prendre en considération la totalité des intérêts des peuples les plus opprimés du monde, se réduit à un combat pour l’intérêt particulier de privilégiés ; elle représente une idéologie très dangereuse...
Notre but est la destruction de l’impérialisme américain et la réalisation d’une société sans classes : le communisme mondial. La conquête du pouvoir d’État aux États-Unis sera le résultat de l’hyperextension des interventions américaines dans le monde entier et de leurs défaites secteur par secteur ; la lutte à l’intérieur des États-Unis sera un moment décisif de ce processus, mais lorsqu’elle triomphera aux États-Unis, la révolution aura été l’œuvre des peuples du monde entier. Définir le « socialisme » en termes purement nationaux dans un pays dont le rôle oppressif est si extrême et, historiquement, si décisif relève, de la part du « mouvement », d’un pur et simple chauvinisme impérialiste.
II. ― Qu’est-ce que la colonie noire ?
Toutes les colonies de peuples opprimés par l’impérialisme ne se trouvent pas hors des frontières des États-Unis. A l’intérieur de l’Amérique du Nord, le peuple noir, amené ici il y a quatre cents ans comme esclave et dont le travail d’esclave a bâti ce pays, est une colonie au sein même de la nation opprimante. Cela signifie que ce peuple noir est opprimé en tant que peuple, par les institutions et les rapports sociaux du pays, en dehors même de sa position de classe, de son revenu, de son niveau de qualification, etc.
Les caractéristiques communes d’oppression, de passé historique et de culture qui donnent au peuple noir l’unité d’une colonie ont (bien qu’historiquement ce peuple soit issu d’un territoire commun différent de celui de l’impérialisme ― l’Afrique et non le Sud) pour origine historique le statut d’esclave, commun à tous les Noirs, statut qui, depuis l’abolition formelle de l’esclavage, a pris la forme d’une oppression de caste, de l’oppression du peuple noir en tant que tel, en quelque endroit qu’il se trouve. Une nation noire nouvelle, différente des nations de l’Afrique dont elle est originaire, a été forgée par l’expérience historique commune de la traite, de l’esclavage et de l’oppression de caste. Affirmer que pour exister comme nation il est nécessaire d’avoir pour but un territoire national commun, différent de celui de l’impérialisme, c’est appliquer mécaniquement des critères valables, autrefois comme aujourd’hui, dans des conditions différentes.
Ce qu’il faut entendre par le terme de caste, c’est que tous les Noirs, à cause de leur origine historique commune d’esclaves, à cause de leur culture commune et de la couleur de leur peau, se voient systématiquement refuser l’accès à certains métiers (ou à certaines responsabilités dans ces métiers), à certaines positions sociales ― et cela sans égard à la qualification, au talent, à la fortune ou à l’éducation. A l’intérieur de la classe ouvrière, ils sont la fraction la plus opprimée ; au sein de la petite bourgeoisie, ils sont encore plus strictement confinés au plus bas niveau. En dehors d’exceptions symboliques, le contenu spécifique de cette oppression de caste s’exprime par le maintien du peuple noir dans les conditions et les métiers les plus en butte à l’oppression et à l’exploitation. Par conséquent, puisque la classe située au plus bas dans l’échelle sociale est la classe ouvrière, la caste noire est presque entièrement une caste ouvrière ou bien se trouve dans une situation d’oppression qui la met sur le même pied que les plus basses couches de la classe ouvrière (c’est le cas des paysans et de la petite bourgeoisie noire). C’est une caste travailleuse coloniale, une colonie dont le caractère national se définit lui-même par la position de classe de ses membres.
Aussi, les Noirs du Nord n’ont pas d’« intérêt double » ― comme Noirs d’une part, comme « travailleurs de la nation américaine » d’autre part. Ils n’ont avec tous les autres Noirs des États-Unis qu’un seul intérêt de classe : celui de membres de la colonie prolétarienne noire.
III. ― La lutte pour l’autodétermination
La lutte du peuple noir, en tant que colonie, vise à l’autodétermination, à la liberté et à la libération de l’impérialisme américain. Parce qu’ils ont été, en tant que peuple, opprimés et maintenus dans une situation sociale inférieure, les Noirs ont le droit de décider, de s’organiser et d’agir sur leur destinée de peuple sans intervention des Blancs... Du fait que tous les Noirs font l’expérience de l’oppression sous une forme inconnue à tout Blanc, aucun Blanc n’est en position de comprendre pleinement et de vérifier par sa propre pratique la situation réelle du peuple noir et la réponse qui en découle nécessairement. C’est pourquoi il est nécessaire au peuple noir de s’organiser séparément et de déterminer séparément son action à chaque étape de la lutte.
Il est important de comprendre les implications de cette nécessité. Il n’est pas légitime que les Blancs interviennent, sur le plan organisationnel, dans les divergences entre nationalistes révolutionnaires noirs. Ce serait de l’arrogance de notre part que d’attaquer n’importe quelle organisation noire qui défend le peuple noir et s’oppose pratiquement à l’impérialisme. Par contre, il est nécessaire de développer dans notre propre organisation une juste compréhension de la lutte des Noirs pour leur libération, car une vision incorrecte entraînerait, dans l’avenir, une pratique raciste dans nos relations avec le mouvement noir.
IV. ― La libération des Noirs implique la révolution
Le fait que la libération noire dépend d’une victoire révolutionnaire totale ne signifie pas qu’elle est contrainte d’attendre pour y arriver qu’un mouvement de masse blanc se constitue et se joigne à elle. L’oppression-génocide du peuple noir doit prendre fin et il ne reste pas trop de temps pour y parvenir. Au besoin, le peuple noir pourrait arracher l’autodétermination en abolissant le système impérialiste et en s’emparant pour le faire du pouvoir d’État, sans avoir à attendre un tel mouvement blanc ― encore que le coût en serait élevé chez les Noirs comme chez les Blancs.
Écarter la possibilité d’une victoire des Noirs seuls mène à la position raciste selon laquelle les Noirs doivent attendre les Blancs et dépendent de l’action des Blancs en leur faveur pour l’emporter. Toutefois, la possibilité d’une victoire des Noirs seuls ne peut être en aucun cas la justification de la carence des blancs à construire un mouvement révolutionnaire parmi les Blancs...
Il est nécessaire de battre en brèche deux tendances racistes :
1° Les Noirs ne peuvent aller de l’avant dans l’accomplissement de la révolution ;
2° Les Noirs doivent aller seuls de l’avant.
La seule troisième voie possible consiste à construire un mouvement blanc qui soutiendra les Noirs et progressera aussi vite qu’ils peuvent et doivent le faire, afin que les révolutionnaires blancs assument leur part des frais et ne laissent pas les Noirs tout faire seuls. Tout Blanc qui ne suit pas cette troisième voie suit objectivement l’une des deux autres (si ce n’est les deux en même temps) et est objectivement raciste.
V. ― La révolution anti-impérialiste et le Front uni
...Lorsque l’impérialisme sera battu aux États-Unis mêmes, il sera remplacé par le socialisme ― et par rien d’autre. Une seule révolution, un seul processus de remplacement, une seule prise du pouvoir d’État ― la révolution anti-impérialiste et la révolution socialiste, une seule et même étape. Parler de ces deux processus comme s’il s’agissait de deux étapes séparées... est aussi stupide que d’imaginer que Marx aurait pu parler de la révolution prolétarienne comme d’une révolution en deux étapes ― la première pour renverser le pouvoir d’État capitaliste et la seconde pour mettre en place le pouvoir d’État socialiste.
De même qu’il n’y a pas deux étapes, il n’y a pas de front uni possible avec la petite bourgeoisie, parce que ses intérêts de classe ne la poussent pas à remplacer l’impérialisme par le socialisme. En ce qui concerne le peuple de notre pays, la tâche de la guerre internationale contre l’impérialisme est la même que celle de la révolution socialiste : le renversement du pouvoir. Dans notre pays, il n’y a pas la possibilité d’un « front uni » pour le socialisme.
Un des motifs qui inspirent ceux qui tiennent à l’idée de « front uni », est la peur de nous interdire, en parlant d’une révolution socialiste en une seule étape, l’organisation du maximum possible de points d’appui dans le peuple ― dans la petite bourgeoisie par exemple qui peut combattre l’impérialisme sur des points particuliers, mais qui n’est pas favorable à la révolution. Quand les intérêts de la petite bourgeoisie la poussent à combattre l’impérialisme sur des points particuliers, sans viser à son renversement et à son remplacement par le socialisme, cette masse contribue quand même, par là même, à la révolution ― et non à l’instauration de quelque régime qui ne serait ni l’impérialisme, ni le socialisme. Quiconque n’est pas pour la révolution n’est pas non plus pour une véritable défaite de l’impérialisme ― mais nous pouvons et nous devons cependant en faire notre allié pour des actions déterminées. Mais il ne s’agit pas là d’un « front uni » (et nous ne devons pas avoir à l’égard de ces éléments une quelconque politique de « front uni » en dehors de notre propre orientation) car la position de classe de ces gens ne les amène pas à s’opposer à l’impérialisme en tant que système...
VI. ― Le mouvement révolutionnaire de la jeunesse : analyse de classe
Le programme du mouvement révolutionnaire de la jeunesse a été salué comme une stratégie de transition, qui expliquait beaucoup de notre passé et indiquait de nouvelles perspectives au mouvement. Mais transition vers quoi ? Quelle était notre stratégie globale ? La stratégie du mouvement de jeunesse n’avait-elle qu’une simple valeur organisationnelles parce que le S.D.S. est lui-même une organisation de jeunes qui peut mieux agir avec d’autres jeunes ?
Nous avons souligné la nature d’avant-garde de la lutte des Noirs de ce pays, partie de la lutte internationale contre l’impérialisme américain. Nous avons indiqué aussi que rien n’était possible sans une stratégie internationale orientée vers la victoire. Toute tentative de mettre en forme une stratégie qui, en dépit de la rhétorique internationaliste qui l’accompagne, fixe une perspective purement nationale au développement des luttes de classes dans notre pays, est incorrecte. Les Vietnamiens (et les Urugayens et les Rhodésiens), les Noirs et les peuples du tiers monde qui vivent dans ce pays continueront à déterminer les termes de la lutte de classes en Amérique.
Dans ce contexte, pourquoi mettre l’accent sur la jeunesse ? Pourquoi les jeunes seraient-ils désireux de combattre aux côtés des peuples du tiers monde ? Avant de traiter ce problème, cependant, nous esquisserons rapidement un tableau des catégories de classes de la patrie blanche que nous jugeons les plus importantes, en indiquant les intérêts respectifs de chacune de ces classes (et en gardant à l’esprit que la possibilité pour les diverses couches de comprendre et de mener la lutte révolutionnaire est beaucoup plus vaste que leurs simples intérêts réels de classe).
La grande majorité de la population appartient à la classe ouvrière. Nous ne désignons pas seulement par là les travailleurs industriels productifs, ni ceux qui travaillent effectivement, mais toute la fraction de la population qui ne possède pas les moyens de production et vit, de ce fait, de la vente de sa force de travail.
Globalement, les intérêts à long terme des fractions non coloniales de la classe ouvrière vont dans le sens du renversement de l’impérialisme par le soutien à l’autodétermination des nations opprimées (y compris la colonie noire), par le combat pour le socialisme international. Cependant, la classe ouvrière blanche, dans sa quasi‑totalité, bénéficie aussi de privilèges à court terme accordés par l’impérialisme ; il ne s’agit pas de faux, mais de très authentiques privilèges qui lui donnent des intérêts établis et la relient à l’impérialisme, surtout lorsque celui-ci est dans une phase de prospérité. D’autre part, dans la mesure où l’impérialisme est en train de perdre son empire, ces privilèges à court terme sont tenus pour temporaires (même s’ils deviennent relativement plus grands avec l’accroissement rapide de la misère des peuples opprimés). Les intérêts à long terme qu’a la classe ouvrière à se placer aux côtés des peuples opprimés sont perçus plus clairement à la lumière de la défaite imminente de l’impérialisme. Au sein de la classe ouvrière, l’équilibre entre les intérêts de classe anti‑impérialistes et les privilèges à court terme accordés par la métropole varie beaucoup.
Tout d’abord, les couches les plus opprimées de la classe ouvrière de la métropole ont des intérêts plus clairement et plus fortement anti‑impérialistes. Quelles sont ces couches les plus opprimées ? Les millions de Blancs qui vivent dans des conditions d’oppression matérielle comparables, ou presque, à celles des Noirs : plus particulièrement, les travailleurs pauvres du Sud, les chômeurs ou semi‑chômeurs, ou ceux qui ont de longues journées de travail pour de bas salaires, dans de mauvaises conditions de travail et qui ne sont pas syndiqués ou ont des syndicats faibles. En poursuivant, on trouve une part importante des ouvriers syndiqués dont la situation est un peu meilleure mais qui sont lourdement opprimés et exploités. Cette catégorie est très vaste ; on n’y trouve pas seulement des travailleurs affectés à la production et aux services, mais aussi certaines secrétaires, certains employés. La plupart de ces catégories tirent quelques privilèges relatifs (autrement dit des bénéfices) de l’impérialisme, ce qui donne une base matérielle à d’éventuelles réactions racistes ou pro-impérialistes ; mais elles sont, par-dessus tout, directement et lourdement opprimées, si bien qu’en plus de leurs intérêts à long terme qui les rangent du côté des peuples du monde, leur situation actuelle constitue une base sérieuse pour aviver leur lutte contre l’État et leur combat pour la révolution.
En second lieu, on trouve les couches supérieures de la classe ouvrière. Il s’agit là aussi d’une catégorie extrêmement vaste, qui comprend les couches supérieures des travailleurs qualifiés, membres des syndicats et aussi l’essentiel de la « nouvelle classe ouvrière », faite des « travailleurs intellectuels » prolétarisés ou semi-prolétarisés. Il n’y a pas de claire ligne de démarcation entre cette catégorie et la précédente ; et, en tout état de cause, nous devrons tirer nos conclusions, à propos des couches « problématiques », d’une analyse plus approfondie de situations particulières. Les intérêts à long terme de la couche supérieure de la classe ouvrière sont, de même que ceux des couches plus opprimées dont nous avons parlé précédemment, en faveur de la révolution, contre l’impérialisme. Cependant, elle a pour caractéristique d’avoir atteint un niveau de privilèges plus élevé que les colonies opprimées, Noirs y compris, et que les ouvriers les plus exploités de la métropole. Il existe donc chez elle une base matérielle solide pour le racisme et le loyalisme à l’égard du système. Dans une situation révolutionnaire, lorsque les forces populaires seront sur l’offensive et que la classe dominante sera clairement sur le point de perdre, la majorité de cette couche supérieure de la classe ouvrière pourra être gagnée à la révolution ; tandis que quelques éléments au moins identifieront probablement jusqu’au bout leurs intérêts à ceux de l’impérialisme et s’opposeront à la révolution (leur comportement ne sera pas strictement déterminé par le niveau de privilège qu’ils ont atteint). Le développement ultérieur de la situation clarifiera le choix de cette fraction de la classe ouvrière, mais il doit être clair aussi que, quelle que soit la voie qu’ils adoptent, nous ne mettons pas l’accent, à l’heure actuelle, sur les combats de cette couche. L’exception ne sera faite que lorsque ces travailleurs auront, dans des conditions données, de l’importance pour la lutte de libération des Noirs, le tiers monde ou le mouvement de jeunesse, ce qui est le cas, par exemple, des enseignants, des techniciens hospitaliers, etc. Nous devrons alors travailler particulièrement dur pour les organiser sur une ligne de soutien intégral à la révolution noire et à la révolution internationale contre l’impérialisme. Ces remarques sont décisives parce que les privilèges de cette fraction de la classe ouvrière ont fourni et fourniront une base matérielle solide pour l’idéologie social-démocrate et nationale-chauvine à l’intérieur du mouvement, sous la forme de concepts anti-internationalistes tels que « pouvoir étudiant » ou « contrôle ouvrier ». Pour comprendre la nature des intérêts de cette couche, il faut tenir compte d’un autre facteur à cause de la façon dont elle s’est développée et s’est qualifiée, les différences entre travailleurs jeunes et plus âgés sont, à l’intérieur de cette couche, plus grandes que dans n’importe quelle autre catégorie de la population.
En troisième position viennent les « couches moyennes » qui n’appartiennent pas à la petite bourgeoisie, qui peuvent même faire éventuellement partie des niveaux supérieurs de la classe ouvrière mais qui sont à un tel point privilégiées et liées étroitement à l’impérialisme par la nature de leur emploi qu’elles en deviennent les agents. Cette couche comprend le personnel de direction, les corps des avocats, les hauts fonctionnaires civils et autres agents du gouvernement, les officiers, etc. Comme le type de métier qu’ils exercent exige et détermine une identification étroite avec les intérêts de la classe dominante, ces couches sont les ennemis de la révolution.
En quatrième lieu, on trouve, dernière catégorie que nous allons aborder, la petite bourgeoisie. Cette classe diffère des couches moyennes que nous venons de décrire dans la mesure où elle a un intérêt de classe particulier qui la fait s’opposer au pouvoir des monopoles aussi bien qu’au socialisme. La petite bourgeoisie est composée par le petit capital ― de l’industrie comme de la terre ― les commerçants autonomes et les professions libérales (parmi celles-ci, nombreux sont ceux qui travaillent pour le capitalisme de monopole et font donc partie soit des couches supérieures de la classe ouvrière, soit de la catégorie des agents de l’impérialisme). Le contenu de ses intérêts spécifiques de classe (contre le capitalisme de monopole mais pour le capitalisme plutôt que pour le socialisme) lui confère un certain caractère d’opposition au « gouvernement des gros », avec ses impôts et ses dépenses croissantes, et l’extension totalitaire de son contrôle à tous les aspects de la vie, et aux « dirigeants ouvriers » qui sont, à l’heure actuelle, intégrés aux structures du pouvoir des monopoles. La direction que prend cette opposition peut être réactionnaire ou réformiste. Aujourd’hui, l’aspect réformiste est très atténué car l’indépendance de la petite bourgeoisie est sapée à la base. A une vitesse croissante, les petites affaires deviennent des succursales des grandes, tandis que les commerçants autonomes et les professions libérales vendent de moins en moins leur qualification au prix qu’elle mérite et deviennent des employés réguliers des grandes sociétés. Cette évolution tendancielle ne signifie pas que la variante réformiste a disparu de la petite bourgeoisie : elle est encore vivante et diverses possibilités existent où, par exemple pour le retrait d’une guerre impérialiste perdues, nous pourrons avoir son soutien. Mais si l’on considère l’impérialisme en tant que système, les intérêts de classe de la petite bourgeoisie sont plutôt favorables à son maintien qu’à son renversement et seuls des déserteurs de cette classe resteront à nos côtés.
VII. Pourquoi un mouvement révolutionnaire de la jeunesse ?
Selon les termes de l’analyse qui précède, la plupart des jeunes Américains font partie de la classe ouvrière. Bien qu’ils n’aient pas encore de profession, les jeunes dont les parents vendent leur force de travail en échange d’un salaire et, bien plus, qui s’attendent eux aussi à la même destinée ― ou à entrer dans l’armée, ou à rester chômeurs ― sont, à coup sûr, membres de la classe ouvrière. La plupart des jeunes savent très bien à quelle classe ils appartiennent, même si leur vision du problème n’est pas très scientifique. Aussi notre analyse a-t-elle pour prémisse initiale que les luttes des jeunes sont en général des luttes ouvrières. Mais pourquoi mettre l’accent maintenant sur les luttes de la jeunesse ouvrière plutôt que sur celles de la classe ouvrière dans son ensemble ?
En règle générale, les jeunes sont moins implantés dans la société (pas de famille, moins de dettes, etc.), sont plus ouverts aux idées nouvelles (ils n’ont pas fait l’objet de lavages de cerveaux depuis aussi longtemps et avec la même efficacité que les adultes) ; ils sont donc mieux à même et plus désireux de s’engager dans une orientation révolutionnaire. Aux États-Unis, très particulièrement, les jeunes ont grandi en faisant l’expérience de la crise de l’impérialisme. Ils ont grandi en même temps que se développait le mouvement de libération des Noirs, que se déroulaient en Afrique les combats pour l’indépendance, que Cuba se libérait et que s’étendait la guerre du Vietnam. Les gens plus âgés ont grandi pendant la bataille contre le fascisme, pendant la guerre froide, l’écrasement des syndicats, McCarthy, pendant aussi la période où les salaires réels croissaient de façon appréciable ― depuis 1965, le revenu réel disponible a légèrement décru, dans les zones urbaines en particulier où l’inflation et l’augmentation des impôts sont venues amoindrir sérieusement les salaires. Cette crise de l’impérialisme affecte tous les secteurs de la société. L’Amérique a dû se militariser pour protéger et étendre son empire ― d’où le grand nombre d’appelés ― aboutissant à l’instauration d’une armée permanente de trois millions et demi d’hommes, qui ont été incapables de l’emporter au Vietnam. Par la suite, les énormes dépenses militaires ― nécessaires à la fois à la défense de l’empire et à l’accroissement des profits des industries qui travaillent pour la défense nationale ― ont été de pair avec la crise urbaine dans les domaines de la sécurité sociale, des hôpitaux, des écoles, du logement, de la pollution de l’air et de l’eau. L’État ne peut faire face aux tâches dont il a été obligé de prendre la responsabilité, et il a besoin d’impôts nouveaux pour paver sa dette croissante, tout en étant contraint de restreindre les services publics et d’utiliser les flics pour réprimer toute protestation. Le secteur privé de l’économie ne peut fournir d’emplois, en particulier d’emplois non qualifiés. L’extension, depuis la Seconde Guerre mondiale, des industries de la défense nationale et de l’éducation sous l’initiative de l’État est, partiellement, une tentative de rattraper le retard, encore que l’impossibilité d’assurer des salaires décents et de bonnes conditions de travail dans les emplois « publics » pose de plus en plus de problèmes.
Dans la mesure où l’impérialisme lutte pour maintenir la cohésion de son édifice pourrissant, il ne peut que recourir à la force brutale et aux idéologies autoritaristes. Le peuple, et particulièrement les jeunes, se trouvent de plus en plus enserrés par les institutions autoritaristes. La révolte contre les flics ou les enseignants, les flics de l’assistance sociale ou de l’armée peut être généralisée et acquiert une portée qui dépasse les institutions répressives particulières qui la font naître pour prendre la forme d’une révolte contre la société et l’État dans leur totalité. La légitimité de l’État est remise en question pour la première fois depuis trente ans et l’anti-autoritarisme qui caractérise la rébellion des jeunes se transforme en rejet de l’État, en refus de se laisser intégrer dans la société américaine. Les jeunes avaient l’habitude de tenter de vaincre le système, de l’intérieur de l’armée, de l’intérieur des écoles ; désormais, ils désertent l’armée et brûlent les écoles... Nous rejetons toute la merde élitaire et technocratique qui nous enseigne que seuls les experts peuvent gouverner et nous cherchons plutôt dans la guerre populaire des Vietnamiens des modèles de direction.
L’effondrement de la culture bourgeoise et l’anti-autoritarisme qui s’est développé en parallèle sont alimentés par la crise de l’impérialisme ; mais, à leur tour, ils alimentent cette crise, l’exacerbent à un tel point que les gens ne se bornent plus à souhaiter le retour des souples années 50, lorgnent vers une nouvelle perspective (comme à l’intérieur des immeubles de Columbia) et se mettent à lutter pour sa réalisation. Nous n’avons pas besoin que les professeurs soient des flics plus aimables ; nous voulons écraser les flics et bâtir une nouvelle vie.
Les contradictions de l’impérialisme pourrissant frappent la jeunesse avec une dureté particulière, dans quatre domaines : l’enseignement, le métier, la conscription et l’armée, les flics et la justice.
a) Dans les écoles-prisons, les jeunes sont bourrés d’une bouillie de mensonges racistes, chauvins, anticommunistes et anti-ouvriers, tandis qu’on les oriente vers des métiers et des carrières qui répondent aux besoins prioritaires du capitalisme de monopole. En même temps, l’État s’avère de plus en plus incapable de fournir assez d’argent pour permettre aux écoles de fonctionner convenablement.
b) Le chômage des jeunes est trois fois supérieur à la moyenne nationale du chômage. Dans la mesure où un nombre croissant d’emplois est menacé par l’automation et la faillite des industries spécialisées, les syndicats agissent pour garantir l’emploi de ceux qui en possèdent déjà un. Les nouveaux arrivés sur le marché du travail ne peuvent trouver du travail, la stabilité de l’emploi est sapée à la base (l’accroissement des cadences et la détérioration croissante des conditions de sécurité du travail vont dans le même sens) ; il y a de moins en moins de gens qui travaillent quarante ans dans la même maison. Et, bien sûr, lorsqu’ils trouvent des emplois, les jeunes se voient attribuer les pires, avec le taux d’ancienneté le plus bas.
c) Il y a maintenant deux millions et demi de soldats de moins de trente ans qui sont forcés de faire la police dans le monde, de tuer ou d’être tués dans des guerres pour la domination de l’impérialisme.
d) Et, comme un « problème de la jeunesse » naît de tout cela, les flics et les tribunaux renforcent le couvre-feu, mettent en place la surveillance, tiennent les gens à l’écart des rues et répriment la moindre initiative des jeunes.
Ce qu’il faut retenir de tout cela n’est pas que la vie en Amérique est plus rude pour les jeunes ou qu’ils sont les plus opprimés. C’est plutôt que les jeunes sont directement ― et sévèrement ― atteints par l’impérialisme... Celui-ci atteint avec un maximum de dureté la jeunesse des couches les plus opprimées (les moins privilégiées) de la classe ouvrière. Il est clair que ces jeunes ont les plus grandes raisons matérielles de se battre. Ce sont eux qui sont le plus souvent appelés dans l’armée, qui se voient attribuer les pires emplois, lorsqu’ils en trouvent, qui sont les plus maltraités par les diverses institutions sociales, de l’armée aux écoles décadentes, aux flics et aux tribunaux. Et leur existence quotidienne montre chez eux un grand potentiel de militantisme. De tous ceux que nous pouvons contacter à l’étape actuelle, ils sont les plus disponibles à s’engager dans une activité révolutionnaire militante.
L’essentiel de la stratégie du mouvement révolutionnaire de la jeunesse consiste à passer d’une base recrutée prioritairement dans l’élite étudiante à la jeunesse ouvrière la plus opprimée (la moins privilégiée) pour approfondir et élargir le mouvement révolutionnaire de la jeunesse ― sans rien abandonner de ce que nous avons acquis, sans abandonner notre vieille voiture pour une nouvelle Dodge. Cette démarche s’intègre dans une stratégie de conquête de l’ensemble de la classe ouvrière. Mais on ne doit pas en déduire qu’il se trouvera un moment magique où, ayant conquis un certain pourcentage de la classe ouvrière, nous nous transformerons d’un coup en mouvement ouvrier. Nous sommes déjà un mouvement ouvrier dans la mesure où nous promouvons une politique internationaliste. Nous n’avons pas non plus à attendre un tel moment pour devenir une force révolutionnaire. Nous devons constituer, dès le départ, une force révolutionnaire et non un mouvement qui fasse allégeance à un quelconque troupe mystique ― le peuple ― qui doit faire la révolution. Nous devons être un mouvement révolutionnaire populaire qui comprend la nécessité de toucher plus le peuple, la classe ouvrière tout entière pour faire la révolution...
VIII. ― Le problème fondamental, c’est l’impérialisme
Nous nous trouvons dans une situation où tous les gens... qui devraient sympathiser avec la révolution, qui le font même, ne comprennent pas quelles tâches spécifiques sont impliquées par la révolution ; aussi bien ne participent‑ils pas à ces tâches. A tout prendre, les gens ne se mettent pas à la révolution parce que les révolutionnaires le leur disent. L’oppression par le système affecte les gens dans des domaines particuliers et le développement de la conscience politique et de la participation aux luttes s’opère à partir de problèmes particuliers qui se transforment en problèmes majeurs et en luttes. Nous devons transformer les problèmes quotidiens du peuple, et les problèmes majeurs et les luttes qui en découlent, en conscience révolutionnaire, en opposition active et consciente au racisme et à l’impérialisme.
Cette perspective s’oppose directement à l’affirmation selon laquelle les luttes sur des problèmes particuliers mèneront naturellement, en leur temps, à la lutte anti-impérialiste. On a prétendu que puisque l’oppression du peuple est due à l’impérialisme et au racisme, toute lutte contre l’oppression immédiate est « objectivement anti-impérialiste », la lutte contre l’impérialisme se déroulant dès lors sous la forme d’une succession de combats pour des réformes. Cette erreur est celle de l’économisme classique.
Une variante de cette argumentation admet que cette position est souvent fausse mais suggère que, puisque nous sommes à l’époque de l’effondrement de l’impérialisme, le combat pour les réformes devient « objectivement anti-impérialiste ». Il est évident qu’à cette étape de l’impérialisme, il y aura de plus en plus de luttes pour l’amélioration des conditions matérielles d’existence mais rien ne garantit qu’elles contribueront à l’approfondissement de la conscience internationaliste du prolétariat.
Si nous autres révolutionnaires sommes, d’une part, capables de comprendre la nécessité d’écraser l’impérialisme et de construire le socialisme, la masse du peuple que nous voulons voir combattre à nos côtés en est tout aussi capable. Mais, d’autre part, le peuple est soumis à un lavage de cerveau permanent et, à l’heure actuelle, ne comprend pas ces nécessités. Si l’on ne soulève pas le problème de la révolution en chaque occasion, comment s’attendre à ce que le peuple voie ses intérêts et se charge du fardeau de la révolution ? Nous devons établir clairement dès le départ que nous sommes pour la révolution. Mais si nous prenons tant de peine pour éviter le danger de réformisme, comment nous rattacher aux luttes pour des réformes déterminées ?...
En chaque occasion, notre but est de faire progresser la conscience anti-impérialiste et antiraciste et de relier les luttes de la jeunesse ouvrière (et du peuple travailleur) aux luttes du tiers monde, plutôt que de nous borner à participer à des combats pour l’amélioration des conditions matérielles, aussi évidemment justifiées que soient ces combats. Cela ne signifie pas que nous ne prenons pas au sérieux ces combats et que nous ne nous y battons pas avec acharnement, mais que nous y mettons toujours en avant notre politique, en sachant que dans le déroulement de la lutte, les gens sont ouverts à une ligne de classe et prêts à dépasser les limites étroites de leur intérêt particulier.
C’est pour cela que nous démontrons que le problème particulier n’est pas le vrai problème, qu’il n’a d’importance que dans la mesure où il démontre que l’impérialisme est l’ennemi qu’il faut détruire. L’impérialisme est en toutes circonstances le problème principal.
Les masses lutteront pour le socialisme lorsqu’elles comprendront que le combat pour des réformes, pour des améliorations de leur situation matérielle ne peut aboutir sous l’impérialisme. Conscients de cela, les révolutionnaires ne doivent jamais proposer de ligne qui renforce l’illusion selon laquelle l’impérialisme peut accorder des réformes significatives. Nous devons participer aux luttes carrément comme des révolutionnaires de façon qu’il soit clair pour tous ceux que nous aidons à gagner que c’est la révolution et non l’impérialisme qui est responsable de leur victoire. Là réside un des points forts du programme des Panthères Noires : « des petits déjeuners pour les enfants ». Il s’agit là de « socialisme mis en pratique » par des révolutionnaires avec une « pratique » d’auto-défense armée et une « ligne » qui met l’accent sur la nécessité de renverser l’impérialisme et de s’emparer du pouvoir d’État. Sans doute, l’American Friends Service Committee a-t-il distribué plus de petits déjeuners aux enfants, mais c’est la valeur symbolique du programme ― démonstration de ce que le socialisme fera pour le peuple ― qui le rend digne d’intérêt.
Que signifie organiser des luttes spécifiques à propos du racisme et de l’impérialisme ? Dans les écoles supérieures et les collèges, cela signifie mettre en avant une ligne de masse tendant à la fermeture des écoles plutôt qu’à leur réforme pour les mettre au service du peuple. La raison n’en est pas que, sous le capitalisme, l’école ne peut servir le peuple et qu’il est donc stupide ou illusoire de formuler de telles demandes. Le fait important est plutôt que les jeunes sont prêts à une lutte militante au niveau le plus élevé, qu’ils font déjà preuve d’une conscience anti-impérialiste, si bien que des luttes pour une école au service du peuple n’élèverait pas le niveau de leur combat au plus haut point possible...
Une ligne de masse pour la fermeture des écoles et des collèges n’entre pas en contradiction avec l’exigence de la libre admission ou toute autre bonne revendication de réforme. L’agitation autour de revendications impossibles, mais raisonnables est un bon moyen de faire ressortir la nécessité de la révolution. L’exigence de la libre admission, en fixant une « alternative » au système scolaire actuel, dénonce sa nature essentielle (raciste, fermée sur une base de classe) tout en indiquant la seule possibilité dans la situation actuelle « Fermez les écoles »...
L’expansion de comités noirs dans les usines et autres lieux de travail dans tout le pays correspond à une extension de la lutte de libération des Noirs. Ces groupes ont soulevé et continueront à soulever devant les travailleurs blancs le problème de l’anti-racisme de façon plus aiguë qu’aucun Blanc ne l’a jamais fait et ne le fera jamais. Les Noirs, en menant des luttes contre le racisme, ont rendu le problème impossible à ignorer, de même que la direction du mouvement étudiant noir l’a rendu inévitable aux étudiants blancs. De plus, ces groupes noirs ont mené des luttes que les directions syndicales traditionnelles refusaient avec persévérance de conduire (lutte contre les cadences et pour la sécurité du travail ― tous problèmes qui ont pris une gravité croissante ces dernières années) ; ils ont ainsi forcé les travailleurs blancs, les plus opprimés en particulier, à choisir entre la fidélité à la méthode blanche et la direction noire. En notre qualité de révolutionnaires de la métropole blanche, nous devons faire notre possible pour être présents dans les usines, les hôpitaux et les entreprises où il y a des comités noirs, peut-être pour y organiser des groupes de solidarité, à coup sûr pour y souligner devant les Blancs l’importance de la lutte de libération des Noirs, pour y distribuer les publications de la campagne « Libérez Huey » (Newton), pour amener des gens aux rassemblements des Panthères, etc. Un seul Blanc peut jouer un rôle décisif pour faire pièce aux dispositions anti-insurrectionnelles de l’U.A.W. (syndicat de l’automobile).
Nous devons aussi nous relier aux lieux de travail où il n’y a pas d’activité noire, mais où il y a encore beaucoup de jeunes travailleurs blancs. Dans les usines, la crise de l’impérialisme se manifeste à propos des cadences, de la sécurité et des réductions de salaires ― dues à l’accroissement des impôts et au développement de l’inflation ― avec la possibilité de voir s’instituer un mécanisme de contrôle sur les salaires et les prix.
Le S.D.S. ne s’est pas occupé convenablement de la question des femmes. La résolution adoptée à Ann Arbor n’a guère eu d’effet pratique, pas plus que ne fut donnée au besoin de combattre la suprématie masculine la moindre orientation programmatique au sein du R.Y.M...
Pour parvenir à une attitude mieux en rapport avec le développement du mouvement des femmes, les femmes du S.D.S. doivent comprendre que leur responsabilité primordiale est d’organiser des femmes conscientes. Nous n’y parviendrons pas à moins de leur parler directement de leur propre oppression. Cela deviendra de plus en plus décisif au fur et à mesure que nous travaillerons avec un nombre croissant de femmes opprimées. Les femmes qui travaillent aussi bien que les femmes qui ont une famille doivent faire face continuellement, dans leur vie quotidienne, à la suprématie masculine ; c’est de là qu’il faut faire partir leur politisation. Les femmes ne pourront jamais tenir un rôle pleinement révolutionnaire si elles ne rompent pas avec leur condition de femmes. Aussi est‑ce une tâche cruciale pour les révolutionnaires que de créer des formes d’organisation au sein desquelles les femmes seront en mesure d’exercer un nouveau rôle, indépendant. Les groupes féminins d’auto-défense seront un pas vers ces formes d’organisation, dans la mesure où ils représentent un effort pour surmonter l’isolement des femmes et créer chez elles la confiance en soi.
Un fort mouvement révolutionnaire des femmes doit exister, car sans lui il sera impossible à l’émancipation des femmes de devenir un élément important de la révolution. Les révolutionnaires doivent être formés à la compréhension de l’extrême degré d’exploitation des femmes et de la nécessité de détruire la suprématie masculine.
IX. ― Le mouvement de jeunesse doit a la fois être a l’échelle des villes et se baser sur les quartiers
Le seul moyen de rendre claires à la fois la nature du système et les luttes particulières que nous avons pour tâche d’accomplir est de les lier les unes à l’autre : montrer que nous sommes un mouvement « multidimensionnel » et non une alliance d’étudiants et d’élèves des collèges, ni d’étudiants et de soldats, ni de jeunes et d’ouvriers, ni d’étudiants et de membres de la communauté noire. On y parviendra en construisant des mouvements organisés à l’échelle de la ville, de la sous-région et de la région, en amenant régulièrement les gens d’une institution ou d’un secteur à participer à des combats qui se déroulent sur d’autres fronts.
Ce travail doit s’exercer à deux niveaux. Dans un quartier ou une localité, en amenant les jeunes à participer à divers combats, que nous relions les uns aux autres (grandes écoles, collèges, logement, affaires sociales, entreprises, etc.), nous commençons à construire, à l’échelle du quartier, un mouvement multidimensionnel. En dehors des actions et des manifestations, nous faisons se mêler des gens différents dans des activités quotidiennes : projections de films, rassemblements, groupes d’études, écoles d’orateur, etc. Au second niveau, nous combinons les « bases » de quartier en un mouvement à l’échelle de la ville ou de la région, avec le même genre d’activité, en concentrant nos forces sur toute lutte en cours d’une certaine importance et en établissant des relations réciproques sans cesse plus développées entre toutes ces luttes.
X. ― R.Y.M. et les flics
Un problème central dans notre travail de quartier et de ville est le problème des flics, car ils désignent aux diverses luttes l’État comme ennemi, et soulignent ainsi la nécessité d’un mouvement combattant pour la défaite du pouvoir.
Les flics sont l’État capitaliste et, à ce titre, ils tracent les frontières de toutes les luttes politiques à un tel point que lorsqu’une lutte révolutionnaire montre des signes de succès, ils arrivent et marquent la limite à ne pas dépasser. Au cours de la première étape de la lutte, ils laissent les parents s’occuper des jeunes des écoles supérieures. Quand il y a escalade de la lutte, les flics débarquent ; à Columbia, la gauche avait peur que sa lutte ne soit détournée vers les brutalités contre la police et la lutte pour chasser les flics des campus ; ils disaient que les flics n’étaient pas le vrai problème. Mais les flics sont le vrai problème et le peuple le comprendra d’une façon ou de l’autre.
Même lorsqu’il n’y a pas de lutte politique organisée, les flics tombent sur les gens dans la vie quotidienne, dans la mesure où ils font respecter les rapports de propriété capitalistes, les lois bourgeoises et la moralité bourgeoise ; dans la mesure où ils montent la garde autour des magasins, des entreprises et des riches et font respecter le crédit et les loyers aux dépens des pauvres. L’écrasante majorité des arrestations est due, en Amérique, à des atteintes à la propriété. Les flics tomberont sur le dos des jeunes avec lesquels nous travaillons dans les écoles, dans les rues ― sous prétexte de drogue. Nous aurons à les placer sous nos projecteurs, à les dénoncer tout le temps, comme le font les Panthères. Nous aurons à relier l’oppression quotidienne par les flics à leur rôle dans la répression politique et à développer, parmi les jeunes avec lesquels nous travaillons, une compréhension de classe de ce que sont le pouvoir et les forces armées.
Dans les écoles, le flic fait partie intégrante de la répression quotidienne : il maintient l’ordre dans les préaux et les cantines, empêche de fumer tout en empêchant les jeunes de distribuer des tracts et en expulsant « les agitateurs de l’extérieur ». La présence de jeunes, ou de jeunes à longs cheveux, est tenue pour une activité politique organisée et les flics réagissent en conséquence. De plus en plus, les activités quotidiennes représentent une menace politique ; du coup, les flics apparaissent soudain au premier plan. En retour, cela détermine l’opposition et l’organisation politiques et ainsi de suite. Notre tâche sera de catalyser ce processus, de pousser à bout les conflits avec les flics, de façon à ce que chaque lutte [...] apparaisse comme une lutte contre les exigences du capitalisme et la puissance de l’État.
Les flics ne représentent pas le pouvoir d’État dans l’abstrait ; ils sont un pouvoir que nous aurons à vaincre au cours de la lutte, à moins de perdre notre raison d’être, de devenir des révisionnistes ou des cadavres. Nous devons nous préparer convenablement à faire face à ce pouvoir car c’est notre devoir que de battre les flics et l’armée et de nous organiser en conséquence. A nos débuts, il nous faudra mettre l’accent sur l’auto-défense ― organisation de groupes de protection à partir de cours de karaté, apprentissage des moyens de se déplacer dans la rue et dans tout le quartier, éducation médicale, propagande en faveur de l’auto-défense armée, vers laquelle il faudra tendre (selon les besoins), en faisant honneur à ce principe que nous devons mettre en avant : « Le pouvoir est au bout du fusil. » Ces groupes d’auto-défense mettront en place des patrouilles de surveillance de la police, des visites aux postes de police et aux tribunaux quand quelqu’un sera coffré, etc.
Ainsi les flics sont-ils, en dernière analyse, la glu ― la nécessité qui maintient l’unité des mouvements de quartier et de ville. Toutes les nécessités concrètes de notre action nous mènent à mettre au premier plan le problème central qu’est le problème de la police :
1° en amenant les luttes pour des réformes institutionnelles à affronter le pouvoir d’État, en poussant chaque lutte soit jusqu’à la victoire soit jusqu’à l’intervention des flics ;
2° en utilisant l’interrelation existant entre les combats à l’échelle d’une ville pour hausser le niveau de la lutte et approfondir la conscience du pouvoir dans les mouvements anti-flics d’une grande ampleur ;
3° en transformant la conscience spontanée anti-flic de nos quartiers en une compréhension de ce que sont l’impérialisme, la lutte de classes et l’État ;
4° en utilisant le mouvement à l’échelle de la ville comme une plate-forme pour le renforcement et l’extension de ce travail de politisation ― en proposant par exemple de rassembler à l’échelle de la ville un réseau, basé sur les quartiers, de groupes d’aide mutuelle pour l’auto-défense contre les flics.
XI. ― Répression et révolution
Au fur et à mesure que se développeront les combats contre les institutions et l’auto-défense anti-flic qui en découle, la répression de la classe dominante ira croissant. L’escalade de sa répression continuera immanquablement à la mesure de la menace que le mouvement représentera pour le pouvoir de la classe dominante. Notre tâche ne consiste pas à éviter ni à arrêter la répression ; on peut toujours y arriver en battant en retraite, de façon à ne plus représenter un danger qui mérite d’être écrasé. Il peut être juste d’agir ainsi, à titre de retraite tactique qui permet de survivre pour reprendre le combat
Battre la répression, toutefois, ne consiste pas à en arrêter la marche, mais à édifier le mouvement pour le rendre plus dangereux pour l’ennemi ; dans ce cas, si elle est battue dans un domaine, la répression franchira de nouveaux degrés dans son escalade. Pour parvenir à défendre le mouvement ― et pas seulement nous-mêmes aux dépens du mouvement ― nous aurons à faire face et à vaincre successivement ces formes de répression sans cesse accrue.
Notre victoire amènera nécessairement, du fait de l’échec des tentatives les moins poussées de l’impérialisme, une phase de répression militaire totale. Pour survivre et nous renforcer face à cette répression, nous aurons besoin d’un peu plus qu’une base élargie de sympathisants ; nous aurons besoin de la force invincible que représente une base de masse à un haut niveau de conscience et d’activité, et qui ne peut naître que de la mobilisation consciente de la créativité, de la volonté et de la détermination du peuple.
Chaque escalade nouvelle de la lutte en réponse aux formes accentuées de la répression, chaque lutte prolongée pour l’auto-défense qui donne naissance à une force de combat matérialisée est partie intégrante de la stratégie internationale de solidarité avec le Vietnam et les Noirs ― par la création de nouveaux fronts. Ces luttes sont contre la guerre, contre l’impérialisme, pour la libération des Noirs. Si elles amènent à combattre l’ennemi, elles sont dès lors partie intégrante de la révolution.
Par conséquent, il est clair que l’organisation et la base de masse, active et consciente de ses actes, qui sont nécessaires pour survivre à la répression sont celles-là mêmes qui sont nécessaires pour faire victorieusement la révolution...
XII. ― La nécessité d’un parti révolutionnaire
Le Mouvement révolutionnaire de la Jeunesse (R.Y.M.) doit aboutir aussi à l’organisation qui est pratiquement nécessaire à notre survie et à la création d’un autre champ de bataille de la révolution. La révolution, c’est une guerre ; quand le mouvement de ce pays pourra se défendre militairement contre la répression totale, il sera partie intégrante de la guerre révolutionnaire.
Cela exigera une organisation de cadres, une clandestinité effective, la confiance mutuelle des cadres et un système complet de rapports avec le mouvement de masse. Pour remporter la guerre sur un ennemi aussi bien organisé et centralisé que l’impérialisme, il faudra une organisation (clandestine) de révolutionnaires, dotée aussi d’un « état-major général » unifié ― c’est-à-dire fusionnée, dans une mesure déterminée, par la discipline, à une direction centralisée unique. Parce que la guerre est politique, les tâches politiques ― la révolution communiste internationale ― en déterminent l’orientation. Aussi, l’organisation centralisée des révolutionnaires doit être une organisation politique aussi bien que militaire ― ce qu’on appelle couramment un parti « marxiste-léniniste ».
Comment parviendrons-nous à construire ce type d’organisation ? Il est clair que nous ne pourrions le construire aujourd’hui, car les conditions de sa naissance n’existent pas dans ce pays, en dehors de la nation noire. Quelles sont ces conditions ?
La première est que, pour avoir une organisation unifiée et centralisée, il est nécessaire d’avoir une théorie révolutionnaire commune qui explique, de façon générale au moins, quelles sont nos tâches révolutionnaires et comment nous pouvons les réaliser. Ce doit être un ensemble d’idées vérifiées et développées dans la résolution pratique des importantes contradictions de notre travail.
La seconde condition est l’existence d’une direction révolutionnaire éprouvée par la pratique. Pour avoir un parti révolutionnaire dans les conditions de l’illégalité et de la répression, il faut une direction centralisée, des individus d’un type spécial, doués du pouvoir de compréhension qui les rende capables d’unifier et de guider le mouvement face aux nouveaux problèmes, en ayant raison le plus souvent possible.
Troisièmement ― et c’est là le plus important ― il faut la base révolutionnaire ou (mieux) le mouvement de masse révolutionnaire que nous avons décrit plus haut. Il est évident que, sans cela, il ne peut y avoir d’expérience pratique qui permette de déterminer si une théorie ou un dirigeant possède ou non la moindre valeur. Sans activité révolutionnaire pratique à l’échelle des masses, le Parti ne peut ni vérifier ni développer des idées nouvelles, ni tirer des conclusions suffisamment sûres pour fonder sur elles sa survie. Plus particulièrement, aucun parti révolutionnaire ne peut survivre sans s’appuyer sur le soutien et la participation actifs de la masse du peuple.
Ces conditions nécessaires au développement d’un parti révolutionnaire dans ce pays sont les « conditions » principales de la victoire. Il en découle deux types de tâches pour nous.
La première est l’organisation de collectifs révolutionnaires dans le mouvement. Notre théorie doit venir de la pratique, mais elle ne peut être développée dans l’isolement. Seule une mise en commun générale de nos expériences peut aider à une compréhension minutieuse des conditions complexes existant dans ce pays. De la même façon, seul notre effort collectif vers un plan commun peut vérifier les idées que nous défendons. L’extension de collectifs marxistes-léninistes-maoïstes qui entreprendront l’évaluation concrète et la mise en pratique des leçons de notre travail n’est pas la tâche de seuls spécialistes ou dirigeants, mais la responsabilité de chaque révolutionnaire. De même qu’un collectif est nécessaire pour faire le bilan des expériences et en mettre en pratique les conclusions sur le plan local, les relations mutuelles entre groupes dans tout le pays sont nécessaires pour parvenir à une vision exacte de l’ensemble du mouvement et pour en tirer les conclusions pratiques à l’échelle de tout le pays. Avec le temps, les collectifs qui prouveront par la pratique qu’ils ont la juste compréhension de la réalité (grâce aux résultats qu’ils obtiendront) contribueront à la création d’un parti révolutionnaire unifié.
La tâche la plus importante dans notre lutte pour la révolution, le travail dans lequel doivent s’engager nos collectifs, consiste dans la création d’un mouvement révolutionnaire de masse, sans lequel un parti révolutionnaire clandestin est impossible. Un mouvement révolutionnaire de masse diffère de la traditionnelle base de « sympathisants » des révisionnistes. Il s’apparente plutôt aux Gardes rouges de Chine, basé sur la participation pleine et entière et l’engagement de la masse du peuple dans le processus pratique de la révolution. C’est un mouvement possédant la volonté pleine et entière de participer à la lutte violente et illégale. C’est un mouvement qui se situe aux antipodes de la conception élitiste selon laquelle seuls les dirigeants sont assez bien ou assez concernés pour accepter toutes les conclusions d’une position révolutionnaire. C’est un mouvement basé sur la foi dans la masse du peuple.
La tâche des collectifs est de créer un tel mouvement (le Parti ne saurait se substituer à lui ; en fait, il en dépend totalement). Nous l’accomplirons d’abord, à cette étape, parmi les jeunes, en mettant en œuvre la stratégie du Mouvement révolutionnaire de la Jeunesse soumise à la discussion dans cet article. Ce sera la pratique ainsi déterminée, et non quelque « enseignement » politique dans l’abstrait, qui déterminera la viabilité des collectifs politiques que nous formerons.
La stratégie du Mouvement révolutionnaire de la Jeunesse (R.Y.M.) ― visant à se donner une base de masse active, à relier les combats dans les villes au mouvement anti-flic à l’échelle de la communauté et des villes, et à bâtir par la suite un parti révolutionnaire à partir de ces actions ― s’accorde avec la stratégie mondiale pour la victoire de la révolution, construit un mouvement qui tend à la prise du pouvoir et qui deviendra une division de l’Armée internationale de Libération, tandis que ses champs de bataille s’ajouteront aux nombreux Vietnam qui démembreront et vaincront l’impérialisme américain.
Vive la victoire de la guerre du peuple !
John Mc Grath
ENTRETIEN AVEC ELDRIDGE CLEAVER
Eldridge Cleaver occupe quelques pièces au premier étage d’une petite maison blanche au bord de la mer, avec vue sur la baie d’Alger. On y trouve une population flottante : des Panthères, des amis, des révolutionnaires, noirs et blancs.
En Algérie, il est en rapport avec des représentants de mouvements de libération d’Afrique et du monde entier qui se retrouvent là sous le regard amical de ce curieux amalgame qu’est le régime algérien. Pendant ce temps, en Amérique, les Panthères sont toujours assassinées ou emprisonnées. De plus en plus, elles évoluent vers la gauche, dépassant l’ancien chauvinisme noir. C’est parce que je m’intéressais à cette évolution ― l’internationalisme de plus en plus prononcé des Panthères et leur prise de conscience socialiste ― que j’ai interviewé Cleaver. Il refuse de s’entretenir avec la C.B.S., la N.B.C. et avec les grandes organisations. Sa femme et ses enfants sont au Danemark. En leur absence il essaie de terminer un livre. C’est un homme de grande valeur qui se révèle ici, et son parti est en train de suivre une évolution idéologique d’une grande importance.
J. McG.
Nous n’avons pas envie de vous présenter comme une personnalité mais pourriez-vous, pour mettre les choses au point, nous décrire votre situation actuelle ?
Quand on parle de ma situation actuelle, on commence par le mot « exil ». Je n’aime pas ce mot parce qu’il est statique. Nous sommes en train de créer ici un centre d’information. Il a pour but de faire connaître notre lutte à l’échelle internationale, de prendre des contacts, de nous faire découvrir nos alliés, de localiser les possibilités de soutien réciproque. C’est une façon de continuer le combat, de poursuivre le travail. Je n’aurais jamais quitté les États-Unis si d’autres n’avaient pas pris cette décision à ma place. A l’époque, nous n’étions pas préparés à mener une action clandestine hasardeuse. Nous nous y préparons maintenant. Mon travail ici me permet d’attendre le moment de mon retour.
Vous vous trouvez en Algérie. Avez-vous choisi l’Algérie ?
Non, pas vraiment. Quand j’ai quitté les États-Unis, j’ai choisi un autre pays qui ne ressemblait en rien à celui que je croyais choisir : j’ai découvert qu’il m’était impossible d’y faire le travail que je m’étais assigné. Ce n’est pas le moment de vous raconter comment je suis arrivé ici ni pourquoi. Ce que je peux dire, c’est que je n’ai découvert l’Algérie telle qu’elle est réellement et les possibilités qu’elle offre, qu’une fois arrivé ici. Je n’ai pas vraiment choisi d’y venir. Très peu de frontières m’étaient ouvertes. Il se trouve que j’ai eu la chance d’aboutir ici.
Quels sont les chefs d’accusation retenus contre vous en Amérique ?
Six accusations d’agression avec intention de donner la mort à un officier de police. On m’accuse également d’avoir manqué à la parole donnée lors d’une libération conditionnelle ; enfin d’avoir fui illégalement pour me soustraire aux poursuites relatives aux autres accusations.
Et quand on vous a confisqué vos livres et vos biens, c’était à la suite d’un autre délit ?
Non, c’est venu d’une décision du Département d’État. On m’a déclaré citoyen cubain. Il existe aux États-Unis une loi portant sur le « commerce avec l’ennemi » ― une loi spécialement votée contre Cuba afin de confisquer les biens de Cubains demeurés fidèles au régime castriste. Il suffit, en vertu de cette loi, qu’on vous déclare citoyen cubain pour que soient confisqués tous les biens que vous possédez aux États-Unis. De plus, on peut poursuivre toute personne qui vous vient en aide. Si, par exemple, quelqu’un vous envoie de l’argent, disons des droits d’auteur, on interprète ça comme une forme de « commerce avec l’ennemi ».
A votre avis, quels ont été, jusqu’ici, les principaux succès remportés par les Panthères Noires ?
Nous avons éveillé la conscience politique de beaucoup de gens. C’est là notre principale réussite, la plus importante. Une fois que les gens sont conscients de leur situation, je doute que le gouvernement puisse leur faire faire marche arrière. Les Panthères Noires ont réussi également à dissiper le sentiment qu’avaient les révolutionnaires noirs et les révolutionnaires blancs d’être étrangers les uns aux autres. Lorsque nous avons fondé notre parti, il y avait entre eux une sorte de gouffre ― c’était l’héritage laissé par le S.N.C.C. , le Pouvoir Noir et Stokeley Carmichael.
Ainsi, vous avez aidé les Noirs américains à prendre politiquement conscience de leur situation, et vous vous êtes alignés sur, ou vous avez conclu des alliances avec, le Mouvement pour la paix et la liberté et autres mouvements blancs. Mais, autant que je sache, vous n’avez jamais fait appel à la classe ouvrière américaine elle-même. Quel est, à votre avis, le rôle politique de cette classe ?
Notre parti, voyez-vous est issu en grande partie du lumpen-prolétariat. Nous appartenons à la classe ouvrière ― ou plutôt beaucoup de nos membres en sont issus ― mais nous devons distinguer ceux qui travaillent de ceux qui ne travaillent pas. Il y a un grand nombre de chômeurs aux États-Unis. Tout d’abord le peuple américain est très corrompu, il est profondément imbu d’individualisme, de cette philosophie cupide qui veut que les loups s’entre-dévorent. Ils se foutent pas mal des autres et du voisin, du moins tant que l’État leur procure du travail, tant qu’il arrive à soutenir l’économie en fabriquant des matériels de guerre ; tant que les gens recevront leur feuille de paie, on ne pourra pratiquement rien faire avec eux. Nous connaissons la théorie selon laquelle la classe ouvrière est la clé de voûte du processus révolutionnaire, mais il faut bien voir la situation telle qu’elle est. L’important, aujourd’hui, est d’organiser ceux qui sont objectivement organisables. Et après ça nous pourrons entamer le morceau le plus résistant. Pour l’instant, j’ai le sentiment ― qui est aussi celui de notre parti ― qu’il faut faire des travaux d’approche auprès de la classe ouvrière en tant que catégorie ; mais nous ne pensons pas qu’elle soit prête à nous rencontrer.
Donc, quand vous parlez d’« impérialisme intérieur », de « colonie noire » et de « libération de la colonie », vous vous situez en dehors du schéma marxiste de la lutte des classes ?
Ce que je dis est tout à fait compatible avec l’analyse marxiste, il me semble. A ceci près que nous sommes obligés d’appliquer les principes universels du marxisme à notre situation spécifique, ce qui n’a encore jamais été fait. Il ne suffit pas d’adopter en bloc la théorie marxiste. Ce ne serait pas fonctionnel. De là vient l’échec diabolique du parti communiste américain, qui se refuse à examiner la situation réelle et se contente de parler de la classe ouvrière, d’affirmer que les Noirs sont membres de cette classe, un point c’est tout. Il n’affronte pas les problèmes ethniques existants. Aux États-Unis, la lutte de classe est dissimulée par la lutte ethnique. Si cette dernière semble l’emporter, c’est parce que les gens sont manipulés par l’État et la classe dirigeante, qui maintiennent l’acuité des contradictions ethniques en jouant sur la corde raciste, en s’appuyant sur toute l’histoire raciste. C’est pourquoi on en est venu à considérer la lutte des Noirs américains comme une lutte de races et non pas une lutte de classes. Nous savons bien que la lutte des classes est décisive, mais on ne peut pas négliger le facteur ethnique. Sinon, on va droit à la catastrophe.
Une question d’ordre chronologique la libération de la colonie noire devra-t-elle, à votre avis, intervenir avant la révolution américaine ?
Non, nous estimons qu’elles doivent se produire simultanément. Les Blancs ont engagé la lutte contre la guerre au Vietnam et ils ont soutenu les Noirs dans leur combat pour leurs droits. C’était le point de départ d’un mouvement décisif qui se développe maintenant parmi les Blancs des États-Unis. Sans la lutte pour les Noirs, il n’y aurait pas non plus de mouvement contre la guerre. Les deux choses sont liées et doivent se développer en même temps ; cela va de soi. Je veux dire par là qu’on ne peut pas remettre l’une à plus tard et s’occuper de l’autre tout de suite. Les deux mouvements doivent, selon nous, se produire ensemble, grâce à un mécanisme qui leur donne une impulsion simultanée.
Les revendications des Panthères Noires ne sont pas précisément socialistes. Par certains côtés vous semblez accepter les structures actuelles de la société. Loin de vouloir les renverser, vous réclamez seulement plus de justice dans le cadre de ces structures. Est-ce bien cela ?
On nous pose souvent cette question, et souvent sous forme de critique. Mais vous devriez comprendre la situation aux États-Unis, comprendre aussi les hommes qui ont élaboré notre programme. Ils ont interprété la société à la manière marxiste. Leur programme, si vous l’avez remarqué, se fonde sur le principe des alternatives. Il dit au gouvernement : ou vous ferez ceci, ou nous ferons cela. Il est sous-entendu qu’il est impossible au gouvernement d’admettre nos exigences. Mais aux yeux du peuple, ces revendications sont très claires et très légitimes. Elles traduisent exactement ses griefs. Or, quand le peuple voit que nous posons de justes revendications et que l’État ne peut ou ne veut pas les satisfaire, il lui paraît raisonnable d’avoir recours aux alternatives. Nous allons toujours au-delà des dix points du programme. Ils ne sont qu’un instrument de travail nous permettant d’approcher le peuple. D’ailleurs cet instrument s’avère très efficace, malgré les critiques dont il fait l’objet de la part de nombreux intellectuels.
J’ai remarqué, dans un des derniers numéros de la publication des Panthères Noires, une très bonne analyse d’une grève à la General Electric qui montre comment fonctionnent les structures du pouvoir dans un cas bien précis.
C’est que nous avons remporté quelques succès auprès de la classe ouvrière au cours des dernières années. Certains membres de notre parti, et certains sympathisants, sont membres de syndicats et ils se consacrent entièrement à la tâche qui consiste à nouer des liens avec les ouvriers. La classe ouvrière nous lit beaucoup. En publiant ce genre d’analyse, nous pouvons l’aider à amorcer un début de réflexion idéologique. Il est certain que ce processus va continuer.
Jusqu’à quel point êtes-vous américain ?
Je suis américain comme la tarte aux pommes. Pour moi c’est très clair. C’est encore plus clair depuis que j’ai quitté les États-Unis, et je ne m’en cache pas. Je n’en ai pas honte. Je ne vois pas ce qu’on gagnerait à changer. Une telle métamorphose serait d’ailleurs toute verbale. Nous avons beau parler du tiers monde, et en être issus, nous appartenons au premier monde, le monde capitaliste.
Vous avez parlé d’un front uni contre le fascisme, vous avez qualifié l’Amérique de pays fasciste. Comment se compare-t-elle à l’Allemagne nazie ?
L’Amérique me semble bien pire, si l’on considère les effets de sa politique sur le reste du monde. Bien des gens n’arrivent à identifier le fascisme que si on leur montre des croix gammées ou quelque chose qui émane de Mussolini. Nous pensons que la forme d’oppression qui sévit aux États-Unis, son caractère global et les facteurs économiques qui lui sont liés, suffisent à qualifier l’Amérique de fasciste. Par des mécanismes retors, par les holdings, les conseils d’administration qui s’imbriquent les uns dans les autres, etc., notre économie est centralisée ; elle est entre les mains d’un très petit nombre de personnes et de corporations au sommet. Il existe une concurrence, une libre entreprise de façade, mais depuis longtemps déjà l’entreprise n’est plus libre, si elle l’a jamais été. Il s’agit sans aucun doute d’un mécanisme hyper-centralisé qui n’est décentralisé qu’en apparence.
Selon certaines déclarations des Panthères Noires, l’Amérique a besoin d’un Front de libération nord-américain. Traditionnellement les fronts de libération ont toujours mené des guerres prolongées. Quelle est la stratégie que vous envisagez ?
En général, quand on parle de front de libération, c’est dans le cadre d’un régime colonialiste. Aux États-Unis, notre principal combat est un combat révolutionnaire : mais en même temps nous sommes en présence de conditions spécifiques qui sont à l’origine de l’oppression que subissent les Noirs. On a transporté des Noirs aux États-Unis à l’époque de l’expansion de la politique européenne dans le monde non européen, qu’il s’agissait de coloniser. De sorte que bien des formes d’oppression qui sont apparues alors ont été infligées aux Noirs à l’intérieur des États-Unis. Certes, nous n’avons jamais connu la colonisation sous sa forme classique, mais elle a existé sous d’autres formes : par exemple, la domination de la communauté noire par la communauté blanche. On a raison d’appliquer à ce propos les analyses marxistes concernant l’impérialisme et le colonialisme. Mais l’important est que notre révolution ne pourra l’emporter que par la guerre. Nous ne ferons disparaître ni le capitalisme, ni la classe dirigeante en votant pour leur disparition. Nous pensons que les gens vont devoir s’organiser, prendre les armes, s’engager dans une guerre afin de renverser le système. On a parlé d’un Front de Libération nord-américain. Je préférerais, quant à moi, un autre nom : Front de libération du Nouveau Monde.
Or que se passe-t-il en ce moment ? De petits groupes sont en train de s’armer, de se livrer à des actes qui visent directement le système. Je crois que de tels actes vont se multiplier, et que de ce mouvement surgira, comme en d’autres pays, une guerre populaire. C’est à cela que nous nous efforçons, à tous les instants, d’aboutir. Combien de temps cela prendra-t-il ? Qui peut le dire ? Certainement pas moi. Il se produit souvent, dans ce domaine, des explosions. On croit que certains développements doivent s’étendre sur dix ans. Or ils aboutissent en quinze jours. C’est dans l’action que l’on peut accélérer la marche du temps.
Ce télescopage serait-il lié, à votre avis, à l’évolution de l’économie ?
Oui, si toutefois l’économie connaît de brusques effondrements du fait de la situation internationale. Ainsi un nombre toujours croissant de personnes seraient mécontentes de leur vie quotidienne. Une telle situation ouvrirait évidemment de très belles, et de très immédiates, perspectives. Mais il faut que vous compreniez une chose : ceux qui, aujourd’hui, aux États-Unis, sont actifs, ne sont pas écrasés par la misère. Parce qu’aux États-Unis, les gens, même les Noirs, souffrent d’une autre forme d’oppression, une oppression spirituelle telle que ses victimes sont plus misérables que si elles mouraient de faim. La faim n’est pas la seule forme de misère ; il y en a d’autres, et les Américains sont misérables. Souvent ils l’ignorent ; mais ceux qui en sont conscients et en connaissent la cause, nourrissent à l’égard du système une haine si profonde qu’ils ne peuvent vouloir que sa destruction. Ils voient bien que leur vie est pourrie, sans valeur, que la seule chose qui ait un sens, c’est démolir ce système monstrueux. On parle beaucoup du mouvement étudiant aux États-Unis, c’est presque une mode ; mais ce n’est plus un simple mouvement d’étudiants, c’est toute une génération de gens conscients que le monde se trouve actuellement dans une très mauvaise passe, qui comprennent pourquoi et qui ont le courage de faire quelque chose. Et cela est une nécessité.
A propos de cette lutte, il semble que les Panthères Noires soient quelque peu aventuristes : elles s’exposent volontairement à la prison ou à l’exil.
Oui. Mais est-ce nécessairement une mauvaise chose ? Nous en discutons beaucoup, nous sommes conscients de ce problème. On a dit, en effet, que nous provoquions le pouvoir, que nous le forcions à s’abattre prématurément sur des gens qui n’y étaient pas préparés. Mais il nous est apparu, de plus en plus clairement, que c’est toujours le moment d’agir si on est prêt à en assumer les conséquences. Certes, nous nous sommes plaints de ces conséquences, mais nous les avions prévues.
Je me souviens du jour où nous sommes allés au Congrès avec nos fusils. Eh bien ! le parti communiste et le parti des ouvriers socialistes, tous les phraséologues super-révolutionnaires ― il n’y a pas d’autres mots ― nous en ont voulu encore plus que les flics, parce que notre action était, selon eux, provocatrice et aventuriste. Mais les Noirs en particulier ont besoin de prendre conscience de la valeur de l’action-suicide. Vous souvenez-vous de la première phrase du Catéchisme d’un révolutionnaire de Bakounine ? Un révolutionnaire, dit-il, est un homme condamné. Quant à ceux qui se préoccupent d’abord de leur propre survie et veulent faire la révolution sans en subir les conséquences, ― ceux-là, au fond, ne tiennent pas à faire la révolution. Nous devons être prêts à prendre des risques et à souffrir pour obtenir des résultats. Nous avons beaucoup souffert, nous n’y avons pris aucun plaisir ; mais nous ne regrettons pas nos actes parce qu’ils étaient nécessaires. Il fallait choisir entre ne rien faire ou accomplir des actes qui nous vaudraient probablement la mort ou la prison nous avons préféré passer aux actes, les yeux fermés pour ramasser ensuite les pots cassés, au lieu de rester assis dans nos fauteuils comme certains philosophes qui se contentent d’analyser la situation. Un exemple : voilà environ cinquante ans qu’aux États-Unis on parle de brutalités policières. La N.A.A.C.P. s’y est mise dès 1911. A ses débuts, la N.A.A.C.P. était une organisation qui protestait. Elle a déposé environ un million de pétitions dénonçant la brutalité policière. Tout le monde en parlait. Mais il a fallu que les Panthères Noires descendent dans la rue avec des fusils et affrontent les flics (non sans accuser de lourdes pertes et connaître de grandes souffrances) pour créer un certain climat, susciter une certaine prise de conscience, qui rendent les flics extrêmement nerveux. Tous les discours du monde n’y avaient rien fait ; il a fallu le genre d’action que nous avons menée ― celle-là même qu’on qualifie d’aventuriste et que nous acceptons. Au fond, je crois que nous devrons nous transformer en kami-kase et en être conscients. J’aime ce mot-là : c’est exactement celui qu’exige la situation.
Devez-vous un jour adopter une stratégie plus proche de celle des fronts de libération traditionnels. Celle du F.L.N. algérien par exemple, qui avait coutume d’attaquer pour disparaître ensuite ? Ou encore les tactiques traditionnelles de Mao ?
Dès la naissance de notre parti nous avons eu de vives discussions sur ce point précis. Nombre d’entre nous voulaient organiser un parti souterrain. Huey traite de cette thèse dans un essai intitulé The Correct Handling of a Revolution. Étant donnée la situation d’alors aux États-Unis, il fallait, selon moi, que notre organisation commence par se manifester en plein jour, afin de nouer des liens avec le peuple, et vice versa. Nous nous attendions, toutefois, à passer dans la clandestinité, et c’est, dans une large mesure, ce qui s’est produit. Une grande partie de notre activité légale nous paraît déjà dépassée. Nous savons bien que nous n’arriverons jamais à renverser le régime en organisant des manifestations de masse et des piquets de grève, que nous devrons recourir à des moyens tant illégaux que légaux. C’est cela, la bonne méthode révolutionnaire : il faut mener certaines actions ouvertement, et d’autres clandestinement. Il est certain que nous devrons recourir aux tactiques dont vous parlez.
J’aimerais votre opinion sur le mouvement étudiant. Quelle est l’importance de sa contribution actuelle ? Est-ce une avant-garde révolutionnaire, ou un détonateur, comme on disait à Paris, ou les étudiants ne sont-ils que des fauteurs de troubles ?
Mon opinion là-dessus est fluctuante, tout comme l’activité des étudiants eux-mêmes. Mais parce que j’ai été associé de très près à un grand nombre d’étudiants, j’ai fini par comprendre qu’ils s’agissait de toute une génération consciente du problème et qui s’est engagée. Mais il y a aussi dans ce mouvement beaucoup de gens qui ne font que le traverser ; c’est pour eux une sorte d’initiation ; celle-ci achevée, ils rentreront dans le système.
Il paraît que vous approuvez tout particulièrement les Weathermen.
Eh bien ! Je me trouvais ici quand les Weathennen se sont lancés dans leurs activités. Je sais que la fraction des Weathermen au sein du S.D.S.8 est composée de gens très bien, très sérieux, très dévoués et très généreux, et j’estime qu’ils méritent un soutien. Leurs actes ne m’ont pas paru nihilistes au point que je devrais leur retirer mon soutien.
Mais quelque chose ne vous a pas plu chez les Weathermen. Quoi donc ?
Il y a beaucoup de naïveté chez eux, vous savez. Quand ils disent par exemple : « Luttez contre le peuple » et « Que le peuple aille se faire foutre », quand ils s’en prennent au slogan « Servir le peuple », eh bien ! je ne sais comment dire, mais... ils se sont laissé entraîner dans des prises de position délirantes, et complètement isolées. Mais ce n’est pas une fatalité. Ils ne resteront pas éternellement sur ces positions-là. A mon avis, ils sont en train d’explorer l’immense broussaille idéologique qui est celle des contestataires américains. Ils sont à la recherche d’une position juste et d’une appréciation correcte de la situation. Et je crois que tout le monde, aux États-Unis, est logé à la même enseigne... D’autres que les Weathermen se livrent à des actes tout aussi désastreux pour le mouvement, quoiqu’ils ne prennent pas toujours une forme aussi violente. Certes, les Weathermen se sont attiré l’antipathie de la classe ouvrière. Mais ce n’est pas tellement grave quand on pense que certains membres de cette classe sont bel et bien des assassins. Et ceux-là, je ne vois pas pourquoi on les dorloterait. Je serais plutôt partisan de les rudoyer un peu.
Quels sont les livres qui vous ont particulièrement influencés, vous et les Panthères ? Quels classiques marxistes ― Marx, Lénine, Trotski, Mao ?
Les membres fondateurs du parti ont lu beaucoup de littérature socialiste. Moi-même j’ai eu, en prisons le temps de lire tous les livres qui me tombaient sous la main. Mais le livre décisif, celui qui a mis le parti en branle, c’est Les Damnés de la Terre de Franz Fanon. C’est après avoir lu ce livre que Huey Newton et Bobby Seale ont senti le déclic ; c’est alors qu’ils ont organisé le parti. A cette époque j’étais prisonnier. Nous avons lu Les Damnés de la Terre en prison ; mais nous y avons lu de tout : le Manifeste et Le Capital et même des morceaux choisis de Lénine qui se trouvaient disponibles à la prison, certaines oeuvres de Mao, quelques essais des socialistes fabiens, des choses comme ça. En les lisant, nous avons réussi à nous faire une idée de la société capitaliste, de son fonctionnement et de ses maux.
Et tout cela vous semblait en rapport direct avec votre situation ?
Oui. Quand j’ai commencé à lire Marx, je n’avais que dix-huit ans, c’était la première fois que je faisais de la prison. Mais à travers cette lecture je n’ai compris le capitalisme que d’une façon abstraite, pas dynamique. Je ne pouvais pas brancher la théorie sur mon activité quotidienne parce qu’à l’époque il n’y avait pas d’organisation à laquelle je pouvais m’associer.
Fanon mis à part, certains marxistes du vingtième siècle ont-ils une signification pour vous, comme Marcuse ou Gramsci ? Et Trotski ?
Il me semble que j’ai lu Trotski plus que les autres. J’ai lu certaines oeuvres de Marcuse, mais c’était du temps où j’étais déjà profondément engagé dans le parti des Panthères Noires. On ne peut donc pas dire qu’elles nous aient stimulés ou influencés directement. J’ai lu Marcuse parce qu’il était là et parce qu’il jouissait d’un large soutien sur le campus, mais son œuvre ne m’a pas attiré. Je n’y pense pas, à moins que l’on m’interroge là-dessus.
Pourquoi les dirigeants des Panthères Noires se sont-ils donné les titres de ministre de l’Information, ministre de la Culture, Premier ministre, etc. ?
Il fallait prendre en considération un fait très important : la tactique du gouvernement a toujours été de dépolitiser les organisations noires aux États-Unis. Nous avons eu des discussions très vives à ce sujet. Les gens pensaient que nos titres étaient prétentieux. Mais nous les avons choisis pour souligner le contenu politique de notre combat.
Quelle est l’attitude de votre parti vis-à-vis des intellectuels ?
Aux États-Unis, les gens instruits forment une classe qui a bradé les masses noires. En effet, ils n’étaient instruits que pour remplir certaines fonctions auprès du maître d’esclaves, et ils les ont bien remplies. Mais nous, au sein du parti, nous avons grand besoin d’intellectuels capables de renouveler constamment notre analyse de la situation. Il faut tout un apprentissage pour gober, pour apprécier un type qui travaille avec sa tête. Si nous sommes revenus sur nos préventions, c’est tout simplement parce que nous avons tiré beaucoup de profit d’une partie du travail accompli par ces intellectuels, comme on les appelle.
A cet égard les flics nous ont beaucoup aidés. Il se trouve que les gens qu’ils ont assassinés étaient ceux qui avaient de la cervelle, comme Malcoim X, et même Martin Luther King. Fred Hampton était un homme très intelligent. Quand certains cerveaux de notre parti ont connu une fin atroce, les gens ont compris que les flics nous faisaient ça pour nous faire du mal, en éteignant les lumières. Les gens savent apprécier l’intelligence. Nous savons pertinemment que nous en avons besoin.
Vous avez exclu un groupe de Panthères que vous accusiez, entre autres, de chauvinisme masculin. C’est sans doute la première lois dans l’histoire de la politique que des hommes politiques sont exclus d’un parti pour un crime de ce genre.
Mais c’est un problème très sérieux, vous savez. Aux États-Unis, les rapports entre hommes et femmes noirs sont effroyables. La femme noire a profondément souffert, depuis les débuts de l’esclavage, époque où les structures familiales du peuple noir furent entièrement disloquées et où sont apparues les structures familiales actuelles. Au temps de l’esclavage ― et c’est là qu’il faut toujours remonter ― on considérait la femme noire comme une pondeuse, destinée à produire d’autres esclaves, et l’homme noir comme un étalon. Tous les sentiments délicats qui peuvent exister entre un homme et une femme s’en sont trouvés déformés, ravagés. Et les choses ont continué comme ça. Les femmes noires ont été victimes d’une oppression double, peut-être même triple ou quadruple. Elles ont à affronter l’oppression en tant que Noires, et en tant que femmes, car elles sont opprimées par les hommes noirs qui sont eux-mêmes opprimés. De sorte que leur vie est extrêmement dure. Et les hommes noirs ont été très brutaux et vicieux dans leurs rapports avec elles.
Du temps de l’esclavage, la femme noire jouissait d’une plus grande sécurité que l’homme noir. Le Blanc américain avait compris qu’en détruisant tous les systèmes de sécurité du Noir, il pourrait le maintenir plus efficacement sous sa coupe. La femme noire, elle, pouvait presque impunément tuer un homme noir, parce qu’un tel geste était considéré comme un homicide justifié. De sorte que les hommes noirs ont eu recours à la force brute pour mettre les femmes à leur place. Au parti des Panthères Noires, nos sœurs ne veulent plus entendre parler de ces foutaises, elles s’y refusent absolument, mais il y a beaucoup de frères qui ne le comprennent pas. Pourtant ils comprennent déjà beaucoup mieux qu’avant.
Figurez-vous que le premier procès qui s’est déroulé à l’intérieur de notre parti traitait justement de ce problème. Un des frères avait envie de coucher avec une sœur, et elle ne voulait pas. Alors il l’a injuriée, frappée et s’est refusé à quitter sa maison. C’est elle qui nous l’a raconté. Il fallait donc tenir une réunion, parce qu’à l’époque nous n’avions aucune idée sur ces problèmes. La réunion a eu lieu. Bobby Seale présidait. On a discuté de la conduite du frère en question. Il y avait trois sœurs qui habitaient la maison ; elles nous ont raconté ce que le type avait fait. Puis nous nous sommes demandé s’il fallait suspendre ce type, ou l’exclure du parti, ou le tuer, ou quoi. Nous n’avions rédigé aucun code, mais quelle autre sanction pouvions-nous infliger à un type pareil ? Après un long débat, Bobby a proposé un vote. C’est alors que s’est posée la question : les sœurs pouvaient-elles voter ? Lorsque le parti est né, il n’y avait pas de femmes membres, nous n’étions que des hommes. C’est seulement après l’arrestation de Huey que des femmes ont commencé à venir au parti. Avant, il y avait bien quelques femmes qui fréquentaient le parti, c’étaient des amies de nos membres qui faisaient des petites choses, et nous rendaient des services. Mais comme en ce temps-là toute notre activité consistait à nous défendre contre les flics ― il y avait très peu de paperasse à expédier ― le parti se réduisait aux Panthères et aux fusils, ou presque. A mesure que nos activités prenaient de l’ampleur, les femmes sont venues au parti. N’ayant pas de règlements nous ne savions quel statut leur accorder. Au début, quand nous tenions des réunions auxquelles assistaient les amies de nos membres il était entendu que n’étant pas membres, elles ne voteraient pas, ne participeraient pas. Puis ces sœurs, et d’autres à leur suite, se sont déclarées Panthères, mais nous, les frères, nous avons continué à voter seuls. Au procès dont je viens de parler, nous avons procédé de la même façon. Mais le problème, ce jour-là, touchait les sœurs de très près. Leur leader, c’était la sœur Jo-anne. nous avons donc procédé au vote. Bobby Seale a dit aux sœurs, comme il le faisait toujours, qu’elles ne pourraient pas voter. C’est alors que nous nous sommes rendu compte que nous avions là un nouveau dilemme à résoudre. Nous avons voté et disculpé le gars. Nos membres l’ont soutenu. C’était une décision injuste. Jo-anne a bondi, hurlé, elle était furieuse, elle a soutenu le point de vue de ses sœurs, elle a dit qu’elles étaient victimes de la même oppression objective que les frères, qu’elles travaillaient dur comme eux, et que si elles ne pouvaient pas voter, elles ne voulaient pas être membres du parti. Là-dessus elle a quitté la salle. Comment régler ce nouveau problème ? Nous avons couru après la sœur Jo-Anne, nous l’avons ramenée et nous avons commencé à élaborer une ligne politique adéquate.
C’est alors que nous avons jeté les bases d’une réflexion tendant à dépasser le chauvinisme masculin.
Ma femme, qui est une féministe militante, a loué un appartement avec d’autres sœurs. Elles y ont introduit des fusils et adopté un règlement interdisant l’entrée aux hommes. Quand les sœurs avaient des difficultés avec les frères, qu’elles n’avaient pas envie de retourner chez leur mère, elles voulaient se retrouver dans un endroit bien à elles, pour y faire le tour de leurs problèmes.
Je me souviens qu’un soir deux de nos frères se sont bagarrés avec leurs mères. Elle se sont réfugiées auprès des sœurs dans ce fameux appartement. Les deux types voulaient entrer. Quand ils furent sur le point de défoncer la portes elles ont tiré, blessant l’un d’eux. On m’a raconté ça le lendemain et je me suis rendu sur les lieux. J’y ai trouvé ma femme et j’ai dit « Bon sang de bon Dieu, qu’est-ce qui se passe ici, pourquoi avez-vous tiré sur ce type ? Elles ont déclaré qu’elles étaient là chez elles, qu’elles n’entendent pas être envahies. J’ai répondu : « Mais moi, vous me laisserez bien entrer ? » Et elles : « Tu ne mettras pas les pieds ici sans notre autorisation. » Kathleen avait un fusil que je lui avais acheté et figurez-vous qu’elle s’est ruée sur moi : pour elles, c’était une question vitale, une question de principes, mais moi, je ne m’en rendais pas compte. J’étais sur le point de pénétrer de force, mais quand Kathleen a brandi son fusil vers moi, j’ai pigé. Et je l’ai supporté.
Y a-t-il quelque chose, dans l’émancipation de la femmes que vous ne puissiez pas tolérer ?
Les hommes ont eu tort pendant si longtemps que je soutiens les femmes même quand elles ont tort à leur tour. Mais quelquefois ma femme me dit : « Tu as beau parler de l’émancipation de la femme, tu es biologiquement incapable de l’accepter pleinement. » Tout de même, je pense que j’y participe d’une certaine façon. D’ailleurs ce n’est pas un problème de femmes, c’est un problème entre hommes et femmes... Ceci dit, les sœurs m’ont mis dans des situations bien embarrassantes. Comme lorsqu’elles ont décidé d’employer contre nous les mêmes tactiques que nous employions contre les flics (encore une initiative de Kathleen !) « Si un frère se met à brutaliser une sœur, eh bien ! nous le tuerons ! » Moi, je suis contre ces brutalités, bien entendu, mais étant donné la situation je n’avais pas non plus envie de perdre une bonne Panthère. Il fallait donc trouver une solution car elles en étaient arrivées au point où elles s’apprêtaient à descendre des mecs qui giflaient leur mère. Elles avaient peut-être raison, je ne vois pas pourquoi un type se permettrait de gifler sa vieille mère, quoique j’en aie fait autant moi-même. Mais j’ai plaidé auprès des sœurs, je leur ai demandé d’avoir un peu plus de considération. C’est ce genre de chose qui me fout en rogne. Mais dans l’ensemble on peut dire que je soutiens plutôt les femmes. J’ai donc trahi le sexe masculin.
L’individu ― noir, notamment ― souffre du racisme, de l’impérialisme et de l’ exploitation de classe. Mais pensez-vous que ces souffrances se situent toutes sur le même plan.
L’individu est une totalité qu’on ne peut pas découper en tranches. Mais on peut remédier à certains maux plus facilement qu’à d’autres. Par exemple, on peut, en supprimant l’exploitation économique, effacer la souffrance qui en découle. Mais il y a d’autres souffrances, comme celles qui découlent du racisme, qui vous déglinguent un homme psychologiquement au point que rien, peut-êtres ne pourra le soulager. Pourtant les deux souffrances sont inséparables puisque le racisme n’est qu’une tactique qu’emploie le capitaliste pour renforcer l’exploitation économique. Supposons que vous traîniez à vos pieds des chaînes et un boulet de fer. Vous vous apercevez que ce n’est pas le boulet mais l’anneau de fer qui laisse une marque autour de votre cheville. Le boulet, c’est, disons, l’impérialisme et toutes les formes d’exploitation économique ; et l’anneau, c’est le racisme, c’est lui qui laissera une cicatrice. Mais ce sont le boulet et la chaîne qui vous tiennent prisonnier.
Votre lutte, en s’étendant, se fondra-t-elle dans le mouvement socialiste international ou dans un mouvement international d’émancipation des hommes de couleur ?
Ce pourrait être aussi bien l’un ou l’autre. Le mouvement socialiste international se trouve actuellement dans une situation désespérée. D’un côté vous avez l’Union Soviétique révisionniste et, de l’autre, la Chine dogmatique. En ce qui me concerne, les deux camps se valent. Les Chinois ont érigé un véritable mur idéologique, de sorte qu’il n’est plus possible d’accrocher avec eux, ni d’ailleurs avec les Soviétiques, qui ont piétiné tous leurs principes idéologiques. Le conflit qui oppose l’Union Soviétique et la Chine a poussé les Russes à adopter des positions « blanches » de plus en plus racistes. Les positions chinoises sont également xénophobes. La seule position qui me paraisse acceptable, c’est celle du camarade Kim Il Sung en Corée du Nord. Seuls les peuples non encore libérés sont fidèles au marxisme-léninisme authentique et révolutionnaire.
Les Nords-Coréens ont subi, outre l’agression américaine et peut-être japonaise, des agressions idéologiques de la part des Chinois et des Soviétiques. C’est pourquoi ils ont dû adopter un système de défense idéologique, et une position très critique vis-à-vis de certains marxistes-léninistes qui cherchent à les dominer. J’étais en Corée du Nord, où j’ai assisté à une conférence de journalistes. De nombreux Coréens nous ont demandé avec insistance d’attaquer vigoureusement les révisionnistes et les dogmatiques. Eux ne pouvaient le faire, mais ils tenaient à ce que ces choses soient dites. Tous les peuples opprimés sont dans le même cas. Les Vietnamiens, et de nombreux mouvements de libération d’Afrique et d’Amérique latine ne peuvent pas dire publiquement ce qu’ils pensent de ce merdier. Nous, nous ne recevons d’aide de personne, alors nous pouvons y aller...
Y a-t-il, selon vous, un risque que Kim Il Sung fasse l’objet d’un culte de la personnalité ?
Ce culte existe déjà, selon une opinion très répandue. Personnellement, je ne vois pas pourquoi les gens n’accrocheraient pas à un leader charismatique, surtout s’il s’agit d’un homme juste. Sinon, c’est évidemment déplorable. En Corée, nos interlocuteurs invoquaient Kim Il Sung à tout propos. A propos de pommes, ou de tasses de thé, de n’importe quoi. Mais il faut comprendre que c’est pour eux un moyen de maintenir l’unité, que le camarade Kim Il Sung est le fondateur de son pays, et après tout il ne vivra pas éternellement...
Les Nords-Coréens pratiquent-ils la démocratie socialiste ?
Nous n’étions pas là assez longtemps pour savoir si tout le monde était satisfait, si la volonté de chacun pesait sur toutes les décisions. Mais la Corée du Nord est dans une situation critique, les gens y sont mobilisés pour une guerre qui peut éclater à tout moment. Les États-Unis ont 60 000 hommes en Corée du Sud, sans parler de l’armée fantoche de 600 000 Coréens. Vivant sous cette menace, les Nord-Coréens ne s’amusent pas à garantir le droit de chacun à soulever une question de forme à chaque réunion. Il faut y penser quand on critique les régimes socialistes. Tous sont occupés à se défendre contre le capitalisme et l’impérialisme qui constituent des dangers immédiats. C’est pourquoi nulle part le socialisme n’a encore eu sa chance.
Dans quelle mesure le mouvement américain peut-il compter sur l’aide des P.C. américain, soviétique, chinois, ou cubain ?
Nous ne comptons pas sur eux du tout. Nous estimons qu’ils sont en retard sur nous. Longtemps, nos rapports avec le P.C. américain ont été désastreux. Le P.C.A. s’est intéressé à nous parce que nous avons su accrocher les gens, et lui n’était pas dans le coup. A une certaine époque nous avons empêché des communistes blancs et noirs de participer à nos activités ; il a fallu les attaquer, les dénoncer dans notre journal, pour qu’ils changent leur conduite à notre égard. Aujourd’hui les Panthères Noires et le P.C.A. collaborent dans une certaine mesure. Mais personnellement je ne peux pas leur pardonner ni oublier ce qu’ils ont fait. Ils ont une déformation idéologique congénitale qui fait qu’ils sont toujours en retard sur les événements. Pour moi, leur marxisme n’est pas un marxisme autochtone, il est sans rapport avec la situation aux États-Unis.
Le P.C.A. nous a contesté le droit d’adopter le marxisme-léninisme sans son approbation. Comme s’il avait le monopole de la doctrine. Il arrivait à nous faire croire que nous l’avions volée.
Quant au mouvement contestataire américain en général, il est en train de nouer avec le marxisme-léninisme. Il n’est pas encore structuré, on ne trouve pas en son sein des partis marxistes-léninistes de type traditionnel, mais on y trouve une certaine compréhension des principes marxistes-léninistes, et on est à la recherche de formes nouvelles adaptées à la situation du moment.
Le parti des Panthères Noires, lui, était déjà structuré quand il a adopté le marxisme-léninisme. Parce que nous en avions besoin. Quand il a fallu enseigner à nos masses les principes marxistes-léninistes, nous avons eu recours à des ouvrages soviétiques. Bientôt toutes sortes d’attitudes révisionnistes sont apparues au sein de notre parti. Alors nous avons cessé de diffuser ces livres, nous nous sommes mis à les récrire nous-mêmes ; et puis nous avons puisé à des sources plus variées, si bien qu’encore aujourd’hui certaines analyses de Kim Il Sung nous semblent plus utiles que celles de certains révisionnistes.
Où puisez-vous votre théorie révolutionnaire ?
Ma foi, nous n’avons plus tellement besoin de la chercher ailleurs parce que nous sommes en train d’élaborer notre petite théorie à nous. Au point où nous en sommes, nous ne pouvons compter sur personne d’autre. L’important est que notre parti ait pu former ses propres théoriciens.
Quelles analyses de Kim Il Sung avez-vous trouvée particulièrement à propos ?
Les Coréens demandent à chacun de compter lui-même ; ils justifient l’autonomie de chaque parti et l’invitent à se défendre idéologiquement contre la domination traditionnelle du mouvement socialiste mondial. Ils affirment que seuls ceux qui sont directement impliqués dans le combat ont le droit d’en forger l’idéologie. C’est là un point très important quand on pense aux P.C. chinois et soviétique qui préconisent l’unité idéologique de tous les P.C. sous leur coupe, et l’adoption, par tous, d’une certaine ligne idéologique.
Kim Il Sung, lui, place le parti sous la responsabilité de ceux qu’il représente. Il est conscient du danger qu’il y aurait à s’inspirer aveuglément des expériences d’autrui.
Le schisme sino-soviétique a-t-il affecté les mouvements de libération américains ?
Jadis les marxistes-léninistes américains étaient les gens les moins racistes du pays. Aujourd’hui, c’est différent. Face à la menace chinoise, l’Union soviétique se lie chaque jour davantage aux pays capitalistes et les arguments qu’elle emploie pour justifier ce rapprochement font leur chemin jusqu’aux États-Unis. Le P.C. américain devient de plus en plus blanc, voire raciste. Les Panthères Noires, elles, prennent la direction opposée. Nous essayons de dépasser le stade du chauvinisme noir pour nous lier aux révolutionnaires blancs.
Quant aux Juifs américains, ils deviennent de plus en plus nationalistes. Je veux dire qu’ils s’identifient à Israël. Or, nous autres Noirs, nous sommes appelés à prendre les armes contre d’autres Noirs. Pourquoi les Juifs n’en feraient-ils pas autant entre eux ? Mais ils sont englués dans leur interprétation sentimentale de l’histoire contemporaine, ils ont recours aux os des victimes d’Hitler pour justifier le fait qu’ils sont en train d’amonceler les os du peuple palestinien.
Les Panthères Noires se sont déclarées solidaires des guerilleros palestiniens, n’est-ce pas ?
Nous ne sommes pas entièrement satisfaits de notre position là-dessus parce que nous sommes mal informés. Mais il nous suffit de savoir qu’Israël est soutenu par l’impérialisme américain pour conclure qu’il nous est absolument impossible de soutenir Israël. D’autre part, nous estimons que le droit est du côté de ceux qui ont été chassés de leur terre.
Pour en revenir aux États-Unis : les Panthères Noires ont déclaré qu’elles entendaient prendre le pouvoir en Amérique. Mais il me semble qu’au départ elles voulaient seulement s’emparer du pouvoir dans les communautés et les quartiers noirs.
Oui, mais nous avons dépassé ce stade. Au début, certes, notre mouvement s’est attaqué aux griefs spécifiques de la communauté noire. Nous n’entendions pas négliger pour autant ceux du prolétariat américain dans son ensemble. Il se trouve que ceux des Noirs étaient prioritaires. Mais c’est justement en nous attaquant à ceux-là que nous avons ouvert de plus larges perspectives, et débouché sur le terrain de la lutte de classes, où nous nous plaçons maintenant, plutôt que sur celui de la lutte purement ethnique.
En d’autres termes, vous contestez toutes les structures du pouvoir en Amérique ?
C’est très clair pour nous maintenant. Et c’est une bonne chose. Parce que nous avons perdu beaucoup trop de temps, d’énergie et de sang à lutter, non pas contre ces structures, mais contre leur façade, leur masque. Je pense, par exemple, à la doctrine « séparés mais égaux » dont les Noirs ont fait leur cheval de bataille pendant 50 ans. Tant qu’on se battait sur ce terrain-là, on ne pouvait même pas commencer à aborder les problèmes de fond. Mais je crois que cette phase de la lutte est bel et bien révolue.
Vos ennemis sont sans doute les hommes les plus riches et les plus puissants de la terre. Qu’avez-vous à leur opposer ?
Vous faites là un raisonnement quantitatif qui ne mène pas bien loin. Même avec un million de dollars, un grand capitaliste tout plein de graisse n’est jamais qu’un grand capitaliste tout plein de graisse. Il tient sa puissance des gens qu’il arrive à tromper et à manipuler. Or, il y arrive de plus en plus difficilement. On est en train de circonvenir ses mass media, en organisant d’autres circuits. Ainsi, on mord sur le système de manipulation. Au sein de l’armée, le processus de pourrissement et de décomposition va en s’accélérant, notamment parmi les appelés Noirs. Au point que le général Westmoreland, chef d’état-major des forces armées, a dû ordonner une enquête sur l’influence des Panthères Noires dans l’armée... Non, ce qui compte, ce ne sont pas les dollars ni les ressources, ni les biens possédés, ni les trusts, c’est ce que les gens pensent et ce qu’ils font. Quelles que soient ses ressources, un vieux porc au Congrès n’est jamais qu’un vieux porc, et s’il n’est pas entouré de gorilles armés qui le protègent, on peut toujours s’introduire auprès de lui et lui tirer les oreilles Ce qu’il nous faut, à nous, ce sont des hommes en armes. Les armes elles-mêmes ne coûtent pas tellement cher.
Vous aspirez donc, d’une certaine manière, à vous emparer du pouvoir. Supposons que vous soyez sur la bonne voie. Comment distinguerez-vous, en cours de route, vos vrais amis des faux ?
Sont nos amis ceux qui sont d’accord pour transformer le monstre qu’est actuellement l’économie américaine, en une économie socialiste où les moyens de production seront entre les mains du peuple.
A votre avis, que va-t-il se passer dans l’immédiat, en Amérique ?
Vous voulez dire dans le camp ennemi ? Eh bien ! je crois qu’ils vont aller jusqu’au bout de la démence, que la décision a déjà été prise. J’en suis certain parce que Richard Nixon, je le connais, voyez-vous, je sais que c’est une bête féroce, et folle en plus. Peut-être même que la décision de détruire le monde a déjà été prise. Nixon, en est bien capable, il est même assez fou pour s’imaginer qu’il pourrait réussir. C’est pour cela que l’avenir se présente à nous comme une course contre la montre. Il faut compter à la fois avec leur capacité de destruction et avec leur folie ; et ils n’ont pas l’intention de capituler. C’est pourquoi la révolution américaine est tellement importante, pourquoi nous devons à tout prix en rapprocher l’échéance. Beaucoup de gens à l’étranger s’imaginent que l’Amérique est une forteresse ; mais ceux qui la connaissent de l’intérieur savent bien qu’elle n’est qu’un squelette dans une armure. L’Amérique est très vulnérable de l’intérieur. S’il se trouve assez de gens pour le comprendre et pour agir en partant de là, on pourra peut-être éviter la catastrophe. Sinon, je crois bien que 1’Amérique entraînera la terre entière dans le néant. Dans certains milieux, même chez les militaires, il y a des gens de gauche qui perçoivent le danger, qui seraient même prêts à défier le gouvernement. Il suffirait de créer les conditions dans lesquelles ils pourraient agir. Mais seule l’action des masses pourra faire éclater les contradictions qui existent dans ces milieux-là.
Et quelle sera pour vous la prochaine étape ?
Pour moi personnellement, le retour aux États-Unis. Au point de vue pratique, la seule chose qui m’intéresse, c’est la guerre ; parce qu’au point où nous en sommes c’est tout ce qui nous reste de valable. Je ne parle pas de la lutte armée comme d’un passe-temps ou d’un job à temps partiel. J’entends par là un mouvement total, et qui prend déjà de l’ampleur. Les tribunaux sont à l’heure actuelle notre principal obstacle. Nous savons tous que l’appareil judiciaire américain est un instrument d’oppression et pourtant nous continuons, même nous les Panthères Noires, à jouer son jeu. Mais à voir la façon dont il fonctionne actuellement, je crois qu’il n’en a plus pour longtemps. Quand il sera bel et bien mort, la guerre pourra commencer sérieusement.
Croyez-vous vraiment que la lutte pour la libération des Noirs aboutira à une révolution américaine ?
Seule la révolution pourra nous libérer. En ce moment les Noirs américains traversent une phase comparable au néo-colonialisme que vous voyez à l’œuvre dans les anciennes colonies. Depuis que Nixon a énoncé sa doctrine du capitalisme noir, on a sciemment déversé des millions de dollars entre les mains de la bourgeoisie noire, on a sciemment privilégié des hommes de paille issus de ses rangs. On commence à intégrer la bourgeoisie noire à la classe dirigeante, à lui donner certaines assurances, certaines garanties qu’elle réclame. C’est pourquoi le moment est venu de s’attaquer au système dans sa totalité*.
* L’interview d’Eldridge Cleaver comme le manifeste des Weathermen expriment admirablement les perspectives de lutte qui sont aujourd’hui celles des révolutionnaires nord-américains. Ces deux textes contiennent cependant un certain nombre d’affirmations, notamment à propos d’Israël, que les Temps Modernes ne reprennent pas à leur compte.
(Traduit de l’anglais par Anne Guérin)
Février 1970.
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (742.9 ko)