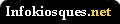N
Le nouveau mouvement ouvrier américain
Extraits de "Spartacus", 1973
mis en ligne le 7 juillet 2008 - Paul Mattick, Jr. , Peter Herman
AU CŒUR MEME DU PAYS : LA GREVE DE LORDSTOWN
Quand vous traversez en voiture les espaces cultivés de l’Ohio, en prenant l’autoroute entre Youngstown et Claveland, vous découvrez soudain une énorme usine, s’étalant sur presque un mile le long de la route. Cette vision surprenante est le grand complexe industriel de la General Motors, dont la construction a coûté plus de 100 millions de dollars en 1966, et qui emploie plus de 13000 personnes. Il comprend une usine de production des carrosseries Fisher, une usine de montage Chevrolet et une usine de camions Chevrolet ; le complexe de Lordstown fabrique principalement la plus petite des Chevrolets : la Vega. Il a la chaîne de montage la plus rapide et la plus automatisée du monde, qui produit plus de 100 voitures à l’heure. Des techniques parmi les plus avancées quand à l’efficacité de la production ont été intégrées lors de sa construction. Tous les travaux sont décomposés ; de nouveaux robots-soudeurs y ont été installés. La GM a pu fièrement annoncer que Lordstown représentait l’usine du futur. Ils s’attendaient peu à ce qu’en quelques années Lordstown devienne le symbole national du mécontentement des cols-bleus [1].
Quand j’ai demandé à des ouvriers pourquoi ils travaillaient à Lordstown, j’ai toujours eu la même réponse : « Le boulot n’est pas drôle, mais ça rapporte ». La GM a construit cette usine dans une région où la plupart des ouvriers travaillaient dans les usines et aciéries des entreprises Youngstown-Akron de l’acier et du caoutchouc ; les conditions y étaient difficiles et la paye et les avantages sociaux relativement faibles. La GM n’a pas eu de mal à recruter des travailleurs ; même des hommes âgés abandonnèrent avec plaisir les années d’ancienneté accumulées aux aciéries pour aller travailler à Lordstown, où les conditions de travail étaient meilleures et la paye plus élevée. Bien que la GM paye des salaires qui, pour un travail non qualifié, sont relativement élevés (un travailleur se fait, au départ, environ 111000 dollars par an), peu de travailleurs à Lordstown ont de grosses économies ou une quelconque sécurité financière. Beaucoup d’entre eux rêvent de quitter leur travail et de se mettre à leur compte, mais la plupart de le peuvent pas. Un travailleur m’expliqua que : « La GM a une façon très particulière d’attirer les gens : un type s’amène et trouve un boulot, et il se fait plus d’argent là qu’il n’en a jamais fait avant dans sa vie ; au début ça fait vraiment quelque chose - on se retrouve avec beaucoup d’argent en plus. Mais, vous savez comment c’est, on regarde la télé, ils font de la publicité : on doit avoir ci, on doit avoir ça - et assez vite ce monsieur se met à dépenser comme Monsieur Millionnaire. Et là, si on travaille à Lordstown, on a le crédit tout de suite. Il a eu son crédit et très vite et s’est retrouvé avec plein de choses sur les bras. Je connais un type qui travaille avec moi, ça fait un an qu’il est marié. Il a acheté une maison de 16.000 dollars, et, sur un prêt de trente ans, avec les intérêts et tout ça, ça lui revient à 48.000 dollars. Et puis il a dû emprunter un millier de dollars pour sa voiture, il lui a fallu acheter à sa femme une machine à laver et une sécheuse, il a les factures de meubles, et par dessus le marché, ils ont eu un petit bébé, et bon dieu, en plus ils ont une trentaine de poissons rouges. Il dit qu’il a trente huit personnes à charge, et qu’il doit gagner de l’argent autant qu’il peut » [2].
Un ouvrier comme celui-là, bien sûr, ne dépense pas vraiment comme Mr Millionnaire. La plus grande partie des dépenses d’un jeune couple est incompressible et dans une économie en inflation comme celle de ces dernières années, pendant lesquelles les salaires réels des ouvriers ont baissé, les salaires donnés à Lordstown sont à peine suffisants à une famille pour pouvoir subvenir à ses besoins sans trop de privations ; beaucoup de travailleurs en fait, ne gagnent pas assez d’argent pour payer leurs factures. Pour faire face à ce problème, beaucoup de femmes travaillent, et, comme il faut quelqu’un pour s’occuper des enfants, souvent l’homme travaille la nuit, et la femme le jour.
Un ouvrier m’a décrit sa situation familiale : « Je n’arrive jamais à voir ma femme. Quand je sors, elle rentre, et quand je rentre, elle sort. Nous faisons de petites réunions pour régler les problèmes, et parfois elles prennent plus de temps qu’il ne faudrait. La semaine dernière, on m’a fait une observation parce que j’étais en retard au travail. J’ai dit au contremaître qu’il avait fallu que je discute un problème avec ma femme, et il m’a répondu : « Ecoute, ici c’est du sérieux. On n’a pas le temps pour ça. Rien à faire de vos problèmes de couple ».
La plupart des travailleurs sont emprisonnés par leur travail à Lordstown parce qu’il leur est impossible de trouver un travail ou un salaire meilleur ailleurs. C’est cet argent qui leur permet de supporter la monotonie mortelle d’une même opération répétée sans cesse et la vitesse inexorable de la chaîne qui ne permet aucun changement de cadence - 10 heures par jour à faire le même travail. Une cadence de 100 voitures par heure signifie que l’ouvrier doit répéter son opération toutes les 36 secondes. La « Vega » elle-même devient un objet haï. Peu de travailleurs ont des Vegas et la plupart en parlent de façon négative. Un ouvrier décrit ainsi ce qu’il pense du travail à Lordstown : « On le fait automatiquement, comme un singe ou un chien ferait quelque chose par conditionnement. On se sent sans vie ; chaque chose est répétée encore et encore et encore. C’est comme si tout ce qu ’on allait faire c’est travailler, et comme si le seul but de la vie était de faire cette opération, et quand on rentre chez soi, on est si fatigué d’avoir passé toutes ces heures à essayer de garder la cadence de la chaîne qu’on a l’impression qu’on n’avance pas d’un pouce. Ça fait que l’individu moyen se sen t à peu près comme une loque ».
Ce qui se passe lors du changement d’équipe témoigne bien de la haine qu’ont les ouvriers pour leurs conditions de travail. Les hommes de l’équipe qui va commencer traînent autour de leur voiture dans le parking ou flânent doucement vers l’usine. A l’opposé les ouvriers qui ont fini se précipitent hors de l’usine, sautent dans leurs voitures, et s’en vont à toute vitesse, en faisant fonctionner leurs klaxons et grincer leurs freins.
L’AUTORITE ET LA PEUR
Il y a quelques années, des magazines importants (comme Life et Newsweek) ont publié des articles de fond sur le travail sur les chaînes de montage. Quand ils ont essayé d’expliquer pourquoi les ouvriers étaient mécontents dans des endroits comme Lordstown, ces journaux ont insisté sur la monotonie et l’ennui du travail sur les chaînes de montage. Les travailleurs étaient traités plutôt avec sympathie, mais même ainsi, l’interprétation était superficielle. La clef réelle du mécontentement ouvrier est le système de relations de domination dans lequel se trouvent les ouvriers, tout un ensemble de structures interdépendantes de pouvoir et de domination, à la fois de la direction et des syndicats, structures qui sont faites pour les rendre isolés et sans pouvoir, et qui renforcent l’ennui et la monotonie du travail lui-même. Le premier symptôme de ces relations est le climat de peur qui règne à l’usine. Un travailleur dit : « Toute l’usine marche à la peur. Le type qui est à la tête de cette usine a peur de quelqu’un qui se trouve à Détroit. Et le type en-dessous de lui a peur de lui, et tu sais, ça descend tout droit jusqu’aux contremaîtres, et les contremaîtres ont vraiment une peur bleue. Et comme ils ont une telle peur, ils s’acharnent sur les gens, et les gens ont une peur bleue parce qu’ils craignent de perdre leurs boulots. Et ils savent que s’ils ne font pas le boulot, ils perdent leur emploi, à cause de ce syndicat idiot... Moi je vous le dis, ces types là, ils pensent qu’ils ont un super syndicat, mais il ne fait rien en fait. »
Ces sentiments de peur sont endémiques à tous les niveaux de l’usine, mais la distinction de la structure de pouvoir est fondamentale et s’étend à des domaines aussi banals apparemment que des places de parking séparées, des endroits pour manger et des tenues vestimentaires distinctes. Pour un directeur, même assez « bas », la corporation est « nous » ; pour un ouvrier, la GM, c’est « eux ». Quand j’ai demandé à un contremaître (ce qui est un travail assez bas) ce qu’il faisait quand il recevait une mauvaise directive d’un membre plus élevé de la direction, il a bien expliqué cette distinction : « Un contremaître, en tant que membre de la direction, doit accepter cette décision, il est partie prenante de la décision, et il ne peut pas laisser les ouvriers savoir qu’il est d’accord avec eux. S’il est d’accord avec les ouvriers, il est fini comme contremaître, il a perdu la balle pour ce qui est de conduire son travail de membre de la direction de façon satisfaisante. S’il est d’accord avec les ouvriers, il ne peut certainement pas le leur laisser voir. Il y a eu beaucoup d’occasions dans lesquelles mon coeur a plutôt penché du côté d’un ouvrier que je devais sanctionner, quand je devais faire quelque chose de déplaisant, mais je devais le faire, et je pensais dans ma tête que c’était mon travail, que j’étais partie prenante de la décision, et que c’est comme cela que cela devait être. »
Pour un travailleur à la chaîne, accepter d’être promu contremaître, c’est traverser la ligne de pouvoir de « nous » à « eux ». Un ouvrier, qui a été contremaître à Lordstown jusqu’à ce que, dégoûté, il abandonne, m’a expliqué à quoi ça ressemblait : « Après avoir accepté une place de directeur en formation, je suis vraiment arrivé à comprendre à quel point le personnel de direction agissait de façon malhonnête ; parce qu’ils avaient accepté que j’aille assister à leurs cours pour apprendre ce qu’ils attendaient de moi, et comment s’y prendre pour diriger ces « idiots sans cervelle » sur la chaîne, ces « gens qui agissent mécaniquement », vous savez, « n’importe qui peut faire le travail que ces idiots que nous avons là-bas font », « si on entraîne un singe on pourra l’envoyer là-bas - ce genre de discours qu’ils m’ont tenu pour montrer que je valais plus que le type qui travaillait sur la chaîne. Ces cours ont tenté de m’apprendre comment je pouvais provoquer quelqu’un tout en restant calme moi-même. Je ne pouvais pas le croire. Il y avait là des contremaîtres tout à fait mûrs, qui m’apprenaient des tactiques dignes de la Gestapo ».
Le mode de vie habituel de Lordstown c’est le règne de l’autorité. En entrant au parking, on voit un panneau immense indiquant que c’est une propriété privée, que la GM dégage toute responsabilité quant aux préjudices que quelqu’un pourrait encourir, et que le parking est surveillé par un circuit interne de télévision. J’ai parlé avec un des cadres de la direction, et je n’ai pas été étonné de voir, au dessus de son bureau, un portrait de Napoléon me fronçant les sourcils de son mur. Si les ouvriers arrivent en retard, ils peuvent recevoir une mise à pied disciplinaire dont la durée peut aller du restant de la journée à une semaine. Le contremaître peut donner un « Ordre Direct Formel », auquel le travailleur doit obéir s’il ne veut pas encourir une sanction disciplinaire pour insubordination. Un travailleur doit avoir la permission de son ou sa chef pour quitter la chaîne pour aller aux toilettes, et le contremaître peut facilement traîner à accorder une telle permission. Les gardiens armés vous demandent à chaque porte de montrer votre carte d’identification en plastic. Un ouvrier de Lordstown a fait très justement remarquer que, en travaillant à l’usine, il « en était arrivé à réaliser que les dictateurs ne sont pas tous dans les pays communistes. Le complexe de Lordstown est lui-même une dictature, un petit monde en soi, et tout ceux qui s’y trouvent tombent sous ce régime de dictature ».
Le comportement des syndicats aggrave l’impuissance de l’ouvrier sur la chaîne. Si un travailleur a une plainte à faire, par exemple contre un contremaître, il ne doit pas déposer sa plainte lui-même, mais il doit demander à ce même chef d’appeler le délégué syndical. Ce fait en lui-même empêche souvent que les plaintes soient rédigées, parce que le contremaître peut très bien par la suite en vouloir à l’ouvrier.
Une fois que le délégué a été appelé, l’ouvrier « plaignant » n’a plus qu’à se mêler de rien dans l’affaire ; celle-ci passe par la « procédure des plaintes » qui est extrêmement bureaucratique et lente à fonctionner. Le cas met souvent plusieurs mois avant d’être réglé, temps au bout duquel le motif de la plainte a souvent perdu toute importance. Un travailleur dit : « Il n’y a rien de pire que quand on appelle son délégué, qu’il vient, écrit quelque chose sur un bout de papier et puis s’en va ; c’est la dernière fois qu’on entend parler de lui - et c’est toujours vous qui restez là à faire le boulot ».
LA COLLUSION SYNDICAT-PATRONNAT
Les racines de la situation actuelle entre la compagnie, le syndicat et les ouvriers de base à Lordstown, sont à rechercher profondément dans l’histoire du travail aux USA [3]. Dans les grandes grèves sur le tas des années 30, le syndicat, en échange du droit d’être reconnu comme représentant des ouvriers pour discuter dans les négociations des contrats et des grèves, a accepté de sanctionner les travailleurs qui s’engageaient dans des actions de grèves sauvages sur le tas ou qui cherchaient à prendre un certain pouvoir sur le processus de production. Ce marché a été jugé inacceptable par de nombreux ouvriers, et il y a eu une vague importante de grèves sur le tas pendant l’été 37, juste après que l’accord sur les négociations collectives ait été signé par la GM et le syndicat. Pour une fois les ouvriers sont arrivés à contrôler la cadence de la chaîne. Le syndicat a combattu ces actions et a réussi à contrôler la situation. Les mesures prises alors furent décrites dans le New York Times :
« 1. Dès qu’une grève sauvage arrive ou menace d’arriver, des responsables nationaux ou des représentants de la UAW sont envoyés précipitamment sur place pour terminer ou empêcher la grève, remettre les ouvriers au travail et amener un règlement dans l’ordre des revendications.
2. Des ordres stricts ont été donnés à tous les organisateurs et représentants qu’ils seraient renvoyés s’ils autorisaient des arrêts de travail sans l’accord des représentants nationaux, et que les unions locales des syndicats ne recevraient pas d’argent de la direction syndicale si la production était, sans autorisation, stoppée ou empêchée.
3. Les délégués sont formés pour appliquer la procédure de règlement des conflits établie dans le contrat de la GM, et un système est mis en place, dont les syndicats croient qu’il convaincra les ouvriers de base de l’inutilité des grèves. » [4]
Ainsi, depuis le tout début, le syndicat a été d’accord pour marcher la main dans la main avec la GM en acceptant de sanctionner les ouvriers qui agissaient par eux-mêmes, où qui revendiquaient des choses non reconnues dans le contrat, en particulier le droit de dire son mot dans les décisions prises concernant la production.
Pendant le grand boom de l’industrie automobile qui eut lieu après la Seconde guerre mondiale, la majorité des membres de l’UAW qui avaient vécu les privations de la Crise, furent d’accord pour discuter afin d’obtenir une part plus grande du gâteau financier. Comme l’industrie se développait rapidement pendant cette période, le patronat pouvait se permettre de faire des augmentations substantielles des salaires et des bénéfices - et en particulier parce que de tels coûts salariaux pouvaient être répercutés sur le consommateur sous forme d’augmentation des prix ; le rôle de l’UAW fut alors accepté sans plaisir. Après la signature du contrat de 1955, tout le pays a connu des grèves sauvages sur des problèmes locaux de conditions de travail ; pendant ces grèves l’UAW a réprimé les sections les plus combatives et établi un système incluant les conditions de travail dans les négociations au niveau local, pour mieux contrôler les revendications des ouvriers de base.
Pendant la « grève » de l’UAW contre la GM en 1970, la collusion patronat-syndicat a été évidente. Pour la GM et le syndicat, le but de cette grève longue et coûteuse était, selon le Wall Street Journal, d’« essayer d’éroder les espoirs des membres du syndicat », « de créer une soupape pour laisser sortir les frustrations des ouvriers dues à leurs conditions de travail qu’ils jugent intolérables » et de« renforcer la position des dirigeants syndicaux » [5]. La GM en retour espérait que la grève stabiliserait la main-mise du syndicat sur les ouvriers et qu’elle « achèterait la paix des années à venir » Comme les négociations locales prolongeaient la grève au delà de la période prévue par le syndicat, la GM a prêté à l’UAW 30 millions de dollars pour l’aider à régler ses frais d’allocations de grève et engagea des discussions secrètes avec la direction syndicale pour l’aider à régler ce qui menaçait de devenir « une grève foutoir dont les dirigeants avaient perdu le contrôle. » [6]
Pendant les années 1970-72, l’industrie automobile américaine, malgré sa grande richesse marchait avec de grandes difficultés. Les profits et les ventes étaient peu élevés ; il y avait une importante concurrence étrangère sur le marché intérieur. Au total, l’industrie ne marchait qu’à 80% de son potentiel productif. Dans de telles conditions, alors que les plus importants investissements en capitaux étaient faits avec réticence, il y eut de gros problèmes pour justifier les 100 millions de dollars déjà dépensés pour Lordstown. Pendant la dépression de 1970, l’usine fut transformée pour construire la nouvelle Chevrolet Vega, un petit modèle de voiture conçu pour contrebalancer la montée de la concurrence japonaise (Toyota, Datsun) sur le marché américain. Le complexe de Lordstown - carrosseries Fischer et montage Chevrolet - construisait la Vega du début à la fin et était censé être assez efficace pour pouvoir produire toutes les Vegas pour l’ensemble des Etats-Unis. Etant donné la stagnation de l’industrie automobile, le moyen le plus simple que les sociétés automobiles avaient de maintenir des profits élevés était d’augmenter la productivité du travail. Les chaînes de Lordstown ont été conçues avec précisément ce genre d’efficacité en tête. Le but était de réduire les mouvements inutiles des ouvriers à un minimum absolu, et ainsi d’éliminer de chaque tâche chaque seconde de temps perdu. On a estimé que si chaque travailleur de Lordstown travaille une seconde de plus par heure, la GM en un an, augmentera ses profits de deux millions. L’effet de la technologie « avancée » à Lordstown est donc d’augmenter l’intensité et le rythme du travail du monteur. Lordstown est un exemple parfait de Taylorisme.
DECOURAGEMENT, ABSENTEISME, SABOTAGE
Après la transformation de la chaîne pour construire la Vega, la GM a voulu essayer de tester la capacité productive maximum de l’usine ; elle a augmenté la cadence de la chaîne de 60 voitures à l’heure au chiffre jamais atteint de 100 voitures à l’heure. Un ouvrier dit : « On travaillait déjà dur, mais ce n’était rien en comparaison de ce que ça a été après l’augmentation des cadences. Le premier jour ils ont sorti une pancarte - « Grande première dans l’histoire de la GM, 100 voitures à l’heure » - Certains anciens de la botte ont applaudi, mais moi j’ai seulement pensé qu’on était fous d’accepter ça. Ensuite ils ont commencé à faire de l’émulation ; ils nous ont dit que la première équipe tournait à 110 voitures à l’heure. Assez rapidement même les anciens ont été dégoûtés de cette merde et ont dit : « Si ceux de la première équipe veulent sortir 110 autos, qu’ils aillent se faire foutre, laissons-les faire. Mais nous on ne va pas le faire ».
En 1971, la situation est devenue critique pour la GM à Lordstown. L’absentéisme, déjà élevé, a beaucoup augmenté, et de nombreux travailleurs ont commencé à laisser passer des voitures sur la chaîne sans y faire leur travail. Il y a aussi eu des cas de sabotage actif. Les ateliers de réparation se sont vite remplis de Vegas, et la « Voiture de l’Année » (selon le Motor Trand) a bien été connue par les acheteurs comme une voiture qui nécessitait de nombreuses réparations. Les ventes ont dégringolé et la Vega non seulement n’est pas arrivée à dépasser la Datsun et la Toyota mais de plus, s’est retrouvée derrière la Ford Pinto. La GM a alors décidé de se durcir et en Septembre 71 elle a annoncé que la totalité de l’usine allait être mise sous la direction du GMAD (General Motors Assembly Divisich - Département de montage de la General Motors) une équipe spéciale de cadres, le mois suivant. L’augmentation de la productivité du travail est devenue la préoccupation majeure de la GM. Ceci explique l’ascension rapide, dans la société, du GMAD qui, depuis sa formation en 1965 a pris la direction de 18 usines et contrôle 75% de toute la production automobile de la GM. La raison d’être du GMAD est la recherche de productivité maximum. Les membres du GMAD ont instauré une émulation entre leurs 18 usines, ce qui implique un relevé quotidien de la productivité et de la qualité de la production de chaque usine par un ordinateur central. Les résultats pour chaque usine sont affichés publiquement. Les bonus et la promotion des membres du GMAD sont proportionnels aux résultats de cette compétition interne, et les pressions que celle-ci exerce sur la direction de chaque usine sont énormes. Ces pressions ont créé, parmi les cadres des usines contrôlées par le GMAD, une éthique de discipline extrêmement dure.
L’annonce de l’imminente prise de contrôle par le GMAD a déclenché une courte grève sauvage à l’usine de production des carrosseries Fisher de Lordstown. En Octobre, la première chose faite par le GMAD a été d’augmenter encore plus la productivité de tout le complexe de Lordstown. Il a renvoyé près de 300 hommes et a réparti leur travail entre les autres ouvriers. Il a aussi introduit de nouvelles mesures disciplinaires très sévères pour tenter de contrôler l’absentéisme et le sabotage. Au lieu de maîtriser les travailleurs, les mesures répressives du GMAD n’ont fait que renforcer leur détermination à ne pas céder. Pendant les premiers mois où le GMAD dirigeait l’usine, plus de 5000 formulaires de plaintes ont été remplis. Le conflit s’est aiguisé ; l’absentéisme, le sabotage et les ralentissements du travail ont augmenté. Le New York Times, de façon significative, a écrit que : « Le syndicat et la direction à la fois ont été surpris de la profondeur de la résistance... chez les ouvriers » et le Président du syndicat local a déclaré qu’il avait été pris une décision de travailler à l’ancienne cadence, non par la direction syndicale, mais par la base » [7].
En fait, les Vegas n’étaient tout simplement pas fabriquées, ou si elles l’étaient -comme le dit un travailleur de Lordstown - « je n’aimerais vraiment pas en acheter une. Ça m’étonnerait vraiment qu’elles tiennent 6 mois ». Le GMAD, déclarant que le manque de discipline des ouvriers rendait toute production impossible a fini par renvoyer les hommes chez eux tous les jours de bonne heure, espérant que de telles baisses de salaire de fait les forcerait à obéir ; mais cette mesure, elle non plus, n’est pas arrivée à maîtriser la résistance. Au contraire, la production est tombée si bas que la situation est devenue vraiment critique pour la direction. Le syndicat local durant cette période a simultanément essayé d’exprimer et de contenir le mécontentement ouvrier. Ce n’était pas la direction syndicale qui avait été à l’origine de la résistance des ouvriers ; elle s’était contentée de faire des déclarations générales de soutien, une promesse de grève, et d’insister sur la nécessité pour les travailleurs de rester dans les limites de la légalité contractuelle. Voici un échantillon des tracts distribués par le syndicat :
1) NOUS N’APPROUVONS PAS LE SABOTAGE
...le Bureau national et votre syndicat local, ensemble, insistent fortement pour que tous ses membres, quelles que soient les provocations faites par la Compagnie,... maintiennent une forte discipline syndicale et mènent la bataille contre la GM de façon légale. Ne vous engagez jamais dans des actions de sabotage. LUTTONS ENSEMBLE ET GAGNONS ENSEMBLE.
2) VOILA DE QUOI IL S’AGIT
LES PROFITS : le GMAD se soucie peu de vos conditions de travail. Ils ont toujours placé le profit avant les valeurs humaines, c’est pourquoi ils ont instauré le règne de la terreur dans les usines.
LA TERREUR : Utilisant des méthodes de terreur hitlériennes, le GMAD espère terroriser les gens de sorte qu’ils tiennent leurs cadences injustes. Ils espèrent pouvoir provoquer une grève sauvage, et ainsi avoir plus d’atouts pour justifier leur programme de terreur. NE VOUS LAISSER PAS ENTRAINER A FAIRE UNE GREVE SAUVAGE ! C’est faire le jeu de la Compagnie. Votre syndicat local prépare en ce moment une grève légale avec le soutien total du syndicat. Votez oui pour la grève. Soutenons ceux qui se battent pour rendre et garder cet endroit décent pour travailler. EN AVANT FRERES ET SOEURS ! EN AVANT !!!
Les ouvriers se rendent bien compte que le syndicat est parfaitement sérieux quand il insiste pour que les gens obéissent aux « lois » établies dans le contrat. Voici l’explication d’un ouvrier : « Vous savez, notre syndicat est un vrai béni-oui-oui. Nous avons un contrat et à la fois la GM et le syndicat sont censés le tenir. Le seul problème c’est que la GM rompt le contrat environ vingt fois par jour, alors que le syndicat respecte le contrat à la lettre. Voyez par exemple, l’autre semaine, les ventilateurs se sont cassés là où je travaille et la température est montée à presque 42 degrés. Notre délégué a prévenu que nous allions enlever nos chemises - ce qui est contre le règlement - s’ils ne réparaient pas les ventilateurs. Je lui ai dit : tu peux enlever ta chemise, tu peux même enlever ton pantalon, mais les voitures continuent à être fabriquées, et on est cinglés défaire ça. Si nous voulons que ces ventilateurs soient remplacés, laissons tous tomber le travail et sortons nous asseoir sur la barrière pendant une heure. Ça fait 100 voitures et ils vont devenir dingues à la direction. Mais le délégué m’a dit qu’il ne voulait même pas entendre parler d’une telle idée. Alors je suis allé vers les autres types et je leur ai dit : sortons nous asseoir une heure, mais ils ont tous dit : est-ce que le syndicat est avec nous ? Quand je leur ai dit que non, ils m’ont dit de laisser tomber. Vous voyez le syndicat ne soutiendra pas 20 ou 30 types qui font une grève sur le tas. Ils les laisseront être virés, et ce n’est rien pour la GM - ils peuvent se permettre de perdre vingt types. Mais pour les gars, c’est leur boulot ! »
De tels refus des syndicats ont un effet extrêmement inhibiteur sur les actions lancées par les travailleurs. Pourquoi le syndicat refuse-t-il de soutenir de telles initiatives des ouvriers pour changer leurs conditions de travail ? Les dirigeants syndicaux se justifient en disant que la procédure des plaintes est là pour s’occuper de tels petits problèmes, et que le syndicat ne peut quand même pas faire mettre en grève une usine de 10 000 hommes sur un problème qui en concerne 30. Ils disent de plus que les arrêts de travail obligent le syndicat à négocier sur des questions de discipline et non plus sur le problème de départ. Le contre argument évident - que les stratégies de luttes possibles ne se limitent pas aux procédures établies - n’a rien à voir ici. Le vrai problème est celui de la nature du pouvoir syndical. Depuis le début de l’accord sur les négociations collectives des années 30 le syndicat a été une sorte de partenaire junion de la Société. Le but poursuivi par le syndicat a été la bonne santé et la bonne marche de l’industrie, sa prospérité et son fonctionnement sans problèmes. En échange d’un accord global sur les salaires et autres avantages, le syndicat s’est engagé à prendre la responsabilité de ce que les travailleurs ne fassent rien pour contester ou empêcher le fonctionnement des usines ou n’importe quel changement dans la production que la corporation jugerait utile de faire maintenir la rentabilité. Le syndicat garantit - comme le dit la formule de la convention collective - le droit de la direction à diriger. Des actions « spontanées » non autorisées de groupes de travailleurs sont des menaces directes pour le syndicat, et naturellement, il ne soutiendra pas de tels groupes de travailleurs quand la compagnie agira contre eux. Dans ce nombreux cas le syndicat cherchera lui-même à sanctionner de tels travailleurs.
LA HIERARCHIE SYNDICALE
La direction locale n’est pas vraiment libre de modifier ces relations de pouvoir. Si un syndicat local soutenait une grève sans avoir le feu vert du Bureau national, il risquerait le retrait immédiat des fonds versés par le syndicat et des menaces de mise sous tutelle, mesure par laquelle le Bureau national déclare la direction locale dissoute, et nomme ses propres dirigeants. Et la direction nationale à son tour, devrait s’assurer que les dirigeants locaux fassent respecter la discipline du travail ; en effet la GM peut faire pression sur le syndicat UAW en menaçant par exemple de refuser de coopérer ou d’aider dans les négociations nationales - comme quand la GM prêta à l’UAW 30 millions de dollars en 1970 - ou encore en menaçant d’exporter les usines de montage hors des USA vers des pays où les salaires sont plus bas (cf. le Président de la Mitsubishi Motor Compagny qui, remarquant que les salaires Japonais étaient le 1/4 de ceux donnés aux USA, demanda récemment : « Est-ce que ce ne serait pas plus profitable pour un producteur américain d’importer des modèles plutôt que de dépenser des sommes énormes à développer ses propres modèles ? » [8].
Ce n’est pas étonnant que, en général, les dirigeants syndicaux soient contents de voir la compagnie renvoyer ceux qui font des grèves non-autorisées. C’est seulement quand les causes de mécontentement deviennent si largement répandues et si aiguës que des actions autonomes des ouvriers menacent d’entraîner une explosion spontanée de toute l’usine, que le syndicat juge qu’il est nécessaire d’agir. En Janvier 72, il est devenu évident qu’une telle situation était imminente à Lordstown. Des milliers de plaintes avaient été remplies, la production avait dégringolé et le sabotage était devenu chronique (moteurs abîmés, revêtements de sièges éventrés, fils arrachés). Le premier février, le syndicat faisait un vote sur la grève. Bien que de nombreux travailleurs aient perdu leurs économies pendant la grève de 1970, et que tous se trouvent en difficulté à cause de l’argent perdu pendant les réductions d’horaire des derniers mois, 85% des membres du syndicat sont venus voter, et 97% ont voté pour la grève. Ces chiffres sont une preuve incontestable de l’ambiance qui régnait alors à Lordstown ; habituellement une grande apathie règne lors des votes syndicaux, et quand 40% des travailleurs viennent voter, c’est déjà bien. Le vote de la grève indiquait que les travailleurs étaient prêts à faire un sacrifice important pour faire quelque chose sur les conditions de travail. Beaucoup de travailleurs - la plupart jeunes et sans expérience militante - croyaient sincèrement les tracts syndicaux qui disaient que la section locale et le Bureau national se préparaient à négocier sérieusement sur les conditions de travail. La direction de la section locale était elle-même jeune et récemment élue. Le Président Gary Bryner, qui n’avait que 39 ans, était un type valable qui faisait des citations du livre The Greening of America [9], tout en promettant de lutter pour « l’humanisation » des conditions de travail. Les travailleurs désiraient sincèrement faire confiance à la section locale et marcher avec elle dans sa stratégie de grève.
Pendant le mois de Février, des représentants de la direction locale et du bureau national, y compris le Vice-Président de l’UAW Irving Bluestone, négociaient avec le GMAD, tout en continuant à insister sur la stricte légalité que devaient respecter les ouvriers : pas de grèves sauvages ni de sabotage. Le GMAD continuait de renvoyer les hommes chez eux plus tôt, empirant par là leur situation économique, puisque, comme ils n’étaient pas en grève, ils ne recevaient évidemment pas de fonds de la caisse de grève. Le syndicat s’est alors trouvé devant un dilemme, il était, autant qu’avant, condamné à demeurer à l’intérieur de sa sphère de pouvoir reconnue. Le GMAD exerçait une pression énorme sur le syndicat pour que celui-ci maintienne sont contrôle sur les hommes, parce que la production baissait. D’un autre côté, le syndicat devait faire face à une base unifiée et en colère qui avait déjà encaissé un grand nombre de sanctions, et qui n’allait évidemment pas simplement continuer à obéir au GMAD, seulement parce que le syndicat le lui demandait.
La stratégie développée par le syndicat a été de faire une grève courte, dans laquelle les problèmes étaient définis de manière précise et égale à la table de négociations et de manière générale et militante dans la propagande syndicale. Au GMAD le syndicat demandait seulement la réintégration des 300 hommes renvoyés lors de la compression de personnel ou par mesure de discipline depuis octobre, et réclamait quelques petites modifications techniques des règles. Ainsi il serait possible pour le GMAD de faire des concessions qui ne signifiaient pas grand chose, en même temps que le syndicat crierait victoire, ce qui serait bon pour le GMAD, si cela avait pour conséquence que celui-ci reprenne le contrôle des travailleurs de l’usine. En bref, si le syndicat « gagnait », le GMAD « gagnait » aussi, le syndicat dans sa propagande, avait demandé à maintes reprises aux travailleurs de cesser d’agir par eux-mêmes, sous prétexte que seule une grève légale était le moyen de résoudre leurs problèmes. Il avait promis que la grève serait un combat pour humaniser les conditions de travail, pour briser le pouvoir « hitlérien » du GMAD, etc, etc... Le syndicat croyait que la grève épuiserait la combativité des ouvriers et pourrait redonner aux dirigeants syndicaux leur rôle de dirigeants. Le syndicat espérait bien sûr pouvoir faire fi de la contradiction, qu’il avait soigneusement évaluée, entre les promesses qu’il faisait aux travailleurs et leurs intentions réelles et, de même, du fossé inévitable entre désirs « utopiques » et objectifs « réalistes ».
UNE GREVE ORCHESTREE
La grève commença le 5 mars. Le jour suivant le New York Times reportait deux faits remarquables : « Le Bureau national du syndicat dit aux dirigeants locaux, quand il autorisa la grève, qu’il n ’y aurait pas très longtemps de fonds de la caisse de grève... (et) que les marchands de Véga devraient avoir un stock de Vegas pour 30 jours » [10].
Il était évident qu’au niveau le plus élevé, la GM et l’UAW orchestraient la grève. La GM dit en effet : nous vous laissons soulever le couvercle de la marmite pour que la vapeur s’échappe, mais seulement pendant quelques semaines. En aucun cas la grève ne doit faire céder l’approvisionnement des vendeurs de Vegas. L’UAW transmettait fidèlement le message aux responsables de la section locale.
Un ouvrier, un « ancien » - un des quelques uns qui avaient voté contre la grève, fit remarquer : « J’ai déjà vu ça, une fois. Le Bureau national leur donne juste assez de corde pour se pendre. Ils voient un jeune dirigeant local très actif. Ils autorisent la grève... Mais ils ne leur donnent aucune aide. Ils ne leur versent aucun fonds. Ils ne laissent même pas les autres syndiqués se joindre à la grève. Alors la grève pourrit et c’est perdu, ou bien ils s’installent à Détroit. Tout le monde dit : « Voilà, ça n’a pas payé ! » [11].
La grève s’est déroulée comme prévu. Il y avait beaucoup de volontaires, très déterminés, pour faire le piquet de grève, prêts à construire des barricades en bois et à allumer des feux pour se protéger du froid, mais le syndicat n’a autorisé que des petits piquets « symboliques » et a organisé de longues réunions (le travailleur était obligé d’y assister s’il voulait toucher ses indemnités de grève). A ces réunions, ils expliquaient combien l’UAW était bénéfique pour les travailleurs, combien de programmes ils offraient, la façon dont ils étaient en train de gagner dans les négociations, etc. Les questions un peu difficiles posées par la base ne recevaient pas de réponse, sous prétexte que les négociations se trouvaient à un point délicat. Pendant ce temps le GMAD assurait la réembauche de 300 ouvriers mis à pied en octobre. Apparemment, il avait subi des pressions de la GM pour le faire. Le New York Times écrivait le 16 avril : « La grève de Lordstown a provoqué des dissentiments au sein même de la direction à propos de la politique suivie par le GMAD - à savoir : l’efficacité de cette politique n’avait-elle pas été un peu remise en cause par les conflits du travail qu’elle avait suscités. » [12]
Le 25 mars, un règlement du conflit était annoncé, et la section locale organisait un vote sur le retour au travail. De nouveau les chiffres parlaient d’eux-mêmes. Seulement 40% environ des syndiqués votaient, dont seulement 70% pour arrêter la grève, malgré une très forte pression économique pour reprendre le travail. La plupart des ouvriers, en reprenant le travail, n’ont pratiquement rien trouvé de changé. Les 300 réintégrations ne modifiaient pas beaucoup la situation générale du monteur, et, bien sûr, les conditions de base du travail à l’usine restaient les mêmes. Elles n’avaient même jamais été discutées, ou encore moins négociées. Gary Bryner parla de la grève comme d’une « victoire totale », une grève qui « avait renforcé le syndicat ». En un certain sens, il a raison quant à la victoire. Le syndicat a réussi exactement ce qu’il avait décidé de faire. Le seul problème c’est qu’il n’avait rien décidé de faire pour changer les conditions de travail à l’usine.
La grève n’a certainement pas renforcé la cohésion syndicale. En effet, deux mois après la grève, le sentiment général était que le syndicat n’avait pas été de bonne foi envers les travailleurs, qu’il avait négocié - selon la formule d’un ouvrier - « juste pour qu’on se remette au travail ». Mais, étant donné l’absence d’une alternative quant à la forme d’organisation du mouvement, et le sentiment général qu’ils ne pouvaient rien faire sans le soutien du syndicat, la majorité des ouvriers de Lordstown se sentaient découragés, cyniques, apathiques et battus d’avance. Quand la section locale s’est présentée pour se faire réélire pendant l’été 72, personne ne s’est intéressé à cette élection ; seulement 30% environ des syndiqués sont allés voter. Bryner a reconnu que maintenant il était hué et accueilli par des sifflets par les travailleurs, chaque fois qu’il quittait son local syndical pour aller dans l’usine.
Quand j’ai demandé à Bryner, voici comment il expliquait le fait d’avoir dit que la grève de Lordstown était une victoire totale alors qu’il y avait un mécontentement général sur le résultat des négociations : « Vous voyez, ici, c’est un syndicat très politique. Si un type est candidat pour être permanent, il peut faire beaucoup de promesses, et si un travailleur est assez naïf pour prendre ce qu’il dit pour argent comptant, je suppose que c’est normal qu’il soit déçu. » Bien sûr la politique du syndicat s’étend bien au-delà des élections. En fait, les paroles de Bryner s’appliquent à toute sa propagande pendant la grève, et à tous les buts et comportements syndicaux. Croire les promesses syndicales, c’est être naïf. Bryner poursuit : « Si l’on y regarde de façon réaliste, on n’était pas parti pour changer quelque chose avec la grève. Nous avons dit : revenons à l’accord d’octobre 72, et on attendra 73 pour négocier sur les autres problèmes. » Pendant la grève, la section locale dit : ne faites pas de grèves sauvages ou de sabotages, nous nous occupons des conditions de travail dans notre grève. Et maintenant, en effet, le Président du syndicat local dit : ne vous en faites pas si la grève n’aboutit à rien. Nous nous en occuperons totalement dans les négociations nationales de 1973.
Lordstown est devenu un symbole, mais elle n’est pourtant pas qualitativement différente des autres usines d’automobile. C’est une version légèrement exagérée des conditions générales qui existent dans le pays, et peut-être qu’elle représente ce que seront demain de nombreuses usines. C’est pour cela qu’il est intéressant de comparer la grève de Lordstown à une autre qui a commencé en avril 1972 à l’usine GM de Norwood dans l’Ohio. Norwood fait de très grosses automobiles GM, comme la Firebird et la Nova. Sa chaîne est plus lente que celle de Lordstown et les ouvriers qui y travaillent ne sont pas aussi jeunes, mais les conditions de travail sont fondamentalement les mêmes. La grève de Norwood s’est développée pour des raisons semblables : mises à pied et sanctions disciplinaires, mais là stratégie de contrôle du mouvement par la GM et le syndicat ont été différentes de celle de Lordstown. Norwood n’est pas la seule usine GM qui fait la Firebird et la Nova et les vendeurs avaient un stock trop grand de ces voitures, c’est pour cela que comme l’écrit le New York Times : « Contrairement à la grève de Lordstown pendant laquelle la direction de Chevrolet a tout fait pour qu’elle se règle rapidement parce que la Véga perdait du terrain par rapport à la Ford Pinto, il y a eu peu de pressions de la Compagnie sur les négociations de Norwood. » [13].
La grève de Norwood avait l’aspect d’un lock-out ; la GM était satisfaite de pouvoir vendre son surplus de voitures pendant que l’UAW payait les travailleurs. Cette fois-là, cependant, l’UAW s’engageait à verser des fonds pris sur la caisse de grève sans poser de limite de temps ; elle précisa que le refus du Bureau national de financer une grève longue à Lordstown n’était pas dicté par la situation économique mais par les problèmes de marché de la Vega. La grève de Norwood a traîné 172 jours et a finalement été arrêtée sans que la GM ne fasse aucune concession. Un ouvrier de Norwood a fait remarquer : « En fait, ça n’a été qu’une grosse farce. Mais, c’est vrai, j’ai voté (pour reprendre le travail). J’ai besoin d’un boulot » [14].
UNE STRATEGIE SYNDICALE
La justification de départ pour la création de syndicats d’industrie tels que l’UAW était de coordonner et d’unifier le mouvement des ouvriers des différentes usines. Mais, malgré des similitudes entre les problèmes de Lordstown et ceux de Norwood, et bien qu’ils se soient posés presque en même temps, jamais l’UAW n’a tenté d’utiliser la vulnérabilité de la GM à Lordstown pour faire pression sur elle pour régler le conflit de Norwood. Au lieu de cela, le syndicat a maintenu les deux grèves dans des compartiments bien étanches. Les ouvriers de Lordstown étaient très intéressés par la situation à Norwood, mais le syndicat ne leur a fourni aucune information sur celle-ci. En fait, on pouvait voir, sur les murs des WC à Lordstown des choses comme : « Comment ça se fait que nous avons repris le travail et que Nordwood est toujours en grève ? ».
A l’automne 1972, le Bureau national adopta une stratégie bien connue : il dit, de façon énergique, mais vague, qu’un effort prioritaire pour soulager l’ennui et l’insatisfaction des ouvriers deviendrait l’un des objectifs principaux des négociations de 1973 [15]. Mais, plus tard, sans que cela n’étonne personne, il est devenu de plus en plus clair que ce n’était pas le cas. En décembre, le Wall Street Journal indiquait que la plupart des revendications (dans les négociations de 1973) se centreraient plus sur l’aménagement du temps libre en dehors du travail proprement dit (c’est-à-dire plus de temps libre) que sur des modifications du travail lui-même » bien que - comme le responsable des relations avec le personnel de Ford fut assez naïf pour le remarquer - « il y a peu d’indications - en fait je n’en connais aucune - qui peuvent faire penser qu’une réduction du temps de travail augmenterait la satisfaction des employés pendant leur travail. » [16]
Même s’il est vrai que la plupart des ouvriers préféreraient avoir plus de temps libre si cela n’entraînait pas une diminution de salaire, les propositions faites pour l’aménagement du temps libre ne sont pas arrivées à régler les enjeux des rapports de force à l’usine, un échec qui, bien sûr, était prévu d’avance. En fait, certains des plans pour cet « aménagement » étaient à double tranchant, et fonctionnaient comme un appât pour remettre les ouvriers dans le rang. Par exemple, le Président de l’UAW, Léonard Woodcock qualifiait de « très imaginatif » un plan du Vice-Président Kenneth Bannen qui visait à réduire le mécontentement des ouvriers en leur donnant « plus de temps libre payé, en leur accordant un pourcentage des heures effectivement faites pendant l’année » [17]. Clairement, ce plan cherchait à contrôler l’augmentation de l’absentéisme dans les usines, puisque la direction peut refuser de payer à un ouvrier son temps libre, s’il ne fait pas son temps de travail comme prévu. On peut imaginer que la GM donnerait de bon cœur à chaque travailleur une semaine de vacances payées en plus, si cela lui garantissait sa présence régulière et disciplinée au travail le restant de l’année.
Quant à l’organisation de la chaîne, le président Woodcock dit, carrément, que « cela ne saurait constituer un sujet de discussion dans les négociations collectives » parce que, pour qu’un problème soit susceptible d’être discuté, « il faut que le syndicat ait une idée quant à sa solution, nous n’en avons pas » [18]. Le syndicat n’a manifestement pas changé de comportement en 1973, mais est resté solidement intégré dans les structures de pouvoir qui maintiennent le contrôle de la direction sur le travail. Ce fait est le point central pour comprendre la situation actuelle des ouvriers de l’automobile et il constitue la conclusion essentielle que l’on peut tirer d’une analyse de la grève de Lordstown. Ces temps derniers, il y a eu de grandes discussions sur le ras le bol ? des « cols bleus » et sur des notions telles « l’aliénation » et la »déshumanisation » de la chaîne. Le rapport du HEW [19] intitulé le travail aux Etats Unis, est une contribution assez typique à cette discussion, et donne un bon exemple de la façon trompeuse dont le débat se déroule [20]. Le rapport parle des sources d’insatisfaction existant parmi les ouvriers américains - la pauvreté, l’absence de moyens pour s’en sortir, la monotonie, une faible opinion de soi-même - et suggère des remèdes qui semblent praticables pour « humaniser » : des groupes de travail autonome, l’émulation dans le travail, la rotation des tâches, l’auto-gestion pour la communauté de l’usine, etc. Ce n’est qu’en deux pages, dont une subtilement intitulée « les obstacles à la réorganisation des tâches », que les auteurs du rapport mentionnent le petit problème des profits, et qu’ils suggèrent joyeusement, sur la base de leur recherche, que la productivité à long terme augmenterait si les travaux étaient réorganisés dans l’esprit d’une telle « humanisation ». A côté des justifications remarquablement faibles et superficielles qu’ils ajoutent en appendice, ils rejettent allègrement le fait (admis par les permanents de l’UAW [21]), que la reconversion des industries principales selon le schéma suggéré serait très coûteux et que les profits et la productivité à court terme décroîtraient fortement. Ce fait, en lui-même, rend le Rapport caduc, puisque rien n’a convaincu les hommes d’affaire qu’ils ont un quelconque avantage à gagner à un si coûteux bricolage. Ce à quoi on peut s’attendre de mieux serait une opération esthétique, semblable aux images écologiquement « propres » que nous projettent régulièrement les compagnies pétrolières.
Mais ces considérations ne vont pas au fond du problème. Les hommes d’affaires américains sont profondément convaincus que la capacité d’un homme d’affaires à être compétitif sur le marché national et international est liée directement à un contrôle strict de la direction sur les décisions affectant la production. C’est pourquoi considérer un peu sérieusement de concéder aux ouvriers un pouvoir sur la prise de décision (ce qui est, comme les hommes d’affaires le pensent à juste titre, le problème réel sous-jacent au discours de l’humanisation et l’aliénation), serait accepter la ruine économique de leurs compagnies. Etant donné de telles attitudes, le rapport HEW doit être compris comme un exercice de « relations publiques », une tentative délibérée de brouiller les discussions sur les causes du mécontentement ouvrier en Amérique, une question qui, si elle était sérieusement envisagée, soulèverait les questions fondamentales du rapport de force entre le capital et le travail.
Pourquoi les travailleurs de Lordstown ne s’organisent-ils pas pour faire quelque chose sur leurs conditions de travail ? Après tout, ce sont eux qui construisent les voitures ; ils peuvent arrêter la chaîne n’importe quand. La raison la plus importante de leur inertie, c’est bien sûr, la vulnérabilité économique de chaque travailleur, et l’atmosphère de peur et de manque de confiance générées par l’isolement bien organisé et par l’absence de pouvoir du travailleur individuel. Une autre chose est que, après 8 ou 10 heures de travail, il ne reste pas aux ouvriers beaucoup d’énergie. Ce peu, ils le consacrent et à leur famille, à leur petite bière, à leur concours de pronostics, ou à toute autre occupation personnelle. Un des ouvriers que j’ai rencontré m’a dit : « Regardez, je me lève à cinq heures du matin, et je ne rentre pas avant six heures. Une fois que je me suis lavé et que j’ai mangé, et parfois que j’ai joué de la guitare une heure, j’ai mon compte pour la journée. Je pense que je devrais lire mon contrat et aller aux meetings syndicaux, mais je crois qu’en fait, je laisse cela à mon délégué. » ceci dit en passant, personne ne peut blâmer quiconque de ne pas lire le contrat de travail. Celui de Lordstown fait à lui tout seul 166 pages et il est écrit dans le style le plus abstrait et le plus bureaucratique qui soit, ce qui, en soi, peut justifier, aux yeux des ouvriers, l’existence d’une caste spéciale de dirigeants capables de le lire.
LA DISPERSION DES RESIDENCES
Les conditions de vie autour de Lordstown empêchent également toute organisation ou formation de groupes. La GM a construit son usine au milieu de la campagne dans le Nord-Est de l’Ohio, et les ouvriers habitent dans la cinquantaine de villes et de camps de caravaning situées dans un rayon de 40 miles autour de l’usine. Il n’y a pas de centre commun à la vie des ouvriers. Après le travail, chaque travailleur, à peu près comme un banlieusard aisé, se rend en voiture vers la ville où il habite et ne voit pas ses compagnons de travail jusqu’au jour suivant. Il lui arrive rarement de parler avec les autres de l’usine, de leur vie, ou de partager leurs problèmes. Le caractère hétérogène de la force de travail à Lordstown contribue à maintenir la division des travailleurs. Ce n’est que par intermittence qu’ils perçoivent leur situation commune et, comme dans le reste des USA, ils passent le plus souvent leurs animosités les uns sur les autres.
Les jeunes aux cheveux longs ne font pas confiance aux vieux « hillbillies » (venus des Appalaches, de l’Ouest de la Virginie et de la Pennsylvanie), qu’ils considèrent comme le noyau le plus dur de la compagnie, ou comme des péquenots. L’animosité est partagée, et les hillbillies n’aiment souvent pas les chevelus. Les hillbillies sont aussi souvent racistes, et n’aiment pas les 10% que représente la population noire, pas plus que le petit groupe de travailleurs Portoricains et Cubains. Les Noirs, habitués à un racisme latent de la part des plus vieux ouvriers, ont du ressentiment particulièrement envers la direction de la section locale, qu’ils voient comme une clique blanche déterminée à tenir les Noirs éloignés des postes de responsabilité dans le syndicat et des postes de choix que sont, par exemple, les travaux qualifiés. Il y a quelques années, quelques Noirs se sont emparés de la direction de la Banque coopérative de Lordstown, alors en faillite, et, en travaillant dur, l’ont transformée en une entreprise rentable. Maintenant la section locale de l’UAW souhaite reprendre la Banque, ce dont les Noirs sont irrités, naturellement. Les Noirs à Lordstown ont formé un comité électoral extra-syndical, seule organisation d’ouvriers à Lordstown qui ne soit pas patronnée par le syndicat. Jusqu’à présent, le comité a patiemment tenté de conquérir le soutien et la solidarité des Noirs de Lordstown, et n’a entrepris aucune action importante à l’usine. Le comité n’est pas anti-Blancs dans son idéologie officielle, mais ses dirigeants pensent que pour le moment les Noirs doivent marcher seuls pour améliorer leur situation en tant que groupe à l’usine.
Il n’y a que 300 femmes employées dans ce complexe de 13000 travailleurs. Les femmes sont victimes du sexisme, à la fois des contremaîtres et de leurs compagnons de travail, les ouvriers mâles leur en veulent, pensent qu’elles ont les boulots faciles, et l’opinion générale est que chaque femme travaillant à Lordstown « se fait de l’argent à côté », c’est à dire est une prostituée. Les femmes sont harassées de propositions sexuelles que leur font crûment les ouvriers et parfois les contremaîtres.
Une femme de 20 ans m’a décrit combien elle était isolée à la chaîne. Rejetée par les autres femmes parce qu’elle était jeune et jolie, elle était constamment insultée et sollicitée par les hommes. Son contremaître mélangeait « propositions » et menaces de sanction. Elle a voulu porter plainte officiellement contre ce contremaître, mais elle avait besoin de témoins pour confirmer ses dires. Le contremaître l’avait abordée franchement, et les autres ouvriers, à côté d’elle sur la chaîne, avaient très bien entendu, mais ils ont tous refusé de témoigner pour elle. On lui répondit : « Ecoute, j’ai une femme et un enfant. Pourquoi est-ce que je risquerais mon travail pour toi ? » Il n’y a pas de dirigeantes syndicales à l’usine, et beaucoup de femmes pensent que le syndicat ne se préoccupe pas de leurs problèmes. Les privilèges d’un petit groupe d’ouvriers « qualifiés », tout ce qu’il y a de blanc, sont une cause supplémentaire de division. Leur « qualification se borne à savoir réparer le matériel cassé, et ne demande que quelques semaines d’apprentissage. Elle ne justifie pas en elle-même l’existence d’une catégorie spéciale de travailleurs. Une des fonctions principales de la catégorie des travailleurs qualifiés est de créer un groupe ayant un intérêt particulier à l’intérieur de l’ensemble de travailleurs. Les ouvriers qualifiés ont beaucoup plus de diversité et d’autonomie dans leur travail qu’un ouvrier enchaîné à sa chaîne. Ils se considèrent comme une élite - un ouvrier qualifié, qui avait laissé tomber l’école, se qualifiait lui-même de « technocrate » - et se jugent supérieurs aux ouvriers de la chaîne. Comme, traditionnellement, les ouvriers qualifiés tiennent un nombre disproportionnellement élevé de places à la direction du syndicat, ils sont souvent un groupe puissant qui s’occupe d’abord de ses propres intérêts. Sa loyauté envers le syndicat est en conséquence beaucoup plus grande que celle des ouvriers de la chaîne. Grands défenseurs du syndicat, les ouvriers qualifiés se faisaient voir partout, pendant la grève de Lordstown, participant souvent aux piquets de grève. Mais cette présence, qui, au premier abord, pourrait passer pour de la combativité, montre en fait le rôle essentiellement conservateur des ouvriers qualifiés. Ceux-ci n’ont pas pris part aux actions de sabotage et se montreraient probablement très réticents pour entreprendre n’importe quelle action directe, destiné à ralentir ou a contrôler la production.
L’organisation syndicale, nous l’avons vu, contribue activement à la division des travailleurs, en favorisant l’existence de groupes particuliers, en faisant de fausses promesses, et en ne donnant pas une image réelle de ce qui se passe à l’usine, dans d’autres usines de la GM, et dans l’industrie automobile en général. Le syndicat, également, coopte habilement d’autres centres d’organisation potentielle par sa structure en comités. Il y a un comité pour la communauté, un comité pour les Noirs, un comité pour les femmes, et il y a eu un comité pour McGovern en 1972. Ces comités existent pour essayer de convaincre les différents groupes que le syndicat s’occupe d’eux. Ils désamorcent également des sources potentiellement explosives, tout en renseignant les dirigeants syndicaux sur l’intensité du mécontentement dans les différents groupes.
Bien des choses à Lordstown ressemblent à ce qu’on a pu décrire de la situation des ouvriers de l’automobile des Etats-Unis, il y a vingt ans . Les ouvriers détestent leur travail et se font une raison parce que « ça rapporte ». Ils rêvent de s’évader de la chaîne mais peu le font. Ils attendent et espèrent que leurs enfants auront une vie meilleure que la leur. Mais il y a aussi une « nouvelle génération » de travailleurs très caractéristiques à Lordstown. L’âge moyen à l’usine est d’environ 26 ans. Les parents de ces ouvriers ont vécu la Dépression et n’ont jamais attendu du travail que peine et désagrément. Pour ces parents, le salaire élevé et les avantages accordés à Lordstown ainsi que des conditions de production plus modernes pouvaient réellement sembler souhaitables. De tels « anciens », favorisés également par le système d’ancienneté du syndicat ne comprennent vraiment pas pourquoi les jeunes travailleurs sont si mécontents. Mais les jeunes travailleurs ont des expériences très différentes. Ils ont eu plus d’instruction et ont grandi dans les années 50 et 60, période d’amélioration du niveau de vie pour un large éventail de la population américaine. Des promesses véhiculées par le mode de pensée dominant, les jeunes ouvriers ont appris à attendre une vie décente, mêlant plaisir et loisir, un sens à leur travail, et un certain contrôle sur celui-ci. Ils sont moins prêts que leurs parents à accepter cinquante ou soixante heures de travail abruti simplement pour une grosse enveloppe.
Les ouvriers se rendent compte qu’une bonne partie d’entre eux sont à Lordstown pour de bon. Ils commencent également à se rendre compte qu’ils ne peuvent pas attendre du syndicat une amélioration de leur vie au travail. Gary Bryner reconnait qu’il y a une exigence de plus en plus grande de « justice immédiate », que les jeunes ouvriers en ont ras-le-bol de la sclérose bureaucratique du syndicat. Ces jeunes ouvriers ont fait confiance au syndicat pendant la grève de 1972, et ont été extrêmement déçus, mais cette expérience peut aider à révéler plus clairement la fonction réelle du syndicat. Et, la prochaine fois, les ouvriers seront moins prêts à croire aux promesses syndicales, et à abandonner leurs propres actions directes.
Le fait de savoir si le mécontentement de ces travailleurs débouchera sur un affrontement global entre les ouvriers et la compagnie, dépend de nombreux facteurs. A présent, comme toujours, les travailleurs ont le pouvoir de contrôler ou d’arrêter la production. Mais, pour être capables d’utiliser ce pouvoir, les ouvriers doivent arriver à dépasser la peur et l’isolement, causés par les divisions à l’intérieur de l’usine, et entre les usines, et parvenir à mener leur propre politique à travers leurs actions propres. La situation économique de la GM et des USA en général, aura une influence sur les choix qui s’offrent à cette compagnie et au syndicat pour faire face aux pressions des ouvriers. Personne ne peut dire de quoi l’avenir serait fait. L’analyse de la situation à Lordstown peut aider à faire la distinction entre les futurs possibles et les futurs impossibles.
Peter HERMAN (1973)
PROBLEMES ET PERSPECTIVES
Parmi les discours creux du début des années 60, un des plus agréables à se rappeler est celui prononcé par A.A. Berle, Jr. au collège de Bryn Mawr en 1962. Condamnant ceux qui considéraient d’un oeil sceptique les résultats obtenus par les Etats-Unis, plus particulièrement en Amérique latine, il a remarqué que nous avions toutes les raisons d’être fiers, ne serait-ce que parce que nous étions la première société de l’histoire à avoir éliminé la classe ouvrière. Même à cette époque une pareille constatation aurait étonné le gardien d’immeuble, mais aujourd’hui cette ère de bonheur a disparu, même pour les Berle et leurs enfants. D’une part, l’échec et l’effondrement des mouvements noirs et étudiants des années 60 ont ébranlés les espoirs investis dans de nouvelles forces capables d’entraîner un changement progressif, à une époque où les « Américains moyens » étaient solidement attachés au statut quo. D’autre part, la fréquence et la combativité des mouvements de grève dans l’ensemble du monde capitaliste - surtout en Europe - et même dans les pays de l’Est où l’économie est sous le contrôle de l’Etat, ont clairement mis en lumière le fait que le prolétariat est une force sociale agissante. Actuellement « tout le monde » s’inquiète de la déprime des cols-bleus et de l’ennui des cols blancs ; des commissions gouvernementales entreprennent des études sur l’aliénation des travailleurs ; des universitaires et autres gangsters intellectuels s’affairent à l’étude de la « démocratie industrielle » et du « contrôle ouvrier ». Ceux qui se veulent révolutionnaires doivent eux aussi réfléchir à ce qu’est aujourd’hui la classe ouvrière et au rapport entre celle-ci et les problèmes et les possibilités d’une révolution communiste.
Pour Marx, l’idée du communisme n’avait d’existence réelle que si elle correspondait à une pratique réelle de lutte de classe de la part de la classe ouvrière. En cela il se démarquait de ses prétendus disciples, Kautsky et Lénine, pour qui le prolétariat était plutôt un agent capable, grâce au nombre de ses membres et sa position clé dans la société moderne, de mettre en pratique une idée élaborée par des intellectuels de la classe moyenne grâce à leur critique scientifique du capitalisme. Marx, au contraire, a développé sa conception du communisme et son analyse du capitalisme pour tenter d’expliquer et d’exprimer dans le domaine des idées la lutte des ouvriers contre l’organisation actuelle de la société.
Marx a défini le concept de « classe » par rapport au rôle que celle-ci joue dans le processus social de prise de décision. En gros, il s’agit du pouvoir de décider de la production des biens - allant du beurre et des canons jusqu’aux livres - de tout ce qui représente la base matérielle de la société. Fondamentalement, il s’agit du contrôle des moyens de production et de ce qu’ils permettent de produire. Pour la masse des producteurs, les débuts du capitalisme coïncident avec leur mise à l’écart de ce contrôle. Cette mise à l’écart a eu comme conséquence de transformer en marchandises - en biens destinés à la vente - et les produits et la capacité de produire. Car lorsque les biens ne peuvent être acquis qu’en les achetant aux possesseurs de l’appareil productif, les producteurs ne peuvent subsister qu’en vendant leur force de travail à ces possesseurs. Les moyens de production se transforment alors en capital dans la mesure où leurs propriétaires peuvent acheter la force de travail nécessaire à leur fonctionnement, situation qui permet à ces propriétaires de conserver la différence (plus-value ou profit) entre ce qui est produit et ce qui est exigé par les producteurs pour subsister. La classe capitaliste, celle qui possède, prend naissance en même temps que la classe ouvrière.
Parallèlement, dans ce système (où les gens ne produisent pas directement pour eux-mêmes) la production en tant que processus physique prend nécessairement la forme d’une inter-relation systématique entre les producteurs eux-mêmes, dans laquelle chacun dépend, pour obtenir les moyens de vivre et de produire, du travail de tout un vaste réseau d’autres personnes. C’est le cas sur le lieu de travail lui-même, où peuvent, aujourd’hui, travailler ensemble des milliers de personnes, comme c’est le cas pour les différents lieux de travail et secteurs productifs. Néanmoins, la production étant sous contrôle privé, capitaliste, il pourrait sembler aux producteurs que leurs relations dépendent entièrement de l’emploi que leur fournissent leurs maîtres.
Puisque le profit des capitalistes se compose intégralement de la somme du produit social soutiré aux producteurs, il y a nécessairement conflit entre les deux classes au sujet du partage du produit de travail, comme des conditions où celui-ci s’exerce. Marx croyait que cette situation provoquerait chez les ouvriers une croissance de la conscience à la fois de leur intérêt commun en tant que producteurs exploités et de leur capacité d’agir ensemble pour défendre cet intérêt. L’organisation collective du travail devait fournir un cadre naturel permettant l’élaboration de conceptions et de formes organisationnelles de lutte solidaire.
En outre, du point de vue de Marx, le développement progressif du système est fonction du désir du capital de maintenir les rapports de classes existants et les positions de force individuelles inscrites dans ces rapports. Autrement dit, l’orientation et le rythme de développement de ce système sont déterminés par la nécessité qui s’impose à chaque capital individuel, et par conséquent au capital dans son ensemble, d’augmenter sa valeur (et par là son pouvoir économique et social) par l’intermédiaire de production et d’accumulation de plus-value. Cependant, comme Marx a prétendu le démontrer, le caractère privé du système de propriété capitaliste entre, à la longue, en conflit avec les besoins du capital dans son ensemble et menace ainsi la stabilité du système social. Selon lui, le processus d’expansion capitaliste créerait lui-même des barrières à sa propre reproduction (sous forme d’une tendance à la baisse du taux de profit et donc du taux d’accumulation). Il en résulterait toute une série de crises dans la production de capital, chacune surmontée au prix d’une réorganisation massive (principalement sous forme de concentration) des structures capitalistes et payées par une misère immense pour la classe ouvrière.
Lors de telles crises, pensait Marx, la solidarité des producteurs, déjà développée au cours de la longue lutte pour les salaires, les horaires, etc… atteindrait le stade d’une lutte ouverte pour le contrôle du système productif de la société elle-même. Le bien public, produit collectif du travail, se libérerait des limites imposées à son épanouissement par le système de propriété privée des moyens de production ; le communisme s’établirait par l’organisation collective de la production et la gestion de celle-ci par les producteurs eux-mêmes.
La société capitaliste n’a pas évolué vers une polarisation marquée entre un petit groupe de capitalistes aisés et une masse de prolétaires appauvris. Bien que, continuellement, le contrôle sur le capital se concentre de plus en plus, le petit groupe de ceux qui détiennent richesse et pouvoir se trouve au sommet d’une pyramide composée de niveaux de richesses et de privilège (pyramide dont les chômeurs permanents occupent la base). De plus, succédant à un passé de crises renouvelées tous les dix ou quinze ans, la deuxième guerre mondiale a permis une réorganisation du capital mondial qui a procuré, dans les pays développés, des revenus stables ou croissants à un grand nombre de travailleurs. Il en résulta une vingtaine d’années de stabilité sociale.
Cette situation a permis une floraison de théories sociales bourgeoises ne parlant pas de classes mais de statut et de niveau de revenu, les deux reliés par l’association du statut et du niveau de consommation. Les problèmes résiduels - vus comme résultant en général d’une distribution « injuste » des revenus et du pouvoir politique et social au détriment de certains groupes régionaux ou raciaux - pourraient être résolus par l’application d’une « science régulatrice des phénomènes sociaux » (social engineering), rendue possible grâce à la démocratie politique pluraliste et la croissance infinie de l’économie. En fait, la guerre des classes s’éteindrait et, avec elle, disparaîtrait l’« idéologie ».
Au sein de la gauche, ou de ce qui se présentait comme telle, on pensait généralement que la classe ouvrière, si elle existait effectivement, ne jouerait plus un rôle révolutionnaire. Dans les faits, l’analyse marxienne fut abandonnée ou subordonnée à l’interprétation bourgeoise de la situation, l’analyse de classe cédant la place dans la méthode analytique à des concepts de statut/distribution de revenus. Cette interprétation pessimiste de l’optimisme bourgeois a trouvé son élaboration théorique, par exemple, dans les oeuvres d’Herbert Marcuse, porté par la presse et par le climat de l’époque au rang de « guru de la Nouvelle Gauche ». Le progrès technologique qui a permis l’expansion continue des capacités productives et ainsi la satisfaction des revendications ouvrières, aurait réalisé l’intégration politique du prolétariat dans ce qui devenait un système « unidimensionnel ». Une fois les contradictions matérielles du capitalisme contrôlées, l’opposition ne pouvait se manifester que dans la sphère idéologique - d’où l’attention portée à l’« aliénation » ou au malaise psychologique dans un système d’abondance - encore que Marcuse ait soutenu que l’unidimensionnalité généralisée pouvait intégrer dans une large mesure le domaine idéologique lui-même. On pensait que toute opposition matérielle ne pouvait que se borner à des développements extérieurs au système en tant que tel ; fondamentalement, il ne s’agissait que de la menace que représente la plus grande « rationalité » des systèmes dits socialistes, dans lesquels le contrôle étatique de la production a pris la place du contrôle capitaliste privé. Ainsi, dans la mesure où il existait un quelconque espoir de transformation dans ce monde, il résidait non pas dans les masses de la « société industrielle avancée » mais dans les paysans du Tiers Monde, avec éventuellement des remous dans les pays développés parmi les minorités défavorisées et la jeune intelligentzia, tels qu’ils s’expriment par les mouvements pour les droits civiques et les mouvements étudiants d’opposition à la guerre. Aucun de ces groupes ne pouvait s’identifier au prolétariat révolutionnaire prévu par Marx.
Par contre, il est évident que la prévision de Marx concernant la prolétarisation de la masse de la population s’est réalisée dans tous les pays capitalistes (prolétarisation qui est aussi une conséquence inévitable du développement économique que visent, les systèmes à gestion étatique). Le processus qui a commencé avec l’expropriation de la paysannerie, effectuée à l’Ouest sous l’égide de la propriété privée et à l’Est sous celle de l’Etat, continue, ainsi qu’il en ressort d’un coup d’oeil aux statistiques professionnelles. Les unités capitalistes survivent et prospèrent en s’appropriant l’espace social économique occupé par des formes de vie pré-capitalistes ou des unités capitalistes concurrentes. Au fur et à mesure que l’entreprise, utilisatrice de travail et productrice de profit, devient la forme dominante de production de biens, toute forme de travail adopte les caractéristiques du travail salarié industriel. Le petit fermier devient un ouvrier salarié agricole sous les ordres d’un « fermier avec compte en banque ». Les travailleurs improductifs - employés dans la distribution de biens, les « services » ou la manipulation de la valeur économique (par exemple dans le secteur bancaire) - sont des salariés d’entreprises qui tirent leurs profits de la différence entre ce qu’elles doivent payer à leurs employés et ce qu’elles peuvent extraire du capital industriel pour les services rendus.
Le concept de « classe moyenne » est souvent utilisé aujourd’hui par des gauchistes (« radicaux ») – peut-être pour se dépeindre eux-mêmes - qui essaient par ailleurs d’utiliser une terminologie marxiste. Le groupe ainsi désigné comprend quelques membres de ce que l’on pourrait appeler une classe moyenne - des professions libérales tels que les médecins, les avocats et quelques professeurs d’élite, ainsi que des petits commerçants - mais il comprend surtout des gens - administratifs et personnel d’encadrement, ingénieurs, techniciens, enseignants - qui sont des travailleurs dans le sens marxiste du terme : dépendant pour leur existence de la vente de leur force de travail. Appeler ces gens la « classe moyenne » ne fait que confondre l’analyse de classe avec les catégories bourgeoises de statut/revenu. Dans les années 50, on nous disait que les « ouvriers » faisaient maintenant partie de la « classe moyenne » ; en fait c’était précisément l’inverse qui se produisait et se produit encore. Comme l’augmentation de la productivité du travail industriel due à la technologie et à l’accélération des cadences a ralenti la croissance du nombre des ouvriers en cols bleus, une bonne part de l’augmentation de la force de travail a découlé précisément de la prolétarisation des professions et des gens qui faisaient auparavant partie de la classe moyenne (due en particulier à l’important développement des emplois gouvernementaux, résultant du rôle croissant de l’état dans la vie sociale et économique). Cette période a également vu une augmentation constante de l’emploi de femmes comme salariées (à bon marché), cette occupation venant s’ajouter à leur fonction familiale de reproductrices de la force de travail.
En voilà assez sur cette notion illusoire de statut. En ce qui concerne le revenu, un ouvrier reste un ouvrier quelque soit le montant de sa paie. Il doit être exploité « que son salaire soit élevé ou non » parce que ce n’est que sur cette base que l’employeur peut réaliser le profit qui lui permettra de poursuivre ses affaires en tant qu’employeur. Pourtant, comme le remarquent les pessimistes de gauche, l’existence de classe n’est pas, en soi, suffisante. L’activité révolutionnaire exige des travailleurs une prise de conscience de leur position dans la société - conscience non seulement de l’exploitation mais compréhension du fait, qu’en tant que producteurs de toute richesse, ils ont le pouvoir de gérer la production et la vie sociale en général afin de satisfaire leurs propres besoins. Selon les paroles de Marx, « le prolétariat est révolutionnaire ou il n’est rien ».
Parmi les idées des pessimistes de gauche, la plus bizarre de toutes, peut-être, était que l’intégration de la classe ouvrière, son acceptation du système capitaliste, était un phénomène nouveau, produit par un état nouveau (super-technologisé) du capitalisme. Le système capitaliste se compose à la fois de travailleurs et de capitalistes ; on ne peut parler d’opposition au système (dans son ensemble et non à tel ou tel de ses effets) que lorsque le salariat, le rapport capital-travail lui-même, est menacé. De tels mouvements de révolution ou de presque-révolution ont été fort rares dans l’histoire du capitalisme. La lutte quotidienne entre employeurs et ouvriers sur les conditions et la rémunération du travail salarié, élément inévitable d’un système dans lequel les intérêts des deux groupes s’opposent, n’a pas plus menacé l’existence du capitalisme hier qu’aujourd’hui, aussi longtemps que la satisfaction momentanée et partielle des revendications pouvait les maintenir à ce niveau.
Ce qui, dans le passé, a pu faire croire que la classe ouvrière n’était pas intégrée, c’était l’existence d’organisation « de la classe ouvrière », syndicats et partis sociaux-démocrates, partis et syndicats communistes de la Troisième Internationale (voire de la Russie soviétique elle-même à une époque où il était plus facile de la considérer comme un bastion de la révolution mondiale), idéologiquement révolutionnaires. En fait, ces organisations, même au moment de leur plus grande puissance, ont été des instruments d’intégration de la classe ouvrière. Ici, on peut distinguer trois aspects du développement et du fonctionnement des organisations ouvrières en Amérique et en Europe. Premier aspect : jusqu’à récemment, le capitalisme a connu une période de croissance (malgré l’interruption due à des crises périodiques). Avec le développement de l’appareil productif, entraînant une montée de la productivité du travail, le capital pouvait à la fois, satisfaire aux exigences du profit et aux revendications ouvrières pour l’amélioration de la vie. C’est pourquoi les organisations ouvrières pouvaient fonctionner, au niveau gouvernemental et sur les lieux de travail, comme des structures permettant à la puissance sociale des ouvriers d’arracher des gains réels. Aux Etats-Unis cet état de fait était encore accentué parce que, jusqu’à récemment, les conditions particulières de ce pays ouvraient une possibilité réelle d’avancement aux ouvriers, allant même, pour un faible nombre d’entre eux, à une entrée dans les rangs des capitalistes.
Deuxième aspect : les organisations qui avaient pour fonction d’obtenir satisfaction des revendications et qui, nécessairement, opéraient dans une situation définie par l’existence du « marché » du travail, canalisaient et contrôlaient les énergies oppositionnelles en institutionnalisant le conflit inévitable entre classes. C’est aux Etats-Unis que ce processus a été poussé le plus loin, aboutissant à la négociation du contrat collectif moderne, complété par une procédure de cahiers de doléances et de clauses anti-grèves. Enfin, à mesure que les dirigeants de ces organisations, à cause de leur activité même, se sont intégrés, d’abord de fait, puis de droit, à la structure sociale et politique des rapports capital-travail et ainsi, quelle qu’ait été la pureté de leur coeur (le plus souvent négligeable), à l’appareil de domination, leur intérêt personnel immédiat s’est lié au maintien du statu quo. Cependant, cette « corruption » n’est pas aussi importante que l’effet général de l’institutionnalisation de la lutte, qui a retiré des mains de ce qui est devenu la base, non seulement la direction de la lutte mais encore une grande partie de l’activité elle-même ; à l’activité de cette « base » se substitue alors celle des permanents des syndicats ou des partis. D’un point de vue révolutionnaire, la suite de victoires ouvrières remportées par les syndicats ou le parlement constitue une longue défaite.
L’intégration du prolétariat est le résultat, non pas d’une quelconque circonstance nouvelle et particulière mais d’une adaptation naturelle aux réalités de la vie quotidienne. Pour parler concrètement, nous pouvons dire que nos idées se forgent à partir de notre expérience du monde. Elevés dans la société capitaliste, avec les leçons que nous impose la vie quotidienne et que renforcent systématiquement l’école et les mass médias, nous avons du mal à envisager sérieusement qu’il puisse y avoir une autre manière de vivre ensemble, tout comme concevoir une société sans esclavage ne venait à l’idée d’aucun Grec. Et, forcément, le désir de vivre autrement s’amenuise lorsque les choses vont pour le mieux ou du moins pas pour le pire. En général, nous aurions plutôt tendance à nous soumettre à des maux supportables plutôt que d’essayer de tout faire éclater, démolissant notre routine quotidienne et notre sécurité personnelle, pour une quelque chose à laquelle nous avons du mal à croire.
De même, la compréhension qu’ont les ouvriers de leur capacité à déterminer collectivement leur propre destin vient uniquement de l’expérience qu’ils en font : c’est-à-dire, l’expérience de la solidarité, de leur capacité à décider et à agir sans l’encadrement de « représentants », politiques ou autres. De telles expériences peuvent être vécues pendant chaque grève, pendant chaque lutte de l’atelier. Mais d’habitude ces expériences d’action commune se limitent aux ouvriers d’un seul atelier, d’une seule usine, d’une seule industrie, s’opposant à un capitaliste unique : on est loin d’un affrontement de la classe dans son ensemble contre le capital dans son ensemble. Apparemment ces expériences ne développent pas la capacité de mettre en cause la société existante toute entière qu’à des moments de grande crise sociale. Alors, l’incapacité de l’ordre existant à satisfaire même les besoins réduits au minimum oblige les gens à dépasser les limites habituelles de la lutte pour entreprendre, à l’échelle de la classe entière, une action pour organiser des formes différentes de vie sociale. En tous cas, cela s’est avéré vrai lors de la vague révolutionnaire en Europe en 1917-1923 (Russie, Allemagne, Italie) née d’une crise mondiale qui avait pris la forme d’une guerre mondiale. La Révolution espagnole de 1936 fut l’aboutissement de plusieurs années de troubles, couronnés par l’éclatement de la guerre civile.
Si, dans chacun de ces cas, les mécanismes qui ont conduit à l’échec étaient différents, le capitalisme a pu, chaque fois, se réorganiser économiquement et politiquement, et continuer sa course. Cependant, la période de l’entre-deux guerres semble avoir constitué un point tournant dans l’histoire de l’économie capitaliste. De même que, par le passé, ils s’étaient trompés sur la nature de l’activité de la classe ouvrière, les pessimistes de gauche sont également passés à côté de ce qu’il y a de neuf dans la situation nouvelle. Il devient aujourd’hui nettement plus clair que le pessimisme à l’encontre de la possibilité d’une révolution prolétarienne reposait sur l’acceptation trop rapide du point de vue de la bourgeoisie, satisfaite d’elle-même, même si, aujourd’hui, les pessimistes agitent le spectre de l’inflation galopante, des difficultés monétaires et de la montée du chômage, pour attirer l’attention sur ce qui se résume à une nouvelle étape du développement des contradictions du capitalisme.
En effet, le capitalisme ne s’est jamais relevé de sa Grande Crise comme il l’avait fait des crises précédentes. C’est-à-dire que la réorganisation du capitalisme qui s’est faite pendant la crise et la deuxième guerre mondiale n’a pas réussi à accroître le taux de profit à un point tel qu’il permettrait au système de continuer à se développer au rythme imposé par le précédent niveau de développement. Par conséquent, les mesures d’intervention étatique, introduites dans l’économie par le « New Deal » et ses équivalents (fascistes) dans d’autres pays, sous forme d’assistance sociale, de travaux publics et de production de guerre n’ont pas pu être abandonnées après la guerre. Le chômage massif et l’agitation sociale n’ont pu être évités que grâce à l’utilisation, par l’Etat, de capitaux (insuffisants pour permettre des investissements) pour colmater le trou provoqué par le bas niveau d’investissement du capital privé. Ce procédé, présenté comme mécanisme qui permettait de surmonter les sombres prévisions des marxistes, représentait une confirmation de la théorie du développement capitaliste exposée dans Le Capital. La croissance régulière du secteur « Public » est le témoignage, en fait, de l’incapacité du secteur privé - c’est-à-dire de l’économie capitaliste proprement dite - à atteindre un taux de croissance adéquat.
Le secteur de l’économie placé sous contrôle étatique est indispensable au maintien du capitalisme en tant que système social. En premier lieu il fournit l’emploi, donc les moyens d’existence, à des milliers d’hommes qui, autrement, seraient au chômage. De surcroît, il fournit les matériaux - essentiellement l’armement - qui permettraient éventuellement de construire un empire américain solide, futur champ d’investissement permettant de compenser le déclin de la rentabilité du capital américain et européen.
En même temps le secteur « public » parasite l’économie capitaliste de la propriété privée. Puisque le gouvernement ne possède pas le capital, les fonds dont il dispose pour ses projets doivent être soutirés par taxation ou emprunts sur le secteur privé (c’est-à-dire, sur les profits : soit directement, soit par le tour de passe-passe des « impôts sur le revenu », qui se résume en fait à une réduction des salaires puisque l’argent dont les ouvriers ne voient jamais la couleur ne peut guère être considéré comme une composante du fond salarial). Ainsi, les transactions gouvernementales se jouent en dehors du marché, c’est-à-dire, en dehors de l’économie capitaliste proprement dite. Car, dans la mesure où l’Etat paie les biens fournis par le capitaliste avec de l’argent provenant des capitalistes eux-mêmes, la production réalisée pour le compte du gouvernement provoque non pas la création d’une nouvelle valeur et d’un nouveau profit mais seulement le transfert de la valeur déjà existante, de l’ensemble de la classe capitaliste à quelques uns de ses membres privilégiés. Ainsi la production que l’Etat gère ne peut pas compenser la baisse du taux de profit dans l’économie privée.
Puisque le secteur étatisé croît plus rapidement que le secteur privé (il croît en effet précisément parce que le secteur privé ne le peut pas), il arrive forcément un moment où poursuivre son extension, bien que nécessaire pour éviter une crise sociale, impliquerait l’absorption de l’espace économique dont dispose encore le capital privé. Le capitalisme privé, qui combat le système économique de contrôle étatique à l’extérieur sous le nom de socialisme, tel qu’il est incarné dans les régimes russe, chinois et alliés, le considère, avec raison, comme une menace interne. C’est pourquoi le capital essaie périodiquement de freiner l’expansion du secteur étatisé, bien qu’il y ait encore bien du chemin à parcourir avant que le secteur « public » n’entre sérieusement en conflit avec le secteur privé, forçant la classe dominante à choisir entre une crise générale et l’abandon total du système de propriété privée.
Ceci a pour résultat la situation de tension continuelle que la classe ouvrière subit aujourd’hui. La tentative d’accroître le taux de profit s’est traduite par la prolongation des horaires de travail, l’intensification du rythme de travail et, pour certains, une baisse constante du niveau de vie depuis la fin de la 2ème guerre mondiale. Les dépenses de l’Etat continuent à se faire au prix de réductions salariales sous forme d’impôts et d’inflation, tandis que les tentatives de ralentir la croissance du secteur étatique ont pour conséquence la récession (c’est-à-dire une dépression contrôlée). Simultanément, l’utilisation des fonds de l’Etat dans le but d’assurer la sécurité de l’Empire signifie mort et destruction pour la jeunesse ouvrière. A ceci, il convient d’ajouter la destruction progressive de l’environnement, qui nuit à la santé et détruit les sources de plaisir pour les moments de loisir, la dégradation des centres urbains dans lesquels s’entassent les populations, et l’incapacité d’un système en stagnation à proposer un soulagement aux masses de la population noire.
Ces pressions pèsent de plusieurs manières et à des degrés différents sur divers secteurs de la classe ouvrière. D’un côté, un grand nombre d’ouvriers blancs, ayant atteint l’âge moyen ou plus, sont depuis la fin de la Grande Crise dans une situation relativement stable, jouissant d’une sécurité d’emploi et d’un niveau de vie « raisonnable ». De l’autre côté, les noirs, les jeunes (quelle que soit leur couleur de peau) et les ouvriers du sexe féminin, en nombre sans cesse croissant, reçoivent de bas salaires, connaissent un taux de chômage important et subissent des conditions de vie en dégradation permanente (ainsi qu’en témoignent les taux de mortalité élevés, la malnutrition, les effets de la tension psychologique, etc.). Ainsi que l’a exprimé un chercheur, cette partie de la population travailleuse vit dans la misère alors que le premier groupe lui a vécu le boum des années 50 et 60. C’est ce qui explique l’apparition d’une « classe ouvrière » réactionnaire en même temps que celle de jeunes, de femmes et de noirs faisant preuve d’une hostilité grandissante au « système » - état de fait en apparence contradictoire. L’importance de phénomènes tels que la récession actuelle résulte de ce qu’ils rendent inéluctable l’aggravation des conditions de vie de cette partie de la classe ouvrière jusqu’alors favorisée - aggravation qui, aujourd’hui atteint même des techniciens et des cadres à salaire et statut élevés. Cette situation ouvre la possibilité d’une montée d’une force d’opposition regroupant l’ensemble de la classe et remplaçant les luttes sectorielles de ces dernières années.
Bien que les étudiants soient à l’écart de l’ensemble des processus de production de la société moderne et que leur poids social soit négligeable, il faut prendre au sérieux le problème de leur rapport avec un mouvement ouvrier à venir. A l’époque de l’éducation de masse, il n’est plus possible de considérer les étudiants comme des éléments petit-bourgeois ou bourgeois tout court. Pourtant, ce ne sont pas des travailleurs : ils peuvent bien suer sang et eau, ils ne reçoivent pas pour autant de salaire et ne produisent aucune valeur. Ce qu’ils sont - et ici je parle de la grande majorité et non pas du futur PDG et/ou politicien – ce sont des travailleurs potentiels, des travailleurs-en-formation. Cette formation qu’ils reçoivent n’est qu’en partie une formation professionnelle destinée à fournir une plus grande productivité ; sa fonction est surtout de justifier un accès limité à certains emplois et certains salaires. De plus, la plus grosse part de l’éducation universitaire (et scolaire en général) est purement idéologique, en ce qu’elle entretient, à la fois à travers son contenu et l’organisation des programmes académiques, une saine passivité et un respect intellectuel pour le système établi. L’éducation de masse existe parce que cette formation - tant des connaissances que du comportement - est importante pour la production moderne. Une bonne partie des produits de cette usine du « savoir » prend la, forme d’enseignants : la reproduction élargie des voies de transmission des aptitudes et des idéologies. Les écoles servent aussi de centres de recherches pour l’industrie et le gouvernement. Ce sont les différentes fonctions de l’éducation institutionnelle qui déterminent l’existence des étudiants, et fournit le cadre qui permet de comprendre le mouvement étudiant.
L’intérêt immédiat des étudiants est de rester étudiants - c’est-à-dire d’abord, de ne pas aller travailler et ensuite, quand ça devient inévitable, de trouver le boulot qui soit bon. Il est évident que le premier est limité dans le temps ; le deuxième a de moins en moins de signification (objectivement, à mesure que se raréfient les postes devenus disponibles à un nombre toujours croissant de diplômés ; subjectivement, dans la mesure où le système de valeurs ne se vérifie pas au contact de la réalité). A l’école, les étudiants se voient à la fois laissés pas mal libres de leurs mouvements et soumis à une administration bureaucratique ; on les encourage à « développer leur esprit » et simultanément on leur enfourne tout un tas de merde pour les préparer à des boulots idiots. Le mystérieux malaise estudiantin, le conflit avec l’autorité, le rejet des carrières et des modes de vie « professionnels », la radicalisation et - parmi les « radicaux » - une tendance à accepter l’idée d’une « alliance » avec la classe ouvrière en sont les résultats. En l’absence d’une classe ouvrière radicale, ceci reste un simple point de vue, à moins qu’il ne se transforme en idéologie stérile, reflétant les objectifs de groupes sectaires, plutôt que le développement du mouvement. Mais elle acquiert un contenu pratique dès que la possibilité se présente comme en France, en Italie et en quelques rares cas, aux Etats-Unis. Les étudiants - pour reprendre une formule - ne sont pas travailleurs, mais la lutte des travailleurs est la leur par nécessité.
On ne surestimera jamais assez le rôle que jouent les divisions internes de la classe ouvrière, dues aux barrières énormes qu’engendrent les expériences différentes et les intérêts particuliers, dans sa soumission aux conditions capitalistes. Les gens travaillent à la campagne et en ville ; dans de grandes villes et dans de petites villes ; dans les ateliers de production, dans les bureaux ; dans l’éducation et dans les services ; pour le capital privé et pour l’Etat. Liées à chacune de ces divisions, sur chaque lieu de travail, nous trouvons une multitude de catégories (en général factices) de spécialisations et de classifications, qui se traduisent par une hiérarchie de salaires et de statuts. Ces divisions, qui s’étendent au domaine de la vie, bien au-delà du travail, dissimulent aux salariés leur position commune d’exploités, qui unit tous les membres de la classe.
De nombreux facteurs idéologiques et institutionnels (en plus de la concurrence générale entre demandeurs d’emploi) jouent un rôle important dans le maintien de ces barrières. L’éducation ou l’ancienneté sont censées justifier la hiérarchie des catégories et des salaires. Le sentiment que la place de la femme est à la maison a souvent contribué à empêcher les ouvriers de soutenir la lutte de leurs collègues féminines pour des salaires égaux, de même que les femmes elles-mêmes ont du mal à exprimer de l’agressivité vis-à-vis de leurs employeurs (ou à soutenir les luttes de leurs maris contre les leurs). A l’heure actuelle, le plus frappant de ces facteurs est le racisme qui empêche pratiquement blancs et noirs de se considérer comme camarades de classe.
Ces barrières, et le frein qu’elles mettent à la solidarité et à la combativité de classe, ont été particulièrement renforcées par les syndicats. Leurs interventions sur les lieux de travail ont eu pour résultat de consacrer la hiérarchie des postes et des salaires ; leurs structures, basées sur les métiers ou les industries, ont contribué à diviser et affaiblir les luttes des différents groupes. Ils ont tenté sciemment d’exclure les noirs et, en fait, la majorité des ouvriers, de la participation aux luttes qu’ils menaient et du bénéfice des gains obtenus. Pour briser ces divisions entre ouvriers il faudra rejeter l’autorité représentative des syndicats et, en fait, tôt ou tard, lutter contre ceux-ci. Les restrictions qui seront sans doute imposées aux syndicats par les employeurs et par l’Etat doivent être attaquées non en s’efforçant de défendre les syndicats, mais en travaillant à ce que la classe ouvrière se défende elle-même par la création de formes d’organisation - probablement toutes sortes de comités d’atelier - contrôlées par les hommes et les femmes qui y travaillent et qui permettront l’unification la plus large possible de la classe ouvrière à tout moment.
Un des éléments nouveaux les plus prometteurs dans notre situation est le fait que les organisations ouvrières traditionnelles, à la fois politiques et syndicales, ne sont plus dans la course réelle. En Europe, les partis de masse, communistes, sociaux-démocrates, et travaillistes, perdent leur couverture prolétarienne, tandis qu’aux Etats-Unis le Parti Démocrate a perdu son image d’ami de l’ouvrier. Ce qui reste de l’identification des ouvriers aux syndicats ne peut que continuer à dépérir. Bien entendu, on peut s’attendre à ce que les nouveaux groupements, comités et réseaux de base deviennent de nouvelles structures d’intégration si les luttes ainsi organisées obtiennent des succès dans leurs revendications - le plus vraisemblablement par leur absorption dans les syndicats déjà existants (avec la montée au pouvoir d’une direction nouvelle et plus combative). Mais ceci dépend de la capacité du capitalisme à réaliser une nouvelle prospérité.
Il est peu probable, si l’on s’appuie sur le passé, que nous ayons la possibilité de participer à une activité révolutionnaire de masse avant que ne survienne un moment de véritable effondrement social - bien qu’une période de résistance à une tension grandissante contribuera sans doute à la préparation du prolétariat à ce moment. En effet, la perspective immédiate est celle d’une consolidation des forces capitalistes, entre autres par la répression sévère de tout ce qui peut exister à gauche, pour tenter de franchir la période difficile qui s’annonce. Pourtant, il y a une possibilité réelle d’une réapparition future de la lutte de classe à une grande échelle, ce qui offre aux « radicaux » un espoir et en même temps les oblige à parvenir à une compréhension des réalités actuelles, indispensable à leur participation active au développement de cette lutte.
Paul MATTICK, Jr. (1970)
[1] Parmi les articles existant sur Lordstown, les meilleurs que j’ai lus sont : Emma Rothschild, « GM in more Trouble » (encore plus de difficultés pour la GM) New York Review of Books, 23 mars 1972, et Barbara Garson, « Luddites in Lordstown » Harper’s, Juin 1972.
NDT : « luddites » est le nom donné aux ouvriers qui, au XIXe s. brisèrent les premières machines.
[2] Ces citations sont tirées d’interviews d’ouvriers de Lordstown que Peter Schaifer et moi-même avons faites en Juin 1972, interviews qui sont disponibles sur bandes-vidéo. Toutes les citations sans notes renvoient à ces interviews.
[3] Voir Jeremy Brecher, Strike ! (Grève !), San Francisco, 1972, chap. 5.3, « Sitdown... » (Grèves sur le tas).
[4] New York Times, 11 avril 1937.
[5] Wall Street Journal, 29 octobre 1970. Voir aussi William Serrin « 777e Company and the Union » (l’entreprise et le syndicat), Alfred A. Knof, Inc., New York, 1973, pour un compte rendu détaillé de la grève de 1970.
[6] Wall Street Journal, 5 octobre 1970.
[7] New York Times, 23 Janvier 1972.
[8] Takashi Oka « American Made-in Japon » (Des produits américains japonais), New York Times, 13 Juin 1971, 3e partie, Cité par N. Chomsky, For Reasons of State (Pour raisons d’Etat), New York, 1973, pp 279-280.
[9] NDT The Greening of America (L’Amérique reverdit) est un livre de Charles REICH, paru dans les années 1970, qui tente d’expliquer les changements survenus aux USA dans les modes de pensée et dans les comportements.
[10] New York Times, 6 Mars 1972.
[11] Cité par Barbara Garson « Luddites in Lordstown », cité plus haut.
[12] New York Times, 16 avril 1972.
[13] New York Times, 26 septembre 1972.
[14] Ibid. 28 septembre, 1972.
* NdT il s’agissait de faire un syndicat centralisé regroupant les syndicats indépendants de chaque usine, d’où leur nom d’« Union », « Fédération », « International Union »,etc.
[15] Ibid, 3 Septembre 1972.
[16] Watt Street Journal, 8 décembre 1972.
[17] New York Times, 28 septembre 1972 et 27 septembre 1972.
[18] Ibid, 28 Janvier 1973.
[19] HEW : Health, « Education & Welfare » (Ministère de la Santé, de l’Education et des Affaires Sociales) NDT.
[20] Publié par U.I.T Press, 1973.
[21] New York Times, 3 septembre 1972.
)
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (1 Mo)