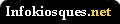T
Transsexuels Incroyables
mis en ligne le 11 février 2009 - Daniele Bocchetti , Giorgio Cuccio
D : Si une personne pense au transsexualisme, elle a sûrement en tête une fille trans. En tout cas quelque chose qui est très loin de notre réalité banale. Ça a été significatif cette fois-là, à Livorno, quand nous avons tous les deux parlé de transsexualisme FtM à la tribune. Je me rappelle que mon intervention démarrait justement en disant que normalement quand je déclare être trans, les gens se demandent où j’ai laissé ma perruque, parce que l’image de l’homme trans n’existe pas dans l’imaginaire – d’où le fameux « Tu trouves que je ressemble à Deborah ? » que j’avais écrit sur ma pancarte à la Pride de Milan. Dans le public quelqu’un a demandé à Nicole : « Mais les deux garçons là… je n’ai pas compris… ils sont gays ? ». Dans un contexte dans lequel on parlait de transsexualisme, dans lequel chacun de nous avait parlé de transsexualisme à partir de son expérience à lui… Il n’avait pas compris qu’on était transsexuels ! Mais qu’est-ce qu’on pouvait être ?! Le mot « trans » doit être rempli de nos significations, et ce qui a le plus de capacité à bouleverser les schémas culturels c’est justement l’opposition entre le sens actuel donné au mot trans et notre réalité.
G : Par exemple on ne dit jamais que les recherches de Harry Benjamin et de sa fondation ont été financées par un homme trans [1]. De la même façon, on ne se souvient pas du premier trans opéré, Michael Dillon, tandis que Christine Jorgensen, la première trans opérée qui est en réalité arrivée après, est entrée dans l’histoire. Le choix de la visibilité pour nous n’était pas évident. Je crois que c’est justement à cause de la possibilité d’être invisibles, que notre choix de visibilité ressemble à celui des gays et lesbiennes au moment où ils ont revendiqué leur existence. Cependant, dans notre cas, cette étape – la sortie du placard et la légitimation de notre condition qui en a découlé – avait déjà été franchie par les filles trans.
D : Ça reste quand même fondamental de reconnaître dans notre choix de visibilité cette demande de légitimation, parce qu’elle constitue justement notre spécificité. Justement parce que la dépénalisation avait déjà été obtenue pour nous aussi par les filles trans – et avec elle la possibilité d’accéder à une identité civile, anatomique et sociale plus conforme à ce que nous sommes – ce qui nous pousse à sortir du placard, c’est le désir d’affirmer notre existence pour conquérir de nouveaux espaces de liberté dans lesquels l’exprimer, sans être obligés de se dénaturer pour s’adapter à ceux qui existent déjà.
La loi 164 [2] ne prévoyait pas que certaines personnes trans auraient disparu de façon absolument silencieuse…ou peut-être poussait-elle justement à ça… En tout cas on ne pensait pas que des personnes auraient renoncé à ce privilège silencieux parce qu’il ne leur correspondait pas.
G : Ça a été ma condition d’invisibilité qui m’a fait comprendre que ma spécificité n’était prise en considération par personne. Une réflexion sur laquelle on peut travailler est celle sur le masculin, produite de l’intérieur, avec une spécificité qui lui est propre, dans l’optique d’un changement du masculin – qui paraît un bastion plutôt dur à vaincre… Nous on navigue dans le masculin, mais ce masculin, tel qu’il est donné, c’est un univers dans lequel il est difficile de se déplacer, dans lequel je ne peux me reconnaître qu’en ayant une attitude critique. Donc notre réflexion est une réflexion culturelle sur les genres. Toutefois ça ne rentre pas dans un discours revendicatif. Ça ressemble plus à une nécessité intérieure, même si en réalité ça ne l’est pas.
D : On peine vraiment à transformer en revendication le fait de ne pas correspondre au masculin donné, la difficulté de façonner pour soi-même un masculin plus personnel et flexible. Mais c’en est une, et sur une base très large. Mais chaque fois qu’on essaie de définir ça comme la spécificité FtM, on peine ensuite à lui donner une forme. Regarde par exemple le parcours de la coordination FtM : quand elle est née, en 2000, la subjectivité FtM n’existait pratiquement pas. Au début, évidemment, le regroupement s’est fait sur une base identitaire et ça a déjà été une conquête énorme que de pouvoir réaliser qu’on n’est pas un extra-terrestre, l’unique et le seul. C’était important de réussir à dire simplement « on existe », et pas à l’extérieur de la communauté qui était en train de se créer petit à petit, mais à l’intérieur même. Se rencontrer les uns les autres au fur et à mesure a été une découverte hyper importante. Au début on était sept dans toute l’Italie et en quelque mois le nombre a augmenté de façon exponentielle. Le travail de Davide Tolu [3] a participé de façon phénoménale à cette dynamique en rendant possible à lui seul la création d’un lieu dédié aux garçons FtM, simplement en rassemblant les connaissances qu’il avait à l’époque et en les balançant sur une mailing list. En quelques années une communauté s’est créée, un peu noyée dans les listes et dans internet, qui accomplit la tâche de fournir une sorte de réseau de soutien. En parallèle, les trans FtM ont progressivement intégré les assos et forment actuellement une présence active qui est en train d’apprendre à se confronter à autrui et à construire et formuler ses spécificités. Le but de créer une communauté FtM et de promouvoir l’émergence de subjectivités qui pourraient amener ces spécificités dans la lutte transgenre a donc été atteint et en quelque sorte épuisé. Mais au moment de relancer sur des contenus on s’est arrêté à cause de la difficulté à les élaborer. Mais on doit constater que l’avant-garde activiste FtM est encore aujourd’hui plutôt éloignée du reste de la communauté.
Ici demeure aussi la difficulté de formaliser nos revendications. Dans le fond, qu’est-ce qu’on demande ? Surtout les droits qui nous manquent, ceux dont la loi 164 nous prive encore, mais ça ce n’est pas spécifique à notre réalité, ces sont les luttes des personnes transgenres en général. Notre spécificité est ce qui concerne la réflexion sur les genres, elle a fait émerger notre envie d’activisme et fait qu’elle perdure. On a eu accès à cette forme de masculin, on pouvait garder l’anonymat. Qu’est-ce qui nous a fait choisir la visibilité ?
G : Le fait qu’on ne pouvait fondamentalement pas supporter ça. On rentre dans l’imaginaire masculin, parce que physiquement on peut être assimilé au masculin, mais cet imaginaire ne nous correspond pas. Avant on se disait que l’invisibilité pouvait justement être utilisée pour surmonter le préjugé : la trans visible est objet de moquerie parce que la personne moyenne ressent le droit – et le devoir – de se conformer à l’attitude commune qui veut que la diversité soit ostracisée. On plaque immédiatement le préjugé sur elle. Au niveau de la discrimination il me semble que pas grand chose a changé : il y a quelques années il y avait les trans invisibles qui vivaient une vie « normale » parce qu’elles arrivaient à passer inaperçues, tandis que celles qui étaient visibles étaient objet de dérision. Aujourd’hui c’est pareil : mais peut-être les gens sont-ils un peu plus habitués au phénomène.
D : Avec la loi 164, celles qui étaient invisibles ont eu un instrument prodigieux pour continuer à passer inaperçues et les trans FtM ont fait de même.
G : Notre opportunité pourrait être celle d’échapper au moment où on nous juge – grâce à une apparence rassurante et insoupçonnable – et d’avoir ainsi une ouverture, qui soit libre de préjugés, pour communiquer avec les gens. Pour le dire de façon simple : moi je peux être à coté de toi, toi tu ne peux pas t’apercevoir de ma diversité et tu entre en relation avec moi comme avec n’importe qui. Dans mon expérience, la « révélation » d’être trans qui vient ensuite, provoque rarement une réaction négative de la part de l’interlocuteur.
D : Ça m’arrive que lorsque je me trouve dans un contexte lesbien ou gay, on me demande ce que je fous là. Quand j’explique que je suis trans, on me regarde d’un air interrogatif, comme pour dire « Comment ça ? ». Mais ce n’est pas envisageable de devoir se balader à chaque fois avec un panneau « Trans de femelle à mâle », comme à la Pride, parce que sinon personne ne te verrait pour ce que tu es. Si tu veux parler de ton expérience dans un contexte intéressant, ou simplement avoir l’opportunité de dire ce que tu penses, tu dois d’abord faire un long préambule pour expliquer qui tu es. « Mais comment ? Ça veut dire quoi ? Dans quelle direction ?... » C’est comme si tu devais montrer tout le temps ta carte de visite.
G : Tu dois spécifier que tes vécus, masculin et féminin, sont différents de ce qu’ils imaginent. De temps en temps tu n’as pas envie de devoir expliquer pourquoi tu ne corresponds pas à l’image que les autres projettent sur toi, pour être toi-même.
Quand tu assumes la responsabilité de la diversité tu as l’impression que ça devient une condamnation : tu es renvoyé constamment à la diversité. Les personnes entrent en relation avec toi en fonction de ta diversité et pas en fonction de ta personne : c’est un réductionnisme qui se présente chaque fois que tu es en minorité. Pour les migrants c’est pareil : un peu de « couleur » sur la peau signifie la légitimation d’une série de préjugés et comportements, peut-être même avec de bonnes intentions. On ne relationne pas avec la personne mais avec son « exotisme ». Le mécanisme de la majorité est exactement celui-ci : décider ce que c’est la normalité et appliquer une méthode quantitative d’évaluation pour comprendre qui peut rentrer dans la norme et combien il peut en rentrer.
D : Le parallèle avec la condition des migrants est fort. Nous aussi on peut être dans n’importe quel contexte en train de parler du sujet le plus haut de gamme, mais finalement ce qui intéresse les personnes est l’exotisme : « Mais l’opération de... », « Mais la thérapie hormonale ça fait quoi ? », « Mais quand tu étais… ». Ces questions arrivent systématiquement.
G : Dans une discussion avec une femme somalienne on s’est aperçu qu’on nous demande constamment qu’est-ce qu’on a dans nos culottes : elle parce qu’on suppose à priori une infibulation [4], moi parce qu’on suppose à priori une miraculeuse reconstruction chirurgicale. Qu’elle soit économiste, ça n’a aucune importance dans la relation : ce qui intéresse c’est la donnée exotique.
D : Quand on nous le demande, ils le font comme si c’était quelque chose de légitime, dans le sens que personne ne se pose la question : « Mais je suis en train de questionner une autre personne à propos de ses organes génitaux. »
G : Ça aussi ça rentre dans le privilège de la majorité, qui décide que ce qui est hors la norme peut être soumis à une série de questions pour comprendre comment le situer. Ce n’est pas envisageable que ces questions puissent être inopportunes ou dérangeantes.
D : Mais c’est quoi ce dégoût profond qui passe du personnel au politique ?
G : Je me souviens qu’une fois tu as dit : « Celui qui n’est pas visible n’a pas de droits ». Nos revendications ne figurent pas dans ce que les gens savent des demandes des personnes trans, parce qu’elles ne font pas partie de l’imaginaire acquis. La chirurgie, par exemple, n’est que celle liée à la féminisation du corps. A mon avis, ce n’est pas un hasard que la technique pour la vaginoplastie reflète l’image que les hommes ont toujours eu de la génitalité féminine, c’est-à-dire un pénis tourné vers l’intérieur ! Tandis que pour nous la chirurgie est une pratique qui mutile et qui n’est franchement pas satisfaisante. Cependant il ne s’agit pas que de meilleures phalloplasties pour tout le monde : tout ce qui nous concerne ne fait pas partie de l’imaginaire commun, y compris les effets de la thérapie hormonale. C’est là le résultat d’avoir vécu dans l’ombre de l’activisme des femmes trans. Aujourd’hui on ne délègue plus, et comme ça on peut revendiquer notre spécificité, construire nos imaginaires.
D : Celui qui n’est pas visible rend invisible ses droits et ses propres spécificités. Aux autres et souvent aussi à lui-même. Sur les trans FtM il existe toute une série de choses non dites qui sont à la base de la difficulté à donner un nom à la forme particulière de discrimination à laquelle on est soumis. Elle est très différente de celle qui concerne les trans MtF. Plus rampante et sans forme, parce qu’elle est inhérente au système même des genres, duquel nous ne sommes pas exclus mais dans lequel nous sommes absorbés, phagocytés, même malgré nous.
Même à l’intérieur de la communauté transgenre, les problématiques qui nous concernent sont peu perçues, et cela relève aussi de notre responsabilité.
Souvent je sens que tant qu’on n’est pas capable d’élaborer ces discours, on est trans mais on ne l’est pas, parce que les problématiques qu’on vit sont invisibles autant que nous. Elles ne sont pas tangibles, concrètes. La demande d’un masculin plus flexible ne peut pas être appuyée par une loi, mais elle nécessite un changement culturel en profondeur, lent et difficile. Ce n’est pas une chose tangible ou immédiate. Pourtant c’est ce qui conditionne majoritairement notre réalité de « transsexuels incroyables ».
Au-delà de la question de la chirurgie, qui n’est pas secondaire mais qui est quand même une revendication visible et tangible, les revendications non visibles et non tangibles sont toutes relatives à notre qualité de vie, très basse, dans un monde où notre masculin n’est absolument pas prévu. Elaborer une pensée autour de cela est plus difficile que de discuter, par exemple, de discrimination au travail. Normalement quand on parle des problématiques liées au transsexualisme FtM ou au transsexualisme en général, on dit « Pour les trans FtM c’est moins.. » : pour les trans FtM le travail est moins problématique, la discrimination sociale est moins perçue, les stéréotypes appliquées au transsexualisme font moins de dommages… Mais ce n’est pas vrai : pour les trans FtM tout ça se concrétise en questions moins visibles, donc plus difficiles à dénoncer.
G : Moins violentes. Ou, plutôt, violentes de façon différente parce que moins palpables.
D : On a du mal à dire qu’est-ce qu’elles sont et où elles sont mais pourtant leur pression est constante et influence énormément notre qualité de vie.
G : Peut-être il y a un manque de littérature sur tout ça. Justement parce que c’est une discrimination invisible ou moins tangible, il y a un manque de récit. Quand les imaginaires manquent, il manque aussi les récits et la possibilité de raconter une chose qui, en théorie, n’existe pas. C’est comme une invisibilité intériorisée : tu es tellement enfermé dans le fait de ne pas être visible que tu ne peux pas raconter ce qui t’arrive comme quelque chose d’extraordinaire, tu le vis comme quelque chose de quotidien. Et même si tu en avais la perception, peut-être intime, tu ne le raconterais pas avec les mots de la discrimination parce que tu ne rentres pas dans un imaginaire de discrimination.
D : En réalité je suis discriminé de façon si constante et inhérente à la culture même que je n’arrive même pas à dire combien je suis discriminé. Parfois toi aussi tu y crois : « Mais je me plains de quoi ? Effectivement je suis moins tout ! ». Si tu adoptes cette optique, tu risques de croire toi-même à ce faux privilège. Sauf si ensuite tu ne réussis plus à nommer ton mal-être profond ainsi que la difficulté de trouver ta propre dimension. Parce que la réalité c’est que tu n’as pas ta place à toi. A la différence des trans MtF pour lesquelles un imaginaire existe, souvent négatif et à combattre mais qui, paradoxalement, constitue au moins un repère ; il y a une communauté de référence avec laquelle éventuellement se confronter, aussi par rapport à ses limites.
Pour ce qui nous concerne, par contre, formellement on voudrait que tout se résolve dans la très convoitée invisibilité. Comme si ce n’était pas vrai que cette dernière prend ensuite ta place, et t’enterre à nouveau derrière un masque. C’est difficile de critiquer cette solution, parce qu’en apparence c’est le but ultime, ce que toi tu as voulu pour toi-même. Il arrive même que quand tu essaies de parler du fait que le masculin donné ne te correspond pas, par manque de mots avec lesquels raconter ton quotidien, ce soit perçu comme si en quelque sorte tu avais changé d’avis, parce qu’un masculin différent de celui classique est en substance plus féminin.
G : Comme il n’y a pas de réflexion sur le masculin, les imaginaires et les modèles du masculin sont peu nombreux et classés par degrés : on est plus ou moins mâle par rapport à un idéal de super-mâle.
D : Donc si tu essaies de produire une réflexion sur le masculin, en en faisant quelque chose d’un peu plus féminin pour qu’il s’adapte à toi, en quelque sorte tu le « déclasses ». Là, les personnes ne comprennent plus et celles qui ont le moins de tact te le disent même explicitement : « Excuse-moi, mais toi tu as choisi de… ». Oui, j’ai choisi de… Mais je voudrais aussi m’exprimer sur comment…
Je n’ai jamais choisi d’acheter un paquet toutes options !!
G : C’est sûr que quand tu affirmes être transsexuel, dans la perception commune tu redeviens une femme et la discussion s’éteint vite.
D : Soit tu incarnes le masculin qui t’es donné, soit tu essaies d’en élaborer un à toi un peu différent, et alors tu es en dehors du masculin. De femelle à mâle : tu inventes ou mieux tu performes ta façon d’être mâle et elle est perçue à nouveau comme quelque chose de différent du masculin.
G : Tu es réabsorbé à nouveau dans le féminin, qui est un contenant beaucoup plus ample. Le féminin a une histoire d’articulation et de réflexion sur ce qu’il est ; tandis que dans le masculin cette réflexion manque et il est plus difficile de se référer à des nuances, des variations dans lesquelles se reconnaître. On n’a même pas été éduqués au masculin, donc notre réflexion ne peut pas se concentrer sur la mise en question du privilège : nous on vit ce privilège depuis pas longtemps et on a senti presque tout de suite qu’il ne nous appartenait pas ou qu’on ne le voulait pas. En plus, dès que tu déclares être trans tu perds immédiatement ce privilège parce que tu es à nouveau perçu comme femme.
D : Mais de quel privilège tu parles ?
G : La première chose qui me vient à l’esprit est que les hommes ne se sentent pas légitimés à t’importuner. Si tu es une femme qui attend à l’arrêt du bus, à cinq ils te proposent de te déposer ; mais tu es en train d’attendre le bus, pas quelqu’un qui passe et qui te gonfle !
Sur un lieu de travail, si c’est une femme qui dit quelque chose, on n’en tient peu compte, si c’est un homme qui le dit, il obtient tout de suite de l’attention. Etc.
D : Moi, ce qui ne me va pas, c’est d’être dans un masculin qui est carré. J’ai l’impression que le masculin ne fonctionne que par paramètres : dedans ou dehors. Si tu es A alors tu es un homme, si tu es quelque chose de différent de A, alors tu ne l’es plus.
G : Parce que le masculin se définit par négation du féminin. Le féminin a toujours été défini par un masculin dominant, pris comme absolu. Pour ça nous aussi on a des difficulté à naviguer dans le masculin : on revendique un masculin différent. Oui, mais lequel ? D’abord il faudrait définir le masculin pour ensuite comprendre quoi garder et comment.
Moi je me sens plus à l’aise avec les "o" qu’avec les "a" [5], avec un corps fait d’une certaine façon plutôt que d’une autre. A propos de voyelles et d’invisibilité, une anecdote me vient à l’esprit : j’avais commencé le traitement hormonal depuis 9 mois, j’étais déjà à Milan et je « passais » au masculin ; je suis rentré à Palerme pendant quelques jours, et les personnes me voyaient au féminin. Quelques mois après je suis retourné à nouveau en Sicile et je suis « passé » même dans un petit village pas loin de Palerme : ça a été la confirmation que j’étais indiscutablement « homme » [6]. Repenser à ces anecdotes à rendu beaucoup moins important mon stress d’être reconnu.
D : Le masculin est aussi une question de latitude. Une des questions les plus fréquentes pour qui commence un parcours de transition est : « Combien de temps il me faudra pour « passer » ? ». La prochaine fois je répondrais : « Ça dépend de la latitude à laquelle tu te trouves ».
G : Mais il faudrait ouvrir une réflexion aussi sur le rapport à la chirurgie : l’expérience trans n’est pas forcément la recherche à tout prix d’un physique prédéterminé, et le rapprochement avec le masculin ne consiste pas juste à avoir ou pas un certain type de physique. Du moins en théorie…
Si on n’élabore pas la diversité on reste esclaves de l’imaginaire dominant et, en conséquence, de l’anxiété d’adéquation.
D : Si je devais dire où sont les contenus du masculin, je saurais peut-être mieux te dire où ils ne sont pas. Dans mon expérience mon masculin ne réside pas dans toute la série de pratiques qui tendent à consolider le privilège.
G : Il semble que la seule dimension du masculin soit le privilège et que la seule définition du masculin soit d’être doté, dès la naissance, d’un pénis. Si tu ne rentres pas dans cette définition tu es irrémédiablement femme : si je dis que je suis trans je ne suis plus un interlocuteur masculin et donc je ne suis pas non plus dans la position de privilège, qui nous a été souvent reproché dans notre choix d’aller vers le masculin.
D : Mais ce privilège ne dure pas longtemps, parce que pour le garder tu dois rester au placard.
G : Ça ne vaut pas la peine de rester au placard pour ce privilège. Tu te sens comme un clandestin du genre : tu profites des avantages du masculin tant que tu reste au placard. Quand tu rentres dans la « légalité », c’est-à-dire que tu déclares ta condition de trans, immédiatement tu en es privé.
D : Je ne crois pas que les personnes qui choisissent de rester invisibles le fassent pour garder le privilège, mais pour se soustraire au poids de la discrimination, à la fatigue de devoir élaborer la diversité avec soi-même… En tout cas le bénéfice du privilège ne fait pas gagner grand chose par rapport au fait de devoir jouer pour toute la vie. Le prix à payer est si élevé que tu n’as pas le sentiment de vivre le privilège, mais d’être un clandestin, avec le stress qui s’ensuit.
G : A mon avis, dans notre réflexion sur le masculin, le fait d’être conscient d’un privilège qui en réalité disparaît au moment où tu dis que tu es trans peut être un apport. Quand je déclare ma transsexualité je m’aperçois d’une part que je ne suis plus perçu comme un danger ou une menace, mais d’autre part que je ne suis plus un objet de désir.
D : De dangereux à inoffensif. De mâle à femelle. C’est une question d’écarts perceptifs…
G : Encore une fois, je crois que notre réflexion sur les imaginaires est importante, surtout le détachement du masculin et du féminin de la génitalité.
D : Je crois que l’expérience de traverser les genres est une des contributions les plus précieuse qu’on puisse porter. Combien de personnes peuvent parler de genre en ayant traversé masculin et féminin dans leur acception chimico-physique et sociale ? Nous on vit et on traverse réellement les deux genres, sans nécessité apparente de nouvelles catégories d’appartenance.
G : Cet aspect ne touche pas les filles trans, au moins celles visibles, parce qu’elles sont constamment renvoyées, même de façon violente, au fait d’être trans. Dans l’histoire de la communauté ça a été sans doute un avantage parce qu’il a amené les personnes à réagir. De revendiquer avec fierté une condition méprisée et stigmatisée par la société fait partie de l’histoire de la communauté gay et lesbienne, mais surtout de la communauté trans, qui a toujours été la plus exposée et en même temps la moins protégée. C’est une conscience que les filles trans ont, et qui nous manque.
D : Notre réflexion sur les genres part d’une base entièrement empirique : on est parti dans le parcours de transition à la recherche d’un plus grand bien-être personnel et on est tombé sur quelque chose de beaucoup plus gros en chemin, en le vivant dans notre chair. L’objectif était différent, mais on s’est retrouvé face à une situation imprévue et inédite. Le désir de se rendre visibles vient aussi de ça, pour témoigner de cette « découverte ». Le voyage à travers les genres a porté à la lumière tellement de contradictions et d’impostures dans le système que ça devient presque impossible de poursuivre son propre parcours de vie comme si de rien n’était. Même si après ça se traduit en non-appartenance, en difficulté à nouveau de trouver sa place. Moi je le vis dans le monde du travail, dans la façon que mes collègues hommes ont d’interagir avec mes collègues femmes. Ils n’arrêtent pas de minimiser le plan professionnel et d’exagérer le plan sexuel. C’est une dynamique qu’il ne suffit pas d’appeler discrimination, parce que c’est quelque chose de plus pernicieux. La discrimination je la vis comme quelque chose de plus évident, à laquelle tu peux t’opposer. Ces dynamiques sont par contre sournoises, si bien que quand je fais une critique ou que je montre que je n’accepte pas certains comportements c’est moi qui devient le bizarre, le différent, l’étrange parce que je ne m’amuse pas mais que je m’énerve pendant le « jeu » collectif. Comme si cet abus n’était qu’un innocent jeu de société. Mais si tu le fais remarquer ça devient de la parano de ta part…
Le résultat est qu’on évite certaines discussions en ma présence. Je suis à nouveau un objet non identifié qui rôde au milieu d’ « eux ».
G : C’est politiquement incorrect de dire certaines choses comme : « Mettez un trans dans vos bureaux : ça fera une dissuasion au harcèlement sexuel ! ».
Le sens commun dit que tu es moins homme si tu remarques ces choses, parce que tu as été – et tout compte fait tu l’es encore maintenant – femelle. Ce qui devrait en ressortir par contre c’est un vécu qui nous permet de voir ces choses « du côté du masculin » et de les dénoncer. Un jour j’attendais une personne et je me trouvais dans un lieu où il y avait d’autres personnes qui me regardaient d’un air menaçant, mais c’était simplement parce que j’étais un étranger dans cet endroit. A ce moment-là la peur de pouvoir être violé m’est revenue : m’est revenu le sentiment d’être traqué et violé. J’ai vu les regards comme des regards de viol, je les ai lus au féminin. Ça a été la seule fois où j’ai senti ce qu’était le conditionnement féminin : ce n’est pas seulement d’être importuné dans la rue, mais d’être obligé à vivre dans une dimension de peur et de méfiance. Dans la vie je n’ai jamais eu peur de la petite impasse dans le noir de la nuit, je l’ai toujours traversée, mais évidemment quelque chose est resté. Cette expérience m’a servi à métaboliser la peur et à me faire sortir la rage pour une violence subie sans jamais réagir ; et en relisant comme violence aussi toutes ces attitudes de sûreté arrogante qu’ont beaucoup d’hommes, j’ai dépassé le sentiment de malaise envers le masculin que je portais en moi dès le début de la transition.
D : Des fois j’ai le sentiment que pour expliquer il faudrait partir de trop loin. Aux collègues sexistes, qu’est-ce que tu dois expliquer ? Le petit guide du privilégié ? Tu devrais dire que la blague sur la collègue, sur le gay, sur l’immigré n’est pas innocente mais coupable ?
G : Après tu vois que même les personnes trans reproduisent un stéréotype de discrimination, en suivant la vague de respectabilité du moment, quand elles cherchent quelqu’un à inférioriser pour se sentir intégrées. Je crois que c’est un aveuglement gigantesque que de vouloir rentrer par la fenêtre de la « normalité » après avoir été chassés par la porte.
D : L’espoir est aussi qu’on se libère, dans les lieux de socialisation des hommes trans, de l’anxiété d’inclusion qui amène à reproduire les mêmes mécanismes, sans se rendre compte que ce sont exactement les mêmes qui nous excluent.
G : Ce monde-ci n’est pas fait pour les personnes trans, donc on se réfugie dans ces micro-dimensions rassurantes qui permettent de ne pas gérer la diversité mais d’obtenir sans cesse des confirmations non critiques.
D : Objectivement, la gestion de notre diversité est très coûteuse. Je réfléchis depuis longtemps à ça et je n’avance pas beaucoup : les alternatives possibles sont vraiment peu nombreuses. Soit tu t’assimiles et tu fais l’homme qui se marre avec les copains quand une femme passe, soit tu acceptes l’exclusion et la lutte quotidienne.
G : Même les hommes qui ne veulent pas faire partie de la bande vivent de façon pesante cette exclusion : celui qui n’est pas mâle de la façon qu’il faut se voit féminisé. C’est la même chose pour nous : si on ne respecte pas les modalités de la bande on n’est plus reconnu comme des hommes. Pourtant notre réflexion sur le masculin ne porte pas uniquement sur la diversité, mais aussi sur les appartenances. La diversité n’est pas un ailleurs absolu mais elle a des points de contact, des tangentes, qu’il serait tout aussi important de reconnaître et d’explorer. Une de ces tangentes est à mon avis le désir, la solitude avec laquelle on peut vivre ce désir, qui est une particularité du masculin que j’aime beaucoup. En parlant avec quelques hommes j’ai trouvé une certaine complicité sur ce point. Quelqu’un s’est même étonné que je connaisse ce type de sentiment.
D : Même ceux qui sont dans la bande, tu vois qu’ils y sont avec un niveau variable de malaise. Pour certains c’est vraiment évident, on le voit. J’ai même demandé à quelqu’un pourquoi il y restait, et la réponse a été qu’en définitive ce n’était qu’un jeu. Comme si c’était un renoncement secondaire de ne pas être soi-même pour pouvoir rester dans le groupe ! Ceux qui décident de ne pas jouer le jeu sont peu nombreux et vivent dans une situation de solitude et d’isolement que je sens très lourde. Mais dans l’adhésion aveugle au groupe je devrais être tellement faux, tellement éloigné de ce que je veux être, que je souffrirai encore plus.
G : A mon avis la nouveauté de ces dernières années est que toujours plus de trans revendiquent une autonomie propre de narration. Et ils veulent aussi s’affranchir de la « légitimation diagnostique », qui découle de ce rapport vertical entre les personnes trans et la science médicale. Dans la scène activiste, en plus de la sortie de la condition de « maladie », le début d’une présence trans s’est affirmée : nous sommes sujets qui narrent avec des histoires spécifiques, qui ne veulent pas rentrer dans des standards de soin. Je voudrais pouvoir dire la même chose aussi en ce qui concerne les modèles, mais je crois qu’en ce moment c’est prématuré. Cependant le standard de soin réfléchit les modèles, il est lui-même façonné sur la base d’un modèle culturel, donc ces deux choses avancent ensemble en quelque sorte. Nos narrations sont beaucoup plus complexes. Plus ambiguës, si on les lit dans une optique d’appartenance linéaire à un modèle ; mais moi je lis cette ambiguïté comme de la liberté expressive.
Il me semble que certains parmi nous sont en train d’essayer de donner autonomie et légitimité à la condition trans à travers elle-même : une expérience de vie qui a sa spécificité, qu’on peut ramener juste à l’expérience de traverser - le mot « trans », justement – mais que chacun réalise dans des modalités, des circonstances, des optiques complètement différentes les uns des autres. Non seulement différentes de l’unique expérience à laquelle on voudrait, de l’extérieur, nous ramener, mais aussi différentes entre nous.
On peine à concilier cette pluralité de vécus si différents et parfois aussi éloignés entre eux : il y a une difficulté de communication qu’on n’arrive pas toujours à combler, et ça, à mon avis, c’est un élément qui, pour l’instant, freine la création d’une communauté et d’une identité trans, même si on veut l’imaginer la plus fluide possible.
D : Nous avons de grosses difficultés à extraire un dénominateur commun de cette pluralité et nous n’avons encore pas trouvé les mots pour parler de nous-mêmes dans un monde uniquement fait d’absolus et de dualismes. Exprimer avec sa vie avec des concepts qui n’ont pas été acquis ni par la culture ni par la grammaire, c’est comme avancer en terrain miné. Soit tu dois forger des néologismes à chaque tournant du discours, soit tu dois aplatir la communication sur les termes existants, avec le risque de finir par te mettre en cage toi-même.
G : Il me semble que le peu de dénominateurs communs ne reflètent pas suffisamment la complexité du monde trans et vu qu’il manque une réflexion identitaire, celui qui les a proposés a dû opérer une simplification sémantique pour être le plus inclusif possible. Dans cette opération de simplification, le protagoniste s’auto-exclut au nom d’une communauté qui de fait n’existe pas, et il cesse donc d’être crédible : c’est comme si on avait de la peur ou de la méfiance à l’égard de la singularité d’une expérience, et qu’il fallait s’anéantir pour trouver des éléments unificateurs. Mais pour moi cette modalité n’a pas de sens.
En ce qui concerne le langage, le seul inclusif jusqu’à maintenant a été le langage médical, et nous ne sommes pas sortis de la schématisation due aux sigles avec lesquels ils nous enregistrent sur les fiches cliniques. FtM : la seule définition identitaire pour l’instant vient de l’extérieur et elle ne fait que répéter la binarité de genre duquel on voudrait s’affranchir. J’ai l’impression que le queer non plus n’a pas produit des changements de langage, du moins dans les langues latines, à l’exception des astérisques dans les mails. Mais on ne peut pas les prononcer, du moins pour l’instant.
Connaître la façon dont les personnes trans ont été socialisées dans d’autres cultures peut servir à relativiser ce qui se passe dans la nôtre, par exemple la base scientifique autour de laquelle le discours sur le transsexualisme s’est construit. La même chose, pour l’instant, vaut pour la culture queer : la culture catholique, dont nous sommes empreints, est basée sur l’idée de « sexe » plutôt que sur celle de « genre », et donc centrée sur une donnée corporelle immuable. Il semble difficile que des concepts « d’importation » déracinent une culture sédimentée.
D : Le problème est que nous sommes un tas d’identités difficiles à synthétiser. Celui qui essaie perd en crédibilité parce qu’il ne se raconte pas lui-même. Et le nombre de personnes qui décident de se raconter est dramatiquement trop bas pour réussir à représenter notre pluralité. Donc l’alternative la plus immédiate ce sont les revendications minimes partagées. De toute façon il existe une énorme différence dans la narration de soi entre ceux qui parviennent à s’adresser à une association à 40 ans ou plus, et ceux qui, toujours plus fréquemment depuis quelques années, y parviennent à 20-25 ans. Leur façon de concevoir le genre, et par conséquence eux-mêmes, est totalement différente. Chez les premiers il y a une souffrance, un sentiment d’aliénation et la suspicion d’être affligé d’une pathologie qu’on trouve de moins en moins chez les deuxièmes. Ceux qui ont 30-40 ans ont grandi avec un manque total d’informations, ont un parcours de vie plus long et dans toutes les phases de leur vie ont vécu avec le manque de connaissance et la culpabilité. Les garçons qui arrivent aujourd’hui ont un accès beaucoup plus facile aux infos et ont grandi à une époque où le genre est progressivement devenu un peu plus malléable. Ils sont donc capables d’appréhender le parcours de transition comme une conquête de soi, en se construisant un parcours « personnalisé » : je prends ce qui me plaît, mais pas ce qui ne me plaît pas.
G : Mais après, cette première approche entre en collision avec une réalité encore façonnée par le dualisme de genre. C’est difficile de prendre dans le genre choisi seulement ce qu’on veut : on retrouve beaucoup de choses collées à soi ou bien on ne les remet pas en question parce qu’elles confirment l’appartenance au genre choisi.
D : Bien qu’on soit conscient de la dangereuse banalisation, le dénominateur commun est que tu te déplaces d’un point pour aller à un autre : c’est le désir.
G : Mais dans la définition identitaire dominante – FtM – il n’y a pas le mot désir : il y a F et M. La lettre « t » est un accident survenu entre les deux : comme par hasard elle est écrite normalement en minuscule, tandis que le M et le F sont en majuscule ! Mais nous ce qu’on revendique c’est la minuscule… Justement parce qu’il n’y a aucune réflexion sur le langage et sur la capacité à se raconter de façon différente, on ne peut pas penser à exprimer d’autres choses avec des mots qui sont déjà connotés. On ne peut pas se décrire avec des mots créés par d’autres, parce qu’ils ont des significations spécifiques et on ne peut pas faire semblant d’y mettre dedans aussi les nôtres. Le seul dénominateur, malheureusement, reste : de Femelle à Mâle.
D : Parce qu’on est en train d’essayer d’exprimer un concept qui est propre au monde transgenre, avec des mots de la culture dominante, décidément basée sur le genre. Le monde est fait pour des personnes qui naissent dans un genre et y restent. Le langage est fait par et pour des personnes qui naissent dans un genre et y restent. Si tu dois te faire comprendre aussi par ces personnes…
G : Ce que je voudrais communiquer c’est le fait de traverser, mais si je résume mon expérience avec un sigle j’ai déjà posé un obstacle à ma narration, parce que dans ce sigle sont contenus et véhiculés des significations qui vont dans la direction opposée à ce que moi je voudrais dire, et ces contenus sont ceux du réductionnisme bipolaire mâle/femelle, auquel il manque vraiment l’expérience du « traverser ». Aujourd’hui le langage commun limite ou entrave ma narration, en la rapportant à ce qu’elle peut contenir.
D : Je ne vois pas beaucoup d’alternatives à court terme, autre que communiquer à travers le langage commun. De cette façon on rend plus flexibles les termes connus, avec une espèce de processus d’hybridation qui fait en sorte que dans les mots connus rentrent aussi de nouvelles significations, et que moi aussi je puisse y être représenté.
G : Le problème n’est pas linguistique, mais concerne les contenus : le discours sur le langage n’est pas libéré du discours sur l’imaginaire : le langage est la codification de l’imaginaire.
C’est le même problème du masculin quand on dit que le masculin n’est pas un conteneur qui nous appartient, cependant on utilise ce mot pour parler de nous. Le travail est celui de remplir les mots de nouveaux contenus et de faire en sorte que ces contenus deviennent partageables. Visibles et partageables.
[1] Reed Erickson (1917-1992), patient de Harry Benjamin, investissant son très riche héritage dans la création de Erickson Educational Foundation, qui, entre 1964 et 1975, a financé les études des principaux groupes de recherche sur le transsexualisme de cette période, dont celui de Money et Benjamin même, et il s’engagea pour améliorer les normes de soin pour la santé des personnes trans.
[2] Ndt. : La loi 164, votée en 1982, reconnaît la condition de transsexualité et règlemente le changement de sexe et d’état civil. Elle prévoit que pour obtenir le changement d’état civil il faut en faire la demande au tribunal, qui donne une première autorisation obligatoire pour l’opération chirurgicale de changement de sexe, et, seulement suite à ça, autorise avec une autre décision le changement d’état civil. Ça se traduit donc pour les personnes trans par une longue procédure bureaucratique très chère qui fait souvent suite à leur psychiatrisation.
[3] Fondateur de la Coordination nationale FtM et co-fondateur de l’association Crisalide-Azione trans. Il est l’auteur du livre « Il viaggio di Arnold » (Le voyage d’Arnold - 2000), duquel a été tiré la pièce de théâtre « One new man show ». Il a dirigé la traduction italienne du roman de Leslie Feinberg « Stone Butch Blues » pour la maison d’édition Il dito e La Luna. Plus d’infos sur www.davidetolu.it et www.crisalide-azionetrans.it
[4] Ndt. : Opération qui consiste à faire passer un anneau à travers les petites lèvres chez la femme ou à coudre partiellement celles-ci, afin d’empêcher les rapports sexuels.
[5] Ndt. : En italien, la lettre "o" à la fin d’un mot est souvent la marque du masculin, la lettre "a" celle du féminin.
[6] Ndt. : Milan se trouve dans le nord de l’Italie, Palerme dans le sud. Le modèle de masculinité du sud de l’Italie est plus viril(iste)/macho que celui du nord.
)
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (10 Mo)