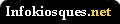N
Notre Individualisme et autres textes...
Une introduction à l’individualisme anarchiste
mis en ligne le 4 août 2011 - Albert Libertad , anonymes , Aviv Etrebilal , Giuseppe Ciancabilla , Max Stirner
Sommaire
• Notre individualisme - Aviv Etrebilal | p3
• Liberté individuelle et société - Max Stirner | p10
• L’Individu contre l’Etat - Max Stirner | p15
• Sur la responsabilité individuelle | p17
• L’Individualisme - Albert Libertad | p24
• L’important ce n’est pas de savoir d’où on vient mais de décider où on va | p30
• Contre l’organisation - Giuseppe Ciancabilla | p33
Notre Individualisme
« Le sage considère la société comme une limite. Il se sent social comme il se sent mortel. »
Han Ryner, 1903.
Si le mot « individualisme » peut paraitre confus de nos jours, c’est que des décennies d’âpre propagande sont passées par là, qu’elle soit capitaliste, libérale, bourgeoise ou marxiste et anti-capitaliste. L’individualisme, c’est chacun pour soi et dieu pour tous, c’est l’atomisation engendrée par l’inconscience de classe, la perte des idéaux collectivistes au profit de l’égoïsme à courte vue et de la réussite sociale ou encore un symptôme du malaise de la société moderne. Voici, pour faire court, les quelques stéréotypes auxquels nous devons, anarchistes individualistes, faire face. C’est pourquoi, il me semble aujourd’hui nécessaire de défaire quelques nœuds en exposant ce que j’entends par là et ce que je combat. Il faut rester conscients cependant, que rarement un terme n’aura autant été débattu, approprié et réapproprié que celui d’« individu ».
L’individu, pour moi, n’est pas une unité transcendantale, une conception mystique, spirituelle ou métaphysique sur laquelle disserter sur les bancs moisis des universités. C’est une réalité vivante, en mouvement, qui ne se fige pas dans la certitude d’une idéologie ou de croyances. En cela, pour l’anarchiste individualiste, l’anarchisme n’est pas une cause pour laquelle l’individu doit se sacrifier. Au contraire, ce sont les idées anarchistes qui doivent servir mon individualité. Je peux citer Max Stirner plutôt que de le plagier : « Foin donc de toute cause qui n’est pas entièrement, exclusivement la Mienne ! Ma cause, dites-vous, devrait au moins être la « bonne cause » ? Qu’est-ce qui est bon, qu’est-ce qui est mauvais ? Je suis moi-même ma cause, et je ne suis ni bon ni mauvais, ce ne sont là pour moi que des mots. Le divin regarde Dieu, l’humain regarde l’Homme. Ma cause n’est ni divine ni humaine, ce n’est ni le vrai, ni le bon, ni le juste, ni le libre, c’est — le Mien ; elle n’est pas générale, mais — unique, comme je suis unique. Rien n’est, pour Moi, au-dessus de Moi ! » (Max Stirner, L’Unique et sa propriété, 1845)
C’est ainsi qu’il posa l’une des fondations les plus solides de l’individualisme :
il n’y a pas de Cause Supérieure, et lorsqu’un idéologue nous en impose une, nous lui opposons notre propre cause, c’est à dire nous-mêmes et notre liberté qui pour respirer doit aussi s’épanouir, à coté ou avec les autres, dans leur combat mené pour leur propre liberté.
C’est cette libre-association, dans laquelle peut respirer notre liberté indissociable de celle des autres, que nous opposons à l’Etat et aux formes étatiques.
C’est Bakounine qui disait, « Je ne suis vraiment libre que lorsque tous les êtres humains qui m’entourent, hommes ou femmes, sont également libres. La liberté d’autrui, loin d’être une limite ou une négation de ma liberté, en est au contraire la condition nécessaire et la confirmation. Je ne deviens vraiment libre que par la liberté des autres, de sorte que, plus nombreux sont les hommes libres qui m’entourent, et plus étendue et plus large est leur liberté, plus étendue et plus profonde devient la mienne. C’est au contraire l’esclavage des autres qui pose une barrière à ma liberté, ou, ce qui revient au même, c’est leur bestialité qui est une négation de mon humanité parce que, encore une fois, je ne puis me dire libre vraiment que lorsque ma liberté, ou ce qui veut dire la même chose, lorsque ma dignité d’homme, mon droit humain, qui consiste à n’obéir à aucun homme et à ne déterminer mes actes que conformément à mes convictions propres, réfléchit par la conscience également libre de tous, me reviennent confirmés par l’assentiment de tout le monde. Ma liberté personnelle ainsi confirmée par la liberté de tous s’étend à l’infini » (Bakounine, Dieu et l’Etat, 1882). Lui aussi préfigurait alors l’anarchisme tel que nous l’entendons ici.
Est-il encore nécessaire après tout cela, de préciser qu’il ne s’agit pas d’un « seul contre tous », de soi contre les autres individus ? Il semble que oui, si l’on tient compte de lectures contemporaines.
Si tant est que nous ayons des modèles, ce qui entrerait en conflit avec nos principes, le mythe Scarface/Tony Montana n’en serait pas un. Car là où celui-ci, pour sortir du troupeau le détruit et en provoque l’holocauste, nous opposons la volonté d’en finir avec le troupeau par la transformation de ses moutons en individus. Nous voulons être libres, ensembles, avec pour carburant l’entraide. L’exemple pré-cité est un peu l’archétype selon moi, de l’« individu » au sens libéral et bourgeois, muni d’une caution gangstériste à deux-sous, je n’ai rien à voir avec cela.
L’anarchiste individualiste part de lui même pour s’opposer à la domination, c’est à dire qu’il ne se définit pas par une quelconque condition ou appartenance qui le dépasserait, qu’elle soit identitaire, sociale, de naissance, ou idéologique. On peut dégager comme principe de base, tant que possible, que l’individualiste s’« engendre » lui-même. C’est à dire qu’en dehors de ses choix conscients et de son éthique personnelle, rien ne peut le définir, le délimiter, le classer. C’est parce que je suis individualiste que je ne reconnais pas le principe de « nature humaine » dans sa conception Rousseauiste (l’homme est naturellement bon, c’est la société qui le corrompt) comme dans sa conception Hobbésienne ( l’homme est naturellement et instinctivement mauvais, il est un loup pour l’homme, une instance supérieure est nécessaire pour contenir sa dangerosité naturelle). Précisément, la nature humaine est un concept qui détermine l’individu hors de sa volonté, qui fait de ses choix des non-choix et surtout, qui sert d’excuse à des comportements autoritaires et donne raison au principe même d’autorité, le rendant nécessaire. C’est parce que l’humain serait « naturellement » et structurellement incapable de se contrôler, de ne pas assaillir son prochain, que des institutions comme la Police et l’Etat existent. C’est comme cela que l’on nous a fait intégrer et digérer l’idée de l’autorité comme chose nécessaire, qui ne peut pas ne pas être.
Seulement, si la nature humaine n’existe pas, qu’est-ce qui fait de nous ce que nous sommes ?
J’affirme sans sourciller que ce que je suis intrinsèquement n’est que la somme de mes actes, de mes expériences, de mes choix et de l’exercice de mes responsabilités. Bien entendu, rien de tout cela n’est isolé du reste de la société ou des choix des autres individus qui la composent, et si cela influence mes choix, cela ne les détermine pas pour autant. Sinon, comment expliquer que face au même choix et avec le même bagage « social » et « culturel », deux individus peuvent faire deux choix diamétralement opposés ? C’est contre le déterminisme social – celui des sociologues, des communistes et autres collectivistes – que la sensibilité individualiste s’érige, c’est-à-dire qu’elle se construit aussi par réaction contre une réalité sociale à laquelle je ne peux ou ne veux pas me plier tout en affirmant la prééminence de l’individu sur les groupes sociaux qui uniformisent, nivellent, s’organisent en pouvoir et tendent à subordonner les gens à des chefs ou à des dogmes. Le rejet des identités attribuées sans consentement et souvent dés la naissance (chrétien, juif, musulman, noir, arabe, blanc, français, hétérosexuel etc.), est à mon avis la préhistoire d’une individualité.
Il me parait maintenant clair et compréhensible, et je pense que le lecteur s’y retrouvera, que l’Individu, de fait, s’oppose à la Société mais aussi à tout groupement social, comme les communautés, les castes, les classes, les races, idéologies ou tout autres généralités auxquelles l’individu est sommé de s’intégrer en laissant de coté ses particularités, son unicité indivisible et irrécupérable : ce qui fait de l’individu un individu.
Cependant, l’antagonisme qui existe entre société et individu, ne fait pas non plus des individualistes des ermites, des apôtres de la solitude, ni non plus des êtres entièrement insociables. D’abord parce que l’anarchisme individualiste propose en second lieu (après l’affirmation de l’unicité de l’individu), la libre-association. L’individu n’est pas un être seul, et mon individualisme ne peut s’exprimer que par la reconnaissance de ma propre unicité d’abord, et ensuite, de celle des autres. C’est pour cela que je souhaiterais apporter quelques nuances à ce sujet. Si lorsqu’il est privé de la libre-association, l’anarchiste individualiste n’est quasiment rien, il reste un être seul dans le sens où il possède la capacité d’être « seul » au milieu d’une foule, voire même au sein de l’association elle-même ; et cela parce qu’il ne rend de compte qu’à lui-même, et agit selon son éthique personnelle et pas selon une morale universalisée de force, sans que cela n’empêche l’entraide, la discussion ou autres apports collectifs. La libre-association anarchiste voit l’individu comme une unité alors que chez les communistes, par exemple, l’unité est formée par le groupe, les individus ne sont que des parcelles d’unité.
La société pourrait être la réunion des individus pour une œuvre commune, comme la subsistance. Mais dans ce monde, et dans toutes les formes de société qui ont existé jusque maintenant, je n’en vois aucune qui fut le produit du choix des individus qui la compose. Dans ce monde d’autorité et de domination, je ne vois d’ailleurs pas comment l’œuvre commune d’une quelconque société pourrait être autre chose que la conservation de richesses et l’auto-perpétuation des hiérarchies qui en forment le squelette par le biais de l’association forcée. Il parait d’ailleurs difficile de dissocier la forme sociale des normes qui s’y imposent, et donc des règles, et par extension du châtiment. En Société, il faut rendre compte de ses actes devant une autorité forcement supérieure, qu’elle soit imposée par une minorité à l’intérieur de la société ou par la société toute entière. Or, nous qui combattons toute forme d’autorité autre que l’autorité de soi sur soi-même nous pensons que l’individu ne doit être comptable qu’à lui-même de ses faits et gestes. Il doit lui même mesurer sa responsabilité, et je crois en cette capacité, sans que cela ne relève d’aucun mysticisme, bien que tout dans cette société nous fait tendre vers la déresponsabilisation ou alors vers la responsabilité collective et la culpabilisation individuelle, ces chimères moraliste qui ne peuvent servir d’autres intérêts que ceux d’une auto-flagellation permanente et stérile.
A ceux, classistes en premiers lieu, qui affirment que l’individu est une construction idéologique, je réponds que là où il n’y avait que des individus, conscients ou non de leur unicité, ceux-ci ont créé eux mêmes des schémas qui les ont subordonnés au groupement social classe. C’est là que se trouve l’idéologie, dans la volonté de créer au-dessus des individus, des entités censées les définir hors d’eux-mêmes, en préférant le définir par sa condition (avec toute la contingence que cela implique) plutôt que par ce qu’il a fait de lui-même, ses choix. Le déterminer à accomplir une tache, la révolution sociale par exemple, me parait être l’achèvement de cette négation de la volonté individuelle. Qu’y a-t-il de plus autoritaire au fond que de transformer des personnes en sujets d’étude ou en sujets politiques, de leur assigner une tache qu’ils n’ont pas choisis ? C’est aussi par individualisme que nous refusons toute forme de sacrifice, celui des guerres des Etats, des Causes Supérieures comme celui de la guerre de classe et sa chair à canon prolétarienne. La société communiste telle qu’elle nous est présentée par ses idéologues assermentés nous parait être l’une des pires solutions pour l’émancipation individuelle en ce que l’égalitarisme qui la gouverne rend impossible l’expression de nos différences, parce que l’égalité ne peut s’appliquer que par le bas, et donc aussi par le droit, cela nous l’avons appris de la démocratie et de ses rêveries paradoxalement si pragmatiques. Le droit, et son inévitable corollaire, le devoir, ne peuvent que nous asservir un peu plus à de nouvelles règles imposées d’ailleurs.
L’on pourrait croire que l’individualisme est une idée pacifique, elle l’a été pour beaucoup, notamment pour la frange dite « educationniste » de l’anarchisme individualiste de la Belle Époque (incarnée notamment par Armand, Ryner, Lorulot...) occupée à vivre en communautés ou a expérimenter de nouvelles formes de pédagogies à l’intérieur de ce monde. En ce qui me concerne, et pour deux raisons, ce n’est pas le cas.
Premièrement parce que dans ce monde où tout me subordonne, où mil choses se placent au-dessus de moi-même, l’individu n’a d’autres alternatives que d’être un iconoclaste, un briseur, un incendiaire, le dynamiteur passionné que craignent les architectes de la domination. Car celle-ci ne s’effondrera jamais d’elle-même, elle pourra se réformer, se transformer, se restructurer, se démocratiser, prendre des formes moins rugueuses, être intériorisée voire même réappropriée, mais elle ne s’arrêtera jamais de progresser tant que ne s’insurgeront pas contre elle nos désirs, par la pensée et par l’attaque physique et théorique de ses mécanismes. Dans ce monde, la libre-association doit servir à l’annihilation de l’existant sous toutes ses formes, qu’elles soient physiques ou bien qu’elles relèvent du mécanisme social ou moral.
Deuxièmement parce que dans un autre monde aussi (même si nous ne voyons rien poindre de ce genre), l’individualiste ne peut accepter la pacification des rapports inter-individuels. Éviter le conflit sera toujours une façon d’éviter de le régler.
Voici deux raisons qui font de l’anarchiste individualiste tel que je l’entends un être antagoniste et conflictuel embrassant la guerre sociale, accentuant les conflictualités plutôt que de les subir. C’est également ce qui fait que je puisse être à la fois individualiste et révolutionnaire.
Pour que les choses soient claires, et pour prévenir toute confusion, je ne crois pas en un quelconque surhomme ni suis-je partisan d’un individualisme aristocratique. D’abord parce que je pense que l’individualité et la conscience de sa propre unicité est accessible à tous. Aussi, parce que les théoriciens du surhomme (qu’il s’agisse de Nietzsche, de la littérature romantique ou du national-socialisme) n’ont inventé cette catégorie imaginaire que par goût de l’aristocratisme, dans la volonté de conférer à un groupement, une caste ou une oligarchie, un pouvoir justifié. Ce concept n’a d’ailleurs jamais servi à rien d’autre qu’à écarter certaines catégories du pouvoir et à en implanter d’autres. Parce que je suis anarchiste, je suis avant tout résolument acrate, et je ne souhaite pas remplacer une mentalité d’esclave par une mentalité de maîtres. Mon désir profond, au contraire, est de voir voler en éclat toutes ces catégories qui appartiennent à ce vieux monde, et donc, de faire la guerre à toutes les classes.
Pour moi, la tension anarchiste ne devrait pas se trouver entre égalitarisme et aristocratisme, mais entre émancipation individuelle et libre-association des individus.
Tel est mon individualisme.
Aviv Etrebilal, 2010.
Liberté individuelle et société
La condition primitive de l’homme n’est pas l’isolement ou la solitude, mais la vie en société. Notre existence commence par l’union la plus intime, puisque, avant même de respirer, nous vivons ensemble avec notre mère : lorsque ensuite nous ouvrons les yeux à la lumière, c’est pour nous retrouver sur la poitrine d’un être humain ; son amour nous berce, nous tient en laisse et nous enchaîne à sa personne par mille liens. La société est notre état naturel. C’est pourquoi, à mesure que nous apprenons à nous sentir nous-mêmes, l’union qui a d’abord été si intime se relâche toujours davantage et la dissolution de la société primitive devient de plus en plus manifeste. Si la mère veut, une fois encore, avoir pour elle seule l’enfant, qui naguère reposait sous son coeur, il faut qu’elle aille le chercher dans la rue et qu’elle l’enlève à la compagnie de ses camarades de jeu. Car l’enfant préfère la fréquentation de ses pareils à la société dans laquelle il n’est pas entré de lui-même, mais où il n’a fait que naître.
(...) Lorsqu’une association s’est cristallisée en société, elle a cessé d’être une association, vu que l’association est un acte continuel de réassociation. Elle est devenue une association à l’état d’arrêt, elle s’est figée. Elle est morte en tant qu’association, elle n’est plus que le cadavre de l’association, en un mot elle est devenue société, communauté. Le parti (politique) nous élire un exemple éloquent de ce processus.
Qu’une société, par exemple celle de l’État, rogne ma liberté, peu me chaut. Il me faut bien me résigner à laisser réduire ma liberté par toutes sortes de puissances, par tout être plus fort que moi, voire par chacun de mes semblables. Quand bien même je serais l’autocrate de toutes les Russies, je ne pourrais pas jouir d’une liberté absolue. Mais quant à mon individualité, je ne veux pas qu’on y touche. Or c’est précisément l’individualité que la société prend pour cible et qu’elle entend assujettir à son pouvoir.
Une société à laquelle j’adhère m’enlève, certes, quelques libertés, mais, en contrepartie, elle m’accorde d’autres libertés. Peu importe aussi que je me prive moi-même de telle ou telle liberté (par exemple par contrat). En revanche je veillerai jalousement sur mon individualité. Toute communauté tend, plus ou moins, selon l’étendue de son pouvoir, à s’ériger en autorité au-dessus de ses membres et à restreindre leur liberté de mouvements. Elle leur demande, et elle est obligée d’exiger d’eux, l’intelligence bornée propre aux sujets, elle les veut assujettis, elle n’existe que par leur sujétion. Ce qui n’exclut nullement une certaine tolérance ; au contraire, la société accueillera favorablement des projets d’amélioration, des réprimandes, des blâmes, pour autant qu’ils lui soient profitables : mais le blâme qu’elle accepte doit être "bienveillant". Il ne doit pas être "insolent et irrévérencieux". En un mot, on ne doit pas porter atteinte à la substance de la société, on doit la considérer comme sacrée. La société exige que l’on ne s’élève point au-dessus d’elle, que l’on demeure dans les "bornes de la légalité", c’est-à-dire que l’on ne se permette que ce qui est permis par la société et ses lois.
Il y a une différence entre une société qui restreint ma liberté et une société qui restreint mon individualité. Dans le premier cas, il y a union, entente, association. Mais si mon individualité est menacée, alors c’est qu’elle a affaire à une société qui est une puissance en soi, une puissance au-dessus de Moi, qui m’est inaccessible, que je peux, certes, admirer, adorer, vénérer, respecter, mais que je ne puis ni dompter ni utiliser, pour la bonne raison que devant elle je renonce et j’abdique. La société repose sur mon renoncement, mon abnégation, ma lâcheté, sur ce qu’on appelle humilité. Mon humilité lui donne du courage, ma soumission fait sa domination.
Cependant en ce qui concerne la liberté, il n’y a pas de différence essentielle entre État et association. Aucune association ne pourrait être fondée ni exister sans certaines limitations de la liberté, tout comme un État n’est pas compatible avec une liberté illimitée. Une limitation de la liberté est partout inévitable. Car on ne saurait s’affranchir de tout. Nous ne pouvons pas, simplement parce que nous aimerions le faire, voler comme des oiseaux, car nous ne pouvons pas nous défaire de notre propre pesanteur. Nous ne pouvons pas non plus vivre à volonté sous l’eau, comme un poisson, car nous ne saurions nous passer d’air, c’est là un besoin dont nous ne pouvons nous affranchir et ainsi de suite.
(... ) Il est vrai que l’association procure une plus grande mesure de liberté et qu’elle peut être regardée comme une "nouvelle liberté". On y échappe, en effet, à toutes les contraintes inhérentes à la vie dans l’État et dans la société. Cependant, en dépit de ces avantages, l’association n’en comporte pas moins pour nous un certain nombre d’entraves.
Relativement à l’individualité, la différence entre État et association est considérable : celui-là en est l’ennemi, le meurtrier, celle-ci en est la fille et l’auxiliaire. L’un est un esprit qui exige notre adoration en esprit et en vérité ; l’autre est mon oeuvre, ma création. L’État est le maître de mon esprit, il requiert ma foi et m’impose un article de foi, le credo de la légalité. Il exerce sur moi une influence morale, domine mon esprit, me dépossède de mon Moi pour se substituer à lui en tant que mon véritable moi. Bref l’État est sacré et, par rapport à moi, l’individu, il est l’homme véritable, l’esprit, le fantôme.
L’association, au contraire, est ma création propre, ma créature. Elle n’est pas sacrée. Elle ne s’impose pas comme une puissance spirituelle supérieure à mon esprit. Je ne veux pas être l’esclave de mes maximes, mais bien plutôt les soumettre à ma critique constante. Je ne leur accorde aucun droit de cité chez moi. Je veux encore moins m’engager pour tout mon avenir dans l’association, lui "vendre mon âme", comme dirait le diable, et comme c’est réellement le cas quand il s’agit de l’État ou de toute autre autorité spirituelle. Je suis et resterai toujours vis-à-vis de moi-même plus que l’État, que l’Église, que Dieu, etc. et donc, infiniment plus, aussi, que l’association.
On me dit que je dois être un homme parmi mes semblables (Marx, La Question juive, page 60). Je dois respecter en eux mes semblables. Personne n’est pour moi respectable, pas même mon semblable. Il est uniquement, comme d’autres êtres, un objet auquel je m’intéresse ou ne m’intéresse pas, un sujet utilisable ou inutilisable.
S’il peut m’être utile, je vais, bien sûr, m’entendre et m’associer avec lui, afin de renforcer mon pouvoir et, à l’aide de notre force commune, accomplir davantage que ne le pourrait chacun de nous isolément. Je ne vois rien d’autre dans cette communauté qu’une multiplication de ma force et je n’y consens qu’aussi longtemps que cette multiplication produira ses effets. C’est alors qu’il y a association.
L’association n’est maintenue par aucun lien naturel ou spirituel, et elle n’est pas une alliance naturelle, une alliance spirituelle. Elle n’a son origine ni dans une consanguinité, ni dans une foi commune. Dans une alliance naturelle, telle que la famille, la tribu, la nation, voire l’humanité, les individus n’ont de valeur que comme spécimens d’un même genre ou d’une même espèce. Dans une alliance spirituelle, communauté religieuse ou Église, l’individu n’est qu’un membre régi par l’esprit commun. Dans les deux cas, ce que tu représentes comme Unique doit être étouffé. Comme individu unique, tu peux t’affirmer seulement dans l’association parce que l’association ne te possède pas, parce que c’est toi qui la possèdes ou qui l’utilises à ton profit.
(...) L’État s’efforce de maîtriser les convoitises ; en d’autres termes, il cherche à les tourner vers lui seul et à les satisfaire avec ce qu’il a à leur offrir. Il ne lui vient pas à l’idée de les assouvir pour l’amour des convoiteux. Au contraire, il traite d’"égoïste" l’homme aux appétits effrénés, et l’homme "égoïste" est son ennemi. Il le considère comme tel parce que la capacité de s’accorder avec l’"égoïste" et de le comprendre fait défaut à l’État, il ne saurait en être autrement, ne s’occupe que de lui-même, il n’a cure de mes besoins et ne se soucie de moi que pour m’occire, c’est-à-dire faire de moi un autre Moi, un bon citoyen. Il prend ses dispositions pour "améliorer les moeurs". Et que fait-il pour se gagner les individus ? Il met en oeuvre les moyens spécifiques de l’État. Il ne se lasse pas de faire participer tout le monde à ses "biens", aux bienfaits de l’instruction et de la culture. Il vous fait le cadeau de son éducation. Il vous ouvre les portes de ses établissements d’enseignement, il vous donne le moyen d’accéder par les voies de l’industrie à la propriété, c’est-à-dire à l’inféodation. En contrepartie de l’octroi de ce fief, il n’exige de vous que le juste intérêt d’une constante reconnaissance. Mais il est des "ingrats" qui oublient de payer leur redevance. (... )
Dans l’association, tu apportes toute ta puissance, tout ce que tu possèdes, et tu te fais valoir. La société, elle, t’exploite, toi et ta force de travail. Dans la première, tu vis en individualiste, dans la seconde, tu dois travailler à la vigne du seigneur. À la société, tu dois tout ce que tu as et tu es engagé vis-à-vis d’elle, accablé de "devoirs sociaux ". L’association, c’est toi qui t’en sers et, dès que tu ne vois plus rien à en tirer, tu la quittes, tu ne lui dois plus rien, tu n’as pas à lui être fidèle.
La société est, elle, plus que toi, elle t’en impose. L’association n’est rien d’autre que ton outil, que l’épée qui confère à tes forces naturelles plus de tranchant. La société, au contraire, te revendique pour elle. Elle peut exister tout aussi bien sans toi. En bref, la société est sacrée, l’association t’appartient. La société se sert de toi, et c’est toi qui te sers de l’association.
Max Stirner
Extrait de L’unique et sa propriété, 1845.
L’Individu contre l’Etat
Ce que l’on nomme État est comme un tissage et un tressage fait de dépendances et d’adhésion, une appartenance commune, où tous ceux qui font cause commune s’accommodent les uns des autres, dépendent les uns des autres. Il est l’ordonnancement de cette dépendance mutuelle. Vienne à disparaître le roi, qui confère l’autorité à tous, de haut en bas, jusqu’au valet du bourreau, l’ordre n’en serait pas moins maintenu, contre le désordre des instincts bestiaux, par tous ceux qui ont le sens de l’ordre bien ancré dans leur conscience. Que l’emporte le désordre, ce serait la fin de l’État.
Mais cette idée sentimentale de s’accommoder les uns des autres, de faire cause commune et de dépendre les uns des autres, peut-elle vraiment nous convaincre ? À ce compte, l’État serait la réalisation même de l’amour, où chacun serait pour autrui et vivrait pour autrui. Mais le sens de l’ordre ne va-t-il pas mettre en péril l’individualité ? Ne va-t-on pas se contenter d’assurer l’ordre par la force, de telle sorte que nul « ne marche sur les pieds du voisin », que le troupeau soit judicieusement parqué ou ordonné ? Tout est alors pour le mieux dans le meilleur des ordres et cet ordre idéal, mais c’est l’État.
Nos sociétés et nos États existent, sans que nous les fassions, ils sont réunis sans notre assentiment, ils sont prédestinés, ils ont une existence propre, indépendante, ils sont contre nous, les individualistes, ce qui existe de façon indissoluble. Le monde d’aujourd’hui est, comme on dit, en lutte contre l’ « état des choses existant ». Cependant, on se méprend, en général, sur le sens de cette lutte, comme s’il ne s’agissait que de troquer ce qui existe actuellement contre un nouvel ordre qui serait meilleur. C’est bien plutôt à tout ordre existant, c’est-à-dire à l’État, que la guerre devrait être déclarée, non pas à un État en particulier, encore moins à la forme actuelle de l’État. L’objectif à atteindre n’est pas un autre État (« l’État populaire » par exemple), mais l’association, association toujours changeante et renouvelée, de tout ce qui existe.
L’État est présent même sans mon entremise. J’y nais, j’y suis élevé, j’ai envers lui mes devoirs, je lui dois « foi et hommage ». Il me prend sous son aile tutélaire et je vis de sa grâce. L’existence indépendante de l’État est le fondement de mon manque d’indépendance. Sa croissance naturelle, sa vie comme organisme exigent que ma nature à moi ne croisse pas librement, mais soit découpée à sa taille. Pour qu’il puisse s’épanouir naturellement, il me passe aux ciseaux de la "culture". L’éducation, l’instruction qu’il me donne sont à sa mesure, non à la mienne. Il m’apprend, par exemple, à respecter les lois, à m’abstenir de porter atteinte à la propriété de l’État (c’est-à-dire à la propriété privée), à vénérer une majesté divine et terrestre, etc. En un mot, il m’apprend à être irréprochable, en sacrifiant mon individualité sur l’autel de la « sainteté » (est saint n’importe quoi, par exemple, la propriété, la vie d’autrui, etc.). Telle est la sorte de culture et d’instruction que l’État est apte à me donner. Il me dresse à devenir un « instrument utile », un « membre utile de la société ».
C’est ce que doit faire tout État, qu’il soit « État populaire », absolu ou constitutionnel. Il le sera tant que nous serons plongés dans l’erreur de croire qu’il est « moi », et, comme tel, une « personne » morale, mystique ou publique.
Max Stirner
Extrait de L’unique et sa propriété, 1845.
Sur la responsabilité individuelle
Ce texte provient de la revue A Corps Perdu n°1, dans lequel il participe à un débat spécifique sur la question d’Emile Henry, cet anarchiste qui le 12 février 1894 lança en l’air une marmite de fer bourrée d’explosifs à l’intérieur du café Terminus, faisant une vingtaine de blessés et un mort, et posant par ailleurs la question de la responsabilité individuelle. Ce texte dépasse largement la simple question du cas Henry, c’est pour cela qu’il nous intéresse ici.
Nos gestes, nos actions, nos paroles portent en eux le monde que nous avons à cœur. Un monde différent de celui-ci, un lieu où – usons un peu de rhétorique – la liberté de chacun s’étend à l’infini avec celle des autres. Non pas un paradis terrestre, non pas « l’utopie » d’une vie a priori exempte de violences ou des contradictions humaines, et encore moins une masse d’égaux.
La société des individus : c’est celle que nous voulons, c’est pour elle que nous continuons à nous battre.
Et c’est « au nom » de la liberté de chaque homme singulier, au-delà de toute autre catégorisation, que nous continuons à penser qu’aujourd’hui est déjà un morceau de demain. Parce que, au-delà des possibilités plus ou moins réelles de voir la situation de cette planète être un jour renversée, la société que nous désirons peut déjà s’entrevoir à présent, dans la réalité de l’affrontement, dans la cohérence entre les moyens que nous utilisons dans la guerre contre l’Etat et les fins de l’émancipation souhaitée.
Certes, dans une société où le pouvoir tire son suc chaque jour de l’aliénation dévorante, où le contrôle (à travers des innovations technologiques et scientifiques permanentes) asphyxie tout aspect du quotidien en niant désormais toute possibilité de « dérobade », il paraît difficile d’échapper au chantage qui oppose la logique de la résignation à celle de la Guerre (civile et militaire). Plus encore, il semble difficile de trouver la manière de déserter, de combattre en « partisans » et pas en soldats, de s’opposer en libres individus aux masses vouées au massacre civil ou à l’esclavage.
C’est difficile, mais ce n’est pas impossible. Au moins nous obstinons-nous à vouloir le croire, parce que de même qu’aucun vaisseau ne peut être construit à partir de planches vermoulues – quand bien même seraient-elles bon marché et faciles à trouver – aucune liberté ne peut naître de l’autorité, de ses moyens et de sa logique.
Alors, tout comme nous avons toujours refusé de participer aux Guerres militaires, à présent, et avec encore plus de force, nous devons déserter et nous opposer à la Guerre civile.
Les armées, tous types d’armées, sont la négation de l’individu. Tout soldat (avec ou sans uniforme) est – potentiellement – en soi un terroriste : il l’est à partir du moment où il n’oppose pas soi, mais son propre camp, à un autre. Les « masses », les « races », les « nations », « le Peuple », « la Classe » : voilà les mots par lesquels on nomme le refus de sa propre liberté et de sa propre unicité, voilà les mots avec lesquels l’homme cesse d’être tel et devient un soldat.
Ce n’est pas la « cause » qui sépare des autres et pour laquelle on combat qui porte l’être humain à « devenir » terroriste, soldat, mais son exact opposé : la communion réciproque des différents camps en présence en une idéologie unique : celle qui nie toute responsabilité individuelle au nom de la sacralité d’une cause réputée supérieure.
L’homme devenu soldat ne se reconnaît pas soi-même en tant qu’individu mais comme faisant partie de quelque chose de plus grand (un peuple, une armée, une religion, une classe), et pour laquelle il agit en conséquence. Face à lui, sous ses coups, ses bombes, ses paroles, ce ne sont pas des êtres singuliers, chacun avec des responsabilités différentes et particulières, mais des masses anonymes, déshumanisées et dévalorisées. En deux mots, ennemies.
Ce n’est donc pas l’acte en soi qui transforme l’homme en « militaire » mais plutôt le mécanisme, l’idéologie. Même l’apparence de justesse ou de bien fondé d’une « cause » – qui à première vue peut nous sembler « sympathique » – peut devenir, en y faisant plus attention, ouvertement réactionnaire. Ceci, parce qu’elle est basée sur la non reconnaissance de l’individu, parce qu’elle ne tient pas compte des responsabilités de chacun, parce qu’elle est massificatrice.
La liberté (ou le bien) du peuple (ou pire d’un peuple) est un concept abstrait, ne signifie absolument rien dans un rapport à la réalité. Disons que c’est un simple artifice rhétorique avec lequel la politique creuse la tombe des nigauds prêts à y croire. La liberté appartient à l’homme, dans sa singularité sans aucune autre acception et exception.
Et tout individu a, justement au nom de cette liberté, sa propre responsabilité, sa propre capacité d’agir, sa propre possibilité de penser. En bien comme en mal. N’importe quel présupposé qui nie ce principe porte en lui un caractère liberticide, prépare la perpétuation d’une société basée sur l’autorité et sur la politique, et peut justifier et absoudre tout massacre.
Les actions conduites en tant que « sujet politique » et contre d’autres « sujets politiques » au nom de la Liberté resteront toujours à l’intérieur de la politique, dans la logique de la Guerre.
Un jeune Palestinien par exemple, membre d’une organisation nationaliste, qui fait un massacre de soldats ou de civils demeure dans cette même dimension idéologique : les responsabilités individuelles ne comptent pas parce que les Israéliens, tous les Israéliens, sont des ennemis. Parce que ce qui est important, au-delà du poids des responsabilités de chacun des hommes qu’il a tués, est de frapper l’autorité adverse, est la pression qui s’exerce sur des pouvoirs ennemis. Au nom de la victoire… la fin justifie tout moyen.
En forçant le trait, mais pas tant que cela, le même raisonnement – avec les petites différences d’usage – vaut pour les organisations islamistes face aux « occidentaux », pour « nos » soldats en mission à l’extérieur face aux « dangereux barbares qui menacent notre civilisation », pour ETA et consorts face à certains gouvernements. Et pourquoi pas, pour trop de révolutionnaires, face à la bourgeoisie.
Ce ne sont que quelques exemples parmi les plus éclatants, que nous ne citons pas pour éteindre les esprits des enragés de ce monde, mais pour empêcher que les flammes continuent à se développer vers la guerre civile.
Parce que nous avons malheureusement souvent vu dans l’histoire « les feux » brûler l’oxygène aux possibilités de libération.
Disons le de façon claire et nette : il n’a jamais été aussi nécessaire que maintenant d’attaquer. Mais attaquer signifie prendre la responsabilité de ce que l’on fait en tant qu’individu. Reconnaître nos responsabilités et les reconnaître chez l’adversaire. Cela signifie que chaque homme doit faire siennes les conséquences de ce qu’il choisit et de ce qu’il fait, sans pour autant se transformer en « sujet politique ».
Nous, en tant qu’individus, nous luttons pour l’affirmation de l’individu et contre des individus : on ne tire pas « sur des uniformes » mais sur des hommes, on ne frappe pas la bourgeoisie mais des hommes, on n’attaque pas des idéologies mais des hommes. Si nous voulons que l’homme soit libre, nous devons reconnaître l’humanité et l’unicité même dans le pire des ennemis.
Les processus totalitaires se sont depuis toujours fondés sur la dés-humanisation de l’adversaire. Or il devrait être évident – rien qu’en ayant en mémoire le passé récent et en regardant le présent tragique – que nous devons tenter le chemin opposé.
Un chemin capable d’abandonner toute idéologie et tout calcul politique est un chemin difficile à parcourir, mais qui peut – si on en a le courage – ouvrir mille possibilités. Certes, il en faut du courage pour se retrouver orphelin d’hypothèses et de perspectives dans un monde toujours plus difficile à comprendre. Il serait plus simple de continuer dans la logique des « catégories », des camps pour le moins dépassés entre sujets, sans comprendre le mécanisme et la dynamique dans leur ensemble.
Le fait est que cette absence, ce vide, ne constitue pas une limite en soi. L’affirmation de la responsabilité individuelle ouvre aux « orphelins » le champ des possibilités d’interventions révolutionnaires. Reconnaître l’individualité et l’humanité de l’oppresseur et de l’exploiteur ne limite ni la critique ni l’action, mais augmente – en tenant présent toute de la complexité des responsabilités et des rôles sociaux – leur potentiel offensif.
Tant que l’individu a une possibilité de choix – si minime soit-elle par rapport à l’existant –, le fait d’accepter une fonction d’oppression particulière à l’intérieur du mécanisme social ne l’exempte pas de ses propres actes, mais le rend plus abject encore dans son humanité et pour son humanité même.
Une évaluation lucide des responsabilités individuelles devient donc une arme. Une arme qui, chargée de la conscience du mécanisme social, peut tirer à coups de critiques et de pratiques sans s’enrayer dans le marécage de l’impuissance et de l’apologie.
Le pouvoir n’a pas besoin d’autres apologistes de la violence : il assume très bien cette fonction tout seul. Les hommes tuent et se révoltent avec nous ou malgré nous, la question est uniquement le pourquoi ils le font.
Les actes de tuer, de faire du mal à un être humain sont – au moins pour l’auteur – toujours quelque chose de désagréable ou de moche, précisément parce qu’ils sont bien sûr intrinsèquement autoritaires. Si, sur le chemin de la révolte contre cette société d’abus en tout genre, de tels actes doivent être accomplis (et il me semble évident que les puissants ne lâcheront pas volontairement leurs privilèges), ces actes doivent être au moins corrélés ouvertement et clairement à la raison, au rêve, à la fin, qui motivent le geste.
Si ces actes, les gestes des enragés, avaient été ou étaient finalement devenus quelque chose qui tend à la liberté, s’ils avaient porté ou voulu porter en eux la fin, le pourquoi, il est clair que tout le débat sur la « légitimité » de la violence aurait pu s’éteindre. Les intentions des politiciens (de profession ou du mouvement), tout comme le vide des rien-à-foutre-je-suis-enragé seraient devenus clairs. En somme, la différence substantielle entre la violence qui tend à la liberté et celle qui tend à l’autorité apparaîtrait clairement.
Dans cette vision « utopique », les débats sur le comment faire, sur l’exemplarité, sur la revendication historique, sur le chemin à prendre pourraient mener à une évaluation sereine des erreurs du passé et des possibilités – grâce aux erreurs précédentes – du futur.
Pourquoi débattre à propos d’Emile Henry au sein du « mouvement » libertaire et anarchiste (comme c’est le cas dans cette revue) ? Pourquoi supporter encore cette fausse diatribe entre ceux qui veulent voir – de manière idéologique – dans un acte du passé « le sens même d’un acte révolutionnaire » et ceux qui veulent – de manière politique – le discréditer parce qu’il est embarrassant ?
Soyons clair : les bombes contre « une catégorie » peuvent exprimer la haine contre un monde, une société, des responsabilités sociales. Cela, avec une analyse grossièrement sociologique. Elles ne peuvent pourtant pas exprimer les responsabilités particulières des individus : le banquier parvenu, le domestique, le lèche-cul des patrons, le serveur, l’employé arriviste, le secrétaire « bien installé et qui s’en satisfait » etc. etc. Tous ne peuvent être mis dans le même sac.
Robespierre est mort et il n’est d’aucun intérêt à l’exhumer. La cécité qui « condamne » à mort, qui frappe « dans le tas » en comptant les bourgeois – et en oubliant les esclaves – n’est donc pas intéressante. Elle est surtout odieuse.
On peut comprendre les passions, la haine, les expectatives, la rancœur des nombreux Emile Henry qui ont fait trembler et tourmenté cette société infâme, mais on ne peut pas en faire l’apologie – aujourd’hui moins que jamais.
Les Emile Henry qui ont peuplé et peuplent cette société sont souvent « sympathiques », sensibles, intelligents, de bons auteurs et des personnes courageuses, mais tout cela ne peut nous faire oublier le principe de base selon lequel on doit reconnaître à chacun sa propre responsabilité. Il n’est absolument pas acceptable qu’une seule vie soit sacrifiée au nom de l’action ou de la cause. En l’occurrence, la cause – s’il s’agit de celle pour la liberté – perdrait toute valeur si une échelle de responsabilité n’y était pas reconnue, si elle portait dans l’action le principe militariste, celui qui frappe dans le tas.
Et frapper dans le tas, pour être encore plus clair, ne signifie pas seulement tuer ou blesser de nombreuses personnes. Cela veut dire faire des calculs sur le nombre de victimes à subdiviser entre celles touchées pour leur responsabilité réelle et celles touchées par « dommages collatéraux » (si l’on reprend un vocabulaire militaire à la mode). Cela veut dire être oublieux de l’existence des individus au nom de la politique.
On peut définir le fait de « frapper dans le tas » comme le fait de prévoir que ne serait-ce qu’une seule personne exempte de responsabilité spécifique soit volontairement atteinte. Revenons à notre exemple historique : il n’est pas vrai qu’Emile Henry ait frappé dans « le tas des bourgeois », pour la simple raison, qu’étaient bien sûr présentes à l’intérieur du lieu qu’il a fait sauter en l’air un certain nombre de personnes qui n’avaient rien à voir avec les responsabilités que l’anarchiste voulait attaquer. Emile Henry a donc « frappé dans le tas » et basta.
Disant cela, nous ne souhaitons pas dénigrer ici un aspect de l’histoire anarchiste, nous dissocier en idées des tragédies du mouvement. Il ne nous intéresse pas non plus d’être des apologistes de tout ce qui est « anarchiste », de regarder « notre » passé de manière acritique, de lancer une polémique historique et stérile.
La chose importante que ces quelques lignes tentent de mettre en discussion est la relation entre l’histoire et un certain type de construction idéologique que nous percevons comme un danger, au sens révolutionnaire.
Si, comme nous l’avons dit, la Guerre civile est en train de s’étendre à toute la planète avec sa charge de barbarie, il devient alors inévitable pour nous de mettre l’accent sur les caractéristiques d’une telle guerre, sur ses raisons historiques et idéologiques, sur des racines culturelles et politiques profondes qui, partout dans le monde, trouvent leur source dans les folles pratiques des hommes en guerre.
Partir du présupposé, malheureusement pas si évident, que tout terrorisme ne peut que pousser dans un sens opposé à l’affirmation de notre individualité devient centrale en temps de guerre. Une affirmation de principe donc, dans ce texte sans conclusion. Et, espérons, le début d’un débat aujourd’hui plus que jamais urgent.
Extrait d’A Corps Perdu N°1, revue anarchiste internationale, décembre 2008.
L’individualisme
Tous les lecteurs de L’anarchie savent que je suis un bonhomme à marottes. J’aime le travail utile, j’ai une antipathie marquée pour les troueurs de cartons ; je ne lis qu’avec peine les livres de sociologie et je tâche d’ignorer ce que clament les députés, ce que bafouillent nos sénateurs, ce qu’écrivent nos grands hommes. Ainsi étant, j’ai le bonheur de n’avoir nullement souffert, de n’avoir été nullement désillusionné quand Clemenceau s’est qualifié de première vache [1] de France, quand Briand est devenu le ferme soutien de la patrie et de l’Eglise, quand Urbain Gohier s’est associé avec Bunau-Varilla du Matin. J’ai souri simplement comme si j’avais souri devant la mine allongée des anarchisants alors que Rochefort s’associait au Mercier de l’état-major.
Comme je me plais à le reconnaître moi-même, je suis donc un mauvais bougre, mais ne croyez pas que je puisse pousser à l’absolu toutes mes théories. Pour assurer mon existence, je fais bien des imbécillités ; j’ai des amis contrôleurs au métro ; je sais que Loubet n’est plus président de la République… et je viens de lire un livre de sociologie de six cents pages. Cinq cent quatre-vingt dix page in-18°, si vous voulez que je sois exact, et cela pas plus tôt que je fermais un autre bouquin de cinq cent cinquante pages in-18°. Tout cela pour rendre service au bibliographe qui se déclarait surchargé. Il y a de quoi être malade et ne plus savoir que penser au milieu de tous ces systèmes économiques tant socialistes qu’individualistes.
Ces bouquins venaient en droite ligne de chez Armand Colin, lequel a la spécialisation paraît-il de ce genre sociologique honnête. L’académie sérieuse et libérale édite chez lui. Venait en droite ligne, moyennant argent, car cet éditeur ne paraît pas fort se soucier de la critique de L’anarchie et ne trouve pas bon de nous faire le service même après demande. Or voyez les coups du sort, la critique marche de trois colonnes.
Je passerai rapidement sur le premier livre lu. Il est intitulé Les systèmes socialistes et l’évolution économique. L’auteur est Maurice Bourguin, professeur en quelque faculté de droit. Ecrit « pour les hommes préoccupés de la question sociale qui cherchent sincèrement à s’orienter dans la recherche de la vérité », c’est une œuvre médiocre et de mauvaise foi. On voit le parti pris depuis la première ligne jusqu’à la dernière. Les systèmes socialistes - systèmes que je combat moi-même très âprement – y sont présentés sous le jour le plus mensonger possible. Tout ce qui est de nature essentiellement ouvrière, susceptible de porter quelque changement véritable dans les bases mêmes du capitalisme, de la propriété, est tracé de façon ridicule. Tous les palliatifs, tous les moyens termes, tous les truquages gouvernementaux sont dessinés avec les traits fermes afin de faire ressortir l’intérêt porté à la classe ouvrière. Sous prétexte d’utiliser la méthode expérimentale, l’auteur fait usage de statistiques et de chiffres qui ne prouvent rien du tout. Dans quelques détails, lorsqu’il n’a pas à parler, Bourguin fournit une documentation qui, si elle est exacte, n’est sans utilité. Mais c’est tout. Ce livre a l’avantage pour nous de n’être pas « dangereux ». Il est exécrable, monotone ; le lecteur le moins avisé y lis le parti pris ; son prix lui-même l’écarte de notre route. Ceux qu’il touche sont ceux qui ont besoin à tout prix d’arguments si peu vraisemblables sont-ils. Evidement « l’anarchisme et le communisme resteront en dehors de cette étude » nous dit l’auteur. Grand merci.
Je ne vous aurais certainement pas dérangé, si le second livre eût été pareil. Il n’en est rien. Son titre : L’individualisme économique et sociale ; son auteur : Albert Schatz, professeur aussi en quelque faculté de droit. Le style en est clair, agréable. Les différentes doctrines y sont présentées avec esprit. L’auteur s’est efforcé d’entrer successivement dans la façon de penser de chacun des économistes dont il parle et, disons-le, il y a réussi. Peut-être n’y a-t-il pris que les matériaux qui facilitaient sa thèse ? Mais, au moins, il a l’avantage de savoir dorer la pilule. Quand nous le suivions à travers le passé, que nous nous attardons à la lecture de l’œuvre des individualistes contre l’Etat, nous ne pouvons nous empêcher de revivre les paroles dites. Ainsi, j’éprouvais le même impression alors que je suivais le cours de Victor Basch, sur le même sujet, aux sociétés savantes. Mais cette impression n’est qu’une impression de sentiments, elle ne dure pas devant le raisonnement (Ah ! cette maudite raison, dirait Albert Schatz). On devine rapidement où veut nous mener l’auteur, à l’acceptation de la fameuse théorie individuelle classique… et libérale.
Nous ne nions pas la valeur des théoriciens individualistes qu’il nous présente, ni même son art de nous les présenter. Mais nous savons que, de tous temps, l’œuvre des meilleurs de l’élite intellectuelle a su être détournée au profit de ceux qui possèdent. Et souvent les théories les plus osées sont devenues- avec quelques accommodements – les théories les plus respectueuses de la propriété de « l’ordre » ! Les cerveaux les plus puissants se mettent à gages !
Voyons donc l’œuvre présente : c’est le résumé d’un cours d’histoire des doctrines économiques, nous dit l’auteur. C’est l’histoire des doctrines prises et présentées par ceux qui possèdent à ceux qui ne possèdent pas, voir même à ceux qui veulent posséder « trop », afin d’éviter l’envahissement de leur propriété, disons-nous plus justement.
Des antimercantilistes jusqu’à Spencer en passant par ceux de l’école morale anglaise, par Malthus et sa théorie de la population, par Ricardo et sa théorie de la rente, par Dunoyer et son libéralisme absolu, par ceux de l’école orthodoxe avec Bastiat, ceux de l’école historique avec Taine et ceux de l’école chrétienne avec Le Play. Ce ne sont là que les différentes formes de l’esprit bourgeois Libéral – libéral, car les mots ont leur ironie.
C’est la glorification de l’individu qui possède, c’est sa défense, c’est l’histoire des différentes doctrines présentées tour à tour comme les meilleures pour empêcher la majorité des hommes d’arriver au libre développement de leur individualité. Il est vrai que c’est toujours au nom de l’individualisme… de ceux qui sont arrivés.
Ces différentes méthodes individualistes qui ne veulent accepter aucun maître, aucune loi, aucune restriction pouvant entraver la puissance de l’individu, acceptent comme acquis et sacré le fait même de la propriété terrienne, de la richesse industrielle. Elles s’appliquent à ceux qui possèdent… et à leurs valets.
L’homme, selon qu’il sera fils de propriétaire ou de non-propriétaire, pourra ou ne pourra pas affirmer son individualité. Au nom de la gloire de l’individu, l’un devra travailler à l’affirmation de la puissance de l’autre. Ce dernier devra tout faire pour assurer l’intégrité de sa fortune, le premier devra tout faire pour commencer la sienne… sauf attaquer les bases de la propriété… elles sont intangibles !
Sous le couvert de libéralisme, d’individualisme, on écrase le développement du plus
grand nombre des individus au profit du plus petit nombre.
Si l’individu doit tout faire pour arriver à conquérir une « situation », à se développer, il doit pourtant s’occuper de certaines morales, de certains respects. Tout ce qui peut vouloir contrebalancer la force des individus en puissance par celle des individus en devenir est considéré comme une entrave à l’individualité des premiers. Nos libéraux poussent les hauts cris. Si une loi semble favoriser les faibles, ceux qui sont nés hors des moyens économiques, l’auteur nous montre que c’est une loi anti-individuelle, mais il oublie de dire tout le travail souterrain de la morale, de la philosophie, des usages qui font accepter comme un fait acquis et inviolable la réparation sociale de la richesse.
Notre individualisme n’a aucun rapport avec cet individualisme tronqué, préparé à l’usage de la société présente. Le moi, l’individu que nous voulons dégager des autres hommes se manifeste avec des moyens égaux semblables à celui des autres « moi », des autres individus. Il ne saurait être logique de conserver la répartition actuelle des richesses et des profits tant matériels que « moraux », et de parler de tels individus développés ou non alors qu’on ne se trouve qu’en face d’hommes plus ou moins favorisés. Si nous ne désirons pas que les individus soient identiques, nous nous plaisons à les voir égaux devant les puissances sociales et économiques. Et nous travaillons à faire que l’inégalité entre le pauvre et le riche ne soit plus, car elle n’affirme pas la puissance des individus mais bien plutôt celle des fortunes.
Rien de plus curieux que cette ignorance des auteurs sociologiques classiques lorsqu’il s’agit de parler de l’anarchisme dans son évolution présente. Ils ne peuvent connaître la manifestation de l’individu, la vie d’un peuple, la réalité d’une pensée qu’en lisant dans les livres et les rapports, ils ne savent voir que ceux qu’on leur dit de voir.
Lorsque, parlant de l’individualisme, Schatz est obligé de toucher à l’anarchisme, il s’en débarrasse en quelques mots. Il y a, dit-il, deux doctrines anarchistes : l’une est un grossissement du socialisme, l’autre est un grossissement de l’individualisme. La première est celle du prince Kropotkine, l’autre est celle de Stirner, un peu celle de Proudhon. Et il s’occupe de ces deux derniers auteurs.
Si au lieu de chercher chez Eltsbacher, il avait essayé de se documenter lui-même, il aurait peut-être pu voir un nouveau courant anarchiste qui l’aurait déconcerté. Ce courant pour dire vrai n’est pas nouveau : il n’est que l’évolution naturelle de l’idée anarchiste. Ceux qui le défendent s’appellent anarchistes tout simplement, mais quand on veut les pousser plus à fond, ils se déclarent « communistes-anarchistes », et, pour sortir du domaine utopique dont Schatz nous accorde si facilement l’exploitation, ils s’efforcent de vivre leurs idées en les mettant en pratique immédiatement.
Ces hommes, ami Schatz, peuvent se réclamer de Mandeville, de bien des phisiocrates, de Malthus, de Stuart Mill, en vous laissant il est vrai Bastiat, Le Play et Sangnier. Ils peuvent prendre à Dunoyer et à Spencer, mais ils ne comprennent pas l’individu courbé sous l’obéissance d’un Dieu hypothétique et le respect à une propriété que trop réelle.
Si l’aristocratie d’un Nietzsche ou d’un Ibsen, la passion réagissante d’un Stirner ou d’un Proudhon sollicitent leur attention, ils n’en concluent pas moins que la réalité est plus intéressante que l’utopie.
A votre grand regret, j’en suis sûr, ceux qui n’ont pas l’appétit des individualistes libéraux ne veulent pas non plus cultiver les paradoxes du « moi » ou de « l’unique » dont la propriété serait de crever de faim.
L’auteur disait dans sa préface qu’il faisait ce résumé pour atteindre un plus grand nombre de personnes. La conclusion qu’il lui donne me permettrait presque d’établir que ce livre devrait avoir la prétention de satisfaire la tendance pratique de l’esprit des jeunes gens de la génération actuelle. Las anarchistes ne se laissent pas prendre à ces jeux-là.
Après avoir touché à toutes les cordes de l’individualisme, voire catholique et papal avec Le Play, Sangnier et Léon XIII, glorifié le développement moral et économique de l’individu avec Malthus, Stuart Mill, Nietzsche et Renan, l’auteur fait une conclusion qui pourrait sembler en complet désaccord avec sa thèse, tant elle est floue et lâche, mais qui est bien l’aboutissant logique du genre d’individualisme qu’il prône. Cette méthode ne peut former que des maîtres et des esclaves, jamais des hommes.
L’auteur propose aux éducateurs de choisir parmi leurs auditeurs « celui » en qui il voient « un futur conducteur de peuple » et voici, en substance, ce qu’ils devraient lui dire : « Tu ne connais le monde que par les poètes, c’est-à-dire tu le connais mal. C’est aux économistes qu’il appartient d’achever ton éducation. Ne crois pas t’abaisser en acceptant leur discipline. Tout ce que les hommes ont fait de beau a pour support la richesse sociale crée par la foule obscure des travailleurs. Les hommes ne sont pas bons, ce qui les fait vivre en paix, c’est l’intérêt ; ne leur demande jamais de service qu’il n’aient avantage à te servir. Aie pour principe de respect l’ordre naturel. Si ta raison proteste contre lui, ne va pas détruire cet ordre, mais force ta raison à en comprendre la nécessité. La raison à en comprendre la nécessité. La raison nous est venue sur le tard : elle est l’ouvrier de la onzième heure, si elle n’est pas la mouche du coche. Méfie-toi de ses prétentions indiscrètes ».
Je cite ce passage textuel pour signaler la tendance générale de l’auteur contre le rationalisme, tendance que j’avais omis de signaler. C’est avec cet art que l’auteur se sert de certains arguments pour les retourner contre ceux qui les donnent. Ainsi, déclarant que l’homme n’a pas de droits, il arrive à dire : « Tu n’a pas à revendiquer tes droits, mais à accomplir tes devoirs. Tu n’éprouveras la joie de vivre, tu ne sera fort qu’en cultivant toi-même ta force et dans les tristesses de la vie, c’est en toi-même que tu trouveras le réconfort. Développe donc en toi moins la raison que la volonté intelligente car la raison est faible, malgré son orgueil. N’aie pas l’ambition de changer le monde, même s’il te déplaît, tu y perdrais ton temps. Accepte-le courageusement comme il est, ne lui demande que ce qu’il peut donner et ne te préoccupe que d’accomplir généreusement et virilement ta tâche. Ce qu’il te faut et ce que tu peux transformer, c’est toi-même. »
Partant donc de pensées semblables aux nôtres – la culture du moi, de la volonté d’être -, l’auteur sait arriver adroitement à des conclusions absolument opposées. Le moi qu’il faut transformer, la volonté tenace qu’il faut avoir, c’est dans le but de grimper à une situation quelconque, de prendre place à l’assiette. Voilà le développement final de l’individu selon Schatz.
Et il continue, critiquant, avec d’autant plus d’art que la tâche est facile, les réformes ouvrières, les promesses radicales et socialistes.
Anna Mahé parlait il y a longtemps, dans L’anarchie, de l’admiration qu’elle avait pour le livre de lecture. Le tour de France par deux enfants. Elle disait combien il répondait au but que s’était proposé l’auteur, celui de moraliser, d’influencer, d’abrutir en un mot, le cerveau des jeunes enfants du peuple. Elle montrait tout le respect qu’il savait inspirer pour la loi, la justice, la patrie, la propriété, etc. Le livre de Schatz s’adresse à une autre « classe », à des fils de bourgeois, des fonctionnaires, à des jeunes gens que pourrait avoir touché le désir de plus de beauté et de logique économique de par le monde. Ce livre est une douche froide. La forme réaliste que prend l’auteur est fausse, mais encore faut-il découvrir sa ruse et beaucoup peuvent s’y laisser tromper.
Ce livre veut détruire, veut entraver une force nouvelle qui libérera les hommes lorsqu’ils sauront s’en rendre maîtres.
Cette force est faite du courant communiste et du courant individualiste enfin fusionnant l’un dans l’autre et trouvant leur aboutissant logique dans l’anarchisme.
Albert Libertad
Extrait du journal L’anarchie, 23 janvier 1908.
L’important ce n’est pas de savoir d’où on vient mais de décider où on va
« Les racines, c’est des cache-misère romantiques pour dire de jolie manière qu’on a suivi les migrations industrielles comme les mouettes le chalutier... Histoire de grappiller les restes. Alors aujourd’hui c’est à la mode d’avoir des racines, de-ci, de-là. Conneries, oui ! Ça nous cloue au sol, ça nous empêche d’avancer. Les racines, c’est bon pour les ficus ! »
Parlons un peu de nous-mêmes, nous les humains. On nous a rangés dans des cases qui sont autant de cages, quand nous ne l’avons pas fait nous-mêmes, on nous a séparés sur des critères qui n’étaient pas les nôtres et en fonction de causes ou d’identités qui n’ont jamais été les nôtres. On nous a compartimentés, classifiés, on a transformé ce qui pourrait être des relations simples entres humains en de sinueux labyrinthes semés de séparations imaginaires rendues réelles et entretenues par une armada de lois, qu’elles soient inscrites dans des codes pénaux ou dans des codes sociaux, moraux et traditionnels. Mais au fond qu’est-ce qui nous différencie vraiment ?
Ce qui peut nous séparer comme nous relier, qui nous différencie vraiment les uns des autres, c’est l’ensemble des choix qui fait de chacun ce qu’il est vraiment, et non pas les diverses étiquettes collées sur notre dos par les autres, à notre naissance, selon la couleur de peau, le milieu social ou les origines, tout cela dans le but de nous uniformiser, nous intégrer, nous formater, nous domestiquer et nous soumettre. C’est parce que nous refusons toute notion de « nature humaine », ou toute nécessité historique et parce que nous pensons que l’individu n’est rien d’autre que la somme de ses choix, de ses désirs et de ses rêves, que nous ne sommes pas solidaires des conditions qui sont faites aux plus opprimés mais de la vigueur et des perspectives avec lesquelles ils résistent et combattent leurs oppressions.
Nous ne reconnaissons pas le statut de « la victime », cette nouvelle catégorie construite par la justice ou la norme et qui pose l’État et les humanitaires charitables comme seul remède, tout comme nous ne reconnaissons aucune généralité qui se place au dessus de l’individu, ni la responsabilité collective qui en découle. Par exemple celle de tous les « blancs » sur tous les « noirs » par rapport à la traite des noirs, de tous les « hommes » sur toutes les « femmes » par rapport au patriarcat, de tous les « hétérosexuels » sur tous les « homosexuels » pour l’homophobie, de tous les « allemands » sur tous les « juifs » pour le nazisme ou de tous les « juifs » sur tous les « arabes » pour les massacres commis par l’Etat d’Israël au Moyen-Orient. Se reconnaître comme « victime » ou « bourreau » pour des actes qu’on n’a pas subi ou commis nous-mêmes, c’est en quelque sorte reconnaître les catégories qui n’ont toujours servi qu’à subordonner l’individu à quelque chose de plus haut, à le sacrifier au nom d’une Raison Supérieure, à recruter des armées pour les guerres entre États. En tant qu’antimilitaristes, par exemple, nous ne sommes pas responsables des massacres commis en Afghanistan par l’État français au nom d’un « peuple de France » imaginaire, unifié et homogène. C’est pour la même raison que nous refusons des slogans tels que « Nous sommes tous des juifs allemands », « Nous sommes tous des palestiniens ». Ainsi, la seule responsabilité que nous reconnaissons est la notre car c’est à nous mêmes que nous répondons de nos actes.
Il est de bon ton, aujourd’hui, de trouver ses racines, de s’interroger sur ses origines, d’aller se ressourcer au bled ; de commander des recherches sur son arbre généalogique, d’être « roots », comme si le sol ou le sang pouvaient apporter une quelconque réponse à nos désirs de liberté ; comme si le rabaissement des autres « identités » était le moyen d’atténuer ses propres souffrances. Chacun a sa petite identité à mettre en concurrence avec celle des autres, chacun a sa petite fierté insipide à mettre en valeur, chacun fait de sa petitesse une force, alors que tout le monde vit dans la même merde, et que toutes ces divisions et fausses-oppositions font le jeu du pouvoir.
A contrario, des individus font quotidiennement le choix de se révolter, dans les prisons, les centres de rétention, les écoles, envoyant chier famille et traditions, armées, frontières et nations. Chaque amant de la liberté n’attend que d’en rencontrer d’autres pour enfin détruire tous les rôles et les catégories sociales qui les empêchent de se retrouver et de vivre enfin ce qui n’a jamais été vécu, en se coupant de toute racine qui nous rattache encore à ce monde de domination.
Attaquons tout ce qui nous détourne de notre liberté.
Des anarchistes
[Tract trouvé à Paris, décembre 2010.]
Contre l’organisation
Nous ne pouvons pas concevoir que les anarchistes établissent des règles à suivre systématiquement comme des dogmes fixes. Parce que, même si une uniformité de vues sur les lignes générales des tactiques à suivre est assumée, ces tactiques sont portées d’une centaine de façons différentes lorsqu’elles sont appliquées, avec un millier de détails variants.
Cependant, nous ne voulons pas de programmes tactiques, aucun, et par conséquent nous ne voulons pas d’organisation. Ayant établi le but, le but auquel nous nous tenons, nous laissons chaque anarchiste libre de choisir parmi les moyens que son sens, son enseignement, son tempérament, son esprit de combat lui suggère de meilleur. Nous ne formons pas de programmes fixes et nous ne formons pas de petits ou de grands partis. Mais nous nous rassemblons spontanément, sans critères permanents, selon des affinités momentanées, dans un but spécifique, et nous changeons constamment ces groupes aussitôt que le but pour lequel nous nous étions associés cesse d’être et aussitôt que d’autres buts et besoins surgissent et se développent en nous et nous poussent à chercher de nouveaux complices, des gens qui pensent comme nous dans les circonstances spécifiques.
Lorsque n’importe lequel d’entre nous ne se préoccupe plus de la création d’un mouvement factice de sympathisants, mais crée plutôt un ferment actif d’idées qui nous pousse à penser, comme les coups d’un fouet, il entend souvent ses amis répondre que pendant beaucoup d’années ils ont été habitués à une autre méthode de lutte, ou qu’il est un individualiste comme les capitalistes, ou un théoricien puriste de l’anarchisme.
Il n’est pas vrai que nous sommes des individualistes, si on essaye de définir ce mot en termes d’isolation et de séparation des éléments, évitant toute association dans la communauté sociale et supposant que l’individu puisse se suffire à lui-même. Nous soutenons le développement des initiatives individuelle. Quel anarchiste ne voudrait pas se rendre coupable de cet individualisme ? Si l’anarchiste est celui qui aspire à l’émancipation de toute forme d’autorité morale et matérielle, comment ne pourrait il pas reconnaître que l’affirmation de son individualité, libre de toutes obligations et de l’influence autoritaire externe, est tout à fait bienveillante ? Car elle est la plus certaine des indications d’une conscience anarchiste. Nous ne sommes pas des théoriciens purs et durs parce que nous croyons en l’efficacité de l’idée. Comment peuvent être organisées les actions, si ce n’est pas à travers la pensé ? Produire et soutenir un mouvement d’idée est pour nous, le moyen le plus efficace pour déterminer le flux des actions anarchistes, tant dans la lutte pratique que dans la lutte pour la réalisation de l’idéal.
Nous ne nous opposons pas nécessairement aux organisateurs. Ils continueront, s’ils le souhaitent, à user de leurs tactiques nauséeuses. Si, comme je le pense, cela ne nous fera aucun bien, cela ne nous fera pas grand mal non plus. Mais il me semble qu’ils nous ont déjà rangés sur leur liste noire comme des sauvages ou comme des rêveurs théoriques.
Giuseppe Ciancabilla (1872 - 1904)
Extrait de La Protesta umana. Traduction extraite de Non Fides n°IV, journal anarchiste apériodique, juin 2009.
[1] Argot pour flic.
)
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (3 Mo)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (3.1 Mo)