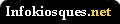T
Tatouage libre
mis en ligne le 9 février 2012 - Acratos éditions
1) Petite histoire politique et sociale du tatouage
La pratique du tatouage est universelle. On la retrouve historiquement sous toutes les latitudes, tous les continents, toutes les civilisations. Il n’est pas de tribu, si minime et isolée qu’elle soit, qui n’ait pas pratiqué la modification corporelle au même titre que la danse, la musique ou les psychotropes.
Que l’on parle de tatouage, de scarification ou de tout autre type de modification corporelle, cela a toujours été intégré dans les codes des sociétés et significatif de la place que les individu-e-s y occupent. La modification corporelle fonctionne comme marque du statut social : passage à l’âge adulte, mariage, place hiérarchique, tout est inscrit dans le corps, véhiculant de ce fait une marque de violence, une souffrance à supporter, une épreuve qui donne accès à une place codifiée dans la société.
Dans un monde qui, à de rares exceptions près, est tout entier soumis au système patriarcal, on embellit les femmes selon des canons de beauté spécifiques. On les décore. Les modifications corporelles esthétisantes les donnent à voir en tant qu’objet à acquérir ou à conserver, en tout cas à convoiter. La virginité, la puberté, le mariage, l’adultère et la fertilité sont présentés par des codes reconnaissables par tous-tes. Les hommes sont quant à eux virilisés par des marques de puberté, d’épreuves, des symboliques de force, de protection ou de statut social.
Ces pratiques ont dominé le monde jusqu’à l’arrivée des grandes religions monothéistes. La conception d’un dieu unique décharge les sociétés de la pluralité des modèles. On ne s’identifie plus à des forces naturelles ou symboliques (dieu de la guerre, déesse de la sagesse etc), mais à une entité dominante, désormais unique, qui ne peut que nous ressembler, attendu que nous sommes les seuls êtres vivants à la concevoir et, de fait, à s’en réclamer : si Dieu nous ressemble, alors nous devons lui ressembler au mieux pour s’en rapprocher. Le monde monothéiste rejette donc ces marques qui altèrent un corps devenu sacré dans sa pureté originelle. La circoncision est une exception de la religion judaïque. On peut penser qu’outre la considération hygiénique, le fait que le pénis de Dieu n’ait jamais été envisagé en représentation ait facilité cette exception.
Pour autant que l’homme soit à l’image de dieu, ce n’est pas le cas de la femme. Dans la genèse de ces religions, la femme n’intervient que comme objet de compagnie et propre à propager l’espèce. Elle est exclue de la divinité afin de la maintenir en domination et son corps en répète les marques, même si celles-ci se font plus discrètes. Ce n’est pas pour rien que le perçage des oreilles des femmes, y compris très jeunes, est resté une tradition fortement ancrée en occident. Ce n’est pas pour rien non plus si le tatouage érotique a perduré au Maghreb par delà des interdictions et autres blasphèmes.
Pendant plusieurs siècles, l’altération du corps est donc l’altération de l’image de Dieu. En dehors des « décorations » féminines, les modifications corporelles deviennent traces d’infamie. Marquages au fer rouge, amputations, sévices et tortures, tatouages forcés dégradent donc non seulement l’intégrité physique des supplicié-es, mais aussi leur part de divinité. La justice des hommes précède la justice de Dieu.
Dans l’univers monothéiste, les modifications corporelles volontaires disparaissent presque intégralement. N’en reste que l’image du mal absolu, punitif et infamant.
Les grandes civilisations d’orient, en dehors de quelques parcelles converties à l’un des trois monothéisme, ont conservé un rapport pluriel à la divinité. La pratique des modifications corporelles y a perduré. Si les aspects religieux et sociaux en sont resté le socle, ce sont des évolutions économiques et politiques qui en ont fait évoluer l’usage, les régulant dans des sociétés bien plus vastes que les cellules tribales : des nations, des royaumes, des empires.
Le social local est devenu politique global, et le tatouage a pu devenir une marque de féodalité (signifiant l’appartenance complète, physique et morale, à tel ou tel seigneur de guerre), un signe de reconnaissance entre membres d’une même secte (organisations multiples travaillant sur fond d’idéologie commune à un intérêt économique et d’influence, parfois proches d’une organisation toute militaire), un élément décoratif ou sensuel.
Il est intéressant de voir qu’au Japon et sur une grande partie de la Chine, le tatouage est à la fois devenu plus étendu sur la surface du corps, plus fourni, plus éclatant, tout en étant circonscrit à des places réservées sous les vêtements, invisibles sur des individu-es habillé-es. Le code est toujours présent et même de plus en plus affirmé, mais réservé à certains regard avertis. Le commun des mortel-les n’y a pas accès. Cela prolonge la dimension de rang social, ou de caste sociale en l’occurrence, qui a bel et bien perduré au delà des pratiques tribales.
De plus, on retrouve encore une fois des schémas fortement sexués dans les modifications corporelles. Une iconographie bestiale ou symbolique toujours signe de force ou de protection sur des hommes élevés pour la guerre, à la fois soumis à une domination féodale aveugle et détenteurs du pouvoir des armes. Les femmes sont une fois de plus objectivées, portant fards, bijoux et coiffures extrêmement sophistiquées, des vêtements entravant les mouvement jusqu’à les rendre pratiquement incapables de marcher, leurs pieds torturés et atrophiés (en Chine) réduisant encore un peu plus l’usage de leur propre corps. Le tatouage est tout à la fois signe de sensualité et de soumission.
Le rang social est encore extrêmement marqué : hommes et femmes de basses conditions ne peuvent arborer aucun signe corporel, les femmes conservant leurs capacités physiques afin de pouvoir travailler efficacement.
Le retour des modifications corporelles en occident se fait à l’époque des grands voyages maritimes, lors de l’expansion coloniale des puissantes nations d’Europe, et ce par deux mouvements qui vont se télescoper.
D’une part, des marins se trouvent confrontés à des peuples ayant conservé la pratique des modifications corporelles. Ces pratiques ont d’ailleurs renforcé la conviction de supériorité des conquérants sur des tribus tellement éloignées de dieu qu’elles en altéraient l’image, les ravalant d’autant mieux au statut d’animaux sans âmes et dont on peut disposer à loisir. Par l’esclavage, par les cabinets de curiosité ou l’on exhibait des « sauvages » portant tatouages, scarifications et autres plateaux au milieu de la belle société, les pratiques corporelles, bien que toujours considérées comme marques du mal, sont réapparues. Certains marins, se liant d’amitié avec des autochtones, ont commencé à se faire tatouer et percer selon leurs rites et coutumes. Pirates et corsaires en furent les plus grand-es représentant-es, allant jusqu’à s’installer définitivement au sein d’une tribu, dans un mode de vie qui correspondait mieux à leurs idéaux.
D’autre part, si cette époque est celle du christianisme triomphant, elle ne l’est que par l’expansion économique qui le précède. Si le travail est utile à l’économie, alors le travail sera une punition idéale pour qui outrepasse les lois des hommes ou de Dieu, les lois de Dieu se rangeant aux lois économiques (On se souviendra de ces natif-ves d’Amérique du sud ne pouvant être de nature divine attendu qu’illes ignoraient la valeur de l’or.) De ce fait, au lieu d’emprisonner ou d’exécuter systématiquement, bagne et mise aux galères deviennent un moyen de punir économiquement viable. De la même manière, on se sert de condamné-es pour coloniser les nouvelles terres trop hostiles. Tout ce bas peuple, qui était jusque-là isolé en cachot, exécuté ou rendu à la société amputé de quelque membre et condamné à la mendicité, ce peuple, donc, se voit réuni dans des lieux de travail forcé. Maintenu à l’écart de ses maîtres et de la population environnante, il forme des micro-sociétés. En ces lieux violents, à l’ espérance de vie plus que limitée, des codes se sont ré-instaurés. Ce qui était autrefois marque d’infamie devient un lien social, et la modification corporelle reprend un aspect positif de l’intérieur et négatif depuis l’extérieur.
C’est dans ce croisement violent de l’apport tribal esclavagisé et de la concentration criminelle que tatouages et modifications corporelles refont surface en Occident.
C’est logiquement chez les marins que le tatouage a pris son essor. Il devient à la fois une identification sociale entre les gens de peine à bord des bateaux et une bravade face à celleux qui les dirigent. L’ exemple de ces marins se faisant encrer un crucifix sur le dos afin d’échapper au fouet qui aurait alors lacéré une image divine est caractéristique de ces pratiques qui deviennent des formes de résistance face à une oppression. (On retrouvera plus tard le même type de protection face à un châtiment : les prisonnier-ères russes du début de l’époque communiste se faisaient fréquemment tatouer des portraits de Lénine ou de Staline sur la poitrine, à hauteur du cœur, évitant l’exécution par balle.) Un-e forçat-ate, un-e prisonnier-ère ne peut rien posséder, mais un tatouage est inaliénable. Qu’un bagne interdise le port de la moustache, et on voit des moustaches encrées apparaître, de même que des chaussettes en des lieux où les vêtements sont uniformisés et sans confort. Une phrase gravée le restera quand bien même on arriverait à faire taire l’individu-e qui la porte, et elle sera un défi lisible au delà de l’exécution.
Petit à petit, au long des années, la pratique se répand. Dans les camps militaires d’abord, en commençant par les pelotons de conscrits. Ensuite, par les peines qui s’achèvent, les évasions, les désertions et démobilisations, le tatouage revient dans la grande société par la petite porte. Tous-tes ces marginalaux se retrouvent, formant à nouveau des micro-sociétés de petite ou grande criminalité. Alors que ces pratiques fleurissent dans les prisons et les bagnes, la rue s’en empare à son tour. Les symboles qui sont restés aujourd’hui les plus traditionnels se font jour : modèle religieux, portrait ou prénom d’ une personne aimée de l’autre côté des murs, métaphores d’animaux ou d’objets (pensée, araignée, dague, rose hirondelle, crâne...), opposition à l’état et revendication de la marginalité (mort aux vaches, « pas vu pas pris », pointillés autours du cou, guillotines, « sans patrie », etc).
Il faut noter qu’à cette période, les cabinets de curiosités ont cédé la place aux foires et à leurs monstres. En tant que phénomènes exotiques et fascinant-es pour la bonne société, les tatoué-es prennent une part du devant de la scène dans une course à l’extrême, se recouvrant le corps, parfois sur une période très courte. Les femmes y tiennent une place privilégiée, l’exotisme et la sensualité plaquée à la figure féminine déchaînant la passion du public. C’est dans cette surenchère que d’autres types de modifications corporelles reviennent à la surface dans le monde des européen-nes : lobes dilatés, lèvres à plateau, scarifications. Cette mouvance « spectaculaire » va avoir un rôle très important à jouer aux côtés de sa sœur « marginale » : c’est d’elle, en effet, dont se revendiqueront plus tard les freaks [ monstres ]. C’est à cette période que les premières boutiques et salons de tatouage ouvrent leurs portes.
En Russie, le tatouage de cette époque est toujours la marque d’infamie qui a longtemps perduré en Europe. Exécuté à même le visage, il stigmatise à vie l’individu-e qui le subit. Mais par le biais des marins anglais, le tatouage commence à se répandre dans la société non carcérale. Ces deux tendances vont amener peu à peu la frange criminelle russe à s’inventer un langage propre, un langage fait d’encre.
L’avènement du cinéma est une date importante dans l’histoire moderne du tatouage. En dehors du fait qu’après la photo, il ouvre la voie de la culture de l’image dont le tatouage fait bien évidement partie, il a eu sur lui des actions plus directes.
D’une part, en faisant découvrir aux spectateur-trices des images vivantes d’exotismes jusque-là statiques ou évoquées, il a enterré pour un temps les modèles tatoué-es des cirques et des foires.
D’autre part, il a cristallisé la vision du tatouage marginal dans des images caricaturales, en créant sur lui un jeu d’attirance / répulsion. Si les rares tatoué-es apparaissant à l’écran sont stigmatisé-es en rebuts de la société souvent patibulaires, hirsutes, violent-es, béstialaux, il n’en émerge pas moins une forme de fascination qui va grandir au fur et à mesure que le cinéma gagne en finesse et se détache petit à petit d’un manichéisme systématique. Même si le tatouage n’est abordé que comme un accessoire assez rare dans la grande panoplie des voyouxtes, c’est toute une esthétique de l’attirance criminelle qui s’installe avec le temps, et le tatouage commence à séduire autant qu’il effraie.
Cette porte d’entrée de l’encre par le cinéma passe par le filtre d’une société qui ne fait pas l’erreur de mettre le tatouage à jour sans le recouvrir d’une part de ses valeurs : le genre de la période précédente se lisait mal sur les tatouages. S’il y avait plus d’hommes que de femmes tatoué-es (une proportion assez proche de celle de la fréquentation des prisons, bagnes et casernes), les tatouages ne différaient guère d’un genre à l’autre. Bien que le jeu homme viril / femme sensuelle ait été de mise, il restait assez léger du fait de la « naïveté » du travail. L’exécution assez maladroite brouillait le caractère éventuellement sexué des imageries (généralement illisibles à moins de deux mètres). De plus, le choix du motif était souvent indifférent au genre : prénoms, fleurs et papillons symboliques (bien plus présents à l’époque chez les hommes que de nos jours. Il y avait, par exemple, une forte tendance, tant chez les hommes que chez les femmes, à se faire encrer des fleurs sur les tétons), oiseaux divers, images pieuses et phrases constituaient la plus grande part des choix. Évidemment, têtes de mort et autres couteaux, ainsi que les tatouages purement sexuels étaient présents (« robinet d’amour » ou « au bonheur des dames » sur des pubis masculins), mais l’aspect général de la personne tatouée était très similaire. Il faut aussi noter que les femmes tatouées étaient issues de milieux souvent violents et étaient bien plus proches dans leurs comportements des malfrats masculins que des dames du monde. Les motifs et symboliques étaient fréquemment plus agressifs que les classiques du tatouage féminin que l’on connaît de nos jours.
Avec le cinéma, le tatouage (au début presque exclusivement masculin) se revirilise. Il devient partie intégrante du séducteur violent et fort. S’y ajoute une vision romantique de personnage libre par opposition à une femme sédentaire et cherchant à fixer cette liberté dans la raison et la famille, jouant sur l’imagerie de la femme de marin en continuelle attente. La référence à ce cliché social n’est pas anodine attendu le rôle qu’a tenu la marine dans la renaissance du tatouage occidental.
Lorsque les femmes tatouées apparaissent enfin à l’écran, ce sont des femmes souvent sulfureuses, conspiratrices, parfois espionnes, toujours sensuelles et séductrices. Le cliché de genre se redouble d’un cliché social : ces femmes tatouées ne sont pas de la même couche sociale que leurs confrères masculins. Si la condition « bestiale » et pauvre de l’homme ajoute à son cachet viril et à sa séduction, le cliché féminin ne peut pas s’y retrouver. Les mains larges et calleuses, les cicatrices et autres marques d’alcoolisme peuvent fasciner chez un homme, mais sont répulsifs pour la femme. Porte-cigarette, gants noirs et corsets sont bien plus à même de faire fantasmer le public. Lorsque la femme tatouée prend place au cinéma, elle est donc d’un niveau social élevé. C’est dans son attitude qu’elle reste liée à la criminalité. On retrouve encore une fois l’idée de nature fondamentalement mauvaise de la femme. Si le tatoué du cinéma est marginal, c’est dû à sa condition, et il peut en venir à se racheter. La femme tatouée n’est mauvaise que par choix, par essence, et ne peut donc s’améliorer. L’homme peut toujours sauver son âme, la femme non.
Les années de guerre, en particulier celle de 39-45 vont voir des mobilisations massives, des victimes plus civiles que militaires. Individu-es et classes sociales de nombreux pays se côtoient, et les différentes imageries se croisent. Dans les contingents et les camps de prisonnier-es, le tatouage se communique au delà des frontières. Le nazisme a pratiquement annihilé cette communication de l’encre entre les pays par la barbarie de ses pratiques et de ses idéologies. Il est évident que l’extrême violence du marquage des juif-ves, rom-es, homosexuel-les et opposant-es politiques, l’industrialisation du génocide et le tatouage comme outil définitif de nomenclature stigmatisante d’un « objet » humain à éradiquer, a placé un jalon qu’il est impossible d’ignorer. La répétition du marquage d’infamie d’autrefois élevé au rang d’industrie du génocide va laisser des cicatrices indélébiles dans la culture moderne du tatouage.
Sur le front de l’Est, quantité de prisonnier-es russes, ayant eu le choix de rejoindre l’armée ou de poursuivre leur peine, s’engagent. Ces engagé-es issu-es des prisons étaient souvent très fortement tatoué-es, arborant codes et symboles des « voleurs dans la loi » (caste criminelle formée de plusieurs organisations mafieuses, se faisant concurrence mais partageant un même langage écrit sur la peau). La guerre finie, les principales mafias rejettent ces engagé-es. Mais partageant les mêmes codes, il devient difficile de ne pas être infiltrés par elles-eux. Le monde de la criminalité va donc élaborer de nouvelles symboliques qui resteront secrètes, sorte de mots de passe internes. Les tatouages déjà fort présents dans les prisons y prennent une place capitale, devenant de véritables curriculums vitae. Pour qui sait les interpréter, on peut y lire le passé, le temps purgé, celui passé au goulag ou dans d’autres camps d’internements, le rang social au sein des « voleurs dans la loi », et même si la personne qui le porte peut tuer, commercer, fournir de la drogue ou organiser des évasions au sein même de la prison. Ce langage tatoué reste le plus vaste et complexe qui ait existé, organisant et régissant toute une société parallèle. Plus qu’une institution, le tatouage carcéral Russe devient l’articulation incontournable de tout un monde complexe. Il est sa loi, sa constitution, sa communication, sa hiérarchie et sa nomenclature.
Cette guerre va aussi remettre le Japon devant les yeux de l’occident. L’holocauste nucléaire a modifié à jamais la vision du monde de ce bassin du tatouage. Si l’impressionnante force de la tradition y a survécu, les traumas de Nagasaki et d’Hiroshima vont peu à peu peupler la culture japonaise de pessimisme, d’ambiances post-apocalyptiques, de fantasmes de fin du monde. Sous l’influence du brassage de l’après-guerre, le tatouage oriental va se diviser entre le pur traditionnel et une vision prise entre les influences extérieures, la culture millénaire et le catastrophisme. À l’inverse, toute une population occidentale se retrouve face à une culture qu’elle avait passé sous silence, et le tatouage japonais, avec sa maîtrise, ses dimensions, ses compositions complexes et sa couleur se diffuse de part le monde.
Nous arrivons à une époque décisive en ce qu’elle porte en elle la première révolution musicale populaire : le rock n’ roll. En partie venu des marginalaux, en partie d’une jeunesse beaucoup plus sage. Deux mondes opposés et pourtant amalgamés dans un cliché de jeunesse / voyouterie qui va perdurer jusqu’à nos jours.
Étroitement liée au cinéma et à la diffusion de masse, cette mouvance avec ses hétérogénéités se ré-empare du tatouage et de ses codes en pleine transformation. Les bandes fleurissent en dedans autant qu’en dehors de la criminalité avec des signes de reconnaissance, jusqu’à investir les institutions, les collèges et autres lycées. Ces codes d’identification de bande rejouent la pièce des bagnes, des galères et des tribus, en y ajoutant un niveau plus large de l’identification collective à une culture musicale, et un niveau plus intime avec l’identification individuelle au sein du groupe. L’ensemble étant encore une fois en opposition avec le reste de la société. Musique et tatouage vont désormais rester intimement liés.
Les années 60-70 sont une rupture culturelle et politique, et le tatouage est pris dans ce mouvement. Les combats féministes le bousculent en deux points : premièrement, les rapports hommes / femmes bien enracinés vont subir une charge qui va, selon les tendances, déviriliser, s’approprier la virilité, dé-féminiser ou au contraire sur-féminiser le tatouage. Évidemment, le socle sexiste reste en place, mais il est ébranlé. Si le motif même du tatouage reste généralement marqué, ce n’est désormais plus forcément en rapport avec le genre de la personne qui le porte. Les codes se brouillent, les possibilités se multiplient.
Deuxièmement, la réappropriation du corps par les mouvements féministes va jouer un rôle décisif. Le corps n’est plus seulement vu comme un rapport social (ou plutôt, ce rapport est combattu), mais aussi comme un support d’émancipation individuelle. Si pour une part, les tatouages et autres modifications corporelles sont rejetées comme stigmates aliénant, ils sont par ailleurs repris et affirmés en tant que moyen de se réapproprier son propre corps, d’en faire un lieu de lutte. Qu’on envisage le corps originel divin, ou celui vierge de l’intégration sociale (qui porte en lui les marques d’un formatage éducatif aux rôles bien assignés de soumission et de domination), ce corps est repris par soi et pour soi.
Encore une fois, le tatouage sort de ses codes. Et il sort aussi plus volontairement des vêtements, pour affirmer d’autant plus la réappropriation du corps, avec en partie l’influence des ces tatouages japonais et de leurs dimensions inédites en occident. Pour celleux qui s’en emparent, le corps tatoué passe d’un code social hiérarchisant à une revendication d’individualité autonome.
D’autres luttes politiques ont de leur côté rapproché les marginalaux de milieux intellectuels, étudiants, ouvriers et militants. Le tatouage se déplace dans diverses couches de la population, dans diverses cultures sociales et prend autant de valeurs différentes que de milieux qu’il rencontre.
Le pacifisme, l’antimilitarisme et la culture hippie contribuent eux aussi à casser en partie le sexisme du tatouage, le virilisme des armes et du combat laissant la place au naturalisme et aux symboliques spirituelles, se réappropriant d’autant plus l’influence orientale.
Au même moment et à l’opposé, les mouvements de bikers, et principalement celui des Hell’s Angels, émergent, entre filiation des bandes du rock n’ roll, nomadisme spirituel des hippies et réaction ultra-viriliste à la non-violence. Le tatouage y est très largement adopté, exaltant la puissance des hommes, celle de leur machines et un érotisme très marqué chez les femmes. Probablement dans un même mouvement de réaction à la déferlante politique du moment, des images violentes déviant parfois vers l’extrême-droite apparaissent. Ces mouvements vont tellement s’approprier le tatouage, qu’outre le fait que ses membres soient souvent très encrés, ils vont s’investir fortement dans la production des tatouages. Pendant plus de 30 ans, ils seront très nombreux à ouvrir boutique, et auront une main mise sur le réseau du tatouage public, en véritable mafia des studios.
Dans cette période particulièrement mouvementée, on assiste à quelque chose que l’on avait jamais vu dans de telles proportions dans l’univers du tatouage : la naissance de différentes tendances, motifs et symboliques en un même lieu et dans un même temps. Le tatouage s’affirme, prend radicalement parti. Il devient un acte politique dans un monde politique.
Les scènes musicales et milieux sociaux ou politiques commencent à compter dans leurs rangs des tatoueureuses, généralement autodidactes. Prolongeant l’encre « fait main » de la prison, le tatouage fait ses prémices d’autonomie dans le giron de la musique. Ce phénomène se développe aussi dans l’émergence de ce que l’on appellera plus tard les « tribus urbaines ». Dans ces rapports de marginalité, de politique et de musique, le tatouage s’implante en profondeur, devient partie intégrante de nouvelles culture qui apparaissent.
Dans les années 70-80, les bouleversements continuent. Dans un contexte de crise sociale, le National Front se développe sous l’Angleterre thatchérienne. Il va infiltrer le mouvement skinhead (originellement issu du brassage culturel et musical des immigrés jamaïcains et de la jeunesse populaire britannique, tribu urbaine très amatrice de tatouage) afin d’y recruter ses « gros bras ». La réaction à cette dérive ne se fait pas attendre, et le mouvement se divise entre traditionnels, néo-nazis et antifascistes. Les tatouages qui les accompagnent se font plus radicaux, jusqu’à devenir des porte-drapeaux d’idées.
Autre élément révolutionnaire de l’époque et qui a été la genèse des modifications corporelles d’aujourd’hui : le bouleversement artistique qui a accompagné les mutations politiques que l’on a vu. Rejetant en bloc toute forme de classicisme, de nombreux-ses artistes ont pris leur propre corps comme matière première, comme support, et la performance comme lieu artistique éphémère en opposition avec l’œuvre d’art habituelle, objet conservable et vendable. À cette époque, il n’y a pas d’art qui ne soit ne serait-ce que sous-tendu par du politique. La revendication du corps pour lui même, comme matière vivante, organique et sociale, sa mise en danger, la recherche de ses limites, sa contrainte et sa liberté occupent pour un temps la scène artistique. Orlan va se modifier physiquement pour ne plus être réduite à une « cute girl » (fille mignonne). Les organes sexuels se montrent comme parties inaliénables d’un corps complexe et social et non plus comme les attributs d’une ségrégation sexuelle. Le « beau corps » est enfin remis en question, des dizaines d’années après la « belle peinture ». Les modifications chirurgicales, scarifications, tatouages, piercings extrêmes s’imposent dans les performances, encore une fois comme réappropriation du corps, mais aussi comme réappropriation du beau qui ne peut plus être une valeur absolue, mais un rapport individuel à soi-même. On se souvient alors des monstres de foires, de modèles tatoués, percés, scarifiés. On redécouvre ces « freaks ». C’est dans des milieux bien plus intellectuels qu’auparavant que les modifications corporelles reviennent. La société du corps moral et immaculé est assaillie de toutes parts : depuis ses prisons, jusqu’à sa jeunesse, de sa marginalité à ses intellectuels, de sa culture populaire à sa culture artistique.
L’histoire du tatouage se prolonge naturellement dans ce croisement de la musique, de l’art et de la marginalité dans le fameux « sex, drugs and rock n’roll ». Les expériences sont extrêmes et on explore toutes les possibilités du physique, du mental et des sens. Le mouvement glam prolonge luttes et performances en jouant la carte de l’extravagance, d’une beauté nouvelle et d’une confusion des genres. Il sera aussi la passerelle entre la musique populaire et l’art. Il va emmener le tatouage sur des terrains d’autant plus visibles et provocants. Si ce dernier fait partie du show de la scène et du spectaculaire, il est toujours présent lorsque les maquillages et costumes sont enlevés. Il maintient l’extériorisation d’une révolte en dehors des projecteurs. Il redit ce qu’il est pour les prisonnier-es et forçat-es : un fait inaliénable face à la dépossession systématique d’individualité de l’univers carcéral. Encore une fois, l’oppression est déplacée depuis l’intérieur des prisons vers la société dite « libre », et c’est face à la normalisation sociale, aux bonnes mœurs et à l’œil de plus en plus coercitif de l’état que le tatouage se pose en outil de ré-individualisation, de manifeste d’un choix de vie différent.
Le punk va pousser le phénomène encore plus loin. Non seulement l’opposition à l’establishment n’est plus un élément, mais bien le fondement de ce mouvement, ses manifestations, tatouage y compris, n’en étant que plus démonstratives, mais en plus, il porte en lui ce qui va devenir le DIY. La musique n’est plus une affaire de professionnel-le, les vêtements sont récupérés et modifiés par celleux qui les portent, les squats se développent. Ce qui était déjà en gestation dans l’autonomisation des scènes s’affirme et le tatouage s’y enracine plus que jamais. Ce n’est plus simplement par une envie « d’entre soi » que les tatouages se pratiquent depuis l’intérieur même de la scène, c’est désormais une volonté manifeste, un choix.
Dans cette mouvance qui croise étroitement le politique et la musique, des groupes de lesbiennes, de gays, de féministes arrivent. Le corps punk est un corps libre, et les motifs, dispositions et autres symboliques des tatouages se ressemblent tant par la réfutation des genres et l’appartenance à un même mouvement, qu’ils varient par l’affirmation de soi.
La poussée radicalement politique de groupes dans la lignée de CRASS va porter le DIY et la réflexion sociale au cœur d’un mouvement dont la musique n’est plus qu’un élément parmi d’autres. L’anarchopunk pointe le bout de son nez. En opposition au système, à l’état, à la social-démocratie mais aussi face au punk commercial et labellisé, face à la dépolitisation du mouvement et à ses idoles naissantes, il va propager une alternative d’action et d’autonomie. La réappropriation du corps revient encore une fois en force. Son indépendance face à des normes de genres, de valeurs morales et de subordination au travail combinée au DIY fait que tout un milieu contestataire s’équipe, se forme en autodidacte et partage ses connaissances et expériences du tatouage à une époque où les « secrets » sont jalousement gardés par les professionnels. Un tatouage positivement amateur et dynamique face à un professionnalisme jaloux de son savoir. Dans ce mouvement libérateur, les imageries explosent. Les motifs traditionnels du tatouage laissent la place à l’expression graphique de chacun-une. La liberté, le refus de l’autorité et la marginalisation volontaire se réinvestissent depuis l’encre du cachot vers un espace politique.
Depuis les années 70, si le tatouage s’est donc clairement politisé, il a aussi commencé à amorcer sa popularisation. De plus en plus vu, de plus en plus montré, parfois médiatisé, il commence à toucher des couches de population qui ne sont pas forcément engagées politiquement, musicalement ou ayant tâté de la prison. L’avènement du petit écran y a très probablement contribué. Aux films et actualités du cinéma se sont ajoutés des feuilletons, des reportages, documentaires, émissions de débats, etc... Malgré la guerre froide omniprésente, le monde se « rétrécit ». Le tatouage prend d’avantage d’importance dans la panoplie de voyouxte déjà en amorce dans le cinéma. Ce que l’on a dit des artistes performeureuses s’ajoute à une diffusion à la fois plus populaire et médiatique du tatouage. Il faut aussi compter avec un aspect générationnel. Si la jeunesse du rock n’ roll des années 50 flirtait avec la marginalité, elle constitue une partie des parents des enfants des années 70. Les jeunes générations cohabitent parfois dès l’enfance avec des personnes tatouées. C’était bien évidement déjà le cas avec les enfants d’ancien-es prisonnier-es, mais désormais, cette influence générationnelle ne se cantonne plus forcément à une imagerie criminelle et négative. Petit à petit, le tatouage entre dans les mœurs. Ce phénomène va, de fait, aller en s’accroissant, chaque génération étant exposée à un univers plus tatoué que la précédente, avec une forme de banalisation progressive de l’encre.
Le tatouage va donc suivre plusieurs évolutions distinctes, parallèles, parfois opposées, mais établissant souvent des passerelles en elles : des courants marginaux, qu’ils soient criminels ou politiques, des courants musicaux, des courants artistiques et des courants moins engagés, plus communs. Il serait un peu prématuré de parler de mode à propos de ces derniers. Ce mot assez fort sera trop utile pour qualifier le boum du tatouage qui explosera tous ces codes quelques 20 ou 30 ans plus tard. On peut en parler en terme de « tendance », pas dans un sens médiatique très synonyme de mode, mais dans le sens de « tendre vers », comme une inclinaison progressive d’une population en direction d’un phénomène. Si cette « tendance » du tatouage touche encore très majoritairement les couches populaires, il se diffuse doucement dans les milieux plus confortables.
Ces phénomènes continuent à s’accentuer tout au long des années 80. La société de consommation qui s’instaure et s’installe ne laisse pas le tatouage de côté. Par la médiatisation, par une banalisation encore timide mais bien en marche, par l’explosion de la production musicale, des clips, la tendance au tatouage se renforce. Encore une fois, le cinéma promeut une certaine vision. Toutes qualités de films confondues, le tatouage revient en force à l’écran. Bon ou mauvais, le héros qui le porte (cette tendance est presque exclusivement masculine) est nécessairement violent, criminel ou militaire. Le tatouage se porte fermement sur les muscles. La fascination grandit, et l’identification aussi. Pour la première fois, le tatouage est vu d’un œil positif, non pas par différentes scènes musicales ou politiques, mais par toute une population consommatrice. La société occidentale, si elle a été touchée peu ou prou par la révolution du corps et les poussées féministes, reste fermement accrochée à ses valeurs sociales et à ses valeurs de genre. Et si le tatouage se déplace dans des couches plus moyennes de la population, c’est rabattu sur les valeurs de cette société. Le tatouage de cette « tendance » s’installe, plein de testostérone, dans les foyers où le petit écran participe à sa diffusion. Bien qu’encore assez rares et souvent vues d’un mauvais œil, le nombre de boutiques augmente, les premières revues spécialisées paraissent, dans un univers affilié ou, dans la plupart des cas, proche du milieu biker.
Avec la chute du mur de Berlin et celle du bloc communiste, capitalisme et société de consommation dominent le monde de leur monopole politique. Le bloc de l’Est explose, et les fameux tatouages des prisons russes sortent des frontières. Bien que la signification en reste secrète, peu à peu les codes sont explorés, et dans certains milieux marginaux en Europe et aux états-Unis, dans et hors des murs, le tatouage reprend en partie sa force symbolique.
Dans les années 90, ce qu’on appelle la mondialisation se met en place. Une mondialisation du marché, un rapport de production / consommation qui devient planétaire où la toute puissance économique et militaire des anciens alliés dominent. Dans ce contexte, les pays économiquement forts lâchent la bride à la société de consommation qui s’était mise en branle dans les années 80. Dans le mélange de ce consumérisme, de l’envie de nouveauté (qui a en grande partie à voir avec un monde à direction désormais unique) et de la présence de plus en plus visible du tatouage, les prémices de ce qui sera un effet de mode se font jour. Au milieu de la décennie, les classes moyennes commencent à entrer plus volontiers dans les boutiques. Celles-ci se font plus nombreuses.
Au tournant du siècle, c’est l’explosion. De quelques centaines début 90, les boutiques se comptent par milliers dans les années 2000, et par dizaines de milliers dix ans plus tard.
La révolution de la bulle Internet, l’arrivée progressive de professionnel-les ayant un véritable bagage en dessin ou en graphisme, la multiplication des médias, l’arrivée des conventions nationales puis internationales font que le tatouage se diffuse partout et à une très grand échelle. De ce fait, la main mise du milieu biker sur la profession commence à se disloquer, et finira par pratiquement disparaître.
Repris, diffusé, « communiqué », le tatouage perd de sa symbolique, de ses significations. Il devient progressivement plus ornemental que chargé de sens. La culture du tatouage propre à certains milieux marginaux ou musicaux se dilue peu à peu dans la masse, et même les codes les plus marqués sont repris à titre de décorations. De l’étoile nautique à la toile d’araignée au coude, de l’hirondelle au dragon japonais, du chat noir à la tête de mort, rien n’y échappe. Par le processus qui vide une forme de son sens et de son histoire, toute une culture devient effet de mode. Il est d’ailleurs assez paradoxal qu’une mode, par essence éphémère, se fixe sur une pratique aux résultats permanents. Ces nouvelles tendances se posent donc sur des motifs particuliers qui passent de mode les uns après les autres. La période dauphins, la période aigles et indiens, la période fées, la période étoiles, la période calligraphie chinoise, etc, etc... Le paradoxe entre mode et permanence n’échappe d’ailleurs pas à ce phénomène désormais mondial : de plus en plus de firmes, de laboratoires et de professionnel-les tendent à chercher d’avantage de moyens de rendre le tatouage éphémère. Encres non-permanentes, dé-tatouage laser de plus en plus efficace, recherche de crèmes et traitements dé-tatouants, autant de tentatives pour que l’effet de mode ne soit plus entravé par la permanence.
Le « phénomène tatouage » s’installe de plus en plus dans la société, touchant d’autant plus de personnes, d’avantage de professionnel-les et générant toute une économie, il entraîne des conséquences jusque-là inédites. D’une part, les tatoueureuses se cherchent une légitimité dans le monde du travail : en Angleterre, en Suisse, Allemagne, Belgique, Italie, Norvège, Canada, USA, Chine, Australie, des associations ou syndicats existent depuis 1975, avec une visibilité de plus en plus légale et acceptée. En 2003, le premier syndicat Français de tatoueureuses est créé : le SNAT (Syndicat National des Artistes Tatoueurs) . D’autre part, les états entreprennent de légiférer sur une activité qu’ils ne peuvent plus ignorer, que ce soit au niveau légal, financier ou au niveau de l’hygiène. Les premières tentatives en ce sens sont extrêmes et stigmatisantes : le 20 février 2008, l’académie de médecine française catégorise les personnes tatouées en ces termes : « Ces modifications corporelles correspondaient d’abord à des camouflages avant de devenir un rite initiatique du passage de l’enfance à l’âge adulte, ont un lien avec certains modes de vie ou comportements sociaux. Elles traduisent plusieurs états : perception négative des conditions de vie, mauvaise intégration sociale, souci d’amélioration de l’image de soi, précocité des rapports sexuels avec grand nombre de partenaires, homosexualité, usage de drogues et consommation d’alcool, activités illicites et appartenance à un « gang », mauvaises habitudes alimentaires. » Les syndicats réagissent et la HALDE (Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité) est saisie. Si le tatouage professionnel se trouve petit à petit légalisé, encadré, institutionnalisé, par effet de réaction, le tatouage traditionnel et culturel plus marginal est montré du doigt. Tout un monde qui vivait sur une marge permanente, ni légale ni illégale, se trouve fractionné. Le mouvement qui légalise une activité illégalise tout ce qui est hors d’elle en même temps. Les tatoueureuses resté-es hors des boutiques sont désormais illégales-aux, tant au niveau de la fiscalité qu’à celui de la législation du travail et jusqu’à l’hygiène. Les syndicats appuient cette « illégalisation » pour deux raisons : premièrement, l’argument de la concurrence déloyale, chaque tatoueureuse travaillant dans l’illégalité peut être la source d’un manque à gagner, d’une perte de clientèle. Ensuite, le fait de s’être opposés à des décisions d’état les a amenés autour de la table des négociations. L’obtention d’aménagements ne peut pas se faire sans contrepartie, et c’est une collaboration entre états et professionnel-les qui s’instaure. Prenant place dans cette nouvelle « chasse aux sorcières », les syndicats en viennent à dénoncer leurs pendants désormais illégaux et à participer à l’action criminalisante de l’état.
Après des siècles de marginalisation, le tatouage se revêt à nouveau de certains aspects tribaux de ses origines. Si ses motifs ont explosé et se sont multipliés à tel point qu’ aujourd’hui, bien que tout ne soit pas tatouable, tout peut être envisagé en tatouage, ce dernier commence à redevenir la marque d’intégration qu’il a pu être dans les civilisations tribales. De plus en plus cher, de plus en plus virtuose, il se rapproche de la tendance artistique qui s’est ouverte dans les années 60-70. Il devient difficile au commun des mortels de s’en faire faire un, et les couches les plus populaires s’en trouvent de plus en plus exclues. Si les codes d’importance sociale des pratiques ancestrales se répètent, ce n’est plus vis-à-vis d’un statut, mais bien, et dans le même sens vers lequel la société entière a évolué, par rapport à une situation de confort financier.
De son côté, le tatouage marginal a lui aussi évolué. Si la pratique à l’intérieur des murs n’a été que peu sensible à la professionnalisation (pas de concurrence déloyale, illégalisme « mineur » exercé dans un milieu confiné de hors-la-loi, d’illégalismes « majeurs »), il a néanmoins subi une partie de l’effet de mode, et ses codes habituels ont évolué vers une pratique plus décorative que signifiante. Hors les murs, une tendance similaire à celle du marché noir a vu le jour. Une sorte de professionnalisme « hors-la-loi ». Il s’agit pour une part de personnes qui travaillaient de cette manière avant la vague de légalisme, et qui ont simplement fait le choix de continuer à fonctionner de la même manière, et d’autre part de personnes cherchant à éviter taxes et investissements très lourds de mise au norme d’une boutique, à maintenir des prestations sociales ou avoir une autre activité (professionnelle celle-là) et conserver la pratique du tatouage en complément ou en loisir.
Restent les cultures du tatouage marginal des scènes musicales et / ou politiques. Celles-ci restent fermement attachées à l’indépendance qui était la leur. Le milieu DIY a, tout au long de ces années de transformations politiques, continué à développer des pratiques d’autonomisation de l’individu-e. Chaque nouvelle loi étant à la fois une réaction face à une résistance et le signe de cette résistance, il s’empare du tatouage en tant que lieu de lutte individuel et collectif. Face à l’effet de mode esthétisant, il a développé des formes et des graphismes différents, alternatifs, démontant en grande partie la forme forcément très identifiée sexuellement de toute esthétique institutionnelle de l’individu-e. Le tatouage qui était, avant la professionnalisation, le lieu d’une lutte de réappropriation du corps, de l’esthétique, devient en plus celui d’une autre résistance face à l’état, à la loi, à la marchandisation de ce corps.
2) Enjeux du tatouage contemporain, idéologies et politique
Dans le tatouage contemporain, si l’aspect purement tribal existe encore dans certaines parties préservées de la planète, on peut envisager une vision globale. Bien sûr, certaines traditions sont fermement attachées aux territoires dont elles sont issues, marquant la pratique locale et se diffusant à l’international. Mais par ces transferts, c’est une notion de style plus que de culture qui s’affiche sur la scène du tatouage. La professionnalisation s’étend à tous les pays industrialisés, cependant qu’il reste une pratique traditionnelle ou artisanale dans les pays les plus pauvres. Seules les populations noires d’Afrique ne le pratiquent que peu ou pas du tout : l’encre ne ressort que très peu sous les peaux les plus sombres. Celles-ci, par contre, réagissant très fortement à la cicatrisation et créant des chéloïdes (excroissances de chair dues à la sur-cicatrisation d’une plaie), ont des rendus particulièrement visibles sur les scarifications. En plus du perçage et autres dilatations, c’est vers ces modifications corporelles que ces cultures se sont initialement orientées. Il faut tout de même noter l’importance des tatouages de prisonnier-es, le plus fréquemment noir-es, d’Afrique du sud qui, sans atteindre la complexité du langage de l’encre des criminel-les Russes, est devenu une culture de codes à part entière. Ce qui suit n’a donc pas de prétention universelle, mais peut s’apparenter à une tendance fortement dominante au niveau mondial.
Qu’il soit abstrait, symbolique ou figuratif, le tatouage fait image. Il est avant tout social, en permanent va et vient entre l’individuel et le collectif. On peut proposer une lecture en quatre tendances :
1- Une réappropriation du corps est un travail privé, une reconquête personnelle de l’individu. Mais elle n’existe qu’en face de codes collectifs ressentis comme oppressants, aliénants, et c’est face à ce collectif que le tatouage va projeter une image d’opposition. Le simple fait d’être porté est suffisant dans cette projection « contre », car, quelque soit le motif, le tatouage est la marque d’un choix, d’une prise de parole, d’un acte volontairement différenciant sur son propre corps. Évidemment, le motif peut venir moduler cette marque : il peut, selon la représentation choisie, adoucir ou au contraire renforcer cette prise d’indépendance, cette opposition. On peut parler dans ce cas de tatouage individualisant.
2- Le tatouage peut aussi être un rapprochement de l’individuel et du collectif. Dans ce cas, ce dernier est généralement défini comme un groupe, une bande, un gang, un collectif bien plus petit qu’une société et souvent opposé à elle. La reconquête de soi passe par un accès à une identification collective. La symbolique ou la figuration choisie le sera généralement selon des codes esthétiques communs. L’acte du tatouage en lui même reprend une part de l’épreuve initiatique tribale qui soude socialement un groupe. Mais ici, ce n’est plus au sein d’un code global, mais partagée dans une fraction de cette globalité et opposée à elle. La différence fondamentale entre l’esprit tribal et cet esprit de marque collective réside dans le choix de s’engager dans ce collectif ou pas. Le tatouage se revêt alors d’une force symbolique de « passage à l’acte » volontaire. Même si ces différents groupes sont loin d’être tous politiques ou politisés, on pourrait néanmoins parler de tatouage militant, car il figure autant la présence du groupe lui même que l’appartenance de l’individu au groupe. Au niveau tant individuel que collectif, il fait acte de propagande.
3- Les milieux carcéralisés, les milieux de la délinquance perpétuent leur culture de l’encre. La relation entre individu-es et collectif y est plus conflictuelle qu’ailleurs : si le tatouage reste l’acte inaliénable des dépossédé-es ou la trace indélébile de leur passage entre quatre murs, il reste un enjeu à tiroirs. Systématiquement opposé à la société, il peut être individualisant envers et contre tout (et contre tous-tes), identitaire vis à vis d’un groupe ou d’un gang à l’intérieur des murs, une affiliation à la population carcérale en général tout en y étant différenciant : les enjeux de pouvoirs et de territoires physique ou para-commerciaux peuvent être extrêmement violents en prison, et à la manière des prisonnier-es Russes, le tatouage peut être un signe distinctif et indicateur de rôle ou de grade à l’intérieur d’un collectif en même temps qu’il affirme ce collectif. Cette culture du tatouage est le constat d’un enfermement subit puis revendiqué comme une part d’identité. On pourra parler de tatouage carcéral puisqu’il affirme ce constat et cette revendication, qu’elle soit individuelle ou collective.
4- Il existe désormais un nouveau phénomène du tatouage qui va intégrer l’individu-e au collectif dans un sens bien plus large, celui d’une société. C’est une tendance en pleine transition vers une hégémonie sur toutes les autres : totalement intégrée dans le milieu du spectacle musical et commercial, dans le cinéma (tant au niveau des vrais tatouages des vedettes que des œuvres de fiction mettant le tatouage en scène), dans beaucoup de milieux sportifs très démonstratifs au point de vue physique (Ce qui est loin d’être anodin lorsqu’on parle de marquage et de rapport au corps), cette tendance est médiatisée, diffusée, montrée en exemple. Toute une population s’en empare, majoritairement jeune bien que touchant pratiquement tous les âges, réfutant l’aspect désocialisant au point de vue de la société pour quelque chose de purement esthétique ou porteur de sens personnel et sans conséquence sur la bonne marche de cette même société. À la fois propulsé par le spectacle du showbiz et adopté par une population relativement mixte du point de vue de la classe sociale, ce phénomène va recouvrir peu à peu l’ensemble de la société, les générations ayant pleinement intégré cette vision particulière du tatouage accédant progressivement aux affaires. Le conflit générationnel historiquement en place depuis l’avènement du rock n’roll est en train de se dissoudre par la masse, par la médiatisation et la législation. Cette tendance se distingue des autres en ceci que le rapport de l’individu au collectif ne se fait plus « contre », du moins, en apparence : il faut bien remarquer qu’une affiliation se fait toujours face à des résistances. Une affiliation à la norme ne peut exister que pour affirmer une non appartenance au « hors norme », celle par rapport à une société, un état ou une nation ne se fait que par peur, rejet ou volonté de distinction de l’extérieur, d’un-e « ennemi-e intérieur-e » ou de quoi que ce soit qui ne correspondent pas aux codes promulgués. Une esthétisation du corps se fait par adhésion à une vision esthétique collective, et rejette de ce fait tout ce qui se situe en dehors de cette esthétique. Cette tendance du tatouage est clairement « contre » le laid, le moche, « contre » le désocialisant, « contre » le hors-normes. Elle devient facteur d’intégration sociale au sens pacifié du terme, d’une intégration à la société entière. Bien que, comme on l’a vu, l’aspect permanent du tatouage soit paradoxal par rapport à une mode par définition éphémère, on parlera ici de tatouage de mode, ou de mode du tatouage.
Si on peut distinguer ces quatre tendances du tatouage, elles sont perméables entre elles, et les va et viens sont incessants de l’une à l’autre. Un tatouage carcéral peut tendre vers la mode, un tatouage militant peut piocher dans l’individualisant etc. Chacun de ces croisement vient moduler, renforcer ou adoucir les motivation « pour », « contre », « face à » ou « indépendant » d’un groupe, une société de groupes, une société tout court. Dans tous les cas, il y a une image individuelle en regard d’une notion collective. Ce regard réciproque, cette tension prend la forme d’un rapport, qu’il soit rapport de nombre (masse / unicité), de norme (homogénéisation / distinction), institutionnel (légalisme / marginalité et délinquance) ou encore de morale (vertu / déviance). Ces rapports antagonistes sont des rapports de force, des rapports de pouvoir / contre-pouvoir, des rapports politiques. Si l’aspect et le motif d’un tatouage ne portent pas forcément une lisibilité de ces rapports, l’acte et le choix de s’en saisir en découlent nécessairement.
Jusqu’à la période récente de la mode du tatouage, ces rapports étaient sous-entendus en permanence. Depuis le tatouage tribal indicateur de rang social, à la marque d’infamie, de l’ornement guerrier ou sensuel Japonais au tatouage carcéral, du tatouage individualisant au militant, la charge politique était affirmée. La nouvelle vague tend-elle à changer la donne ?
Le tatouage est donc en plein milieu de l’une de ses grandes transitions, comme ont pu l’être l’arrivée des religions monothéistes ou le retour de l’encre en occident lors de l’expansion coloniale, de l’esclavage et de la rentabilisation de la peine criminelle. La société de consommation désormais mondialisée et les politiques qui l’appuient s’emparent de tout ce qui est économiquement exploitable. Le tatouage, en tant que véhicule visuel a été complètement happé dans cette tendance. On peut se poser la question de ce succès tout particulier. L’envergure du phénomène n’a que peu de précédents, hormis les raz-de-marée de certains mouvements musicaux. La façon qu’a eu le tatouage de s’imposer est à elle seule distincte des autres phénomènes mondiaux. Chronologiquement, on assiste habituellement à une petite étincelle localisée qui explose et contamine toute une partie du monde très rapidement. Suit généralement une stabilisation qui vient peu à peu banaliser le mouvement, puis un déclin progressif ou rapide selon le cas, puis une autre explosion se déclenche ailleurs. L’arrivée du tatouage de mode a été bien plus progressive. Non seulement d’un point de vue purement matériel, le nombre de boutiques de professionnel-les et de tatoueur-euses indépendant-es ou marginalaux n’a pu s’adapter à cette demande grandissante qu’avec du temps, mais, en plus, l’aspect définitif, la douleur qui peut accompagner l’acte ont refréné nombre de personne susceptibles de s’y intéresser. Près de quinze ans après son initialisation, cette phase d’explosion n’est pas encore achevée. Le phénomène, loin de stagner, continue à prendre de l’ampleur. Or la dangerosité n’est pas rentable : non seulement le danger fait fuir le public, mais quand bien même la clientèle serait présente, ce danger décuplé par le nombre se reporterait sur le commerce, menacerait l’économie, la société. Mais si la fascination populaire pour la criminalité, l’illégalisme et la rébellion sont compensés par la peur de leur réalisation concrète, le trio consommation / communication / pacification peut « désarmer » ces fascinations et les exploiter économiquement sans crainte de leurs effets réels. Fantasme de la piraterie, imagerie et slogans DIY en publicité pour de grandes marques, reprise de l’imagerie punk rock dans la mode vestimentaire, capillaire et encore une fois publicitaire, utilisation d’images de révoltes ou détournement de symboles révolutionnaires pour des annonceurs souvent économiques (banques, assurances, produits pétroliers), les exemples se bousculent d’imageries contestataires rendues inoffensives par l’évacuation de leur contenu et la dilution de leur aspect visuel dans la masse. Il n’est pas question de crier à la récupération concertée ou au complot systématique. Bien que cela permette souvent de désincarner et de désarmer certaines révoltes, l’intérêt est bien plus économique que politique, une forme de consommation de révolte sans danger. Le plus souvent, ces détournements prennent naissance dans des initiatives individuelles sur de petites entreprises commerciales ou de communicants, amenés fréquemment par des personnes ou groupes de personnes issues des mouvements en question sans intention manifeste de leur nuire, mais d’une simple envie de « vivre de ce qu’on aime ».
Ce qui est en jeu dans cette mode du tatouage, c’est donc une diffusion massive, un désamorçage de l’acte individualisant, carcéral ou militant au profit d’une esthétique du simple motif, un rapport commercial dominant, et une légalisation, à la fois du point de vue des pouvoirs publics que de l’organisation des professionnel-les en syndicat. Une « mondialisation » du tatouage. Mais ce n’est pas parce que la résistance en a été édulcorée que celui-ci n’est plus politique.
Un effet de mode est nécessairement porteur d’idéologie : outre le fait qu’il est amorcé depuis les sphères médiatiques du spectacle et du vedettariat, qui sont des milieux totalement intégrés dans une société communicante et commerciale, le tatouage « intégrant » est bel et bien porteur de valeurs, et ce sont les valeurs de la société qui les porte. Récupérant et piochant dans les différentes cultures des symboliques et des motifs, l’effet de mode les rabat sur les canons de beauté contemporains, vidés des enjeux sociaux des milieux qui les ont vus naître. L’acte en lui même, la marque, perdent de leur sens au profit du seul résultat visuel, au profit d’une esthétique homogénéisante. L’idéologie de la mode est celle de la société qui la véhicule, recouverte d’une extravagance ou d’une nouveauté qui tendent à la faire oublier. La mode est l’agent infiltrant de l’idéologie d’état.
Dans ce mélange commercial et médiatique, comme on l’a vu, le niveau technique des tatoueureuses a explosé. Les qualités de dessin quasi facultatives il y a une trentaine d’années sont devenues indispensables aujourd’hui, avec régulièrement de nouveaux apports provenant du graphisme, de la peinture, de l’infographie qui s’ajoutent au panel des possibilités. L’aspect « artistique » devient de fait de plus en plus présent et, en tant que nouvellaux artistes, les tatoueureuses accédant au statut de star, de vedette, sont toujours plus nombreureuses. Les pièces réalisées grandissent, se colorent, deviennent toujours plus virtuoses. Sous le regard des valeurs véhiculées, ce n’est pas anodin : le résultat primant sur le sens, ce résultat prenant un aspect qualitatif (sur l’esthétique) et quantitatif (la surface, ou l’homogénéisation des surfaces entre elles), il devient comparable, mesurable à un autre. Entre professionnalisation et mise en vue de ces nouvellaux « artistes » tatoueureuses, le tatouage devient un objet précieux à collectionner, une marque de valeur, une forme sociale du traditionnel signe extérieur de richesse. Financièrement inabordable pour toute une partie de la population, et accédant progressivement au statut d’objet de luxe, il affirme un statut social.
Autre conséquence de l’explosion artistisante, le corps, s’il est resté un enjeu, est devenu tout à la fois un support et un objet de mise en valeur. Il n’est plus à se réapproprier mais à ornementer pour s’aligner sur un canon de beauté. Les tatouages se sont en effet mis à suivre les lignes du corps pour les affirmer, les souligner. Un motif esthétique en lui même qui va esthétiser un corps. Les canons de beauté étant toujours aussi implantés dans leurs clichés de genre, ces tatouages de « mise en valeur » vont affirmer des chutes de reins, des poitrines dans des exacerbations érotiques du côté des femmes, et souligner des musculatures, des statures virilisantes pour les hommes. De ce point de vue, les boutiques de tatouages se rapprochent de plus en plus des salons d’esthétique, avec maquillage permanent, pose de faux ongles décoratifs, bronzage artificiel et épilation y compris masculine. Les salles de musculations et autres remises en forme n’ont jamais aussi bien marché. Le corps devient un enjeu croisé de santé et d’esthétique. On ne cherche plus à s’approcher de son propre corps, mais d’un corps idéalisé beau et fort. Une idéologie qui, certes n’est pas encore poussée à son paroxysme, mais dont les effluves fascisantes sont difficiles à ignorer. La notion de « mise en valeur » est très claire en ce sens : par le prix et la marque de niveau social qu’imprime le tatouage, le corps prend une « valeur » financière, autant qu’il prend une « valeur » sociale marquant le degré d’affiliation du corps à l’idéologie esthétique de la société. L’idée de « valeur » elle-même rejouant la carte de ce qui est quantifiable et comparable, de ce qui a un rang et une place, de ce qui est mis en concurrence.
Avec cette expansion et une fois le processus de tatouage désarmé de ses forces contestataires, la culture générale y est ramenée, principalement par les professionnel-les, par le biais des magazines papier et d’internet, et de livres thématiques. Articles sur les forçat-ates, les marins, les prisonnier-es de différents pays et différentes époques, sur les cultures musicales, les gangs, les symboliques particulières de tel ou tel motif traditionnel, des reportages ethnographiques sur des populations ayant conservé une culture tribales du tatouage, etc... Le résultat en est une forme d’historisation, une mise au passé de toutes ces cultures, ce qui permet de mieux dégager le tatouage contemporain de toute intensité « contre », tout en l’implantant dans l’inconscient collectif comme l’aboutissement d’un parcours historique. La reprise de tout motif porteur de sens, ne l’est plus que par esthétique, ou hommage historique perdant la force subversive de l’original. À la fois justifiante et désincarnante, cette remise en culture pose le tatouage de mode comme modèle actuel unique, niant de ce fait toute culture vivante mais marginale ou alternative du tatouage. D’un côté, le mode de production du tatouage de mode fait disparaître en « creux » toute autre forme de tatouage contemporain, de l’autre, la légifération et la professionnalisation les combattent non pas comme des cultures opposées ou simplement non-affiliées, mais, on l’a vu, comme une dérive de la profession, un travail au noir désarmé de toute autre volonté que de faire de l’argent facile au mépris des tatoué-es qui ne sont plus désormais que des client-es.
Du point de vue du tatouage de mode, des verdicts tombent :
– Le tatouage individualisant n’est plus qu’une recherche d’originalité du motif, ou de particularisme de référence (initiales, prénoms, dates de naissance, signes astrologiques, allusions à une passion ou à un métier etc...). Le corps n’a plus rien d’un enjeu, c’est un support d’esthétique socialisante. D’individualisant, le tatouage devient personnalisé. De prise d’indépendance, il devient alignement identitaire esthétique, une valeur sociale.
– Le tatouage militant n’existe guère plus que dans l’armée, ou il n’est de toutes façons plus « contre » un autre collectif plus englobant et oppressant, mais encore une fois une forme, certes distinctive, mais absolument participative de la société. On le retrouve aussi dans d’autres milieux tous rattachés à une institution : affiliation à un club sportif, nationalisme des drapeaux et cartes de pays, ne restent que quelques cultures urbaines ou musicales enfouies dans la masse et la récupération par la mode du tatouage.
– Le tatouage carcéral, qui ne se prête que très peu à l’esthétique, est généralement mis à l’écart, en marginalité non seulement sociale, mais aussi historique, le reléguant à quelque chose du passé, à une forme d’âge d’or éventuellement nostalgique et niant le plus souvent son existence contemporaine.
Le tatouage de mode est bel et bien politique : non seulement il combat, désamorce et met à terre par tous les moyens à sa disposition les formes qu’on pourra désormais qualifier d’alternatives du tatouage, leur niant tout aspect politique en les reléguant au passé ou en les requalifiant de dérives de ses propres valeurs commerciales (travail au noir, argent facile etc...), mais il véhicule ses propres idéologies. Idéologie du corps idéal, idéologie libérale et sexiste, uniformisation de la population dans une recherche commune d’intégration. C’est définitivement un pouvoir qui s’exerce ici. Pouvoir social, pouvoir du savoir (exclusivité et statut des professionnel-es via les autorités), un pouvoir politique.
Si au vu des qualités d’exécution du tatouage professionnel actuel, nombres de populations tatouées « hors-mode » se sont tournées vers les boutiques (nombre de gangs, de groupes de motards ou autres affiliations musicales ont eu quelqu’un-e de l’intérieur passé-e professionnel-le, et ont de fait leur boutique attitrée), il reste malgré tout, encore aujourd’hui, une forte présence du tatouage alternatif. Elle vient du milieu carcéral (et encore, d’ici à ce qu’on ouvre des boutiques en prison pour « réduire les risques sanitaires » ou « empêcher la trop forte stigmatisation lors de la sacro-sainte réinsertion »), qui, ne serait-ce que matériellement, reste amateur de fait, et aussi de milieux clairement politiques, qui ne s’engagent pas sur la voie du tatouage de mode non pas par manque de moyen, mais par choix. Entre autres, les milieux autonomes, DIY et anarchopunks.
Dans ces milieux, l’enjeu du tatouage n’a jamais jamais été celui d’un acte pour lui même. Il est, comme on l’a vu, un moyen de réappropriation du corps, d’exposition d’idées, mais aussi une technique à s’emparer en toute autonomie, comme peuvent l’être la mécanique, la sérigraphie, ou tout autre moyen d’augmenter sa capacité à l’autogestion. Autre exploration, celle du rapport tatoueureuse / tatoué-es, qui essaie de se dégager du rapport professionnel-le / client-e : ce rapport est porteur d’énormément de pouvoir : pouvoir du savoir, pouvoir qui s’instaure entre professionnel-le agissant et client-e subissant, rapport d’une douleur contrôlée par l’un-e et infligée à l’autre, rapport aussi du fort contact physique dans un contexte dominant-e / dominé-e. Il y a un travail nécessaire de remise en question de ces rapports. Cela peut passer par un lien affinitaire, de confiance, par une plus grande part d’intervention du la tatoué-e, dans l’échange de savoir, de technique, dans une participation plus imbriquée dans l’élaboration du projet et dans sa mise en œuvre, bref par un rejet de la consommation du tatouage. Des formes de conventions alternatives sont organisées ou l’échange est le maître mot. Des pratiques non-mixtes apportent aussi d’autres réponses, qui brisent en grande partie le rapport de domination qui peut se créer autour d’un tatouage. Le mode de diffusion est aussi réinventé : la communication du tatouage de mode passe encore une fois par les valeurs qu’il véhicule. La mise en avant du « produit fini » et de son éventuelle virtuosité, avec des tatouages frais ou n’ayant que très peu vieilli (Ce qui s’explique en grande partie par le fait que les profesionnel-les peuvent difficilement prendre les photos autrement qu’en fin de séance ou juste après cicatrisation. Ceci dit, nombre de client-es repassent au long des années, et des clichés de tatouage ayant vécu avec le corps seraient possibles, mais bien moins valorisant que pris frais). Les professionnel-les sont eux aussi clairement mis en scène, avec noms, noms de boutique, pays, éventuellement contact ou adresse, avec des reportages sur tel-le ou tel-le artiste, soit un aspect clairement publicitaire. L’argument racoleur est décuplé par l’exposition de femmes très souvent bien plus objets sexuels que sujets tatoué-es en couverture et tout au long des magazines. Vedettariat, méritocratie et sexisme sont la vitrine du tatouage de mode. Bien évidemment, l’aspect financier n’y est jamais évoqué en chiffre. Peur d’une concurrence des prix, peur d’un recul de client-e potentiel-le, bien plus facilement flexible et influençable en boutique, devant le coût d’une pièce. Par contre, on trouve souvent des arguments justifiant un tarif passé sous silence par la qualité et le temps de travail, la reconnaissance de l’artiste etc... Le mode de diffusion du tatouage DIY, outre qu’il passe par les médias traditionnels du mouvement (brochures, livrets, etc), s’attache bien plus à une démarche, à une implication physique du la tatoué-é qu’à une éventuelle esthétique. Les tatouages ne sont pas hiérarchisés, ni en taille, ni en qualité supposée. Ils ne le sont pas non plus par style, et leurs auteur-trices ne sont pratiquement jamais cités. Les tatouages sont le plus souvent en situation sur un corps sans artifice, sans mise en scène, ayant vécu avec lui plus ou moins longtemps, et généralement sans identification de cellui qui le porte. L’individualisation, la réappropriation du corps ne sont pas une mise en lumière de personnalité, mais une démarche propre qui ne peut fonctionner dans une esthétisation extérieure à elle.
Dans le DIY, le tatouage n’est pas un produit, mais un outil, n’ayant de valeur en propre que selon la façon dont on le met en œuvre. Le tatouage DIY, après son travail sur le corps et l’autogestion, doit à présent ajouter un domaine à sa lutte. On l’a vu, le tatouage non-pro était marginal. Avec le légalisme du tatouage de mode, il devient illégal. Une pratique indépendante s’apparente désormais à un délit aux yeux de la loi, et le tatouage DIY doit intégrer des stratégies de résistance nouvelles face à une nouvelle domination.
Mais par le phénomène de mode du tatouage, cette contre-culture devient de moins en moins lisible. On a vu que le tatouage de mode a repris des imageries propres au graphisme, et s’est étendu à un champ des possibles dans le visuel qui n’est plus limité que par la technique pure. En un même temps, il y a, encore aujourd’hui, nombre de professionnel-les au travail médiocre et particulièrement maladroit. Le tatouage DIY, lui, est influencé par son milieu, par ses pratiques. Il est évident que le collage, la sérigraphie, la photocopie entrent dans le bagage graphique des tatoueureuses. L’imagination et la liberté de dessin y ont aussi une place importante. De plus, par l’échange et le partage des savoir, le niveau technique et figuratif s’est largement amélioré par rapport à ses débuts. Si on considère en plus que nombre de professionnel-les sont issus de milieux marginaux, de scènes proches du punk, voire qui font des aller-retours entre boutiques et squat (pour faire simple), On en arrive à un jeu d’influences visuelles croisées, et il est devenu impossible de lire les conditions dans lesquelles un tatouage à été fait. Un « Mort aux vaches » mal exécuté peut avoir été fait en boutique, et un tribal de qualité professionnelle avoir été piqué à prix libre dans une cuisine autogérée. Pour ce qui est de ses origines, du contexte, de la charge de docilité ou de résistance hors motif, le visuel ne distingue plus en rien un tatouage d’un autre. Un tatouage ne porte plus de trace lisible de l’acte politique d’où il provient. Il semble même qu’aujourd’hui, dans un contexte de tatouage globalisé, et pour ce qui est de la réappropriation de son propre corps, le choix de ne pas se faire tatouer ait une charge politique équivalente à celle qui consistait à se faire tatouer dans les années 60-70 : un refus d’homogénéisation, une recherche d’indépendance et une opposition radicale au phénomène de mode.
Si le tatouage de mode, devenu global poursuit sa transformation, il entraîne avec lui (par effet plus ou moins direct, par influence ou par réaction), toutes les cultures d’encre qui le précédaient. Si on considère l’homogénéisation visuelle, et qu’historiquement, on regarde les différentes implications, les différentes pratiques libératrices, stigmatisantes, imposées, choisies, normalisantes ou déviantes, et qu’on reprend cette dernière remarque sur le choix du non-tatouage, on peut considérer que si, de façon consciente ou non, le tatouage est définitivement politique, il ne l’est que très peu vis à vis de l’imagerie, du motif lisible qu’il présente, mais que c’est son contexte, sa genèse et les choix qui l’ont amené qui l’affirment. Le politique qui était propulsé aux yeux du monde revient dans une sphère bien plus privée. Celui qui était varié, multiple, protéiforme se condense dans un rapport quasiment unique de domination / résistance et de sa triple descendance légale / illégale, capitaliste / autogérée, et uniformisation / individualisation. La domination se recentre, la résistance aussi.
Le tatouage peut tout être : un outil d’oppression, un outil d’émancipation, de pacification, de résistance, de soumission, de lutte. C’est en tant qu’outil que le tatouage est politique, et c’est en tant qu’outil qu’il faut s’en ré-emparer.
Tatouage libre !
Cette brochure n’a pas une prétention de vérité. Elle propose des pistes de réflexions, des interrogations, des propositions de pistes politique et de moyens de luttes. Chacun-une est à même de la compléter, de la corriger, de la retravailler, de s’en emparer. La reproduction complète, partielle ou remaniée en est bien sur libre et même encouragée. Le « logo » de « tatouage libre » sur la couverture ne se veut pas individuel. Libre à tous-tes de l’utiliser, du moment qu’il reste en dehors des circuits de l’argent et qu’il contribue à la lutte de l’encre noire.
Merci à Mélo pour son boulot (« les robots aussi », photo du matériel DIY deux pages au dessus) qui a apporté pas mal des réflexions de cette brochure : girlzilla[at]no-log.org. Si le CD est indisponible, l’émission de radio « dégenrée, émission spéciale meufs et modifications corporelles » est téléchargeable sur Radio-Indymedia.
Contact : acratos [at] no-log.org
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (968.7 ko)