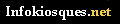Brochures
Et si l’humain valait l’homme ?
Antisexisme et antispécisme : rapports d’un dominant
mis en ligne le 8 juillet 2019 - Yves Bonnardel
Le spécisme, mais qu’est-ce donc ?
Je suis partisan de l’égalité animale [1]. Je pense que l’idée d’égalité seulement humaine est indéfendable, que rien ne justifie de ne pas considérer de façon égale au nôtre l’intérêt individuel d’un être d’une autre espèce à jouir au mieux de sa vie. Je suis opposé au spécisme. Le mot se base sur la notion d’espèce, par analogie avec les mots racisme ou sexisme : c’est la discrimination fondée sur le critère arbitraire de l’appartenance d’espèce des individus. Le mouvement antispéciste, ou mouvement de libération animale ou bien encore pour l’égalité animale, affirme que les appartenances à des catégories biologiques (d’espèce, de race, de sexe, d’âge…) sont non pertinentes pour décider quelle considération accorder aux désirs d’un individu (elles n’entretiennent aucun lien logique avec la question), et servent simplement de prétextes idéologiques à la discrimination et la domination, selon un processus commun qui consiste à invoquer « la Nature » pour se justifier.
L’antispécisme est donc un mouvement – très récent en France, puisqu’il a moins de dix ans [2]. On peut lire sur internet la principale revue théorique et militante francophone, Les Cahiers antispécistes – qui réclame l’égalité pour tous les êtres qui ont des intérêts à défendre, c’est à-dire tous les êtres capables de souffrir et d’éprouver du plaisir : tous ceux dont la vie dès lors peut se passer bien ou mal et dont on peut dire qu’elle leur importe. A l’heure actuelle, on sait que cela concerne au moins les individus animaux vertébrés et certains invertébrés. Une conséquence immédiate est qu’utiliser ces individus sensibles pour s’en nourrir est injustifiable.C’est surtout la pratique de consommation de poisson, de viande, d’œufs et de laitages qui cause le plus de souffrances, et les victimes se chiffrent par dizaines de milliards par an dans un pays comme la France.
Quelques difficultés
Depuis le début des années 1990, le mouvement contre le spécisme se développe un peu dans les milieux libertaires, essentiellement parmi les jeunes. Les groupes non mixtes hommes d’inspiration
politique [3] sont également nouveaux dans ces milieux (ils y « accompagnent » le renouveau
du féminisme) et certains militants ont découvert simultanément antispécisme et antisexisme.
Bien que composant une sorte de « gauche radicale », nous avons en commun de ne pas croire en un Grand Soir ni en une Terre promise ; en revanche, nous importe ce que nous subissons mais aussi ce que nous imposons à d’autres, ici et maintenant. Souvent au début avec beaucoup de naïveté sur nos
capacités de changer les choses et de changer nous-mêmes, sur l’étendue des révolutions nécessaires, sur ce que cela peut nous coûter, et du coup – parfois – sur notre volonté même de réellement changer. Nous sommes en mouvement…
Pour un homme, engagements antispéciste et antisexiste signifient tous deux intervenir contre la domination à partir de sa situation de dominant. Situation paradoxale d’où découlent quelques problèmes :
- Cela présente le danger de parler à la place des dominé-e-s, en leur nom, mais finalement une fois de plus contre leurs intérêts réels. Cela engage de ce fait à se pencher très sérieusement sur ce que vivent les dominé-e-s, aller à la découverte de leur monde, cesser de considérer mon monde de dominant comme étant le monde. Et lorsque c’est possible, prendre évidemment en compte leur propre avis.
- C’est aussi vouloir garder bonne conscience, ce qui peut vite mener à ne plus agir que dans un esprit de déculpabilisation, de diabolisation des autreset sublimation de soi-même, etc.
- Antispécisme ou antisexisme me placent dans une position similaire par rapport aux autres hommes (ou aux autres humain-e-s, dans le cas de l’antispécisme) : rompre le consensus, la solidarité des dominants, leur complicité ; cela signifie prendre des risques. L’antispécisme se heurte à des violences qui rappellent le harcèlement dont le féminisme est également l’objet : le ridicule, le refus de discuter, le déni, la déformation des propos, la diffamation, l’agression et parfois la violence physique. Ce qu’on a dans les années 2000, à la suite de la marche de la Veggie Pride, appelé « végéphobie »... Sans m’appesantir, je veux souligner que cette violence très réelle est une des principales raisons qui freinent le développement des 3 mouvements de refus des dominations. De façon générale, celui qui prend parti pour les dominé-es hérite en partie du mépris dont ils ou elles sont victimes. L’homme antisexiste sera par exemple ramené à une figure de couillon qui se fait avoir par les filles. L’homme végétarien sera également ramené à une figure de non-dominant (c’est-à-dire, une figure « efféminée ») : on parle alors de « sensiblerie »… Dans les deux cas, l’engagement contre la domination est perçu comme une privation (d’usage sexuel ou bien de consommation carnée) ; privation, abstinence, ascétisme sont alors opposés à la jouissance de celui qui a compris la Vie et la loi de Nature : la prédation, la loi du plus fort, l’utilisation des
autres [4]… L’homme qui ne participe pas des blagues sexistes des autres hommes passe au mieux pour un triste sire, cul serré et moraliste… Si, au-delà du simple boycott personnel, nous nous désolidarisons de façon marquée ou en intervenant activement, nous sommes perçus comme traîtres et risquons alors très réellement de prendre des coups.
- Remettre en question ladomination, c’est aussi interroger mon rapport, masculin, à la domination. Ce rapport est en effet un rapport de genre : le recours à la violence, l’utilisation de l’autre au profit matériel et identitaire de son propre groupe sont avant tout des pratiques masculines. Le rapport meurtrier à l’animal, de consommation de sa chair, paraît de prime abord concerner pareillement l’ensemble des humain-e-s ; pourtant, on s’aperçoit que les pratiques sont différenciées : par exemple, lors-qu’elles en consomment, les femmes « choisissent » plutôt les viandes blanches ou « le » poisson, alors que les hommes préfèrent nettement les viandes rouges, à plus grande valeur symbolique de violence et de domination [5]. Les quantités consommées par les femmes sont d’autre part généralement moindres.
Mais les femmes sont aussi plus nombreuses que les hommes à refuser carrément cette consommation de viande ou de poisson ; elles présentent leur motivation
souvent comme purement personnelle (« la viande me dégoûte »), mais il me semble plausible qu’il
s’agit alors d’éluder cet aspect éthique et politique qui ne manque pas de nous exposer sinon à des réaction agressives (Olivier, 1993). Les hommes, en revanche, semblent tenir beaucoup plus fortement à continuer à manger d’autres animaux [6].
Pourquoi les femmes se montrent-elles plus sensibles à la question animale ? Manque d’attrait pour la violence, en conséquence d’une mise hors-jeu des circuits de la domination, qui restent prérogative masculine ? Plus grande capacité à s’identifier aux autres, à compatir ? Peut-être, mais attention aux affirmations différentialistes/naturalisantes… La moindre consommation de viande des femmes, ou leur répulsion, dénote certainement leur place dominée ou subordonnée dans le système « patriarcal » (hétéroviriarcal, plutôt), mais peut-être aussi une attitude, consciente ou non, de solidarité envers les autres dominé-e-s. Ne serait-ce que parce qu’elles subissent, sous le regard des hommes et dans leurs discours, une certaine animalisation…
Le masculin et l’humain : l’instrumentalisation des corps
Quel lien le regard des hommes sur les femmes entretient- il avec le regard des humain-e-s sur les autres animaux, et comment dans les deux cas le rapport symbolique de la domination est un rapport d’instrumentalisation du corps [7] ?
Ce sont des féministes, il me semble, qui les premières ont abordé le sujet. C’est sur ce thème, par exemple, que Carol Adams a centré son Sexual Politics of Meat (Adams, 1990 ; Zarmazones, 1991).
Les individus qui sont propriété d’autrui, qui sont approprié-es, sont perçu-es comme des choses par les propriétaires [8]. Animaux et femmes, tout comme autrefois les esclaves, sont fondamentalement appréhendé-e-s comme corps : ils et elles sont détaillé-e-s, disséqué-e-s du regard, en fonction de l’usage qu’on en veut faire. C’est qu’ils et elles sont directement utilisé-e-s comme corps.
Si l’humain contemporain se perçoit comme ayant un corps, qu’il possède et dont il use, il perçoit par contre l’animal comme étant un corps. C’est l’argumentaire de l’humanisme dès les XVe et XVIe siècles : parce qu’ils sont doués de conscience et de raison, les hommes maîtrisent leur corps, le disciplinent et le civilisent. Par là-même, contrairement aux femmes, aux enfants, aux sauvages et aux animaux qui sont les jouets des instincts et des pulsions corporelles, ils possèdent leur corps et le soumettent. Les premiers sont propriétaires [9], d’eux-mêmes et du monde, les second-es sont approprié-es/- appropriables, puisque livré-es sans cela à leurs (bas) instincts. Cette différence est socialement fondamentale, puisqu’elle détermine qui « passera à la casserole » et qui décidera par contre de « à quelle sauce qui sera mangé » [10].
Les femmes sont vues comme corps sexuel
Des féministes ont fait remarquer que « l’homme » se saisit immédiatement, spontanément comme ayant un sexe, qu’il possède et dont il use comme un outil, une arme. Et il perçoit par contre « la femme » comme étant un sexe (dont il use). Tota mulier in utero : toute la femme trouve son explication dans son utérus. L’« être » des femmes, c’est leur sexe : il constitue leur nature, leur vérité, leur destination, leur fonction, leur essence, leur corps. L’homme, lui, ne saurait se réduire à son sexe ; il a un sexe, c’est tout (Fournier et Reynaud, 1978 ; Welzer-Lang, 1998 c : 72) [11].
Le regard des hommes hétérosexuels sur les femmes est un regard réifiant, qui transforme en chose. Un homme sera regardé comme un être agissant, voulant, sentant. Une femme sera détaillée dans son physique, ou dans ses attitudes en tant qu‘elles semblent être une émanation de son corps fondamentalement sexuel. Je cite quelques phrases d’une très instructive exposition féministe d’affiches de soirées étudiantes [12] :
« Des jambes, une bouche, des seins, des fesses… L’image de la femme n’est pas représentée comme un tout, comme un individu à part entière (c’est le cas de le dire !) mais comme l’addition ou la segmentation des parties "intéressantes" de son corps. Ce n’est ici qu’une variante de la représentation de la femme objet : en tant qu’objet, on peut la découper, on peut la réduire à une (ou à des) partie(s) de son corps, qui sont choisies ou isolées parce qu’elles suffisent à éveiller des fantasmes masculins, ou tout au moins parce qu’elles intéressent directement l’imaginaire sexuel des hommes. »
Lorsque des hommes sont présentés sur ces affiches, c’est en tant que... prédateurs : des loups façon Tex Avery, l’oeil luisant et la babine salivante, guettant la « créature de rêve ». Tout comme des non-humains, les femmes sont des proies qu’on peut s’approprier, ce qui autorise toutes les comparaisons imaginables entre drague « amoureuse », chasse ou braconnage.
Les animaux sont perçus comme corps carné
Puisque je parle du rapport prédateur, revenons-en à la façon dont nous percevons les animaux. Voilà en illustration ce qu’en dit Pierre Guénancia (Guénancia, 1986 ; 32-33) :
« La perception du corps de l’animal, de l’animal comme corps, coïncide avec le sentiment de cette extériorité infranchissable [que ressentirait « naturellement » l’humain face à l’animal, ndm]. L’animal donne à voir son corps comme la seule chose qu’on peut voir de lui. Son corps n’est pas seulement la découpe matérielle (sic) de son individualité, il est le seul objet sur lequel se pose le regard qui est comme réfléchi par ce corps qu’il observe mais ne traverse pas. […] l’homme, d’emblée a un corps. Il n’est pas son corps, comme l’animal dont c’est pour ainsi dire la carapace et l’identité même. »
Si le corps des femmes est « sexuel », celui des animaux [13] est généralement « carné ». Bien souvent, l’on ne sait carrément pas si ce qui est nommé est sa chair ou l’individu en tant que membre d’une catégorie : L’animal dans l’alimentation humaine est le titre d’un livre consacré à la consomation carnée ; « Du veau » est l’appellation de la chair de veaux, comme « du poisson » est celle de la chair de poissons, etc…Les animaux domestiques sont tellement identifiés à leur seule chair que « pour ce qui est des bovins et des moutons, Henry More, en 1653, est convaincu qu’ils n’ont reçu tout d’abord la vie que pour conserver la fraîcheur de leur viande “jusqu’à ce que nous ayons besoin de les manger” » (Thomas, 1985 : 22). Ne traduit on pas « bétail » en anglais par lifestock ?
Les schémas spéciste et sexiste opèrent tous deux une réduction [14] de l’« autre » au corps. Si les animaux apparaissent comme de la viande sur pattes, les femmes ne sont-elles pas tout aussi crûment perçues (par les hommes) comme des « vagins ou des utérus sur pattes » ?
Domination et instrumentalisation
Colette Guillaumin (1992 : 23) note que la consommation sexuelle est la marque de l’appropriation d’une femme :
« Lorsqu’on est une femme et qu’on rencontre après un certain temps un ancien amant, sa préoccupation principale semble être de coucher à nouveau avec vous. […] Ce n’est pas de sexualité qu’il s’agit ici, ni de « sexe », c’est simplement d’usage ; ce n’est pas de « désir », c’est simplement de contrôle, comme dans le viol. Si la relation reprend, même de façon éphémère, elle doit passer à nouveau par l’usage du corps de la femme. »
La sexualité virile – la pénétration – est consommation sexuelle du corps des femmes. C’est en ce sens qu’on a pu affirmer que le viol est à la sexualité masculine ce que la guerre est à la politique ou à l’économie : « je t’ai baisée » signifie aussi « je t’ai eue », « c’est toi la perdante », et la réciproque n’existe pas : on dit d’une femme qu’elle est baisée ou qu’elle baise, mais pas qu’elle baise un homme.
Voilà ce qu’analysait Emmanuelle de Lesseps (1980 : 96, 98-99) :
« Dans l’utilisation du corps d’un esclave et dans le viol il y a en commun la consommation de l’autre comme chose. […] Les femmes sont désignées au meurtre par la même déshumanisation qui les désigne au viol : le viol est un degré du meurtre, un degré dans la chosification d’un être humain dont la limite extrême est le meurtre. Et la menace toujours sousjacente, sinon exprimée, qui permet aux hommes de violer, est celle du meurtre. Tuer quelqu’un c’est en faire une chose et le « meurtre sadique » n’a pas d’autre signification que la volonté de transformer totalement une femme en une chose. C’est la mise en acte du fantasme sexiste que « les femmes n’ont pas d’âme », déni de leur être conscient, déni de leur humanité, déni enfin pour un homme de « la » femme comme sa semblable. Le meurtre « sexuel » (sexiste) comme le meurtre raciste, ce n’est certes pas le rejet horrifié de la différence, c’est au contraire le rejet de la similitude humaine, c’est le renvoi de l’autre à l’état de chose, à la suprême différence : l’objet inanimé. C’est une différenciation mise en acte pour nier la similitude, l’« intérêt » de cette différenciation étant de rendre concevable, symboliquement et concrètement, la faculté de posséder d’autres êtres humains ; et ce n’est concevable (et réalisable) qu’à condition de les décréter « différents », c’est-à-dire non-humains, objets à prendre, manipuler, utiliser et ultimement détruire, c’est-à-dire consommer. Consommé = fini = achevé. Y’a plus. J’ai tout mangé. »
L’instrumentalisation du corps des individus des autres espèces s’analyse logiquement dans les mêmes termes : tuer un animal, c’est en faire une chose : c’est la mise en acte du déni spéciste de leur être conscient, déni de leur caractère sensible, déni enfin pour un-e humain-e de « l’animal » comme son semblable.
Manger un animal, c’est l’utiliser radicalement : peut-on nier plus fondamentalement un être vivant sensible comme individu ayant des intérêts propres ? Manger un animal, n’est-ce pas lui signifier symboliquement, et surtout se signifier à soi-même : « Vois-tu, tout ce qui fait ta valeur à mes yeux, c’est ta pure matière, c’est ton corps mort. »
Noëllie Vialles note que l’on ne mange que la chair d’animaux que l’on a préalablement tués, et généralement, saignés (Vialles, 1987) ; ceux qui meurent de mort naturelle ou de vieillesse sont très rarement consommés. David Olivier a par ailleurs montré que le seul trait qui soit commun à l’ensemble des viandes, ce qui fonde en fait cette catégorie « viande », c’est ce meurtre qu’il a fallu perpétrer : le caractère fondamental de la viande, ce qui lui confère ce charme et ce prestige que n’ont pas les légumes, c’est la violence commise (Olivier, 1994).
Dans notre civilisation qui oppose le corps à l’esprit et la Nature à l’Humanité comme la brute au civilisé, le corps reste symbole de la matérialité et de la naturalité, et dès lors utiliser quelqu’un dans son corps reste une façon fondamentale de le dévaloriser. En aucun cas n’est affirmé aussi nettement le fossé qui sépare « l’Homme » de « l’Animal », et l’infériorité de ce dernier ; ce qui objective pratiquement dans notre conscience le mépris des uns et la supériorité des autres, c’est bien la différence concrète de traitement.
Sous l’Ancien Régime, des bandes de jeunes garçons allaient agresser les veuves et les femmes célibataires, les femmes isolées (Orpitz, 1991). Ces agressions jouaient un rôle initiatique,
ouvraient l’accès au statut d’homme adulte ; sans aller si loin, pensons simplement aux blagues sexistes de nos contemporains, aux interpellations et harcèlements divers dans l’espace public (Baillette & Liotard, 1999)… L’agression de femmes (ou d’hommes « efféminés ») prouve ou fonde notre appartenance commune à la virilité (Welzer-Lang, Dutey et Doray, 1994).
Ne doit-on pas penser que le meurtre d’êtres sensibles, autrefois public et objet de fête collective, et leur
consommation, leur chair trônant au coeur du repas, centrale, obligatoire pour faire honneur à des invités de marque, confirment parallèlement notre appartenance commune à l’humanité, notre solidarité et notre complicité ?
Le rapport des genres est un rapport inégalitaire d’exploitation. La domination des hommes sur les femmes est concrète et matérielle, puisqu’elle consiste notamment en l’exploitation du travail dit domestique, de l’ensemble ou presque des tâches liées à l’élevage des enfants, à la famille, etc., travail contraint, gratuit et non reconnu comme tel. Mais, comme tout système de domination, il a ses symboles, ses marqueurs. Je pense que l’imposition sexuelle est le symbole par excellence de la domination masculine. Les genres masculin et féminin sont construits à partir de la différence des organes sexuels. La domination d’un genre sur l’autre se marque alors logiquement, me semble-t-il, par l’imposition d’une pratique au coeur de laquelle se retrouvent ces fameux organes sexuels : la
sexualité [15]. Je pense que, parallèlement, le symbole principal de notre domination sur les autres animaux consiste en la pratique de les manger, d’utiliser leur individualité, non comme corps-sexe, mais comme corps-chair, comme simple matière [16].
Pour les dominants, ce sont bien sûr des gains matériels, mais ce sont aussi des symboles très forts. Pour les dominé-es, ce sont la souffrance, les viols, la mort.
Usage sexuel et consommation orale
Il existe une forme très rare de violence, qui correspond au plus fort tabou qui soit dans nos sociétés occidentales : tuer un-e humain-e pour la manger, la traiter en tant que bête. Le crime de lèse humanité ne semble pouvoir être plus… consommé : si cela paraît la normalité même lorsqu’il s’agit d’un non-humain, cela devient une monstruosité sans précédent lorsque c’est un-e humain-e qui est ainsi ravalé-e. On ne trouvera pas assez de mots pour qualifier la folie, la pathologie, l’anormalité bestiale du meurtrier (qui est quasiment systématiquement un homme). A travers la victime, c’est l’Humanité qui se sent atteinte.
On oublie alors, mal à propos, que c’est de gynophagie plus souvent que d’anthropophagie dont on devrait parler : en effet, qu’il s’agisse en France de Issei Sagawa qui avait mangé une humaine, ou d’autres cas relatés ces dernières années en Occident, ce sont généralement des femmes qui sont consommées [17]. Les meurtriers sont fous en ce qu’ils n’usent pas du mode de consommation et de violence normaux, en ce qu’ils mélangent les genres et les espèces. Ils ne font simplement qu’aller plus loin que ce que permet la société et la (fragile) humanité reconnue aux femmes.
Marina Yaguello note que parmi les métaphores qui situent les femmes comme marchandises se trouvent en bonne place celles qui les désignent comme nourriture : « Une jolie fille est appétissante, mignonne à croquer, on en mangerait, à défaut, on se la farcit ». Et à propos des prostituées, elle remarque également : « La métaphore animale est particulièrement productive. Le thème de la volaille y est, comme pour la femme en général, central » (Yaguello, 1982). Dans le dictionnaire érotique de Pierre Guiraud (1978) qu’elle cite plus loin, on trouve aussi pour désigner les femmes, les termes de « gibier d’amour », de « bête à con », de « boudin », de « cotelette » (pensons aux insultes par lesquelles on traite les hommes de femmelettes, et les femmes de… femmes ( ! ) : connasse, conne, pétasse, salope… (Bonnardel, 1995).
Il nous faut constater qu’un viol suivi de meurtre ne suscite pas une aussi grande émotion que lorsqu’une femme est consommée comme viande. On peut penser que lors d’un viol, c’est seulement la féminité qui est attaquée à travers la victime, cette fois de manière abusive, certes, mais comme tout le monde l’attaque sans cesse… (Atkinson, 1975 : 76) En revanche, le mode de consommation employé fait bien de la gynophagie une attaque des femmes dans leur humanité, et celle-ci, identité de dominants, est autrement sacralisée que la féminité !
L’exploitation identitaire des dominé-e-s
Je crois qu’au coeur de l’exploitation matérielle des dominé-e-s l’on ne peut sous-estimer ce que Ti Grace Atkinson appelait « cannibalisme métaphysique » : l’exploitation identitaire. Elle consiste à s’offrir une identité distinctive et valorisante en retirant conjointement de la valeur aux êtres à l’encontre desquel-les nous nous définissons : car une valeur n’existe pas seule, un (+) n’a de sens que comparativement à un (-). On peut penser que la virilité procure d’autant plus de valeur à ses ressortissants que la féminité en retire aux femmes, de même que l’humanité n’est sacralisée qu’à la mesure d’un total mépris de l’animalité. C’est bien sur un arrière-plan de mépris général des dominé-es que l’encensement de soi-même en tant que membre d’un groupe dominant peut faire relief. Dominer signifie : « se placer plus haut ».
Lorsque nous faisons souffrir, utilisons un-e autre à notre propre fin et le/la plions à notre volonté, nous marquons notre différence : notre prétendue différence ontologique et la très réelle différence de statut social, éthique et politique censée en découler. Nous marquons notre supériorité : l’utilisation de l’« autre » le/la dévalorise. C’est son utilisation directe dans son corps qui signe le mieux la domination. Plus la violence exercée est importante, plus notre supériorité est assurée ; plus notre volonté s’impose ainsi à la sienne, plus sa souffrance est grande, plus nous jouissons. La torture, le meurtre, le viol, et bien sûr la consommation orale du corps, sont alors des actes qui fonctionnent comme symboles privilégiés de domination.
Changer de civilisation
Nous remettons ainsi en cause parmi les plus fondamentales de nos identités : masculine et humaine ; « homme » ne signifiet- il d’ailleurs pas « humain », en francophonie ? Ces deux termes réfèrent en fait, non pas véritablement à une appartenance biologique, mais bien à un statut social de dominant légitimé idéologiquement en recourant à « la Nature ». Les identités humaine et masculine se définissent en opposition avec ce qui est censé être leur contrepoint : la féminité, l’animalité, elles mêmes fortement jumelées dans l’idéologie patriarcale-spéciste. Virilité et humanité en appellent à la propriété, la liberté, l’activité et la responsabilité individuelles, à une histoire linéaire et de progrès fondé sur la raison. La naturalité (féminité ou animalité) réfère en revanche à une nonhistoire, cyclique et statique, fondée sur l’immobilisme de l’instinct. Virilité et humanité insistent toutes deux sur l’individualité, l’affirmation de soi, quand l’animalité ou la féminité posent une prétendue fonctionnalité naturelle.
L’individu prôné par les identités virile ou humaine est dominant, se hausse comme une forteresse dans un rapport de séparation/opposition et dans un rapport de valeur : il n’a de cesse de se poser en s’opposant, de se poser comme supérieur. Il appartient à des communautés dominantes (le groupe des hommes ou l’humanité sont des groupes d’appartenance pourvoyeurs de valeur et de privilèges matériels), et doit se battre pour rester en leur sein et ne pas finir « déclassé », renvoyé socialement à la féminité ou à l’animalité (ou bien encore,
variantes, à la monstruosité et l’inhumanité), avec tous les risques que cela entraînerait.
De la même façon que le sexisme structure de façon violente aussi les rapports entre hommes (par le biais de la violence homophobe), le spécisme structure les rapports entre humain-e-s : on est plus ou moins humain-e-s, donc plus ou moins animal-e selon divers critères qui, évidemment, varient selon les sociétés et les époques, les groupes sociaux et les impératifs politiques du moment (cf. Bonnardel, 1998).
Mais la première raison de lutter contre le spécisme, contre le sexisme, et contre tous types de discriminations injustes, ce sont bien sûr les intérêts des dominé-es, qui sans commune mesure sont fondamentalement niés. Ce sont eux/elles les premier- e-s concerné-e-s.
Bibliographie
Carol Adams (1990), Sexual Politics of Meat, a feminist-vegetarian critical theory, Londres, Polity Press [extrait traduit en 1991 dans la revue Zarmazones].
Ti Grace Atkinson (1975), « Le cannibalismemétaphysique », in Odyssée d’une Amazone, Paris, éd. des Femmes.
Frédéric Baillette & Philippe Liotard (1999), Sport et virilisme, éd. Quasimodo & fils.
Yves Bonnardel (1995), « Sale bête, sale nègre, sale gonzesse », in Cahiers antispécistes n°12.
Yves Bonnardel (1995), « La consommation de viande en France : contradictions actuelles », in Cahiers antispécistes n°13.
_ Yves Bonnardel (1998), « À propos des handicapés », in Pour l’égalité animale n°4.
Nick Fiddes (1991), Meat : a Natural Symbol, Londres, Routledge.
G. Fournier et E. Reynaud (1978), « La sainte virilité », in Questions féministes n°3.
Pierre Guénancia (1995), « Quelques doutes sur la différence entre l’homme et l’animal », Animalités, revue Milieux n°26.
Colette Guillaumin (1992), Sexe, Race. Pratique du pouvoir et idée de Nature, Paris, éd. Côté femmes.
Emmanuelle De Lesseps (1980), « Sexisme et racisme », in Questions Féministes n°7.
Colette Méchin (1992), Bêtes à manger, usages alimentaires des Français, Nancy, Presses universitaires de Nancy.
David Olivier (1993), « C’est horrible », in Cahiers antispécistes n°6.
David Olivier (1994), « Le goût et le meurtre », in Cahiers antispécistes n°9.
Claudia Orpitz (1991), « Contraintes et libertés (1250-1500) », in G. Duby et M. Perrot (dir.), Histoire des femmes, tome 2 : Le Moyen-Âge, Paris, Plon.
Peter Singer (1993), La Libération animale, Paris, Grasset.
Peter Singer (1999), L’Egalité animale expliquée aux humain-es, Lyon, éd. tahin party.
Keith Thomas (1985), Dans le Jardin de la nature. La Mutation des sensibilités en Angleterre à
l’époque moderne (1500-1800), Paris, Gallimard.
Noëllie Viallès (1987), Le Sang et la chair, les abattoirs des pays de l’Adour, Paris, éd. de la Maison des Sciences de l’Homme, coll. Ethnologie de France.
Daniel Welzer-Lang (1998), « L’utilité du viol chez les hommes », in David Jackson et Daniel Welzer-Lang, Violence et masculinité, Montpellier, Publications « ...
Daniel Welzer-Lang, Pierre Dutey et Michel Dorais (1994), La Peur de l’autre en soi. Du sexisme à l’homophobie, Montréal (Québec ), VLB éditeur.
Marina Yaguello (1982), Les Mots et les femmes, Paris, Petite Bibliothèque Payot/Documents.
[1] C’est bien Yves Bonnardel qui a écrit
cet article (qui n’engage donc que moi,
comme on dit), mais les réflexions qui
suivent ne résultent certainement pas
des analyses d’un seul individu, mais
bien de discussions et de confrontations avec de nombreuses personnes.
Je remercie d’ailleurs toutes celles qui ont lu cet article, l’ont critiqué, et
m’ont entre autres évité parfois de dire des bêtises.
[2] Le mouvement pour l’égalité animale est né en 1975 aux USA, en 1991 en France (Singer, 1993, 1999).
[3] Ces groupes sont finalement restés très ponctuels et n’ont jamais été très actifs.
[4] Une brochure livre un état des lieux et une analyse politique des réactions d’hostilité envers le végétarisme pour les animaux, qui développe une analogie avec l’antiféminisme ou l’homophobie. Cf. le site fr.vegephobia.info.
[5] Les viandes blanches ainsi que les espèces des individus dont c’est la chair (volailles, lapins…) sont d’ailleurs connotées comme féminines, alors que les viandes rouges (de gros mammifères) sont nettement indiquées comme viriles. En outre, l’élevage et la mort des premiers est plutôt une tâche féminine, alors que le meurtre (et, dans de nombreuses autres civilisations, l’élevage) des seconds est exclusivement une affaire d’homme (Méchin, 1992 ; Bonnardel, 1995).
[6] Une étude menée en 1997 par la Faculté de médecine de Paris V précise que 61% des adhérent-e-s de l’Association végétarienne de Francequi ont répondu à leur questionnaire sont des femmes.
[7] Parce que le sujet est inépuisable et particulièrement complexe, les lecteurs/lectrices voudront bien se souvenir que ces analyses restent schématiques.
[8] Cela ne fait que quelques décennies que les femmes ont juridiquement cessé d’être appropriées. Je renvoie aux formidables analyses de Colette Guillaumin (1992), pour comprendre la logique de naturalisation des dominé-e-s.
[9] En fait, ususfruitiers : car c’est le corps social dans son ensemble (ou ceux qui le dirigent) qui sont les véritables propriétaires de chacun des membres. Les membres par contre, peuvent se servir des appropriables comme outils (« instruments animés » disait déjà Aristote des esclaves) ou matières premières.
[10] Métaphores connues de la domination et de l’exploitation, notamment sexuelles.
[11] Ce n’est que lorsqu’ils se sentent acculés que les hommes se posent comme déterminés par leur « nature masculine » : les auteurs de viol parlent par exemple de rigolade, et ce n’est que s’ils doivent se défendre qu’ils invoquent des pulsions sexuelles impérieuses…
[12] Exposition que le Collectif d’Action et de Réflexion pour l’Égalité des Sexes (CARES) a présenté à Lyon en 1995.
[13] Je parle ici des animaux dits de « boucherie », ou bien de ceux qu’on chasse ou pêche, dont je considère le cas comme emblématique de notre rapport aux autres animaux en général – même si ce rapport est sans doute en (r)évolution. De fait, il existe de nombreuses autres catégories d’animaux, également appropriés, mais dont la fonction sociale (la fin qui leur est assignée, généralement selon leur espèce) peut être très différente, puisqu’ils peuvent être atrocement torturés (animaux dits « de laboratoire ») comme gentiment aimés (animaux dits « de compagnie »)…
[14] En fait, il ne s’agit d’une « réduction » que dans le cadre de pensée de l’idéologie dualiste patriarcale et humaniste qui pose qu’il y aurait d’une part un corps-matière (vil et naturel, déterminé) et de l’autre un esprit-âme (élevé et humain, libre). Si nous refusons la métaphysique de l’« être » et la différence corps/esprit pour porter la distinction entre la matière douée de sensibilité (individu sensible) et la matière inanimée (matière morte, inanimée ou insensible), il n’y a plus « réduction » parce qu’il n’y a plus hiérarchie.
[15] Il s’agit du propre point de vue du dominant ; pour quiconque violenté-e, il ne s’agira certainement pas de sexualité, mais purement de violence et d’humiliation (Welzer-Lang, 1998 ).
[16] C’est la thèse défendue également par Nick Fiddes dans Meat : a Natural Symbol (1991). Ce livre d’anthropologie
est centré sur la thèse selon laquelle la consommation/non-consommation de la viande dans nos sociétés dépend de la volonté/non-volonté de dominer.
[17] Il apparaît à la lecture du n°2 de la revue Dossiers criminels (1999), dont un article est consacré aux « tueurs cannibales », que ce sont toujours des femmes (éventuellement des prostituées), ou des enfants, des adolescents « de couleur », bref, des humain-es ayant statut de dominé-es, qui sont les victimes.
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (448.4 kio)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (142.4 kio)