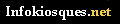D
De la grève étudiante à la grève humaine
Retour sur le mouvement étudiant à Rennes II, hiver 2003-2004
mis en ligne le 2 octobre 2004 - Anonyme
PREMIERE PARTIE : LE POINT OU NOUS EN SOMMES
L’écriture d’un texte de critique du mouvement étudiant de novembre-décembre, pour nous
qui ne réalisons pas de mémoire ou de thèse de sociologie pour le compte d’une institution, qui
n’avons pas l’ambition de faire avancer la recherche au service d’une abstraction telle que le progrès
ou le bien de l’humanité, pourrait constituer le prototype de l’activité laborieuse non-salariée. Il y
aurait de la cohérence à prendre ses distances avec l’objet de son étude, à considérer froidement
l’apparition des phénomènes, leur concentration temporelle formant le contenu de l’ “ événement
” nommé mouvement étudiant, les étapes de sa dissolution, l’élaboration d’un discours collectif. On
y retrouverait alors parfaitement ce qu’on cherche, à savoir un mouvement social, un mouvement
étudiant, essentiellement semblable à ceux qui l’ont précédé, très comparable aux mouvements non
étudiants qui l’environnent, annonciateur des mouvements sociaux à venir. Qu’on éprouve ou non
de la sympathie pour les luttes étudiantes, on n’échappe pas, malgré ses distances, à l’empathie
pour le labeur qui s’est donné à voir dans ce mouvement, qui l’a effectivement dominé. Mais ce fut
au prix d’une lutte qui n’a pas laissé indemnes les bâtisseurs de mouvements sociaux, tant il apparaît
qu’à la suite de cette grève, et pour les années à venir, les rivalités entre bâtisseurs ne pourront
plus masquer l’évidence d’un conflit entre bâtisseurs et démolisseurs du mouvement social classique,
cyclique et reproductible. Un tel conflit se retourne aisément entre bâtisseurs d’un mode de
subjectivation collective qui cherche à accroître sa puissance par le plaisir partagé, et démolisseurs
de toute joie autre que réduite à un appendice du travail. Finalement, il s’agira d’une lutte irréconciliable
entre joueurs et travailleurs.
Ainsi, nous n’éprouvons pas plus de sympathie que d’empathie à l’égard de ce qui dans ce
mouvement s’est donné pour l’essentiel, à savoir la production d’un discours syndical et para-syndical
de refus des “ dérives libérales ” du gouvernement, la reproduction de modes d’organisation,
d’action et de communication des mouvements sociaux les plus conformes à leur essentielle
impuissance contemporaine. Tout cela, nous en avons éprouvé le poids mort, paralysant, traverser
les corps et les esprits réveillés par la grève, pour en arrêter le jeu, pour les mettre au travail. Dès
les premiers jours, l’affreux scénario, prévisible et prévu, se mettant en scène, nous avons pris le
parti de le combattre avec colère. C’est cette colère, qui sans se satisfaire d’aucun exutoire littéraire,
veut parler ici de ses joies, ses échecs, ses amis et ennemis, ses déceptions et ses perspectives d’éclater,
d’en finir avec la demi-mesure.
Victoires de la démocratie
Nous partons d’une société profondément abîmée qui se voudrait la société, d’une organisation
des rapports humains qui en aurait fini avec le conflit, comme si les conflits qui avaient présidé
à sa formation s’étaient résolus dans une totalité consensuelle, où n’existeraient pas de désaccords
assez profonds pour justifier un affrontement. Pourtant, dénier ainsi l’existence du conflit
constitue la stratégie moderne du parti qui travaille au maintien des conditions existantes. Ce parti
est le parti de la démocratie. La démocratie moderne est un système de gouvernement des corps et
des sensibilités, qui travaille à médiatiser les flux qui traversent les corps, à former et contrôler les
sensibilités, avec l’espoir qu’enfin toute socialité se rapporte à elle, parle sa langue, donne à l’abstraction
de son rêve de contrôle absolu la richesse de la totalité sensible. Le rêve de la démocratie,
c’est de constituer pour les rapports humains ce que constitue l’argent entre les biens et services :
l’abstraction qui leur donne de la valeur, témoigne de leur réalité. Comme pour le capitalisme le travail
doit créer de la valeur, et que la valeur d’usage des biens produits n’est que le support de la
valeur d’échange des marchandises, pour la démocratie qui constitue sa théorie et sa pratique
moderne en tant que régime politique, les rapports humains doivent créer de la positivité sans
négativité, c’est à dire être disposés en permanence, sans résistances, à l’intégration et au renforcement
de l’intégration aux normes comportementales. Ainsi, en démocratie, peu importe ce qui est
vécu et partagé par plusieurs individus, car il ne s’agit pour elle que du support des rapports normés
entre parents et enfants, mari et femme, travailleur et patron, vendeur et consommateur... Rien
d’étonnant à ce que l’Etat traque avec une détermination toujours plus grande la moindre forme de
ce qu’elle appelle déviance : un acte, un comportement identifié comme déviant devient par là
même, négativement, un moment de sa rationalité. L’acte, le comportement autonome, qui n’en
réfère pas à la norme, devient criminel. Par là, tout ce qui se dégage de ces normes, et qui révèle au
moins indirectement un désaccord avec l’ordre des choses, est vidé de tout enjeu politique, réduit
à une aberration à traiter. En niant partout l’existence du conflit, en détruisant ce qui faisait les solidarités
pratiques indispensables à la constitution d’une force (la classe ouvrière), la démocratie a
produit ce champ informe de la criminalité, de la déviance, de l’incivilité qui ressemble à tout sauf
à un ennemi organisé, un sujet historique capable de lui faire face et de la renverser. Cependant, en
pénétrant toujours plus profondément les groupes humains, brisés en agglomérats fragiles d’individus,
l’abstraction démocratique tend à l’élimination de la valeur d’usage dans les rapports
humains : le travail exigé de chacun sur lui-même pour conformer son existence aux normes, la
peur de déchoir, la rancoeur et l’envie devant les images du bonheur, du succès et de la richesse, la
compétition à tous les niveaux, font de la survie des civilisés une guerre permanente et larvée de
l’individu avec lui-même, dans un milieu où les rapports entretenus avec ses semblables sont essentiellement
des rapports d’hostilité.
l’individu et les communautés effondrées
De fait, la question sociale moderne tient tout entière dans le conflit entre ceux qui cherchent
à maintenir ces rapports d’hostilité et ceux qui cherchent à les détruire. Il ne suffit pas d’en avoir
conscience pour s’en dégager. Car la question sociale est aussi la seule question politique fondamentale
: comment retrouver la communauté, quand les anciennes communautés fondées sur la
contrainte, perçues par l’individu avant tout comme des limites, des atteintes à sa liberté individuelle,
et par là fuies et détestées, telle la famille, l’école, l’usine, l’armée d’il y a trente ans, se sont
effondrées ? Ces communautés ont subi de profondes transformations : le modèle de la famille
nucléaire s’est généralisé, les familles se sont recomposées sur la banalisation du divorce, les enseignants
ont troqué la trique pour la pédagogie, la force de travail requiert la subjectivité, la créativité
et l’esprit d’initiative de l’employé, les engagés sont volontaires par peur du chômage et goût
du fonctionnariat. Mais en se transformant, les communautés se sont effondrées en tant que communautés
: elles ne s’affirment plus comme imposition faite à l’individu de se plier à ses lois, de se
soumettre ou de les combattre.
On s’accommode du travail sans l’aimer, parce qu’il rapporte de l’argent, et qu’occupant une
grande partie du temps, il donne le sentiment d’une utilité sociale. Même si l’on exerce une activité
salariée nuisible, on n’en reste pas moins utile “ aux siens ”, ceux qu’on fait survivre en travaillant.
On s’accommode de la famille, plus souple et plus sensible à la circulation d’affects que la rigide
famille patriarcale, car on y trouve le “ supplément d’âme ”, la continuité et un confort relatif qui
adoucit les blessures liées à la disponibilité exigée du travailleur, qui doit pouvoir se reconvertir,
travailler son employabilité, prendre des initiatives, etc. De tout ceci, il résulte que la démocratie
biopolitique n’est pas seulement un régime politique, ni seulement une opération guerrière contre
ceux dont les comportements sont “déviants”, mais aussi un art fait par tous, l’art de s’accommoder
des communautés effondrées, et ainsi de les maintenir en vie, elles qui maintiennent en vie l’ordre
des choses. L’art de vivre dont parlent les publicitaires est une science des transactions existentielles.
La vie de chacun devient vraiment une oeuvre d’art : plus la peine d’incriminer “ la société
”, si le tableau est raté, l’artiste est un raté. Ceux qui ne parviennent pas à s’accommoder avec leur
travail, avec leur famille, avec leurs amis (l’amitié la plus répandue aujourd’hui n’est pas très différente
du lien familial), n’ont d’autre choix que de se tourmenter, assoiffés d’un bonheur, d’un
confort, d’une sécurité qu’ils croient voir chez les autres, lesquels en jouissent avec la parcimonie
de ceux qui savent pouvoir vite tout perdre. L’art de vivre en démocratie biopolitique implique la
mise en perspective des manières d’agir, d’être présent à l’autre, à la situation, avec l’éducation à
une stratégie d’évitement des conflits. Les communautés fondées sur la contrainte des corps se sont
effondrées justement parce qu’elles entravaient l’idéal de bonheur démocratique : elles fourmillaient
de conflits, en elles et souvent contre elles. Le monopole de la médiation acquis par la démocratie
dans les rapports que l’individu entretient au monde signifie que l’individu est privé de
défenses face à un monde qui s’unifie dans son étrangeté à lui : tout ce qui n’est pas moi est autre.
Une stratégie individuelle d’évitement des conflits, c’est la disposition à garantir soi-même son
équilibre moral et psychologique en évitant ce qui pourrait blesser, la rencontre, l’inconnu, la dis-
corde. L’individu, faible et abandonné à lui-même, se carapace de tous côtés, et son bonheur
devient un bonheur carapacé, une carapace de bonheur, qui se promène parmi le monde dans l’hostilité
à ses semblables, menaces potentielles à sa sécurité.
L’espace public, celui qui n’appartient à personne, si ce n’est au contrôle biopolitique, témoigne
avec éloquence de ces rapports d’individu à individu dans un milieu d’hostilité. L’université
est particulièrement représentative de ces communautés profondément effondrées où se croisent
sans se rencontrer étudiants, enseignants, chercheurs, personnels de service et administratifs qui
entretiennent un rapport fonctionnel (suivre un cursus, gagner de l’argent, se procurer les matériaux
d’un travail) à une communauté sans lui appartenir. C’est dans ce contexte qu’il convient de
penser un mouvement universitaire, dans la double perspective qu’il permet la rencontre, le dialogue
entre des milliers d’individus éduqués à la méfiance, à l’autisme et à la peur, et où il postule
l’existence d’une communauté sensible qui n’existe plus. Il n’est pas nécessaire de chercher beaucoup
plus loin la réponse à ce qui a tant angoissé ceux qui se nommaient eux-mêmes les “ militants
de la grève ”, syndiqués ou non : comment les deux tiers des étudiants ont-ils pu ignorer ce qui se
passait à Villejean ? Par quel mystère quatre-vingt dix pour cent de ceux qui y ont participé ne l’ont
fait qu’à travers le spectacle des assemblées générales et des manifs ? Tout simplement parce que
cette grève fut une grève de militants et d’apprentis militants, une grève d’esprits politisés. Il s’agissait
de transcender la mort de la communauté universitaire, et corrélativement de l’identité d’étudiant,
par la constitution immédiate d’une communauté d’individus mobilisés en tant qu’étudiants,
parce qu’étudiants, qui singe la communauté universitaire défunte. Le fait que la démocratie biopolitique
cherche à s’imposer comme médiation universelle dans les rapports humains participe du
mouvement de restructuration capitaliste qui vise à détruire les frontières entre ce qui est du temps
de travail et du temps de loisir, entre le travailleur, le consommateur et le citoyen. Les dimensions
politiques, économiques et culturelles de l’existence tendent à l’indistinction. Le travail rejoint la vie
quotidienne, la vie est quotidiennement mise au travail. Cette indistinction croissante rejoint l’art
de l’accommodement : c’est toujours soi qui va d’activité salariée à non salariée, de moment de tension
à moment de délassement. De fait, il n’y a plus un étudiant, un travailleur, mais un moi qui
étudie, travaille, aime, chôme, élève des enfants, consomme, déprime, vote, boit de l’alcool... Il ne
s’agit pas d’une subtilité de philosophe : les identités sociales qui déterminaient l’identité individuelle
en rapport à une communauté sont devenus des attributs divers d’une identité qui ne se
laisse réduire à aucune forme de collaboration avec une communauté.
mouvement social, mouvement étudiant, mouvement citoyen
Ainsi les mouvements sociaux actuels se réfèrent presque toujours à un passé qui ne reviendra
plus, reproduisent indéfiniment des archaïsmes qui les vouent à l’échec : on lutte en tant
qu’étudiant quand ceux qu’on aimerait voir lutter à nos côtés ne se perçoivent plus comme, et ne
sont réellement plus, des étudiants. Les militants de la grève étudiante ne sont d’ailleurs eux non
plus pas des étudiants ; mais luttant en tant qu’étudiants, ils affirment leur fidélité à un moment
de l’histoire où lutter au nom d’une identité socio- professionnelle, pour la défense des intérêts de
la corporation (une communauté contrainte) à laquelle on appartenait participait d’un conflit qui
était perçu par une grande partie de la population comme un conflit irréconciliable : la lutte des
classes. Ainsi la défense des intérêts catégoriels pouvait, en tant qu’elle se dépassait dans la défense
des intérêts de la classe ouvrière dans les moments de grève générale, constituer un moment du
processus révolutionnaire. Aujourd’hui, la défense des intérêts catégoriels, non seulement interdit
son propre dépassement, en revalorisant abstraitement une identité particulière qui n’existe plus
(quand le dépassement impliquait justement le dépassement des identités socio- professionnelles
particulières) mais récupère, canalise et trahit les raisons obscures qui fondent notre mécontentement.
Les luttes et mouvements sociaux sont aujourd’hui, pour la plupart, des spectacles plus ou
moins bien réussis de ce que fut la lutte de classe.
On se demandera aussi pourquoi la gauche de la gauche, citoyenniste et altermondialiste, est
si visible dans les mouvements sociaux, particulièrement les plus aisément récupérables comme les
mouvements étudiants : c’est qu’en se référant à des identités qui n’existent plus, on se réfère aussi
à ce qui transcenderait ces simulacres d’identités tout en les conservant, je veux parler de la citoyenneté.
Le mouvement citoyen entretient une fidélité à la lutte de classe en tant qu’elle était défense
des intérêts des travailleurs, en faisant oublier qu’elle était aussi promesse de révolution. Sur le
terme de “ citoyen ”, rappelons que tout sujet politique d’une démocratie ou d’une république en
est citoyen par définition ; un mouvement citoyen serait un mouvement de citoyens plus citoyens
que les autres, qui pensent être particulièrement utiles au bien public. Le bien public est une invention
de démocrates pour conjurer la guerre civile. Mais les démocrates de gauche disent combattre
le néolibéralisme. Comment ? A la destruction du lien déjà fort lâche entre les catégories d’exploités,
destruction opérée par les restructurations capitalistes en réponse aux attaques portées par les
exploités eux-mêmes (dans les années 60/70) contre les communautés rigides et fortement hiérarchisées
de la société- usine, le mouvement citoyen oppose la collaboration entre les institutions qui
se sont détachées des catégories effondrées qu’elles prétendent représenter (syndicats, partis de
gauche et associations). Finalement, la collaboration entre ceux dont le travail, la spécialisation dans
le cadre de la division du travail, est la défense d’intérêts catégoriels et la production- reproduction
du mythe de la gauche. La défense des intérêts catégoriels des institutions de gauche consiste à
garantir leur pérennité, c’est à dire à empêcher les révolutions. Le mythe de la gauche a toujours eu,
et aura toujours pour fonction de transformer un refus, une révolte, en un art de s’accommoder du
report perpétuel des lendemains qui chantent, les “ conditions objectives ” n’étant jamais réunies.
Croire en la gauche permet en cela de conjurer l’insatisfaction primordiale par des petites satisfactions
symboliques, fabriquées à peu de frais (du type amendement Michelin), qu’on s’emploie à
célébrer comme des victoires, qui permettent de célébrer la disposition de l’ordre des choses à être
“ amélioré ” (comme si on pouvait améliorer une guerre) et par là célébrer ce monde lui-même. La
gauche est là pour nous permettre de nous raccommoder avec la démocratie biopolitique.
Il s’agissait de préciser ce qu’est programmé à être un mouvement étudiant dans l’époque où
nous vivons : un mouvement social de défense d’intérêts catégoriels, un mouvement citoyen, une
page ajoutée au récit mythique de la gauche. Cependant, comme il a été indiqué au début, le mouvement
auquel nous avons participé, en même temps qu’il illustre ces analyses, n’a pu échapper au
conflit entre les raisons qui l’ont fait advenir et leur occultation qui impliquait la fabrication d’un
mouvement social classique. Car la grève étudiante, en durant plus d’un mois, n’a pas plus essuyé
une défaite qu’obtenu une victoire : inutile de gloser sur le “ recul ” du ministre, de savoir si oui
ou non c’est “ déjà bien ” qu’il ait ajourné son projet d’autonomie des universités qui doit de toute
façon être appliqué en Europe, car il n’y a pas de commune mesure entre la démocratie biopolitique
et son refus, à l’heure actuelle où une surenchère de mesures, lois, décrets, composent ouvertement
depuis quelques faits divers (“11 septembre”, “21 avril”) une offensive systématique de prévention
à l’encontre des possibilités même d’un mouvement social classique qui serait quand même
gênant pour le pouvoir (en démantelant le secteur étatique et ses bastions syndicaux) et une guerre
contre l’ennemi inavouable (la batterie de mesures sécuritaires, traitement de choc contre les pathologies
de la déviance, de la criminalité, de l’incivilité), tandis que le “ scandale ” des plans sociaux,
devenu quotidien, ne laisse même plus le temps à la bonne conscience de gauche de se scandaliser.
La défaite de la grève étudiante, c’est la réussite de l’opération qui consiste à faire travailler
au service du mythe éventé de la gauche la joie d’interrompre le cours quotidien des rapports
d’hostilité. Sa victoire, c’est d’abord d’avoir été l’espace-temps d’un affrontement sur le sens et l’enjeu
d’un mouvement, quand tout ceci aurait dû tomber sous le sens. Mais c’est aussi d’avoir constitué
pour cet affrontement une caisse de résonance suffisamment consistante pour que les échos parviennent
avec force jusqu’à nous, au point de rendre ridicule l’idée même d’une reprise à l’identique
de la grève étudiante, au point de laisser imaginer les linéaments d’une subversion qui prendrait
pour cible les rapports d’hostilité eux-mêmes, entraînant la dissolution de l’université comme
médiatrice des rapports entre ceux qui sont présents à la situation, disposés à la rencontre.
DEUXIEME PARTIE : COMMENT LA JOIE EST MISE AU TRAVAIL
On a raison de faire remarquer ce qu’il y a de profondément décalé par rapport aux exigences
de l’époque, malade justement de son obsession d’éviter toute manifestation du conflit, dans la
nécessité, pour que s’impose au bruit des fonctionnements institutionnels, le silence de l’interruption
et l’irruption du débat, de présenter des prétextes du type réformes LMD- autonomie des universités.
Finalement, on ne rompra ni avec le champ universitaire ni avec la propagande : à nouveau,
comme toujours, une parole portée par des spécialistes de la parole, de la communication,
devra être intégrée telle quelle, avec respect. Les syndicalistes succèderont aux professeurs, les professeurs
aux syndicalistes : mais on ne se doute pas au début que cette étrange alternance sera mise
en oeuvre avec tant de clarté que sa critique ouvre, pendant et après la grève étudiante, les perspectives
de la grève humaine.
joie de l’interruption, désir d’adhésion, mémoire et oubli
Lors des premières assemblées, qui réunissent plusieurs centaines de personnes, on est tout
à sa joie d’être ici et pas ailleurs, pas en cours, pas au travail, dans l’amphithéâtre disposé selon d’autres
règles, dans la présence à tant d’autres corps inconnus comme autant de possibilités de rencontre.
C’est la joie juvénile des commencements, où la parole, même confuse, même inconsistante,
n’existe que dans la perspective de ce commencement : apparaissent d’autres contenus de discours
appelés à un devenir, un partage, appelés à participer d’une reconfiguration des rapports entre
ceux qui étaient bien forcés de s’ignorer. Tout à notre mouvement de croire, on accepte tels quels
les objets de ce mouvement : finalement, peu importent ces prétextes à l’enthousiasme. On ne se
soucie pas d’en examiner la pertinence vis à vis de ce qui fonde notre désir de rupture dans l’ordre
du quotidien : l’examiner serait corseter, entraver la naissance du plaisir. Ici réside le drame de
nombre de mouvements sociaux : dans les circonstances, le milieu où ils naissent, leur manière de
naître se dit déjà leur défaite. Parce que ce qui les fonde est une soif terrible d’adhésion à une parole,
qui n’est pas fatalement adhésion à un discours politico- syndical, qui constitue aujourd’hui pour
les luttes le prêt-à-parler, le prêt-à-adhérer disponible en magasin. Cette soif d’adhésion à une
parole manifeste le désir de créer une langue nouvelle pour des rapports nouveaux : cette soif est
elle-même pauvre en expérience, complètement dépourvue de mots pour se dire, réduite à de l’attente,
de la disposition à croire. Elle est aussi bien éduquée que peu scrupuleuse : le long travail
d’intégration de ce qui est dicible et de ce qui ne l’est pas, de ce qui est politique et de ce qui est de
l’ordre de la vie privée, du raisonnable et de l’utopique, s’est effectué sur le mode de l’insatisfaction
: d’un côté, des mots, de la pensée élaborée, qui dans une certaine mesure permettent l’adaptation
aux rapports d’hostilité de la démocratie biopolitique ; de l’autre un manque, un creux, un vide de
mots, de pensée, un champ libre et un no man’s land : le désir d’interruption. Ainsi, la grève qui se
dessine, comme toute grève sans préavis, à l’état naissant, n’est pas complètement réductible à de
l’imitation de ce qui a échoué partout ailleurs : mouvement contre la réforme des retraites, contre
le changement de statut des intermittents du spectacle, mouvements lycéens et universitaires de
1998, grève de la fonction publique en 1995.
La contradiction et le conflit se donnent donc à percevoir dans ces tentatives théâtralisées de
fonder l’origine d’un refus collectif : le désir d’interruption est le dénominateur commun de présences
individuelles (les mouvements sociaux jouent très mal l’exhortation à dépasser l’individu)
saturées de mémoire des luttes passées et défaites, brisées par leur tendance dominante à souhaiter
l’évènement tout en le conjurant. Il ne reste presque rien du mouvement des chômeurs (hiver
1997 / 1998), de ses réquisitions (ou pillages, comme on voudra) de supermarchés, de ses auto-invitations
dans les grands restaurants, de ses occupations de lieux impromptus, de ses assemblées,
telle celle de Jussieu, assemblée quotidienne pendant deux mois, où se cherchait dans les mots la
critique moderne du travail, approfondissant la tendance à la fuite collective hors du salariat, à la
recherche d’autres manières de satisfaire les besoins. Quant au mouvement de l’anti-CIP (le Smicjeunes
de Balladur, qui prévoyait l’embauche des diplômés à bac plus 2 à 80% du SMIC) en mars
1994, mouvement qui durant un mois avait réuni dans la rue lycéens des centre-ville, étudiants aux
cursus longs ou courts, aux diplômes professionnalisant ou non, jeunes banlieusards, chômeurs, de
nombreux travailleurs précaires ou menacés de licenciement, manifestations de rue qui se soldèrent
notamment à Paris, Lyon et Nantes par des affrontements avec la police, des attaques de vitrines et
des pillages, il n’est que l’écho lointain, exorcisé, d’une époque qu’on espère disparue. Notons que
le mouvement des chômeurs avait au moins obtenu une prime de Noël, qui s’est institutionnalisée
depuis, que le CIP avait été retiré : même si l’on considère ces faits par le petit bout de la lorgnette
(car toutes les apparences de victoire hors d’un mouvement révolutionnaire sont sans lendemain,
et ne disent essentiellement que le succès d’une normalisation), en termes de satisfaction immédiate
de revendications-prétextes, ces mouvements, ayant manifesté intensément un conflit irréconciliable
quant à la nature des rapports sociaux, ont été capables d’imprimer un mouvement de recul au
pouvoir qui les combattait. Ce n’est pas le cas des mouvements cités plus haut, et ce n’est pas un
hasard si le mouvement des chômeurs et le mouvement anti-CIP ont disparu de la mémoire collective
à l’oeuvre dans l’élaboration des mouvements sociaux actuels, et que les autres, au contraire,
fournissent aux luttes présentes un imaginaire, des formes organisationnelles et des moyens d’action,
immédiatement disponibles et reproductibles.
Car la mémoire propre aux luttes du post-fordisme, et plus particulièrement à celles de la
dernière décennie, n’est pas qualitativement différente de la mémoire individuelle de ce qui est présenté
comme événement concernant la collectivité par l’information dominante (les grands médias)
et l’éducation nationale. Depuis que l’information a fait des faits une matière première qui doit être
transformable en marchandise sous le nom d’ “ actualité ”, depuis qu’elle détermine ce qui a lieu
et ce qui n’a pas eu lieu, depuis qu’elle a accru sa puissance au point de figurer elle-même directement
parmi les acteurs de l’ “ évènement ” qu’elle commente et qu’elle peut entièrement fabriquer,
la mémoire et l’oubli sont largement dépendants de l’intensité du matraquage médiatique et
du jugement moral, explicite ou implicite qui manifeste le caractère essentiellement propagandiste
de l’information.
violence du conflit et évènement médiatique
Il est manifeste, à ce propos, que le mouvement social classique tel qu’il se reproduit depuis
1995, et son allié le plus proche, le mouvement citoyen, achèvent la séparation entreprise depuis les
années 80 entre lutte et évènement, ici entendu comme ce qui trouble le cours normal de la production-
consommation- circulation des marchandises, comme ce qui manifeste la conflictualité historique.
Reconnaissons-le : quand il y a conflictualité, il y a approfondissement des rencontres que
l’interruption rend possible, désir de leur donner consistance et ainsi d’extirper la médiation qui
maintient la séparation. Cette médiation cherche à se conserver sous les formes diverses du modérantisme
syndical et politique, puis, le cas échéant, par la police. Quand la conflictualité est forte,
elle a d’ailleurs toujours recours à la police. A ce sujet, notons que la question de savoir s’il est bien
ou mal d’employer la violence est une fausse question : même les formes d’action non-violentes
sont confrontées à la violence policière, pour peu qu’elles dérangent vraiment : il n’y a qu’à voir
comment ceux qui étaint venus rencontrer et soutenir les“ éco-citoyens ” logés dans les arbres du
parc Mistral à Grenoble ont été ramenés au réel, par la matraque. La violence est donc une caractéristique
fondamentale des moments de conflictualité forte : elle n’est une question morale que pour
ceux qui cherchent à exorciser la conflictualité : les instances dirigeantes de la démocratie biopolitique
dont font partie les médias et la gauche. La question de la violence est une question tactique
: en quoi, à certains moments, dans certaines circonstances, l’usage de la violence peut-il concourir
à l’accroissement de notre puissance ? ; de même, en quoi le déploiement nécessaire du mouvement
par lequel nous nous approprions ce dont nous étions séparés par la médiation démocratique
implique t-il la confrontation ? Les instances dirigeantes sont divisées à ce sujet : pour les premiers,
il n’y a de violence, donc de mal, que dans les actes violents de leurs subordonnés ; pour les
seconds, la police, l’armée, et même les entreprises qui licencient peuvent aussi être violentes, du
côté du mal. Pour les deux, la violence doit être éliminée : c’est la forme grossière que revêt leur
rêve commun d’exorciser la conflictualité. Nous dirons pour notre part que la violence n’est jamais
que le point de rencontre entre deux forces opposées, dont la coexistence est impossible. La violence
traverse les antagonistes : il n’y a pas des violents et des non-violents, des victimes et des
bourreaux, mais une situation où les forces et faiblesses rentrent en jeu pour faire, provisoirement
ou finalement, des vainqueurs et des vaincus. Mais la violence est devenue un tabou : elle ne doit
plus apparaître que fictive, imaginaire, dans les films et séries télévisées, ou encore mise à distance
et sublimée pour le spectateur dans les guerres dites chirurgicales.
L’image télévisuelle des “ violents ” (black bloc, racailles de toutes les banlieues du monde,
émeutiers albanais, algériens, indonésiens, argentins...) en action réduit toute conflictualité historique,
dans laquelle l’affrontement violent n’est qu’un moment, à ce moment même, dont on change
le sens selon les catégories de la démocratie biopolitique : un paroxysme de déviance et de criminalité.
L’exposition d’une telle image n’est rien d’autre qu’une opération à l’intention des spectateurs
: que vous refusiez ou non quelque chose, qu’il vous arrive ou non d’aller dans les manifs,
voilà ce qu’il faut craindre, voilà ce qu’il faut haïr, voilà ce qu’il faut empêcher. Il ne s’agit pas seu-
lement d’empêcher les émeutes, mais tout ce qui les rappelle : un bruit de verre brisé, un vol, une
engueulade un peu rude, un tag, et, plus généralement, toute mise en danger.
Ainsi la mémoire des mouvements sociaux est-elle filtrée, épurée : occultant la conflictualité,
médias et gauche (syndicats, associations et partis) s’emploient à construire l’évènement médiatique,
l’évènement qui se nie en tant qu’évènement. Idéalement, il ne devrait pas y avoir de grève
sans préavis de grève, de manifestation non autorisée et dont le parcours ne soit par avance communiqué
à la police, de brèche dans la direction du mouvement qui doit été confiée à des syndicalistes,
de slogans, de revendications et généralement de comportements qui échappent à la biopolitique
des assemblées générales. Le fléau agité en permanence est celui de la “ criminalisation ”
: et quand on écrit qu’on refuse la criminalisation des mouvements sociaux, malgré les apparences,
ce n’est pas au pouvoir, à la justice que l’on s’adresse : dans un Etat de droit, comme disent les
citoyens, nul n’est sensé ignorer la loi. Un acte illégal est réprimé, rien de plus normal. On s’adresse
bien plutôt à ceux qu’on sent derrière soi, imprévisibles, potentiellement déviants ; mais aussi, soucieux
de la respectabilité de leur engagement : on veut conjurer la tendance à l’indistinction entre
“ crimes de droit commun ” et illégalisme politique. Les bâtisseurs de mouvements sociaux et
citoyens anticipent la déviance potentielle d’une grève, d’une manifestation quelconque, et s’emploient
à ce que ce léger mouvement de rupture se conserve (et comme il ne s’accroît pas, s’annule)
pendant un temps donné, sous la protection de la loi, ceci impliquant de protéger pour elle-même,
contre elle-même la “masse” des grévistes de sa propre immaturité en flattant son goût pour la posture
des justes.
joie et démocratie
Les mouvements étudiants ont au moins ce charme non négligeable de ne pas exiger de
préavis : il suffit d’être quelques centaines dans un amphi, prêts à voter la grève pour que tout commence.
Deux assemblées générales le 5 Novembre ouvrent donc la voie à la grève, au blocage des
cours et à l’occupation du hall B (bâtiment B), principal lieu de passage des étudiants, environné de
cinq amphithéâtres, de sa cafétéria universitaire et de ses machines à café. La mise en place de “
barricades ” de tables, de bureaux et de chaises bloquant les accès aux autres bâtiments, aux salles
de cours et amphis est sans doute possible l’un des moments les plus enivrants du mouvement :
comment ne pas penser à Fourier admirant la dextérité et la rapidité d’exécution d’ouvriers
construisant une barricade, bien supérieures à un ouvrage réalisé dans le cadre du salariat ? Les
petits chefs ne sont pas encore là, fais donc comme tu l’entends, profites-en pour écrire sur les murs,
retire la chaise sous le cul du professeur stupéfait. Les initiatives autonomes donnent à la coopération
son contenu. Le lendemain, avec déjà moins de joie (plus de labeur) mais plus d’audace, la
même imposition de l’interruption se produit à la fac d’éducation physique, avec une demi-douzaine
de complices du cru et en l’absence des étudiants. Une grande absente : la démocratie. Sur ce
point, les anti, ou alter- grève (qui comme les “ alter- mondialistes ” ont dû batailler pour ne pas
apparaître comme des négateurs refusant de “ proposer ” aux “ mouvements sociaux ”, aux gouvernements,
aux journalistes des “ alternatives ” de gestion, de conjuration du conflit, conflit qui
se donne encore trop à sentir par le préfixe “ anti ”) ont raison : jamais la majorité des étudiants ne
s’est prononcée pour la grève, le blocage. Ni contre, d’ailleurs. La majorité des individus suivant des
cours à Villejan était absente lors de toutes les AG, même les plus massives (jusqu’à cinq mille participants)
: ils laissaient donc le soin à d’autres de faire de la fac quoi bon leur semblerait. Les récriminations
sur le caractère anti-démocratique ne disaient rien d’autre que le refus de l’interruption
du cours normal des choses : où l’on voit bien à quel point démocratie et maintien de l’ordre sont
devenus synonymes.
Les multiples altercations entre grévistes et anti-grévistes, entre sociaux-démocrates de
l’UNEF, grévistes non affiliés et anarchistes de la CNT sur la question de la démocratie, n’ont cessé
d’entretenir la confusion entre la démocratie comme forme de lutte, modèle d’organisation politique
de la lutte (qui ne serait jamais complètement réalisée mais toujours en travail), et démocratie
au sens commun de démocratie biopolitique, ensemble de dispositifs de conjuration du conflit.
Aussi abrupt que cela puisse paraître, ce consensus sur la centralité de la question démocratique,
cette lutte pour imposer la “démocratie véritable” indique dans sa pluralité le travail collectif de
conjuration de l’événement. Ce qu’on a voulu empêcher, c’est l’affrontement entre des formes de vie
qui cherchaient à accroître leur puissance au détriment des autres ; on a donc travaillé à atténuer ces
différences, pour grand nombre irréductibles, en diffusant l’idée qu’on pouvait se mettre d’accord,
trouver un terrain d’entente.
l’assemblée générale, haut lieu de la démocratie
L’assemblée générale, seule décisionnelle et ouverte à tous les étudiants, est la structure organisationnelle
où se déploie un tel consensus. Les anti-grévistes n’ont pas longtemps pu dénier toute
légitimité à l’assemblée générale. Ils ont vite reconnu que leurs réunions en petit comité, malgré les
propositions “alternatives à la grève” qu’ils annonçaient toujours pour la prochaine AG, n’avaient
pas d’autre but que d’arracher l’arrêt du blocage à l’assemblée générale “souveraine”, seule légitime.
L’UNEF, par son nombre de militants, ses grands prêtres de gauche, sa capacité à fournir tous
les rôles, du modéré médiatique qui flatte les anti-grève et les autorités universitaires au radical qui
tempête contre patronat et gouvernement, de l’austère spécialiste des réformes au tribun, a toujours
été, même occasionnellement sous-représentée, dans son élément. Elle a toujours manœuvré sur ce
terrain connu, et, même en dehors des AG, elle a toujours agi et manœuvré en vue, en prévision des
AG. Certains ont reproché à l’UNEF de placer systématiquement ses militants à la présidence des
AG, du comité de grève, des commissions, de se permettre d’accumuler les interventions pour
noyer toute parole ennemie, de ne pas soumettre au vote de l’AG les propositions qui les dérangeaient.
Tout cela est juste, et même évident pour qui a participé, même brièvement, au mouvement.
Mais cela ne sert en rien de s’en scandaliser, d’en appeler à la démocratie directe. Toutes les
assemblées constituaient des espaces et ouvraient des moments au conflit : l’UNEF faisait la guerre
à ce qui dans la grève désirait au delà des revendications LMD-autonomie, au-delà du monde étudiant,
au delà du mouvement social. Pour cela, il fallait nier que ce courant existe, et quand cela
était impossible, en appeler à la “masse des gens” qui n’était pas prête, frileuse, sous-informée, mal
“conscientisée” pour employer un des termes les plus significatifs de cette grève d’intellects sans
corps. L’UNEF faisait la guerre à ce qui dans la grève étudiante était déjà de l’ordre de la grève
humaine : non défendre l’université, mais la critiquer ; ne pas réclamer plus de droits pour l’étudiant,
mais rejeter la séparation déjà fausse entre ceux qui étudieraient et ne travailleraient pas, et
ceux qui travailleraient après avoir fini d’étudier, en brisant la séparation réelle entre les corps qui
travaillent, qui se redouble dans la séparation spatiale des espaces connectés de la production
(l’université, l’Etat, l’entreprise). Et il n’est donc pas étonnant que dans cette miniature de démocratie
biopolitique qu’est une assemblée générale, la guerre menée par l’UNEF prenne la forme d’une
dénégation du conflit, de constants appels à l’”unité du mouvement” et de la présentation comme
un corps étranger à celui-ci ceux qui voudraient le “casser”, tant ils s’identifiaient à ce mouvement
en ce qu’il s’approchait de la moyenne de tous les autres, en ce qu’il illustrait leur propre puissance.
Reprocher à l’UNEF de manipuler la démocratie directe des assemblées générales (dont les
CNTistes n’ont jamais contesté la forme), c’était leur reprocher d’être ce qu’ils sont. Les assemblées
générales sont faites pour être manipulées, et le resteront tant qu’elles rassembleront des individus
séparés et non des tendances, des forces qui peuvent dialoguer, s’agréger, mais aussi se combattre,
mais aussi agir en dehors de l’assemblée générale. En appeler à l’assemblée générale comme seule
décisionnelle , à la démocrate directe comme principe transcendant, c’était renforcer l’UNEF, parce
qu’elle tire sa force dans sa supériorité quantitative et qualitative pour ce qui est de la manipulation.
Nul ne peut rivaliser avec elle sur ce terrain. C’est pourquoi il fallait déconstruire ces assemblées,
faire éclater la souveraineté qui voulait régner là sans partage.
On a beaucoup ri et médit dans ce mouvement sur les assemblées générales. Ridicules,
consternantes, pitoyables, des qualificatifs peu amènes ont servi à décrire ces grands-messes qui
concentraient toutes les tensions et l’attention de ceux qui faisaient cette grève et qui s’achevaient
toujours comme un ballon qui se dégonfle : c’était gros, massif, mais plein de vide. Au début, cela
commençait par le rituel rappel des réformes, UNEF et SUD, puis, plus tard, UNEF toute seule
venaient réciter le credo. Quel plaisir de voir ces gens si bien parler ! Les applaudissements étaient
alors systématiques. On ne se répondait pas entre intervenants, on en rajoutait. La LMD, les crédits
ECTS, l’autonomie des universités. Vous avez oublié les frais d’inscription ! Je peux faire la session
de rattrapage ? Et la non-compensation des notes ? Moi aussi, je veux conscientiser la masse. Ainsi
prenaient corps les serpents qui sifflent sur nos têtes, la catastrophe annoncée qui viendra boule-
verser notre système si parfait, le monstre hideux du libéralisme sauvage. Mais il est encore temps
camarades ! Cette grève rejettera le dragon dans son enfer. Ce qui compte, c’est de bien voir à quoi
il ressemble, de le connaître à fond pour pouvoir le combattre, ce dragon. De temps à autre, un étudiant
de droite, toujours le même, venait apporter la contradiction : ce dragon n’est pas aussi
méchant que vous le dites, on ne sait pas encore, ne nous emballons pas. Mais l’étudiant de droite
était tout seul, et endurant particulièrement bien les huées, il paraissait un peu idiot, décalé, à
essayer de dire ce qui n’était pas faux : que les réformes avaient été initialisées par la gauche au pouvoir
et que l’UNEF (alors encore scindée entre UNEF et UNEF-ID) avait cherché à freiner la tentative
de grève contre ce qui s’appelait alors le “Plan Attali” ; que le LMD était déjà appliqué dans certaines
universités, que les réformes avaient été élaborées au niveau européen et que les professeurs
y avaient été associés... Dans ces conditions, où le débat ne pouvait pas mener au-delà des réformes,
sur ce qu’était déjà l’université et son étroite collaboration avec les entreprises dans la production
immatérielle (qui ne se mesure pas par le temps de travail et implique un investissement
important en savoirs) il ne pouvait que se perdre dans les méandres politiciens d’une “autre LMD
est possible” avec “maintien du cadrage national des diplômes”, à l’époque où le diplôme n’ouvre
déjà plus à lui seul les portes de l’entreprise, quand les entrepreneurs font donner à leurs futurs
employés des cours à l’université ou quand ces cours ont lieu à titre de formation directement pour
le compte de l’entreprise.
Il ne pouvait plus alors s’agir que de psalmodier ces principes abstraits, égalité, solidarité,
service public, éducation, culture, qui sont chez les militants de gauche les formules mythiques
pour conjurer l’impuissance. Evidemment, ces grands concepts ne sont pas les fruits du hasard, ils
font consensus, ils conjurent réellement le conflit, ils inondent les tracts, chants, slogans, déclarations
à la presse : bien qu’invertébrés, ils travaillent pourtant à produire l’évidence sensible du partage
d’idéaux et de valeurs indiscutés. Un autre élément, et de taille, fut déterminant dans la production
du “tous ensemble” obligatoire, s’ajoutant à ces premiers dispositifs de neutralisation : il
s’agit de la présence, de plus en plus massive, des anti-grévistes dans les AG. D’abord timides et
empruntés devant les sarcasmes et les huées, ils devinrent omniprésents et ne connurent plus de
limite quand, par esprit démocratique, furent proscrits sarcasmes et huées. Ils intervinrent presque
toujours sur le mode du piétinement : peu leur importait le sujet abordé, réformes, blocage, rapport
à l’administration, coordination nationale : ils venaient juste dire qu’ils en avaient marre, qu’ils se
moquaient bien des réformes, qu’ils voulaient aller en cours. C’est mon choix. Leur adhésion forcenée
au libéralisme existentiel opposait la trivialité, l’obscénité tranchante de l’individu dressé à la
séparation (de l’individu qui habituellement fonctionne, et qui voit détraqué, avec l’institution, son
propre fonctionnement) au ronflant humanisme de la pseudo-communauté gréviste. Tout l’enjeu
des AG se réduisait alors à la reconduction ou non de la grève : faire bloc, montrer aux indécis que
s’opposaient dans la question du blocage des cours le mauvais égoïsme et le gentil altruisme, répéter
à l’envi qu’il était bien dommage d’avoir à faire grève, qu’on ne le faisait pas pour s’amuser mais
par devoir, qu’on préférerait être en cours, mais... et les générations futures ? Dès lors qu’on
s’adresse prioritairement à ceux qui réprouvent un peu des réformes mais aimeraient bien retourner
en cours, bref à la majorité silencieuse, bref à ceux qui ne vivent pas la grève, dès lors que tout
est suspendu à un vote final, l’assemblée générale, lieu où était sensé avoir lieu le débat, lieu où
étaient sensées se prendre des décisions, n’a plus pour enjeu que la poursuite ou non de la grève :
pourquoi, pour quoi et comment n’a plus d’importance.
« sensibliser l’opinion publique »
Les assemblées générales étaient, comme les manifestations, des moments de mobilisation
massive. Tel était le concept central de la rhétorique du mouvement. Ces moments révèlent pourtant
en négatif la non-participation massive à ce qui a fait le minimum de substance du mouvement,
le travail des commissions, du comité de grève, l’occupation du hall B, du rectorat et de la présidence,
les “barricadages”, les multiples discussions sur le sens à donner au mouvement, formalisées
par les ateliers de lutte et qui avaient également cours de manière informelle durant toute la
grève. Ainsi quelques centaines d’individus seulement se sont-ils mobilisés : attentifs d’abord à la
masse qui leur restait extérieure, ils ont perdu de vue ce qui se passait entre eux. La masse extérieure,
multiforme, “les étudiants”, “l’opinion publique”, il allait falloir la convaincre, la mettre de
son côté, l’amadouer, et l’on n’allait pas reculer devant les compromissions. On n’allait pas se soucier
d’avoir raison, mais d’être crédible, visible pour sensibiliser, amollir la rude indifférence, la
rigide hostilité du monde extérieur. Il s’agissait d’élaborer une politique du consensus à tous les
niveaux. D’abord vis à vis des médias : comme dans tout mouvement social classique, on oublie (à
ce stade, on fait semblant d’oublier) que les médias sont toujours, a priori, hostiles à toute interruption
délibérée, même minime et circonscrite, des flux de production et de circulation des marchandises.
Ils sont les porte-parole zélés de ceux que toute interruption gêne, de ceux qui quotidiennement,
fonctionnent normalement. Dans ces conditions, il ne sert à rien de vouloir séduire ces censeurs :
il convient plutôt de les tenir en respect, à distance, en se servant occasionnellement d’eux
mais toujours cyniquement, de manière stratégique. Ce problème, qui n’a jamais été abordé dans
toute son ampleur dans le cours du mouvement, a donné lieu, vers la fin, à la très insuffisante exigence
que soit demandée aux commissions et au comité de grève la permission de venir les filmer.
Pour le reste, les caméras pouvaient pulluler et filmer ce que bon leur semblait, en commençant par
le plus scandaleux pour eux, un tag, un peu de verre brisé, le bordel du petit matin après une nuit
d’occupation... Quel plaisir de remarquer, alors qu’aux dernières nouvelles, le bâtiment B serait aux
mains des grévistes, qu’un journaliste vous filme à votre insu ! Présents à la plupart des AG, les
caméras, comme celles de vidéosurveillance, sont des incitations permanentes à l’autocensure, au
contrôle de soi, au polissage de ses mots et de ses gestes. C’est une forme de police préventive.
Comme les autres, sa présence vise, avant même de réprimer (ici de dénoncer, stigmatiser) ce
qu’elle considère comme déviant, à prévenir le conflit, à atténuer les différences. Si le conflit se
manifeste quand même, il se théâtralisera, se déréalisera en présence de cette machine à produire
de la fiction qu’est un journaliste muni d’une caméra. La “télé réalité” n’est pas une aberration
monstrueuse, mais seulement la logique de la médiation entre sujets biopolitiques poussée à son
terme : quand l’instrument de la médiation qui est aussi celui de la surveillance, devient explicitement
le centre des rapports humains, qui n’ont plus cours malgré cette instance de jugement, mais
pour elle-même, pour lui plaire, la divertir, la renseigner. La question des médias n’est ainsi pas une
question de principes, de pureté : elle pose la question plus générale de la médiation démocratique ;
et il est vrai que tant qu’on ne critique pas la démocratie, tant qu’on fait grève en se référant à des
valeurs abstraites, qu’on détermine sa politique comme une stratégie de communication à l’adresse
de l’”opinion publique”, ce qui n’existe pas et ne s’exprime jamais, et qui n’a plus de réalité qu’à travers
les sondages (dont les élections font partie) comme accumulation de points de vue privés, on
serait bien en peine de vouloir affronter le pouvoir de nuisance des médias. Dans ce mouvement,
l’interruption de l’activité productive n’a pas interrompu la centralité du jugement policier dans les
rapports qui se sont constitué par la grève.
Cette persistance de la médiation dans le mouvement qui potentiellement portait le dépassement
de la séparation public-privé, dépassement que laissait deviner les accès de grève humaine
attisant les rencontres au cours d’un mois d’occupation, a permis au mouvement de rejoindre le
domaine public où il ne s’appartient plus à lui-même mais appartient à l’Etat. Il faut dire qu’à la
médiation démocratique s’agrégeait la médiation des diverses fonctions militantes, maladroitement
inspirées des modèles entrepreneuriaux post-fordistes.
l’auto-entrepenariat militant
Le mouvement qui en voulait tant aux entreprises privées a repris leur modèle d’organisation
et leur rationalité. Il est évident pour des entrepreneurs que le problème est de gagner de l’argent,
qu’il s’agit pour cela de mettre la subjectivité et la créativité des employés au travail, de
manière à prévenir une dissociation éventuelle entre les intérêts de ces employés et ceux de leurs
employeurs. Il s’agit d’orienter toute l’activité vers la valorisation capitaliste, de stimuler cette activité
par toutes sortes de promotions, d’intéressements, en lui accordant l’autonomie nécessaire à la
création et aux initiatives, l’essentiel demeurant de canaliser cette production immatérielle diffuse
vers l’extraction de valeur-argent. Non plus discipline et hiérarchie, mais autonomie contrôlée.
Pour un mouvement étudiant, il s’agit de mettre la joie au travail, de construire efficacement, en
mettant à profit toutes les ressources de l’individu, un mouvement social classique. Je vais parler
du travail des commissions. Dès le 7 Novembre, ont été mises en place une commission action, une
commission réflexion, une commission externe, puis, vers le milieu du mouvement, une commis-
sion occupation, et même une commission blocage. A première vue, il s’agissait là d’une division
du travail très traditionnelle. Mais l’argument pour parer à cette critique était tout prêt : il s’agissait
de favoriser la communication entre ces commissions, sur le modèle de l’interdisciplinarité chère
aux universitaires modernistes. A l’objection un peu naïve que certains d’entre nous ont pu faire,
qu’il n’y avait là que de la très banale séparation entre une réflexion sur les réformes, entre l’élaboration
des formes et des moyens de la lutte, et entre la mise en oeuvre d’une stratégie quant à la
manière de se rapporter aux amis, ennemis et alliés potentiels, il a été répondu que si la communication
entre ces sphères ne fonctionnait pas encore parfaitement, on était sur la bonne voie. On prétextait
à raison que les individus pouvaient passer d’une commission à une autre, que le comité de
grève était le lieu de la mise en commun de ces labeurs respectifs. Mais on perdait de vue la caractéristique
centrale de l’entreprise post-moderne, la collaboration des spécialistes, l’intégration de la
coopération à la spécialisation. Cette spécialisation demeure essentiellement, mais elle a perdu son
étanchéité ; sans disparaître, elle se renforce et s’enrichit au contact de ce qui lui est étranger. Ainsi
la réflexion, l’action et la communication ont elles été réunies et harmonisées en tant que séparées.
La séparation n’a pas été abattue, ce qui aurait supposé la constitution dans le même mouvement
d’une critique sociale et d’une stratégie, de formes de vie qui soient aussi des formes de lutte.
L’on a pu chercher à faire passer cette question de “structuration” du mouvement comme
une question de pure forme, opposer la logique des commissions et celle des ateliers de lutte en termes
de principes abstraits, le premier offrant l’incontestable avantage d’être là, éprouvé, quand le
second se heurtait à la soi-disant impossibilité matérielle d’associer les grévistes à l’élaboration
commune des divers aspects de la grève. La logique de l’urgence, la logique pragmatique qui voulait
que la temporalité des assemblées générales et des manifs détermine la substance même de la
grève, les rencontres, les débats, les actions, l’organisation dont on se dote, a pu déterminer la
nature de l’efficacité qui était mise en avant pour justifier ces opérations. Une efficacité numérique,
qui se mesure au nombre d’individus présents dans les AG, dans les manifs ; une efficacité médiatique,
puisque les médias n’ont pas été trop méchants avec ce mouvement qui a su rester universitaire ;
une efficacité politique, puisque le ministre a ajourné son projet d’autonomie des universités.
Le mouvement a donc été une réussite puisqu’il a pu arracher un geste symbolique quand nombre
de mouvements sociaux vivent et meurent sans avoir suscité de la part des gouvernements autre
chose que du mépris. C’est ce que dit l’UNEF, et comme elle se contente de peu, nous lui laissons
sa victoire. Mais il a aussi été une réussite puisqu’il a pu bloquer pendant un mois le fonctionnement
d’une université sans que la reprise des cours pose le moindre problème, puisque l’université
a pu redevenir aussi triste et terne qu’avant, puisque la plupart des occasions de rencontre, qui n’ont
pu s’approfondir, se sont noyées dans le retour à la normale. Les choses sont redevenues telles
qu’on les avait interrompues : il n’en reste rien, sinon le découragement à devoir travailler beaucoup
plus pour rattraper tout ce retard. Cela, l’UNEF ne le dit pas : elle s’entend en réformes, mais cale
un peu sur la liberté.
TROISIEME PARTIE : PRESENCE COMBATTUE DE LA GREVE HUMAINE
Pour nous, il en reste quelque chose. Par “nous”, je n’entends pas seulement ceux qui se sont
constitués en force sous le nom d’atelier de lutte (et qui, d’ailleurs, n’ont jamais eu besoin de nom
pour agir en tant que force, et ne se sont servis de ce nom, vers le milieu du mouvement, que parce
que se dégageaient, à l’occasion de ces ateliers ouverts à tous, des positions qui faisaient exister, en
théorie et en pratique, la critique du mouvement étudiant, la critique de la démocratie) mais aussi
ceux que nous avons pu croiser, avec qui nous avons pu partager refus, joies et insatisfactions, et
qui s’engageaient eux aussi, diversement, dans la constitution d’une force. Il va de soi que ce nous
traverse tous les partisans de la grève humaine, nos amis qui ont préféré ne pas affronter la déperdition
d’énergie qu’impliquait l’engagement dans un mouvement étudiant aussi classique, et tous
ceux qui, connus ou inconnus, sabotent l’alternance réglée de la paix sociale et des évènements
médiatiques. Il en reste pour nous quelque chose, d’abord parce que nous sommes plus nombreux
et plus forts qu’auparavant, mais aussi parce que ce mouvement s’est achevé sur l’irréconciliabilité
d’au moins deux tendances et la promesse de conflits d’une toute autre envergure. La logique des
ateliers n’a pas été de proposer systématiquement des solutions “radicales” toutes prêtes, de psal-
modier plutôt classes populaires, autogestion, que service public et égalité des étudiants. Il s’agissait
de prendre le temps d’aborder tous les problèmes de l’heure, blocage des cours, rapport à l’administration,
aux médias, convergence des luttes, critique de l’université productive, appropriation
des moyens matériels nécessaires. Evidemment, cela n’était pas soluble dans les commissions, où
une réflexion minimale sur la manière de se constituer en force (capable d’infirmer l’évidence que
l’effondrement de tous les mouvements qui comptent sur les “masses” et l’opinion publique est
programmé, cyclique, inévitable) n’était pas matériellement possible, faute de temps. Déserter les
commissions, c’était bien le minimum que nous pouvions faire pour garder de la distance, ne pas
se laisser happer dans l’implacable logique de l’urgence. Nous étions, comme tout le monde, obligés
de subir les AG et les manifs, et il serait mensonger de prétendre que le découragement ne nous
a pas gagnés, comme tant d’autres, devant les fréquents triomphes des démocrates de gauche. Nous
avons souvent éprouvé combien il est difficile de troubler la léthargie et l’ennui de ceux qui font
confiance aux autres pour diriger, de ceux qui ne se positionnent pas. Nous avons vu comment cette
léthargie, cet ennui sont contaminants, et comment ils ont pu nous pousser à répéter les mêmes
arguments, ennuyeusement, sans conviction. Cela donne à penser sur la manière dont sont neutralisés
les flux qui traversent les corps, même en période de grève, au profit des carapaces cérébrales.
les occupations
Mais cette grève, longue d’un mois, n’a, fort heureusement, pas été qu’ennui. L’occupation
du hall B a donné lieu à une relative appropriation de l’espace (tables d’information, de nourriture,
de café, confection de banderoles, d’affiches). Si les repas n’étaient pas pris en commun, le réinvestissement
immédiat de ce qui était vendu à un prix modique ou libre, dans la caisse de grève pour
les tracts et la nourriture, la possibilité de dormir dans les amphis, faisaient qu’on s’engageait dans
cette grève sans peur de se mettre trop à découvert. Il y avait déjà là des ébauches de communisation.
Vers la fin du mois de novembre, l’occupation nocturne gagnait en joie, de manière perceptible,
de jour en jour. A la fin du mouvement, il y avait fête tous les soirs, des grévistes jouaient du
punk ou de la musique bretonne, on passait de groupe en groupe pour échanger quelques mots,
quelques bières. La dernière fête, le 3 décembre, fut sans conteste la plus belle : des centaines de personnes
occupaient les amphis et le hall B : les comportements dans l’ivresse se déliaient, tout le
monde se parlait, et ce n’était pas du LMD, de l’égalité des droits mais du plaisir d’être là, du désir
un peu délirant, étant donné l’absence totale de perspective du mouvement, de ne jamais arrêter.
Elle était là, enchaînée et désespérée, la grève humaine que ces mêmes grévistes, pour la plupart,
avaient conjurée : dans cette bizarre conjonction entre un jeudi soir dans la rue de la Soif et un
moment de lutte étudiante, dans la proximité de tant de corps attentifs les uns aux autres, pressentant
la fin proche, retrouvant un mois après le souvenir de l’interruption, réalisant enfin au moins
une des possibilités ouvertes par la grève. La grève d’esprits politisés révélait son négatif : nous
fêtions notre échec, toute la joie refoulée réapparaissait, séparée de ce qui aurait pu lui permettre
de se répandre au-delà de la nuit. Le lendemain matin, en comité de grève, l’UNEF décidait de proposer
à l’AG la dissolution du mouvement.
Certes, l’occupation du hall B avaient bien mal commencé. On décidait de fermer les portes
du bâtiment B à minuit pour éviter que “les zonards de la place Saint-Anne” viennent finir leur soirée
à la fac. Si la question se pose bien de la nécessité, dès lors qu’une occupation a été collectivement
décidée, de déterminer des manières de réagir collectivement en cas de problème, on ne
m’ôtera pas de l’esprit qu’il y avait là du mépris et une certaine fatuité à penser qu’il serait agréable
pour des zonards de venir à la rencontre de la forme de vie étudiante surtout quand elle s’enferme
sur elle-même par souci de « crédibilité » médiatique . Les zonards ne sont jamais venus. Au
début, on partait à minuit ou on devait rester toute la nuit. On se demandait sérieusement s’il ne
fallait pas interdire l’alcool. On se proposait d’organiser des rondes de surveillance pour attraper
ceux qui écrivaient sur les murs. Puis, peu à peu, la peur des “débordements” s’est relâchée (elle se
reportera des occupations aux manifs), ceux qui occupaient ont appris à se parler, la joie a pris le
pas sur la police. La question centrale de l’appropriation de l’espace est restée en suspens : le bâtiment
B était-il notre lieu, ou était-il encore le lieu de l’institution ? Les assemblées d’occupants, formée
d’individus aux formes de vie et de lutte incompatibles, ne pouvaient pas régler le problème.
Pour les uns, écrire sur les murs constituait une dégradation de ce qu’ils considéraient à la fois être
leur lieu et le lieu de l’institution, ce qui pour beaucoup d’entre eux revenait au même. Pour nous,
écrire sur les murs signalait au minimum que le respect de l’assignation par l’institution d’un objet
à son rôle -un mur qui ne serait là que pour tenir le plafond- se perdait, ou s’était perdu, et cela nous
plaisait plutôt. Il était évident que ce lieu n’était notre lieu que tant que nous y faisions ce que nous
voulions y faire, et nous voulions bien discuter, des heures s’il le fallait pour établir des règles susceptibles
de contenter tout un chacun : mais si les désaccords étaient trop graves, il ne fallait pas
compter sur nous pour nous plier à la majorité. Après, le problème de savoir si l’on veut immédiatement
chercher le conflit ouvert se pose en termes stratégiques. Pratiquer la démocratie n’a de sens
que pour les amis. Il fallait des bases d’accord suffisamment consistantes, l’appropriation de tout le
bâtiment, la réquisition de tout le matériel nécessaire, pour que l’énonciation de règles communes
aient un sens.
L’occupation du rectorat, le 13 Novembre a posé les mêmes problèmes en les exacerbant : les
quelques centaines d’étudiants qui l’ont investi ne se sont pas laissé intimider par le service d’ordre
de l’UNEF qui patrouillait à la recherche du flagrant délit de déviance. La joie était de passage, le
photocopillage de rigueur. On photocopiait ses pieds, ses mains, son visage, ses tracts, sanctionnés
ou non par l’assemblée générale ; on affichait tout cela sur les murs, on visitait les bureaux, on buvait
le café et les bières, affalés par terre. Dans une salle, ceux qui voulaient parler du mouvement en
assemblée faisaient taire les appels au repli des petits chefs de l’UNEF. Finalement, las d’attendre
l’arrivée de la police, les occupants ont pour la plupart quitté le rectorat avant son intervention.
Décidément, ce lieu n’était pas le nôtre : nul désir de le défendre.
Une autre occupation, pour en finir avec cette question de l’appropriation, celle du bâtiment
de la Présidence, la semaine du 24 au 28 Novembre. L’atelier de lutte avait provoqué le 19 la tenue
d’un “comité de grève exceptionnel”, qui n’avait rien d’officiel, parce qu’il s’avérait intenable de
repousser perpétuellement le débat entre tous les grévistes sur la question notamment des commissions,
de la convergence des luttes, de l’inanité des assemblées générales, bref sur la question du
mouvement dans son ensemble. Le comité de grève officiel avait pour fonction de préparer les
assemblées générales et de faire appliquer les décisions de l’assemblée générale ; bien sûr, il fallait
bien suppléer un peu à l’absence de débat en AG, prendre des initiatives, mais pas n’importe lesquelles ;
il ne fallait surtout pas trop débattre et respecter son mandat. (Soit dit en passant, quelle
sorte de mandat confie t-on à ceux qui viennent là parce qu’ils en ont envie ? 3000 en AG, 100 en
comité de grève, confiez votre lutte aux militants, aux citoyens, ils en feront bon usage) Le comité
de grève exceptionnel, réunissant la centaine d’occupants du moment, aurait pu être décisionnel : il
posait les problèmes de l’heure, exposait des divergences, cherchait des terrains d’entente, avait
tout son temps. Quand les démocrates, qui auraient bien aimé l’interrompre, eurent compris que
ceux qui étaient là n’oseraient pas vouloir les conséquences de leur pensée, ils purent se retirer, soulagés.
Faute de mieux, on décida d’élaborer des positions communes en vue du prochain comité de
grève, de la prochaine AG. La question du blocage des cours y fut abordée : il faut savoir que les
étudiants en CAPES, les étudiants étrangers (CIREF) et même certains DESS avaient été autorisés
d’aller en cours. Chaque nouvelle AG se faisait la caisse de résonance d’une nouvelle catégorie
d’étudiants qui venait se faire plaindre et arracher, par compassion, le droit de retourner à ses chères
études. Les grévistes qui tenaient les piquets de grève, obligés d’être présents douze heures par
jour, rarement relevés par ceux qui cherchaient à prendre en marche le TGV des commissions et
comités, étaient confrontés non seulement à l’agressivité des étudiants, mais aussi à leurs complaintes,
pour aller dans une bibliothèque, aller voir son prof, un tableau, une secrétaire, mais aussi à
leurs ruses, quand les catégories épargnées par la grève se sont mis à servir de mots de passe. Il n’y
avait à certains piquets pas d’autre choix que de laisser passer tout le monde, et à d’autres de prendre
sur soi de ne laisser passer personne, quitte à être sermonné par un syndicaliste, pour passer
outre à ce qu’il peut y avoir d’indigne à demander à quelqu’un, comme un videur de nuit, comme
un flic, s’il a les papiers requis pour passer. Nous étions très nombreux à penser qu’il fallait en finir
avec les piquets, qu’on pouvait, à la rigueur, laisser un bâtiment à ceux qui pouvaient avoir cours,
mais que tout le reste devait être fermé. Cette position exposée en comité de grève, qui la reprit en
la diluant, aboutit à la proposition en AG de réduire les piquets de 3 à 1 par bâtiment. Les portes
laissées auparavant ouvertes seraient fermées à l’aide de chaînes et de cadenas. Cette proposition
fut acceptée, contre l’avis de l’UNEF, par l’AG, (qui refusa par ailleurs, le même jour, de remplacer
les commissions par des ateliers) ce qui aboutit à la création d’une “commission blocage” chargée
de mettre en oeuvre ces améliorations.
Le lundi 24, trois jours plus tard, la Présidence, prenant acte de ce “durcissement” qui ne permettait
plus d’”assurer des conditions normales de sécurité”, fermait la fac. Le matin, après deux
heures d’atermoiements sur la méchanceté de la Présidence, la porte d’entrée du bâtiment B fut
enfin fracassée, provoquant l’indignation de nombreux assistants, bien contents pourtant de pouvoir
aller boire leur café. Le même jour, la Présidence fut occupée pour exiger la réouverture de la
fac. On peut se demander quel problème cette fermeture pouvait bien poser, puisque personnels
IATOSS et professeurs n’avaient pas voulu rejoindre physiquement le mouvement, se contentant
d’un soutien verbal par l’intermédiaire de leurs responsables syndicaux. (Il est vrai que ce mouvement
s’est fort soucié de son indépendance, de nombreux syndiqués et non-syndiqués considérant,
sans rire, qu’il fallait d’abord construire un mouvement étudiant fort, et que la “convergence des
luttes” viendrait après). Que nous importait alors que la fac soit fermée, si nous avions le bâtiment
B ? L’occupation de la Présidence pouvait cependant paraître justifiée par cet acte hostile : elle a duré
quatre jours. Là où elle aurait pu, vite et bien, arracher les moyens matériels qui manquaient au
mouvement, être à la hauteur du conflit qui s’offrait, elle n’a abouti qu’à la réouverture le 28
Novembre de la fac, avec le retour aux trois piquets par bâtiment, et une prime de quelques milliers
de tracts, à adresser exclusivement aux étudiants, réservés aux mandatés par l’AG et le comité
de grève. Pendant quatre jours, on avait donc le choix entre s’ennuyer dans le hall B ou dans la salle
du grand conseil, où l’on se sentait infiniment fort, tout en s’excusant devant le responsable de la
sécurité, en colère, d’avoir allumé une cigarette.
partout et toujours, la peur de l’évènement
Ce qu’on retiendra également, c’est à quel point le désir d’évènement à l’origine de la grève
se doublait d’une peur systématique de l’évènement, de ce qui pourrait reconfigurer les rapports
de force, marquer un avant et un après, faire consister le conflit. Cette peur se dit par exemple dans
le refus de casser une vitre qui nous a été fermée à la figure, d’interrompre l’émission de TV Match
qui était enregistrée dans l’Opéra, sur la place de la Mairie, où la manif passait le 20 Novembre
(alors que l’animateur - vedette était venu, de son plein gré, à la rencontre des grévistes pour se foutre
de leur gueule), dans l’angoisse qui nous fait craindre la colère de la police ou des médias quand
des oeufs de peinture sont jetés sur les banques et les agences d’intérim, autant de symboles outrés,
indéfendables, de la “marchandisation” qu’on dit refuser, quand des tags sont laissés sur les murs,
traces de ce mouvement sans traces, sans histoire. Il s’agissait, plus généralement, de la peur de
s’approprier, simplement, ce dont on a besoin (nourriture, boisson, photocopieuses, imprimantes..).
On a voulu croire que ce qu’on refusait de faire, par peur, c’est ce dont on n’avait pas vraiment
besoin, ce qui ne servait à rien. Mais le désir d’évènement exige de se libérer de la peur ; et pour cela,
il faut réfléchir à comment faire ce que dans le fond on aimerait tant faire ; il faut élaborer une stratégie
collective, tisser des amitiés, former des attachements, partager des moments de joie ou de
tristesse, avoir confiance, sentir que nos perceptions s’affinent en un savoir qui soit aussi un pouvoir
de transformation. Cela implique une autre présence des corps que celle des manifs, desquelles
il n’y a, hormis ces quelques moments où les corps se mettaient en jeu, en lançant des fruits
pourris ou des oeufs de couleur en direction des CRS qui gardaient le rectorat, en lançant des oeufs
(frais, hélas) sur la façade du MEDEF, rien à retenir, tout à oublier parmi les slogans du type “quand
le MEDEF attaque l’école, l’école répond résistance” ou encore “une seule solution, la manifestation”,
tout à oublier de ces marches sans joie dans des quartiers résidentiels où il n’y a rien à salir.
Grosses, massives manifs, et pleines de vide.
« Mobilisation massive » et « convergence des luttes »
Il y eut d’autres actions, dite de “sensibilisation”, barrages filtrants et distribution de tracts,
“actions artistiques” et enfin, peut-être la plus intéressante, le blocage pendant quelques minutes
d’un accès du centre commercial du Colombier, le 13 décembre, alors que la grève avait été définitivement
enterrée deux jours plus tôt. Mais il y avait toujours entre les grévistes et ceux qu’ils voulaient
toucher, ce discours unilatéral de celui qui lutte face à celui qui ne lutte pas. La logique de
“mobilisation massive”, de “conscientisation” a fait des ravages, n’envisageant la communication
que sur le plan quantitatif, ignorant le simple fait que la rencontre exige une certaine communauté
d’attentes, de désirs, chez celui qui parle et celui qui écoute, de nature à rendre possible le renversement
le jeu des rôles. On a cru efficace de diffuser massivement un discours consensuel selon
lequel les valeurs abstraites de la gauche, l’éducation et la culture, et avec elles l’étudiant lui même,
seraient mises en péril par des réformes catastrophiques. L’histoire de ces étudiants à la fac de droit,
à moitié convaincus en AG par les alarmes de l’UNEF, puis changeant d’avis après leur réfutation
par un professeur, nous est éclairante. Il y a une certaine manière de parler de soi qui empêche le
partage ; il y a une certaine manière de se poser en victime qu’il faut plaindre, soutenir et encourager,
qui rend toute empathie impossible. Les discours pseudo-universels sur le « progrès social »,
les discours empruntés, renforcent l’extériorité de tout message à caractère explicitement politique à
l’expérience individuelle et collective. Il convient plutôt, pour provoquer la rencontre, de partir ce
qui nous est commun, une certaine insatisfaction, une soif d’interrompre dans le début d’un partage
et non dans le déchirement, le cours normé d’une vie quotidienne aux douleurs vécues comme
incommunicables.
En luttant en tant qu’étudiant, comme on l’a vu, les grévistes recréaient un ersatz de lien
communautaire autour d’une identité effondrée. Tout le temps passé à travailler, dans les jobs précaires,
les stages, pour les examens, tout cela disparaissait dans la célébration de l’université démocratique
et égalitaire. Il semblait alors qu’on étudiant spontanément, par plaisir, en tout cas par
choix, pour se cultiver », « s’enrichir »... ce qui pris à la lettre, aurait pu faire dévier le débat du
refus de l’autonomie des universités entre elles au processus d’autonomisation de la production et
de l’échange de savoirs vis à vis de l’économie, vers l’université sauvage (la constitution d’une force
autonome de production et d’échange de savoirs-pouvoirs).Il ne s’agissait pourtant pas là d’un discours
habité, mais d’une manière de sublimer la mise au travail de la subjectivité dans la production
immatérielle : ce discours, encouragé par l’UNEF au fait des techniques mises en œuvre par
les individus pour s’accommoder aux communautés effondrées, interdisait en même temps la critique
de l’université que la critique du travail. Le manque de consistance de ce qui a été effectivement
vécu par chacun à l’université en termes « d’épanouissement moral et intellectuel » (ce
qu’elle serait sensée permettre, selon un syndicaliste UNEF), fait l’inconsistance du refus de la «
marchandisation », qui retombe sur la platitude du « il faut bien travailler pour pouvoir manger
». Il faut savoir qu’au début, l’UNEF disait rejeter complètement le LMD, puis, à partir du 27
novembre, a commencé à diffuser l’idée qu’une « autre LMD était possible », quand la tendance à
la sécession hors des rapports de production qui était virtuellement là dans le refus affiché de la «
rentabilité », fut conjurée chez la majorité. Séparés de leurs désirs par la défense d’une condition
particulière effondrée, les grévistes restèrent séparés de tous ceux qui auraient pu être leurs alliés.
Construire un mouvement étudiant fort (une contradiction dans les termes) avant de chercher
la rencontre avec d’autres secteurs en lutte, l’ayant été ou en passe de l’être, cette évidence des
quinze premiers jours n’avait pas d’autre motivation que d’empêcher une éventuelle « radicalisation
» du mouvement. On n’a pas non plus questionné ces évidences que les rencontres, souhaitées
en principe par la suite , ne pouvaient prendre d’autre forme que celles de la juxtaposition un peu
arbitraire des mouvements et de leurs revendications respectives, que celles des tractations entre
responsables syndicaux au sein des « interprofessionnelles ». Quant aux lycéens, on les a invités à
se « mobiliser » (jamais explicitement à la grève) pour les mêmes prétextes que nous. On n’a pas
cherché avec les lycéens qu’on avait pu rencontrer des moyens de provoquer une grève au lycée.
(Recette éprouvée : distribuer, avec des amis, quelques jours avant, voire la veille, du jour où l’on
veut faire grève, des tracts appelant explicitement à la grève pour un jour précis, autant de tracts
qu’il le faudra pour être sûr que la plupart des lycéens soit au courant, propager la rumeur que le
jour J la grève aura lieu ; nul besoin de convoquer avant des assemblées générales ou des réunions
de délégués, nul besoin de permettre à l’administration d’entraver le mouvement avant qu’il ait lieu
; le jour choisi, avec les quelques dizaines qui auront effectivement répondu à l’appel, monter dans
les salles de classe et interrompre les cours. Vous serez très vite plusieurs centaines. Après, à vous
de jouer.) Nous avons pour notre part diffusé deux tracts, dont le premier avait surtout valeur de
contre-discours à la prose démocratique ; le second est intervenu trop tard, quand la grève étudiante
touchait à sa fin. Nous ne pouvons bien sûr nier notre part d’échec, les forces de l’atelier de
lutte n’étant pas suffisantes pour contrecarrer efficacement ce qui se faisait par ailleurs pour provoquer
la « convergence des luttes ».
Nous avons pu cependant rédiger un tract ( tract aux ambitions limitées puisqu’il appelait
seulement à une manifestation commune toutes les catégories qui subissaient les unes après les
autres l’accélération des restructurations capitalistes) avec les salariés de STMicroelectronics, entreprise
en pleine santé financière qui compte un site à Rennes et produit des semi-conducteurs, en
lutte depuis septembre contre la fermeture annoncée de leur site qui doit conduire au licenciement
des 600 salariés (dont 200 intérimaires). Un tract aux ambitions limitées puisqu’il appelait seulement
à une manifestation commune toutes les catégories qui subissaient les unes après les autres
l’accélération des restructurations capitalistes. Même s’il s’agit d’une lutte défensive, pour sauver
des emplois et qui se donne de mauvais prétextes (le risque de « désertification » économique de
la Bretagne, quand c’est plutôt l’économie qui répand le désert, et son refus qui le repeuple), se
disait là aussi le refus d’être déplacés selon les offres de « reclassement » de la direction, notamment
à Grenoble et de servir pour leurs employeurs de cobaye à licenciements boursiers (ainsi leurs
patrons prévoient des restructurations dans de nombreux sites et cherchent à se faire la main, en
commençant par le site de Rennes). Du 18 novembre à début janvier (la séquestration du directeur
et sa libération 24 H plus tard), alors que l’activité a été fortement réduite, les employés ont bloqué
les stocks de semi-conducteurs qu’ils continuaient à produire. Une grande tente militaire, toujours
en place aujourd’hui qu’ils ont jugé ne pas devoir continuer à empêcher la sortie des produits finis
(ils ont fait face à la menace de condamnations en justice), abrite les repas et les discussions collectives
de plusieurs centaines d’employés qui ne se résignent pas. Malgré le caractère indépassable
pour l’instant de cette question de l’emploi, et de la valorisation du travail qu’elle implique, l’intensité
de l’expérience a créé de la communauté parmi les salariés, et une certaine disponibilité vis à
vis de ceux qui viennent les voir. Il était, il est toujours essentiel de les rencontrer, même si ce renforcement
du lien entre les salariés ne s’est pas encore traduit par un renversement du rapport de
force avec la direction de nature à leur permettre d’espérer mieux que de conserver leur emploi.
Mais il n’y eut pas, hors des interventions de délégués STM en AG et de leur participation à
cet manif du 27 Novembre, d’autres moments de partage entre la lutte de ces employés et la contestation
étudiante : sur ce plan, tout reste à construire. Quant aux autres catégories rien n’eut lieu
hors de leurs interventions en AG et des réunions interpro, si ce n’est la participation individuelle
de chômeurs ou de professeurs qui se sont investis dans la grève au même titre que les étudiants.
Ce qu’il nous fallait élaborer et qu’il eût été impossible sans occasionner une dispersion de nos forces,
c’est une transversalité des luttes, non une interprofessionnelle. Par transversalité, il faut entendre
la constitution, par l’approfondissement des rencontres, de positions, de modalités d’action et
d’organisation communes, une manière de comité d’action sans référence à une identité socioprofessionnelle.
Compter sur la collaboration des appareils syndicaux, quand ceux-ci souvent se font
concurrence à l’intérieur de chaque secteur (sans prêcher l’ « unité syndicale », il faut bien reconnaître
le caractère dissolvant de ces luttes au sommet), reproduisent la logique du mouvement
social classique et l’attachement travailliste à sa corporation, ne fait qu’amplifier, sous couvert de «
prudence », l’étrangeté des mondes du travail salarié proprement dit et du travail immatériel. Pour
en finir avec le mythe inhibant de la grève générale, apprenons à reconnaître nos alliés potentiels,
en provoquant les rencontres et les positionnements, prenons méthodiquement pour cible les dispositifs
de séparation qui neutralisent l’amitié et l’inimitié dans l’inconsistance et la révocabilité des
solidarités invocatoires.
suite et fin
Lors de l’avant-dernière journée de grève, l’UNEF proposa sa propre « alternative à la grève
» (suspension dès le lundi 8 décembre, journée « fac morte » avec blocage le 11, élaboration
conjointe par l’UNEF et le SNES SUP, syndicat des professeurs de l’enseignement supérieur, de
contre-réformes à négocier avec le ministre). Les syndiqués UNEF présents à la tribune de l’AG,
comme à tant d’autres reprises, omirent de mentionner la prosposition qui leur avait été soumise
de reconduire la grève jusqu’à lundi, ne laissant d’autre choix qu’entre leur projet et la poursuite
jusqu’au 13 décembre (journée de manifestation européenne des étudiants). La suspension fut
adoptée par l’AG. Quelques étudiants, pas du tout convaincus de l’intelligence stratégique de ce
qui qui se présentait comme une tentative de sauver le mouvement, ignorant qu’un tel plan devait
être soumis au vote, appelèrent à une réunion le lendemain pour contrecarrer les effets de cette
manœuvre. Une bonne centaine d’étudiants répondit à l’appel. Les syndicalistes UNEF présents y
furent fort malmenés. Prenant le prétexte d’une altercation un peu vive avec l’un d’entre nous, ils
réussirent, en quittant en bloc l’assemblée, à provoquer sa suspension. Ils partirent donc en emmenant
avec eux les plus tièdes, ceux qui se sentaient compromis par le succès du « sauvetage » du
mouvement chez les anti-grévistes, et ceux qu’un conflit ouvert de tendances effrayait. Le débat
entre la cinquantaine qui restait put commencer : il y fut assez vite admis qu’on proposerait à l’AG
la reprise de la grève dès lundi, le remplacement des commissions par des ateliers, le remplacement
du comité de grève par une assemblée de grévistes décisionnelle. Le lundi, beaucoup de ceux qui
avaient été là n’y croyaient déjà plus : à l’AG de quelques quatre cents personnes, on n’osa proposer
que le remplacement des commissions par des ateliers, qui fut une nouvelle fois repoussée, cette
fois-ci à une faible majorité. La reprise de la grève serait proposée jeudi et l’assemblée de grévistes
serait suspendue à la reprise ou non de la grève. Le lendemain mardi fut affiché l’appel « pour une
grève humaine ». Mercredi soir, les grévistes se préparaient à la journée « fac morte » : cadenas,
chaînes, tables et chaises pour ceux qui croyaient que de tels moyens suffiraient pour empêcher la
tenue des cours (la Présidence avait affiché quelques jours plus tôt sa satisfaction de voir les cours
reprendre et assurait qu’une nouvelle journée de grève compromettrait gravement la tenue des examens,
déjà retardés d’un mois, ce qui constituait une menace voilée contre ceux qui chercheraient
à faire déraper le redémarrage de la machine universitaire), glu pour les autres. Pendant la nuit, les
vigiles firent sauter la plupart des barrages et les employés IATOSS ceux qui restaient au petit
matin, et la glu disposée sur un nombre trop restreint de serrures ne suffit pas à empêcher l’entrée
en masse des étudiants. Lors de l’AG du midi, la reprise de la grève (tandis que certains s’employaient,
stupidement, à faire voter le « principe de la grève » pour une reprise « dès que les
conditions seraient réunies ») jusqu’aux vacances fut repoussée. ; la proposition que soit demandée
la démission du président Mouret, pour ses diverses tentatives d’intoxication et d’intimidation
des grévistes, fut également repoussée : on n’en avait pas, après cinq semaines de grève, encore fini
avec le respect des managers.
La « manifestation européenne » du 13 décembre, à 200, fut aux dires de certains de ceux
qui y ont participé la moins terne de toutes, liée qu’elle était au blocage du Colombier, mais aussi à
un certain soulagement d’en finir avec une grève qui n’avait pas conduit à un épuisement, mais à
un tarissement achevé de ses potentialités. La grève avait effectivement cessé d’être désirable, en
secrétant un quotidien qui, s’il était moins triste qu’avant l’interruption du 5 novembre, révélait
l’ampleur de l’échec au regard de l’enthousiasme et de la confiance en ses forces qui caractérisaient,
malgré leur immédiate exploitation démocratique, le mouvement à ses débuts.
Ceux qui n’avaient rien retenu d’une grève qu’ils avaient trouvé pour l’essentiel fort belle,
continuèrent et continuent encore à parier sur la reprise d’une grève similaire pourvu que soit mené
à bien leur travail de « remobilisation » des étudiants. L’UNEF a perdu un certain nombre de voix
aux élections universitaires, et gagné un certain nombre de militants. L’atelier de lutte, qui avait
cherché à approfondir ce qui dans la grève étudiante était déjà de la grève humaine, qui se voulait
une tendance constituée au sein du mouvement pour augmenter les chances de la grève humaine,
a quitté le champ des luttes universitaires, s’est dissous en tant que tendance pour se fonder en force
autonome, participer à laconstitutiondeformesdevie quisoient aussi des formes de lutte.
SURPRISE - PARTIE : VERS LA GREVE HUMAINE
Il reste que si dans cette lutte la logique du mouvement social classique a dominéjusqu’à
sonterme, elle n’a pu le faire qu’en combattant sciemment les éléments de déprise des rôles, des
identités, des rapports d’hostilité, dont la grève n’était pas exempte. Ce faisant, cette logique s’est
appauvrie au point de ne pas même nécessiter un épuisement pour s’achever. Les rapports d’hostilité
se sont renforcés (on ne parle plus de grève, ni de politique à Villejean, et chacun est retourné
à son cursus) au point d’apparaître, de manière évidente ou confuse, par de nombreux grévistes
comme le centre de ce qu’il faut attaquer. Si une grève étudiante devait reprendre à l’identique dans
les semaines qui viennent à Villejean, elle ne tiendrait pas trois jours. Le seul mouvement possible
aujourd’hui, c’est une vaste propagation de grève humaine. Il s’agirait d’opérer, conjointement, l’interruption
du cours normal des flux humains et matériels qui font l’université et l’expérimentation
de formes de partage et d’élaboration collective de savoirs, d’expériences et de désirs. Il s’agirait de
provoquer une vague de rencontres, qui désagrègerait les rapports normés qu’entretient l’individu
à la condition étudiante et provoquerait l’agrégation des dispositions nouvelles aux flux d’affects en
circulation. Ceci, en d’autres termes, se résume assez bien par la formule : d’un côté, nous voulons
vivre le communisme ; de l’autre, nous voulons répandre l’anarchie. Vivre le communisme, répandre
l’anarchie, c’est, par exemple, avec ceux qu’on rencontre, redécorer la fac, préparer un repas
pris en commun, mettre en place une zone de gratuité, danser, s’aimer, s’enivrer, planter un jardin
potager, interrompre un cours, s’entretenir longtemps de Rimbaud, de l’Argentine ou d’Haïti, de
l’art de faire les crêpes et de griller les transports en commun... C’est aussi cesser de vouloir à tout
prix être à la hauteur d’identités socialement construites qui sont comme autant d’injonctions morales,
à être un étudiant cool et cultivé, un homme riche à l’épaule solide, une maîtresse sexy et une
mère aimante, un honnête travailleur. C’est se rendre attentifs aux désirs qui nous traversent. C’est
aussi perdre le respect et la politesse envers ceux qui n’ont rien à partager avec nous, et plus largement,
substituer au respect et à la politesse, l’attention à ce qui nous attache et nous détache, aux
processus qui fondent l’amitié et l’inimitié, se tenir à la hauteur du conflit, présents à la situation.
Nous avons tout notre temps.
Commencer la propagation de grève humaine dans et contre une institution n’est pas la simple
« radicalisation » d’un mouvement social, au sens où celle-ci pourrait s’identifier dans des faits
isolés, le désaveu des leaders syndicaux, des heurts lors d’une manifestation, la séquestration d’un
bureaucrate, l’occupation de « lieux symboliques »... Elle impliquerait avant tout une logique de
sécession : chercher à dissoudre l’institution plutôt que de chercher le dialogue ou même le conflit
avec ses gestionnaires du moment, ministres, managers. Ne plus déterminer la constitution du lien
communautaire par la nécessité de réagir à une attaque, n’en plus faire un moyen mais un processus
valable pour lui-même, chercher à échapper au regard et aux critères de rationalité définis par
la démocratie et ses employés. Briser la médiation démocratique et capitaliste entre nous et nos
moyens de subsistance, dont l’appropriation et la maîtrise sont les conditions du jeu. Penser ainsi
les moyens d’échapper ensemble au salariat, rendre impossible le retour à la normale, faire persister
l’expérimentation au delà du retour périodique des mouvements et de leur prévisible effondrement.
Cela passera certainement dans l’avenir par l’ouverture de maisons du peuple, rappelant ces
lieux constitués par le mouvement ouvrier à la fin du XIXe siècle pour tisser les solidarités entre les
luttes qui agitaient les divers métiers, luttes qui avaient pour ennemi commun la classe bourgeoise
et qui cherchaient à s’agréger dans la constitution d’organes de lutte révolutionnaire (les premiers
syndicats) de la classe ouvrière. Les maisons du peuple étaient ce lieu où l’on pouvait se rencontrer
hors du travail, échanger des expériences, des informations et des savoirs, faire consister l’invocatoire
prolétariat hors des moments de guerre sociale ouverte. Aujourd’hui qu’on ne peut plus rien
attendre de ce qui reste des maisons du peuple (une triste juxtaposition de locaux syndicaux), qu’il
est devenu impensable et même nuisible de vouloir agréger des luttes corporatistes qui ne peuvent
plus réaliser cette agrégation que par le biais des intersyndicales et en respectant le consensus
démocratique, il faut envisager l’ouverture de telles maisons comme une tentative de communisation
des diverses expressions du refus, qu’elles viennent du salariat classique, de la production
immatérielle et du précariat, des zones d’autonomie qui cherchent à abolir en elles les rapports de
production, des populations inadaptées et /ou inadaptables qui peuplent les métropoles contemporaines.
La propagation de grève humaine aboutirait certainement à l’ouverture de telles maisons,
achetées, louées ou squattées, selon les moyens en présence et la tactique choisie, au sein des institutions
en dissolution ou hors de ces lieux désertés, où l’on chercherait à centraliser les informations,
provoquer les rencontres et rendre effectives les solidarités. Il s’agirait également d’y mettre
en place l’université sauvage : ne plus être dépendant d’institutions qui monnaient et mettent au
travail notre désir d’apprendre et de transmettre, en finir avec la capitalisation individuelle des
savoirs : faire communiquer ces savoirs pour qu’ils trouvent toute leur place dans nos savoir-vivre,
dans nos savoir-lutter.
Le communisme est à tout moment possible.
Vous trouverez dans le .pdf tracts, affiches, documents...
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (663.9 kio)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (675 kio)