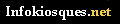D
Dans la Google du loup
Reportage au coeur de la Silicon Valley
mis en ligne le 4 janvier 2017 - Alexis Dubrasier , Emilien
« Dans la Vallée j’ai pu entendre les échos.
Dans la Vallée des chants de guerre près des tombeaux. »
« La tribu de Dana », Manau, boys band celtique
Shoreline Park. Une esquisse de marais, de la vase, des herbes pâles, un ersatz de Vendée parcouru par des eaux stagnantes, des poussettes, des vélos multicolores. C’est moche et c’est touchant, cette petite langue verdâtre entre un éclat d’océan et un désert, entre l’onde amère de la baie de San Francisco et le noyau physique du monde virtuel, le campus de Google, qui commence à une centaine de mètres.
Elle serait là, tout autour. The Silicon Valley.
Il faut atterrir ici, à Mountain View, au bord de l’eau, avec les canards, les hérons et les chouettes des terriers, sur cet ancien site d’enfouissement d’ordures qui accueille désormais des pélicans et un golf 18 trous. Il faut s’être égaré au début d’un printemps, sous un ciel bêtement bleu, dans la mollesse d’un parc ornithologique de Californie, pour la ressentir, cette question éphémère, illusoire.
La Silicon Valley existe-t-elle ?
Il y a bien le flux, son épaisseur quotidienne, sur la One-O-One, l’autoroute qui descend de San Francisco. Puis des bretelles s’en vont vers Menlo Park, Mountain View, Sunnyvale, les voitures s’éparpillent à faible allure dans les avenues boisées de Palo Alto, se dispersent dans les allées à angle droit, banlieue feutrée ou cimetière climatisé, des pavillons et des arbres. Il y a parfois un parking et, par accident, on aperçoit les verres teintés d’une façade d’immeuble. On finit par deviner les bâtiments dans l’ombre, les bureaux discrets, pareils à des lycées, peut-être des petites cliniques. Rien ne dépasse, rien n’intimide. Aucune puissance visible. Ce n’est donc pas une vallée de vertiges et de démesure – non, en surface, le sommet du monde numérique paraît stupidement plat et ordinaire. Après tout, Google est une page blanche.
Il y a un pouce sur un panneau gris, au siège de Facebook, à Menlo Park. On peut incruster sa tête sur une photo à bout de bras. On peut aussi tenter de s’approcher et se faire jeter du parking en cinq minutes par des vigiles parano. Il y a une pomme, à Cupertino. On peut poireauter dans la laideur, mais pas visiter le siège d’Apple. Sinon, il y a une boutique.
À Mountain View, il y a des bicyclettes sur leur béquille à l’entrée des herbes hautes de Shoreline Park. Le guidon est bleu, la fourche rouge, le cadre jaune, les pare-boue verts. C’est sans doute cool, inoffensif, des vélos en libre accès. Mais ce n’est pas seulement ça. Ces vélos délimitent autre chose qu’un territoire. Dispersés sur les trottoirs des environs, ils véhiculent une image, sa fiction. Ils sont, parmi d’autres, le message d’une société. La société Google, sans cadenas, innocente et gratuite.
À côté d’une piscine de balles bleues-rouges-jaunes-vertes s’étend la moquette soyeuse d’un mini golf de bureau, au milieu du visitor center, la vitrine dans laquelle Google vous accueille. Il y a là une citation de Lao Tseu, un fauteuil massant, des robots couverts de tags et des bureaux témoins truffés de post-it fluo. « Comment Street View a changé nos vies », annonce un panneau jurant qu’à Pompéi les « visites dans le monde réel » ont augmenté de 30% depuis qu’il est possible de se promener parmi les corps pétrifiés sans bouger de son canap’. Sous les photos d’un autre genre de ruines, l’invasif système d’exploration virtuelle est célébré pour avoir « aidé à reconstruire le Japon après le tsunami de 2011 ». En attendant de recevoir les autorisations pour quadriller la Terre avec des drones, Google missionne désormais des équipes à pied pour enregistrer à 360° la nécropole de Gizeh, le Grand Canyon ou les fonds marins.
Abolir les distances. Suspendre le temps. Numériser l’horizon. Grâce à Street View, le passé est en mémoire, les victimes d’un tremblement de terre pourront arpenter les monuments disparus. Google se propose même de rétablir le réseau juste après la catastrophe. « Pour les crises, on a développé un système de ballons à l’hélium qui dérivent au-dessus d’une zone sinistrée [1], précise notre guide. Ainsi les gens peuvent se connecter à Internet malgré tout. »
Notre guide s’appelle Léo [2]. Devant la piscine à balles, il nous assure que « les réunions de brainstorming qui se tiennent à l’intérieur sont plus efficaces ». Face au sourire tendre de Léo, son sourire nettoyé de tout mystère, son tee-shirt « This is what awesome looks like », il semble impossible d’hésiter. Il faut suivre cet ingénieur belge de 27 ans qui nous parle de « switch » et utilise à répétition l’adjectif « stylé ».
Il existe une dimension du réel dans laquelle Léo, en étant Léo, éveille un genre de fascination, jusqu’à devenir l’idole immédiate d’une douzaine de jeunes Français venus visiter la Silicon Valley. « Je les ai rencontrés sur la plage », glisse Léo. Ces visiteurs sont de Strasbourg et n’ont pas encore vingt et un ans, si bien qu’ils ne peuvent pas acheter d’alcool – leur drame quotidien. Mais aujourd’hui, ils sont heureux, ils sont à Google. Depuis six ans, un classement couronne l’entreprise préférée des étudiants du monde entier. Chaque année, Google est le rêve numéro un.
« Il faut avoir un contact pour entrer chez Google, affirme Léo. Le principe, c’est que les gens intelligents connaissent des gens intelligents. » Ici, un stagiaire gagne 6000 dollars par mois, mais ce n’est pas l’argent qui distingue le géant du search. Le mythe se situe au-delà du salaire, au-delà même du travail –c’est justement l’image de son dépassement que Google est parvenu à vendre.
Pour saisir, il faut traverser les espaces, se perdre à côté du terrain de beach-volley. Il faut trouver un peu d’ombre entre les bureaux et observer le devenir yoga d’un morceau de pelouse, l’aisance des shorts et des joggings, le rire des amateurs de frisbee, ce climat Disneyland permanent où rien n’est jamais pénible, où chacun ressemble à une publicité pour yaourts. Il faut admettre cette surenchère perpétuelle de faux besoins, ce vœu d’adolescence prolongée, la présence de toboggans pour glisser entre deux étages et l’existence, dans une salle de jeux, d’une version base-ball du baby-foot.
On peut trouver comique cet acharnement à synthétiser l’entreprise idéale. C’est là sans doute la stratégie de Google, la puissance de son storytelling : montrer l’exemple d’un présent embaumé, en faire une promesse de l’avenir. Cette mystification est profonde, car bien sûr, comme toute société, elle n’est pas seulement une communauté d’ingénieurs et de cadres surpayés. Il y a des larbins aussi. « Chez Google, la différence entre les revenus des chefs et ceux des employés – dans les cuisines par exemple– est proprement inhumaine, détaille Fred Turner, professeur de communication à Stanford [3]. Or, il y a beaucoup de gens dans les cuisines de Google. Aux dernières nouvelles, ils gagnaient 12 dollars l’heure. Ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas avoir d’assurance‑maladie, les compagnies d’assurances la leur refusent avec un salaire pareil. Or, ils travaillent dans l’entreprise la plus riche d’Amérique. »
La baie des cocons
On pourrait l’oublier, mais Google n’a pas dix-huit piges. Née dans un garage, comme toutes les légendes de la Valley, en 1998, la start-up a fleuri après l’explosion de la bulle Internet au début des années 2000. Si la spéculation n’a jamais déserté le secteur technologique, la bulle s’est déplacée, s’est faite existentielle, planant désormais au-dessus des serviteurs de l’empire. « Travailler pour Google, c’est un peu comme habiter encore chez ses parents », confie Léo, dans son duplex, devant un délice de spaghettis sans sauce réchauffés au micro-ondes.
Sur un mur, il a suspendu une carte du monde à la gouache, où l’Afrique est remplie par un éléphant, la Californie par un soleil. Léo a tenté de vivre à San Francisco, « mais le bus, c’est hyper‑long et je n’arrivais pas à bosser pendant le trajet ». Il habite désormais à quelques minutes du siège, dans un quartier somnolant de Menlo Park. Le week-end, il balade parfois le long de la côte son rêve californien : un Combi Volkswagen jaune qui traîne dans un garage et sur son fond d’écran. Sinon, il vient faire ses lessives au boulot : « Pendant que la machine tourne, je grimpe au mur d’escalade dans la salle d’à côté. Certains préfèrent le bowling. J’ai même le temps de faire une dernière voie pendant le séchage. » Avec le temps, il avoue s’être un peu désintéressé des loisirs, de leur abondance. « Quand tu arrives, tu as envie de tout faire tout le temps. Mais avec le temps, c’est moins excitant. C’est comme les resto qui sont tous gratuits. Les premiers mois, tu prends cinq kilos. Les stagiaires mangent comme dix. »
Les salles de gym sont ouvertes jour et nuit. « Tu badges à l’entrée et à la sortie, explique Léo. Si tu restes au moins trente minutes, Google te donne sept dollars. J’y vais souvent, mais je ne fais pas grand‑chose ; je prends mon téléphone, j’en profite pour passer des coups de fil. » Bien sûr, il y a des bugs. « On est allé au ski en groupe cet hiver, et c’était un peu étrange, se souvient Léo. Dans l’hôtel, il n’y avait que des employés de Google. Le soir, dans le hall, tout le monde restait bloqué sur son téléphone ou sa tablette. Personne ne se parlait, il n’y avait pas un bruit. C’était mort. »
Il est nu, Léo. Nu et seul dans le nombril du monde.
La solitude. Depuis des années, la Silicon Valley désire conjurer cette faiblesse originelle, cette fragilité de l’âge numérique. Bien sûr, ce ne sont pas les utilisateurs, c’est-à-dire les clients, qu’il est question d’éloigner des écrans et des gadgets, d’arracher à leur condition individuelle. La transformation vise la classe productive de l’industrie technologique, l’élite des informaticiens et des ingénieurs. C’est la figure du geek/nerd, réputé fragile, solitaire, blafard, qu’il a fallu corriger telle une ligne de code défaillante. En quelques années, les corps ont donc changé, rénovés dans les salles de musculation, purifiés par les soupes bio, relookés en profondeur. Une mise à jour cosmétique et sociale. « Il y a dix ans, le cliché du geek boutonneux tournait à plein régime, confirme Jérôme Marin, correspondant du Monde dans la Baie, rencontré dans un café à la française. Aujourd’hui, on est davantage sur le hipster, des gens sportifs, moins renfermés sur eux-mêmes. Ils veulent désormais vivre à San Francisco, avec tout ce que cela veut dire culturellement. »
La mécanique de rationalisation est double : confisquer à la vie quotidienne le temps perdu dans tout ce qui ne serait pas le travail, mais déguiser cet enfermement sous les traits d’un accomplissement personnel. Vivre mieux, bosser mieux.
Et plus. Sous l’empire d’Internet, des smartphones, des messageries continues, le temps du travail ne s’interrompt jamais vraiment, prolongé jusqu’à l’intime. « La liberté vantée chez Google est évidemment factice, dit Jérôme Marin. Si on te conduit, si on te nourrit, c’est pour que tu bosses plus longtemps. 9 heures à 17 heures, ça n’existe plus. Pareil avec les vacances. Tu es censé pouvoir en prendre autant que tu veux, mais au final ça te conduit juste à ne plus en prendre du tout. C’est très retors. Quand tu disposais de trois semaines, tu les prenais. »
Cyrus Farivar écrit pour Ars Technica, une référence des sites d’info sur les technologies. « Pour percer dans la Silicon Valley, explique-t‑il, il vaut mieux être un homme blanc ayant étudié dans une bonne université et issu d’une bonne famille. En gros, il faut avoir de l’argent. Les entreprises parlent beaucoup de méritocratie, c’est très américain, mais les types de la Silicon Valley sortent de Stanford, pas des bas-fonds d’Oakland. »
Dans son resto « fusion asiatique » préféré, Cyrus nous a accueillis avec un très adapté « Bienvenue dans le futur ». Pour cet expert du business numérique, qui « trouve magique » de commander en ligne des couches pour sa fille, « la Silicon Valley se porte bien, car l’argent coule à flots ». Il n’est pas question pour lui de remettre en cause les bienfaits d’Internet : « Depuis l’invention de l’écriture et l’impression de Gutenberg, rien n’a autant changé la manière dont on vit, dont on pense, dont on échange de l’argent ». Spécialiste de la surveillance et des menaces sur la vie privée, Cyrus ne met pas de photos de sa très jeune fille en ligne. « Je veux qu’elle ait le choix », dit-il. Lui se donne celui de suspendre la connexion. Il parle d’une « solution extrême », c’est-à-dire « éteindre [son] smartphone pendant quelques jours ». Pensif, il ajoute : « Mais je dois le dire à tout le monde, sinon on pense que je suis mort. »
L’addiction numérique est devenue un sujet médiatique depuis qu’il existe des logiciels de blocage du Web et des campings « detox » pour se sevrer d’Internet, depuis que se multiplient les exemples de dirigeants de la Silicon Valley qui éloignent leur famille des écrans [4]. Ce genre de fragments ne suffit pas à décrire l’ampleur de la dépendance, car le monde en cours ne s’interrogera bientôt plus sur une vie réelle qui serait parfois intoxiquée par l’emprise du virtuel. Il ne sera plus question que d’une existence essentiellement numérique dans laquelle un usage du monde sans technologie deviendra chaque jour un peu plus suspect.
S’il se trouve, dans le présent, quelques applications pour se déconnecter temporairement, il s’en crée surtout une infinité pour recouvrir la surface entière de la réalité. C’est dorénavant l’essence des investissements et de la recherche dans la Valley : traquer chacun des gestes sociaux, domestiques, intimes, puis en imaginer la traduction numérique la plus efficace et rentable. Des exemples récents ont montré l’effrayante rapidité avec laquelle il est possible de redimensionner l’information (Twitter), le sexe (Tinder) ou bouleverser en profondeur des secteurs comme le livre (Amazon), l’hôtellerie (Airbnb) ou le transport (Uber).
« Le futur commence ici »
À Mountain View, au siège de Google, au milieu d’une allée qui fraye entre des ensembles aux vitres noires, il y a un aileron de requin en métal poli. Il doit faire trois mètres de haut. Sur sa page « philosophie », l’esprit de Google est développé en « dix principes fondamentaux ». Le sixième est une confidence insolite : « Il est possible de gagner de l’argent sans livrer son âme au diable. » L’entreprise, avec sa devise « Don’t be evil », s’amuse régulièrement de sa part d’ombre. « Notre politique sur bien des points consiste à flirter avec la limite de l’acceptable sans jamais la franchir », expliquait l’ex-PDG Eric Schmidt en 2010 [5].
L’acceptable, voilà la nature de Google. Non pas flirter avec, mais fixer la limite, en monopoliser la définition. En 1998, les cofondateurs traçaient une ligne de démarcation bien nette entre leur jeune algorithme et leurs concurrents [6] : « Il faut s’attendre à ce que les moteurs de recherche financés par la publicité fassent preuve de partialité en faveur des annonceurs et au détriment des besoins du consommateur. » Dix-sept ans plus tard, 90% des revenus de Google proviennent de la publicité. La société la plus rentable du monde a trouvé le produit idéal, celui qui se fabrique chaque jour de lui-même. Nous sommes la marchandise consentante que Google vend « sans livrer son âme au diable ». « Nous ne monétisons pas ce que nous avons créé, atteste Andy Rubin, un ancien haut dirigeant [7]. Nous monétisons les individus qui en font usage. Plus les gens se servent de nos produits, plus nous avons l’occasion de les exposer à la publicité. »
Google est déjà le péage du Web. Ce que désire désormais le géant californien, c’est construire la route. « Je suis convaincu que la majorité des gens n’attendent pas seulement que Google réponde à leurs questions, déclarait Eric Schmidt en 2010. Ils veulent également qu’on leur dise ce qu’ils doivent faire [8] ».
Le futur. Dans le centre verni de Palo Alto, sur les terres souveraines du capital-risque, réside un think tank au nom sidéral : Institute For The Future. « Une bonne science-fiction n’est pas une fiction, mais une prophétie », avait affirmé Cyrus Farivar en nous conseillant de venir ici. Un homme nous attend. Dans une pièce sans fenêtre, il nous parle, écrit des mots sur des feuilles de papier, dessine des flèches qu’il appelle shift, il a les yeux clairs, il invoque sa femme, leur vie de couple, pour illustrer sa leçon. Sean Ness est le business director de l’institut. Un type inquiétant. Brutalement, il se lève de sa chaise pour mimer l’extase d’un pilote de drone, enfoui dans un bunker sécurisé, qui vient de larguer une bombe à 8000 miles. Sean, soudain habité, est debout dans la petite salle de réunion. Il joue le pilote de drone qui célèbre son tir, il dit : « Yeah ! », il tape dans la main d’un autre pilote de drone. « Nous vivons dans un monde étrange », lance-t‑il.
Ce sont des sociologues, des économistes, des philosophes qui, entre ces murs tapissés de concepts écrits au feutre, « regardent le futur depuis 50 ans » [9]. Leur marchandise prophétique, centrée sur les interactions humain-machine, est ensuite refourguée à l’industrie technologique. Parmi les présages de l’Institut du futur, celui-ci, qui concerne le design des villes : « Il va changer, car 80% des voitures vont disparaître. » Plusieurs fois, Sean Ness nous retrace à coups de schémas binaires tracés d’une main excitée le shift à venir de la propriété vers l’accès, symbole d’un « monde meilleur », optimisé par la gestion algorithmique. « Les humains sont la chose la plus difficile, concède cet ancien chimiste. On n’apprend pas de nos erreurs. Nous sommes émotionnels et nous avons d’horribles addictions. » Les progrès en robotique, promet l’institut, arrangeront tout ça : « La question n’est pas : Va-t-on devenir des cyborgs ? La question est : Quel genre de cyborgs voulons-nous être ? » [10].
Face aux temps qui viennent, conclut notre apôtre, « il y a ceux qui subissent et il y a ceux qui s’organisent ». Inutile de préciser que, dans la langue de demain, « ceux qui s’organisent » signifie avant tout « ceux qui décident ». Car bien sûr « le futur commence ici, dans la Silicon Valley », professe Sean Ness.
Il était une foi
Derrière la vanité et l’outrance consistant à se proclamer « le centre du monde », il y a un lieu. Sa frontière est toute proche, à la limite de Palo Alto, à dix minutes à pied. Stanford. Pour résumer l’influence de la prestigieuse université, on peut commencer par dire que la Silicon Valley s’est érigée autour de Stanford, et non l’inverse. Si les racines de l’informatique sont intimement mêlées à celles de l’institution, c’est aussi une histoire culturelle qui s’est écrite ici. Fred Turner raconte dans Aux sources de l’utopie numérique les liaisons californiennes entre la contre-culture et la cybernétique, quand le Laboratoire d’intelligence artificielle de Stanford était, pour le personnage principal de son essai, Stewart Brand, grande figure de la contre-culture et cofondateur du magazine techno-libéral Wired, « la scène la plus vibrionnante que j’ai eu l’occasion de croiser depuis les acid tests des Merry Pranksters ». « Qu’ils le veuillent ou non, les ordinateurs arrivent chez les gens, écrivait Brand en 1972. C’est une bonne nouvelle, la meilleure peut-être depuis les drogues psychédéliques. »
En 1995, le web tourne au 56k quand, toujours à Stanford, un Américain rencontre un Russe. Si leur premier serveur est en Lego et leur degré-LSD proche du néant, Larry Page et Sergey Brin vont réinventer le web. À une époque où Lycos va chercher l’information, Google la trouve. Dans un monde incertain, ce qui s’impose alors, au-delà de toutes les questions que pose le nouveau siècle, c’est que chacune de ces questions aura désormais une réponse. La réponse de Google.
Internet est la plus vaste expérience impliquant la religion dans l’histoire [11]. Il suffit d’Entrée.
Dans la vallée des data
Data. Derrière les écrans noirs, au cœur du sous-bois des machines, il y a un nuage absolu. Un nuage de données, électrique et glacial. Dans cet espace sans limites, nous dressons des cathédrales ensevelies, des pyramides de temps. Nous peuplons des océans d’émotions dupliquées, de sentiments de synthèse. Nous sommes des orgies de chiffres perdues dans l’infini. « Il n’y a pas de réponses, seulement des références croisées », affirmait Norbert Wiener, le père de la cybernétique.
Le nom le plus récent de ce mode de gouvernement est big data. Si la finance a inauguré les prises de décisions algorithmiques, l’expression a été popularisée avec la réélection assistée par supercalculateur du président Twitter Barack Obama en 2012. Depuis qu’Edward Snowden a révélé que la NSA se comporte comme Google, les médias associent régulièrement ces big data à la surveillance électronique, au fichage commercial ainsi qu’aux menaces de « chômage technologique ». « Je vais perdre mon boulot et vous aussi, aperçoit dans le marc de son café le futurologue Sean Ness. Les gens n’auront plus besoin de l’histoire ou de l’esprit, ils ne voudront que les données. »
L’information traverse en continu les frontières du Réseau, pluie d’images toxiques, infinité de mots sans phrases, de miniatures narcissiques, semblant social aussitôt périmé. L’homme connecté se ligote à la quantification, comptant ses pas et ses amis, collectionnant son reflet et ses scores. Nous devenons cet hybride aliéné souriant, cette viande de données tout emballée.
Nous aimerions être autre chose.
Allèle-uia
Avec la croissance de la Silicon Valley, la ville de San José, fief d’eBay et d’Adobe est passée de 100000 habitants après la guerre à plus d’un million aujourd’hui. Dans cette ville propre et fortunée, perdue au fond de la Baie, on peut goûter au devenir-data au Tech Museum of Innovation. « Explore the digital you », promet Body Metrics, une expérience de biométrie « sociale et émotionnelle ». Avec des capteurs dans le dos et sur le front, un « kit sensoriel » autour du cou, il s’agit de visiter ce sanctuaire tech. En fin d’expérience, on pose ses mains sur une table écran et des mesures s’affichent. Des graphiques de couleurs vives livrent leur verdict : sociabilité OK, tempérament contemplatif. OK.
Dans ce musée du futur, jardin d’enfants en forme de réacteur nucléaire, il est aussi possible de disputer une course de fauteuils roulants, de danser devant son image thermique, de bricoler un robot avec des scratches autocollants. On peut aussi défendre la recherche en génétique devant le Sénat américain. Des gosses sont filmés récitant leur discours face à une vidéo d’archive. On y voit de vieux hommes en cravate qui applaudissent. Ils sont assis. Probable qu’ils sont déjà morts.
Plus loin, au centre du musée, une femme attire les regards. Elle est nue sur fond noir. Cette statue lascive de métal froid est habillée de lignes de code génétique couleur or. Au-dessus de son visage sans regard défile un texte bleu qui ressemble à des informations boursières. Une phrase apparaît : « Google wants to store your genome [12] ».
« Chez Google, peut-on lire dans la communication du groupe [13], nous avons la conviction qu’il est possible de rendre le monde meilleur grâce à la technologie. C’est, en quelque sorte, dans nos gènes. »
Il y a un an, 23andMe a organisé ici un concours de « l’image génétique ». Cette entreprise de biotechnologie basée à Mountain View s’est fait connaître avec le brevet d’un système qui permet aux parents de configurer leur futur bambin en triant les donneurs de sperme ou d’ovule à partir de leur profil ADN. Si cette porte ouverte sur Gattaca s’est refermée aussitôt, 23andMe a déjà réalisé le génotype par analyse salivaire de près d’un million de ses clients. Cette cartographie du vivant a débuté en 2007, quelques mois après le mariage de la PDG, Anne Wojcicki, avec un certain Sergey Brin, le cofondateur de Google.
D’après son expertise génétique, le mari de Mme Wojcicki présente un risque élevé de maladie de Parkinson. « Quand l’on regarde notre propre code, notre ADN, dit-il, on se rend compte que cela représente 600 mégabits compressés. Notre système d’exploitation (OS), celui qui permet par exemple de faire démarrer notre cerveau, est donc plus petit que n’importe quel OS moderne, plus petit que Linux ou Windows ou n’importe quoi du même genre. Et nos algorithmes personnels de programmation ne sont sans doute pas bien compliqués à décoder. » Sergey Brin, qui veut faire de Google « le troisième hémisphère de [notre] cerveau [14] », dirige Google X, la cellule innovation de la firme, celle qui développe les voitures sans conducteur (Google Car), les lunettes de réalité augmentée (Google Glass), la livraison par drone (Google Wing), mais aussi des lentilles de contact capables de mesurer la glycémie ou des nanoparticules aptes à identifier les cancers. Depuis 2013, Google a acquis des dizaines d’entreprises de robotique.
Un moteur de recherche célèbre référence tout cela.
À côté de l’aileron de requin, au siège de Google à Mountain View, à l’opposé du terrain de beach-volley, il y a un squelette de T-Rex. Un démon fossile parmi la foule des modernes, un témoin en résine face à la métamorphose de l’espèce. La grande référence de Sergey Brin n’est pas Jurassic Park. C’est Kubrick. Dans 2001, l’Odyssée de l’espace, le vaisseau Discovery One est piloté par une intelligence artificielle, HAL 9000. « Il avait beaucoup d’informations disponibles, il pouvait les rassembler, les rendre intelligibles, raconte Sergey Brin. Heureusement, il n’y aura jamais de bug comme celui qui fait que HAL tue les occupants du vaisseau. Mais HAL, c’est ça que nous recherchons. Et je pense que nous avons accompli une partie du chemin vers ça. [15] » En résumé, « l’intelligence artificielle sera la version ultime de Google [16] », annonce depuis quinze ans Larry Page.
Nous qui ne faisons pas confiance à HAL, mais alors pas du tout, nous n’avons pas réussi à supporter longtemps cet abîme. Nous avons vite fui la Silicon Valley.
À Palo Alto, au moment de partir, une voix nous arrête. Une voix chaleureuse. Impossible de ne pas se retourner. C’est une jeune fille avec de longs cheveux noirs et un piercing au nez. Elle sourit.
« Je vous fais visiter ? »
Elle s’approche en oscillant des épaules. Il faut un moment pour s’habituer. Accepter cette fille décapitée. Son corps est machine ; deux grandes barres parallèles en plastique descendent à hauteur de ses épaules jusqu’à un socle à roulettes. Son visage est enfermé dans un écran. Elle nous accompagne dans une sorte de boutique [17].
« Ou êtes-vous ?
– Je suis à Fremont, chez moi. Je fais tout depuis mon ordinateur. Le matin, j’ouvre les portes du magasin. J’allume les lumières. »
Elle rigole, tourne la tête, enfin, l’écran, vers les murs où patientent une dizaine de ses semblables. L’une des machines finit par se réveiller. Un homme apparaît avec un bouc et une tête de mort sur son tee-shirt. Son supérieur. Il roule vers la vendeuse, s’arrête à vingt centimètres d’elle. Les deux robots se font face, fantômes numériques qui dialoguent.
Il me plaît à imaginer (le plus tôt sera le mieux !)
une prairie cybernétique où mammifères et ordinateurs
cohabiteraient harmonieusement dans une programmation mutuelle
comme de l’eau pure dans un ciel pur.Il me plaît à imaginer (tout de suite, s’il vous plaît !)
une forêt cybernétique de pins et d’électronique
où les cerfs gambaderaient parmi les ordinateurs
comme parmi des fleurs aux cœurs tourbillonnantsIl me plaît à imaginer (il faut qu’elle existe !)
une écologie cybernétique où nous serons libres de tout travail
et retournés à la nature, réunis à nos frères et sœurs mammifères,
sous la haute surveillance de machines pleines d’amour et de grâce [18]Richard Brautigan (1967),
poète et grande figure de la contre-culture de San Francisco
[1] Projet Loon.
[2] Contacté sur un site de couchsurfing, Léo nous a hébergés chez lui pour une nuit, nous invitant à une inoubliable séance d’escalade dans une salle de sport de Sunnyvale.
[3] Fred Turner, « Google, Uber et l’idéologie de la Silicon Valley en treize mots », Rue89, 21 décembre 2014.
[4] Guillemette Faure, « Ces branchés qui débranchent », Le Monde, 27 avril 2012 ; Celia Izoard, « Les joujoux des pauvres », CQFD n°130, mars 2015.
[5] Washington Ideas Forum, 1er octobre 2010.
[6] Larry Page & Sergey Brin, thèse à l’université de Stanford, 1998.
[7] Steven Levy, « In The Plex : HowGoogle Thinks, Works, and Shapes Our Lives », Steven Levy, p.229, 2014.
[8] Eric Schmidt, The Wall Street Journal, 14 août 2010.
[9] En 2009, pour son premier numéro, Z avait consacré une longue enquête aux laboratoires d’acceptabilité sociale, chargés d’anticiper les réticences sociales aux innovations. Nul doute que l’Institute for the Future fonctionne sur le même modèle, avec pour première ambition de « nous faire avaler la pilule » des technologies.
[10] « Human+Machine Futures in Full Color : Extending Our Senses and Ourselves », IFTF, 2015.
[11] Dans son manuel du futur à l’usage du pouvoir, The New Digital Age (2013), signé par Eric Schmidt et Jared Cohen, Google prétend qu’Internet « est la plus vaste expérience impliquant l’anarchie dans l’histoire » car « le monde en ligne n’est pas véritablement limité par des lois terrestres ».
[12] Pour 25 dollars par an, Google nous propose littéralement de stocker notre génome dans son cloud.
[13] « Google Impact Awards : Un grand geste solidaire ».
[14] « Sergey Brin : We Want Google to Be the Third Half of Your Brain », Business Insider, 8 septembre 2010.
[15] « Google : The Search Engine That Could », PBS Newshour, novembre 2002.
[16] « Making the World’s Information Accessible », entretien avec Larry Page et Sergey Brin, Achievement Academy, octobre 2000.
[17] Les BeamPro, utilisés par exemple par Edward Snowden, sont fabriqués par Suitable Technologies.
[18] Richard Brautigan, « Sous la haute surveillance de machines pleines de grâce », 1969.
Texte paru initialement en 2015 dans le n°9 de la revue Z.
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (6.6 Mio)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (3.9 Mio)