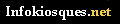A
Aigu... agressif... foudroyant...
mis en ligne le 24 novembre 2017 - Anonyme
L’histoire que je raconte ici est la mienne. Mon récit subjectif et partiel. D’autres personnes l’ont traversée avec moi – et je vais m’efforcer ici de ne pas parler d’elles – car c’est mon choix de m’exposer, et non le leur. Bien sûr, toute cette histoire n’aurait pas été la même sans elles.
Apprendre à dealer avec la mort
Comme pas mal de gosses, j’ai été tenu à l’écart de la mort. Trop jeune. Alors il valait mieux me dissimuler les problèmes des proches, éviter de m’emmener au chevet des malades, m’interdire les cérémonies et les enterrements. Pas de son âge. Alors la mort reste ce truc lointain, conceptuel, un peu vague ; radicalement déconnecté du quotidien. Des morts traversent mon histoire de vie, bien sûr, mais des morts brutales, accidents et suicides, de celles qu’on n’a pas eu le temps de voir venir – et il ne nous reste plus qu’à faire avec une situation déjà passée. Ou de celles qui semblent dans la logique des choses, au bout d’une maladie, d’un lent déclin, d’une vieillesse à laquelle on a eu le temps de se faire. Des morts plus lointaines, de celles où je peux toujours me cacher derrière l’idée que d’autres sont plus proches que moi. Être présent au quotidien, croiser le regard de celui qui se sent condamné, essayer de lui apporter tout le soutien dont je suis capable, accompagner du mieux que je peux celles et ceux qui sont autour, mettre cette fin de vie en haut de mes priorités, regarder mourir une des personnes qui m’est le plus cher au monde – tout cela était une première fois pour moi.
Tout commence avec un texto. Un texto qui dit : CANCER. Je lâche mon verre, m’effondre, je pleure. Je te savais à l’hôpital pour des examens et un problème au poumon. Je savais aussi que depuis des années tu traînais des problèmes chroniques à l’estomac. Les choses se relient enfin. Tout juste le temps d’envoyer un camarade me chercher une bouteille de whisky, et puis je m’y mets. Faire l’autruche, ne pas y penser, ne pas en parler, tergiverser : « j’y vais ? j’y vais pas ? est-ce le bon moment ? est-ce que c’est plus tard ? est-ce que c’est trop tôt ? y a-t-il besoin de moi ? est-ce que ma présence apporte quelque chose ? ». Besoin de signes explicites, une demande claire : dis-moi que tu veux que je vienne sinon je n’arriverai pas à prendre la décision. Trop peur de l’impuissance. De ne pas t’être utile.
Premier trajet vers chez toi. Le temps de faire un peu de distraction - il paraît clair que tu attends ça de moi. On parle pas de ce cancer qui te ronge l’estomac, on essaye de l’oublier, on prend un peu de bon temps, une excursion dans la montagne enneigée, et puis je rentre chez moi. Une semaine à peine et déjà ça se dégrade. Ça sent pas bon. Ça va beaucoup plus vite que je pensais. Te voilà hospitalisé à nouveau – et ce silence des médecins qui fait tellement flipper. Je sais pas quoi faire. Je pensais avoir le temps de m’organiser, planifier mes aller-retour, pouvoir concilier ma vie à moi et ma présence à tes côtés. Ça va trop vite et déjà je sens que tu ne seras plus là longtemps. Multi-bug. J’ai trop peur de la mort, je me sens pas les épaules, je suis trop proche de toi, je suis pas sûr de pouvoir gérer ça ; putain je suis trop jeune. J’ai peur que tu ne ressortes jamais de l’hôpital. J’arrive pas à penser à autre chose, je me mets la race tous les soirs, je ne dors plus et puis après quelques jours à tourner en rond dans mon bocal tout devient clair : je déménage. Je serai là jusqu’à la fin. Parce que je suis incapable d’être ailleurs.
Premier rendez-vous avec ton médecin – sans toi puisque tu es à l’hosto. Diagnostic implacable. Intuition confirmée : « cancer AIGU, AGRESSIF, FOUDROYANT » (termes médicaux). Aucun espoir de rémission. Espérance de vie : 1 à 2 mois sans chimio, 2 à 3 mois avec. Ce diagnostic que j’entends, personne ne te l’a annoncé. Le généraliste n’est pas responsable, c’est au médecin de l’hôpital de le faire. Le médecin de l’hôpital ne veut pas le faire, car lui est là pour gérer un problème annexe dans le poumon et non pas le cancer. Le gastro-entérologue qui est censé s’occuper du cancer ne se sent pas concerné tant que tu n’es pas sorti de l’hôpital. Et toi tu me parles de la chimio qui doit commencer dès que le problème du poumon sera réglé. Est-ce que je dois te mentir ? Est-ce que je dois faire oui de la tête ? Est-ce que je dois changer de sujet ? Ou dire la vérité, c’est-à-dire que la chimio est pensée uniquement comme palliative. C’est à dire tenter de soulager un peu la douleur, te donner quelques semaines de délai, au mieux. Mon éthique me dit qu’on a besoin d’informations pour avoir du pouvoir sur nos vies, pour pouvoir faire des choix dans la marge qui nous reste, aussi merdique soit-elle. Je choisis la vérité du moins jusque là où je peux sans m’effondrer.
On parle peu. Les mots manquent. Assez vite tu évoques le fait que tu ne veux pas mourir à l’hôpital – et que tu veux pouvoir choisir ta mort. Aussi vite je m’engage à t’accompagner sur ce chemin du suicide.
Sortie de l’hôpital au bout de quelques semaines – retour chez toi. J’essaie d’accompagner le quotidien, d’alléger du plus que je peux, d’être attentif à tes demandes. Toi tu es tourné vers ce que tu vas laisser, tu prépares des clés USB pleines des souvenirs que tu veux partager – et tu cherches les moments de répit. Tu veux régler des questions matérielles, des questions de fric, de succession – des trucs dont je me fous éperdument mais que je choisis d’écouter, car c’est ce qui est devenu important à tes yeux. Une session de 3 semaines de chimio débute – et te massacre. Tu refuseras la suivante. Je fais cuisinier, chauffeur, confident, partenaire de distractions, assistant médical, accompagnateur de ton testament officieux, interface entre toi et les autres – jusque-là où la route s’arrête. Jusqu’au moment de ta mort, par suicide, ma main posée sur la tienne. À chaque étape je me suis demandé si j’aurai le courage de t’accompagner à la suivante. À chaque étape j’ai trouvé plus de force que je n’aurais pensé en avoir. De la force que j’ai tirée de toi, principalement, et de cette confiance que tu as placée en moi.
Je traverse tout ça au milieu de ma structure famille. Celle que j’ai désertée il y a 10 ans. Je dois capter ma place, trouver ma place, négocier ma place. Celle qu’on me donne, celle que tu souhaites que je prenne, sans avoir toujours les mots pour le dire, celle que je me sens capable d’occuper. On me dit que c’est moi qui suis légitime avec mon frère à rencontrer les médecins. Je sais pas d’où vient cette légitimité. Le sang ? La filiation ? Je veux pas d’une légitimité octroyée par le livret de famille ou l’état civil. Je veux du choix. Tes choix. Naviguer dans les complexités, les tensions, les non-dits, dealer avec ma transition qui n’a jamais été parlée dans l’espace familial, l’évidence d’une cohésion familiale que je ne comprends pas toujours, la place de tes histoires d’amitiés, d’amour que je ne connais pas.
La situation est tellement merdique, et en même temps je suis conscient d’avoir une position privilégiée, parce que j’ai ce lien avec toi, parce que nous savons partager, parce que tu peux me demander et que cela me permet de lutter contre l’impuissance. J’ai envie d’être un soutien pour les autres, prendre soin d’elleux ; mais c’est tellement d’énergie déjà d’être auprès de toi. Je découvre la solitude, la sérénité que je trouve dans mon silence. Je vais courir au bord de l’eau, marcher, faire du vélo. Je me sens tellement vivant. Je me fabrique une stratégie : clairement tu es le centre de mon attention, mais je sais que je dois prendre soin de moi si je veux tenir pour toi. Alors j’apprends, et je me découvre des ressources insoupçonnées. J’ai l’impression de n’avoir jamais été aussi ancré dans le présent, aussi centré, droit dans mes pompes. Je sais pourquoi je suis là et j’ai cette certitude : je fais du mieux que je peux. Ça me donne une force incroyable.
Ton corps livré à la médecine
À l’hôpital ton corps est promené d’une chambre à l’autre, changeant de service sans explication, passant de mains en mains puisque la rotation des équipes ne permet pas de se familiariser avec les soignantEs. Même tes médicaments, leur posologie, leur mode d’administration changent régulièrement, sans explication. Jusque-là tu prenais les cachetons avant le repas, maintenant c’est après, pourtant ce sont les mêmes – ah non attends il y en a un de plus qu’hier non ? Ici à l’hôpital les corps sont administrés, gérés, optimisés. Aujourd’hui on t’as mis une sonde urinaire. Ils ont dit que c’était plus pratique. Depuis tu as mal. Quand c’est pas ça c’est autre chose. Tu es ici pour régler un problème d’eau dans le poumon. Donc, puisque tout est bien compartimenté, personne ne semble au courant de ton cancer de l’estomac. L’infirmière ne comprend pas pourquoi tu bouffes rien. Est ce que tu es un peu déprimé ? Ce drainage du poumon n’est pourtant qu’une intervention bénigne, tu seras bientôt sur pied... La veille de ta sortie, le médecin brandit la radio et déclare : « je suis optimiste ». Il sait pourtant que tu es condamné, mais sa responsabilité à lui c’est le poumon, et le poumon va mieux. Peu importe ce qui te ronge le corps, tant que tu ne vas pas mourir dans son service (mauvais pour leurs statistiques ça). Ça fait 3 fois que l’aide-soignant vient pour récupérer ton plateau-repas – et tu lui donnes alors que tu n’as pas fini. Lui ne sait pas que pour toi réussir à bouffer est un combat. C’est juste que ça colle pas avec le planning. La nuit dernière, les infirmières t’ont réveillé 4 fois, pour prendre ta tension, te donner des médicaments, te faire faire une inhalation (ça débouche le nez tu dormiras mieux après...). Je rêve de luttes collectives, que l’isolement des chambres soit rompu, d’AG de patientEs, d’émeutes hospitalières, de groupes de proches qui séquestrent les médecins pendant que les malades foutent le feu à toutes ces putains de machines.
On dirait que la position des médecins est d’en dire le moins possible. Partant de l’idée que si vraiment tu veux savoir, ben t’as qu’à poser la question plus clairement. Quand j’appelle le putain de spécialiste qui te suit pour le poumon, il m’explique qu’il est hors de question qu’il t’annonce ce diagnostic. Il s’énerve, se vexe du fait que je me permette de remettre en question sa toute puissance : « Il est foutu votre papa. C’est ça que vous voulez que je lui dise ? Que les carottes sont cuites ? Je trouve cela bien cruel de votre part. De quel droit pensez-vous qu’on doive lui enlever tout espoir ? » (termes médicaux). Jamais je n’ai eu à ce point l’envie de tabasser quelqu’unE. En même temps la conscience que sa toute puissance est effective : il a tout le pouvoir ici, et il est bien capable de te faire payer pour mon impudence. Alors je ravale et je brosse dans le sens du poil.
Depuis l’annonce du cancer, les médecins parlent de chimio, comme le seul horizon possible. Mais l’étau se resserre et maintenant il est clair qu’il n’y a pas d’espoir de guérison. Pourtant cela ne change rien – évidence est faite que dès que possible tu iras en chimio. Pour quoi ? Gagner du temps y disent. Du temps, OK, mais avec quelle qualité de vie ? Quand je lui pose cette question, ton généraliste ne me répond pas. Leur boulot aux médecins, c’est d’appliquer le protocole. Cancer = chimio, point. Leur boulot n’est pas de discuter avec toi, capter ce que tu veux, qu’est-ce qui t’est important ; ni de te dire précisément ce qu’ils savent de ce traitement et de comment il risque de te ravager – leur boulot n’est pas de t’accompagner à faire un choix, ça non. J’imagine que je suis la seule personne à t’avoir posé cette question : est-ce que tu veux faire une chimio ? Tu choisis de tenter le coup, espoir d’une stabilisation, d’un peu de répit, avec quelles données pour prendre une décision ? « Il peut y avoir des effets secondaires indésirables, mais c’est très variable d’une personne à l’autre », voilà l’information éclairée que t’aura donnée le gastro-entérologue.
Quelques jours plus tard, c’est moi qui te lirai la notice de ce putain de traitement. La liste des effets secondaires fréquents fait 3 pages : nausées, diarrhées, dégoût, perte de l’appétit, vertiges, troubles de la vue, tremblements, bouffées de chaleur, froid, mycoses, démangeaisons, éruptions cutanées, migraines, déprime, insomnie, etc. Je me creuse la tête pour essayer de trouver une chose désagréable qui ne fasse pas partie de cette liste. Cette chimio t’a flingué le peu qui te restait. Je ne t’ai jamais vu avec le même « confort » de vie que la veille de démarrer cette saloperie de traitement. Pourtant, le médecin, après que tu lui aies fait la liste de tous tes effets secondaires, continue l’évidence et se lance à programmer le prochain cycle. Quand tu lui dis que tu arrêtes, il te répond : « je vous comprends tout à fait. C’est vrai que c’est beaucoup de désagréments pour aucune amélioration ». Cet enfoiré en est conscient, mais continue de t’entraîner là-dedans. Pourquoi ? Ces gens ne sont pas là pour dealer avec de l’humain, pour parler de la mort, de la fin de vie. Ces gens sont là pour te prescrire et ne veulent surtout pas sortir le nez de leur carnet d’ordonnance. Les gens comme toi ça les fait chier. Celleux qui sont foutuEs. Celleux qu’on ne guérira pas. Ça fait pas partie du job. Le job c’est de soigner. Réparer et passer à autre chose. Et les condamnéEs ça plombe leurs statistiques.
Avoir prise sur sa vie, y compris la fin
Je m’éloigne de mes fantasmes. Moi qui nous avais imaginés en road-trip jusqu’à la fin, je me voyais bien binôme d’une dernière excursion, marcher dans la montagne ou faire ce saut en parachute qui t’a toujours tenté – et pourquoi pas finir en beauté en sautant d’une falaise dans un décor fabuleux ? Ce qui se vit ici c’est tout autre chose. C’est dans ce quotidien banal, ordinaire auquel tu dois te préparer à renoncer, que se déploie notre relation. Ce qui en fait des moments uniques, intenses, c’est simplement de pouvoir les vivre, d’avoir encore cette occasion. Je trouve un réconfort immense dans ta présence. J’ai l’impression qu’on se tient l’un l’autre.
Comment tisser la relation quand se projeter à plus de 4 jours est difficile ? On parcourt les librairies à la recherche de BD qui font partie de notre commun. Dans la dernière boutique, le type dit qu’il peut les commander. Je demande pour quand. 1 semaine. Tu me regardes et me demandes ce que j’en pense. Est-ce que ça vaut le coup ? Seras-tu toujours en vie ? Qu’est ce que j’en sais ? Dois-je faire des pronostics sur ta longévité ? Comment cheminer avec l’imminence de la mort quand on a envie de vivre ? C’est une course contre la montre dans laquelle tu es perdant. Parce que chaque jour tu dois t’adapter à de nouvelles limites, des impossibles, des portes qui se ferment et l’espace de vie qui se restreint. En 3 mois tu as renoncé à la natation et au badminton, puis à la marche intensive puis à la marche tout court, à sortir dans le jardin, à monter l’escalier qui te permet de sortir de chez toi, à t’asseoir sur une chaise, à mettre tes chaussettes tout seul. À te concentrer suffisamment pour faire un jeu quelconque, du plus complexe au plus simple – ou simplement pour avoir une conversation. Et puis à parler parce que le souffle te manque de plus en plus. « Je voudrais juste avoir un moment où je me sente bien, ou au moins pas trop mal ». Ton espoir le voilà, trouver un peu d’énergie, un moment de détente, décoller un peu de là et pourquoi pas oublier quelques instants. Mais les marges se réduisent à vitesse grand V. Ce qui était possible la semaine dernière ne l’est déjà plus.
Tu sors de chimio en vrac. Tu tiens à peine debout... Chez toi il n’y a que des putains de chaises de cuisine, et un canap dont t’es plus capable de ressortir. J’arrive à te convaincre d’aller acheter un fauteuil – et on est là, à tous les essayer dans un dépôt-vente. J’essaie de mettre tout ce que je peux d’humour et de désinvolture, et au moment où on dit au vendeur qu’on va prendre celui-ci, tu figes. Je vois tout ça dans tes yeux, ce désespoir qui n’est pas dicible. Toi, hyperactif, qui n’as jamais posé le cul dans un fauteuil de ta vie – c’est pourtant dans celui-ci que tu vas mourir, un mois et demi plus tard.
D’un coup toutes ces choses du quotidien qui jusque-là paraissaient insignifiantes deviennent essentielles. Comment as-tu réussi à dormir cette nuit ? Est-ce que les somnifères fonctionnent ? Que pourras-tu avaler ce soir ? Parce que ces fragments d’énergie, de repos, c’est ce qui conditionne tout le reste : ta capacité à partager un moment de détente, à amorcer une discussion, à faire un jeu ou autre chose. Trouver un langage, une grammaire, un putain de canal pour raccrocher nos réalités, pour imaginer une relation où le futur est un impossible, trouver à te tendre les perches pour te dire, élaborer sur ce qui peut être soutenant ; rien de tout ça ne s’invente. On l’apprend sur le tas. On l’apprend en le vivant, en observant les autres, en discutant ensemble.
Jamais je n’ai entendu parler d’aide au suicide – quelqu’un faire le récit de ça. Risque juridique ? Ben oui mais comment débloquer nos imaginaires ? Tu me cherches sur ce terrain dès le début. Une première fois tu glisses qu’il t’est hors de question de finir ta vie alité et sédaté ; et qu’il te faut d’autres solutions. Une deuxième que je saisis au vol, je m’engage auprès de toi à trouver des solutions techniques et à t’accompagner. C’est une question d’amour, et de camaraderie, d’engagement politique, de t’aider à conquérir ce droit à choisir ta mort. Et si je n’étais pas capable ? Et si je flanchais ? Et si je te laissais seul ?
Lorsque tu sors de ce second séjour à l’hôpital, je sais que tu n’y retourneras pas. Parfois j’ai peur de te retrouver pendu au matin. Je navigue entre cette certitude que je vais t’accompagner jusqu’au bout, et la peur d’avoir l’air de te pousser vers la sortie. Alors je te laisse venir à la discussion. Un jour tu craques, fonds en larmes. Je te prends dans mes bras, je crois que c’est la deuxième fois de notre histoire relationnelle que c’est moi qui prends ce rôle d’essayer de te réconforter – la dernière fois j’avais 8 ans. C’est pourtant une chose que tu as fait tant de fois pour moi. Tu essaies de me raconter, de nommer cette angoisse des heures passées seul à te demander comment mourir, à chercher quel pont, quel immeuble est assez haut pour garantir l’issue.
On cherche, on active toutes les pistes – je parcours mes ressources dans l’illégalité, me demandant si je saurai faire un geste pour mettre fin à ta vie. Mes limites se déplacent au fil des jours – j’avance pas à pas avec toi. Tu finis par trouver une solution chimique. Prise orale.
Tu sais que je suis là jusqu’au bout mais on ne le parle pas. Et je sais que ça te pèse d’avoir le sentiment de me priver de ma vie le temps d’achever la tienne. Il n’y a pourtant aucun endroit au monde où je voudrais être plus qu’ici avec toi. Parfois je voudrais étirer le temps et profiter de chaque fragment. D’autres je voudrais tellement que ça s’arrête au plus vite, pour ne plus que ça empire. Il y a ce moment où je me dis : c’était notre dernier ciné il y a 2 jours. Puis notre dernière sortie. Et vient le moment où je me dis que c’était notre dernier repas. L’espace-temps se rétracte. Parfois je me dis que j’aurais peut-être dû plus te parler, te dire combien tu comptais pour moi, et tout ce que tu avais été dans ma vie. Faire des déclarations d’amour, comme au cinéma. Mais peut-être avions-nous besoin de maintenir ce semblant de normalité, de limiter nos effusions émotionnelles pour ne pas se laisser engloutir dans le désespoir de la situation. Qu’aurions-nous gagné à nous pleurer dans les bras toute la journée ?
Le bout de la route
Tu as reçu ce produit qui te permettra d’en finir, avec l’apaisement d’avoir enfin une solution. Qui te permet de sortir ça de ta tête, de quitter l’angoisse de mourir à l’hosto, de prolonger l’agonie. Pendant un temps tu n’en parles plus. Puis tu me dis que tu as déjà trop duré, alors nous parlons de comment peut se passer ce dernier moment. Discussion improbable, un peu surréaliste – impression récurrente d’un mauvais rêve. J’essaie de contenir mes larmes, de permettre un échange technique alors que tu m’annonces que tu veux arrêter de vivre la semaine prochaine. Je savais que nous allions en arriver là, mais c’est comme si j’avais cette part d’espoir irrationnel que cela pourrait être évité. Nous nous mettons d’accord sur un protocole, je m’engage à être avec toi pour ce dernier moment. Tu entends que j’ai besoin d’autres présences à mes côtés – pour cet instant où tu ne seras plus là pour que je tire ma force de toi. J’appelle mon binôme, celle qui sera mon roc pour traverser ces derniers moments. Les choses se mettent en place. Toutes les conditions matérielles sont réunies. Après ça tu n’en parles plus. Et je me laisse aller à oublier l’issue, à penser qu’il y a le temps, à faire comme si ta mort n’était pas imminente. Je me perds à imaginer que peut-être tu feras durer plus que ça, que tu accepteras des soins palliatifs, que je n’aurai pas à me confronter à ce dernier moment.
Mais ton état empire. Tu respires à grandes peines, le poumon se rétracte, inexorablement, et je commence à avoir peur de te trouver incapable de prendre ton souffle. Que ferais-je alors ? Devrais-je te laisser suffoquer ou appeler les pompiers, les laisser t’emmener à l’hôpital où on prolongerait cette vie insupportable, au nom de « l’éthique médicale » ? Tu prends peu d’antalgiques, parce que tu veux plus que tout rester lucide, et j’ai peur que la douleur que tu gères depuis des mois d’un coup te submerge. Que se passera-t-il si tu te retrouves contraint à l’hospitalisation ? Devrais-je te laisser crever impuissant, ou prendre le risque d’être l’auteur d’un geste létal que tu ne serais plus en état de faire toi-même ? Je viens à la discussion là-dessus, tu me dis que demain soir tu vas mourir. Tes capacités d’autonomie disparaissent plus vite que tu n’arrives à t’y faire. À la fin je dois t’aider à t’habiller, à te déplacer, rester au bord de ton lit le temps que tu reprennes assez d’air pour ne pas avoir peur de t’étouffer en t’endormant.
Les deux derniers jours de ta vie, tu parles à peine. On se comprend par gestes, quelques bribes de paroles. Tu portes des boules quiès quasi en permanence. Parce que le bruit t’est devenu intolérable, mais j’imagine aussi que tu commences à te couper du monde, car il t’est trop dur de te résoudre à quitter la vie tout en y étant fort accroché. Alors tu commences à t’isoler, à te couper du monde, à prendre tes distances. Je sens toute ton énergie orientée vers cette ultime étape, puisque c’est tout ce qui reste. Je devine que tu te soucies de comment celles et ceux qui te survivent vont dealer avec ce moment, de comment faire au mieux pour elleux, mais tu n’as pas les moyens d’élaborer les réponses. Tu me délègues un gros morceau, à mi-mots. Avec ton accord, c’est moi qui ai averti d’autres proches de ton projet de suicide, et qui l’ai discuté, jusqu’à annoncer le dernier moment. Tu as peur d’un échec de la chimie, de ne pas réussir à avaler ce produit, de le vomir. Je te rassure, déployant toute l’assurance dont je suis capable alors qu’à l’intérieur je suis pétrifié. On échafaude un plan B, qui est branlant mais je me dis qu’il sera toujours temps d’aviser en cas de besoin.
Je te trouve dans l’après-midi, l’air perdu devant ton ordinateur, essayant d’envoyer un message pour dire « c’est fini ». Tu me dis que tu n’y arrives pas. Comment pourrais-tu écrire ces mots, alors qu’il te reste encore cette montagne à gravir ? Je m’engage à le faire pour toi, après ta mort. Peu de gens sont au courant de ta maladie. Parce que la mort est une affaire privée, une affaire qui doit être maintenue à part de la vie. Parce que le monde doit continuer de tourner – maintenir l’illusion d’existences épanouies, comblées par le travail, la famille et la nation, l’illusion de sécurité maintenue par le cloisonnement. TouTEs en bonne santé car l’état s’occupe de nous et que nous mangeons 5 fruits et légumes par jour. Le meilleur des mondes. Masse citoyenne docile qui ne voudrait pas d’un changement social puisque ce système là nous apporte la longévité... Alors cachez cette maladie que je ne saurais voir...
Tu passes ces derniers moments entre visites des proches et solitude, jusqu’au soir où nous avons convenu de regarder un film avec celleux qui le souhaitent.
C’est un film que je connais par cœur, un monument de notre histoire commune, et à mesure qu’il s’approche de la fin je sens l’angoisse monter. J’ai compris ce soir-là le sens de l’expression « se chier dessus », parce que j’ai littéralement peur que mes intestins se vident sur le canapé tellement je flippe. J’ai l’envie de fuir, de partir en courant, tellement la trouille de pas être à la hauteur, d’avoir pris un engagement que je ne sais pas tenir. Mais là encore, la force émerge de ressources insoupçonnées. Le film finit, moment de latence – tu t’agites, je ne te comprends pas, tu paniques en fait mais aussi étrange que cela puisse sembler je ne m’y attendais pas. Au bout de quelques minutes tu me regardes et me demandes « qu’est-ce qu’on fait maintenant ? ». C’est ta dernière délégation, la dernière demande que tu m’adresses. Alors je prends en charge le moment. Je t’aide à te déplacer, aller dans ce fauteuil, comme tu l’avais décidé. Tu suffoques. Je pense d’abord que c’est ta difficulté habituelle à reprendre ton souffle après avoir bougé, mais je réalise que tu es en crise d’angoisse, impossible de dire un mot – tellement prévisible quand on y pense mais pourtant je l’avais pas anticipé. Bouffées de chaleurs, j’essaie de te faire sentir ma présence physique, j’ouvre ta chemise, enlève ton foulard. Tout ce qui me vient en tête à te dire c’est des conneries du genre « respire profondément », et je me demande si tu aurais la force de me mettre une baffe si je te disais un truc aussi stupide, à toi pour qui respirer est devenu la chose la plus difficile à faire depuis des semaines. Alors j’attends, je ferme ma gueule, pas besoin de te dire que je suis là car tu le sais. Je ne veux pas te précipiter – c’est toi qui maîtrises le timing et me demandes de te passer les anti-vomitifs que tu dois prendre en premier lieu. Nouvelle montée d’angoisse. Tu gigotes, transpires – je réalise que je ne peux plus bouger, impossible de lâcher ta main, je fais des signes pour que le reste de la chimie resté dans la cuisine soit amené. Comme toujours quand j’ai peur, j’ai envie de pisser mais il me faudra me retenir.
Je te tends ce bol – une mixture infâme que tu dois avaler alors que la prise alimentaire t’est quasi impossible. À la première cuillère, tu la laisses retomber dans ma main et murmures : « pas possible ». Ces deux mots suspendent le temps. Nous avions parlé de plan B, évoqué la possibilité d’une injection en cas d’échec, mais dans tous mes imaginaires nous pouvions nous parler à ce moment-là. Sauf que tu es au bout de tes mots. Mon cerveau tourne à 100 à l’heure, je me vois gravir l’escalier en courant pour prendre de quoi te faire une injection, un geste que jusque-là je ne m’étais jamais imaginé capable de réaliser mais qui d’un coup devient une nécessité absolue, et une évidence. J’imagine que tu fais ce même chemin dans ta tête, et que me faire prendre ce risque t’est inacceptable. Tu récupères cette putain de cuillère et tu avales jusqu’à la dernière goutte. J’ai peur que tu vomisses. Je te passe deux verres d’eau. Au bout de 2 ou 3 minutes tu bailles à t’en décrocher la mâchoire, puis tu t’endors, avec un filet de bave au coin de la bouche. Je vois ta tête tomber – encore une chose que je n’avais pas anticipé alors que tu es assis dans ce fauteuil. Agitation autour pour te glisser quelque chose sous la tête. Un ou deux légers spasmes, tes mouvements respiratoires s’espacent – chacunE a les yeux rivés sur ton abdomen dénudé. Toutes mes angoisses disparaissent, on dirait que cela fonctionne mieux que ce que j’aurais pu espérer. Sans douleur ni conscience du moment de la mort.
Je me suis tellement trituré le cerveau à me demander comment j’aurais la certitude que tu es mort, pour être sûr que ça a fonctionné et que tu risques pas de te réveiller – et maintenant cela me paraît tellement évident. Je vois la couleur quitter ton corps – tu deviens gris. Pour autant je ne peux pas te lâcher la main. Une idée irrationnelle : et si tu te réveillais ? Quelle serait ton angoisse de te trouver seul ? Quelqu’une te ferme les yeux. Elle n’arrivera pas à refermer ta bouche. Quelques bribes de discussion sur comment gérer la suite, et puis nous passons une bonne partie de la nuit autour de toi, à discuter, échanger nos anecdotes, nos souvenirs de toi, à rire, te parler, boire pas mal de bière. Jusqu’à installer nos couchages pour camper près de toi – pour ne pas te laisser seul. C’est fini, et nous partageons ce soulagement infini – de savoir qu’enfin tes souffrances s’arrêtent.
Le lendemain il faut gérer, appeler le médecin, faire constater le décès, aller aux pompes funèbres choisir la suite des événements, avertir les proches, les moins proches, parcourir ton carnet de téléphone, annoncer ta mort à des inconnuEs, ou des personnes que je n’ai pas vuEs parfois depuis des décennies. Te laisser partir une deuxième fois, emmené par les pompes funèbres, choisir tes vêtements, et puis te retrouver au funérarium.
Et ensuite ?
Le lendemain de ta mort, j’ai fouillé toute la maison à la recherche d’une lettre, d’un mot pour moi. Qu’y avait-il à dire ? Que tu m’aimais ? Que tu me remerciais d’avoir partagé ces derniers moments ? Toutes ces déclarations que tu n’as jamais fait de ton vivant, et que je n’ai jamais eu besoin d’entendre, m’ont manqué d’un coup. Parce que je n’avais plus cette complicité, ces échanges de regards, ce sentiment d’être connecté et de se comprendre. Parce qu’à partir d’aujourd’hui il n’y aurait plus rien venant de toi. Évidemment je n’ai rien trouvé, parce qu’il n’y avait rien de plus à dire. Là encore, l’imaginaire façonné par les films à grand coups de déclarations poignantes sur lit de mort en a pris une claque. La mort c’est ni beau ni romantique.
Préparer la cérémonie. On me donne une place de ouf dans tous ces moments. Parce que je suis ton enfant. Mais je veux pas d’un statut légitimé par la sacro-sainte famille à laquelle je ne crois pas. Je veux de la place ici parce qu’on avait une bête de relation, parce qu’on s’est choisis, parce qu’on s’est engagés côte à côte dans ce combat jusqu’à ta mort. Mais d’un coup c’est moi qui suis dans la position d’avoir le pouvoir de donner de la place aux autres – à toutes celles et ceux pour qui tu comptais et qui n’ont pas ce statut qui les rend légitimes. Je déploie de nouvelles ressources pour discuter avec tout le monde, essayer d’imaginer un moment où chacunE se retrouve. Je vais te voir chaque jour au funérarium, et je sais que bientôt je devrai te laisser disparaître une nouvelle fois, pour la mise en bière. Je me mets la pression pour être capable de parler à la cérémonie, d’amener la possibilité de rire, d’échanger sur celui que tu étais, de rassembler dans un moment tous ces morceaux séparés de ton existence. Et je crois que ça marche. Les bouts d’histoires et de relations se croisent. Peu de gens parlent de la mort en elle-même, ou me questionnent sur ta fin de vie. Moi je me demande à qui je dois la vérité, et à qui je dois la masquer. Et je trimballe l’image de ces derniers mois, image difficilement partageable avec tous ces gens qui n’ont pas su ta maladie, ou sa gravité, et pour qui le chemin commence à l’annonce de ta mort.
Me voilà quelques mois plus tard. D’un coup, des bouts de récit de deuil que je jugeais « mystico-pétés » jusque-là prennent un éclairage différent. Parce que je sens ta présence en moi tellement fort. Parce que je suis connecté et conscient de tout ce qui chez moi vient de toi, ou de nous, du construit commun. Postures, gestuelles, pratique du corps, expressions et tics de langage, petits trémoussements du postérieur qui veut dire « nananananère » ou mouvement des doigts devant la bouche pour se narguer (emprunté à Hook). Mais aussi rapports au monde, façons d’interagir, habiletés (ou non-habiletés) relationnelles. Je sens ta présence dans les activités communes, quand je marche dans la montagne en te parlant, commentant la flore ou cadrant mentalement la photo que tu te serais arrêté pour prendre, pendant que je m’impatientais. Aussi dans l’envie de prendre de nouveaux morceaux de toi, d’apprendre, de lire, de faire ce qui comptait pour toi ; ou dans l’envie de rencontrer celles et ceux qui ont pris place dans ton cœur et que je n’ai pas connuEs. On est quelque chose de différent dans chaque relation. Ce qui veut dire qu’une partie de moi qui existe par rapport à toi, qui existe dans l’espace de notre relation est définitivement perdue. Ce que j’étais avec toi je ne le serai plus jamais avec personne. Le quotidien est plein de situations que j’aurais spontanément partagées avec toi, pris mon téléphone pour t’envoyer un texto – mais maintenant je garde ça pour moi. C’est fou tout le volume que tu prends depuis que t’es plus là, dans mes pensées, dans mon quotidien (étrangement, plus que de ton vivant). Et à la fin de ma vie, quel espace sera rempli de la présence de toutes les personnes chères que j’aurai vues partir ? Est ce qu’on marche avec nos morts à nos côtés ? Vivre ce deuil est un nouveau chemin à parcourir pour moi, encore une chose à apprendre.
Pourquoi écrire tout ça ?
J’écris aujourd’hui parce qu’il me semble qu’il nous faut parler de la mort, du chemin que nous avons parfois à parcourir jusqu’à elle. Parce que j’ai la rage d’entendre des banalités du type « il est mort dans son sommeil » ou « il n’a pas souffert ». Parce que c’est trop facile de garder ces œillères, d’ignorer combien de personnes traversent ces épreuves dans la solitude et le silence. Parce que je n’y avais jamais pensé avant, mais il me paraît évident que cette histoire singulière que j’ai vécue fait écho à tant d’autres. Combien de morts seulEs dans leurs lits, dans l’angoisse, la douleur, d’un arrêt cardiaque, la suffocation, parce que l’espace d’élaborer des solutions pour choisir le moment de la fin fait défaut ? Combien de suicides qui ne disent pas leur nom, de parcours solitaires pour trouver des ressources, des solutions techniques ? Combien de suicides dans des conditions de merde parce que pas d’accès à des options techniques satisfaisantes, à étouffer dans son vomi après avoir avalé la moitié de l’armoire à pharmacie ? Combien de tentatives réprimées dans les taules, combien de ratés qui se paient chèrement ? Quel poids a ce tabou, qui contraint à l’isolement, qui prive de l’espace où partager ses angoisses, la peur de se louper, la peur de souffrir ?
J’écris pour dire qu’il y a des situations tellement merdiques que chacunE fait au mieux, avec ce qu’il/elle est, avec les ressources disponibles, avec toutes les complexités que nous trimballons avec nous. Avec l’histoire relationnelle que nous avons avec celui ou celle qui meure. Avec nos faiblesses. Et qu’il ne peut y avoir de place pour les regrets, ou la culpabilité. On a fait comme on a pu. Beaucoup de personnes m’ont renvoyé que j’avais une force incroyable – et c’est vrai que je me suis rarement senti aussi droit dans mes pompes. J’écris parce que j’ai l’envie, le besoin de transmettre cette force, pour qu’on se sente capables d’accompagner ce merdier. Parce qu’il n’y a pas le choix, parce que la mort ne fera que nous encercler toujours davantage à mesure que le temps passe.
J’écris comme exutoire, bien sûr, parce que coucher ces mots me permet de sortir un peu de ce qui me triture le cerveau chaque jour. Parce qu’il m’est difficile de trouver comment partager cette expérience, comment évacuer un peu de ce surplus émotionnel. Parce que je ne sais pas faire avec légèreté – et que 10 fois par jour quand l’histoire de cette mort vient remplir tout mon espace de pensée, je dois choisir entre la refouler, la vivre seul, ou « plomber l’ambiance », parce que je vois trop souvent la gêne et le malaise à évoquer ces sujets.
J’écris parce que j’ai envie d’élaborer du politique avec ces questions de fin de vie. C’est un récit émotionnel que je fais aujourd’hui, car c’est tout ce dont je suis capable pour l’instant. Mais derrière lui ce sont les questions du droit à disposer de nos corps, à maîtriser nos existences, à récupérer ce pouvoir sur nous-mêmes confisqué par l’État et l’ordre médical. Et parce qu’il y a tellement de questions qu’il nous faut confronter.
Je vis ma vie entre des communautés, des collectifs, des liens de solidarités et d’amitiés. Dans des enchevêtrements relationnels où nous choisissons ensemble d’avoir prise sur nos existences, et de partager nos quotidiens en dehors des structures traditionnelles travail/famille. Comment allons-nous mourir ? Comment allons-nous nous accompagner les unEs les autres dans nos fins de vie ? Avons-nous la capacité collective d’affronter ces situations, ou allons-nous laisser celles et ceux pour qui un retour dans la famille reste possible partir mourir ailleurs – et les autres crever seulEs au bord du chemin ?
J’écris parce que mon expérience de ces derniers mois – et ma capacité et mon désir d’en parler – m’ont rendu visible comme personne ressource sur ces questions techniques liées au suicide. Et comme les espaces de le parler sont rares, j’ai déjà été sollicité là-dessus à plusieurs reprises. Alors j’ai envie de partager ces réflexions, de sentir du commun, des alliances, des complicités.
J’écris parce que je veux péter ce tabou autour du choix de mourir, parce que je ne veux pas que mes camarades, mes amiEs, se démerdent seulEs avec ces questions-là. Parce qu’au delà des situations de maladie incurable, il y a la question du pouvoir que nous avons de décider de vivre ou non. Quel que soit notre état de santé. Et peu importe ce que l’ordre médical en pense. Parce que nous voulons récupérer du choix, du pouvoir sur nos vies, et que le droit de mourir fait partie intégrante de ça. Parce que dans l’histoire que je raconte ici, l’ « acceptabilité » du suicide vient du diagnostic médical. Aigu, agressif, foudroyant. Mais je refuse l’idée qu’on puisse retirer à quelqu’unE le droit à mourir de la façon dont elle/il l’entend, et au moment où elle/il l’entend. Et admettre cela, c’est aussi admettre qu’être des amiEs et des camarades c’est aussi entendre, et soutenir, les décisions de l’autre concernant sa propre existence – dont sa fin.
On ne peut pas prétendre avoir le contrôle de nos vies si on n’a pas celui de nos morts. Et si on ne peut pas faire le choix de mourir, il n’existe pas de possibilité de choisir de vivre. Alors vivre est quelque chose qu’on subit. Et nos existences ne nous appartiennent pas à nous, mais à celleux qui décident de qui doit vivre ou mourir. L’État a besoin de sa masse citoyenne et le capital de sa force de travail. Et le pouvoir psychiatrique est là pour t’enfermer et t’empêcher de t’ouvrir les veines. Pour ton bien y disent.
J’écris parce que je voudrais que ce moment de mort ne soit pas à part de la vie, mais une partie importante de la vie. Et qu’on puisse le partager – comme on partage le reste de nos existences.
J’écris parce que partager ça avec toi a été une des plus belles histoires d’amour de ma vie.
Merci à toi de m’avoir révélé toute cette force que j’avais en moi.
Merci à touTEs celles et ceux qui ont su t’accompagner dans ce dernier morceau de ta vie, et t’apporter leur soutien, leur présence, leur tendresse.
Merci à touTEs celles et ceux qui ont été à mes côtés, qui m’ont porté dans ces moments, qui m’ont permis de tenir le coup, qui m’ont donné leur soutien et leurs ressources matérielles, leur amour, leur écoute.
Merci à celle qui a su partager les moments les plus durs.
Les mots ne seront jamais assez.
À la vie - À la mort
alavialamor@riseup.net
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (2.8 Mio)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (2.8 Mio)