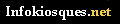A
Les ateliers du groupe soin volume 3
mis en ligne le 15 février 2021 - Groupe soin
Sommaire :
- Qu’est-ce qu’un médicament ?
1. Le parcours et les principes du médicament
2. Les formes galéniques
3. L’effet placebo
- Systèmes
1. Le système endocrinien
2. Du système immunitaire aux allergies
- Questions gynécos
1. Endométriose
2. Papilloma virus
+ Livret central
Trucs & Astuces de Charlatans Face au COVID, téléchargeable en PDF ici :
Une brochure pas comme les autres

Derrière cet intitulé pompeux, aucune prétention de notre part à faire mieux qu’une autre brochure éditée dans les milieux radicaux. Non, si elle se distingue, c’est des brochures du Groupe Soin des années précédentes.
Et pour une raison, somme toute, évidente mais qu’il convient sans doute de rappeler : ça n’a pas été une année comme les autres. Singulièrement comme collectivement, nous avons été frappé.e.s (de stupeur, de plein fouet, en plein cœur, etc.) par l’effraction virale du COVID-19 aux premiers frémissements du printemps dernier. Comme tout le monde, nous avons suspendu nos ateliers, nos réunions... et pour un temps même, notre réflexion.
Puis nous avons plongé dans le virtuel et développé des manières de continuer à penser ensemble, même à distance. Il était assez heureux de constater que nous n’étions pas complètement désarmé.e.s (du point de vue du soin, s’entend) dans la situation. Pouvoir s’appuyer sur les connaissances acquises lors d’ateliers des années précédentes (que ce soit les maux de l’hiver ou les angoisses) était d’un certain réconfort. Ne pas être complètement démuni.e.s pour prendre soin de nous et des nôtres, dans ces temps d’incroyable dépossession, était presque un luxe. Il y a trois ans maintenant, quand nous avons lancé le Groupe Soin, nous n’imaginions certes pas que les problématiques de santé (publique et individuelle) organiseraient autant le réel mais cela nous conforte dans l’idée qu’il faut poursuivre la réflexion et les échanges en la matière. Toujours travailler à trouver les bonnes alliances dans le monde du soin, toujours essayer de détricoter les enjeux du biopouvoir, toujours se refiler les remèdes de grand-mères qui ont survécu à la marche forcée du progrès scientifique, toujours se nourrir des médecines millénaires qui ont traversé les époques, etc. Bref, continuer à patiemment construire les chemins de l’autonomie. Sans quoi, nul devenir révolutionnaire ne semble possible.
Ceci étant dit, revenons à cette mouture 2019-2020 de la brochure. Elle n’est pas comme les autres aussi en ceci qu’elle ne contient pas seulement les comptes rendus des ateliers que nous avons pu mener cette année. Nous avons classé ces derniers thématiquement plutôt que chronologiquement, notamment parce qu’il y avait une vraie plus-value à mettre en regard l’atelier sur les médicaments, celui sur les formes galéniques et celui sur l’effet placebo. Nous en avons donc fait un « bloc ». Pour le reste des comptes rendus, c’est l’habituel patchwork : deux systèmes (immunitaire et endocrinien) et deux « maladies » gynécologiques (endométriose et papilloma virus). Mais ce qui diffère surtout, c’est que nous avons rajouté un petit livret « Trucs & Astuces de Charlatans face au Covid » (c’est-à-dire issus des pratiques traditionnelles et populaires de soin) que nous avons récoltés et testés par temps de confinement. Cette annexe n’est donc pas le fruit d’un atelier (qu’il faudrait peut-être mener d’ailleurs) mais d’échanges à différentes échelles, entre différentes personnes.
Voilà, bonne lecture. On a hâte de vous (re)voir/rencontrer dans un atelier ou un autre.
Le Groupe Soin, septembre 2020
I) Qu’est-ce qu’un médicament ?
Le parcours et les principes du médicament
0. Le médicament et l’industrie pharmaceutique
Aujourd’hui, il est impossible de dissocier l’histoire des médicaments de celle de leurs processus de fabrication et de commercialisation, c’est-à-dire de l’industrie pharmaceutique. Pourtant cette identification est récente. L’industrie pharmaceutique moderne apparaît au milieu du 19 e siècle. Elle se développe en s’éloignant volontairement des pratiques de pharmacopées traditionnelles par la « création » de médicaments chimiques – nous y reviendrons. Elle crée un véritable marché répondant aux mêmes principes d’offre et de demande et de fixation des prix que tous les autres marchés mondiaux. Les petites entreprises familiales se transforment rapidement en firmes multinationales : en France, en 1950, on comptait 1 960 entreprises pharmaceutiques ; en 1960, il en restait 880 et en 1999, 299. C’est aujourd’hui le quatrième marché économique mondial via la production à très grande échelle de produits normalisés.
1 . Plantes & médicaments

Il existe un peu partout des pharmacopées dites « traditionnelles » parce qu’elles ont traversé les âges. Elles utilisent des plantes, des champignons, parfois des minéraux voire des animaux (extraits de venin par exemple). Leur élaboration répond à différentes logiques/conceptions du corps, de la maladie et de la santé. Elles sont en cohérence avec les milieux où elles se déploient (faunes et flores locales, habitudes culturelles d’usages, représentations cosmogoniques...). Différents principes peuvent ou ont pu orienter le recours aux plantes dans les médecines du monde entier : – Le principe des analogies : les caractéristiques de la plante dans son milieu et ses propriétés estimées sont mises en correspondance avec ce sur quoi l’on souhaite agir. Si une plante pousse les pieds dans l’eau, elle sera sûrement d’une grande aide pour lutter contre les rhumatismes... (c’est le cas de la Reine des prés par exemple). Historiquement, ce principe rejoint « la théorie des signatures ».
– Le principe des similitudes : telle plante fait vomir mais, à très petites doses, elle va aider à combattre les nausées
– c’est entre autres le concept de base de l’homéopathie. Ici la question du dosage sera très importante, la même plante pouvant être à la fois poison et remède (c’est le sens du terme « pharmakon » en grec).
– La théorie des contraires : on utilise une plante qui va avoir une action rééquilibrante, par un effet inverse au symptôme. Par exemple une plante réchauffante contre un coup de froid, une plante rafraîchissante en cas de forte fièvre, une plante cholagogue en cas d’excès de bile.
– Enfin, et c’est important pour comprendre certaines critiques qui seront formulées plus loin quant aux médicaments « modernes », le principe du totum : l’ensemble des composés d’une plante a un effet potentiellement différent des effets spécifiques de chacun des composants, ceci basé sur l’idée qu’il existe une synergie entre eux. On dit que le totum d’une plante est supérieur à celui de ses constituants. Ce sont les processus de transformation qui vont se modifier à mesure que se développe la production moderne des médicaments, et notamment à partir d’une notion centrale : le principe actif. Il s’agit d’identifier et d’isoler ce qui soigne dans la plante, de passer de l’usage du tout à chacune de ses parties, prises en solo. Et, très vite, principe actif devient synonyme de molécule. Une molécule étant isolable, bien identifiable, et... brevetable !
On peut se questionner sur ce modèle comme seul valable et constater en tout cas qu’il fait l’impasse sur de nombreux autres aspects et logiques de pensée, qui prennent en compte le soin dans un sens plus large, et qu’il ne favorise pas particulièrement notre autonomie, laissant à la seule « chimie de synthèse » la capacité de produire ce qui soigne.
2. Plantes, principes actifs et molécules

Les médicaments « modernes » sont tous composés d’un (ou plusieurs) principe actif et d’un (ou plusieurs) excipient. Le principe actif, c’est la ou les molécules censées agir sur le problème. Les excipients, ce sont les composants soi-disant inertes, n’ayant en principe aucune influence sur le fonctionnement du médoc. Ils sont rajoutés aux molécules dites actives dans un médicament pour le stabiliser, lui donner une consistance pour pouvoir le contenir, le manipuler, etc. C’est parfois du lactose, du fructose, de l’éthanol, des huiles, des colorants, etc.


Si l’industrie est tant attachée à la notion de principe actif = molécule, c’est que tout l’objectif des préparations de la pharmaceutique moderne est d’obtenir des médocs stables et fiables dans un maximum de cas pour « standardiser », « normaliser » les dosages, les modes de prise/administration et donc les processus de fabrication.
Le « principe actif » est un concept plus complexe qu’il n’y paraît et dont la définition a des conséquences très importantes sur la conception de ce qui soigne. Cela fait souvent l’impasse sur la complexité des interactions entre les molécules présentes dans une même plante, mais aussi cela relègue les excipients au rang de molécules « inertes » (bien que pouvant avoir « des effets notoires », c’est écrit dans la notice...) qui n’auraient aucune influence sur le traitement. Si la médecine occidentale et les industries pharmaceutiques n’en ont pas eu grand-chose à faire en sélectionnant et en isolant les molécules extraites de plantes, de plus en plus d’études montrent l’importance de la combinaison des substances à l’origine de l’efficacité de leurs effets.
Cette ligne de partage entre molécule active et inerte a des implications directes, notamment au niveau de la confection des médicaments génériques (par opposition aux princeps qui sont des médicaments sous brevet). Une fois tombée dans le domaine public, une molécule identifiée comme utile pour tel ou tel problème peut être reconditionnée avec d’autres excipients pour faire un médicament générique pouvant remplacer la formule brevetée. Le nouveau médicament est moins cher et libre de droit, ce qui est déjà pas mal, mais l’idée que les excipients sont remplaçables « poste pour poste » sans conséquence aucune sur la nature du médicament est pour le moins questionnable. Par exemple, nous avons tous un ou une amie qui prétend que l’Efferalgan marche mieux sur lui/elle que le Doliprane, alors que la molécule considérée comme principe actif est la même, le paracétamol. Mais les excipients diffèrent. Pourquoi cela n’aurait-il pas un effet réel ? En fonction des personnes peut-être ? De leur métabolisme ? En fait, les excipients ne sont pas la cinquième roue du médicament. Ils sont importants et peuvent interagir les uns avec les autres, et avec la molécule dite active, mais cela est bien trop souvent négligé, et les patients sont renvoyés à leur subjectivité quand ils ont le malheur de contester une nouvelle formule en raison d’effets indésirables (cf. l’affaire très médiatisée du changement de composition du Levotirox).
À noter aussi que, si jusqu’à il y a peu, les médecins avaient le choix de prescrire – et les pharmaciens de proposer/délivrer – un princeps ou un générique, la législation s’est durcie récemment. D’abord en 2015, quand les médecins ont eu l’obligation de prescrire non plus une marque, mais le nom de la molécule (cf. dénomination en DCI dans l’encadré à la fin), puis en janvier 2020 quand le remboursement intégral par la Sécu ne se fait plus que sur les génériques (si la personne souhaite la molécule dite « de référence », c’est-à-dire le princeps, celui qu’elle pouvait avoir l’habitude de prendre, elle ne sera remboursée que sur le prix du générique, et devra faire l’avance du paiement : principe du « tiers payant contre générique »). Les trois seules exceptions reconnues, pour lesquelles l’ordonnance peut comporter la mention « non-substituable » et la personne être remboursée pour le princeps, sont : les treize médicaments reconnus à « marge thérapeutique étroite » (quand les concentrations toxiques sont proches des concentrations efficaces, et c’est le cas de la levotyroxine), les médicaments pour les enfants de moins de 6 ans dont les génériques n’ont pas la forme galénique adaptée (voir l’article sur le sujet), et enfin les médicaments dont tous les génériques contiennent des excipients auquel la personne est allergique.

3. Médoc naturel, médoc de synthèse... c’est-à-dire ?

Il existe de nombreuses façons de classifier les médicaments et les substances d’une manière générale. L’une d’elles consiste à distinguer trois grandes catégories de produits : naturel, semi-synthétique et synthétique.
• LE PRODUIT NATUREL (végétal, microbien, animal, minéral) : il est consommé tel quel ou alors « préparé », transformé, pour un usage plus efficace (le concentrer pour ne pas avoir à en ingérer 6kg pour obtenir l’effet voulu par exemple). On peut extraire ou concentrer les propriétés désirées et/ou certaines molécules par des procédés mécaniques ou chimiques simples ou plus complexes (voir l’article sur les Formes galéniques). Au départ, les antibiotiques sont ainsi produits à partir de champignons ou de bactéries existantes (on cultive par exemple des champignons pénicillium desquels on va extraire la pénicilline) bien qu’ils soient aujourd’hui de plus en plus produits de manière synthétique.
• LE PRODUIT SEMI - SYNTHÉTIQUE : la plante fournit la base – une molécule – qui est ensuite extraite, isolée et transformée par réaction chimique en une autre molécule qui n’existait pas à l’origine. Près de la moitié des médicaments anti-cancéreux sont de cet ordre, élaborés à partir d’une molécule originelle extraite de plantes (par exemple le taxol extrait de l’if) qui sera ensuite synthétisée en une molécule très proche mais plus puissante (ou de meilleure tolérance pour le corps humain). C’est aussi le cas de la diacétylmorphine, autrement dénommée héroïne, qui est synthétisée à partir de la morphine, un alcaloïde que l’on trouve tel quel dans le pavot (tout comme la codéine), par l’ajout de produits chimiques qui vont transformer la structure moléculaire de cette dernière.
• LE PRODUIT SYNTHÉTIQUE : ici la molécule est entièrement fabriquée en laboratoire, sans nécessiter de produit naturel à la base. Elle est soit la copie manufacturée d’une molécule existante (qui aurait pu être extraite d’un produit naturel mais certainement à plus grands frais ou avec moins d’autonomie pour les labos), soit l’invention d’une nouvelle molécule, le plus souvent ressemblant très fortement à des molécules présentes dans le monde végétal et ayant fait leurs preuves. Ça, c’est vraiment la forme moderne des médicaments. On tente d’améliorer des substances, des principes actifs connus, par l’élaboration de molécules de synthèse plus efficaces ou faciles àproduire. On fabriquera ainsi par exemple des médicaments opioïdes avec des molécules beaucoup plus puissantes que la morphine ou même que l’héroïne (oxycodon, fentanyl...).

4. Trouver de nouvelles molécules


Passer de la plante à la forme de synthèse repose en partie sur la possibilité de réaliser des « screenings », principe du big data où une quantité énorme de molécules d’origine naturelle va être analysée de manière informatique pour chercher des analogies entre ces nouvelles molécules et celles dont on se sert déjà. Le but est d’en trouver des plus efficaces ou des plus simples à modifier. Pour l’instant, ces techniques n’ont pas réellement permis de renouveler les pharmacopées millénaires et leurs connaissances des plantes. Sans compter que cela fait peu de cas de ce qui entoure la plupart des médications traditionnelles à savoir le mode et contexte de prise (synergie du mélange de molécules, rituel, relation soignant.e/soigné.e, etc.) dans l’efficacité du traitement.
Ce lien pour l’heure indépassable avec les plantes peut entraîner en certains endroits ce que des chercheur.euse.s ont appelé un épistémicide : quand un labo est intéressé par une espèce des pharmacopées traditionnelles, il doit s’en procurer beaucoup très rapidement pour des histoires de concurrence (dépôt de brevet, on le verra après), cela entraînant souvent de graves problèmes de dégradations de l’environnement qui portent préjudices aux populations locales.
5. À propos des brevets


Si Einstein n’avait pas publié sa théorie de la relativité générale en premier lieu dans une revue scientifique, la livrant ainsi au monde, il aurait pu déposer un brevet dessus. Du genre, « si Mars veut orbiter à un demi-grand-axe de 1,5 UA du soleil elle doit me donner 200€ par tour, car c’est moi qui ai compris comment c’est foutu ce bordel... ». Car oui, la publication de découvertes scientifiques sur un sujet nouveau, avant qu’il n’y ait de brevet, ferme la possibilité de dépôt de brevet puisque les découvertes sont rendues publiques avant d’avoir été « protégées ». Pour bien verrouiller un savoir, il faut faire les choses dans l’ordre : d’abord déposer un brevet sur sa découverte secrète, puis la publier ou non. Le système du brevet sert à protéger la propriété intellectuelle d’une découverte, la rendant ainsi monnayable pour son/sa propriétaire. Car à part lui/elle, personne ne peut faire usage de sa découverte (sauf si on le/la paye... et qu’il/elle le veut bien).

En pharmaceutique, un brevet rend une molécule privée pour une durée de 20 ans. Personne ne peut s’en servir ni à des fins commerciales ni à des fins de recherche quand bien même elle aurait un intérêt autre que celui pour lequel elle est commercialisée. Une firme exploite donc SA molécule comme elle le veut, pour ce qu’elle juge le plus rentable, et ne permet pas à d’autres de faire de la recherche avec. Il y a toute une série de « ruses » pour empêcher qu’une molécule ne tombe dans le domaine public, c’est-à-dire pour prolonger la durée d’un brevet. C’est le cas des médicaments « me too » par exemple : on améliore un médoc qui existe déjà, on le présente autrement (ça peut être en changeant certains excipients), on le propose pour une autre indication... et hop, c’est reparti pour 20 ans.

L’OMS peut toutefois faire sauter ou empêcher le dépôt d’un brevet si elle estime que le médicament concerné est nécessaire à la survie d’une population. Elle peut aussi demander à ce que des médicaments soient mis sur la liste des « médicaments essentiels » pour qu’ils restent accessibles (c’est le cas du paclitaxel/Taxol dont on a parlé) ou encore qu’ils ne soient pas inscrits sur la liste des stupéfiants soumis au contrôle international (cf. plus bas concernant la kétamine).
Le débat sur la propriété intellectuelle des produits de santé (et accessoirement du vivant) est vaste et n’est pas près de s’arrêter... mais on notera l’apparition de labos DIY, issus du monde du libre et de l’Open-Source, qui cherchent à se réapproprier la fabrication de certaines substances au bénéfice du commun. C’est le cas de l’insuline, avec des projets comme « open-insuline » qui répondent aux scandales liés au brevet américain sur cette substance.
6. Vous avez dit « drugs » ?


La kétamine
La kétamine est le premier anesthésique utilisé au monde (et pas que pour les animaux, pour les humains surtout). L’OMS l’a classée, depuis 1985, « médicament essentiel » et refuse son classement comme stupéfiant afin qu’elle soit « disponible à tout moment en quantité adéquate pour des besoins de santé ». Il y a peu de risques de surdose, peu de risques de dépression respiratoire comparé à d’autres substances. Les instances de régulation des drogues débattent depuis une quinzaine d’années du placement de la kétamine sous contrôle international des stupéfiants, ce qui compliquerait son accès pour raison médicale. La Chine aussi veut en faire une substance contrôlée (c’est de Chine que vient une grande partie de la kétamine consommée illégalement en Europe). Elle a fait de nombreuses demandes en ce sens à la Commission des stupéfiants des Nations unies (UNCND) et, à chaque fois, l’OMS s’y est opposée.
Ce n’est pas le cas pour de nombreuses autres molécules, alors que la convention unique sur les stupéfiants de l’ONU devrait normalement « assurer la disponibilité suffisante des substances contrôlées à des fins médicales » et « prévenir leur détournement à des fins non médicales ». L’équilibre a été très vite rompu sous l’impulsion des États-Unis et de leur approche essentiellement punitive (la fameuse « guerre contre la drogue »), faisant plus souvent pencher la balance du côté de la répression au détriment des fins médicales.
Le cannabis thérapeutique
Le cannabis est un parfait exemple pour saisir les enjeux autour de l’usage d’une plante, d’une substance, d’une molécule, à différentes époques et par différentes instances de régulation.
D’un usage traditionnel (rituels, médicinaux) à travers le monde et les âges, il a été intégré dans la pharmacopée occidentale petit à petit dans les deux derniers siècles, via des préparations variées. Mais les bienfaits de la plante se sont révélés peu concluants sous ces formes, du fait d’effets erratiques en lien avec les conditinnements de l’époque peu appropriés pour le cannabis : teinture-mère instable, pas de forme injectable (forme prisée de l’époque). Associé à la répression de son usage récréatif en 1916, cela conduit à son retrait de toute pharmacopée occidentale dans les années 50. Mais entre temps, le développement de médicaments synthétiques renouvelle la recherchesur cette plante. On découvre ses principes actifs (THC, CBD, etc.) dans les années 60 et le système des endocannabinoïdes (les récepteurs de notre cerveau qui permettent au cannabis d’avoir un effet sur nous) dans les années 80. Les premiers médicaments à base de molécules extraites du cannabis (THC ou CBD extraits à partir de la plante) ou bien fabriqués de synthèse (THC ou CBD de synthèse) voient le jour en France à la fin des années 90, pour diverses préconisations (épilepsie notamment), sous forme de capsules ou de solution buvable (Marinol, Epidiolex). En 2019, la plante cannabis est autorisée à des fins médicales (« cannabis thérapeutique ») dans un cadre expérimental avec des indications précises (spasticité de la sclérose en plaque, épilepsie sévère, douleurs réfractaires à d’autres traitements, soins palliatifs...). C’est donc ici la plante entière qu’il est possible de se voir prescrire (sous forme d’herbe à vaporiser ou de gélule à ingérer), avec des compositions définies en termes de principes actifs, toujours, notamment un dosage précis en THC et CBD. Mais des associations de patient.e.s indiquent que c’est bien trop peu, au vu de la multiplicité des compositions possibles de la plante, dont ils/elles ont pour la plupart un usage de longue date et ont pu expérimenter laquelle leur convenait le mieux, probablement avec bien d’autres facteurs qu’un simple ratio CBD/THC. À noter qu’il ne faut pas confondre cannabis thérapeutique et CBD, bien que le CBD seul ait lui aussi des effets intéressants, les effets officiellement démontrés comme « thérapeutiques » du cannabis proviennent également du THC, et probablement de l’interaction entre ces différentes molécules (et d’autres encore). Des associations de patient.e.s militent donc pour une liberté d’usage de la plante sans restriction afin d’y trouver légalement et en toute autonomie l’efficacité recherchée. Car parallèlement, la plante cannabis reste classée stupéfiant et son usage hors de ce cadre est interdit. Le CBD seul n’est pas classé stupéfiant, mais il est interdit de l’extraire de fleurs ou des feuilles de cannabis, il doit donc être extrait uniquement des graines (où il est quasi inexistant) ou être produit de synthèse pour être légal.
7. Le contrôle du circuit du médicament en France
La mise sur le marché d’un médicament est possible à partir du moment où il a obtenu une AMM, ou Autorisation de Mise sur le Marché. Celle-ci est délivrée par l’agence nationale de sécurité du médicament (l’ANSM). Cette AMM indique à la fois la composition (principes actifs et excipients, en gros la recette), les pathologies pour lequel il est indiqué et les posologies (si on le prescrit pour autre chose et dans d’autresquantités il ne sera pas remboursé), et enfin les taux de remboursement. Avant d’obtenir une AMM, le médicament peut recevoir une autorisation temporaire d’utilisation (ATU) qui permet de mettre en circulation un médicament avant d’avoir totalement confiance en lui.


Pour obtenir ces autorisations le médicament doit passer par des phases de tests que les firmes pharmaceutiques financent elles-mêmes. Le médicament va être testé sur des êtres vivants, à différents niveaux : les tests pré-cliniques se font sur deux espèces animales différentes. S’il n’y a pas trop de dégâts sur les animaux, on passe aux tests cliniques réalisés sur des humains (pauvres de préférence !). En France, on ne jure que par la fameuse randomisation en double aveugle : on constitue deux groupes tests et personne ne sait (ni les patient.e.s, ni les médecins qui les suivent) quel groupe aura le médoc à tester et qui aura un placebo (voir l’article sur l’effet placebo). Ces essais se font en trois étapes : la première sur un échantillon de gens malades uniquement ; la deuxième sur un mélange de gens malades et de gens qui ne le sont pas, le but étant de confirmer la non nocivité du produit (même si certains médocs sont nocifs par essence). Enfin, la troisième phase est la phase des tests de confirmation qui a pour but de confirmer les deux premières étapes.
Ce processus de test est encore une fois issu de la vision occidentale moderne de la pharmacopée ce qui en exclut tous les concepts de contexte de prise (rituel et mélange de molécules par exemple), c’est pourquoi elle est très efficace pour « prouver » que les méthodes traditionnelles de soin sont inopérantes à soigner largement et efficacement.
Une fois obtenue l’AMM, il n’y a aucune instance officiellement en charge de continuer de mener des études sur la molécule en question. Il faut compter sur les associations de malades ou les professionnel.le.s attentif.ve.s pour détecter d’éventuels problèmes liés à tel ou tel médoc. L’ANSM estime que 20 000 personnes meurent chaque année à cause de médicaments. Sur ces 20 000 morts, elle estime aussi que 10 000 seraient évitables !
Les formes galéniques en phytothérapie



0. Formes galéniques
Le nom vient de Galien (129–201), médecin de la Grèce antique, chirurgien réputé des gladiateurs puis médecin de l’empereur Marc Aurèle, qui a influencé la médecine des siècles suivants par la formalisation stricte du modèle basé sur les « humeurs » et dont la phytothérapie actuelle reste teintée.
La forme galénique désigne la manière dont sont mis à disposition les principes actifs d’une substance pour être utilisés dans un remède. En phytothérapie, les substances sont généralement des plantes ou des champignons. Il s’agit donc de la manière de transformer une substance pour extraire et absorber le maximum de ses principes actifs. Concrètement, une tisane, une gélule (ou cachet), un baume, une alcoolature.... sont des formes galéniques.
On appelle « solvant » la base utilisée pour extraire les principes actifs. Le solvant peut être de l’eau, de l’alcool, de l’huile, etc. et on ne va pas extraire les mêmes principes actifs suivant celui que l’on utilise. Avec une même plante, on n’aura donc pas forcément les mêmes propriétés suivant le solvant utilisé / la forme galénique choisie. Une plante a souvent sa forme galénique de prédilection, sa meilleure potentialité. Mais une même plante peut en avoir plusieurs suivant l’usage souhaité : citons par exemple le calendula qui va être utilisé en macérat huileux pour les problèmes de peau et en tisane pour ses propriétés digestives et mucilagineuses (c’est-à-dire adoucissantes).
Il y a aussi des formes galéniques dites « non extractives » comme lorsqu’on réduit en poudre une plante ou qu’on la mange directement (mais c’est assez rare).
1 . Les différentes formes extractives en phytothérapie

Extraction par l’eau :
tisane, décoction, macération à froid
On va extraire toutes les molécules hydrosolubles, comme les mucilages (qui adorent l’eau) ou les tanins. On parle en général de tisane, mais, en vérité, il y a des subtilités.
• INFUSION : On place les plantes dans l’eau froide, quand ça commence à frémir, on couvre et on laisse infuser 10 minutes. Le résultat s’appelle un infusé.
• DÉCOCTION : pareil mais on fait bouillir entre 2 et 10 minutes, parfois 30 minutes (pour une décoction en usage externe par exemple). Le résultat s’appelle un décocté.
• MACÉRATION : on laisse les plantes dans l’eau froide pendant un temps variable selon la plante (plusieurs heures).
• DIGESTION : macération dans l’eau chaude (mais < 100°). On ne garde jamais une tisane plus de 24h. En général on utilise une cuillère à soupe de plantes pour 3/4l d’eau froide, mais ça peut dépendre des plantes. Pour les parties fragiles (comme les fleurs), on fera une infusion, tandis que pour les parties plus solides (comme les racines), on fera une décoction.
Extraction alcoolique : alcoolature, teinture, teinture-mère
L’alcool est un bon solvant, car il va extraire une grande partie des molécules présentes dans la plante, dont beaucoup qui ne seraient pas extraites uniquement avec de l’eau.
• TEINTURE - MÈRE : réalisée en laboratoire, elle ne peut pas se faire sans matériel et mesures spécifiques. Les plantes fraîches sont mises dans de l’alcool à 60°, mais en utilisant la proportion d’alcool nécessaire par rapport à la plante sèche. Il faut donc connaître la quantité d’eau dans la plante fraîche. C’est la base de l’homéopathie (c’est la teinture-mère qu’on dilue ensuite). Souvent, les teintures-mères sont diluées au moins 1 fois quand on les achète en pharmacie. On la consomme diluée ensuite (dans du sucre, du miel ou de l’eau) car c’est très fort et concentré.
• ALCOOLATURE : c’est un peu la même chose (et on utilise parfois l’un ou l’autre terme de manière indistincte). Elle se fait à base de plantes fraîches aussi (enfin, séchées 2 heures) mais elle est bien moins précise en terme de proportion qu’une teinture-mère. Elle peut donc être faite de manière artisanale. On utilise un alcool entre 60 et 95°, plus titré (c’est-à-dire plus fort), pour éviter que la macération ne moisisse.
• TEINTURE : c’est une macération alcoolique à base de plantes sèches. Elle peut se faire chez soi avec de l’alcool un peu fort (à partir de 45°) et une balance. On laisse en général macérer un mois.


Extraction lipidique
Ce sont les macérats huileux. On place les plantes (fraîches ou sèches en fonction de la plante) 21 jours dans de l’huile. Le plus souvent, on maintient le macérat dans l’obscurité et à la chaleur (qui permet d’extraire plus vite). Si on ne veut pas attendre, on peut le chauffer au bain marie en ne dépassant pas 40° (30 min à 2h). Mais certaines plantes préfèrent macérer au soleil.
Extraction par entraînement à la vapeur d’eau :
la distillation
On place des plantes aromatiques au-dessus de l’eau dans un alambic. On chauffe. L’eau dans l’alambic s’évapore, emmène les essences aromatiques des plantes et redescend dans un petit tube où elle va se re-condenser. On obtient une phase aqueuse (l’hydrolat) et une phase plus légère (l’huile essentielle, HE). L’huile essentielle, ce sont les molécules extraites de la plante. L’hydrolat (ou eau florale), c’est l’eau de la base qui s’est chargée avec un soupçon d’huile essentielle. C’est beaucoup plus doux que l’HE et utilisable pour les enfants.
Ce procédé n’extrait que les molécules volatiles, donc une partie seulement des propriétés, mais de manière hyper concentrée. C’est pour cela qu’il y a de grandes différences entre l’usage d’une plante en HE ou en tisane. Par exemple, il n’y a pas les mucilages, et la concentration n’a rien à voir.
Cela ne fonctionne qu’avec des plantes aromatiques (c’est-à-dire qui possèdent des molécules aromatiques, qui peuvent se volatiliser) comme la lavande, le thym, le romarin... Beaucoup de plantes de la famille des lamiacées sont aromatiques.
Macérât glycériné
C’est une extraction réalisée avec de la glycérine alcoolisée (mélange eau-alcool-glycérine, qui maximise les capacités d’extraction). C’est notamment utilisé en gemmothérapie (thérapeutique basée sur l’usage des bourgeons). Certains praticiens remplacent la glycérine par du miel. On place les bourgeons les plus frais possible dans le macérat.

2. Conservation/transformation des extractions

Les formes galéniques sucrées à ingérer
A partir d’une extraction ou d’une autre, on peut lancer un processus de transformation pour rendre l’ingestion plus facile et/ou la préparation plus facile à conserver.
Il est possible par exemple de faire des sirops à partir d’une extraction à l’eau. La quantité de sucre à rajouter joue surtout sur la conservation. Plus on met de sucre, plus le sirop se conserve à l’air libre (un maximum de 50/50 en poids entre sucre et infusé). Sinon, il faut conserver le sirop au frigo et parfois moins de trois mois.
On peut aussi faire des mélittes : ce sont des sirops de miel. Ou encore des élixirs c’est-à-dire des sirops d’alcool.
Les formes galéniques pour se tartiner

Les baumes, crèmes, pommades, cérats, sont différentes manières de conserver un macérat huileux, un hydrolat, et permettent d’obtenir différentes textures. On peut les faire soi-même (cf. le célèbre baume choc, recette trouvable dans Les Ateliers du Groupe Soin, Vol. 1).
Une pommade est une préparation à usage externe, de consistance molle ayant pour base un ou des principes actifs avec un corps gras (parfois un peu solide, type huile de coco).
La crème est une pommade coupée à l’eau ou l’hydrolat, donc c’est une émulsion (eau et huile mélangées).
Le baume est un mélange entre corps gras (qui peut être un macérat huileux), de la cire pour solidifier et des huiles essentielles. Pas d’émulsion, pas de phase aqueuse. Vieille appellation pour les trucs qui sentent fort (embaumer !)
Enfin, le cérat est une pommade, avec une phase aqueuse et de la cire.
Autres façons de se soigner par les plantes
– La fumigation : on fait brûler la plante séchée (de la sauge par exemple) et on laisse la pièce et l’air s’imprégner de l’odeur (un peu comme pour de l’encens).
– L’inhalation : on met la plante ou, le plus souvent, l’huile essentielle, dans de l’eau très chaude et on fait circuler la vapeur dans nos sinus en inspirant au dessus du bol (la vapeur d’eau en tant que telle a déjà la capacité de nettoyer les sinus).
– La diffusion : on met la plante ou, le plus souvent, l’huile essentielle, dans de l’eau très chaude et on place le bol dans un coin de la chambre pour respirer les effluves pendant qu’on dort. Et puis il y a aussi : les gargarismes, les bains de bouche, les bains de pieds, etc. où on utilise en général des décoctés concentrés.

3. Où trouver les plantes ?
On peut les acheter en herboristerie, chez de petit.e.s producteur.rices.s ou cueilleur.euse.s. On trouve de plus en plus d’huiles essentielles et de gemmothérapie dans les bio et parapharmacies.
On peut aussi les cueillir et faire ses préparations soi-même quand on est sûr.e.s de les reconnaître (comme les champignons). Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir toxique de certaines plantes si l’on se trompe (ne pas confondre consoude et digitale, ciguë et carotte sauvage, etc.). Au-delà de ça, voici quelques petites recommandations.
Il faut éviter de cueillir sur d’anciens sites industriels, au moins à 3 mètres des routes, voire davantage pour les voies plus passantes. On ne ramasse pas plus d’1/5 de la quantité de la plante sur le site, on prend ce dont on a besoin (quantité, variété) et on les ramasse plutôt le matin, par temps sec. Le séchage se fait à l’abri de la lumière, dans un endroit chaud et aéré, le plus étalé possible.
La conservation des plantes se fait dans des bocaux avec des couvercles en liège ou dans des sacs en papier. La lumière et l’humidité sont vraiment mauvaises pour la conservation. En général on dit qu’on peut les garder un an, mais dans de bonnes conditions c’est plus. Pour les aromatiques, c’est facile, il suffit de les sentir : s’il n’y a pas d’arôme, au compost !
Bonus : Fragments de pharmacopée chinoise

Comme la plupart des pharmacopées, la pharmacopée chinoise utilise beaucoup de plantes séchées et réduites en poudre pour en faire des décoctions ou des infusions. Elle a cependant recours à des formes moins classiques puisqu’elle considère qu’il y a beaucoup de passage vers l’intérieur du corps via les méridiens et les points d’acupuncture. Il n’est donc pas rare de faire des « patchs » de pharmacopée. Et cela a permis de développer un ensemble de pratiques autour de la moxibustion. Il s’agit de faire pénétrer dans l’organisme l’énergie d’une plante, de l’armoise dans la quasi totalité des cas, via sa combustion, l’armoise étant LA plante tonifiante de la médecine chinoise. Pour se faire, cette armoise est séchée plusieurs années.
On peut l’utiliser telle quelle, sous forme de « bourre » c’est-à-dire déchiquetée. On fait des petits cônes de plantes séchées qu’on pose sur un support (du gingembre, de l’ail, du gros sel voire une aiguille en fonction de ce que l’on veut faire : le gingembre est piquant, il va nourrir et réchauffer, notamment le Poumon ; le gros sel sera bon pour les Reins et fera sortir l’humidité, etc.) et on va allumer le cône. La chaleur et l’énergie de la plante vont alors pénétrer peu à peu à travers le « support ». On attend que le cône ne dégage plus, ni fumée ni chaleur et on réitère l’opération, trois à neuf fois.
Les moxas existent aussi sous forme de « cigare ». Ils serviront également à chauffer et énergiser certains points ou certaines zones.
L’effet placebo

Commençons par un petit exemple. On teste des patient.e.s qui ont des douleurs. Au groupe A, on dit qu’ils vont avoir de la morphine et on leur en injecte. Au B, on ne dit rien mais on lui donne de la morphine. Au C, on dit qu’ils vont avoir de la morphine mais il n’y a pas de produit actif dans la seringue. Au D, on ne dit rien et on leur injecte un produit non actif.
Qui aura le moins mal à votre avis ? Dans l’ordre : A, C, B, D.
Donc le groupe à qui on a dit qu’ils auraient de la morphine et qui n’en ont pas eu (C) a moins mal que le groupe à qui on n’a rien dit mais à qui on a donné de la morphine (B).
L’effet placebo plus puissant que le médicament ?
0. Idées reçues sur le placebo

Quand on pense placebo, on pense, la plupart du temps : leurre, faux médicament (et par la même occasion fausse maladie bien souvent), auto-persuasion, somatisation, expérimentation, expérimentation en double aveugle, eau sucrée (qui sert parfois à qualifier l’homéopathie...). L’imaginaire autour du placebo est donc presque toujours dépréciatif, et le jugement péjoratif (c’est-à-dire qu’il dévalorise ce qu’il qualifie). Il y a l’idée de sous-remède qui fonctionnerait parce que nous sommes encore trop souvent des êtres irrationnels soumis à des régimes de croyances diverses et variées.
Si l’usage du terme placebo dans son sens médical remonte au 18 e siècle, son histoire ne commence à être faite que dans les années 60 par le couple Shapiro. Leur définition, qu’on peut résumer par « ne rien donner et ça a un effet », n’est pas neutre et ne correspond pas aux usages plus anciens du terme. Un des sens du terme, par exemple, permettait de décrire certaines tactiques déployées par les médecins, tactiques de « roublards » pourrait-on dire : pour gérer les moments d’incertitudes, le médecin donnait quelque chose qu’il considérait comme sans effet, un remède anodin au regard de la maladie mais qui permettait de temporiser et donc de garder ses patient.e.s. Littéralement, Placebo en latin, c’est « je plairai ». À l’époque, il y a cette idée que si un médecin ne donne rien à ses patient.e.s, ces dernier.ère.s ne seront pas content.e.s.
Aujourd’hui, le placebo a pris une autre place : un sondage de 2008 aux États-Unis révélait qu’environ 50% des médecins américain.e.s prescrivaient des placebos à leurs patient.e.s si aucun traitement efficace n’était disponible car, globalement, les placebos permettent aux patient.e.s de se sentir mieux.
1 . Le vrai médicament et le fantôme du placebo

Aujourd’hui, nombre de recherches sont organisées autour de l’effet placebo. Autant pour valider un nouveau médicament (agit-il plus qu’un placebo ?) que pour continuer à essayer de percer les mystères du placebo.
Pour le mesurer, on fait des tests en « randomisation double aveugle », c’est-à-dire des études dans lesquelles ni les soignant.e.s ni les soigné.e.s ne savent s’ils/elles prennent/donnent un placebo, la répartition ayant été faite au hasard et tenue confidentielle. Par contre, tout le monde sait qu’il y a possiblement du placebo. Cette méthode est caractéristique de l’Evidence Based Medecine (EBM ou Médecine fondée sur les preuves), d’autant plus si les résultats sont publiés dans une revue scientifique avec comité de lecture. Malgré un net penchant de l’EBM pour mettre l’accent sur toute la panoplie de labo plutôt que sur la dimension « qualitative », la relation thérapeutique s’est re-trouvée comme facteur décisif. La nécessité (désormais démontrée) de « prendre soin » des gens, d’inclure du « care » dans le « cure » et de remettre la personne au centre du soin a relancé les études sur le placebo, notamment avec les recherches sur la prise en compte de la douleur (peu considérée jusqu’alors puisque difficile à objectiver).
En 2017, des chercheur.euse.s de la faculté de psychologie de l’Université de Bâle sous la direction de Cosima Locher et leurs collègues de la Harvard Medical School à Boston ont testé l’efficacité de médicaments placebos ouvertement désignés comme tels dans une étude expérimentale. L’expérience consistait à chauffer l’avant-bras de 160 patient.e.s jusqu’à ce que ils/elles ne le supportent plus. Dans tous les cas, on a appliqué une crème sur la zone chauffée, mais l’information la concernant était variable : soit c’est un antidouleur, soit c’est un placebo (noté sur le tube et expliqué) ou encore aucune explication (mais avec le terme placebo bien lisible sur le tube). Les personnes avec des explications ont ressenti une diminution significative de la douleur. Les chercheur.euse.s concluent de cette expérience que les placebos ont des effets même s’ils sont désignés comme tels, mais uniquement lorsqu’ils sont accompagnés d’explications.

2. Placebo et actions chimiques

Placebo et antidépresseurs
Irving Kirsch, professeur de psychologie à l’Université de Hull en Angleterre, a longuement étudié les effets comparés des placebos et des antidépresseurs. Ces derniers ont été conçus pour avoir une action chimique sur l’organisme. D’après l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament), tous les antidépresseurs présentent la même efficacité clinique, que ce soit les inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO), les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS), les antidépresseurs tricycliques (ATC) ou leurs collègues. Pourtant, « la différence d’amélioration entre les patients prenant des placebos et ceux prenant des antidépresseurs n’est pas très importante. Cela signifie que les personnes souffrant de dépression peuvent aller mieux sans traitement chimique ». Voir le livre Dépression : Le mensonge des antidépresseurs , Mosaïque Santé, 2013

Placebo et gestion de la douleur
Fabrizio Benedetti, un neuroscientifique italien, professeur de physiologie à l’université de Turin, a déterminé les chemins neurobiologiques du placebo dans le cas des antidouleurs. Il a mis en place des études pour comparer l’évolution des
douleurs en fonction de l’intervention médicale. Des personnes recevaient des injections de capsaïcine aux mains et aux pieds, provoquant une sensation de brûlure, et il s’agissait d’observer l’évolution de la douleur en fonction de différentes variables : pas d’intervention médicale/soin, administration d’une crème antidouleur (anesthésiant local) à la lidocaïne, administration d’une crème placebo. En parallèle, certaines personnes recevaient une injection de naloxone, une substance qui bloque les récepteurs opioïdes au niveau du cerveau et qui empêche donc une réponse antidouleur du corps (qui se fait via la libération d’endorphines notamment).
L’expérience a montré une nette amélioration de la douleur sur le ou les membres traités avec la crème placebo (les membres non traités restant douloureux). Mais, aucune amélioration n’est constatée quand l’application de la crème placebo est doublée de l’administration de naloxone. Cette dernière annihile donc les effets de la crème placebo. Par contre, lorsque la crème utilisée est la lidocaïne, la naloxone n’interfère pas et la personne est soulagée. On en déduit que le placebo a engendré un circuit opioïdergique au niveau cérébral/général (puisque la naloxone interfère), mais avec un réseau de diffusion localisé (puisque seuls les membres traités avec la crème placebo sont soulagés, pas les autres) ce qui peut sembler tout à fait paradoxal. Une conclusion qui, loin de clore le débat, ne fait que l’ouvrir.
Voir : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01593054/document
3. Pourquoi et comment ça marche ?
Ceci est une expérience commune. Nous avons mal quelque part – à la tête, au ventre, à la gorge... Nous prenons, à un moment donné, la décision de prendre un médicament et l’effet est immédiat, c’est-à-dire qu’il survient avant même que la substance/molécule ait réellement pu pénétrer l’organisme et faire effet. Pourtant, ce n’est pas non plus une guérison spontanée. Sans la prise, le problème aurait perduré.
Effet placebo. Mais pourquoi et comment ?
Plusieurs éléments sont mis en avant pour expliquer l’efficacité de l’effet placebo :
– le traitement se place dans un contexte qui fait sens pour la personne ;
– la forme galénique va avoir une importance (on est plus réceptif à une injection qu’à un comprimé) ;
– la maladie en cause/type de trouble (notamment la douleur et les maux chroniques) ;
– le conditionnement (l’habitude de prendre une substance, les effets continueront avec un placebo qui y ressemble) ;
– la foi dans la médecine ;
– le discours sur le traitement (si la prescription est faite avec conviction ou non) ;
– la relation soignant-e/soigné-e.
Loin de répondre à la question du pourquoi et du comment, cette liste et les études ne font que soulever plus de questions. Le placebo vient jeter le trouble dans les classifications. Un peu comme l’ornithorynque qui est mi-mi ou ni-ni (mammifère-oiseau). Au fond, le mystère de l’effet placebo reste pour l’heure insaisissable et rétif aux systématisations.
4. Le vrai et le faux en question


Une fois accepté qu’il y a quelque chose du placebo qui échappe pour l’heure aux raisonnements scientifiques, on peut s’interroger non pas tant sur ce qu’il est exactement que sur ce qu’il dit de notre rapport à la médecine, au soin, au corps, etc. En creux ou en négatif, il nous permet de toucher du doigt la façon dont la vérité, la santé et le soin se sont construits, probablement autant qu’il renseigne sur comment fonctionne le corps. On sent bien qu’il y a, avec lui, toute une bataille sur le vrai et le faux (le vrai/faux remède, le vrai/faux médecin, le vrai/faux malade), voire le bon et le mauvais (tant la science n’est pas débarrassée de présupposés moraux). Sans compter que certaines entreprises sont passées maîtres dans l’art de produire du doute et de l’ignorance (agnotologie). En gynécologie, il y aurait ainsi des vraies règles et de fausses règles (sous pilule). En psychiatrie, on entend parfois parler de vraies hallucinations auditives (la région de l’audition dans le cerveau est activée) VS de fausses hallucinations... Les études sur les effets placebo ne laissant aucun doute sur leur efficacité, remettent en question ces catégories de vrai médicament, mais aussi de vraie maladie, vrai symptôme. Et n’en finissent pas de re-poser la question du rapport ou plutôt de la séparation entre le corps et l’esprit, séparation qui a aussi amené des rôles propres à chacun d’eux, parfois une hiérarchie : le corps dit vrai, l’esprit trompe (dit faux). Une fois posé cet arrière-fond, quoi de plus simple pour le corps médical que de passer à travers/outre ce que son/sa « patient.e » lui dit.

II) Systèmes

Le système endocrinien
Le système endocrinien est fondamental dans le maintien de l’homéostasie, c’est-à-dire dans la capacité du corps à équilibrer et réguler en permanence les différentes fonctions dont il est constitué. C’est un système fin et complexe dont il ne sera donné ici que les grandes lignes. L’étymologie du mot endocrine provient du grec endos, « à l’intérieur » et krino « sécréter ». Le système endocrinien se compose des hormones et des glandes qui les produisent.
Les hormones ? Ce sont des substances chimiques fabriquées par les glandes endocrines déversées directement dans le sang. Elles circulent dans l’organisme vers d’autres organes et tissus au niveau desquelles elles exercent leur influence. Chaque hormone intervient dans de nombreux processus (dire qu’une hormone n’a qu’un rôle reste donc très inexact – exemple : endorphine = hormone du bonheur, alors que ce n’est même pas spécifiquement une hormone). Leur rôle est de réguler les différents métabolismes présents dans le corps humain. C’est un système fonctionnant en cascade. Un premier chemin va des glandes situées dans le cerveau vers les glandes périphériques. Mais le système est bien plus complexe et on peut distinguer encore deux autres cas de figures de production d’hormones : 1. par une glande spécialisée dans la production et sécrétion d’hormones (comme la thyroïde) ou 2. par un organe ayant plusieurs fonctions dont une endocrine (le rein par exemple).
L’hypothalamus
C’est une glande située au centre de l’encéphale. Elle produit et libère des hormones à destination unique d’une autre glande dont elle contrôle l’activité : l’hypophyse. Ce contrôle est exercé via des hormones qui vont stimuler (hormones libératrices) ou freiner (hormones inhibitrices) le fonctionnement hypophysaire.

Concrètement, il donne des ordres à l’hypophyse qui communique avec les autres glandes. Aussi appelé « cerveau endocrinien », c’est lui qui dirige toutes les hormones.
L’hypothalamus est régulé à la fois par le système nerveux et par un rétrocontrôle hormonal. La régulation nerveuse se fait via des influx neuronaux stimulant l’activité de l’hypothalamus.
Le rétrocontrôle hormonal se traduit par la capacité de l’hypothalamus à connaître le taux d’hormones circulant dans le sang. Cela lui permet de donner des ordres à l’hypophyse via des hormones inhibitrices ou libératrices.
L’hypophyse (ou glande pituitaire)

C’est une petite glande de la taille d’un petit pois, séparée en deux lobes (anté et post-hypophyse) et suspendue à l’hypothalamus. C’est à travers son lien direct avec l’hypothalamus que l’hypophyse produit plusieurs hormones, qui servent à réguler les autres glandes endocrines. C’est donc une réaction en cascade permettant la stimulation de glandes plus spécialisées (surrénales, thyroïde, testicules, ovaires, etc.), la libération de leurs hormones spécifiques (respectivement, adrénaline, T3/T4, testostérone, œstrogène, etc.), et en bout de ligne, une action directe sur le corps humain (réponse immédiate au stress, régulation de l’humeur, spermatogenèse, ovulation, etc.).
La glande pinéale ou épiphyse
C’est une petite structure en forme de cône à l’intérieur du cerveau. Elle pèse seulement 1g et pourtant elle a un rôle primordial, entre autres, sur le rythme veille/sommeil à cause d’une hormone qu’elle sécrète : la mélatonine. Elle joue un rôle central dans la régulation des rythmes biologiques (saisonniers par exemple).
La thyroïde
Elle pèse environ 30g (c’est la plus grande des glandes endocrines) et a la forme d’un papillon. Elle est située dans la trachée, au niveau du cou. Elle est nourrie par l’iode (c’est pour ça que, lorsque l’on vit dans des zones trop cool avec des risques nucléaires par exemple, des pastilles d’iode sont distribuées, cela permet de saturer la thyroïde et de l’empêcher de capter les radiations). Elle sécrète deux hormones essentielles à de nombreux systèmes du corps humain. De manière non exhaustive, ces hormones favorisent le bon fonctionnement d’organes et systèmes vitaux comme le bon fonctionnement du cœur, le développement du squelette chez l’enfant, la production d’énergie pour les cellules.


Les glandes parathyroïdes
Généralement au nombre de quatre, parfois jusqu’à huit, situées dans le cou, en arrière et à proximité de la thyroïde (2-3 mm de diamètre et 30 à 40mg), elles gèrent, via un système de régulation complexe, l’équilibre entre le calcium et le phosphore dans l’organisme et sont absolument vitales. Sur les premiers cas d’ablation de la thyroïde, on n’avait pas conscience de l’existence de ces petites glandes, qui étaient parfois enlevées avec la thyroïde. Dans ce cas, les patient.e.s décédaient en quelques jours...
Le thymus
Surplombant le cœur, il joue un rôle dans le système immunitaire. Il produit des lymphocytes T (effectivement, c’est pas des hormones) et les hormones (ah ! nous y voila !) permettant à ces globules blancs de reconnaître un antigène, une substance reconnue par l’organisme comme étrangère.
La lymphe transporte les globules blancs vers cet organe, où ils prolifèrent et se transforment en cellules spéciales chargées de lutter contre l’infection. Bien que la fonction du thymus ne soit pas encore complètement comprise, on sait qu’il constitue un élément important dans le développement de l’immunité à l’égard de diverses maladies. De taille plus importante dans l’enfance (lié au développement de cette immunité que l’on nomme « immunité acquise »), elle rétrécit à l’âge adulte une fois le gros de son activité d’apprentissage effectuée.

Les surrénales
Ce sont des glandes qui coiffent chaque rein. Elles sécrètent des hormones, notamment liées à la réponse face au stress. De grandes quantités d’hormones sont libérées chaque fois que le système nerveux sympathique réagit à des émotions intenses, telles que la peur ou la colère. Ce phénomène peut déclencher une réaction de « lutte ou de fuite » au cours de laquelle la pression artérielle et la fréquence cardiaque augmentent, les pupilles se dilatent, et le sang est dirigé en priorité vers les organes vitaux et les muscles squelettiques, le sucre est rendu davantage disponible pour les cellules, etc.
Comme dans l’ensemble du système endocrinien, il existe un phénomène de rétrocontrôle. Lors d’une hémorragie par exemple, la pression artérielle diminue ce qui affecte directement (et potentiellement gravement) le cœur et les organes. Un baromètre surrénalien permet alors en direct la sécrétion d’hormones luttant contre ces phénomènes (par exemple, en rétrécissant le diamètre des artères et des veines ce qui a pour effet d’augmenter la pression artérielle). En dehors du stress, elles interviennent dans l’équilibre hydroélectrolytique, qui est primordial par exemple pour la contractilité des muscles.
Le pancréas
C’est un organe situé dans l’abdomen, en arrière de l’estomac. C’est un organe vital. Parmi les hormones qu’il sécrète, le glucagon et l’insuline sont nécessaires à la régulation de la glycémie (concentration du glucose dans le sang). L’insuline sert à métaboliser le sucre (en favorisant le passage du glucose de la circulation sanguine vers les cellules) alors que le glucagon agît de manière opposée. D’autres hormones (somatostatine et polypeptide pancréatique) interviennent quant à elles dans de nombreux mécanismes digestifs. L’ensemble des hormones pancréatiques interviennent donc également dans le métabolisme des lipides et des protides.
Les différents diabète viennent d’une dysfonction du pancréas. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune qui détruit les cellules du pancréas qui produisent l’insuline. Le diabète de type 2 est un phénomène complexe (liant des prédispositions à une consommation importante et prolongée de sucre) qui rend les cellules résistantes à l’insuline et épuise le pancréas (qui devient incapable d’en produire). Dans les deux cas, un apport d’insuline via des injections peut être proposé.
Les ovaires et les testicules
Elles sont contrôlées directement par l’axe hypothalamo-hypophysaire. Les ovaires produisent principalement de l’œstrogène et de la progestérone (mais aussi de petites quantités de testostérone) qui servent à développer et maintenir les caractéristiques sexuelles secondaires dites « féminines » et ont un rôle prépondérant dans la reproduction.
Les testicules produisent principalement de la testostérone, qui sert à développer et maintenir les caractéristiques sexuelles secondaires dites « masculines » et a un rôle prépondérant dans la reproduction.

Du système immunitaire aux allergies

Pour bien comprendre les allergies, il est nécessaire d’expliquer au préalable comment fonctionne le système immunitaire et ce qu’est une réaction inflammatoire.
Le système immunitaire
D’une manière générale le système immunitaire est présenté comme une armée. C’est la vision occidentale. On aurait sans doute pu faire autrement pour se figurer les fonctionnements de ce système... mais là y a rien qui nous vient. Ses objectifs sont : 1. de maintenir l’intégrité de l’organisme ; 2. d’assurer son rétablissement ; 3. d’être capable de reconnaître le soi et le non-soi. Quand cette fonction déconne, c’est le cas des maladies auto-immunes, le corps ne reconnaît pas ses propres cellules et les attaque. Il y a deux formes d’immunité : innée (non spécifique) et adaptative (spécifique).

L’immunité innée
Elle est présente dès la naissance. C’est une barrière dont l’efficacité ne nécessite pas de contact préalable avec un agent infectieux. Seule la constitution génétique de l’individu garantit son efficacité. Elle est la première ligne de défense contre les infections et se compose de barrières externes et internes.
La barrière externe est constituée de 3 éléments : la peau, les tissus épithéliaux et la flore bactérienne commensale. Son rôle est d’empêcher les agents infectieux de se retrouver dans le milieu interne (sanguin). La peau est imperméable
à la majorité des agents infectieux. Les tissus épithéliaux (bordant des cavités, comme les muqueuses ou encore l’estomac, l’intestin, etc.) sécrètent entre autre du mucus (liquide visqueux emprisonnant les agents infectieux) qui est évacué hors du corps. Enfin, la flore commensale (c’est l’ensemble des bactéries présentes sur/dans la peau et les muqueuses) tient un rôle important dans l’immunité car ces microbiotes font concurrence aux agents pathogènes. Les bonnes bactéries, vivant en symbiose, ne laissent pas la place aux mauvaises pour s’installer.
La barrière interne, elle, déclenche une réponse immunitaire non spécifique via les globules blancs, puis la réaction inflammatoire. En voici les deux grandes étapes :
– Parmi les globules blancs, on trouve des cellules sentinelles de l’immunité dont le rôle est de repérer des cellules étrangères, de lancer un signal d’alerte via des molécules afin d’obtenir des renforts et de faciliter leur transport dans le sang. L’histamine libérée par des mastocytes (un type de globule blanc), par exemple, permet de provoquer une vasodilatation des vaisseaux sanguins et une augmentation de sa perméabilité. C’est-à-dire que les vaisseaux gonflent pour faire circuler plus de sang et ainsi permettre l’arrivée de nombreuses cellules protectrices (macrophages) venues en renfort. Ces vaisseaux deviennent poreux pour laisser passer les renforts. La vasodilatation provoque des rougeurs, de la chaleur et des gonflements.
– Toutes les cellules concernées sont arrivées sur les lieux et se mettent au boulot. Débute alors la phagocytose (du grec phago : manger, cytose : cellule). C’est-à-dire que les cellules microphages et macrophages adhèrent aux agents pathogènes, les ingèrent puis les digèrent pour les détruire. En parallèle, l’information est aussi transmise à l’immunité adaptative pour une action complémentaire.
L’immunité adaptative ou immunité acquise
Elle résulte d’une adaptation du système immunitaire aux différents microbes rencontrés depuis la naissance. Elle nécessite donc un contact préalable avec des agents infectieux pour être efficace. Elle a quatre particularités : l’immunité acquise est dite « spécifique » (un anticorps se fixe à un antigène spécifique) ; « diversifiée » (capacité du système immunitaire à réagir via les lymphocytes B et T face à un nombre infini d’agresseurs) ; « dotée de mémoire » (par sa capacité à se souvenir des antigènes déjà combattus afin de réagir plus rapidement et plus efficacement) et, enfin, capable de « discernement entre le soi et le non-soi » (capacité du système immunitaire à reconnaître les cellules auxquelles il appartient de celles étrangères à notre corps).
Grossièrement, l’immunité adaptative utilise deux types de cellules : les Lymphocytes B et T, qui sont produits par la moelle osseuse. Les B (pour « bone », os en anglais) finissent leur maturation dans la moelle osseuse pour apprendre des techniques d’immobilisation. Les T finissent leur maturation dans le Thymus pour apprendre le combat au corps à corps. Ces lymphocytes sont ensuite stockés dans les organes lymphoïdes secondaires dont font partie la rate et les multiples ganglions répartis un peu partout dans le corps. Dans les ganglions, on trouve des centaines de lymphocytes différents, et chacun va devenir spécialiste d’un pathogène spécifique. Ce sont eux qui produisent les anticorps. Les anticorps ne détruisent rien, ils neutralisent (ex : ils se fixent sur un virus et l’empêche de rentrer dans une cellule). Ils permettent aussi l’agglutination, c’est-à-dire qu’ils sont capables de fixer des cellules pour empêcher leur dissémination. Et enfin, ils font de la précipitation : ils immobilisent des molécules.
Au cours de la réaction inflammatoire, certaines cellules sont chargées de récupérer un échantillon du pathogène pour aller le présenter aux cellules de l’immunité adaptative.
Comme il existe pleins de lymphocytes différents, il faut trouver le bon. Une fois que le bon lymphocyte a été identifié pour aller mener la bataille, il est cloné et envoyé via le sang ou la lymphe pour rejoindre la zone de grabuge.
Les lymphocytes B vont créer des anticorps spécifiques pour immobiliser les pathogènes, et inactiver leur prolifération, sans les éradiquer. Ce sont alors les cellules macrophages qui vont s’occuper de manger le pathogène en vue de les éradiquer.
Les lymphocytes T vont tuer au corps à corps les cellules infectées par le pathogène, et les débris seront alors mangés par les macrophages.

La réaction inflammatoire

L’inflammation est la réaction du système immunitaire à une agression externe (infection, trauma, brûlure, allergie, etc.) ou interne (cellules cancéreuses). Une réaction inflammatoire provoque 4 grands symptômes :
– la douleur due aux signaux de danger envoyés par les molécules, et par la surpression de l’afflux sanguin dans une petite zone ;
– la chaleur : la peau n’est qu’à 34° et le sang à 36,8°. La présence d’une grande quantité de sang fait augmenter la température localement ;
– le gonflement : les vaisseaux se dilatent ;
– la rougeur : il y a une plus grande quantité de sang localement donc plus de globules rouges, et cela se voit par transparence sur la peau. Attention, la réaction inflammatoire n’est pas synonyme d’infection. Ce n’est pas non plus un dysfonctionnement du corps mais bien une réaction visant à régler un souci local. Limiter cette réaction peut être néfaste au processus global de réparation. Parfois cette réaction s’emballe et devient « pathologique ».
L’allergie

Les allergies concernent plus de 20 % de la population occidentale et est en constante augmentation sur les 30 dernières années. Les explications sont à chercher du côté de la forte pollution, de la diminution de la pression infectieuse (hygiène, antibiothérapie), des modifications des habitudes alimentaires (donc du microbiote humain).

On évoque comme facteurs protecteurs : la vie de famille (dans le sens la vie à pleins, où l’on échange les infections, les bactéries... L’immunité, c’est une histoire collective !), la proximité avec les animaux, la faible utilisation d’antibiotiques pendant la petite enfance. Il y a aussi une forte influence de l’âge et de la génétique. On parle alors d’atopie : la tendance génétique (héréditaire) à développer des syndromes allergiques. Le système immunitaire fabrique des anticorps IgE spécifiquement dirigés contre une substance allergène. Les principales manifestations de l’atopie sont l’asthme, la rhinite et conjonctivite allergique et la dermatite atopique.


Une allergie, c’est une réaction anormale et excessive du système immunitaire acquis (ou adaptatif) suite à un contact avec une substance étrangère (un allergène).
Le corps sur-réagit au contact de ce qu’il considère comme un élément à combattre, et provoque une réaction inflammatoire en réaction.
On distingue plusieurs catégories d’allergènes.
– Les pneumallergènes ou aéro-allergènes : ils pénètrent l’organisme par voie aérienne et respiratoire. Les plus fréquents sont les acariens, les poils d’animaux, les pollens et les moisissures.
– Les trophallergènes : ils pénètrent le corps par ingestion (voie alimentaire). Tous les aliments sont capables de déclencher une allergie, mais les principaux sont le lait de vache, les œufs de poule et l’arachide.
– Les allergènes de contact : boucles et boutons de jeans, fermetures éclair, montures de lunettes, bijoux, de nombreux accessoires contenant du nickel ou du chrome, les produits cosmétiques et parfums, etc.
– Les venins d’hyménoptères : abeilles, guêpes, frelons, bourdons...
– Les médicaments : les antibiotiques, et en particulier les béta-lactamines, sont les principales substances à l’origine d’allergies médicamenteuses. Comme pour les aliments, tous les médicaments peuvent être responsables de réactions allergiques.
La première étape de l’allergie, c’est la sensibilisation, au cours de laquelle le corps rentre en contact avec un allergène et produit les anticorps qui pourront attaquer l’allergène dès la deuxième rencontre.
La seconde étape est donc le déclenchement de la réaction allergique. Le corps reconnaît un antigène avec lequel il a déjà été en contact et s’y attaque via les anticorps produits suite au premier contact avec cet antigène.
La majorité des allergies sont causées par une classe d’anticorps, les immunoglobulines de type E (IgE). Ces anticorps sont couramment fabriqués par le système immunitaire. Ils circulent dans le sang et sont aussi associés à des cellules du système immunitaire particulièrement nombreuses dans la peau, les poumons et le tube digestif. Cela explique la localisation des symptômes allergiques.
Principes thérapeutiques
L’éviction de l’allergène est le plus évident et le plus logique mais ce n’est pas toujours possible (essayez de ne plus croiser de pollen, d’acariens ou de poussière pour voir) ni agréable (se priver de sorties chez des ami.e.s qui ont un chat ou des acariens domestiques, c’est toujours un peu triste).
En pharmacologie, pour traiter les causes il existe la désensibilisation qui a pour but de rendre la personne tolérante vis-à-vis de l’allergène responsable. C’est une sorte de traitement vaccinal des allergies, reposant sur l’administration régulière d’extraits allergéniques pendant une période prolongée, idéalement 3 à 5 ans. Néanmoins, les bénéfices sont beaucoup plus précoces, apparaissant nettement au bout de trois ou quatre mois. Pendant longtemps, la désensibilisation se faisait par injections sous-cutanées, hebdomadaires puis mensuelles. Depuis plusieurs années, on tend à lui préférer la voie sublinguale, moins contraignante et mieux tolérée. Il s’agit de prendre le matin des gouttes d’allergènes, gardées deux minutes sous la langue puis avalées. Enfin, des comprimés sont maintenant disponibles pour certains allergènes. L’effet protecteur de la désensibilisation se prolonge habituellement plusieurs années après l’arrêt de celle-ci. Plusieurs études montrent, en outre, que ce traitement réduit le risque de développer d’autres allergies.
Pour traiter les symptômes uniquement, on peut avoir recours par exemple aux différentes classes d’anti-inflammatoires stéroïdiens et aux antihistaminiques. Cela enraye alors certains mécanismes responsables de l’inflammation et les symptômes qui vont avec.
Il existe aussi des plantes antihistaminiques. C’est le cas du plantain (plantago lanceolata) ou de l’origan (origanum vulgare). On peut les préparer en tisane et ils agissent comme les molécules de synthèse.

Témoignages
La piste alimentaire
M. a été très allergique aux acariens, à la poussière et aux poils d’animaux pendant dix ans. Ses symptômes se portaient sur la sphère ORL : rhinites, toux, éternuements, yeux qui grattent. Ils étaient présents au quotidien et ça impactait fortement sa vie sociale. Un jour, une psy lui propose une nouvelle approche pour diminuer les allergies : arrêter les produits laitiers pendant un mois, histoire de voir ce que ça donne. Au bout de 15 jours, les réactions allergiques et leurs symptômes diminuent fortement ! Depuis, en évitant les produits laitiers, plus de 90 % des symptômes ont disparu ! À son avis, ce sont des indigestions qui seraient à l’origine de ces réactions allergiques. Notamment parce que, aujourd’hui, ses symptômes réapparaissent après un repas trop copieux ou trop riche.
Complément : dans le milieu de l’Opéra, il est conseillé d’éviter le lactose dans les périodes de représentations pour préserver la sphère ORL. En phytothérapie, les produits laitiers sont considérés comme favorisant les allergies et produisent du mucus. On retrouve le même principe en médecine chinoise.
Les émotions comme facteurs déclencheurs
C. a des crises d’allergies depuis dix ans plusieurs fois par semaine. Mais ce qui les déclenche n’a pas été identifié et ne semble lié à aucun élément extérieur. Ses réactions allergiques sont souvent déclenchées par des états émotionnels comme la fatigue ou le stress. Dans le cabinet d’un allergologue, on lui parle d’insuffisance respiratoire. Lié à des allergies, le traitement consiste à prendre des antihistaminiques quotidiennement. Rapidement, ça ne lui a pas convenu. Elle est allée voir un acupuncteur qui a travaillé sur la sphère digestive, ce qui a contribué à réduire la fréquence des crises. Puis une autre praticienne de médecine chinoise qui a davantage travaillé sur le côté émotionnel (notamment sur le poumon et l’émotion qu’il abrite : la tristesse). Ces séances ont permis de réduire grandement les symptômes au quotidien (se moucher, éternuer) et d’identifier l’élément déclencheur il y a dix ans : un choc émotionnel. Pour avancer sur cet état émotionnel, elle consulte une psychologue qui pratique l’EMDR* et ça marche plutôt bien. Elle continue ce travail. Aujourd’hui, les crises sont très peu fréquentes (une fois par mois environ) et même quelques journées sans avoir à se moucher ! Pour remplacer les antihistaminiques en cas de crise, elle se fait des tisanes de plantain bien corsées, et prend un temps pour se détendre.
* EMDR : Eye Movement Desensitization and Reprocessing (désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires). Ce type de thérapie sert principalement pour traiter les syndromes de stress post-traumatique, les manifestations corporelles qui font suite à un traumatisme.

Le rôle de l’environnement
X. a eu des allergies respiratoires importantes qui se sont calmées en déménageant. Au lycée, elle a commencé à être asthmatique. Puis elle a changé de ville pour ses études et les crises ont diminué. Et elles ont été encore moins fréquentes quand elle a changé de région. Maintenant, elle ne fait des crises que quand elle est de retour chez ses parents ! Elle a remarqué qu’à la période où elle est arrivée dans un environnement plus pollué et en commençant à fumer, elle ne faisait plus d’asthme ! La conclusion qu’elle fait : elle avait surtout besoin de changer d’environnement... Elle a longtemps cherché un antihistaminique qu’elle supportait bien, qui ne la shoote pas trop, et elle a trouvé ceux à base de molécule de rupatadine. Mais cela dépend de chacun.e, il faut en tester plusieurs pour trouver celui qui nous convient.
Changer d’air
A. fait des crises d’allergies surtout dans les contextes de fatigue et stress. En général, une crise qui se déclenche le matin va durer toute la journée. Dans le même environnement, dans la même pièce, à différents moments de la journée, l’allergie ne va pas forcément se déclencher. Par exemple, elle constate qu’elle est beaucoup plus sensible le matin que le soir. Pour les allergies respiratoires, sa méthode pour un apaisement rapide c’est de changer d’air, prendre une douche ou faire une inhalation (même juste d’eau) voire changer de vêtements (allergies aux acariens). Elle a commencé une désensibilisation depuis deux ans et voit une petite évolution (seuil de déclenchement plus élévé). Elle explore aussi des techniques de recentrage (Yoga) et de rééquilibrage immunitaire (en phytothérapie, cure d’astragale et de plantain).
III) Questions Gynécos

Endométriose

L’endomètre est la muqueuse qui tapisse la cavité interne de l’utérus. À chaque cycle menstruel, sous l’effet des hormones, elle gonfle et crée un environnement propice au développement d’un embryon. Lorsqu’il n’y a pas de fécondation une grande partie de la muqueuse s’évacue par le vagin, ce sont les règles (voir Les Ateliers du Groupe soin Vol. 1).
On parle d’endométriose lorsque du tissu endométrial s’implante ailleurs que dans la cavité utérine. Elle est considérée comme une maladie lorsqu’elle provoque douleurs et/ou infertilité, ce qui est le cas pour une femme sur dix en âge de procréer.

Le tissu endométrial peut coloniser toutes sortes d’organes : il peut pénétrer à l’intérieur du muscle utérin (adénomyose), remonter les tubes utérins (anciennement trompes de Fallope) et s’installer dans les ovaires, se développer dans la vessie, ou dans la cavité péritonéale*, parfois même dans les poumons ou le cerveau (c’est rare et on ne sait pas bien l’expliquer).
Ce tissu est composé de cellules qui conservent toutes les caractéristiques cellulaires endométriales. Ainsi, où qu’il soit, il réagit au bain hormonal du cycle menstruel : il gonfle puis saigne comme lorsqu’il est situé sur les parois de l’utérus. La différence est que, contrairement au sang menstruel, ce sang ne peut pas s’écouler vers l’extérieur ; il s’accumule donc dans la cavité abdominale. Les cellules vont persister à leur nouvelle place, s’implanter sur les organes pelviens et peuvent proliférer à chaque cycle menstruel. De plus, elles sont invasives : elles ne font pas que se coller à une paroi mais peuvent pénétrer les organes ou les muscles.
Cela crée des nodules, des kystes qui évoluent chaque mois en fonction de la sécrétion hormonale de la personne. L’endomètre est alors en situation ectopique (pas à sa place).

Comment le tissu se déplace-t-il ?
L’explication la plus courante repose sur le phénomène de reflux menstruel : les trompes sont perméables, d’un côté avec l’utérus, et de l’autre avec la cavité péritonéale. Pendant les règles, il est possible que du sang remonte par les tubes utérins, passe dans la cavité péritonéale, puis s’implante sur l’ovaire, sur des tissus de la cavité générale (rectum, vagin, les ligaments utéro-sacrés). Ce reflux menstruel existe chez au moins 90% des femmes, et pourtant seulement 10% développent une endométriose. La théorie du reflux menstruel permet de comprendre uniquement la localisation pelvienne. Aucune théorie n’est complètement satisfaisante pour expliquer pourquoi l’endomètre se retrouve plus loin que la cavité pelvienne.
Symptômes
Il existe des endométrioses asymptomatiques, et d’autres symptomatiques. Les symptômes principaux sont :
– dysménorrhée : douleurs pendant la menstruation ;
– dyspareunie : douleurs pendant les rapports sexuels ;
– douleurs dues à des troubles digestifs ou urinaires qui arrivent systématiquement au moment des règles ;
– infertilité, difficulté à concevoir, fausse couche, complication de grossesse. On estime que la moitié des infertilités féminines sont liées à l’endométriose. Suite à plusieurs épisodes d’infertilité, une endométriose asymptomatique peut être découverte de manière fortuite.
Pourquoi ça fait mal ?
Étant situées au mauvais endroit, les cellules endométriales peuvent être combattues localement par les tissus « envahis ». En résulte une réaction inflammatoire très douloureuse.
De plus, ce tissu ectopique cicatrise de façon rétractile et fibreuse. Et à la longue, cela va changer l’anatomie et la physionomie des organes. Ces modifications anatomiques vont être responsables de douleurs. Dans le cas de pénétration d’endomètre dans le muscle utérin, le tissu ectopique va représenter un véritable corps étranger. Le muscle va alors réagir à cette présence et se contracter, comme au moment d’une expulsion (IVG médicamenteuse, accouchement), ce qui est très douloureux. C’est comme un hématome dans le muscle utérin. Ces lésions pénètrent aussi dans les fibres nerveuses, ce qui est très douloureux.
Comment diagnostiquer ?
Les premières observations faites datent du début du 20 e siècle. On la diagnostique depuis 1960. C’est très dur d’obtenir un diagnostic car socialement : « C’est normal d’avoir mal pendant les règles ». On notera quand même des voix montantes en gynécologie qui tendent à détruire ce point de vue (cf. Martin Winckler avec son blog martinwinckler.com ou Daniel Vaiman par exemple). On parle d’une moyenne d’environ sept ans pour parvenir à se faire diagnostiquer. Difficiles à repérer, les lésions sont identifiées par :
– un examen gynécologique : si les douleurs, très fortes, ont une périodicité menstruelle, et que celles-ci sont parfois situées ailleurs qu’au niveau de l’utérus (troubles digestifs ou urinaires), alors il y a une probabilité d’endométriose ;
– une imagerie médicale, meilleur test actuellement pour le diagnostic (scanner qui montre les nodules, échographie endo-vaginale et IRM). Les lésions étant très difficiles à voir, beaucoup de personnes doivent passer par plusieurs types d’imageries pour parvenir à les repérer. À noter qu’avant, on procédait par chirurgie exploratrice, il fallait voir les lésions après avoir ouvert.

Différents stades de l’endométriose
– Superficielle, les cellules restent à la surface des organes ;
– Profonde, les cellules pénètrent dans les muscles et organes ;
– Impacts sur la fertilité, les endométriomes ovariens : kyste aux ovaires ; À savoir qu’il n’existe pas toujours de corrélation entre l’intensité des troubles et le degré de sévérité de l’endométriose.
Causes/origines ?
– Environnement : il est plausible que les perturbateurs endocriniens (pesticides, plastique...) soient en cause.
– Génétique : certaines études parlent de prédisposition génétique à l’endométriose mais les gènes en question semblent encore mal connus et n’expliquent pas à eux seuls l’apparition de la maladie.
– Une hypothèse serait celle d’une défaillance du système immunitaire. Là où la majorité des personnes qui ont des reflux sanguins voit les cellules ectopiques détruites par le système immunitaire, 10% de celles-ci ont peut-être un système immunitaire qui ne fait pas ce travail. On parlerait alors d’une maladie auto-immune.


Quels traitements ?
La recherche médicale bute encore sur un traitement efficace.
– Traitement hormonal pour stopper les règles et prise d’antalgiques pour diminuer la douleur. On parle de ménopause artificielle (traitement de type progestatif : arrêter la production d’œstrogène). Mais cela provoque d’autres dérèglements physiologiques. Un exemple simple, c’est que l’œstrogène participe à la consolidation osseuse donc les problèmes d’ostéoporose sont très courants dans les cas de ménopause artificielle.
– Hormonothérapie avec GNRH : hormone hypothalamique qui va agir sur l’hypophyse et qui va bloquer la production de FSH et de LH dans le cerveau (qui agissent sur la sphère gonadique et utérine).
– Chirurgie : pour retirer les nodules. Mais c’est très invasif et rapidement très lourd s’il y a plusieurs petites zones touchées. Il peut y avoir l’ablation d’un tube utérin et d’un ovaire, des morceaux d’intestin, une partie du rectum avec une convalescence de plusieurs semaines à l’hôpital... Dans les options un peu plus « radicales », certaines personnes se font retirer l’utérus. Cette démarche peut être difficile à obtenir chez les moins de 40 ans car les gynécologues pensent que vous voudrez des enfants... Si c’est la solution retenue, mieux vaut demander à garder les ovaires qui jouent un rôle important dans la libido et ça n’a rien d’anodin.
Mais là on est tous et toutes content.e.s d’apprendre que dans cet univers de loose médicale, la pratique la plus efficace à ce sujet (et même la très ouverte médecine occidentale commence à le dire) semble être la médecine chinoise. On notera que les gynécologues commencent à travailler avec des praticien.ne.s de médecine chinoise pour certains cas d’endométriose (Cf. L’hôpital d’Angers et son service de gynéco). Chercher de ce côté semble être le bon plan.
Sinon, adopter une alimentation anti-inflammatoire (c’est-à-dire retirer le sucre raffiné, le café, la clope, le gluten...) semble très efficace pour réduire les douleurs de manière significative.
Papilloma virus de l’humain (ou HPV)
Le papilloma virus est comme son nom l’indique un... virus, c’est donc un organisme qui s’infiltre dans l’ADN des cellules qu’il infecte. Il y a 120 souches différentes de ce virus, les infections peuvent être cutanées (verrue), ORL ou génitales. Certaines sont à haut risque oncogène (qui favorise le développement de tumeurs), notamment deux à très haut risque, qui sont responsables de plus de 70% des cancers du col de l’utérus (Étude européenne réalisée de 1949 à 2009).
Si le virus arrive à survivre dans le corps et à se développer, il pourra dégénérer en deux types de lésions : les lésions cancéreuses (cancer de l’anus, du col de l’utérus ou de la gorge) ou en lésions bénignes mais bien chiantes comme des condylomes (verrues) sur les organes génitaux et l’anus (dont le traitement repose dans la majorité des cas sur l’ablation à l’azote liquide).
L’HPV est donc une Infection Sexuellement Transmissible tellement répandue qu’on la considère comme le marqueur de l’activité sexuelle. Ainsi la quasi-totalité des personnes actives sexuellement ont été en contact avec le virus. Il est très répandu car il est très fin (il passe à travers la protection comme les préservatifs), et très résistant aux désinfections. Par exemple la Haute Autorité de la Santé a demandé aux gynécos d’augmenter le niveau de stérilisation de leur matériel car un des vecteurs connus du HPV sont les sondes gynéco.
Étapes de développement du virus
C’est une maladie très lente, elle met pour la majorité des personnes entre 15 et 20 ans pour parcourir toutes ces étapes : infection virale, développement du virus au sein des cellules, développement de lésions, forme précancéreuse, cancer. À chaque étape, il y a de fortes chances de régression spontanée, c’est une maladie qui offre le temps de se faire guérir, ou de guérir seul.e. Ainsi 80 % des personnes exposées se débarrassent des virus dans les 3 ans après l’infection. Pour les lésions de bas grade (les premières formes de dégradation du virus en lésions tissulaires), il y a plus de 70 % de cas de régression spontanée. Pour les lésions de haut grade (le plus haut grade de lésion précancéreuse) il persiste encore 30 % de cas de régression spontanée.
Le dépistage
Tout d’abord le dépistage qui sert à détecter une anomalie, une possibilité de maladie.
– Dans le cadre du cancer du col de l’utérus, on utilise le frottis : avec une petite brosse, on frotte au niveau du col de l’utérus pour en prélever des cellules afin d’analyser la forme, la taille, l’aspect au microscope. Il a une très bonne spécificité mais une mauvaise sensibilité.
En médecine, la sensibilité d’un test diagnostic est sa capacité à détecter tous les malades (c’est-à-dire à avoir le moins de faux négatifs), tandis que la spécificité de ce test est sa capacité à ne détecter que les malades (avoir le moins de faux positifs). Dans le cas du frottis, quand il dit qu’il y a une maladie, il se trompe dans 50 % des cas ! Par contre quand il dit qu’il n’y a rien, il a raison dans 97 % des cas !
– Le test HPV : avec une sorte de coton tige en auto prélèvement, on frotte le vagin, puis une analyse est réalisée en laboratoire pour connaître les souches de HPV présentes. Les HPV présents dans le vaginle sont également au niveau du col de l’utérus et inversement. Les recommandations de l’HAS concernant le dépistage du cancer du col ont changé et varient désormais suivant l’âge des patientes :
– de 25 à 29 ans : un frottis tous les 3 ans, après deux premiers tests réalisés à 1 an d’intervalle et dont les résultats sont normaux.
– de 30 ans à 65 ans, : le test HPV, plus efficace pour ces femmes, remplace le frottis. Le test HPV est réalisé 3 ans après le dernier frottis normal. Puis tous les 5 ans, jusqu’à l’âge de 65 ans.

Le diagnostic
Ensuite si le dépistage est positif on s’oriente vers le diagnostic qui détecte de manière certaine et précise la présence d’une maladie. Dans ce cadre une colposcopie est proposée. C’est un examen réalisé par un.e gynécologue qui visualise le col de l’utérus grâce à un spéculum, elle/il y dépose un colorant faisant réagir les tissus qui contiennent le virus HPV et permettant de le localiser. Si une réaction est observée à un endroit, un prélèvement du tissu du col de l’utérus peut être réalisé à l’aide d’une pince pour analyse en laboratoire : c’est une biopsie.
Les traitements curatifs
Le but est d’enlever les zones lésées avant qu’elles ne risquent de se dégrader davantage et n’arrivent au stade de cancer.
Pour les lésions de bas grade, le laser et la cryothérapie peuvent être suffisants. Il s’agit d’enlever les couches supérieures de cellules du col, ce n’est donc pas trop traumatique pour le corps. Ce geste peut se faire en consultation sans être hospitalisé.e.
Plus tard quand le virus s’est enfoui trop profond dans les cellules, une exérèse peut être proposée. C’est le fait de retirer une partie du col.
Deux méthodes existent :
– par conisation : on découpe au scalpel les tissus précancéreux. Les effets secondaires à moyen ou long terme sont possiblement une augmentation des risques de naissance prématurée ou par césarienne après 2 conisations. Par contre, il n’y a pas d’incidence sur la fertilité.
– ou par anse diathermique : c’est le nom de l’instrument utilisé qui est un fil en métal traversé par un courant électrique. Cette méthode est moins traumatique pour les tissus en profondeur.
Les traitements préventifs
Des vaccins existent depuis plusieurs années en France, il est actif uniquement contre les HPV les plus oncogènes et doit être réalisé au début de la vie sexuelle.
Il est nécessaire de mener une réflexion de fond sur la nécessité du vaccin ou son opportunité. Le cancer du col de l’utérus est une pathologie grave et mortelle dont l’incidence peut être radicalement diminuée avec le vaccin. Par ailleurs, cette maladie présente un développement très long dans la grande majorité des cas et il existe aujourd’hui des capacités de dépistage et de prévention très efficaces avec la prise en charge de lésions pré-cancéreuses. Le sujet ne sera pas abordé plus en détail ici.
LES ATELIERS DU GROUPE SOIN VOL . III – 2019/2020
Pour nous contacter : groupesoin@@@riseup.net
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (3.3 Mio)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (3.3 Mio)