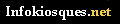C
Combattre la biométrie
Appel à soutien
mis en ligne le 24 octobre 2007 - Collectif anti-biométrie
Combattre la biométrie
Appel à soutien
En 2004, les industriels de micro-électronique (Gixel) publiaient leur Livre Bleu conseillant au gouvernement de faire accepter la biométrie par le conditionnement des plus jeunes, et prescrivaient une « éducation dès l’école maternelle » pour les technologies susceptibles d’être mal accueillies et de susciter des résistances populaires.
Dès 2005 cette propagande se matérialise avec l’installation progressive de bornes biométriques dans les établissement scolaires pour gérer l’accès des élèves à la cantine, comme dans une école maternelle à Angers ou au lycée de Gif-sur-Yvette, dans l’Essone (91), parmi tant d’autres.
Le 17 novembre 2005, une vingtaine de clowns sont allés dans ce lycée de la Vallée de Chevreuse pour y détruire les bornes biométriques et inviter les élèves du lycée à se poser quelques questions sur ces nouvelles machines. Trois d’entre eux ont été arrêtés, puis jugés le 20 janvier 2006, pour « intrusion dans un établissement scolaire et dégradation de biens privés à usage public en réunion ». Ce jour-là, les inculpés ont tenté d’expliquer leurs motivations, soutenus par de nombreuses personnes venues témoigner et manifester, par leur présence, leur hostilité à ces dispositifs. Mais ni les inculpés, ni les témoins n’ont eu la parole, si ce n’est pour s’en tenir strictement aux faits. Ils ont été condamnés à trois mois de prison avec sursis chacun, 1 500 euros d’amende et 9 000 euros de dédommagement pour le lycée.
Les dispositifs biométriques ont d’abord été installés dans des zones dites « sensibles » (prisons, aéroports...). Ils se multiplient depuis quelques années dans de nombreux domaines de la vie quotidienne. « BIO-MéTRIE », c’est-à-dire la mesure de parties du corps (iris de l’œil, empreintes digitales, contour de la main, du visage...) ou de comportements (démarche, manière de signer...) propres à chaque individu. Les parties de mon corps sont numérisées, puis enregistrées dans des bases de données, et réactivées à chaque fois qu’il faut m’identifier. Ce n’est plus ma parole qui compte, la confiance ou le conflit entre humains, mais la vérification systématique de données par une machine. C’est l’ordinateur qui décide, instance supérieure, qui rationalise les décisions humaines selon des protocoles binaires. Plus de négociations possibles, de droit à l’erreur, ni à l’oubli. Tu mets ta main dans une machine, et selon des critères prédéfinis, la porte s’ouvre – ou pas. Ne nous voilons pas la face : il existe une demande sociale en faveur de ce type de contrôle ; et comme pour le GPS ou les caméras de surveillance, cette demande n’émane malheureusement pas que des flics et des patrons. Nous sommes partout rivés à nos portables, ce qui permet à la police de toujours nous localiser. On peut aussi retracer la journée du citadin moderne grâce à sa carte bleue, son pass Navigo, son velib’, la consultation de son courrier électronique. La dure réalité est que nous avons déjà accepté dans ses grandes lignes une société de contrôle.
Ce n’est pas que l’on préfère les flics aux machines. Mais la biométrie s’immisce dans des espaces de la vie qui jusqu’ici ne sont pas totalement sous contrôle ; les échanges de cartes, les faux papiers ou même les arnaques restent possibles pour vivre malgré l’arbitraire.
Plusieurs logiques s’interpénètrent pour rendre ces nouveaux dispositifs monstrueux. Le contrôle, d’accord, c’est pas nouveau. Mais il change de nature, devient plus vicieux, car nous sommes facilement fascinés par la technologie. On connaît tous l’envie de cracher dans l’œil du flic qui contrôle, de se rebeller contre le surveillant à l’école. Mais quand les technologies de contrôle s’installent à l’entrée des écoles, les lycéens sont déjà habitués : « C’est cool, ça fait high tech, c’est comme dans Minority Report, ou 24h. » Jeux vidéo et films de science-fiction ont bien préparé le terrain.
Le monde de la biométrie est le même que celui du prélèvement massif d’ADN et de la pose de bracelets électroniques sur les nourrissons. Le pouvoir odieux se cache derrière la machine pour endormir la révolte, servir ses impératifs de fichage et de contrôle et nourrir en même temps des intérêts économiques. Tantôt en agitant la peur des terroristes, tantôt simplement par souci de rentabilité, les bureaucraties, petites et grandes, étatiques ou marchandes, ne cessent de soumettre les espaces de la vie commune à leurs propres critères : rien ne doit entraver le flux de l’économie ; rien ni personne ne doit se déplacer incognito.
Les inculpés de Gif ont, après bien des hésitations, renoncé à faire appel du jugement. Non qu’ils acceptent la condamnation, mais le contexte actuel ne les laisse pas espérer une diminution de peigne en rappel. Ils n’ont pas non plus réussi à trancher la question de savoir s’il était intéressant de contribuer à faire reculer la biométrie dans l’enceinte d’un tribunal. On peut les aider à payer leurs frais de justice.
L’opposition à l’identification électronique doit désormais dépasser la préoccupation de quelques cercles d’amis, personnalités et associations. Il est nécessaire de soutenir tous ceux et celles qui ont déjà commencé à s’y attaquer, de continuer à réfléchir ensemble pour saisir l’ampleur du problème, de faire jouer notre imagination pour déjouer la Machine.
Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés
depuis 2005, que ce soit personnellement ou en s’engageant autour de la lutte contre la fuite
en avant technologique et scientifique.
Par les temps qui
courent, votre soutien, y compris financier,
est le bienvenu.
Vous pouvez adresser des chèques
à l’ordre du théâtre du Cheval Noir,
Le Cheval Noir, 131 rue du Cherche-Midi, 75015 Paris, Fr.
Le jour de l’action, le tract suivant avait été distribué sur les lieux :
Lycéennes, lycéens,
Ne sentons-nous pas autour de nous l’étau qui se resserre, le bocal qui rétrécit ? Ne voyons-nous pas venir ce moment où l’on saura dans tous les détails ce que nous faisons, où nous sommes, ce que nous consommons ?
Il y a quelque chose de ça avec le système de biométrie installé dans la cantine du lycée. Pas un contrôle fort, d’accord. Juste l’un de ces trucs qui nous apprennent à toujours être identifiés, triés, séparés. Qui nous conditionnent, nous habituent à ressembler aux moutons et aux veaux dans nos assiettes, pucés pour que les administrations sachent parfaitement d’où ils viennent, quand ils naissent, quand ils meurent.
Le meilleur moyen de contrôler les humains, c’est pour l’instant de les mettre à l’école et au travail, avec en poche une carte bleue et un téléphone mobile. Imaginez qu’un jour prochain, on nous mette une puce sous la peau, objectif avoué de ceux qui nous invitent à « s’inscrire à la biométrie » : il deviendra alors complètement impossible de nous révolter contre le pouvoir de l’Etat et des entreprises.
Il ne s’agit pas de science-fiction, mais de ce qui arrive petit à petit ici et maintenant sous le voile du high tech branché et du jeu. Du temps de nos grands-parents, la science et la technologie devaient permettre d’en finir avec la misère et les inégalités. Aujourd’hui, le progrès cher aux anciennes générations sent à plein nez la prison et la mort. Dans ce nouveau millénaire, nous sommes nombreux et nombreuses à savoir que le délire scientifique et technologique est le premier obstacle à la justice sociale et à la liberté humaine.
Il est encore temps : demandons-nous si un monde sans caméra de surveillance, sans ordinateur et sans portable, ne serait pas plus vivable. Demandons-nous ce que la biométrie et ses puces peuvent nous apporter. Et ne laissons pas remettre en marche ces foutues machines à trier entre ceux qui ont les moyens et ceux qu’on envoie manger dehors (... Et n’hésitons pas à en saboter d’autres !).
Des complices
Déclaration des inculpé-e-s au tribunal d’Evry
Il nous revient, pour notre défense, d’éclaircir en quelques mots les raisons de notre présence dans ce lycée.
Si les outils biométriques ont été introduits dans les écoles, ce ne sont pas au fond, les écoliers qui sont visés par ces contrôles. Car même le proviseur le plus bureaucrate ne pourrait justifier un instant qu’ils sont nécessaires. Si la biométrie est entrée à l’école, c’est parce que les écoliers d’aujourd’hui seront demain des adultes.
Or l’industrie de pointe, omniprésente dans ce département de l’Essonne, considère avec l’appui actif de tous les décideurs politiques que les citoyens doivent être, dès l’enfance, conditionnés au high-tech, afin qu’ils ne remettent jamais en question les transformations que le déferlement technologique exerce sur leurs modes de vie. L’arsenal publicitaire façonné à leur intention, les mutations successives de l’école, dressent les plus jeunes à accepter ou à désirer la technicisation croissante des activités humaines, que l’on appelle, contre toute sensibilité et contre toute raison, le « progrès ».
La manière dont on impose la biométrie par le conditionnement des plus jeunes, entre autres, est d’inspiration tout aussi totalitaire que le contrôle biométrique lui-même. Cet échantillon de barbarie électronique signifie littéralement que l’individu se situe à mi-chemin entre le produit étiqueté du supermarché et le détenu tatoué du camp. Nous nous demandons alors quelle part de dignité il reste à celui qui doit transformer une partie de son corps en code-barre pour être identifié. Nous nous demandons à quelle marge d’autonomie morale il peut prétendre une fois que son anatomie est devenue le support direct du fonctionnement social. Jusqu’où ira-t-on pour achever de rendre les comportements prévisibles, et les personnes étrangères à elles-mêmes ?
Tantôt au nom de la menace terroriste, tantôt simplement parce que “ c’est plus pratique comme ça ”, les bureaucraties petites et grandes, étatiques ou marchandes, ne cessent de soumettre les espaces de la vie commune à leurs propres critères : rien ne doit entraver le flux de l’économie ; rien ne doit obscurcir la transparence du contrôle. Le langage et le rapport sensible, trop lents, trop ambigus, sont évacués au profit de la surveillance électronique.
Nous estimons donc que la biométrie est un pas de plus vers la déshumanisation de la société : la gestion des populations s’automatise et devient à elle-même sa propre fin. Conformément aux pires anticipations cybernétiques, il semble de plus en plus admis que l’existence n’est qu’un prétexte à la production et à la circulation de l’information. C’est ce que rend possible la biométrie, en faisant de la vie elle-même la matière première de sa version artificielle et programmable.
Nous avons voulu, le 17 novembre, interrompre symboliquement une expérimentation désastreuse sur des adolescents, dont le déploiement n’est pas en l’état contrôlable par la législation. Nous ne dénonçons pas les dérives de l’outil biométrique, mais la biométrie en tant que telle.
Nous considérons qu’accepter les contrôles biométriques signifie livrer la société à une logique de ghetto, c’est pourquoi nous engageons le plus grand nombre à refuser de s’y soumettre.
Les inculpé-e-s. Evry, le 20 janvier 2006.
Ne laissez pas les machines jouer avec les enfants
Témoignage rédigé à l’attention des juges.
Un pas vient d’être franchi dans la confrontation entre l’homme et la machine en milieu scolaire. Le 17 novembre, vingt personnes habillées en clowns sont entrées en chantant dans le lycée de Gif-sur-Yvette. Alors qu’ils exécutaient une saynète, deux dispositifs biométriques contrôlant l’accès des élèves ont été détruits à coups de marteaux. Trois personnes ont été arrêtées, battues par un surveillant et des élèves. Elles seront jugées par le tribunal d’Evry le 16 décembre. Installés en 2004, ces dispositifs biométriques qui associent vérification de la paume de la main et frappe d’un code à sept chiffres n’avaient pas obtenu d’autorisation de la CNIL… peu importe.
Cette expérience n’est pas isolée. A Angers, dans une école primaire et un collège, c’est l’empreinte digitale qui donne accès à la cantine, à Gif-sur-Yvette, à Sainte Maxime, Marseille ou Carqueiranne les élèves introduisent leur main dans une machine qui en reconnaît le contour. Qui peut prétendre que prendre la main d’un enfant est un geste neutre ? « Il est apparu que certains élèves associaient la biométrie à des représentations infantiles d’angoisse. Certains petits ont même évoqué la présence d’un monstre à l’intérieur de la machine. Les plus grands rationalisent leur peur, mais ils l’expriment dans des termes assez proches : on a peur de se faire électrocuter en mettant la main dans la machine, par exemple. [1] » Au lycée Jean-Baptiste Dumas à Alès, ce sont 90 caméras de vidéosurveillance, 104 au lycée Jean Rostand de Mantes-la -Jolie, associées à un dispositif de gestion des absences par codes barres et stylos optiques.... Les technologies sécuritaires modèlent les espaces dans lesquels toute une génération se construit.
Régulièrement, les experts consultés s’inquiètent de leurs conséquences sociales mais ces technologies originaires du milieu carcéral, promues ailleurs au nom de la lutte contre le terrorisme, se propagent en milieu éducatif, sans débat, comme si vingt ans de discours alarmistes rendaient inéluctable la transformation des écoles en prisons.
Car la logique est bien carcérale. Elle s’ajoute dans les établissements scolaires à la multiplication des injonctions focalisant le rôle des enseignants et de l’institution au contrôle de la présence. Les récents remplacements de courte durée sont un pas de plus dans ce sens : l’important c’est de garder les élèves. Pudiquement, les enseignants regretteront que leur rôle soit de plus en plus limité à de la « garderie ». Mais la garderie est une démarche éducative qui s’appuie sur une formation et ne se limite pas à contraindre un enfant à la présence dans un lieu clos. Par ailleurs, à la différence de son application dans les aéroports, la biométrie à la cantine ne répond à aucune menace. Elle ne vise pas à empêcher une intrusion mais, officiellement, à contrôler la présence que ceux qui devraient être là. Le principal du collège Joliot-Curie (de Carqueiranne) dit chercher à obtenir une « transparence absolue [2] » : il s’agit de savoir en permanence, et en temps réel, où sont et ce que font les élèves, notamment s’ils mangent ou s’ils ne mangent pas. Dès lors, on ne peut pas s’empêcher de penser au panopticon de Bentham. Schizophrénie de ces établissements où le développement des visions panoptiques à grands renforts de vidéo, de biométrie et d’alertes par SMS place l’administration au centre quand les textes officiels proclament depuis 15 ans que c’est l’enfant (ou l’élève) qui doit être « au centre » des institutions éducatives et sociales [3].
Avec la logique carcérale c’est le renforcement de la notion de frontière qui se développe par ces technologies. L’entrée des lycées est surveillée, l’extérieur est diabolisé. Les agressions, les vols, les trafics sont liés, dans les discours médiatiques et institutionnels aux intrusions : « On entre dans ce lycée comme dans un moulin. » La biométrie et la vidéo sont supposées protéger des élèves et un personnel vertueux du contact avec une plèbe étrangère. Ce « rêve politique de la peste » de Foucault, on le retrouve dans la diabolisation de l’extérieur, des non-scolarisés ou de ceux qui ont été exclus de l’école ou qui viennent de tel établissement suspect. Ainsi, cette « technologisation de la frontière [4] » de l’école se développe sur fond de discours xénophobe et éduque ces enfants à la suspicion de l’Autre. Le renforcement narcissique de ces insiders leur rappelle, contrôle après contrôle, leur appartenance à une communauté, par opposition au magma dangereux des outsiders. Pire, elle fait planer comme une menace d’exclusion le risque un jour de ne plus être contrôlé, générant de fait une demande de contrôle de la part des enfants eux-mêmes.
Le développement de ces technologies marque également la progression des logiques policières à l’école. A cette époque où c’est le ministre de l’Intérieur qui demande une évaluation des ZEP, l’avènement de la vidéosurveillance et de la biométrie au détriment de l’encadrement humain réduisent les possibilités d’intervenir en amont ou pendant les conflits et cantonnent toute réponse à l’a posterori. Alors qu’un surveillant pouvait intervenir pour tempérer les prémisses d’une bagarre, ou pour séparer, la vidéo ne fait qu’enregistrer un affrontement qui fatalement s’envenime jusqu’à son terme. Elle ne peut alors que témoigner de ses conséquences les plus graves et ne servir que de preuve, lors de l’investigation future. Car, ici encore, c’est bien l’un ou l’autre, l’homme ou la machine, tant les moyens humains se réduisent au fur et à mesure que progressent les investissements dans ces dispositifs. Au lycée J. Rostand de Mantes-la-Jolie, le projet d’installer 104 caméras de vidéosurveillance a ainsi été annoncé le même jour que la suppression d’un poste d’aide éducateur. à Alès, ces personnels ont d’abord été sur-occupés à des tâches de bureau, notamment de contrôle des absences, avant que les caméras soient installées. à Gif-sur-Yvette c’est peut-être le désarroi de ce surveillant, « obsolète » dirait Anders, au milieu de ces technologies qui l’a poussé à frapper les clowns et à appeler les élèves à les battre. Alors, face au manque de personnel compétent et présent, la réponse qui s’impose aux administrations est policière. Les interventions policières dans les établissements, les patrouilles ou les arrestations se multiplient donc. Loin d’apporter la réponse définitive qu’on nous annonçait médiatiquement, pour certains élèves ce n’est que le retour à des situations d’affrontements quotidiens qu’ils ont appris à gérer : « Oh ! la police vous savez, on a l’habitude. » Leurs yeux alors trahissent la déception : ils attendaient autre chose de l’éducation.
Ce qui subsiste aujourd’hui de la volonté de préserver une présence humaine pousse les conseils d’administration au recrutement de personnels sans formation, à des postes de vigiles pour un temps limité et de faibles salaires. Le chemin est alors tout tracé pour la privatisation prochaine de ces fonctions. Un enseignant d’anglais du lycée de Mantes remarquait avec tristesse qu’on enseignerait Orwell et Bradbury, écrivains visionnaires des sociétés de la surveillance généralisée, à des élèves lâchés ensuite dans des espaces dont les moindres recoins sont sous surveillance vidéo.
Cette avancée vers la privatisation, par ses aspects mercantiles mais aussi par la soumission des références éducatives à celles de l’industrie, est une composante fondamentale de ces processus. Pourquoi dépenser de telles sommes pour contrôler que des enfants mangent, alors même que l’accès à la cantine est un problème financier pour certains ? Pourquoi persister dans la vidéosurveillance lorsqu’une seule année de mise en place suffit à démontrer son inefficacité ? Pourquoi prendre tant de risques, avec les implications que peuvent avoir sur ces enfants le contact avec de telles technologies ? Une réponse majeure réside dans les fabuleux budgets publics que représentent ces dispositifs pour les industriels, une autre dans la faculté des établissements scolaires à fabriquer de futurs clients pour ces secteurs.
Le livre bleu rédigé par le GIXEL (Groupement des industries de l’interconnexion des composants et des sous-ensembles électroniques) à destination du gouvernement contient ce passage impayable, à la rubrique « Acceptation par la population [5] » :
La sécurité est très souvent vécue dans nos sociétés démocratiques comme une atteinte aux libertés individuelles. Il faut donc faire accepter par la population les technologies utilisées et parmi celles-ci la biométrie, la vidéosurveillance et les contrôles.
Plusieurs méthodes devront être développées par les pouvoirs publics et les industriels pour faire accepter la biométrie.
Elles devront être accompagnées d’un effort de convivialité par une reconnaissance de la personne et par l’apport de fonctionnalités attrayantes :
– Éducation dès l’école maternelle, les enfants utilisent cette technologie pour rentrer dans l’école, en sortir, déjeuner à la cantine, et les parents ou leurs représentants s’identifieront pour aller chercher les enfants.
– Introduction dans des biens de consommation, de confort ou des jeux : téléphone portable, ordinateur, voiture, domotique, jeux vidéo.
Ceux qui sont familiers des méthodes de relations publiques reconnaîtront les stratégies de communication des firmes de l’agroalimentaire pour faire accepter les OGM. La pression exercée sur les établissements pour une course à l’équipement (budgets spécifiques, limites dans le temps, débats bâclés…) les pousse à accepter des équipements sans mesurer les impacts de leur utilisation banale et encore moins ceux de leurs dysfonctionnements. Or, pour des documents aussi sensibles que les passeports biométriques américains, par exemple, The Economist notait que le système de reconnaissance adopté échouerait à identifier une personne sur dix et que « les fausses alertes pourraient devenir la norme ». Faute d’être cryptées, les données des puces incluses dans les passeports pourraient être lues à distance et donc permettre le vol d’identité. Malgré tout l’investissement réalisé, les constructeurs promettent rarement une sécurité absolue (« taux d’erreur de 0,0001 % », « ne fonctionne pas au-dessous de– 8 °C »…). Bien vite alors, l’humain est appelé en renfort pour composer un code secret, surveiller un écran… en périphérique de la machine.
Pourtant, les défaillances de ces technologies nous intéressent peu. Leur bon fonctionnement nous paraît déjà une défaite de la relation éducative dans son ensemble.
La CNIL rappelle fréquemment dans ses pathétiques tentatives de contrôle que l’usage de ces technologies doit être contraint par la « proportionnalité » entre l’exigence de contrôle et le processus utilisé et que chacun a « droit à l’oubli » ; les enregistrements sur « listes noires » et autres fichiers doivent pouvoir être effacés. Ce droit à l’oubli, fondement du droit, est aussi un fondement de l’éducation. La relation avec l’enseignant est pour l’enfant un temps à l’abri, un temps de confiance où la compréhension peut suivre l’erreur et permettre qu’on « oublie tout », qu’on « ferme les yeux pour cette fois », renvoyant l’enfant, lavé, à la possibilité de progresser.
La place de cette relation, entre humains, recule à mesure que progresse l’œil froid de la machine qui vient conforter une pénalisation de rapports éducatifs dont la référence est la délirante théorie de la « vitre brisée » fondement des politiques de tolérance zéro. Si « qui vole un œuf, vole un bœuf » ou « qui brise une vitre ouvrira le feu au fusil automatique ou dealera la cocaïne au kilo » alors sur les actes banals de l’enfance qui étaient source d’apprentissage bienveillant de la norme s’abattra une répression automatisée, implacable et démesurée, véritable « pédagogie noire ». Le rapport parlementaire Benisti sur la « prévention de la délinquance [6] », qui préconise la création d’un « système de repérage et de suivi des difficultés et des troubles du comportement de l’enfant » mis en place non seulement dans les établissements scolaires (de la maternelle au lycée), mais aussi dans les crèches, montre les liens qui peuvent exister entre une vision politique de l’enfance, une pathologisation de la délinquance et ces technologies hors de contrôle.
L’enregistrement préalable des paumes de main des élèves est appelé « l’enrôlement » et l’administration appellerait en début d’année ces enfants à se « soumettre » à la biométrie. Est-il ironique de rappeler que la déclaration universelle des droits de l’Homme dans son article 26 lie l’éducation à la liberté lorsqu’elle proclame : « L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. » ?
Comment imaginer former des hommes et des femmes libres, usagers de leurs libertés et familiers de celles-ci si on les familiarise dès l’enfance aux chaînes, fussent-elles numériques et modernes ?
L’action du 17 novembre sur les deux dispositifs biométriques du lycée de Gif-sur-Yvette, a peut-être simplement remis ces machines à leur place et nous donne une occasion unique de réfléchir au tournant que prennent les politiques de l’enfance, qu’elles soient éducatives, sociales ou judiciaires. Qu’a-t-on à gagner dans la course à la soumission des enfants et des personnels à des technologies qui les déshumanisent et les cantonnent à des rôles d’automates apeurés, de périphériques, et leur font perdre tout le génie et la créativité de leur humanité ? Jusqu’où sommes nous prêts à sacrifier cette génération au Moloch de la technologie et du marché ?
Jean-Philippe Joseph
Christine Rojewski
Jean-Pierre Joseph
Biométrie : l’identification ou la révolte
Texte paru dans La tyrannie technologique, L’échappée, Paris, 2007.
« La biométrie : le plus court chemin entre la loi et vous »
Le contrôle biométrique signifie dans un premier temps, la réduction du sujet incarné en corps anatomique objet de la clinique, et dans un second temps, la réduction du corps anatomique vivant en support informatique mort. Ces deux opérations permettent le branchement de l’anatomie sur les bureaucraties ; d’une certaine manière, elles la placent en prise directe avec le pouvoir. C’est précisément ce qu’exprime le rapport du Ministère du budget et de la réforme de l’état, rédigé à l’intention du public, dans cette formule cinglante : « La biométrie, le plus court chemin entre la loi et vous. »
Ce qui est intrigant avec la biométrie, c’est qu’elle est en même temps terrifiante et anodine. Anodine, parce qu’elle ne fait qu’étayer des procédures de contrôle préexistantes (cartes magnétiques, badges, banques de données, empreintes digitales non numériques…).
Terrifiante, parce que ces éléments de contrôle dont on avait toujours réussi à se persuader qu’ils ne nous concernaient pas s’immiscent à présent à même le corps. La biométrie viendrait donc nous signifier que la gestion bureaucratique des administrations, en se mariant avec l’examen anatomique, se rapproche dangereusement. Littéralement, elle ne peut plus ne pas nous toucher. Elle m’oblige à me pencher sur cette partie de mon existence dont j’avais pensé qu’elle n’était pas la mienne : ma vie dans la gestion.
L’empreinte biométrique vient compléter, et parfois se substituer à, un édifice d’individualisation administrative déjà en place, matérialisé par la carte d’identité, le numéro de sécurité sociale, d’assedic etc. Cette individualisation qui donne lieu à la personne juridique, morale ou légale du citoyen est une abstraction de ce que nous sommes au sein d’un groupe de personnes, dans notre réalité sensible. Au risque d’enfoncer des portes ouvertes, disons que la perte de puissance politique qui résulte de cet édifice d’individualisation abstrait est ce sur quoi repose le fonctionnement républicain : la renonciation à notre capacité d’organisation politique locale au profit de l’organisation centrale étatique. Mais le simple fait que nous préférions nous associer physiquement les uns aux autres dès qu’il s’agit de contester ce pouvoir, plutôt que d’adresser chacun en particulier des doléances aux ministres, montre que nous avons parfaitement conscience du caractère purement formel et impuissant de la personne légale. Nous savons dès que nous engageons une action politique que la véritable puissance dont nous pouvons nous prévaloir contre le pouvoir n’est pas dans l’association médiatisée par l’État que sont les citoyens pris un par un, mais dans l’association concrète face à l’État. En somme, plus l’individualisation abstraite gagne du terrain, plus nous perdons en puissance d’action collective.
Parmi les critiques relatives aux contrôles biométriques, la remarque a souvent été faite que « si un dictateur prenait le pouvoir, il pourrait faire de la biométrie un usage totalement fasciste ». Je crois que c’est se méprendre sur les enjeux politiques. La question est, d’une part, celle de la nature du pouvoir politique de l’État qui s’exerce déjà, et d’autre part, de la nature du gouvernement cybernétique naissant dont participe la biométrie. De quelle forme de pouvoir la personne légale fait-elle l’objet dans le premier cas ? De quel pouvoir l’anatomie est-elle l’interface dans le second ? À mon sens, c’est par nature et non par accident que le pouvoir gestionnaire nous prive de la liberté d’agir politiquement. Car l’individu isolé, objet de la gestion administrative, n’est absolument pas doté des moyens de préserver sa liberté, et encore moins des moyens de contester le pouvoir en place. En fait, si je parviens à jouir d’une relative liberté, c’est parce que le pouvoir gestionnaire est encore suffisamment en retrait pour que je ne sois pas confronté à lui à chaque instant de mon existence. D’autre part, c’est parce qu’il n’a pas complètement envahi mon esprit, et que, pour cette raison, je ne suis pas contrainte de m’identifier à ce qu’il fait de moi, de nous.
Personnellement, ça m’est égal d’être le numéro 2800567 ou l’identifiant Z. ça m’est égal que dans les fichiers de telle compagnie de téléphone, je sois une cliente plutôt comme ci ou plutôt comme ça selon les résultats de leurs calculs marketing, pour peu que je puisse continuer à vivre ma vie. Ils ne nous connaissent pas. Ce n’est pas avec nous que la gestion traite, mais avec un objet qu’elle constitue elle-même et qui nous ressemble. Le fait que nous ayons presque un statut d’esclave dans la gestion, que les recours soient si difficiles, ne nous préoccupe pas tant que ça – pourvu qu’on ne se mette pas à nous traiter en esclaves dans la vraie vie. En d’autres termes, nous ne pourrons conserver un semblant de liberté que si la gestion ne s’exerce pas le mieux possible, mais le moins possible.
L’objet de la gestion est, comme dans le récit éponyme de Dostoïevski , une sorte de Double assez désagréable et avec qui je ne voudrais pas que l’on me confonde – je sens qu’il pourrait vite m’étouffer. S’il est embêtant d’être arrêté, jugé et d’avoir un casier judiciaire, c’est parce qu’alors, notre Double gestionnaire se rapproche dangereusement, de sorte que le nuage de liberté qui nous entoure commence à se volatiliser : celle de pouvoir se déplacer, rencontrer qui nous voulons, dire certaines choses et de ne pas être activement surveillé en permanence. S’il ne s’agit que d’une liberté privée – si réduite que l’on devrait plutôt la nommer « sentiment de liberté » –, elle peut, à certains moments, prétendre à devenir publique, comme à la faveur d’un mouvement social. Ceux qui considèrent que le problème de la biométrie n’est pas la biométrie en soi mais ce qu’une dictature pourrait en faire estiment que cette relative liberté privée est suffisante, et qu’il importe de laisser subsister à travers elle la possibilité de la liberté publique pour se révolter, un jour, au cas où les fascistes prendraient le pouvoir. Je crois que c’est se méprendre sur la nature et l’exercice du pouvoir des états dits démocratiques. La biométrie n’est pas l’instrument potentiel d’un pouvoir sujet à des modifications, en fonction de qui dirige l’état, de qui dirige le ministère de l’Intérieur. Le pouvoir est bien plutôt constitué par l’arsenal technique dont dispose l’état pour homogénéiser nos modes de vie et nos activités en fonction d’une série de « nécessités », qu’elles soient d’ordre économique, administratif ou spectaculaire. C’est dans ces nécessités-là que liberté privée et liberté publique s’entremêlent et se confondent, que les systèmes de régulations techniques de l’existence interdisent de fait d’exercer une action politique qui ne serait pas une activité abstraite, une mise à distance de l’organisation pratique de nos vies. En ce sens, au même titre que la gestion centralisée des ressources naturelles ou la robotisation du travail, la biométrie témoigne de l’inversion si bien décrite par Michel Foucault : elle n’est pas l’instrument du pouvoir, mais le pouvoir de l’instrument.
Cela est assez bien illustré par le fait qu’à l’issue d’un sondage minimal, le ministère a opté pour quelques changements dans le dispositif de la carte INES (Identité nationale électronique sécurisée) dotée d’une puce électronique contenant des informations biométriques telles que la photographie et les empreintes digitales numérisées. Ces aménagements consistent à verrouiller le recoupement de certains fichiers, et à limiter la lecture à distance de la puce RFID contenue dans la carte en imposant une décision préalable de l’autorité judiciaire. Dans les deux cas, il s’agit de faire en sorte que le dispositif marche moins bien que ce pour quoi il est pratiquement conçu – une puce RFID est faite pour être lue à distance, la constitution de fichiers compatibles sert à fusionner des données. Il semble donc évident que ces aménagements ne sont que provisoires, et destinés à prouver que le politicien sait tenir les brides d’un équipage technologique dont il n’est pourtant pas maître, quitte à le laisser partir au galop un peu plus tard. Comme le montre bien Jacques Ellul, l’essence de l’État moderne et des administrations est technicienne. Le pouvoir gestionnaire, parce qu’il est d’essence technicienne, ne dépend donc pas d’une quelconque volonté, qu’une quelconque intention. C’est parce qu’il est par nature anti-politique que ceux sur qui il se penche ne sont pas et ne seront jamais des sujets politiques, et que toute véritable prise de position politique ne peut que se placer en dehors de la gestion.
La biométrie s’inscrit dans le droit fil de la forme de gouvernement gestionnaire en voie de numérisation. En effet, le fait que l’objet de la gestion passe de l’individu abstrait au substrat anatomique tout aussi abstrait est une conséquence presque nécessaire du fait que l’administration soit en passe de devenir totalement électronique.
Effectuer une transaction à distance implique de s’identifier en l’absence de la personne détentrice de l’autorité. Plus les formalités et les achats sont automatisés, et plus ces transactions sont sensibles (paiement des impôts, obtention d’un visa), plus le système répandu d’identifiant et de mot de passe s’avère insuffisamment sécurisé – le risque qu’il s’agisse d’une personne se faisant passer pour une autre, ou d’un logiciel se faisant passer pour une personne n’est pas véritablement atténué malgré les garde-fou supplémentaires développés par les informaticiens.
Dans le contexte de la numérisation des échanges, appelée à remplacer les transactions de la main à la main, la généralisation de la biométrie obéit à quelque chose d’assez logique – elle est loin d’être imparable, et serait plutôt dangereuse, puisque le fait de fusionner les principes distincts de l’identifiant et du mot de passe en les remplaçant par l’empreinte biométrique permet des usurpations aux conséquences quasi-irrémédiables. En effet, nous pouvons tous constater que les lieux d’exercice du pouvoir d’État se vident progressivement, pour se transformer en traitement automatique de données et de prestations par internet. Cette délocalisation – il faudrait plutôt parler de déterritorialisation, ou de virtualisation du pouvoir – implique une transformation des activités bureaucratiques : là où auparavant il fallait venir avec ses papiers, le bon formulaire et une signature, il faut maintenant taper un mot de passe, un identifiant et rentrer ses données. Manque la preuve que la personne qui est là est bien là même que sur le papier, d’où l’identification biométrique.
D’une certaine manière, puisque personne n’aime se confronter à la bureaucratie, que la machine bureaucratique se transforme véritablement en machine, avec des pages web et des souris à la place des tristes employés de l’administration, ce n’est pas une grosse perte.
L’informatisation de l’édifice étatique, tout comme celle des bureaucraties marchandes, n’est pas une surprise : ce n’est que la transformation de pseudo-machines en véritables machines. La déterritorialisation de leurs fonctions, cela signifie quelques brèches, quelques possibilités de recours qui se referment, une centralisation accrue des données. À première vue, le changement n’est pas si grand, de l’arbitraire à l’arbitraire électronique. Le problème est qu’à mesure que nous permettons que les activités de l’État et des entreprises se déplacent vers le monde virtuel, les lieux physiques de pouvoir se vident.
Le temps de la matrice n’est plus si lointain, où personne ne pourra plus dire précisément où est le Sénat, l’Assemblée Nationale, le ministère de l’Intérieur (Or, si personne ne peut affirmer avec certitude qu’une révolte sur internet n’aura jamais lieu, cela reste assez improbable).
Parallèlement, par l’intermédiaire de ces empreintes qui collent à la peau et qui deviennent les mêmes pour toutes sortes de prestations, la gestion centraliste se place au cœur des activités les plus quotidiennes : école, bibliothèque, bureau, transports…Certaines mairies, pour leur simplifier la vie, ont choisi d’offrir à leurs habitants des « Cartes de vie quotidienne », qui regroupent les domaines du médical, du scolaire, de l’administratif et du judiciaire. Enfin : l’interface avec ces organismes n’est plus le rôle très temporaire de personne légale ou d’usager que j’endosse pour mieux m’en départir quand je vais au impôts ou à la CAF, mais… mon empreinte digitale, la paume de ma main, l’iris de mon œil. La généralisation du contrôle biométrique qui transforme mon anatomie en support d’informations implique que la gestion se rapproche au point que mon « Double » gestionnaire vienne à présent se nicher quelque part dans mes organes. Et là… il devient vraiment difficile de prétendre qu’il ne s’agit pas de moi.
Nous l’avons évoqué : si l’informatique est capable de se greffer sur les organes et sur la peau, c’est dans la mesure où le corps est soumis à un processus de réduction machinique qui le rend radicalement autre. Le contrôle biométrique nous somme de donner une livre de chair : une aliénation bien concrète dans laquelle nous devenons un peu plus étrangers à nous-mêmes. Si nous l’étions déjà devenus au détour d’un formulaire, d’un entretien, d’un contrôle d’identité, il nous semble, avec ces nouvelles empreintes du quotidien, de plus en plus difficile de nous distancier de ce que le pouvoir fait de nous. Nous pouvions peut-être encore penser préserver notre quant-à-soi, ce sentiment de liberté qui accompagne notre réalité sensible, cette impression que nos choix et nos opinions, notre intégrité peuvent survivre à la tourmente de transformations politiques qui nous échappent depuis bien longtemps, et se recomposer entre deux humiliations à la petite semaine. Avec la biométrie, pourtant, l’incarnation qui nous protégeait de l’abstraction gestionnaire est elle-même visée par ce pouvoir désormais doté d’une capacité de frappe chirurgicale.
Si le « Je » de ma réalité sensible ne se confond pas avec l’objet de la posture gestionnaire, c’est dans la mesure où ce « Je » s’incarne dans une communauté sensible. La médiation de la bureaucratie technicienne n’a cessé de gagner du terrain au détriment des communautés politiques plus ou moins formelles qui pouvaient exister ou qui auraient pu voir le jour. Pourtant, cette individualisation est restée incapable de réellement empêcher que, là où les personnes se rencontrent, elles puissent encore se parler, se retrouver et s’organiser, que les corps de mêlent. S’il peut encore parfois se passer quelque chose, c’est parce qu’une communauté sensible parvient à se reformer ponctuellement malgré la privation formelle de liberté publique. En cela, l’incarnation qui lui permet de voir le jour est bien plus menaçante pour la gestion rationnelle de surplomb que toutes les idées désincarnées. Nous démontrons régulièrement notre capacité à éluder la posture gestionnaire, l’observation et le calcul dont nous faisons l’objet, voire de nous y confronter en bloc. Mais l’avènement de la biométrie est à la fois la conséquence et le symptôme d’un déploiement sans précédent du pouvoir technologique et gestionnaire. C’est un moment de rupture. Moment d’inventer la critique, les critiques, intellectuelles et concrètes, compatibles avec ce qu’exige une guerre à la gestion.
Celia Izoard
Logiques biométriques
Extrait du texte paru dans Bachibouzouk, n°1, décembre 2006.
Biométrie et logiques du corps
Le corps se numérise, se transforme en algorithme. Devenu ligne de code, il peut être stocké et tout un ensemble d’opérations peuvent s’effectuer : je pose mon empreinte et je passe, mon visage est authentifié et l’on sait si oui ou non je dois être là. Le corps se donne à la machine qui l’enregistre. Mon corps devient ainsi une clé : c’est-à-dire autant un pass que quelque chose qui enclenche un mécanisme qui va provoquer une nouvelle action. Mon corps se transforme en signe pour la machine, tandis que jusqu’alors il l’actionnait, la mettait en route, l’utilisait. Désormais la machine reconnaît, intègre, apprend : ainsi se voit-elle dotée d’une pseudo-subjectivité que nulle machine n’avait auparavant, en dehors de ces fantasmes de bricoleurs et de bricoleuses, ces elle-me-reconnait et ces il-n’y-a-qu’avec-moi-que-ça-marche. Nous voilà face à cette fausse subjectivité de machine qui reconnaît nos corps, « sait » quand nous sommes là. La machine ne fait plus qu’être là, elle me regarde. Nouvelle machine, nouveau rapport. Mon corps banal, qui déambule, devient source d’information : il n’est plus besoin de paroles, plus besoin d’actions. Plus besoin de me présenter à un guichet, de parler, d’introduire la parole pour devenir quelque chose pour l’administration, pour la police, pour le commerce. Je suis toujours à nu, moi, sans cet atour que constitue ma parole, sans ce sentiment de n’être présent, moi, que pour celles et ceux que je souhaite. Je suis présent, moi, pour tous les dispositifs qui m’entourent et pour toutes celles et ceux qui détiennent ces informations. Ce qui s’opère, subjectivement et objectivement, c’est le dédoublement de mon corps. D’un côté, il y a mon corps pour celles et ceux que je souhaite, le corps que je veux présenter, mon corps qui parle et dit son nom. De l’autre, il y a mon corps pour les dispositifs, mon corps à gérer, à contrôler, à surveiller, mon corps sans parole qui me dit, qui me présente et qui m’indique. On le comprend assez vite, ce corps-pour-le-contrôle est aussi potentiellement le corps qui me trahit, le corps qui me trace, qui me suit, me surprend, me fait prendre. C’est le corps qui, par conséquent, m’enferme, le corps qui m’empêche, sans risque, de pénétrer dans telle zone, de participer à telle chose à laquelle je ne devrais pas participer.
Et cela ne recouvre pas seulement ce qui est légalement interdit : il y a plein de choses que je n’ai pas à faire, qui ne correspondent pas à ce que je devrais faire conformément à mon état, à ma fonction, à mon âge. Les raisons de sonner l’alerte sont bien plus multiples car il est question de prévention et non de m’arrêter. Dès lors, je me trouve enjoint sous peine d’alerte à ne pas dépasser les limites qui sont celles de ma caste : me voilà doté-e d’un corps qui « reconnaît » à tout moment les limites de ma cellule ; me voilà doté-e d’un authentique corps-cellule.
On le sait : nos corps sont déjà conditionnés, domestiqués, disciplinés par le monde de la marchandise et du biopouvoir. Habitués à manger cela, à se tenir dans telles postures. Des années de « tiens-toi droit-e » ont fait leur chemin, tout comme nos habitudes d’hygiène : du nettoyage des dents aux douches chaudes, du rester propre aux cheveux coiffés. À l’image de nos « environnements », nous avons dû devenir lisses, aussi plastiques que nos nourritures ou nos jouets. Nos corps, devenus souci de l’institut pour les dents qui propose des chewing-gums, pour les industriels du glamour chimique, pour les esclavagistes du textile, sont aussi négativement devenus des tas de chair, des bonbonnes de sueur, des sources d’odeurs infâmes. Le souci de soi industriel, massivement enseigné, enregistré dans de multiples rapports, en finirait presque par nous convaincre qu’il y a dans cette bestialité quelque chose à détruire, quelque chose dont il faut se séparer. Nos corps, à travers cette vaste injonction au plastique, ont déjà cessé de nous appartenir, pour ce qui est de ces corps que nous montrons. Et avec cela, de manière corrélative, un dédoublement qui ressemble à celui que nous avons dévoilé plus haut. Comme s’il existait une correspondance.
D’un côté, ce corps-plastique, corps du regard public, corps inscrit dans la norme du lissage, corps invisible – corps, en somme, de la vie commune, corps de la norme, corps produit de manière hétéronome. De l’autre côté, ce corps du fond, corps de l’intime, corps velu qui sue, qui pue, qui se cache et cache ses aspérités, ses recoins, qui se dévoile au creux de l’intimité. Corps sauvage, corps-pourriture, corps qui déborde, qui dépasse les zones, qui s’anime de forces ingouvernables, qui transgresse, sale – corps qui définit, envers et contre tout, une résistance continuellement recouverte.
Quand on leur demande, les lycéen-ne-s qui passent les bornes biométriques, dans une cantine, affirment généralement que leur principale peur est d’avoir les mains sales. D’un côté, qu’illes se salissent sur la borne ; de l’autre, que leurs mains sales ne conviennent pas à la machine. Cette crainte témoigne de la continuité qui existe entre ce corps-pour-le-contrôle et le corps-plastique : le corps pour la machine doit être propre. Le contrôle est la fois celui de mon corps et de mon bon corps, celui qui circule, dans sa transparence fonctionnelle, sans aspérité. La biométrie provoque ce dédoublement du corps que nous avons décrit, avec la naissance de ce double qui nous enferme, nous trahit. Ce faisant, elle redouble ce premier dédoublement que nous subissons, avec ce devoir d’entretenir en permanence ce corps lisse compatible aux autres, aux entretiens d’embauche et aux affiches publicitaires. Par ce redoublement, elle rend évidente le rapport entre le corps sauvage et l’activité sauvage, entre ce corps qui sue et ce corps qui s’agence dans l’amour, dans la foule ou dans la fête et qui s’échappe en terrains inconnus. D’un côté, la biométrie vient comme un symptôme de ce que nos corps ne nous appartiennent plus, appartiennent aux industriels, à la marchandise ou au contrôle. Elle vient aussi extrêmiser le sentiment de cette dépossession en dévoilant sa fonction : séparer nos corps de nous-mêmes et nous séparer des autres.
Nos corps construits par la gestion sont ré-élaborés, par la biométrie, pour la gestion. Nos corps aliénés puis codés finissent par leur servir dans le cadre d’une gestion préventive de nos bons comportements. Nous pouvons ainsi saisir sans trop d’effort la voie qu’ouvre la biométrie, c’est-à-dire une gestion sans parole de nos corps domestiqués. On pourrait parler d’une logique de cheptel, mais ce serait rester en deçà de la réalité. Le cheptel est dirigé par un-e berger-e qui l’oriente, qui le traite et le soigne. Il faut noter que chaque animal est considéré comme un être vivant, avec lequel peut s’élaborer une entente, un rapport de connaissance mutuelle. Avec la biométrie, rien de tel ne s’annonce. Certain-e-s ont bien vu le rapport existant entre le corps lisse et le corps-marchandise : c’est le corps que l’on nous vend, que l’on achète, qui circule et se fond dans la masse. C’est le corps abstrait, produit d’une auto-exploitation, à la surface duquel rarement le bricolage du souci de soi vient affleurer. Et, produit d’un monde d’usines et de centres commerciaux, ce corps-marchandise est en train de se faire code-barrer par la biométrie. Ce qui se dévoile va bien au-delà de la cheptellisation : avec cette technologie, c’est l’utopie d’un monde de marchandises en perpétuelle circulation et sous contrôle permanent qui se révèle, un monde où corps humains, aliments et gadgets équivalent techniquement sous le règne de la marchandise industrielle. Il y a quelques décennies, certain-e-s se moquaient des cybernéticien-ne-s, de leurs délires sur l’information et son contrôle, de leurs rêves d’un monde réductible à un espace informationel peuplé de boîtes noires qui réagiraient à des messages extérieurs. À présent, alors que nos corps informent, peuvent être traités et soumis automatiquement à des injonctions par rétroaction, leurs rêves paraissent tout d’un coup moins fous, moins délirants. Le délire cybernétique trouve peu à peu ses voies de réalisation : lorsque le corps devient marchandise informationnelle, le rêve d’une transparence totale de la société peut se réaliser .
Biométrie et logiques de l’opacité
La Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL), partenaire de l’exposition sur la biométrie de la Villette, a notamment pour fonction de protéger notre vie privée face aux mésusages de données personnelles inclues dans divers fichiers susceptibles de recoupements. D’où, aussi, dès la première arrivée de la biométrie, la fameuse problématique de la « vie privée ». Pourront-illes croiser les fichiers, constitueront-illes de grosses bases de données ? Autant de questions qui viennent, comme une vieille rengaine. Et avec cela, évidemment, les armes de l’acceptation : oui, ne vous inquiétez pas, la Commission veillera à ce que rien ne se constitue de tel, et nous pourrons avoir les avantages de la biométrie sans ses inconvénients... nous voilà rassuré-e-s, une fois de plus.
Reste que cette topique de la « vie privée » est devenue centrale, même si la définition de celle-ci est incroyablement floue pour tout le monde. Ce que l’on sait, c’est qu’elle est fondamentale dans le libéralisme politique, comme notion autour de laquelle s’articule tant ma protection par rapport aux incursions de l’État que celle de mes biens et de ma personne. Ma vie privée, c’est cette part de ma vie sur laquelle l’État n’a en principe pas le droit d’intervenir : mes opinions religieuses, mon intimité, ce qui en somme me concerne moi chez moi ou chez mes ami-e-s. De plus en plus, cela définit aussi une sorte de besoin d’anonymat, de refus que l’on sache ce que je fais et où je suis en permanence. Mais cette idée a évidemment des limites, car la question revient toujours, dans la bouche des citoyen-ne-s ou des dirigeant-e-s : « mais qu’avez-vous à cacher ? » Chacun-e se défend comme ille peut en invoquant une espèce de pudeur à fleur de peau, en faisant remarquer que si tel-le dirigeant-e arrivait au pouvoir ce serait terrible. Mais, au fond, il reste le sentiment d’être désarmé. Face à celles et ceux qui n’ont rien à cacher, celui ou celle qui défend l’anonymat se retrouve en position de coupable. Et le contre-argument, qui fait valoir que chacun-e fait des choses plus ou moins répréhensibles est également un peu vaseux, puisque se sait également, souvent, que ce n’est pas cela qui sera visé et réprimé. Le fait est que cette problématique de la vie privée est une impasse. La protection de la vie privée, pour beaucoup, signifie que telle enseigne de la distribution ne doit pas savoir ce que j’ai acheté chez telle autre, que je peux avoir telle pratique sexuelle sans être inquiété-e. Le recoupement moderne entre loisir et vie privée en fait très largement une zone sans intérêt, où se massifient en toute tranquillité des pratiques en continuité absolue avec le temps de travail. La vie privée est protégée par tradition, alors même que celle-ci, bien souvent, se trouve réduite à la plus pure insignifiance.
Ces technologies sont susceptibles d’empêcher tant dans les faits que dans les têtes toute opacité de la vie sociale. Pourtant, des choses à cacher se font et/ou se feront. Passer le seuil sacré de la légalité arrive souvent dans un monde régulé par des normes gestionnaires qui viennent exclure tant de convenances communes, élaborées dans les interstices, les vides. Que ce soit pour le présent ou pour le futur, nous sommes nombreux à savoir qu’arrive ou arrivera le moment où se franchit ou se franchira cette barrière légale et qu’une répression assurée à l’aide de machines sera terrible. Ces technologies sont terrifiantes, elles impliqueront sûrement trop de feintes insupportables au quotidien pour que l’on puisse – même si la « vie privée » reste protégée – les laisser arriver. Conserver l’opacité de nos mouvements, l’opacité de notre identité, c’est maintenir la possibilité de la fraude, la possibilité de la ré-appropriation de richesses abandonnées ou de maisons vides, la possibilité de productions illégales, non-suivies, non-pucées. Face aux fasciné-e-s de la Loi, du respect de l’ordre existant, rien d’autre n’est à dire sinon : oui, des choses se cachent.... Aux autres, moins respectueux-ses, il s’agira de faire valoir la valeur de tant de luttes qui ont besoin de cette opacité, la valeur de formes-de-vie en résistance, faire saisir le danger que représentent de telles technologies pour leurs continuités et éventuellement leurs minces victoires.
La vie privée à l’intérieur du libéralisme n’est rien d’autre qu’une vie privée de sens, dans laquelle se trouve en permanence assumée la séparation nette entre ce que je veux et ce que je dois faire pour l’avoir ; cette vie privée n’est rien d’autre que ce petit morceau de « vie personnelle » concédé en échange de terribles collaborations. En revanche, il y a bien des enjeux à conserver les zones d’ombre, les ruelles, les petites places, les fermes abandonnées. La pleine lumière de la gestion affadit, dénonce, amoindrit tant d’amours, d’amitiés, de fêtes, de luttes. Ce qu’il reste d’autonomie, c’est-à-dire de capacité à faire exister des rapports et à vivre des désirs qui conviennent à des sujets-groupes, se déploie plus à l’aise à la lumière d’une bougie qu’au grand jour du contrôle. C’est cette opacité des formes de vie des offensé-e-s, l’épaisseur des attachements qui tiennent chacun-e, leur incompréhensibilité pour le pouvoir qui seule peut permettre d’imaginer une quelconque victoire. À vrai dire, il est bien possible que ce soit le retour perpétuel de cette opacité – et de la complexité qui lui est comme inhérente – qui retarde encore et toujours une victoire des gestionnaires qui signifie avant tout la victoire de la clarté, du rationnel, du machinesque. Avec la biométrie, il est à craindre que ces zones d’opacité se rétrécissent jusqu’à disparaître. Certes, des feintes verront le jour, mais cela a toutes les chances de nuire à toutes ces coalitions improbables, ces rencontres au hasard, ces gestes qui sont autant survie que lutte, ces moments par lesquels se constitue toute lente insurrection. L’enjeu de cette lutte n’est donc pas le respect de la « vie privée », mais bien la perte d’une autonomie sociale et individuelle plus que jamais attaquée.
Biométrie et logiques d’émancipation
L’erreur fondamentale de la « Science moderne » – celle qui a engendré tous les désastres que nous subissons aujourd’hui – est de prétendre qu’elle peut étudier et manipuler les êtres vivants, les hommes et leur monde tout comme elle étudie et manipule les choses dans ses laboratoires. Or les êtres vivants et les hommes ne peuvent être réduits à l’état de choses sans être très gravement mutilés ; sans que leur soient ôtées les capacités qui fondent leur spécificité d’êtres vivants, sensibles et pensant. Ce qui distingue les êtres des choses, c’est cette capacité d’avoir une grande diversité de rapports entre eux et avec le monde qui les entoure, et par là pas seulement subir et s’adapter aux circonstances, mais aussi d’utiliser et de transformer ces circonstances pour vivre à leur manière. En les traitant comme des choses, non seulement on nie l’existence de leur liberté et de leur autonomie, mais surtout on en vient naturellement à vouloir la supprimer, puisqu’elle devient un obstacle à leur manipulation en tant que choses.
Bertrand Louart, Quelques éléments d’une critique de la société industrielle, p. 14, juin 2003
Chacun-e le sait, plus ou moins confusément : nous sommes en permanence géré-e-s par divers appareils, qui nous ont, depuis le départ, configuré-e-s, conformé-e-s à leurs exigences. Gestion dès la naissance, et gestion continuée, avec apprentissage, mise au travail, retraite. Nos intimités elles-mêmes, qui, pensons-nous, peuvent nous définir, sont très souvent massives, constituées massivement. La part des décisions que nous avons prise en toute conscience, en fonction de nos désirs, est extraordinairement faible. On nous a appris à nous satisfaire de nos niveaux de vie, de nos conditions d’exploitation, du travail que nous effectuons. Ça marche, et ça ne marche pas. Ça marche : il suffit de croiser tou-te-s ces satisfait-e-s, bien content-e-s de leur confort statistique, de leur vie qui fonctionne bien, de leur travail qui fonctionne assez. Et ça ne marche pas : ces coups de blues, ces moments où l’on sent que l’on s’est perdu-e, ces moments où tout cela manque terriblement de sens, ces moments où l’on s’embarque dans de mauvais personnages, où l’on s’enferme dans de petits rôles, où l’exploitation devient trop pénible, où les problèmes physiques arrivent par surprise. Tout d’un coup apparaît que nous n’avons rien choisi, sauf des détails. Tout d’un coup, on se rend compte que l’on s’est fait embarquer pour rien. Comme si ce monde se faisait toujours sans nous, à côté de nous, contre nous, comme s’il venait d’un extérieur qui cependant nous traverse.
[...]
La biométrie, en tant qu’outil de gestion de masse, est le signe d’un futur qui se décline sous la forme d’un bonheur transparent, sans saveur, lisse et sordide à l’image des technicien-ne-s qui ont pu imaginer et confectionner une telle technologie de contrôle. Elle annonce un monde où des machines réguleront, en silence et sans exception, la circulation des corps, l’impossibilité de leurs enchevêtrements subversifs. Un monde sans parole, sans petits recours, c’est-à-dire un monde où la politique n’existe plus que sous la forme de techniques de gestion. Les forces qui s’y opposent et s’y opposeront se constituent et se constitueront dans cet antagonisme qui est né avec le capitalisme industriel et la gouvernementalité moderne, qui voit sans cesse l’affrontement entre les forces de la gestion et les désirs populaires d’émancipation et de communisme.
Kamo
Non à la biométrie. Désobéissons pendant qu’il est encore temps
Article paru dans Le Monde, 6 décembre 2005.
Lorsque, à la fin du xixe siècle, Galton en Angleterre commença ses recherches sur les empreintes digitales et Bertillon en France inventa la photographie judiciaire « pour l’identification anthropométrique » (c’était le terme de l’époque), de tels procédés étaient exclusivement réservés aux criminels récidivistes. Aujourd’hui une société se profile où l’on se propose d’appliquer à tous les citoyens des dispositifs qui étaient jusque-là destinés aux seuls délinquants. Selon un projet qui est déjà en voie de réalisation, le rapport normal de l’état à ce que Rousseau appelait les « membres du souverain » sera la biométrie, c’est-à-dire le soupçon généralisé. Au fur et à mesure que les citoyens, sous la pression de la dépolitisation croissante des sociétés postindustrielles, se retirent de toute participation politique, ils se voient traités de plus en plus comme des criminels virtuels. Le corps politique est ainsi devenu un corps criminel.
Les dangers d’une telle situation sont évidents pour tous sauf pour ceux qui refusent tout simplement de voir. On ne sait pas assez que ce sont des photos tirées des cartes d’identité et des cartes professionnelles qui ont permis aux polices nazies des pays occupés (notamment en Hollande, en Belgique et au Danemark) de repérer et d’enregistrer (souvent avec un simple « J » – pour Jude – gravé sur l’image) les juifs et qui ont facilité ainsi leur déportation. Que va-t-il se passer le jour où un pouvoir despotique disposera de l’enregistrement biométrique de toute une population ?
Or cela est d’autant plus inquiétant que les pays européens, après avoir imposé le contrôle biométrique aux immigrants, s’apprêtent à l’imposer à tous leurs citoyens. Les raisons de sécurité invoquées en faveur de ces pratiques odieuses ne sont pas convaincantes, car si elles peuvent contribuer à empêcher la récidive, elles sont bien sûr inutiles pour prévenir un premier délit ou un acte de terrorisme. En revanche elles sont parfaitement efficaces pour le contrôle massif des individus. Le jour où le contrôle biométrique sera généralisé et où la surveillance par caméra sera établie dans toutes les rues, nous n’aurons pas seulement perdu la simple joie de pouvoir marcher dans nos villes. Toute critique et tout dissentiment seront devenus impossibles.
Les jeunes étudiants qui ont détruit le 17 novembre les bornes biométriques dans la cantine du lycée de Gif-sur-Yvette ont montré qu’ils se souciaient bien davantage des libertés individuelles et de la démocratie que ceux qui avaient décidé ou accepté sans broncher leur installation.
Il y a trois ans, j’ai démissionné de mon poste de professeur à la New York University parce que les états-Unis avaient décidé d’imposer un contrôle biométrique aux étrangers qui entraient dans le pays.
Aujourd’hui non seulement j’exprime ma solidarité aux étudiants français, mais je déclare publiquement que je refuserai de me prêter à tout contrôle biométrique et que je suis prêt pour cela à renoncer à mon passeport comme à toute pièce d’identité.
Giorgio Agamben
La France contre les robots
Il y a vingt ans, le petit bourgeois français refusait de laisser prendre ses empreintes digitales, formalité jusqu’alors destinée aux forçats.
Oh ! Oui, je sais, vous vous dites que ce sont là des bagatelles. Mais en protestant contre ces bagatelles, le petit bourgeois engageait sans le savoir un héritage immense, toute une civilisation dont l’évanouissement progressif a passé presque inaperçu, parce que l’état moderne, le Moloch technique, en posant solidement les bases de sa future tyrannie, restait fidèle à l’ancien vocabulaire libéral, couvrait ou justifiait du vocabulaire libéral ses innombrables usurpations. Au petit bourgeois français refusant de laisser prendre ses empreintes digitales, l’intellectuel de profession, le parasite intellectuel, toujours complice du pouvoir, même lorsqu’il paraît le combattre, ripostait avec dédain que ce préjugé contre la science risquait de mettre obstacle à une admirable réforme des méthodes d’identification, qu’on ne pouvait sacrifier le Progrès à la crainte ridicule de se salir les doigts. Erreur profonde ! Ce n’était pas ses doigts que le petit bourgeois français, l’immortel La Brige de Courteline, craignait de salir, c’était sa dignité, c’était son âme. Oh ! peut-être ne s’en doutait-il pas, ou ne s’en doutait-il qu’à demi, peut-être sa révolte était-elle beaucoup moins celle de la prévoyance que celle de l’instinct. N’importe ! On avait beau lui dire : « Que risquez-vous ? Que vous importe d’être instantanément reconnu grâce au moyen le plus simple et le plus infaillible ? Le criminel seul trouve avantage à se cacher... » Il reconnaissait bien que le raisonnement n’était pas sans valeur, mais il ne se sentait pas convaincu. En ce temps-là, le procédé de M. Bertillon n’était en effet redoutable qu’au criminel et il en est de même encore maintenant. C’est le mot de criminel dont le sens s’est prodigieusement élargi, jusqu’à désigner tout citoyen peu favorable au Régime, au Système, au Parti ou à l’homme qui les incarne. Le petit bourgeois français n’avait certainement pas assez d’imagination pour se représenter un monde comme le nôtre si différent du sien, un monde où à chaque carrefour la Police d’État guetterait les suspects, filtrerait les passants, ferait du moindre portier d’hôtel, responsable de ses fiches, son auxiliaire bénévole et public.
Mais tout en se félicitant de voir la Justice tirer parti, contre les récidivistes, de la nouvelle méthode, il pressentait qu’une arme si perfectionnée, aux mains de l’État, ne resterait pas longtemps inoffensive pour les simples citoyens. C’était sa dignité qu’il croyait seulement défendre, et il défendait avec elle nos sécurités et nos vies. Depuis vingt ans, combien de millions d’hommes, en Russie, en Italie, en Allemagne, en Espagne, ont été ainsi, grâce aux empreintes digitales, mis dans l’impossibilité non pas seulement de nuire aux Tyrans, mais de s’en cacher ou de les fuir ? Et ce système ingénieux a encore détruit quelque chose de plus précieux que des millions de vies humaines. L’idée qu’un citoyen, qui n’a jamais eu affaire à la Justice de son pays, devrait rester parfaitement libre de dissimuler son identité à qui il lui plaît, pour des motifs dont il est seul juge, ou simplement pour son plaisir, que toute indiscrétion d’un policier sur ce chapitre ne saurait être tolérée sans les raisons les plus graves, cette idée ne vient plus à l’esprit de personne. Le jour n’est pas loin peut-être où il nous semblera aussi naturel de laisser notre clef dans la serrure, afin que la police puisse entrer chez nous nuit et jour, que d’ouvrir notre portefeuille à toute réquisition. Et lorsque l’État jugera plus pratique, afin d’épargner le temps de ses innombrables contrôleurs, de nous imposer une marque extérieure, pourquoi hésiterions-nous à nous laisser marquer au fer, à la joue ou à la fesse, comme le bétail ? L’épuration des Mal-Pensants, si chère aux régimes totalitaires, en serait grandement facilitée.
Georges Bernanos
Sur la biométrie et plus avant :
– Collectif, La tyrannie technologique : critique de la société numérique,
éditions de L’échappée, Paris, 2007.
– Groupe Marcuse, La liberté dans le coma,
éditions de La lenteur, à paraître, Paris.
– Harun Farocki, Images du monde et inscription de la guerre (film), 1988.
Voir aussi les textes des films dans Harun Farocki : Films,
Théâtre Typographique, Paris, 2006.
– Xavier Guchet, « Les deux corps de la biométrie », Communications.
– Laurent Guillot, Le temps des biomaîtres (film), 2006.
– P. Piazza, X. Crettiez (dir.), Du papier à la biométrie : identifier les individus, Presses de Sciences Po, Paris, 2006.
– Pierre Piazza, Histoire de la carte nationale d’identité,
Paris, Odile Jacob 2004.
– Sébastien Thomasson, Au doigt et à l’œil : lettre ouverte à Henri Chabert, Grenoble, 2005, disponible sur http://infokiosques.net/.
– Nicolas Bonanni, Des moutons et des hommes,
Grenoble, 2007, disponible sur http://www.piecesetmaindoeuvre.com/ et http://infokiosques.net/.
[1] Xavier Guchet, « Manger sous surveillance, L’usage d’une technique biométrique pour le contrôle d’accès à la cantine scolaire ».
[2] Ibid.
[3] Loi du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation, loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale.
[4] Philippe Bonditti, « Technologisation de la frontière : vers un état de peste généralisé ? », Chantiers Politiques, ENS, Paris, n°2, Oct. 2004.
[5] « Livre bleu, grands programmes structurants, proposition des industries électroniques et numériques », juillet 2004. Au cours de l’année 2006, suite à la mise en évidence de ce passage par le collectif anti-biométrie, le GIXEL a modifié formellement son Livre Bleu en ôtant le passage en question. Original disponible ici.
[6] Le rapport Benisti a préparé la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (2.1 Mio)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (1.9 Mio)