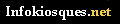I
Italie 70
Récits du mouvement autonome
mis en ligne le 24 mars 2008 - Erri De Luca
Les premières fois, tu fais l’expérience du vent que font les corps en course. Tu vois la fuite qui t’arrive dessus, les tiens se sauvent, tu restes sur un bord pour ne pas les avoir sur toi. Ils courent en silence, pas de cris, le souffle sert tout entier pour les jambes. Tu regardes leur course. C’est du vent de face, des corps de garçons et de filles giclent plus loin, personne ne fait attention à toi. Puis quelqu’un dira oui, je l’ai vu, il était immobile dans un coin, appuyé au mur.
Derrière arrivent les troupes en uniforme. Toi, tu attends le peu de terrain neutre entre ceux qui s’enfuient et ceux qui leur courent après, tu te détaches du bord, du mur, tu lances ce que tu as dans la main, tu tires vers le bas pour faire trébucher, puis c’est ton tour de gicler. Tu as eu le temps de regarder où il faut aller, où est ton avantage, de préférence en montée. Les poursuivants sont déjà essoufflés et n’ont pas le courage de courir dans une côte. Même s’ils veulent te tirer dessus, une cible en hauteur est plus malaisée.
Tu as peu d’avance, quelques mètres, mais avec ta sortie tu as dérangé leur galop, pour quelques secondes, tu les as surpris. Ils ne voient que toi, mais le doute qu’il y en ait d’autres les effleure, et une seconde encore ils regardent autour d’eux. C’est un vieux vice de la peur de ne pas se fier à ses propres sens dans un moment d’excitation. Tu en profites et tu gagnes des mètres. Ils ont enfin compris que tu n’es qu’une esquille, celle qui frappe les jambes écartées de ceux qui abattent un arbre à la hache. Derrière toi éclate leur colère qui les entraîne à ta poursuite, tu entends quelqu’un hurler de t’attraper, tu penses : tant mieux, ils gaspillent leur réserve d’air en cris, en vents, dans trente mètres ils auront le souffle coupé, ils devront s’arrêter en pleine course pour reprendre haleine. En attendant, tu as dérangé leur poursuite, les tiens sont à l’abri et tu peux ralentir, essayer de les rejoindre plus loin à l’endroit convenu en cas de fuite. Toi : qui es-tu ?
Tu es quelqu’un qui, un jour, est resté sans bouger dans une charge des troupes. Tu as eu peur en voyant la course bancale de ceux qui t’entouraient, car si l’un d’eux tombait, les autres, pris de panique, risquaient de lui passer dessus. Tu souffrais de voir la course maladroite de tant de filles qui alors n’allaient pas dans les gymnases ou dans les parcs pour s’entraîner. Quand ce fut ton tour d’être jeune, un jeune de la rue, le sport avait été l’heure d’éducation physique dans une grande salle d’école. Les garçons savaient courir parce qu’ils jouaient au ballon dans le parc municipal, interrompus par les agents de police. Les filles ne savaient pas courir. Elles apprenaient alors, dans les manifestations attaquées, enfumées, poursuivies.
La première fois que tu ne t’es pas échappé, ils t’ont pris ou plutôt tu les as pris dessus. Tu t’es recroquevillé par terre, un coup de pied a fait voler ton bonnet, mais ton instinct t’a bien conseillé. Entre leurs pieds, il était plus difficile d’être frappé, alors que le coup est plus facile et plus fort sur celui qui se plie en restant à mi-hauteur. Ils se défoulent sur toi, puis l’un d’eux te pousse vers l’arrière, tu reçois encore des coups, un autre plus dur te fait de nouveau tomber, il vient de derrière, apprends, apprends, oui, ainsi tu apprends qu’une fois arrêté, quand tu t’es rendu, tu n’es pas à l’abri, tu dois d’abord passer au milieu d’eux. Ce n’est pas comme lorsqu’on était petit et que celui qui était fait prisonnier restait sans bouger pendant un tour, personne ne le touchait. Ici, tu es dans le purgatoire de leurs arrière-lignes, les coups surgissent à froid, en voyous de pacotille comme on dit dans ton pays.
Ainsi, la première fois tu t’es fait prendre, mieux qu’un poulet, qui lui du moins tente de glisser entre les jambes. Rien, tu les as attendus la tête vide, uniquement parce que tu ne voulais pas t’en aller. Poussé à l’intérieur d’un fourgon, tu es surpris de ne pas être seul. Près de toi dans la maigre lumière, il y en a un autre, à peine mieux habillé que toi, sans trace de sang sur le visage ni sur les vêtements. Il demande comment tu vas, si tu es conscient, si tu sais compter. Il cherche à savoir si tu n’as que des dégâts extérieurs et pas dans le crâne. Il dit que c’est dur une tête, pas si facile à casser, mais à peler oui. Il regarde ton trou, écartant le mouchoir que tu tiens dessus, dit qu’elle sera comme neuve avec quelques points.
Ils l’ont pris, pourtant il est resté debout, il a évité des coups, ils n’ont pas réussi à le faire tomber par terre, ils l’ont porté sous les bras comme un poids mort jusqu’au fourgon, ainsi ils avaient les mains occupées. Ça lui est déjà arrivé. Il demande pourquoi tu ne t’es pas échappé. Tu ne le sais pas, mais oui, tu le sais, mais tu ne veux pas dire que tout à coup tu as eu honte de fuir, une honte plus forte que la peur. Si tu pouvais le dire dans ton dialecte “me so’ miso scuorno ‘e fuì”, j’ai eu honte de fuir, ce serait précis, mais en italien ça fait bizarre l’intimité d’une honte, alors tu appuies plus fort le mouchoir sur le trou et tu te tais. Maintenant tu le sais, mais alors non : une quantité de courages naissent de la honte et sont plus tenaces que ceux venus des colères qui sont des élans vite refroidis. En revanche, les hontes sont faites de blé dur et ne sont jamais trop cuites.
Entre-temps, ils ouvrent et en lancent un autre dedans qui reste par terre sans bouger, lui se lève et l’aide à s’asseoir, l’autre résiste, il a peur de prendre d’autres coups, lui insiste, s’il reste par terre ils entreront et frapperont de plus belle : pourquoi ne restes-tu pas chez toi où tu peux dormir par terre comme un chien que tu es ? Il arrive ainsi à le convaincre et l’installe sur le dernier banc au fond dans le noir du fourgon. Les deux portières s’ouvrent en grand et, sous les cris et les gifles, arrive un petit groupe de six, dont une fille, pris tous ensemble, ils ferment, le fourgon part, avec sa sirène et son escorte.
Où nous amènent-ils, demande quelqu’un, au commissariat, dit-il. Ils nous arrêtent, s’informe-t-on, quelques-uns oui, au hasard, parfois, répond-il. Un autre se souvient qu’il n’a rien dit chez lui. En arrivant à la caserne lui te dit : quand ils ouvrent, moi je sors en premier, toi tu viens derrière, reste collé à moi, marche le plus vite que tu peux, ne t’arrête pas, surtout ne tombe pas, regarde seulement par terre, où tu mets les pieds, ils nous font passer au milieu d’eux, si tu tombes tu en prends plus qu’avant et tu en fais donner à ceux de derrière qui ne peuvent pas passer.
Et c’est comme ça, il prend les premiers coups de poing et va droit au bout du couloir des coups sans trébucher dans les pieds, les croche pattes, tu es contre lui et tu parviens à entrer dans la grande pièce sans d’autres coups sur la tête, rien que des coups de pied. Il t’a ouvert le passage, tu ressens envers lui une gratitude à pleurer. Derrière toi, le premier a trébuché, tu as entendu ses cris, tu ne t’es pas retourné. Quand ils arrivent eux aussi dans la salle tu t’es mis les mains sur les yeux et tu ne veux pas regarder. Mais il te faudrait deux autres mains pour les oreilles. Tu lui dis merci, il répond qu’il ne l’a pas fait pour toi, mais pour lui, car si tu étais passé avant et que tu t’étais arrêté, lui en prenait plus.
Combien de fois t’ont-ils pris, demandes-tu, plusieurs fois, répond-il. Vous êtes assis côte à côte. Ne demande pas d’aller aux waters, dit-il, si tu ne peux pas te retenir fais sur toi, de toute façon ça sèche vite. Tu lui demandes s’ils vont nous arrêter. Si nous passons la nuit ici, non, ils nous relâchent demain matin ; sinon dans la soirée ils nous conduisent en prison et au moins là tu peux pisser en paix.
Tu ne t’es pas enfui, te demande-t-il. Non. Lui non plus, ceux qui ne veulent pas fuir commencent à se trouver. Une file d’obstinés commence à se former. Ils sont encore dispersés, mais on se connaît. Vous échangez vos noms. Ainsi passe ta première nuit au poste, à parler de demain, des prochaines fois, de comment arrêter les assauts. Voilà, toi tu es quelqu’un qui a commencé comme ça. Le matin, ils vous mettent dehors. Tu ne vas pas aux urgences, mais chez un médecin qui aide les blessés des manifestations, c’est lui qui t’y conduit, l’ami de moins d’un jour, à qui tu confierais tes deux yeux, car ce sont des jours où la confiance, la loyauté et même le destin vont vite.
Dans les réunions, beaucoup en connaissent beaucoup. On parle de ne pas se laisser envoyer les quatre fers en l’air, de préparer des défenses avec ceux qui se sentent capables de serrer un rang. Le plus clairvoyant d’entre nous dit qu’il n’y a pas de différence entre violence d’agression et violence de défense, qu’une barricade est violence pure, une pierre et une bouteille d’essence aussi. Il dit que toute la différence est entre violence d’État et violence du peuple, l’une est abus de pouvoir, l’autre non. Et puis il dit qu’il faut s’enlever de la tête les mots exotiques venus des autres continents, par exemple guérilla qui veut dire petite guerre. Chez nous, dit-il, on fait une bataille de rue, pour pouvoir rester dans la rue même contre les interdictions, pour ne pas se laisser disperser, pour ne pas se faire arrêter. Ce n’est pas une guerre la nôtre, ni petite ni grande, c’est un adroit vol à la tire de quelques heures de manifestation. Nous ne libérons pas des territoires, nous prenons seulement la liberté d’être contre tous les pouvoirs constitués.
Cela paraît peu à certains, et la révolution ? Elle vient, si elle vient, au bout de nombreuses journées de démocratie volée. Celui qui a étudié le latin, dit-il, sait comment la règle de la consecutio temporum court après les verbes, comment elle enchaîne les phrases l’une après l’autre avec une suite de verbes. Telle est la révolution, une subordonnée pour nous aujourd’hui. Mais il nous incombe d’agir comme si nous l’avions à l’ordre du jour et d’être au monde en révolutionnaires. Non pas pour la révolution mais pour la plus élémentaire forme de la démocratie qui est le droit de manifester. Trouver des logements où puissent vivre ceux des nôtres qui sont en fuite, des avocats qui défendent au tribunal les raisons politiques de nos mouvements mis en accusation, des médecins qui soignent les blessés hors de l’hôpital.
Les arrestations augmentent à la fin des manifestations, mais la fuite n’est plus la pagaille d’avant. Il y a une ligne qui absorbe et repousse le choc. Tu apprends à rester là, parmi ceux qui ne se mettent pas à l’écart. Si quelqu’un se retrouve isolé avec la troupe sur le dos, on va le reprendre et on le chipe de force. Toi, tu as connu ce soulagement d’être arraché de haute lutte à la troupe qui venait de t’arrêter. Tu te souviens d’un ami qui attaqua tout seul un fourgon arrêté à un feu rouge, sans escorte, qui prit les clés du chauffeur, ouvrit les portières et libéra tout le monde en criant “But”, comme les enfants.
En même temps, tu t’apercevais que les troupes en uniforme préféraient s’attaquer à des personnes isolées, non pas à toute la ligne. À travers eux, tu t’es aperçu que les rapports de force dans les rues commençaient à changer.
Tu as continué car ça continuait et durcissait en années, tu as pris part aux affrontements, pas mal, car la foule des insubordonnés augmentait et qu’à ceux comme toi incombait une responsabilité envers eux, les venus après. Dans les réunions, tu parlais du droit d’avoir peur, car elle est saine et fait raisonner correctement. Il ne fallait pas vouloir l’arracher, la violence sur soi ne donne pas du courage, mais seulement quelques minutes d’audace hystérique. Nos rangs étaient de ceux qui tiennent à rentrer chez eux, ce n’étaient pas des entreprises pour audacieux mais pour confiants, pour ceux qui se fient à qui ils donnent le bras, qui restent à côté. Cela suffisait-il ? Pas toujours, mais dans les bagarres il valait mieux le calme que l’enflammé, un discipliné plutôt qu’un héros.
Les rapports de force évoluèrent jusqu’en 1975, lorsque, pour redonner l’avantage à la force publique, le Parlement, à une large majorité, donna en dot aux agents la loi qui leur permettait de tirer dans la rue sans menace de danger ni besoin de légitime défense, d’entrer dans les maisons et dans les sièges politiques sans mandat de perquisition, de garder un prévenu pendant deux jours et deux nuits sans avertir ni avocat ni magistrat. En somme, elle permettait l’ainsi de suite, sévissant dans la prairie brûlée des droits personnels et publics. À partir de ce moment-là, se mettre en travers des rues fut le choix des prêts à tout.
Aujourd’hui tu le reconnais, il était impossible de négocier avec cette jeunesse. D’où avait-elle surgi d’un seul coup ? Si opposée à toute autorité, se moquant des délégations, des partis, des votes, si bien implantée dans le peuple, rompue aux moyens expéditifs, contagieuse. Elle entrait dans les prisons, arrêtée par paquets, elle se liguait avec les détenus, et les révoltes contre le traitement carcéral commençaient. Elle allait faire son service militaire et des casernes partaient des soulèvements pour un meilleur ordinaire et une paie décente. Dans les stades, les supporters adaptaient les chœurs et les rythmes des manifestations à leurs incitations. D’où avait-elle surgi cette génération impardonnable qui paie encore la dette pénale de son vingtième siècle ? Tu ne le sais pas, tu imagines plutôt que dans un système houleux il y a une vague plus large et plus forte, qui ne s’explique pas par celle d’avant ni par celle d’après. Tu imagines donc que tôt ou tard les générations reviennent.
Elles reviennent, elle est revenue, à présent il y en a une autre qui agit comme un corps, qui se met en mouvement en tant que génération. D’autres venues avant elle se sont arrangées en filles de leur temps auquel elles ont adhéré avec une obéissance convaincue. Celle de maintenant, comme la tienne, fait du contretemps, elle passe à rebrousse-poil, et par conséquent elle est contemporaine d’elle-même, extemporaine au reste. Elle s’occupe du monde, plutôt que de la copropriété. Toi, tu la suis, tu suis ses mouvements et les libertés que les autorités prennent contre elle. Toi, avec tes histoires passées de rues grillées enfumées tu es près d’elle, périmé : cette génération admet de subir la violence mais ne veut pas se salir avec elle en réagissant. Elle veut que l’agression soit d’un seul côté, elle met leur droit à nu et le montre à l’état de nature, pour ce qu’il est : abus de pouvoir.
Mais que fais-tu, toi et les autres de ton espèce et de ton âge, au milieu de ces nouveaux ? Tu fais peu et rien, qui puisse leur servir, mais tu y es quand même, rappelé dans la rue en juillet 2001 par le rouge de Gênes, de la place Ali-monda, de la nuit à l’école de Diaz, du reste à la caserne Bolzaneto, par le rouge répandu exprès qui, par des chemins mystérieux, remonte à tes artères et t’appartient.
Traduit de l’italien par Danièle Valin, 2003
Chemise blanche, jupe bleue, avec sa tenue d’école sans passer chez elle l’après-midi, elle arrivait dans la salle et venait dans le coin où j’imprimais les tracts. Elle aimait la machine, elle avait appris à s’en servir et me remplaçait quelques heures. Avec une pointe, elle dessinait sur la matrice les lettres les plus grandes, celles du titre, les mots forts. Elle ajoutait le dessin d’un poing, d’une étoile. Je lui donnais la ronéo, elle était en de bonnes mains. Si elle s’enrayait, elle savait la réparer. Sur le banc, je lui laissais les rames de papier déjà triées par tas à remettre aux militants.
En ce temps-là, le tract était notre journal, il relatait le fait du jour et notre avis sur l’action à mener.
La jeune fille à la jupe bleue mettait ma blouse, posait la nouvelle matrice, vérifiait l’encre et faisait repartir la voix de la machine et la nôtre. La nuit, c’était moi qui m’occupais de la ronéo. Dans la grande pièce encore enfumée par la dernière réunion, les tours du moteur recrachaient les feuilles à un rythme soutenu. Dans ma tête ensommeillée j’associais ce bruit à celui des pas, aux syllabes d’une chanson, ainsi je restais éveillé.
Je me proposais volontiers pour le tirage de nuit, à cette époque j’étais hébergé par un militant, dans sa chambre exiguë. Il venait de rencontrer l’amour et la nuit leurs étreintes étaient fortes. Ils n’étaient pas gênés de s’aimer pendant que je dormais deux mètres plus loin. Rester dans le noir à écouter les coups et les souffles émus de deux qui s’aiment, sans désir d’avoir son tour, j’en étais capable, mais il était plus utile de surveiller les pistons de la ronéo plutôt que ceux de l’amour des autres. Et donc la nuit, je tournais volontiers autour de la minuscule rotative, une Gestetner, de notre groupe d’agités politiques.
Poussés tous à la fois à l’intérieur d’une génération, comme si nous nous étions donné rendez-vous au berceau : dans dix-huit ans dans la rue. Pasolini l’appelait excédentaire, cette génération, un surplus dû à la découverte des antibiotiques, n’ayant subi aucune sélection et foisonnée par l’excès de mariages de l’après-guerre. Ce n’était pas grand-chose comme explication, mais lui du moins se posait la question : d’où étions-nous sortis, nous autres étrangers, différents de tout ? Je ne savais que répondre, je faisais partie de ces sortis et il me manquait la distance d’un point d’observation. Par esprit de contradiction, je me forgeais une pensée différente de la sienne et de la providence de la pénicilline. Notre génération était la première d’Europe qui, à dix-huit ans, n’était pas prise par la peau du cou et envoyée à la guerre contre une autre jeunesse déclarée ennemie. C’était la première qui s’affranchissait des conséquences catastrophiques du mot patrie. C’est ainsi que nous étions patriotes du monde et que nous nous mêlions de ses guerres. Sur une grande partie de ces tracts était écrit le nom d’un lointain pays de l’Asie : Viêt-nam.
La jeune fille à la jupe bleue le traçait en lettres d’imprimerie pointillées, qu’on aurait dites cousues sur le papier. Elle dessinait le drapeau, par amour pour son étoile. Entre nous il y avait un peu d’entente, c’était un moment propice, la différence de revenus, d’instruction, d’âge comptait peu. Elle me parlait de l’école, elle aimait la chimie. “Aujourd’hui, j’ai étudié l’ozone, il se forme autour des éclairs, il est bleu, il pique le nez.” Et puis, brusquement : “Tu irais te battre, toi, là-bas ?” Et moi : “Tout de suite même. — Mais tu sais tirer ? — Non. — Et alors ? — J’apprendrai, comme tu l’as fait avec la ronéo.”
Elle restait un moment pensive, puis revenait sur le sujet : “Et la peur ? — Je suis un révolutionnaire, disais-je, la peur je dois la chasser. — Moi, la peur me gagne même dans les charges de la police, je m’enfuis, je pense à mes parents qui ne se doutent de rien. Je ne crois pas être une révolutionnaire.”
Je ne savais pas quoi répondre à la jeune fille et puis j’avais tort : ce n’était pas nous les révolutionnaires, mais le temps et le monde tout autour. Nous, nous aidions le mouvement qui dégondait colonies et empires. Avec toute la disproportion entre nous et ce qu’il fallait faire, nous voyions aussi augmenter le nombre de tracts à distribuer et celui des volontaires venus les retirer. Les écoles étaient affamées de ces feuilles, les écoles étaient en continuelle effervescence, il n’y avait pas un quadrimestre oui et un autre non, c’était toute une assemblée d’octobre à juin. “Si tu n’es pas une révolutionnaire, qui es-tu ? — Une fille qui aide la justice, qui est du côté des gens opprimés par les manques et les abus. — Alors tu es une fille qui veut aider son prochain ?” Ma question sonnait faux dans un siège et un après-midi de révolutionnaires. Elle s’en aperçut. Elle resta silencieuse, et je pensai l’avoir vexée. Elle se tourna pourtant vers moi, car nous étions côte à côte, et elle dit, à peine plus fort que le moteur de la ronéo : “Mais toi, tu ne veux pas être le prochain de quelqu’un pour une fois ?” Je détournai mon regard, je crois que la confusion gagna mes mains.
Elle fréquentait une institution privée, elle en portait l’uniforme jusqu’aux souliers et aux chaussettes blanches, qu’elle retirait cependant en arrivant dans la salle du quartier de San Lorenzo. Elle mettait des bas en nylon et des mocassins. Elle seule de son institution et en cachette s’était mise à prendre part aux mouvements et aux raisons d’une jeunesse inapaisée et dépareillée, ennemie des pouvoirs constitués, secouée par les affaires du monde. En secret, elle apportait un peu de ces feuilles dans son école à ses seuls risques, sans aucun espoir d’adhésion. Et elle doutait d’être révolutionnaire ? Le degré de rupture à l’intérieur de l’ordre social d’alors ne se mesurait pas à des personnes prêtes à partir pour un front, mais à des citoyens comme elle qui se mettaient à saboter des pouvoirs dans les endroits les plus étranges et les plus difficiles. Le degré de fièvre de cette Italie n’était pas donné par les surexcités, mais par le pouls des doux, des pacifiques qui collaboraient aux révoltes. Quand ce sont les pensionnaires qui vont à l’aventure, un pays est proche de l’incandescence.
La jupe bleue, la chemise blanche, les bas en nylon, les mocassins et les manières : elle était élégante par rapport au reste de nous autres. C’est ce qui me plaisait : qu’elle ne voulait pas mettre un second uniforme, celui des révoltés.
Elle avait de la sympathie pour moi qui venais du Sud et qui avais l’air dépaysé des émigrants, eux qui n’auront plus jamais de pays. En dessinant un poing sur la matrice, elle disait que c’était le mien. Je ne me permettais aucune familiarité, mais je regardais sa jupe, sa belle couleur bleue apaisait mes yeux trop rivés sur le blanc et noir des polycopiés sous la lumière du néon. Ce n’était pas le bleu des salopettes ouvrières qui sortaient de leurs usines à l’air libre pour une grève improvisée. Celui-là, je l’ai porté et je l’ai appris ensuite. Sa jupe était du bleu qui entoure le lamparo dans la pêche nocturne au calmar, au tòtano. C’était le bleu qui enveloppe la lumière et l’accompagne tandis qu’elle s’enfonce dans la mer.
Avant de nous relayer, nous sortions boire un café. Le quartier était plein de boutiques, typographes, marbriers, menuisiers, couturiers, cordonniers, il y en avait toujours en pause pour discuter avec nous au bar. Et nous ne parlions ni de sport ni de la pluie et du beau temps, mais d’un événement quelconque et de ce qu’il fallait en penser. Ils demandaient volontiers un avis à cette nouvelle jeunesse qui avait décidé d’en avoir un à part et bien à elle sur tout et n’importe quoi.
Le préalable était de tout retourner, mettre sens dessus dessous. C’était une insolence méthodique et elle avait des conséquences. La police venait perquisitionner, contrôler les identités, dénoncer à la justice. Une de ces occasions fut brutale et elle était là elle aussi dans la salle. La surveillance spontanée du quartier avait eu le temps de prévenir de l’arrivée de la colonne. Je cachai dans un appartement voisin la ronéo, le seul trésor à sauver. Nous étions peu nombreux et nous fûmes maltraités. Le fonctionnaire était mécontent de n’avoir rien à saisir et il décida de nous conduire au commissariat.
Pendant qu’avait lieu le remue-ménage qui servait à intimider aussi le quartier, elle resta toute raide, pâle de peur mais aussi de dégoût devant l’exhibition de coups de pied aux chaises et aux tables, devant les ordres pour nous mettre face au mur hurlés dans nos oreilles, avec l’accent méridional qui était le mien et pourtant si opposé au mien. Le fonctionnaire la remarqua, elle si différente, lui demanda ses papiers sur un autre ton en disant : “Mademoiselle, que faites-vous ici, laissez tomber ces quatre vauriens et retournez chez vous aux Parioli.” II la laissa partir. Entre-temps, elle était passée de la pâleur au réchauffement, au rouge d’un effort pour réprimer de tous les muscles de son visage les larmes au bord de ses yeux. L’attention du commissaire-adjoint la séparait de nous. Elle avait honte du privilège de pouvoir s’en aller et elle avait honte aussi de son soulagement de ne pas voir ses parents convoqués au commissariat pour venir chercher leur fille mineure. Au milieu des uniformes des agents, je vis sortir sa jupe bleue. Si elle voulut me saluer du regard, je ne peux le savoir. Je regardais le bord de sa jupe disparaître dans l’obscurité de la cour. Ainsi s’éteint le lamparo, s’estompe le bleu et les yeux peinent un moment dans le noir. Quand tout autour il y a de l’agitation, de lointaines pensées me reviennent. C’est ce qui a dû arriver bien des années après à Carlo Giuliani avec son extincteur à restituer.
Lorsque nous sommes sortis empaquetés pour monter dans le fourgon, il s’était formé un petit groupe sympathique d’habitants de San Lorenzo, sortis de leurs boutiques, silencieux et sérieux, accoudés aux balcons. Pas de circulation, la rue était bloquée par l’opération de police, pas de bruit, les gens ne parlaient pas et encerclaient ceux qui nous encerclaient. Nous allions revenir d’ici peu, encore plus ancrés à notre poste, mais elle non. La jeune fille à la jupe bleue s’éloigna ce jour-là et qui sait qui a mérité de l’avoir entre ses bras.
Traduit de l’italien par Danièle Valin, 2003
Roma-Amor. Dans les jeux de mots, on appelle palindromes les mots et les phrases qu’on peut lire aussi en sens inverse. Ils m’arrivèrent tous les deux avec une force de primeur loin de chez moi. Dix-huit années, de la première à la dernière, j’ai vécu à Naples, ma ville de naissance, stérile, sans aimer aucune fille dans les quartiers de mon adolescence. Ce n’est que sur l’île d’en face, un été, que m’est venu un amour pour une fille de Rome. Et quand à dix-huit ans je me suis évadé de mon lieu de fondation et du Sud, je me suis rendu dans cette ville, parce qu’il m’était resté de l’amour, un peu, mais assez pour faire passer par là celui qui se détachait de son centre et qui était équidistant de toute gare d’arrivée.
Elle, elle était déjà grande, elle étudiait l’architecture, elle fumait. Moi, jamais capable de tabac, dérivés et composés, j’avais envoyé promener ville, études, maison, famille. J’étais dépaysé et possédé. Les décisions prises à un âge âpre ne cèdent plus, enfoncées dans on ne sait quel os.
Comme pour beaucoup arrivés sans invitation, Rome fut au début gare de chemin de fer. Dans ses parages, je trouvai des lits de camp dans des chambres meublées, parmi des inconnus. Je n’ai jamais été aussi seul, une bonne condition pour tomber amoureux ou se perdre. Je ne fus pas égaré parce que tout autour il y avait une étrange colère de jeunesse, politique, mais rien à voir avec les partis. Divisée, irrégulière, sans congrès, affiliations, cartes, elle avait pour terrain la rue et pour Parlement les assemblées. Elle se heurtait aux polices, tribunaux, prisons. Je fus des leurs, c’est pourquoi je ne me suis pas égaré. Je suis tombé amoureux, non pas de la première, celle de l’île, mais de sa sœur, seize ans, effrayante de volonté et de beauté. Elle avait les mains abîmées par une maladie, la seule que j’ai aimée. Je vénérais ces doigts crevassés, rouges, endoloris, elle ne l’a jamais cru. Eût-ce été la lèpre, je l’aurais léchée pour me la coller à la langue, eût-ce été la mort, je l’aurais voulue moi. Moins que ça, l’amour n’est rien.
Arrivait l’année mille neuf cent soixante-neuf, plus dure et plus longue que l’année d’avant-goût soixante-huit. Des jeunes commençaient à penser par eux-mêmes d’après les biographies de révolutionnaires du début du vingtième siècle. Nous étions nombreux à apprendre le pleur artificiel des lacrymogènes, les bagarres des charges, les coups et le drôle de transport dans des cages à poules, les fourgons cellulaires. Qui étais-je, que pouvais-je dire de moi : rien. Je n’étais de rien et d’aucun lieu. J’étais un parmi tant, qui parfois n’étaient pas bien nombreux à compter dans une cour de commissariat, au milieu des représailles endurcies d’hommes en uniforme. J’étais un, même moins qu’un. Pourtant j’aimais. J’aimais la fille aux cheveux plats, prise de profil sur une photographie de printemps aux forums romains, une de nos promenades. J’aimais la fille qui m’avait accueilli dans ses larges épaules, comme le fait une tempête avec un bateau.
Je comptais mes muscles, mes os, comme j’étais peu de chose, je comptais mes années, mon argent : comment pouvais-je la garder ? Elle grandissait, c’était un été de figues de Barbarie et une chaîne de baisers exaucés. Je n’avais rien d’autre à désirer en dehors du seuil des baisers. Plus que la liberté, j’ai attendu la minute bouillante où quatre lèvres suspendent leur souffle, se mêlent pour se goûter elles-mêmes à travers deux autres et se confondent pour s’appartenir.
Elle vivait dans une maison, moi dans des chambres, nous nous rencontrions rarement seuls. Les baisers ne sont pas une avance sur d’autres tendresses, ils en sont le point le plus élevé. De leur sommité, on peut descendre dans les bras, dans les poussées des hanches, mais c’est un effet de traction. Seuls les baisers sont bons comme les joues du poisson. Nous deux, nous avions l’appât sur nos lèvres, nous happions ensemble.
C’était l’hiver et j’étais dans une petite chambre, la première que je louais, près de la Villa Ada. J’avais cloué au mur une chemise. Les boutons s’ouvraient et à l’intérieur il y avait deux photos, les siennes. Elle vint me voir en cachette, j’étais tombé malade. Une de ces fièvres épaisses, violentes se calmait peu à peu en moi. En ouvrant la porte, je me suis tenu solidement à la poignée. Elle m’a serré fort, comme si elle embrassait l’hiver, des frissons insistants, du marbre dans les pieds. Il n’y avait pas de chauffage, mais je m’en suis aperçu à ce moment-là. Mon corps était dur de froid, alors que j’aurais voulu dans mes veines plus de chocolat que de sang. Elle me garda dans son manteau en peau de mouton doublé de laine. Elle ferma la porte de son talon et me poussa en arrière vers le lit sans relâcher son étreinte.
Elle m’allongea, puis retira ses vêtements en gardant une chemise blanche, légère. Elle entra dans le noir des couvertures et couvrit tout mon corps du sien. J’étais au-dessous d’elle, tremblant de bonheur et de froid. Les parties de notre corps trouvaient une coïncidence, main sur main, pied sur pied, cheveux sur cheveux, nombril sur nombril, nez près du nez, ne respirant que par lui, nos bouches unies. Ce n’étaient pas des baisers, mais la jonction de deux morceaux. S’il existe une technique de résurrection, elle était en train de l’appliquer. Elle absorbait mon froid et ma fièvre, matières brutes qui, pétries dans son corps, me revenaient sous un poids d’amour. Le sien tenait le mien sous lui et le mien portait le sien, comme fait une terre avec la neige. S’il existe une alliance entre femelle et mâle, je l’ai ressentie alors.
Cela dura une heure, plus qu’un quelconque toujours. Avant de partir, elle rit de la chemise au mur. C’est ma crucifixion boutonnée. Je ne lui dis pas qu’elle y était, à l’intérieur. Elle ne vint plus. L’hiver nous détachait. Elle était venue pour me quitter et au contraire s’était allongée pour me guérir. Les meilleures choses de l’amour arrivent par hasard, on les comprend ensuite. Je croyais que cette visite était pour nous un début de plus vaste vie à deux, c’était au contraire un terme. Dans ma tête battaient comme des coups de cloche les syllabes du poète espagnol : “Pour aller au nord, il alla au sud. / Il pensa que le blé était eau / il se trompait. / Il pensa que la mer était ciel / et la nuit le matin. / Il se trompait. / Que les étoiles étaient rosée / et la chaleur une chute de neige / il se trompait.” Chez nous, un chanteur avait mis ces vers en musique. La musique, comme le sel, conserve mieux. Je me trompais et entre-temps je guérissais de l’amour, de ses attaques de bonheur. Je m’habituais à la ville, une conduite qui perdait de l’amour par toutes les fontaines. Je la traversais avec les yeux que j’aurai à nouveau une fois vieux : la Villa Ada était pleine d’enfants et de mères qui ne me concernaient pas.
À cette époque, les ouvriers du restaurant universitaire et les étudiants avaient décidé que tout le monde pouvait venir et manger, même sans carte. Avec trois cents lires, j’étais à l’abri. La fièvre et le jeûne étaient finis, je me nourrissais rue De Lollis avec tous ceux qui inventaient de nouveaux droits, en les retirant aux pouvoirs. La ville était un lieu pentu pour nous qui descendions dans les rues du centre et des banlieues, encerclés par des troupes que nous ne craignions plus.
Je l’ai revue quelquefois à certaines manifestations, dans les tas que nous formions. Elle s’était vite mariée. Elle devenait une femme, une, et elle en avait contenu tant, et moi je les avais connues. J’avais aimé en elle toutes ces filles qui essayaient des vêtements de femme au cours de l’année des baisers. Plus tard, j’en ai aimé d’autres avec l’illusion que c’était encore elle. Je me donnais cette illusion pour pouvoir tomber amoureux.
Quelques années plus tard, je quittai en courant cette chambre louée, sans rien emporter, pas même un caleçon. La chemise clouée aux poignets resta là, à personne. Et peut-être est-il bon de s’en aller comme ça, en vitesse, poursuivis. Mais ça ce fut après, quand se durcissait la haine civile et que nos sangs et ceux des autres n’avaient pas le temps de sécher.
Dans la fureur des deuils, j’oubliai la jeune fille qui m’avait tenu debout dans son manteau et qui s’était détachée de moi pour devenir une femme. Rome était pleine de guerre. Ceux qui disent qu’elle était inventée l’ont au contraire désertée. Il n’était pas obligatoire de se battre, mais il y avait de quoi. Cette génération des si nombreux ne cherchait pas à recruter, elle se suffisait. Elle n’aspirait pas à des majorités, elle déplaçait sa charge par à-coups de minorités. Elle ne me manque pas, car elle n’est jamais sortie de mes pensées. Pas plus que ne me manque cette heure de résurrection sous le corps de la fille aimée. Moi, je l’ai eue cette heure illimitée. Moi, je l’ai eue.
Traduit de l’italien par Danièle Valin, 2003
Dans la confusion climatique et politique de ce siècle, il y eut aussi un mai long de dix ans. Né ce mois-là, il m’a été facile d’adhérer à cette fixité de saison. J’ai fait partie intégrante de ces dix années parce que j’étais de mai. Tous ensemble alors, nous étions de mai. Nous étions ouvrables : nous ne laissions pas un seul jour de paix aux pouvoirs constitués. Nous étions du samedi : aucun ne se passait sans une manifestation de rue, à nous égosiller en chœur les oreilles de villes ahuries. Nous étions nocturnes, les réunions du soir finissaient le jour suivant. Nous étions très diurnes, nos tracts étaient distribués devant les portes de la première relève. Nous étions insomniaques, tendus et prêts à la prison comme des enveloppes qui devaient êtres affranchies de la sorte. Et, quand nous sortions de là-dedans même au bout de quelques mois seulement, il nous semblait avoir perdu une moitié de révolution et qu’il nous fallait suivre un cours de rattrapage pour nous mettre au courant de toutes les luttes qui avaient eu lieu entre-temps.
Je n’arrive pas à faire un paisible mois de novembre du long antipode de ce mois de mai de dix ans. Je reste squietato (inapaisé) : il me convient bien ce mot napolitain qui a la précision clinique d’un diagnostic. Et quelques phrases inapaisées, tirées d’un de mes récits, sont placés en antienne de certains passages de ce livre [La Révolution et l’Etat], lui aussi un peu agité et pourtant sage. Ainsi, tiré à l’intérieur, j’essaye d’intervenir sur quelques lignes qui me concernent plus directement. Il est écrit que les groupes Lotta continua et d’autres analogues finirent leur cycle politique en 73. Je peux dire qu’à Rome Lotta continua commence seulement son expansion cette année là et que les années suivantes elle devient insupportablement vaste et multiple pour les épaules de ceux qui en avaient la charge et la responsabilité. Le nerf de cette croissance fut l’antifascisme, une évidence urbaine urgente pour bien des gens alors. Et bien sûr on me dira, à juste titre, que cette activité, cette contradiction est secondaire. Très bien, c’était la consigne, venant aussitôt après la principale, mais elle n’était pas moins la condition de son déroulement. Il est vrai que c’est justement à partir de l’année 73 qu’à Rome les jeunes rejoignaient Lotta continua car elle faisait quelque chose contre les fascistes et moi, je me trouvais un service d’ordre avec des centaines, plusieurs centaines de jeunes disposés à se battre, et ce, non pas en ordre dispersé, mais en rang disciplinés. Et toutes ces vies étaient enracinées dans le sol, ne cédant pas un pouce de terrain, alors qu’elles étaient suspendues au minuscule fil de mes maigres capacités. C’est ce qui arrivait parce que le monde était un peu fasciste et que l’Italie se trouvait entre le Portugal, l’Espagne et la Grèce qui l’étaient, et que chez nous, il y avait un bon nombre de gens qui trafiquaient pour nous aligner sur les autres péninsules. C’étaient des contradictions secondaires, pourtant elles contenaient une charge émotive d’indignation, de passion, qui les rendaient inévitables. A la formation de tout caractère révolutionnaire préside une déchirure d’émotion, de colère, de honte pour une impuissance propre. Les analyses des situations historiques lui donnent par la suite poids et sens, mais initialement c’est un coup de fouet dans le système nerveux. L’antifascisme était cela. Et c’était un lien d’origine, une lettre de change contestée aux pères, leur dette qui nous était laissée et que nous prenions en charge, c’était notre inscription dans le XXe siècle, notre “jamais plus” adressé au monde.
Une génération toute entière à été mordue par la tarentule du besoin de justice. Il m’arrive parfois d’être invité par des groupes de jeunes qui me questionnent sur l’époque où nous avions le même âge qu’eux. Je parle d’un communisme quotidien, défendu dans toutes les luttes à coup de pieds et de feux, je raconte la vie d’une journée car telle était l’unité de mesure de notre façon de comprendre le mot communisme : non pas dans les patries étrangères qui exerçaient leur pouvoir en son nom, non pas dans le futur antérieur où nous pourrions y parvenir, mais dans le piétinement des jours, où l’orgueil était d’être meilleurs, non pas que le pouvoir constitué ni que nos pères étaient meilleurs que nous, ce que nous avions été le jour précédent, plus généreux, décidés, experts. Notre communisme ne visait pas à saisir les rênes de quelque diligence, il n’attendait pas de partir d’une prise de pouvoir, mais il se déroulait et se consumait dans la vague de nouveaux droits obtenus par besoin de justice et avec une méthode de choc frontal. Nous nous sommes très peu confrontés à l’hypothèse d’un pouvoir nous appartenant, nous avons toujours veillés à la nécessité d’une force à nous qui nous semblait utile et juste, alors que le pouvoir fort était suspect. Moi, je sais ce que j’ai fait à ce moment-là, le communisme que je pouvais. Et à la question de savoir si nous étions violents : je réponds oui. Je ne prétexte pas le temps et le lieu, le sang déjà versé et les injustices. Je réponds oui : que c’est à eux, ces jeunes, de chercher pour nous les pièces justificatives, s’ils le désirent.
“Je cherche la fille qui le soir du... est entrée dans le magasin de fruits et légumes de la rue... Elle avait les yeux gonflés, un pantalon troué aux genoux.” Ainsi commencent les lignes d’une annonce jamais envoyée, qui a fini dans les désirs inassouvis et pour cela intacts.
Ses cheveux étaient longs, couleur des châtaignes quand elles sont mûres et qu’on monte sur la colline secouer les branches. Elle était secouée, comme il fallait pour ce temps-là.
Ses cheveux dénoués s’accrochent et il lui manquait une mèche, arrachée. Elle me dit qu’elle voulait les couper le lendemain. Sa voix était basse, enrouée. Autres détails : une blessure à la lèvre supérieure, une trace de rouge en un seul point. Pas de fard, on n’en mettait pas. De ses yeux je ne sais quoi dire, c’était noir, il y avait de la fumée. Je cherche cette fille-là, jamais revue. Aujourd’hui, elle n’est plus de cet âge-là, c’est du reste un temps court et alors il durait encore moins. Par exemple, j’ai été jeune pendant quelques semaines, deux fois, l’été. Dans tout entre-temps nous étions des adultes involontaires.
Je cherche la fille qui entra en courant dans le magasin de fruits et légumes, au cas où elle se souviendrait de la tiède soirée d’une guerre locale, dans un seul quartier, une soirée de guerre un peu mondiale aussi parce qu’elle voulait déranger la séance de la grande alliance guerrière de l’Atlantique Nord.
“La meglio zoventù”, disait une chanson d’Alpins apprise de mon père. La fleur de la jeunesse de la ville de Rome se donnait rendez-vous, endurcie et effrontée, autour de la basilique Saint-Paul, contre la réunion des chefs de l’Otan dans le quartier de l’EUR.
Les partis de la gauche assise, au Parlement et dehors, dictaient des formules de conjuration : c’est une manifestation provocatrice (la nôtre, non pas celle de l’Otan), l’œuvre de groupuscules extrémistes. Ils prescrivaient à leurs adhérents la vigilance dans les sections, c’est-à-dire : se calfeutrer à l’intérieur. Cette jeunesse-là n’était pas gentille, elle n’obéissait à personne, elle était envahissante, sans représentants même dans la loge de concierge des institutions.
Nous venions juste de nous rassembler, un beau tas de quelques milliers autour de la basilique. La manifestation n’était pas autorisée, et après ? Nous ne voulions pas ouvrir une exploitation commerciale, pour avoir besoin de leur licence. Il s’agissait de manifester, un point c’est tout, un droit intraitable. Alors c’était plutôt une aimable concession, très révocable. La démocratie dominante était celle du parti unique, au gouvernement sans relâche déjà depuis un quart de siècle. Ainsi donc, après les premiers affrontements et les premières arrestations, la plupart d’entre nous montèrent vers le quartier voisin de Garbatella. En ordre dispersé et hors d’haleine, nous bloquâmes la rue avec tout ce qui nous tombait sous la main, panneaux de signalisation, bidons, gravats d’un chantier voisin.
C’étaient de brusques mouvements masculins, pourtant quelques filles restaient et, si elles n’avaient pas la force de lancer des pierres, en échange elles les ramassaient et te les mettaient dans la main. Tu n’as jamais eu dans la main une pierre donnée par une fille ? Ce sont les meilleures, tu y mets dedans une telle force en les lançant que tu te prends pour une catapulte. Et tu lui en demandes encore pour sentir à nouveau le toucher du passage de main. Et, pendant que tu penses à ça, la charge avance et tu restes un peu en arrière par rapport à ceux qui se sont retirés plus haut, tu restes en arrière parce que cette sacrée fille ne s’enfuit pas, elle t’attend et tu ne veux pas t’enfuir avant elle et alors les autres approchent et tu pourrais peut-être encore filer car ils sont essoufflés par leur course en montée et aussi par la trouille de tomber sous une météorite volante, mais rien, la fille ne se déplace pas et toi tu es là en train de tirer sans rater un coup tant ils sont près, il y aura bientôt une mêlée, et toi ne fallait-il pas que tu te trouves à côté d’une Jeanne d’Arc, et, maintenant ils sont arrivés à la distance où l’on peut se regarder en face et, ça alors, ils s’arrêtent, font demi-tour, l’assaut est fini, ils ont eu l’ordre de se retirer.
Ce qui se passe, et tu ne t’en es pas aperçu, c’est que les gens sont en train de lancer leur maison par les fenêtres, toutes leurs vieilles affaires, on se croirait le jour de l’an, des pots de fleurs, des pots de chambre, de la ferraille, des chaises cassées, des briques, des carreaux, des boîtes, des bouteilles et des seaux d’eau. Le quartier s’est mis à la fenêtre, a bombardé la charge, l’a réexpédiée en bas. Les gens descendent de chez eux, ceux des nôtres qui avaient pris position plus en arrière reviennent vers la barricade, de grandes couvertures à brûler surgissent, un vieil homme en pousse une enflammée dans la descente par où se sont enfuies les troupes de l’ordre public. Et moi il me semble que l’ordre public est celui de l’insurrection inattendue de gens qui ne nous connaissent pas, qui ne savent pas pourquoi nous leur apportons la guerre chez eux, mais qui décident au vol et à la majorité que nous avons raison et que les troupes ont tort. Ces gens-là font leur ordre public en se mettant avec la fleur de la jeunesse et en faisant son bonheur. Car le bonheur pour nous a été un quartier insurgé à l’improviste à nos côtés et tout autour.
Nous appelions ces choses-là du communisme, mais nous cherchions à deviner, c’était surtout un bonheur, âpre et enfumé.
Je cherche la fille du magasin de fruits et légumes, qui n’est pas celle de la barricade tête contre tête, pierre contre pierre, non, celle-là je la connais, elle a toujours été dans la rue et elle a remonté les degrés des affrontements jusqu’à la plus violente forme de la critique. Ces affrontements étaient la critique, des actes d’une raison dotée d’une force de démolition, car elle est bonne à ça, la raison. Et ceux qui ne faisaient pas comme ça ? C’étaient des gens qui niaient l’évidence, ils s’excluaient du champ. Ils choisissaient l’État, qui n’est en aucun cas une indication de mouvement. Au terme de ce jour et de cette nuit de la critique, nous devions compter cinquante d’entre nous emprisonnés, un hôpital de blessés, mais pas un dans une salle commune, chacun dans une chambre des habitations du quartier. La critique était coûteuse. Je cherche la fille saisie au vol à la sortie du magasin de fruits et légumes.
Les troupes revenaient à la charge à partir d’autres points d’encerclement. Ils parvenaient à entrer, capturer, emmener en courant, mais ils ne pouvaient pas se planter au milieu du quartier. Les magasins restaient ouverts. Ils fermaient aussitôt si l’un d’entre nous était poursuivi et s’y réfugiait, alors le patron baissait brusquement le rideau de fer et dehors les troupes donnaient des coups de pied, nous lançaient une grenade. Mais ils devaient vite se retirer, des balcons ça grêlait dur.
Tu n’as jamais vu des commerçants se comporter ainsi avec la clientèle ? C’était un effet de cet étrange bonheur : si par erreur l’un d’eux fermait son rideau devant un garçon en fuite, le laissant se faire tabasser dehors, le jour suivant et ceux d’après il pouvait rester chez lui, personne n’entrait dans sa boutique pendant un bon bout de temps.
Je cherche la fille qui se sauva dans le magasin de fruits et légumes, les yeux gonflés de gaz lacrymogène, son pantalon troué. Le patron n’eut pas le temps de fermer, les agents relevèrent le rideau de fer déjà à moitié baissé, excédés de courir sous la grêle des balcons, enfin à l’abri pour une capture facile, bonne pour se dégourdir aussi les membres supérieurs. Ils s’en prirent à la marchandise, un méli-mélo de coups sur brocolis, chicorée, tomates, jambes du commerçant qui avait fini la tête en bas, pommes, courgettes, bras de la fille qui se protégeait sous les paniers renversés. Ils l’attrapèrent par les cheveux, la traînant dehors abrutie de coups et de peur.
Ils avaient soufflé trop longtemps dans le magasin, le reste de la troupe s’était retiré. Ils sortirent en courant et tombèrent sur un groupe des nôtres. La fille passa devant moi, je la pris par un bras. Ainsi pendant deux secondes, trois tout au plus, nous formâmes un beau trio primitif, deux mâles qui se battaient pour la possession de la femelle en la tirant de deux côtés opposés. Puis l’autre céda, touché par un coup de pied de la fille, brusquement ranimée par la bagarre en son honneur et décidée à faire valoir son droit de choix entre ses prétendants. L’agent s’enfuit en serrant dans son gant un bout de scalp. “Je jure que je me les rase à zéro, je jure que je ne me ferai plus prendre comme ça.”
Je cherche la fille qui disait ça sous une porte cochère où nous avons passé une heure à reprendre notre souffle, à dégonfler nos yeux avec du citron, à compter les bleus qu’elle avait, à retirer les légumes de ses vêtements et de ses cheveux. Je la quittai alors qu’elle était calme, elle avait sommeil et elle voulait rentrer chez elle, avertir quelqu’un. Moi non, le soulagement du solitaire dans ces échauffourées était de ne pas avoir d’arrière lignes à prévenir.
Le reste des nôtres resta toute la nuit dans la rue avec le peuple de Garbatella pour raconter, se compter, boire du café, des petits verres de cordial, mâcher du pain tout frais, s’échanger des poignées de main. Le commerçant avait remis en ordre son magasin et la marchandise épargnée, aidé par plein de gens. Il avait gagné une bonne part d’estime, aujourd’hui on dit de marché. Même si aucun expert en la matière n’aurait pu lui donner le bon conseil qu’il sut se donner tout seul au milieu de la petite guerre qui lui était tombée dessus.
Je ne l’ai plus vue pendant les jours, les semaines, les assemblées, les manifestations qui suivirent. À distance de la maigre assurance de plus d’une demi-vie plus tard, je rédige de mémoire une annonce jamais envoyée. “Je cherche la fille...” Je ne la cherche pas et, l’annonce, je ne l’ai même pas écrite. Mais pendant les jours, les semaines, les assemblées, les manifestations qui suivirent j’ai regardé s’il y avait celle qui m’avait juré sous une porte cochère d’aller chez le coiffeur, tout en enlevant la salade de ses souliers. Pendant plusieurs semaines m’est resté tendrement gravé le serment de couper court.
Traduit de l’italien par Danièle Valin, 2003
Abstème jusqu’à dix-neuf ans et plein de jours, je n’aimais pas boire, même les boissons à la mousse retenue sous le bouchon. Je trouvais du goût aux eaux, je les reconnaissais : l’eau de pluie, de la fontaine publique, du robinet, du puits, de la neige et puis celle de mai, une eau à part qui faisait du bien aux yeux et sentait la foudre. L’eau bénite je ne l’ai pas bue, j’ai résisté à la tentation.
Autrefois, les aqueducs remplissaient les cruches des tables, on versait à boire par le tuyau de la cuisine. J’étais abstème, un bon goûteur d’eaux. Pas calme du tout, j’étais devenu sauvage tout jeune en quittant brusquement ma maison d’origine, en mangeant dans une autre ville les repas d’une cantine qui aigrissait les viscères. En quittant la table où il a grandi de tous les centimètres et les repas d’obligation, un homme se crée un vide à l’estomac, un angle aigu qui ne peut être atteint.
À la cantine aussi, pas de vin, je prenais part à d’autres fermentations. Tout autour piaffaient les révoltes de rue et elles m’avalaient. Avec tous ceux qui avaient poussé en même temps, j’étais pressé comme du raisin dans cette année mille neuf cent soixante-neuf, indécente et décisive. Des ouvriers agricoles fusillés par la police au sud, des bombes dans les banques au nord, des anarchistes inculpés à tort et exprès : c’était l’année de la colère, une colère pure. Pour beaucoup, elle devenait un tournant de non-retour à la suite de paroles impitoyables, de réplique. Les dire obligea à leur obéir. En tant qu’abstème, je peux dire à froid que ce ne fut pas une cuite, mais l’avènement à sec de la haine. Dans le désordre nouveau, il y avait une place pour chacun. Pour tous, pour moi aussi, s’était même ajoutée l’aventure des amours tout neufs, qui n’excluaient personne, ni les pauvres ni les laids. Les filles, les femmes tombaient amoureuses dans un élan de générosité, elles répandaient du bonheur parmi ceux à qui ça n’arrivait jamais. C’est arrivé alors et jamais plus. C’était l’amour des insurgés, un cadeau de la fièvre politique, sans laquelle il ne pouvait naître. Etreintes et arrestations, lacrymogènes et baisers, et puis les nuits sur la colline du Janicule, aller pour chanter en chœur et se faire entendre des nôtres enfermés à l’intérieur de Regina Coeli. C’étaient les nouvelles sérénades, les voix des filles fendaient le noir.
Au bistrot, les camarades buvaient le vin pâle et soufré des Castelli, faible en degrés, tournant facilement en vinaigre. Sur la nappe en papier tachée de gras, j’écrivais un billet doux et je le remettais à ma petite amie, à son école, le jour suivant. Les nouveaux amants déchaînés n’avaient pas besoin de facteurs.
Je voyais boire du vin, une substance qui troublait les yeux des anciens et finissait en sanglots. Aux jeunes, il donnait une envie de bagarres, un peu de courage, mais il enlevait agilité et précision. Après le premier coup de poing sur la figure, il rendait honteux, parce que le vin, et non pas moi, avait repoussé l’insulte et l’insolent. Être abstème était un avantage déloyal.
Une autre fois, j’ai eu honte d’une gueule en sang, mais il était sobre lui aussi. Il se trouvait dans un groupe d’ouvriers qui voulait enfoncer de nuit la barrière où d’autres ouvriers veillaient pour garder fermée une usine en grève à outrance contre les licenciements. Nous les avons surpris dans les allées une nuit de brouillard et il y eut un premier sang, pas si grave que ça, mais du sang amer, dur à admettre même quand tu lui donnes raison. La jointure écorchée sur le visage frappé, prête à recommencer, et pourtant une douleur te saisit et désarme ta colère. Sans arriver au terminus de la pitié, tu t’arrêtes à la honte et tu laisses tomber.
L’amour était abstème, une pizza entamée entre les doigts à la tablée où nous étions serrés entre les autres et seuls avec plus de force encore, le vacarme de nos camarades protégeait notre intimité, la renforçait. La même chose est arrivée plus miraculeusement dans les salles des procès politiques à l’intérieur des grandes cages des enfermés en masse. Ils se mettaient debout, bien serrés et entre leurs souliers un couple s’allongeait pour se donner l’amour. Tout autour se tenait le cercle des carabiniers, puis venait le polygone de barreaux et dans le dernier anneau les corps des camarades faisant une haie à l’amour acharné et béni qui s’accouplait dans l’endroit le plus hostile, se glissant entre les mailles des chaînes. C’était ça le miracle, un coup de sainteté donné à la vie. Et des enfants sont même nés comme ça. Il arrive qu’on fête la naissance en captivité d’un petit panda, on fait mine de rien avec nos petits accouchés en prison.
Pour nous deux serrés dans la cohue des camarades, la confusion du bistrot bondé était semblable à une niche dans un bois où rester invisibles, à l’écart. Nous nous parlions à deux centimètres entre bouche et visage, chaque mot était un demi-baiser, arrivé à l’autre avec un goût de salade, de potage. Si un baiser nous échappait, c’était pour conclure notre dialogue. Une gaieté très grave développait l’amour. Il était loyal, sans l’effort de faire bonne impression, sans excuses ni grâces ou autres parties doubles. Et s’il finissait, tu le prenais en pleine figure qu’il finissait, qu’un des deux passait son chemin et pas de questionnaires, mais comment, pourquoi, comment est-ce arrivé, mais tu m’avais dit, écrit, fait : rien, car le monde éclatait en révoltes à suivre et toi avec tes coronaires constipées tu étais à gifler avant de faire rire. C’est juste, mais en attendant ça ne m’était encore jamais arrivé et je ne savais pas quel dégât faisait son absence. La fille poursuivait son chemin loin de moi et un dégoût de douleur me saisissait, j’étais abruti à force de m’endolorir autant, de pleurer derrière mes poings serrés. Celui qui choisit d’être du côté de la multitude peut-il donc rester éclopé par la perte d’intimité avec une seule personne ? Faire couple avec la multitude ne lui suffit-il pas ? La surprise de ne pas m’asseoir à côté, de m’asseoir et c’est tout, de parler aux autres et de ne pas la regarder tandis qu’elle m’écoutait, la surprise de parler et c’est tout, et le reste du travail sans un mot d’elle, le travail et c’est tout, elle me faisait tituber, la surprise. La solitude qui dresse les pires embûches dans la jeunesse, l’avais-je combattue avec elle ou avec la communauté des nombreux enragés de justice ? Alors je ne le savais pas et aujourd’hui je ne le sais plus, mais il a bien dû exister pour moi une heure où j’ai connu de quoi était fait l’envers des solitudes, le contraire de un.
En attendant, j’étais furieux contre moi qui tombais malade de mélancolie de ne plus la sentir à mon côté. Je devenais querelleur, au milieu d’une assemblée, si celui qui était debout sur l’estrade en train de parler ne me revenait pas, je l’attrapais par ses chaussures et je le tirais en bas. Il s’ensuivait une bagarre et il y avait ceux qui me donnaient raison. La colère politique s’infectait de mouvements enragés, d’ulcères enflammés. Le sommeil était mort, la nuit à la ronéo, à l’aube aux tracts, à midi aux chantiers pour s’entendre avec les ouvriers sur ce qu’il y avait à faire, et puis des réunions, et puis, et puis, sans pouvoir m’enlever quand même la paille des yeux.
Alors, un soir de décembre de l’année d’impatience mille neuf cent soixante-neuf, j’allai à Naples pour me remettre dans le cercle des visages. J’étais déjà un intrus. Je regardais à contrecœur l’endroit d’où je m’étais détaché. La mise au point réglée sur le tout près du visage aimé et sur l’ampleur d’une foule en cortège ne se fixait pas dans les pièces quittées, ni dans les usages. La nourriture de la maison était bonne, d’une bonté d’âme, elle contenait le soin, les assiettes ne faisaient pas de bruit, accompagnées et non pas brutalement posées. J’y trouvais un air d’hôpital : une année loin d’eux et j’étais tout retourné jusqu’à l’étourdissement, mais où avais-je été, de quelle guerre punique revenais-je aussi amoché ? Les yeux meurtris, j’accusais l’amour qui ne relâchait pas sa prise même dans les affrontements de rue. Dans ceux-là justement au contraire, je voulais montrer que tout était fini, que je me foutais bien d’elle et je montrais en revanche que c’était de ma vie que je me foutais.
Ainsi, un soir de Naples et de décembre, avec la circonstance aggravante de l’année, dans le sous-sol de mon cousin Danny on fêtait un de leurs exploits. Je m’assis confortablement, toujours avec cette douleur aiguë d’absence à mon côté, et ils me présentèrent une belle jupe de paille entourant une bouteille, du nom de Chianti, je la pris par le col et me versai de sa bouche le premier verre de vin de ma vie. Je le goûtai, âpre, moi à jeun et traître envers l’eau : le dégât dans ma bouche affleura sur mon visage avec une grimace crispée sur les pommettes. Je la retins, c’était un masque qui m’était utile, bride et mors.
Un début de douceur détacha ma peine de mon flanc, il dura moins que rien. Je bus la deuxième gorgée, une pâte de crachat entre la bouche et le nez qui pouvait devenir un éternuement mais qui monta aux yeux : non, des larmes non, vite une autre gorgée me les fit ravaler. Mélangées au vin, elles l’adoucirent, ainsi vidai-je mon verre. Danny, le sous-sol, ses amis chantaient appuyés à une guitare, moi j’oscillais en mesure en serrant dans ma main la jupe de paille.
Danny m’avait appris les bons mouvements des doigts pour ma première chanson à la guitare, la première et non pas les autres qui viendraient toutes seules sous la pincée des cordes. Lui commençait, puis la suite m’appartenait. Je m’appuyai sur son vin et je titubai fort. Chaque gorgée était un coup de hache sur mes pieds, sous la table un bûcheron était en train de m’abattre. Quand je voulus me lever, je m’écroulai, les branches étalées, par terre. Ils me firent la grâce de ne pas s’occuper de moi, c’était un soir de leurs amours en cours. Au contact du sol, ma fureur fit une pause. C’était drôle d’entendre tout autour un chant de jeunes amoureux qui s’aimaient comme ça, à l’intérieur d’un soir, en chœur. Planté là sur le sol, je refusai d’être transporté. Ils me laissèrent sous une couverture. Je n’étais plus abstème, du tout.
Dans la période qui suivit, j’ai tenté de faire avec mon corps le miracle des noces de Cana. Plein d’eau, je voulais le transformer en plein de vin. Pas d’un seul coup, mais par une régulière substitution des liquides, en buvant autant que mon poids en eau. Ça m’a en partie réussi, avec mon crâne seulement. À la fin de l’expérience, je l’avais noyé. Avec lui, au fond du même étang de vin, il y avait le corps de l’amour perdu, une fille aux cheveux défaits était immobile, ne donnant plus de coups de griffes à mes tendons, à mes nerfs.
Il a fallu plus tard une hépatite virale pour me ramener à l’eau et aux papilles vierges. Ce fut une année d’intervalle et point à la ligne. Depuis lors, le vin n’est rien qu’une compagnie, pour équilibrer la journée avec un verre levé au niveau des yeux. Pour celui qui boit le soir, les gorgées sont des baisers à toutes les femmes absentes, et les yeux qui se baissent, une révérence.
Traduction : Danièle Valin, 1993
Entre notre première rangée et leurs boucliers en plastique, il y avait le vide. Les magasins fermaient en cascade leurs rideaux de fer, les passants prenaient des rues latérales et les voitures piégées par notre passage éteignaient leurs moteurs. C’était le couvre-feu qui accompagnait toujours ces cortèges. Nul ne pouvait savoir si une erreur, un prétexte, une occasion pousserait cette foule à se lancer en courant sur les troupes. Il y avait le vide au milieu, un accordéon d’air comprimé par des cris scandés comme des syllabes, évent de gorges et de nerfs d’une foule de personnes devenues prêtes.
Nous étions bien différents, en ces premières années de la décennie soixante-dix, de ceux du coup d’œil de Pasolini qui, quelques années plus tôt seulement, en 1968, vit saigner les jeunes policiers, emmitouflés dans de lourds uniformes, chemises et cravates, et qui s’émut de leur premier sang. C’était un premier sang, le premier qui coulait chez la partie adverse, rien par rapport à celui qui fut prélevé et effacé chez nous, coagulé uniquement sur quelques photogrammes censurés. Nous étions différents de nous-mêmes à nos débuts dans les premières défenses. Il y avait désormais parmi nous une majorité de désolés sociaux venus pousser dans la brèche inaugurée en 1968 et élargie ensuite. Nous avions changé de visage et d’estomac, nous étions l’antagonisme qui ne voulait rien savoir. Nous avions déjà passé l’âge de la pierre, annoncée par le verset de Kohelet qui fixait un endroit, “lehashlìc avanìm”, pour jeter des pierres. On en était à l’âge du fer et des bouteilles, verre vide à casser et amorce chimique. La terre de personne s’était ouverte en grand entre les détachements de police et nous. Il n’y avait ni pratiques ni hommes politiques, seulement une hostilité renforcée à chaque pas, un pas qui écrasait fort le sol, et pas avec des chaussures de gymnastique. On peut faire un tremblement de terre avec les pieds. S’il est vrai qu’au combat l’œil est le premier sens à être vaincu (la seule vue de l’ennemi peut désarmer), alors nous, nous avions lentement endolori la pupille des détachements, avant-poste de l’État, qui n’était pour moi qu’un cirque à démonter. Je ne rêvais pas d’un bateau portant le nom d’Aurore qui pointait ses canons sur le palais d’hiver, je m’imaginais en revanche un chapiteau de banlieue qui s’affaissait sur des dompteurs obèses, des bêtes fauves vieillies, des acrobates arthritiques et des jongleurs parkinsoniens. Entre ce cirque et nous, il n’y avait plus personne. C’était un vide obtenu sans le chercher.
Ainsi, en arrivant sur une place terminale du désert de la ville de Rome, il n’y avait rien d’autre que l’espace entièrement dégagé. C’est pourquoi je l’ai vu et je le revois encore : adossé à un mur de cette place, en imperméable, les bras croisés, nous attendant. Je débouchais souvent le premier, au sommet d’une cuirasse de rangs serrés, comme une mouche sur la corne du rhinocéros. Je le vis et je le laissai tranquille, même si d’habitude nous n’aimions pas les invités. C’était un étranger, l’intellectuel-poète-metteur en scène-romancier-essayiste et journaliste, P.P.P. Il l’avait gagné tout seul ce titre d’étranger, une mise à l’écart hargneuse et sans coquetterie, prêt à donner un coup de main comme à cracher des invectives. C’était une extranéité physiquement exposée comme la nôtre et comme la nôtre impudemment courageuse dans une nation qui déguise sa peur en prudence, un bloc dans le bassin qui empêche de bondir en avant. Nous l’avions actionné bien des fois notre bassin, dans les va-et-vient de nos étreintes. Des lits gratis se présentaient de toutes parts et un esprit d’exploration charnelle permettait des mêlées amoureuses aux beaux et aux laids, aux pauvres et aux riches. Nous avions un air sauvage aussi à cause de ça. Et lui de même : déchaîné, mais pour son compte, dans les ruelles du monde pour connaître les tarifs du sexe, de la Turquie au Brésil. Qui s’en remet au hasard des corps inconnus la nuit sait que, dans les poches sans argent, il y a des couteaux. Il avait tant de fois calmé des lames sur sa gorge, il n’avait sûrement pas peur. Mais il n’aurait jamais admis la honte d’être écrasé par un pneu, plutôt que d’être ouvert par un rasoir. C’est pourquoi lui seul parvenait à rester là, dans ce vide, l’étranger capable de le respirer. Il n’avait pas voulu rajuster l’impression physique que nous lui donnions, nous, jeunes gens comme il faut, encanaillés contre les pauvres diables en uniforme. Il avait tort, et après : que savait-il des vieux de la Garbatella, de San Lorenzo, qui arrêtaient les charges lancées contre nous en jetant toute leur maison sur les détachements du haut de leurs balcons ? Que savait-il des citrons qu’on nous offrait pour nous les passer sur les yeux et nous éviter de pleurer au milieu du gaz ? De l’acide citrique coulait sur nos visages à la place des larmes et nous avions cessé de pleurer. Tout était changé, mélangé, à cause de la joie forcenée d’un atelier, qui s’élevait brusquement contre un licenciement et qui entraînait derrière lui le reste de l’usine. Tout était changé à cause des lambeaux d’étoffe de piazza Fontana : personne n’était plus soi-même, for the times they are a changing, mais lui n’avait pas rajusté ce vers. Quod scripsi, scripsi. Les hommes, rares désormais, savent que les mots qui sortent de la bouche ou du stylo engagent, que c’est eux qui commandent. On est leur maître tant qu’ils sont enfermés dans l’encre ou dans la bouche. Quod scripsi, scripsi. L’étranger avait un fil à plomb dans son épine dorsale ; même dans l’invective, il était fidèle. Il était le seul à pouvoir supporter le vide entre nous et le cirque. Que nul ne dise qu’il le remplissait, car nul ne le pouvait. Pourtant, lui était là, tout seul, et c’était bien la seule façon d’y être. Il nous regardait, il pensait et nous pensait. Et moi, mouche au sommet de la corne, en le sautant, en le dépassant, je faisais en sorte que la grosse bête derrière moi l’ignore, le recouvrant de son ombre. Et quand il vit le corps tout entier jusqu’à la queue, terminée par la dernière tranchée de rangs d’arrière-garde, il s’en alla. Il n’était pas là pour écouter nos paroles brûlantes qui se voulaient efficaces, bien plus qu’exactes. Il était là pour le son de nos pas sur les pierres, pour l’apnée de la ville tout autour et pour nos visages fils de personne, défigurés par les cris. Il avait une passion pour les visages. Il aimait Naples pour la résistance obstinée de ses linéaments, fatigues et obscénités, insomnies humides de sel de mer et dents de café, mandibules effilées et cataractes, faces de pain sec, travaillées à la cuillère. Et si la tête sert à peine plus qu’à “spartere‘e rrecchie”, à maintenir les oreilles séparées, quelle architecture crânienne résistait à Naples dans l’espace compris entre les deux pavillons. C’est ainsi qu’il a volé le dernier éboulement facial de Toto devenu petit oiseau, ainsi qu’il vola à un groupe d’intellectuels leur plus bel affolement en les faisant poser en apôtres dans son Évangile, peu selon Matthieu, plus selon lui-même. Ce n’était pas du grand cinéma : vaste bien sûr dans le champ d’os et d’ombres qu’est un visage, mais toujours raidi par la crampe d’une idée à démontrer. Accattone me donne des frissons à cause du jeu des “vrais”, si faux et maladroit, qui en fait un découpage pour vitrines et auquel on pourrait donner un petit titre explicatif comme faisait Godard, son ennemi. Comencini est bien meilleur, lui qui est capable de faire évoluer des enfants vrais “tels quels”. Cependant, quel metteur en scène a eu l’idée de faire coïncider dans sa propre œuvre les immensités si éloignées d’un évangile grec comme Médée avec une tragédie juive comme “selon Matthieu” ? Personne. Voilà, lui était plus grand que les choses qu’il faisait, il était plus étendu et ouvert que la somme de toutes les parties, de ses produits. C’est une grandeur qui n’a jamais abouti, à cause d’une émouvante disproportion entre ses idées et leur rendu, à cause d’une outrance qui ne reculait devant aucune entreprise.
De lui, quelle que soit la partie ou le bout, je n’aime rien. Et si son nom n’avait pas grossi à force de cinéma solennel et brutal, mais boiteux et négligé, il aurait été un des manquants à l’appel, comme D’Arzo ou Delfini, vite tombés de leurs branches fruitières. Je ne suis pas arrivé à terminer la lecture de Ragazzi di vita et je n’ai rien retenu, pas même un seul de ses vers en phrase, mutilés de musique, soumis à la rédaction d’un procès-verbal d’une tempête d’humeurs. Je ne l’ai pas suivi non plus dans ses pensées aigres comme celles qui nous concernaient nous, jeunes de l’après-guerre, survécus en surnombre à la mortalité infantile grâce à la puissance militaire des antibiotiques. Il nous regardait comme une excroissance de l’espèce, nous qui étions “destinés à être morts” et qui nous étions encanaillés jusqu’à l’extrémisme du fait de cette arrogance d’être encore vivants. Il nous attribuait un besoin d’uniformité et d’uniformes, en trouvant une confirmation dans l’irrégularité méthodique de nos vêtements. Et il en mourait, et comment, parmi nous, les “destinés à être morts”, clairsemés de toutes les manières, desaparecidos, inutilisables dans l’échange du pouvoir, exception faite d’une poignée d’élites du reniement, athlètes de la spécialité. Comme il était hypocrite et formel dans Lettres luthériennes, ce monologue qui s’adresse à un garçon de Naples, Gennariello. Mais si en changeant l’ordre des termes le total est toujours le même et si tout ce qu’il a fait ne donne qu’une maigre somme, la perte de sa personne physique est le seul deuil de notre vie culturelle que je suis disposé à admettre. Car il me manque, car on apprend quelque chose en se fâchant contre quelqu’un ou si lui se fâche contre nous. Et il était le seul, lui, l’étranger, capable de me donner le frisson d’être dans l’erreur, en vie et dans la rue. Il n’y avait que lui et il ne pouvait pas être un ami car nous ne le méritions pas et lui ne nous méritait pas. C’est la personne que je voudrais aujourd’hui près de moi dans le camion que je conduis par monts et par vaux sur les routes de guerre de Bosnie. Il aurait été là pour regarder des visages, pour voir le gaspillage général des Abel de cette terre, égorgés par les frères de tous les peuples de Yougoslavie. Et je peux croire qu’il n’aurait pas demandé une autre guerre à la guerre. Car lui savait être la blessure et non pas le remède, la douleur, non pas la médecine.
Et dans une réunion du comité national de Lotta continua arriva sa mort (oui la mort arriva, pas seulement la nouvelle) et un silence passa que nous n’avions pas encore connu. Le vide entre nous et le cirque s’était aussi débarrassé de lui. Oui, il nous avait prêté son nom, pendant quelques mois, pour garantir la sortie de notre journal, il nous avait donné de l’argent et des crachats. Mais ce silence était tout à fait dénué de reconnaissance. Ce n’étaient pas des temps propices aux reconnaissances, chaque nouvelle journée effaçait les précédentes et on valait seulement pour ce qu’on mettait dans l’assiette du jour. Un silence se fit qui mimait déjà son absence. Nous étions trop nombreux pour nous sentir seuls, pourtant brusquement nous nous trouvâmes “sans” : sans l’étranger à dévisager, seulement pour détourner le regard de la rangée compacte des casques, là-bas, au-delà du vide conquis.
[Pier Paolo Pasolini meurt assassiné dans les faubourgs de Rome à Ostie en 1975.Encore aujourd’hui on ne sait toujours pas qui est (ou sont) l’(es) auteur(s) de cet acte.]
Traduit de l’Italien par Danièle Valin, 2002
C’était bien autre chose, l’action convulsive dont tu me parlais et qui contenait, d’après ce que tu disais, une part d’un monde futur […]. C’était une façon de se battre. On ne demandait pas d’être d’accord avec un projet, mais de s’engager dans les luttes. Il y eut des maisons vides qu’on occupa, des loyers qu’on ne paya plus, des quittances d’électricités brûlées dans la rue. On entravait les mesures de rétorsion, coupures de courant, expulsions. On avait cessé de payer les additions, on arrivait à exiger. Quand le temps de la lutte finissait, avec plus ou moins de succès, on recommençait d’un autre côté […].
Nous n’étions pas convenables, notre technique étant le choc, technique éprouvante pour n’obtenir que peu de chose, parfois rien. Pourtant cela donnait du poids. Il y a un moment dans sa vie où un homme veut poser sur le sol une plante de pied large, un pas qui ne soit pas léger. Il était urgent d’avoir une gravité différente ; elle modifia la démarche de beaucoup. Quand elle prit fin, chacun l’effaça en enfilant des chaussures de gymnastique. Durant ces années de chocs, personne ne souhaitait être plus grand, plus maigre, pas même plus sain : elles riaient volontiers, les bouches édentées […].
Traduit de l’Italien par Danièle Valin, 1995
EPILOGUE
Les enfants scrutent les tatouages. La virile vanité des marins, comme la nostalgie des détenus, laisse le corps se prêter comme la feuille ou la toile à la plume pointue du graveur.
Au temps de la mer d’été je connaissais les dessins et les couleurs sur la peau des pêcheurs, noms, cœurs, bateaux, lunes. Quand j’étais enfant, j’allais à la pêche avec mon oncle. Il avait un bateau à moteur que pilotait Nicola, le pêcheur qui partageait avec lui le produit de la journée. Le plus souvent on y allait tout seuls, mais parfois avec un invité.
On se levait de bonne heure, moi je passais par le seul bar ouvert et j’arrivais à la plage apportant les brioches encore tièdes à peine sorties du four. L’odeur appétissante se mêlait à l’odeur salée du bois de la barque et aux bouffées cadencées du vieux moteur diesel. Pour moi, c’était une odeur d’hommes et j’éprouvais un certain orgueil à la partager.
On partait de la plage des pêcheurs d’Ischia pour atteindre le bras de mer que l’on disait poissonneux à cette époque de la saison. Une fois, un homme maigre, d’une quarantaine d’années, l’âge de mon oncle, nous accompagna. Avant de monter à bord, je lui fus présenté et il me donna une poignée de main lente, distraite. Je faisais attention aux mains des hommes, à leurs cals, à leur façon de les tendre, de les croiser à l’état de repos : formes dans lesquelles j’essayais de reconnaître le caractère. Cet homme n’était pas de Naples, il parlait peu et tenait ses mains sur ses genoux. Il avait un tatouage sur le bras. Je le vis sur le bateau, car là seulement il retroussa ses manches, plongeant la main dans l’eau pour se mouiller les cheveux tandis que la barque avançait. Il n’était composé que de numéros.
Je ne posais pas de questions aux hommes, je savais qu’un enfant ne pouvait rester parmi eux qu’à condition d’être silencieux. Avec le temps, j’ai apprécié de tels usages. Les enfants qui posent des questions en rafales goûtent plutôt la sonorité péremptoire du ton de leur voix que les vagues réponses. Jamais je n’aurais demandé à l’invité ce qu’était le chiffre qu’il portait gravé. Je pensais d’abord à un numéro de téléphone, puis à un message secret, enfin j’imaginais qu’y était inscrite la somme des jours d’une vie, peut-être la sienne.
Les hommes parlaient peu entre eux, le moteur faisait sauter les lignes sur le payol en bois du fond de la barque. Le voyage vers le périmètre de pêche était fait de peu de gestes. Nous nous arrêtâmes au large de Procida. Nous plongeâmes les fils de nylon amorcés avec des bouts de tòtano, sorte de calmar, en essayant de deviner le niveau de profondeur moyenne à laquelle pouvaient se trouver ces poissons qu’on appelle vope [1] chez nous. L’homme au bras marqué imitait nos gestes en novice, mais avec assez de précision.
Je vis le coup sec que mon oncle donna brusquement, levant au ciel la main qui tenait la ligne. Tatata, les trois coups violents donnés par la vopa à l’hameçon, je les entendis et Nicola aussi. Debout tous les trois, nous tirions nos fils avec l’habileté nécessaire. Il fallait que la remontée fût rapide mais régulière, sans secousse. On devait aussi veiller à ne pas piétiner l’écheveau de nylon qui s’entassait entre nos jambes pour ne pas le retrouver ensuite tout emmêlé. Les belles vope argentées montèrent à bord et commencèrent leur frénétique batterie caudale sur le bois, son qui rend les pêcheurs tout joyeux.
Notre invité n’avait pas deviné la bonne profondeur, deux mètres suffisent parfois pour se trouver à l’écart du groupe. Nicola la régla pour lui et il commença lui aussi à sentir les petits coups brusques qui, du fond de la mer, transmettent au bout du doigt le frémissement de la prise.
Les poissons s’entassaient dans le baquet alors que le soleil montait au milieu du jour. Nos doigts imprégnés de poisson et d’eau salée, nous portâmes les brioches à nos bouches, les savourant sous le coup d’un féroce appétit. Les hommes avaient une odeur d’appât et de four. À cet âge-là, je me sentais membre d’une virilité commune du monde, muette, parfumée. Adulte, je ne l’ai pas retrouvée chez les hommes.
Nous revînmes vers Ischia. Mon oncle au gouvernail, Nicola nettoyait les poissons, moi à l’avant, loin d’eux. Notre invité mettait son bras dans l’eau, traçant un sillon parallèle à la barque qui avançait. Le bras tatoué fendait les vagues, proue de rien, derrière laquelle rien ne suivait.
Nous passâmes devant Procida à quelques encablures du pénitencier. D’une fenêtre à barreaux sortit un chiffon blanc, un bras nu agita ce linge. Ce signe nous était destiné, il n’y avait pas d’autre bateau à proximité. Je repassai en courant à l’arrière pour attraper mon maillot à rayures et je revins aussitôt à l’avant. La mer calme me permettait de rester debout : ainsi j’agitai mon vêtement de toutes mes forces, en équilibre. J’avais l’âge de raison, environ dix ans, je connaissais cet endroit et les réclusions avaient déjà mis leur germe dans ma pensée. Les hommes me laissèrent faire, ne répondirent pas au signe, ne s’occupèrent pas de moi. Tant que je vis ce bras j’agitai le mien. L’invité retira le sien de l’eau et enfila sa chemise.
Je raconte les petites choses qui se sont fixées dans mes sens. Avant tout, je garde en mémoire une odeur masculine, une appartenance à un monde d’adultes. Plus tard j’ai su qui était cet homme avec nous. Il faisait partie du petit nombre de rescapés des camps d’extermination. Ce numéro sur son bras n’était pas un tatouage, mais l’infamie d’un marquage. Il appartenait à cette humanité exterminée au gaz Zyklon B, dont l’odeur a empoisonné notre siècle, et que personne ne connaît.
Lorsque nous débarquâmes, il me tendit sa main, serrant la mienne avec une certaine fermeté. C’était une étreinte légère, mais sur son bras les chiffres remuèrent sous la poussée des tendons. Je répondis avec ma faible force à sa main. Comme la mienne, elle sentait le poisson et les brioches.
Traduit de l’italien par Danièle Valin, 1993
Le sénateur à vie Andreotti après sa condamnation à une toute autre vie à cause d’une peine de vingt-quatre ans, a dit qu’il n’a plus le temps d’être anarchiste. C’est un tort. Si une horrible malchance l’obligeait au neuf millième de la peine de prison annoncée, un peu moins d’une journée, il pourrait s’amender et devenir un bon anarchiste.
Si l’anarchie prévoit l’abolition des cages pénales, si l’anarchie prévoit une façon différente de s’acquitter du tort commis, je suis anarchiste. Mais il vaut mieux ne pas déranger l’histoire passionnée d’un mouvement hostile aux pouvoirs politiques, tous sans exception. Il suffit d’être au raz du sol de la société, de son rez-de-chaussée. Il suffit de regarder qui est en prison et qui ne l’est pas, il suffit de savoir que ceux qui ont les moyens, en mettant les choses au pire, passent quelques semaines d’arrêts forcés à domicile dans l’attique du quartier Parioli, il suffit de se rendre compte que la justice est la même pour tous les malheureux et bizarre pour les autres, il suffit de regarder les plateaux de la balance pour voir qu’ils sont faussés : pour désirer la fin des prisons.
Et alors que j’exprime ce désir depuis que je suis tout petit et que j’ai vu un bras agiter un chiffon derrière les barreaux, et tandis que pleuvent au sol des millions d’étoiles sans qu’il soit exaucé, ce n’est pas par erreur que je ne peux m’empêcher d’écrire : je veux la fermeture des prisons. Moi je veux l’ouverture des prisons, la démolition à coup de burin de toutes les serrures et cadenas, le défoncement et le dégondement de toutes les portes blindées derrière lesquelles se trouvent mes semblables. Comme pour le coup de pioche sur le mur de Berlin, j’attends le jour où les prisonniers vieux et neufs seront convoqués pour la plus belle corvée : aller démolir cadenas et serrures, démolir les portes d’entrée, arracher les barreaux. Ouvrir les prisons avec irrévérence, en laissant derrière soi des portes qui ne peuvent plus se fermer derrière personne.
Je suis de l’espèce animale née libre, je réponds à la voix du verbe ouvrir, au cri sourd-muet de mon sang qui court et bat à force d’oxygène, de grand air.
Je vous remercie vous, hommes et femmes de peine, voix de Radiobugliolo, de donner un lieu et un droit à ma supplique à la langue italienne : que seul soit autorisé l’usage du verbe entrouvrir, que soit effacé du vocabulaire le verbe fermer.
Revue No Pasaran ! Hors Série, 2003
[1] Bogues : poissons méditerranéens au corps allongé, rayé de couleurs vives. (N.d.T.)
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (1 Mio)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (1 Mio)