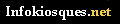G
La Guerre Sociale
mis en ligne le 15 octobre 2008 - Collectif
Note des éditions de la guerre sociale :
Un siècle plus tard plus tard, pourquoi publier des articles de la Guerre sociale ?
D’abord, parce que la charge politique et la passion de la révolution qui transpirent de ces pages — et de cette époque — n’ont pas d’âge, et qu’elles parlent à tou-te-s celleux qui sont aux prises avec ce monde, finalement pas si différent de la société de la Belle Époque.
La Guerre sociale, c’est la cristallisation dans un journal de toute l’offensive révolutionnaire portée par ce qui s’est appelé le « mouvement ouvrier » ; c’est la grande frousse de la bourgeoisie avant le 1er mai 1906 ; c’est la propagande par le fait des attentats anarchistes des années 1890 ; c’est Marx qui théorise la lutte des classes ; c’est les société secrètes ouvrières du milieux du XIXème qui deviennent des « caisses de résistances », puis des chambres syndicales, pour finir par s’agencer dans la CGT et la fédération des Bourses du travail, portant réellement et pratiquement le projet d’en finir avec l’organisation capitaliste ; ce n’est déjà plus la ferveur « républicaine », qui de 1789 à Blanqui et la Commune aura porté le souffle de la révolution : c’est l’aboutissement de l’époque charnière où la République (et la démocratie ?), comme forme affirmée de la gouvernance capitaliste, devient l’ennemi à abattre ; c’est l’apogée du prolétariat révolutionnaire, si ce n’est dans le monde, du moins en France ; c’est la réalisation proche, si proche, du communisme, qui depuis ce moment n’en finira plus de se dérober.Au-delà de la transcription quasi palpable de la puissance révolutionnaire de l’époque, ce qui frappe à la lecture des articles publiés ici, c’est la façon dont ils entrent en résonance, parfois indirectement, avec des problématiques contemporaines :
L’importance de bloquer les « services de circulation » pour peser dans le rapport de force, et conséquemment l’instauration par le gouvernement de la militarisation des « services publics », ancêtre du service minimum (« services publics et grève générale » p.6).
Le rôle de chien de garde de la presse dans la gestion des mouvements sociaux (« après le sang, la boue » p.12).
L’« urgente campagne [qu’]il est nécessaire d’entreprendre avec acharnement contre la police et les policiers » (« la journée des flics » p.21, par Georges Yvetot, secrétaire de la fédération des Bourses du travail et donc n°2 de la CGT...), et la nécessité de tenir tête aux condés dans la rue (« le prestige de la fonction » p.26, « premier avertissement... avec frais » p.26 et « comment on les dresse » p.53), avec si nécessaire le « citoyen browning » — ancêtre du « camarade P38 » italien des années 70 — (« après la défaite » p. 55).
La propagande en faveur des campagnes de sabotages (« réflexions sur le sabotage », p.33) qui visaient notamment les câbles longeant les lignes de chemins de fer (« sabotage et hommes de l’ordre », p.36) — pratique qui a réémergé lors des grèves SNCF de fin 2007, début 2008.
Les dangers et limites du « front républicain », qui ne s’appelait pas encore « antifasciste » mais qui sous couvert d’anticléricalisme ou de lutte contre la droite réactionnaire et monarchiste assurait la domination de la bourgeoisie parlementaire (« défendrons-nous la République ? » p.30).
L’épineuse question de l’organisation, sans cesse renouvelée, avec les réflexions et débats sur le rôle et les limites d’un parti révolutionnaire [1] (« quel est le rôle du parti socialiste ? » p.14 et « l’attitude des insurrectionnels » p.48).
Les embrouilles plus ou moins confraternelles entre tendances du mouvement, avec toutefois la conscience de la nécessité de composer avec des camarades plutôt proches (« pour des salauds » p.44, et les différentes piques contre l’Humanité).
L’apologie du geste de révolte de l’« apache », équivalent de notre « lascar » moderne, quand il s’en prend radicalement à la police (« l’exemple de l’apache » p.46, « Liabeuf...& Caserio » p.58).Certains textes permettent aussi de mesurer le chemin parcouru, pas forcément dans le bon sens, depuis un siècle :
L’affirmation croissante du féminisme, et de l’égalité entre les sexes (« le droit à l’avortement » p.23).
Le rapport de force entre travail et capital, avec une classe ouvrière qui se payait le luxe de refuser la loi sur l’instauration des retraites proposée par les modérés du parti socialiste, alors que le temps de travail réglementaire a aujourd’hui tendance à repartir à la hausse — une première depuis des décennies — avec la bénédiction des organisations syndicales (« la classe ouvrière contre les retraites » p.51).
L’anticolonialisme, conséquence directe de l’antipatriotisme et de l’antimilitarisme porté alors par les organisations de classe ouvrière (« engrenage marocain » p.9).
La critique de la république et du parlementarisme, sur laquelle s’assoient et se reconnaissent depuis les mouvements révolutionnaires (« les dangers du parlementarisme » p.27).
Et, cerise sur le gâteau, la Guerre sociale prétendait aussi contribuer à l’édification culturelle et politique du prolétariat [2], avec notamment un article sur Karl Marx qui énonce clairement ce que représente l’auteur du Manifeste du parti communiste, et qui pose les bases que partageront par la suite les mouvements marxistes anti-autoritaires. (« Karl Marx » p.18)[1] Evidemment, si cette question se pose toujours aujourd’hui, la réponse n’est pour nous pas plus à chercher du côté de l’actuel parti socialiste que de celui d’un éventuel « parti anticapitaliste »...
[2] Dans « La Guerre sociale, un journal contre », figurent un certain nombre d’articles traitant de questions culturelles — défendant notamment les prémices des avant-gardes artistiques qui marqueront le XXème siècle.
« LA GUERRE SOCIALE »
Ce qu’elle veut être. Ce qu’elle sera.
La création de ce journal a été décidée à la prison de la Santé et à Clairvaux où, pendant plus de six mois, vingt-cinq militants anarchistes ou socialistes furent détenus pour insuffisance de patriotisme.
La Guerre Sociale ne fait double emploi ni avec Les Temps nouveaux, Le Libertaire, L’Anarchie, feuilles libertaires ou anarchistes, un peu théoriques ; ni avec La Voix du peuple ou Le Socialiste, organes officiels de deux grandes organisations, la Confédération générale du travail et le Parti socialiste — qui ont fatalement les timidités et les réserves de tous les organes officiels — ni encore moins avec L’Humanité qui est un quotidien entre les mains des socialistes « jauressistes », c’est-à-dire ultra-réformistes et parlementaires, et ouvert aux seuls éléments syndicalistes modérés ou sur la pente du modérantisme.
La Guerre Sociale n’est un journal ni exclusivement socialiste, ni exclusivement libertaire.
Elle aspire à devenir l’organe :
- des socialistes « unifiés » qui déplorent de voir leur parti devenir de plus en plus un parti d’action électorale et parlementaire et qui, à l’intérieur du Parti, luttent pour l’arracher à son réformisme, à son respect de la légalité, à son révolutionnarisme purement verbal ;
- des syndicalistes qui veulent orienter de plus en plus les organisations ouvrières dans les voies de l’action directe et de la grève générale violente et maintenir — en les accentuant — leurs tendances fédéralistes, antipatriotes et antiparlementaires ;
- des communistes libertaires qui en ont assez des vaines discussions théoriques, de l’action purement individuelle, et qui, dans les sections de l’AIA (Alliance internationale anti-militariste) ou dans tout autre groupement, s’efforceront, par une propagande antimilitariste incessante et par une énergique résistance aux menées et aux brutalités policières, d’entraîner les masses pour la prochaine insurrection, lorsqu’une guerre, une grève générale, ou toute autre circonstance imprévue, permettront de la tenter avec quelque chance de succès.
La Guerre Sociale sera donc un organe de concentration révolutionnaire, ouvert à tous ceux qui travaillent, autrement que par l’action légale, à l’expropriation de la bourgeoisie capitaliste en vue de la socialisation des moyens de production et d’échange.
Elle dira, au surplus, sur tout et sur tous, ce qu’on n’ose pas dire ailleurs.
(19 décembre 1906)
—
La militarisation des services publics :
SERVICES PUBLICS ET GRÈVE GÉNÉRALE
(20 mars 1907)
Des évènements récents — comme la grève des facteurs (avril 1906), la formation des syndicats d’instituteurs, la grève des électriciens (mars 1907) — ont fait apparaître l’État sous son véritable aspect d’ennemi des travailleurs. L’action du libre-penseur Clemenceau [1], le briseur de grèves, a été tout particulièrement instructive à ce sujet.
L’histoire de ces dernières années a montré que l’État, loin de rester impartial dans les conflits du capital et du travail, met toujours sa force au service du plus fort et prend parti pour le capital.
L’État n’a de raison d’être que comme défenseur de la classe possédante.
La conquête des municipalités, l’entrée au parlement de représentants de classe, dont on espéra tant, de 1893 à 1898, n’ont donné que des résultats mesquins. Le Parlement est alors apparu comme une machine merveilleusement montée pour ne jamais aboutir, jamais réaliser, déformant les esprits les plus clairs en un crétinisme spécial que signala Marx, corrompant les plus honnêtes. Il ne semble pas embrayé, pour ainsi dire, sur la vie sociale, et tourne dans le vide comme une roue folle, sans action sur le reste de la machine.
A mesure que l’action ouvrière provoquait ces constatations historiques, l’importance révolutionnaire de la Grève Générale s’imposait à tous les esprits.
Lorsque l’on parle de grève générale, il faut entendre « grève généralisée et coordonnée », car, outre qu’une cessation universelle et simultanée du travail semble impossible, l’universalité de la grève est loin d’être indispensable.
Dans la grève générale, transformatrice de la société, la grève des services de circulation des richesses serait beaucoup plus efficace que la grève des services de production.
L’arrêt de la production proprement dite (filatures, forges, construction, etc.) ne serait pas immédiatement victorieux, car les réserves du capitalisme, les stocks, permettraient à la société bourgeoise une existence précaire, mais possible.
Au contraire, l’arrêt des services de circulation (chemins de fer, postes, éclairage, etc.), aboutirait à une mort rapide du capitalisme [2].
De même, le corps humain ne succombe que lentement aux affections organiques — comme le cancer —, qui intéressent la production des tissus, tandis que la mort est foudroyante en cas d’arrêt de la circulation (embolie).
L’action des tabletiers ou des tourneurs-robinetiers, en cas de grève générale, serait utile mais secondaire. Ce serait la grève des mines, des chemins de fer, des postes, du gaz et de l’électricité qui serait décisive. Ce sont précisément ces fonctions vitales que, sous le nom de services publics, on va nationaliser, c’est-à-dire militariser [3].
Les travailleurs des services publics n’ont pas le droit de grève : en cas de révolte, l’armée les mitraille ou les remplace.
Rien de plus élastique que le terme de « services publics ».
Dès que la grève générale d’une corporation se révélera comme politiquement dangereuse, il suffira de la baptiser Services publics pour lui retirer le droit de grève. Si les boulangers font la mauvaise tête, ils seront déclarés accomplir un service public et, en cas de grève, la troupe les remplacera au fournil.
Il est significatif de voir figurer au programme du Parti radical la nationalisation des mines et des chemins de fer.
Contre l’éventualité redoutable d’une grève générale de ces corporations, la nationalisation est un remède utile pour la bourgeoisie, car c’est la perte du droit de grève, la militarisation.
La démocratie, forme idéale de la domination capitaliste
De même que la république est la forme idéale de la répression bourgeoise (juin 1848, mai 1871, etc.), le radicalisme, promoteur de la nationalisation des services publics, est la forme idéale du conservatisme capitaliste.
Les socialistes se sont trop laissés envahir par les préjugés démocratiques. Ils ne doivent pas se laisser prendre à la comédie parlementaire, soit au petit jeu de bascule entre les conservateurs tories et les libéraux whigs, comme en Angleterre, ou entre les républicains et les démocrates, comme aux États-Unis, ou bien au petit jeu de manger du curé, que l’on fait ensuite soigneusement renaître, comme en France.
Il ne faut pas se faire d’illusion non plus sur la portée du suffrage universel, où la minorité consciente est écrasée par le plébiscite des alcooliques, des boutiquiers, des imbéciles qui veulent travailler le dimanche, des dégénérés qui font les jaunes en temps de grève, de tous les poltrons qui ont de la couenne à la place de la cervelle.
Il ne faut pas croire davantage que la forme politique républicaine suit un acheminement vers une législation sociale. En ces matières, l’état des mœurs importe plus que l’étiquette politique. Les royaumes d’Angleterre, de Belgique, de Hollande et d’Italie sont parfois plus libéraux, dans les questions ouvrières, que les républiques de France, de Suisse et surtout des États-Unis.
L’Allemagne impériale a une législation sociale plus complète que celle de la République française, et c’est cette République qui annule en fait sous Clemenceau, le droit de grève accordé par l’Empire (1864).
Les gouvernements à tendance oligarchique ont besoin d’accorder plus de réformes sociales à l’ouvrier, afin de se le concilier, tandis qu’en proclamant la république, la bourgeoisie fait, pour un temps, l’économie des lois sociales.
L’État démocratique, hypocrite ennemi de l’ouvrier, est l’agent le plus sûr de la conservation capitaliste. En plus des redoutables moyens de duperie et de mensonge dont il dispose, de la fantasmagorie décevante du parlementarisme, l’État démocratique s’arme dès maintenant contre une grève générale par la militarisation des services publics.
S’il avait bien dans la main les services publics, les mines et les chemins de fer nationalisés, en accordant de petits avantages (sécurité, retraites, etc.) en divisant son personnel (agents, sous-agents, dames, main d’oeuvre, etc.), en corrompant les secrétaires des syndicats, l’État démocratique, appuyé sur l’armée, pourrait braver les colères du prolétariat de l’industrie privée.
André Bruckère
—
Les escarpes français au Maroc
ENGRENAGE MAROCAIN
(3 avril 1907)
Un médecin français, intrépide autant qu’imprudent, a été assassiné au Maroc, dans une région peu sûre où le même accident peut arriver à n’importe quel indigène- ; aussitôt, une colonne française de 3000 hommes occupe une province marocaine, située à 500 km du lieu du meurtre.
Avec la même logique, la première fois qu’un sujet allemand sera assassiné sur les boulevards extérieurs, sans qu’on puisse trouver et punir l’assassin, l’empereur d’Allemagne n’aura qu’à faire occuper Nancy.
Ce n’est pas la même chose ?
Évidemment, les capitalistes allemands ne veulent pas annexer la France pour l’exploiter, comme les capitalistes français veulent faire pour le Maroc, mais ce serait le même procédé, le même abus du droit du plus fort, et ce ne serait pas plus répugnant.
En ont-ils poussé des cris de putois les jésuites tricolores, quand on leur a pris leur Alsace !
Dix ans ne s’étaient pas écoulés qu’ils volaient la Tunisie ; puis le Tonkin, puis Madagascar, puis le Dahomey. C’est maintenant le tour du Maroc.
Du moment que les grands-pères ont volé l’Algérie, ce vol confère aux petits-fils des droits incontestables sur le Maroc qui est à deux pas.
Et pendant ce temps, ils font prêcher aux enfants des congréganistes [4] et des écoles laïques le vieux cliché chrétien et républicain : « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse ! »
Il ne faut pas se le dissimuler : le petit doigt est dans l’engrenage marocain ; tout le corps y passera.
Actuellement, on y met encore les formes ; on hésite ; on crie par-dessus les toits que l’occupation d’Oujda n’est que provisoire. Les Anglais aussi n’ont occupé l’Egypte que provisoirement en 1881 ; aujourd’hui, en 1907, ils y sont encore.
On évacuera peut-être Oujda ; car nos jésuites tricolores, s’ils n’ont pas peur des Marocains, ont une peur atroce des Allemands ; ils redoutent des complications du côté du Rhin ; là est pour eux le seul frein à l’heure actuelle, et notre seule garantie. Mais on peut s’arranger avec les Allemands : « Passe-moi le séné, je te passerai la rhubarbe. » Laisse-moi le Maroc, je te donnerai carte blanche en Syrie. Alors, gare aux Marocains ! [5]
Sans compter que même si notre classe dirigeante ne s’entend pas sur le dos des Marocains avec les dirigeants d’Allemagne, la paix au Maroc est à la merci d’un incident : que quelques tribus marocaines fanatiques ou patriotes ne trouvent pas de leur goût l’entrée des troupes françaises à Oujda ; que quelques zouaves ou légionnaires commettent quelques exactions sur des indigènes, et c’est assez pour que les fusils partent tout seuls. On n’accumule pas longtemps impunément des explosifs près du feu.
Quel vacarme eût fait le Clemenceau de jadis si, il y a vingt ans, c’était Jules Ferry qui se fût laissé engager dans une telle aventure ! Vous en auriez entendu de beaux discours ! Jules Ferry est mort, mais il est ressuscité, il s’appelle Clemenceau.
Les opportunistes ont été chassés du pouvoir ; mais les radicaux y continuent leur politique de conservation sociale et d’expansion coloniale. Quant aux élus socialistes, n’en parlons pas ; ils sont restés muets comme des carpes lorsque l’occupation d’Oujda a été votée. Il a suffi que M. Ribot déclarât que l’occupation ne serait que provisoire pour qu’ils se taisent, de peur de passer pour de mauvais patriotes et compromettre leur réélection.
Aussi bien, ce n’est pas sur le parlement, c’est sur eux-mêmes, que doivent compter les prolétaires pour ne pas aller au Maroc, et pour empêcher les dirigeants de les lancer dans cette aventure qui sera plus coûteuse et plus sanglante qu’on se le figure.
Les jeunes gens qui sont sous les drapeaux y ont été appelés sous le fallacieux prétexte de défendre la patrie française ; s’ils ont du cœur, qu’ils refusent donc d’aller envahir la patrie marocaine ; il n’y a pas un homme intelligent, fût-il patriote, qui pourrait désapprouver un tel acte de désobéissance.
Et comme des actes individuels n’ont aucune portée, sinon de donner aux masses moutonnières de bons exemples, que la CGT n’hésite pas à opposer la force collective du prolétariat révolutionnaire à la première tentative de nos dirigeants pour escamoter le Maroc.
Il ne peut y avoir d’expédition coloniale aujourd’hui que si les ouvriers des arsenaux le veulent, que si les dockers, les inscrits maritimes, chargés d’embarquer le matériel de guerre et de conduire le bétail humain à l’abattoir, le permettent.
Ces syndicats sont capables de se mettre en grève pour des questions de salaire ; ne finiront-ils pas par comprendre que si jamais une grève s’impose, c’est le jour où nos dirigeants voudront accomplir quelque nouveau brigandage colonial ?
J’écrivais un jour que j’avais pour les soldats français morts en annexant Madagascar la vague pitié que j’ai pour les escarpes qui meurent en accomplissant leur difficile profession.
Je sais que c’est le sentiment que professent tous les révolutionnaires de la CGT et du Parti socialiste pour les escarpes en uniforme français qui viennent d’envahir le territoire marocain.
Mais il ne suffit pas de le penser et de le dire ; il faudrait que le prolétariat, qui seul a la force, s’habituât à traduire sa pensée par des actes virils [6].
Gustave Hervé
Le socialisme, méconnu et calomnié
Du citoyen Jaurès dans L’Humanité, cette apologie électorale de l’internationalisme socialiste :
« Ce n’est pas notre faute si le socialisme est méconnu et calomnié ; si les manifestes du Parti qui proclament le double et indivisible devoir de défendre jusqu’à la mort l’indépendance des nations menacées par l’étranger et de s’opposer par toute la force du peuple, même révolutionnaire, aux guerres offensives, si tout cela ne suffit point à rassurer les démocrates sur le patriotisme prolétarien, c’est qu’ils ne veulent pas comprendre. »
Pour rassurer plus complètement le Parti radical sur le patriotisme prolétarien, nous nous faisons un devoir de publier à la suite de ce distingo socialiste entre les guerres offensives et défensives — impossibles à distinguer dans la pratique — le texte de la motion Yvetot en 1906 au congrès d’Amiens, votée, à une belle majorité, par la Confédération générale du travail, laquelle est peut-être plus qualifiée que Jaurès pour parler au nom du prolétariat :
« Le congrès de la CGT, tenant compte de la majorité significative qui s’est affirmée sur l’adoption des rapports du comité confédéral, de la section des Bourses, et de La Voix du peuple, comprend que les ouvriers organisés de France ont suffisamment démontré leur approbation de la propagande antimilitariste et antipatriotique. Cependant, le congrès affirme que la propagande antimilitariste et antipatriotique doit devenir plus intense et toujours plus audacieuse. Dans chaque grève, l’armée est pour le patronat- ; dans chaque conflit européen, dans chaque guerre entre nations ou coloniale, la classe ouvrière est dupée ou sacrifiée au profit de la classe patronale parasitaire et bourgeoise. C’est pourquoi le 15ème congrès approuve et préconise toute action de propagande antimilitariste et antipatriotique, qui peut seule compromettre la situation des arrivés et des arrivistes, de toute classe et de toute école politique. »
Vive le patriotisme prolétarien ainsi conçu !(15 mai 1908)
—
APRÈS LE SANG, LA BOUE
(19 juin 1907)
Il ne suffit pas que les mercenaires de Flic 1er égorgent les vignerons du Midi. Il faut encore que ses valets de plume vomissent l’ordure sur ses victimes.
Pour le terre-neuve Maujean [7], « la révolution du Midi finit dans un éclat de rire ». C’est bref et cynique.
Le basset Henry Bérenger, l’honnête et vertueux Bérenger, est plus avisé. Dans l’Action [8], ce drôle, qui se connaissant bien, croit connaître les autres, demande à quelle source mystérieuse les vignerons puisent les fonds nécessaires à leur campagne. Ange de pureté ! Que ne nous éclaires-tu sur celles qui alimentent ta feuille sans lecteur !...
Quant au négrier Gérault-Richard [9], l’élu des concussionnaires de la Martinique, il s’émeut du sort des soldats qui ne peuvent cependant pas se laisser écharper par de mauvais garnements. C’est exquis. Presque aussi exquis que ce couplet qui chante en ma mémoire et dont Gérault-Richard doit connaître le père :
Dans vos estomacs bedonnants,
Nous ferons, bourgeois ruminants,
Plus d’une entaille,
La lutte sera sans merci
Nous aurons le cœur endurci
Dans la bataille.
Au surplus, les trois tire-laine sont d’accord pour dénoncer la participation de la réaction dans les affaires du Midi. Cela ne peut faire de doute. Partout où il y a mécontentement, bruit, émeute — en un mot tout ce qui déplaît à la République —, on doit trouver la réaction. Aussi le gouvernement a-t-il le devoir de sévir avec rigueur et si, par aventure, la répression fait des morts, que la responsabilité tout entière en retombe sur les réacteurs !
Voilà ce que ce trio a pour mission de répandre chaque matin !
La question qui se pose sera de savoir si les révolutionnaires seront assez bons garçons ou assez couards pour tolérer plus longtemps ces insolences, ces mensonges et ces calomnies.
Pendant l’Affaire — celle qui valut à bon nombre des nôtres des mois de prison et qui fit la fortune politique de ces bateleurs —, les révolutionnaires insultés, diffamés par les feuilles nationalistes inaugurèrent des méthodes d’action directe qui ne furent pas sans résultats. Maintes salles de rédaction pourraient témoigner de leur efficacité.
Il n’est pas impossible de voir les révolutionnaires revenir à ces méthodes ! Récemment, un grand journal du matin se vit contraint par quelques-uns de nos amis à plus de circonspection et de tact. Que MM. Maujean, Bérenger et Gérault-Richard n’escomptent pas trop notre longanimité.
Une goutte suffit à faire déborder un verre trop plein.
La patience a des bornes si l’abjection de ces messieurs n’en a pas.
Eugène Merle
—
QUEL EST LE RÔLE DU PARTI SOCIALISTE ?
Est-ce un parti électoral ? Est-ce un parti d’action ?
(26 février 1908)
Vous êtes socialiste-syndicaliste ?
- Vous l’avez dit..., citoyen.
- Vous croyez que les syndicats sont les organisations de classe par excellence du prolétariat, tandis que les groupes socialistes ou anarchistes sont de simples groupements d’opinion où se coudoient bourgeois et ouvriers ?
- Oui.
- Vous croyez que les syndicats sont les organes révolutionnaires qui transformeront la société par la grève générale et insurrectionnelle, dès que la conscience ouvrière sera suffisamment développée et qu’un nombre assez grand de prolétaires en uniforme sera acquis, dans l’armée, à la cause révolutionnaire !
- Oui.
- Mais alors, à quoi sert le Parti socialiste ? Et pourquoi y restez-vous ?
- Nous voulons y rester, et nous y resterons, parce que le rôle du Parti nous semble important, et que nous croyons y représenter, nous les jeunes, la vieille tradition révolutionnaire de ceux qui ne furent pas députés, et qui sont morts. Expliquons-nous :
Mettons-nous, d’abord, d’accord sur un point : nous raisonnons sur les choses telles qu’elles sont et non pas sur les choses telles que nous désirerions les voir.
- Entendu.
- C’est un point capital. Lorsqu’on parle raisonnablement du Parti socialiste, on entend le Parti tel qu’il a été dans le passé, tel qu’il est dans le présent, — et non pas selon notre pieux désir de voir le Parti devenir tel ou tel, parce que ce serait alors une question de pure imagination.
Primo. Dans tous les temps, dans tous les pays, le Parti socialiste a été un parti électoral.
- Mais...
- Voyons les faits. Tout groupe socialiste passe alternativement par deux états. Il est gonflé pendant un an, il est squelettique l’année suivante. Les réunions sont nombreuses et suivies pendant l’année des élections, puis l’effectif se dégonfle et le marasme règne pendant l’année qui sépare les périodes électorales.
« Pendant l’année grasse, les salles de cent personnes sont trop petites et l’on n’a plus de quoi s’asseoir. Pendant l’année maigre, on se retrouve une vingtaine dans une arrière-boutique de bistro.
« Il y aussi les groupes à élus très nombreux, avec des petits commerçants, des francs-maçons, des concierges enthousiastes, une bande de postulants aux recettes buralistes. On y désigne des candidats pour la caisse des écoles et l’on y votaille à propos de botte. Surtout on s’y engueule.
« Au contraire, les groupes sans élus sont maigres, maigres, mais ce sont de petites familles pleines de cordialité, où l’on fait de l’éducation.
Dans la Seine, la première catégorie tend à disparaître au profit de la seconde. Bravo pour la Seine.
- Parti électoral, soit, mais... dans tous les pays !
- Oui.
- A toutes les époques ?
- Oui.
- En Russie ?
C’est une lutte franchement — héroïquement — révolutionnaire, mais son but immédiat n’est-il pas la conquête de la démocratie, la conquête du parlementarisme ? C’est à quoi, d’ailleurs, elle aboutira, tout comme la grande épopée révolutionnaire de la bourgeoisie anglaise de 1640 à 1688 [10], et de la bourgeoisie française de 1789 à 1830.
- Cependant, les vieux blanquistes !...
- Admirables, mais si peu socialistes ! Ils ne connaissent pas les questions économiques. C’étaient des patriotes et des républicains révolutionnaires.
« Partons donc de cette double constations de fait :
« 1) Le Parti socialiste est un parti électoral.
« 2) La masse de la population ne vient aux réunions qu’en période électorale.
« Quand nous avons 80 personnes à une réunion non électorale, c’est un succès, mais aux réunions électorales, il y vient facilement 500 à 1000 personnes.
« Ne venir qu’aux réunions où l’on voit la figure d’un candidat peut être absurde, mais c’est un préjugé très répandu. Dans ces réunions, nous avons l’occasion de toucher des gens — dont nous avons besoin — et que nous ne toucherions pas autrement : il serait fou de négliger ce moyen, en tant que moyen d’éducation.
- Mais, en réunion électorale, vous mettez de l’eau dans votre vin.
- Mon ami, les orateurs qui mettent de l’eau dans leur vin sont des niais, car on n’enlève jamais si bien une salle — sauf quand elle faite d’avance — qu’avec une affirmation nettement révolutionnaire.
- Maintenant, la nature du Parti socialiste vous apparaît-elle clairement ? Il réunit tous les hommes, quelle que soit leur classe, qui croient à la nécessité de grouper les prolétaires, sans distinction de patrie, dans le but de détruire l’État et de socialiser les moyens de production et d’échange [11].
« Sommes-nous d’accord ? Le Parti socialiste est électoral et éducatif, électoral parce qu’éducatif.
**
- Est-ce un parti d’action ?
- Si vous entendez par action les affiches, les réunions, les manifestations de tapage, oui ; le Parti socialiste est un parti d’action. C’est le parti des « mauvais coucheurs », de ceux qui n’aiment pas avaler une injustice sans gueuler un bon coup et casser des vitres.
Le Parti socialiste doit aimer descendre dans la rue et faire du boucan, beaucoup de boucan, lancer des pétards pour faire retourner les gens et les faire réfléchir, leur corner des vérités aux oreilles.
- Utile, tout cela, mais est-ce la véritable action, et faut-il confondre l’action avec la gueule ?
- L’action — aux heures troubles où la foule est dans la rue, fiévreuse, pleine de bonne volonté mais ignorante, aux jours de grève, aux jours d’émeute — consiste à mener cette foule, aveugle et puissante, comme un élément, à lui suggérer les actes nécessaires, à commettre l’irrémédiable pour la jeter en avant..., à fusiller [les généraux] Lecomte et Clément-Thomas, parce que d’une échauffourée de Montmartre, il en sort la Commune.
« Or, de telles initiatives sont nécessairement spontanées. Imaginer un « groupe d’action » stable, permanent, est une contradiction dans les termes. Qui dit groupe dit discussion, vote, délais. Toute organisation règle l’allure de l’élite sur la lenteur de la moyenne.
« On ne peut pas être « révolutionnaire » de fait à jet continu ; il n’y a pas de nerfs humains qui résisteraient à cette tension perpétuelle. Tout groupe qui ne veut être que d’« action » se dissout, ou finit dans le chiqué.
« L’ancien Parti ouvrier français [POF, fondé par Jules Guesde] voulait, de 1875 à 1885, être le parti révolutionnaire de la classe ouvrière. Il a fini dès 1893 dans le marécage parlementaire, dans le chiqué révolutionnaire où l’on « bourre les fusils avec des bulletins de vote ».
« Les syndicats qui ne veulent être que des groupes d’action finissent dans le subventionnisme. Il fut de mode, dans certains milieux « révolutionnaire » de considérer la subvention... comme une « reprise » !
« Il faut des groupements spéciaux pour des cas spéciaux.
« Selon l’acte à accomplir — nettoyer le grand-duc Serge [Romanov], par exemple — les hommes que la besogne tente se groupent spontanément, s’entraident, accomplissent et se séparent.
« L’action par sa nature est spontanée. Elle naît du libre groupement de ceux qui prennent un plaisir silencieux à exécuter par une nuit sans lune... ce dont on ne se vante pas le lendemain.
« Avez-vous vu Paris pendant les échauffourées du quartier Latin en 1893 ? Cela se faisait à deux ou trois. L’un ameutait la foule, un omnibus était arrêté, vidé, versé, flambé ; le populo s’excitait, les deux artistes s’éclipsaient, la police chargeait et, pendant ce temps-là, les deux même recommençaient un kilomètre plus loin.
« Un beau coup, c’est comme une œuvre d’art : ça se fait d’inspiration. Quand on veut le faire sur commande, on obtient quelque chose d’officiel et de raté. »
En cela comme en tout, la pratique a devancé la théorie. En Russie, les coups de main révolutionnaires sont faits par les organisations de combat du Parti socialiste révolutionnaire, organisations spontanées et provisoires, hors des cadres permanents du parti.
Ils sont faits bien souvent par des hommes étrangers à tout parti.
Un exemple plus modeste nous montre L’Humanité ayant sa personnalité indépendante, en-dehors des cadres du Parti qui n’a sur elle qu’un contrôle politique. C’est précisément grâce à cela qu’elle est vivante et qu’elle progresse.
Si La Guerre Sociale était l’organe d’une organisation quelconque, socialiste, syndicaliste ou anarchiste, elle ne tirerait pas à 25 000. Les canards guesdistes en sont bien la preuve : le tirage du Travailleur du Nord et celui du Socialiste diminuent : les sectaires font avorter tout ce qu’ils touchent.
Aucune organisation régulière n’aurait pu prendre l’initiative de l’historique « Affiche rouge » [12] de 1905. Il a fallu que ce geste, qui vint à son heure et fut nécessaire, fût accompli par le libre groupement de 28 camarades venus de partout.
Parti d’action le Parti socialiste ? Soit. Mais n’exagérons pas : le petit jeu est son affaire. Quand au « grand jeu » — quand l’heure sonnera de le jouer —, il reviendra non pas aux cadres réguliers du Parti, mais à ses francs-tireurs, ses organisations de combat, et tout ce qu’on pourra demander au Parti sera de ne pas le désavouer.
Quand à présent, le Parti socialiste est un parti d’éducation mutuelle et d’agitation publique. C’est le parti électoral de la classe ouvrière.
A. Bruckère
—
KARL MARX
(18 mars 1908)
La grande figure de Marx commence à se dégager de toutes les déformations des polémiques et, à mesure qu’elle s’éloigne de nous, dans le recul de l’Histoire, nous pouvons mieux juger l’homme et l’œuvre.
Les pires ennemis de Marx ont été ceux qui se disent marxistes ; ces disciples intolérants, hargneux et dogmatiques ont rendu Marx odieux à ceux qui ne savent pas que ce que l’on donne souvent comme le marxisme est la plus impudente altération de la pensée de Marx.
« Moi, je ne suis pas marxiste- !- » disait Marx lui-même.
Semblable mésaventure est arrivée au grand Proudhon que l’on a, bien à tort, enveloppé dans le même ridicule que ses piteux disciples. Proudhon, lui aussi, n’était pas proudhonien. Beaucoup s’étonneront en lisant qu’il est peu d’hommes, en France, qui soient plus éloignés de Marx que Jules Guesde [13]. On croit communément que Guesde est le représentant de la « pure doctrine » marxiste, et ce n’est pas la moindre illusion qu’a su créer autour de lui cet habile metteur en scène.
Il est arrivé à Marx cette étrange aventure que les hommes qui se réclament de lui sont ceux qui ne représentent pas sa pensée, et les pseudo-marxistes de France, comme les sociaux-démocrates allemands, s’inspirent bien davantage des pires illusions de Lassalle sur la valeur du suffrage universel et le rôle de l’État-providence.
Bebel est un lassallien, comme Guesde, mais dans la mesure où Lassalle se trompait.
Qu’est-ce donc que Marx ?
Né à Trèves en 1818, de parents juifs, il fit ses études dans les plus illustres universités allemandes ; c’était un bourgeois comme d’ailleurs tous les théoriciens socialistes : Saint-Simon descendait d’un duc, et Kropotkine était prince.
Peut-être serait-il devenu un rat de bibliothèque de la science allemande, s’il n’avait pas rencontré, dans sa jeunesse, celui qui fut l’ami de toute sa vie : Friedrich Engels.
Fils d’un industriel d’Eberfeld, Engels était un homme d’une culture universelle, aussi bien hégélien que tacticien militaire, journaliste, économiste, directeur d’usine, polyglotte, ne reculant ni devant une partie de chasse au renard ni devant une bonne bouteille, grand contempteur de la respectability britannique, et qui avait déjà écrit, à 25 ans, un ouvrage sur la Condition de la classe ouvrière en Angleterre.
Nul doute qu’Engels exerça une grande influence sur l’orientation des études de Marx et qu’il contribua à tourner ce prodigieux esprit vers les sciences sociales.
La belle période de la vie de Marx s’écoula de 1843 à 1850, pendant laquelle il fut successivement expulsé de Prusse, de France, et de Belgique bataillant pour la cause révolutionnaire, dans cette universelle fermentation des années 1848.
Fixé à Londres, où il connut la misère, le naturel d’homme d’études reprit le dessus et, dans le calme du cabinet d’où il ne sortit jamais plus, il entreprit son œuvre.
Ce ne fut pas un homme d’action, mais un homme de science, un scholar, un travailleur acharné, une des intelligences les mieux meublées, les plus méthodiques, les plus puissantes, les plus claires dont puisse s’enorgueillir la famille humaine.
Si le théoricien fut immense, l’homme politique fut mesquin. Il n’était pas organisateur, et, de même que Comte (qu’il domine cependant de si haut), il ne pouvait souffrir la contradiction.
Autoritaire et médisant — et son ami Engels l’était davantage — sa présence dans l’Internationale fut une calamité pour le mouvement ouvrier.
Son penchant naturel lui faisait mener l’Internationale comme un maître d’école mène sa classe ; comme un patron mène une usine. Il combattit avec haine Michel Bakounine, pauvre théoricien mais admirable homme d’action, bien qu’il fut d’accord avec lui sur tous les points de doctrine.
Bakounine avait tout ce qui manquait à Marx, et Marx avait tout ce qui manquait à Bakounine.
La première Internationale mourut de ces querelles, et il n’y a pas lieu de la regretter ; regardons les pseudo-héritiers de Marx, les Guesde et les Ferri, les Bebel et les Plekhanov : la survie d’une Internationale centralisée eut soumis le mouvement ouvrier à la théocratie des cuistres.
**
Si l’on oublie, dans Marx, la médiocrité de l’homme d’action et de l’agitateur politique, si l’on dégage son œuvre des niaiseries des « marxistes » prédisant la révolution pour 1893 ou pour 1898, par la vertu du bulletin de vote ; si, au lieu de connaître le marxisme de seconde main, par ses commentateurs, on remonte aux sources, si on étudie Marx dans Marx lui-même, on ne peut qu’admirer.
Marx ne fut pas un prophète ; il ne dessina pas le plan de la cité communiste : il parlait avec ironie de ceux qui composent des « menus de cuisines pour les marmites de la société future ».
C’est un historien qui, par sa lumineuse analyse du passé, nous donne une méthode pour comprendre les phénomènes sociaux : le véritable marxisme n’est pas un système, mais une méthode.
L’essentiel dans Marx, ce n’est pas la théorie de la valeur ou le communisme, d’autres l’avaient dit avant lui ; ce n’est pas la théorie des crises périodiques de chômage, Marx ne l’a jamais systématisée ; ce n’est pas la conquête des pouvoirs publics, Marx ne l’a jamais préconisée !
Ce qui subsiste dans Marx, c’est la théorie de la plus-value (mehrgeld), qui établit que ce Capital est nécessairement du travail volé. C’est l’aboutissement communiste de la concentration des capitaux, c’est l’antipatriotisme, c’est la croyance dans la supériorité de l’action sur la théorie : « Toute action, tout mouvement réel importe plus qu’une douzaine de programmes. »
Ce qu’il y a d’essentiel et d’éternellement vivant dans Marx, ce sont les deux principes fondamentaux de sa méthode : la lutte de classe et le matérialisme historique.
La lutte de classe où, se dégageant des fadaises humanitaires, il montre l’Histoire comme la suite des luttes épiques des classes les unes contre les autres.
Le matérialisme historique par lequel il établit que la base de la société, ce qui détermine tout le reste (institutions politiques, idées morales, formes familiales), c’est le régime de propriété, déterminé lui-même par le mode de production.
**
Ceux qui, selon la saine tradition de saint Thomas, ne nous croiraient pas sur parole, ne pourraient mieux employer les loisirs de leurs soirées qu’en lisant celles des œuvres de Marx qui sont traduites en français.
Le Capital n’est guère accessible qu’aux spécialistes ; mais il existe cependant le Résumé du « Capital », par Deville, dont on dit parfois du mal, mais que je trouve fort clair. [...]
Surtout le Manifeste, l’immortel Manifeste !
A. Bruckère
—
LA JOURNÉE DES FLICS
(29 avril 1908)
[...]
Le premier mai, ne pouvant être une journée sérieuse pour la classe ouvrière, sera la journée des flics. Ces braves gens (!) la veulent, leur journée. Ils l’auront, nom d’un sabre ! Clemenceau se repose sur Lépine [14] pour la leur donner.
Oui, ils l’auront aussi parce que le peuple, ce bon troupeau, en souvenir des processions d’autrefois, aime à défiler devant ses pires ennemis. Seulement, autrefois, il priait et se faisait bénir. Aujourd’hui, il gueule et se fait assommer. Il n’a que la consolation de se dire : ça ne durera pas toujours !
Mais, en attendant, ça continue et ça recommence.
Si c’est ainsi qu’il plaît aux travailleurs d’obtenir des améliorations, ils en auront bien plus qu’ils n’en voudront, au pied de la botte du flic. Cette année, selon la bonne méthode du Clemenceau de bonne humeur, l’armée ne se montrera peut-être pas. Mobilisée, elle se tiendra cachée. Et la police exercera seule. A Paris, Lépine opérera lui-même. Ses brutes s’en donneront à poings et à bottes-que-veux-tu. Ce sera joli !
Le lendemain, les journaux célébreront l’habileté du Premier flic et l’énergie du Second. Et le Premier Mai 1908 aura vécu ! La préfecture de police enregistrera une glorieuse journée pour elle !
Ah ! mes amis, quelle urgente campagne il est nécessaire d’entreprendre avec acharnement contre la police et les policiers !
Que de crimes et de hontes nous supportons de ça !
Est-il possible qu’un ouvrier, de sang-froid, puissent regarder sans colère une de ces faces patibulaires, un de ces crânes d’abrutis, un de ces groins d’alcooliques malfaisants ? Est-il possible que la masse des locataires d’un immeuble de faubourg puisse supporter le voisinage, supporter la promiscuité d’un aussi lâche produit de la vie de caserne ? Quelle pitié, quels égards peut-on avoir pour ce renégat de la classe ouvrière qui a demandé au guichet de la Préfecture ou du ministère de l’Intérieur sa gamelle et son collier de chien de garde ?
Cet homme déchu dont le régiment a développé les pires instincts, au point d’en faire un mouchard, est toléré, parfois respecté, toujours craint. _ Il pullule partout sans danger pour lui-même. Il rit, il cause, il boit avec les gens du peuple quand son service ne lui commande pas de rudoyer, d’accuser, de brutaliser, de massacrer ceux auxquels, devant le comptoir d’un empoisonneur, il fait bonne figure !
Si seulement il n’y avait que ceux qui se soûlent avec lui pour recevoir ses coups, ce serait juste.
Le mouchard, le flic, a parfois des manières hypocritement affables en temps de calme. Si vous êtes bien habillé, si vous avez de l’« extérieur », ou si vous êtes nombreux et qu’il soit seul, il vous respecte. Car ce chien sue la peur et devient lâche quand il ne risque rien. Cet animal est ordinairement féroce quand on est en bande. Vous tous qui êtes des hommes fiers, dignes, francs ; vous tous, qui osez protester quelquefois et qui vous croyez libres, vous savez quels traitements vous attendent au poste, au Dépôt, à la gendarmerie, en prison !
Et vous, travailleurs, qui les avez vus à l’œuvre les Premiers Mai précédents, les jours de réunion à votre Bourse du travail, les jours de manifestation et les jours de grève, vous savez quelle race est celle de ces mufles ignobles qui ont trahi leur cause et leur classe et cognent sur ceux dont le courage et la conscience leur font honte et les affolent ; vous connaissez bien ces bandits !
Et bien ! le Premier Mai est le jour de leurs grandes manœuvres. Que dis-je ? C’est le jour de gloire pour eux ; car l’ennemi, c’est le peuple, c’est l’ouvrier.
Quels que soient l’âge et le sexe, ils cognent sur ceux que leur chef leur fait voir en rouge... et, comme nous ne sommes pas des jaunes, nous les rendons furieux.
Comme des taureaux, ils foncent, aveugles de rage et d’alcool, sur ceux qui n’ont ni armes ni bâtons. Et ils mettent la loque en pièces. Et cela durera tant que le peuple aimera à se faire traiter comme une loque par ces brutes ; cela durera tant qu’il persistera à se mettre en cortège pour recevoir des coups en gueulant l’Internationale ou tout autre cantique révolutionnaire avec les mains dans les poches.
Georges Yvetot
—
LE DROIT À L’AVORTEMENT
(20 mai 1908)
Gros scandale dans la région ouvrière du Nord ! On a découvert à Tourcoing une demi-douzaine de faiseuses d’anges qui n’y allaient pas de main morte. L’une d’elles qui opère depuis quarante-cinq ans à raison de deux ou trois opérations par semaine aurait plusieurs milliers d’« anges » sur la conscience. S’il y en avait comme cela quelques douzaines dans la région, on s’explique que la population de Tourcoing ait diminué dans des proportions qui doivent paraître effrayantes à M. Piot.
Si j’étais une vieille catin en retraite ou un vieux monsieur décoré courant après les petites filles de 10 ans, un prostitué du grand journalisme honnête ou un pédéraste impertinent [15], ou seulement si j’avais l’âme de larbin sans laquelle on ne fait pas un bon avocat général, j’invoquerais la Morale outragée et j’appellerais les foudres de la loi sur ces mégères.
Pauvre France, de combien de soldats t’ont privée ces monstres ! Usiniers de mon pays, de combien de serfs, mâles et femelles, elles ont frustré vos bagnes industriels ? Sainte Vierge, combien d’âmes immortelles elles ont envoyé ad patres sans les sacrements de l’Église ?
La Morale, la Patrie, la Propriété, la Religion, la Vie humaine, cette chose sacrée — comme dirait Clemenceau, le massacreur de Narbonne et de Casablanca — , elles n’ont rien respecté, ces harpies !
Ce qu’ils vont en entendre sur ce chapitre les malheureux jurés qui vont subir le réquisitoire du défenseur officiel et patenté de l’Ordre et de la Société ! En débarrassant des milliers de femmes de fœtus de quelques semaines ou de quelques mois, elles ont tué des germes de vie !
Hé ! cuistre à robe rouge, valait-il mieux qu’elles condamnent à la misère, au déshonneur et au suicide des êtres vivants en pleine conscience ? Tu ne soupçonnes pas les drames auxquels ont assisté ces faiseuses d’anges ! la détresse tragique des malheureuses qu’elles ont délivrées ?
Tu ne devines pas cette religieuse, à qui une éducation idiote avait imposé une chasteté monstrueuse et qui, un beau jour à l’hôpital, est tombée dans les bras de quelque carabin, de quelque infirmier ou de quelque convalescent, lequel s’est empressé de la planter là avec son ventre ballonné !
Tu ne la vois pas cette ouvrière, mère de sept enfants, que son mari, un soir d’ivresse, a prise de force et pour qui la perspective d’une huitième bouche à nourrir est une catastrophe ?
Et cette jeune fille du monde — de ton monde — que l’insuffisance de dot a condamnée à un célibat contre nature et chez qui, un beau jour ou une belle nuit, la nature s’est révoltée, et qui se trouve « déshonorée » ?
Et cette ouvrière qui gagne 25 sous par jour, pour qui un enfant sera la perte de sa place, la misère et la honte à perpétuité, parce qu’elle aura « fauté » ?
Tu ne les vois pas, fonctionnaire enjuponné, se rendant la tête basse, la rougeur au front, demander à une de ces mégères providentielles que tu poursuis, de les sauver de la honte, du suicide, d’épargner à leurs proches un malheur qui va empoisonner toute leur vie !
Car c’est une tare dans la société d’être mère sans l’autorisation des autorités constituées.
- Mais les mégères risquaient de tuer les patientes !
- Et bien quoi ! est-ce que les patientes ne sont pas libres de leur corps ? Est-ce qu’on n’a pas le droit, entre deux maux, de choisir le moindre ?
Si ton imbécile Code pénal n’avait pas prévu des peines atroces pour le médecin qui provoque un avortement, les patientes iraient trouver des mains plus expertes — et plus propres surtout, moins brouillées avec l’antiseptie — qui les débarrasseraient sans danger et sans attendre le septième mois !
Un jour viendra où, par l’instruction générale assurée à tous les hommes et à toutes les femmes, les préjugés séculaires ayant disparu, les plus obtus comprendront que condamner quelqu’un à la chasteté, c’est aussi raisonnable, comme disait Luther, « que de décréter qu’on vivra sans boire et sans manger » et que la morale et l’honneur ont aussi peu à voir dans les relations sexuelles que dans toutes les autres fonctions physiologiques de notre machine humaine, un jour viendra où tous les enfants porteront le nom de leur mère, où il n’y aura plus ni enfants naturels, ni enfants légitimes, et où la société assurera à toutes les mères la subsistance de leurs enfants en bas âge.
Quand ce jour viendra-t-il ?
Il arrivera quand les travailleurs organisés, dans la CGT, auront mis la main sur les mines, les usines, les banques, les maisons d’habitation, les grands domaines ; quand ils auront, par l’expropriation des parasites, par la suppression des gaspillages de la société capitaliste et l’organisation de la production sur des bases sociales, assuré à tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté, l’instruction, le bien-être et l’indépendance.
Jusque-là, le seul remède à la généralisation des manœuvres abortives, c’est de propager dans toutes les classes de la société la connaissance des pratiques malthusiennes qui permettent, on le sait, de ne procréer qu’à volonté, dans la limite où l’on a les moyens — et le droit — d’avoir des enfants.
En attendant que les moyens préservatifs malthusiens soient connus universellement, c’est à chacun de nous, dans son entourage, dans sa famille, de réagir contre les préjugés stupides et féroces dont sont victimes les filles-mères ; c’est le devoir surtout de tous les esprits libres, au risque de scandaliser les Piot, les Bérenger [16] et toute la race des Tartuffe, des pharisiens et des imbéciles, de réclamer hautement le droit à l’avortement.
Un Sans-Patrie
Oh ! pudeur
L’Humanité publie chaque semaine quelques lignes de notre éditorial, avec des amabilités dont nous la remercions par des critiques tout amicales, amicales sinon de forme, du moins d’intention.
La semaine dernière, elle reproduisit dix lignes de l’article « Le Droit à l’avortement », en ayant soin de choisir les dix lignes qui pouvaient le moins permettre de deviner de quoi il s’agissait dans l’article.
À cette découpure, L’Humanité mit un titre comme toujours.
Le droit à l’avortement était trop « shocking », trop scabreux.
On est socialistes, même révolutionnaires, mais on a de la pudeur, et puis, il ne faut pas effaroucher le public.
Le filet eut pour titre, nous vous le donnons en mille : « Les Enfants » !
Pour une trouvaille, c’est une trouvaille.
Quand donc notre consœur socialiste se guérira-t-elle de sa sotte pudibonderie et de sa peur des mots ? Sans doute le jour où elle acquerra le sens du journalisme ?(27 mai 1908)
—
LE PRESTIGE DE LA FONCTION
(27 mai 1908)
Le deuxième flic de France — nous avons nommé Lépine — continue à jouer les invulnérables, tels Achille aux pieds légers. Et de fait, invulnérable ou non, il se montre d’une crânerie qui n’a d’égale que le respect de ces bons révolutionnaires pour sa répugnante personne. Dernier exemple : la manifestation de dimanche au Mur des fédérés.
Tandis que les manifestants étaient aux prises avec les renégats des groupes Morel et Lajarrige [17], on vit Lépine se jeter au plus fort de la mêlée, et n’était-ce l’intervention de 3 ou 4 camarades de la Guerre sociale qui firent à ce moment un beau tapage, on eût vu cette chose réjouissante : le préfet de police faire cesser à lui seul l’effervescence, imposer le silence à plusieurs centaines de révolutionnaires « braillards ». Qui nous expliquera le respect superstitieux et paralysant dont jouit ce sinistre fantoche auprès des nôtres, même parmi ceux qui passent à juste titre pour n’avoir pas froid aux yeux ?
Est-ce que M. Lépine posséderait par hasard un pouvoir d’hypnose insoupçonné et irrésistible [18] ? Répondez, les gelés, les engourdis, les figés sur place, si toutefois vous ne préférez être réveillés par un passage à tabac !
En attendant, Lépine le dompteur passe, souriant, intrépide, intangible, à travers les effervescences et les bagarres.
Faut-il l’admirer ? Non, ce qui est admirable, c’est la patience de ses adversaires, de ses victimes...
—
LES DANGERS DU PARLEMENTARISME
(16 septembre 1908)
Beaucoup de camarades du Parti nous reprochent notre insistance à signaler les dangers du parlementarisme pour le Parti socialiste.
À la veille du congrès de Toulouse, il faut que nous y revenions pour qu’on comprenne bien la nature de nos critiques.
Les guesdistes, qui ont été un temps à la gauche du parti, avaient bien compris les dangers du parlementarisme ; c’est pour cela qu’ils avaient élevé, dans les règlements, toute espèce d’obstacles pour entraver les élus dans leur marche naturelle à la direction du Parti et à la conquête individuelle du pouvoir ; exclusion des parlementaires de la Commission administrative permanente, refus du budget, interdiction de faire partie d’un ministère bourgeois, etc., etc.
Mais devant la force que donne un mandat législatif, l’obstacle des règlements est dérisoire. En fait, les élus, les élus législatifs surtout, sont les maîtres du parti, et dans quelques années, il ne restera plus rien des entraves qui les arrêtent dans leur ascension vers la participation au gouvernement.
Certains camarades, comme Cambier, affirment que les inconvénients du parlementarisme ne tiennent qu’à la déloyauté de quelques parlementaires et que ces égarements individuels n’enlèvent rien à l’idée. Ils sont dans l’erreur.
Croit-on que les élus actuels soient des hommes particulièrement malhonnêtes et que le Parti, tombé sur une série si mauvaise, ait chance à l’avenir d’en trouver de meilleurs ? Il serait enfantin de le soutenir.
Les élus d’aujourd’hui ne sont pas plus criminels que d’autres ; seulement il est tout naturel qu’on ne désire pas sérieusement un bouleversement social alors que, dans l’état présent, on gagne quinze-mille francs par an.
La psychologie de l’ouvrier socialiste qui devient député est bien simple.
Jeune, actif, plus intelligent que la masse de ses camarades, il comprend l’horreur de sa situation particulière et de celle de sa classe, et il veut que cela change ; le Parti socialiste se présentant alors à lui, il y entre pour préparer la révolution.
À force de parler dans les sections, il devient orateur passable ; il est écouté, on le délègue aux congrès et, alors, des ambitions auxquelles il ne songeait pas tout d’abord s’éveillent en lui, il se sent un candidat possible ; et, dès ce moment, il tiédit.
L’observation et l’expérience lui ont appris, très durement parfois, à être habile. Il a compris que les intransigeants, ceux qui disent carrément ce qu’ils pensent envers et contre tout, ne sont pas aimés, et que, pour acquérir les sympathies, il faut au contraire adopter une attitude conciliatrice, tant vis-à-vis des idées qu’à l’égard des individus.
Il apprend à placer son opinion dans la moyenne, afin de pouvoir sans heurt la faire glisser jusqu’à la tendance la plus forte ; il apprend aussi à être aimable, à flatter la foule, et cela lui réussit admirablement.
Une fois élu, il reste socialiste, certes ; c’est le socialisme qui l’a mis en place ; c’est lui qui l’y maintient. Dans les réunions, il fait ce qu’il faisait avant : il parle, il combat l’organisation sociale, les partis au pouvoir et, aux yeux du public, aucun changement n’est survenu en lui car il a su, à force de faire des discours, substituer une indication factice à celle qu’il éprouvait jadis réellement contre les injustices sociales.
Mais sa vie matérielle s’est complètement transformée.
Il habitait une mauvaise chambre où vivait toute sa famille ; il a maintenant un appartement confortable, une domestique ; lui, sa femme et ses enfants sont bien habillés. Aussi, parmi les invités d’autrefois, beaucoup commencent à lui peser ; les trop pauvres détonnent dans son confort, leur présence même est un reproche ; et puis, un jour ou l’autre, ils pourraient lui emprunter cent sous.
L’élu commence donc à tenir les gens à distance ; lui qui recevait à toute heure, qui allait lui-même chez tout le monde, a maintenant son jour ; afin même d’être moins dérangé, il loue pour recevoir ses électeurs un logement spécial, fort laid le plus souvent, et qu’il meuble de quelques vieilles chaises. L’appartement où il vit, il en cache l’adresse s’il le peut et le réserve à l’élite qu’il s’est choisie pour entourage ; pas des grands bourgeois certes, l’aristocratie moderne n’ouvre pas aussi facilement ses portes. Elle accueillera peut-être son fils si le père a su en faire un haut fonctionnaire bien sage, mais lui fleure encore trop vivement le hareng prolétarien.
Ses amis, le député ouvrier les choisit parmi ses collègues de la Chambre, d’abord, et il y adjoint quelques camarades du Parti triés sur le volet, bourgeois de naissance, fonctionnaires moyens, employés bien rétribués, commerçants gagnant largement leur vie.
Nous disions que le candidat éventuel avait tiédi ; cette description suffit à faire comprendre combien l’élu est devenu froid. Au fond, il ne désire qu’une chose, c’est qu’il y ait longtemps encore un prolétariat avec un Parti socialiste qui continue de l’envoyer à la Chambre.
Si seulement il se contentait d’y exécuter les volontés du parti, on pourrait encore passer sur les quinze-mille, quoique... Mais il fréquente les élus des partis modérés et, pour placer des parents, pour entrer dans des affaires lucratives, il consent à se laisser mettre un fil à la patte.
Alors il s’efforce, par une grande habileté, à ne s’affirmer jamais dans une question compromettante. Pour attaquer le gouvernement, il choisira un point secondaire- ; dans la question militariste, il condamnera la guerre — ce qui est bien vu de tout le monde — et se déclarera patriote ; afin même d’éviter ce dernier mot, qui pourrait faire croire..., il se contente de dire qu’il faut travailler à créer la patrie, ce qui est d’un clair-obscur plus rassurant.
Le Parti, il fait tout ce qu’il peut pour le rendre le plus modéré possible et il y réussit, car son prestige est énorme.
Dans les sections, sa présence suffit à modifier le sens des résolutions. Il tient les uns par des bienfaits, places, décorations, services ; d’autres, par l’expérience ou la crainte ; et le reste, qui craint ni n’espère rien, est subjugué par l’éloquence, le prestige des vêtements élégants, de la richesse relative. D’ailleurs, dressés par de longues années de préparation, les élus sont si habiles à soutenir simultanément des opinions opposées, à se déclarer révolutionnaires tout en se déclarant réformistes, que chaque tendance les croit plus près d’elle que de la tendance adverse.
Mais, pensera-t-on, vous n’allez pas nous faire croire qu’il n’y ait pas un honnête homme au monde et que l’intérêt personnel soit absolument tout ?
Eh si ! L’intérêt personnel est tout, absolument tout.
Songez que pour ne pas se conduire comme le font les élus, il faudrait être plus qu’honnête, être l’homme qui a fait siennes les idées qu’il soutient et qui les préfère à l’argent, au confort, à l’amitié, à sa famille même ; et croyez-vous qu’il y ait assez d’hommes de cette trempe pour en remplir les bancs de l’extrême-gauche à la Chambre ?
L’élu, voyez-vous, est un homme moyen ; il faut donc se dire qu’il agira comme tel. Aussi, dans un parti de révolution, il ne peut être qu’une entrave. Certes, des périodes électorales sont des occasions de propagande, mais il vaut mieux être quelques milliers de mécontents qui excitent les prolétaires à la haine des bourgeois, qui préparent des grèves et des émeutes afin de préparer la révolution, qu’un puissant parti politique destiné à remplacer un jour le Parti radical et à faire faillite à son tour.
Madeleine Pelletier
—
DÉFENDRONS-NOUS LA RÉPUBLIQUE ?
(3 février 1909)
L’opposition de droite s’agite. Ses prétextes, il est vrai, sont un peu forcés ; des coups de canne plombée, 30 blessés, deux cents arrestations, parce qu’un professeur de lycée, Thalamas, a dit il y a quelque huit ans qu’on pouvait élever des doutes sur la mission divine de Jeanne d’Arc ! Mais enfin l’on saisit les prétextes que l’on peut : « Sans motif, ou avec motif, agitez, agitez ! », disait jadis Mazzini [19] ; les royalistes suivent le conseil et, somme toute, ils n’ont pas tort.
Deviendront-ils une force ? Certes, pour le moment leurs effectifs sont bien jeunes. Les adolescents de quinze et seize ans abondent dans leurs réunions et leurs manifestations ; et, à cet âge, on fait de la politique bien plutôt par un impatient désir d’é[mastic sur original]tions qu’on peut avoir encore. Dans cinq ou six ans, ces jeunes gens feront paisiblement leur droit ou leur médecine, ne songeant plus qu’aux examens à passer et à la situation à acquérir.
Mais il ne faut pas se dissimuler que derrière les manifestants il y a des masses de gens qui, s’ils n’aiment pas à crier dans les rues, n’en sont pas moins acquis à la cause de la restauration monarchique.
Dans les milieux les plus divers on entend à l’heure présente la même ; « Ah ! la République n’a pas donné ce qu’elle avait promis. »
Les étrangers, aux idées libérales également, voyant évoluer notre régime, n’ont plus aucune envie de l’instaurer chez eux.
Certes, pour nous socialistes, une république, quelle soit-elle, ne saurait, en régime capitaliste, réaliser l’entière justice, mais tout de même, pour les hommes de la première révolution et pour ceux qui, durant tout le XIXème siècle ont conspiré la chute des gouvernements despotiques, la république avait sa valeur.
C’était la liberté de pensée dans toute son étendue ; c’était l’impossibilité des fortunes scandaleuses par la suppression complète de l’héritage, l’assurance pour tous d’un minimum de vie, non par des aumônes dégradantes et aléatoires, mais par de grands services publics organisés à cet effet ; c’était l’accessibilité à tous aux plus hautes fonctions de la république par la gratuité de l’enseignement secondaire et supérieur. C’était enfin ce démocratisme des mœurs, ce sens chez tous de l’égalité morale dans la diversité des conditions matérielles, par l’effet de quoi le talent, le caractère, l’intelligence devaient, même alliés à l’indigence, rencontrer partout considération et respect.
Voilà ce qu’était la république dans l’esprit des hommes qui pour elle, jadis, ont été exilés, emprisonnés, tués.
Qu’est-elle, en réalité, depuis trente-huit ans que nous en avons fait l’expérience ?
La liberté de penser ? Les années de prison infligées à jet continu aux rédacteurs de ce journal en sont un exemple.
On en trouve un autre dans le fonctionnaire révoqué ou disqualifié à la moindre velléité d’exprimer tout haut des opinions différant tant soit peu de celles que le gouvernement prescrit.
La suppression de l’héritage ! Il y a belle lurette que les radicaux au pouvoir l’ont jetée au panier.
La gratuité de l’enseignement secondaire et supérieur ? Les élus du Parti eux-mêmes ne s’y intéressent pas, ils aiment mieux la soupe gratuite à l’école primaire, pensant qu’il est sans intérêt électoral de donner au prolétariat une culture intellectuelle qu’il ne réclame pas, n’en comprenant pas la portée.
Enfin, sur le démocratisme des mœurs, mes lecteurs savent à quoi s’en tenir sans que j’insiste. Mérite, caractère, intelligence, activité, désintéressement ! Fausse monnaie que tout cela, la république n’en a que faire. Gagnez une fortune même en tenant un gros numéro [20] et il n’y aura pour vous que sourires accueillants. Mme Steinheil [21] faisant sacrer son mari grand peintre par la seule vertu (si l’on peut dire) de services... spéciaux rendus à un président de la république, est la caractéristique du régime.
La république actuelle est si abjecte qu’elle a démoralisé le peuple tout entier. Les faits révoltants du népotisme de Chaumié [22] n’ont, lors de leur divulgation, indigné personne. Il a pu le faire, disait chacun ; il a bien fait ; si j’étais à sa place, j’en ferais autant. Wilson [23], le gendre de Grévy, pourrait revenir aujourd’hui vendre ses décorations, il ne susciterait plus la belle indignation d’autrefois ; personne seulement ne le remarquerait.
La corde patriotique, que nos élus tiennent tant à ménager, est aussi pourries que les autres. Des patriotes eussent bondi à la nouvelle que Krupp s’était associé à Schneider, du Creusot, pour exploiter le Maroc ; aucun Français de France n’a bougé.
Mais ce qui assure le châtiment du régime, c’est que cette veulerie où il a laissé tomber la masse se tournera contre lui-même.
Plus d’enthousiasme pour la forme de gouvernement ; la conserver ou en changer indiffère au peuple ; on ne crie plus nulle part : « Vive la république ! » Plus de considération pour les hommes au pouvoir ; pour tous, ministres et députés ne sont que des « roublards » qui ont eu de la chance.
Sans opposition de nulle part, les choses pourraient quand même aller longtemps ainsi, mais vienne une minorité royaliste ayant quelque énergie ; c’en sera fait de Marianne ; nul ne se lèvera pour la défendre.
Mais nous, car là est l’important, la défendrons-nous, la république ?
Il faut espérer que non.
Je sais bien qu’ici je vais faire jeter les hauts cris à quelques-uns.
Comment !!! Mais alors, vous allez laisser triompher la réaction.
Vous retardez, mes amis, les étiquettes ne recouvrent plus les mêmes marchandises qu’autrefois. Aujourd’hui, la réaction, c’est la république radicale. Sauver encore une fois la république ; s’allier pour ce faire aux modérés du Parti, aux radicaux, ressusciter l’affaire Dreyfus ; revoir pulluler les jeunes bourgeois arrivistes serrant avec ostentation, pour les essuyer ensuite, les mains des ouvriers des Universités populaires en minaudant qu’ils vont « toujours plus à gauche ». Et après, le lâchage sans vergogne, la remise au grenier de « la solidarité » et même de « la justice » et, comme bénéfice net, quelques Viviani [24] et quelques Briand [25] de plus.
Ah, non ! mille fois non !
Loin de penser à aider les radicaux à sauver Marianne, il vaudrait mieux commencer à envisager la possibilité de concourir à son étranglement.
Une fois le régime renversé, on verrait à tirer le parti le meilleur pour le socialisme révolutionnaire.
Madeleine Pelletier
—
RÉFLEXIONS SUR LE SABOTAGE
(10 mars 1909)
Le sabotage est l’arme des lâches, dit le vieux.
Le sabotage est l’arme naturelle de l’exploité, dit le jeune.
- Il y a la grève...
- La grève ? ha ! ha ! ha ! La grève digne, n’est-ce pas, vieux père ! La grève où l’ouvrier attend placidement que le patron se rende à ses revendications. La lutte du buffet vide contre le coffre-fort bien garni. Ha ! ha ! ha !...
- C’est toujours ainsi que nous avons lutté.
- Et c’est toujours ainsi que vous avez été roulés.
- Vois-tu, fiston, c’est plus fort que moi. Jamais je ne pourrai me résoudre à faire mal ma tâche, à dégrader le matériel ou à détériorer les machines. Je suis pour la franchise, moi ; cette lutte sournoise et impersonnelle me dégoûte.
- C’est bien ça, tu vas trouver ton patron. Tu lui dis : « Patron, nos salaires sont manifestement insuffisants. Les compagnons et moi demandons de les relever. »
- Parfaitement !
- Et le patron te jette dehors en criant que tu veux le mettre sur la paille.
- Alors, on quitte le travail.
- Et on attend.
- Dame...
- Et les gosses, ta femme, ils attendront que ton patron revienne à de meilleurs sentiments ?
- Faut bien.
- Et si le patron (car ses gosses et sa femme à lui peuvent attendre), et si le patron ne cède pas de plusieurs semaines ou de plusieurs mois ?
- Nous faisons des démonstrations dans la rue, nous en appelons à l’opinion publique.
- Des démonstrations pacifiques, hein, vieux sage ?...
- Bien entendu.
- Bien entendu aussi, la police vous tombe sur le poil, ramasse les plus agités, et le brave prolo que tu es rentre chez lui écœuré, désabusé et prêt, pour peu que sa femme crie et que les mômes pleurent, à aller s’aplatir devant le singe.
- Eh oui, le sabotage manque de franchise ! Eh oui, il est normal que l’ouvrier loyal que tu es ressente quelque répugnance de cette lutte en catimini, dans l’ombre et l’anonymat, alors qu’on sait avoir raison et que l’on rêve de vaincre par la seule force de son droit dans la pleine lumière du jour. Mais est-ce que nous avons le choix des moyens, nous autres ! Est-ce que tu ne sens pas que le patron aura toujours le dessus avec son argent, sa police, avec ses soldats, si tu ne le frappes pas au cœur avec les armes dont tu disposes !
- Sans doute, sans doute...
- Comment peux-tu espérer triompher du patron avec les formidables armes dont il sait s’entourer ! Tu te mets en grève : le patron embauche des jaunes qui seront protégés contre les insultes et les coups.
Si les jaunes font défaut, le patron aura des soldats qui assureront le travail à ta place. Ou bien encore ton patron demandera aide et protection à ses confrères. Un lock-out se formera. Toutes les usines ou tous les chantiers de ta corporation seront fermés par la volonté du patron, en attendant que toi et tes collègues soyez redevenus raisonnables.
- Tout cela est vrai, mais je n’admets pas ton sabotage.
D’ailleurs, le sabotage, neuf fois sur dix, frappe le public plus que le patron.
- Ce sont les journalistes qui racontent ces sottises. Toutefois, il arrive que le public est atteint. Quand les boulangers font grève, par exemple, et qu’avant de quitter le pétrin, ils rendent les fours inutilisables, le public est atteint puisqu’il lui faudra manger du mauvais pain fabriqué dans des fours de caserne.
Mais que faire à cela ? Vaut-il mieux que les ouvriers boulangers capitulent avant d’avoir lutté ?
Le public, le public ouvrier, celui qui souffre de l’organisation actuelle, celui qui est capable de comprendre la légitimité des revendications corporatives, ce public-là n’a qu’à prendre parti pour le mitron, il n’a qu’à menacer son boulanger de boycottage s’il ne cède pas. Il n’a qu’à manifester d’une manière positive sa sympathie pour le prolétariat en révolte. C’est son devoir, à ce public, et c’est aussi son intérêt.
- Oui, oui, tout cela est très beau, mais le public ne bouge pas et s’il manifeste son opinion, c’est pour se prononcer contre nous.
- Parce que la presse le trompe. Parce que nous n’avons pas encore fait son éducation sur ce point.
- Le fait est que si la population nous soutenait...
- Il n’y a qu’à le vouloir. Assurément, il faut que le sabotage soit pratiqué intelligemment. Je sais qu’il existe de jeunes compagnons qui pratiquent le sabotage à tort et à travers, comme une revanche de la misère sur le luxe bourgeois. Je sais qu’il se produit des actes de sabotage ridicules et inutiles : nuisibles, puisque personne ne les comprend et qu’ils apparaissent plus comme des actes de vandalisme brutal que comme une tactique de lutte réfléchie.
- Je suis content, fiston, de t’entendre dire ça.
- Oui, vieux père, le sabotage doit être raisonné. Appliqué aveuglément, sans raison, pour le plaisir, il est néfaste et condamnable. Appliqué à bon escient, dans un cas de mauvaise volonté évidente du patron, comme un moyen d’intimidation ou de pression, le sabotage est légitime et de première importance. Il est une des formes de l’action directe de l’exploité sur l’exploiteur. Il est, en période ordinaire, notre seul instrument sérieux de défense. Le tout est de savoir s’en servir... Hélas ! Vieux père, voilà que tu sabotes le temps de ton patron. Tu ne vois pas que l’heure de reprendre le boulot est passée !...
Aucun des deux interlocuteurs ne m’a demandé mon avis, mais, en les quittant, je savais bien lequel des deux avait raison.
Bob
—
Leurs opinions et les nôtres
LE SABOTAGE ET LES HOMMES D’ORDRE
(16 juin 1909)
Le citoyen Prosper Ferrero est, si nous ne nous trompons pas, député socialiste du Var. Dans Le Petit Var, organe républicain socialiste quotidien, il flétrit avec éloquence le sabotage des lignes :
« Dans la Guerre Sociale, Hervé se félicite de ce que les saboteurs ont coupé des lignes télégraphiques le long des voies ferrées. On imagine les catastrophes de chemin de fer que de pareilles pratiques peuvent amener. Hervé s’en préoccupe fort peu. »
Hervé s’en préoccupe au contraire beaucoup.
L’Organisation révolutionnaire secrète [26] qui a organisé le sabotage, de l’aveu des journaux de la bourgeoisie, a même bien recommandé de ne pas toucher aux lignes télégraphiques et téléphoniques qui protègent la sécurité des trains.
Les saboteurs doivent d’ailleurs tous savoir que, le long des voies ferrées, les deux ou trois lignes du bas seules appartiennent aux compagnies de chemin de fer et que toutes les autres, placées au-dessus, appartiennent aux lignes de l’État : et la meilleure preuve, c’est qu’il n’y a eu aucun accident de chemin de fer.
« Pour lui, cet acte est le commencement du chambardement anarchique qu’il rêve. »
Nullement.
Ce sont simplement des représailles pour venger les 650 révoqués des Postes... et une gymnastique révolutionnaire pour détraquer le système nerveux de la société bourgeoisie, le jour où il sera utile à la cause révolutionnaire de le détraquer complètement.
« Si la propagande socialiste n’avait pas d’autre moyen d’action que le sabotage des fils télégraphiques, il est probable que le résultat atteint serait diamétralement opposé à celui qu’on cherche. »
Le sabotage n’est pas un moyen de propagande socialiste ; c’est un acte de vengeance, un acte de guerre sociale.
On peut être un saboteur accompli, et en même temps un bon propagandiste, par la plume et la parole, de l’idéal socialiste.
L’un n’empêche pas l’autre.
« Pour quiconque réfléchit, il est des sabotages odieux. Ceux qui risquent de compromettre les vies humaines le sont particulièrement. Certaines méthodes de lutte sociale sont antipathiques au grand public. Les bombes tuant stupidement à droite et à gauche, coupables et innocents, amis et ennemis, ont excité une réprobation générale, les anarchistes français y ont renoncé, se contentant de répandre journaux et brochures, ce qui est infiniment moins dangereux. Ils préconisent encore le sabotage qui, parfois, peut avoir des conséquences redoutables pour un tas de pauvres diables n’ayant rien à voir dans la bataille engagée par les révolutionnaires contre la société. »
Le sabotage des lignes télégraphiques et téléphoniques de l’État ne risque de compromettre aucune vie humaine.
Ferrero, très jésuitiquement, feint de croire que les révolutionnaires tiennent plus que lui à faire dérailler les trains !
« Nous ignorons quels sont les individus qui coupent les lignes télégraphiques, mais nous voyons bien que leur geste rend au gouvernement le plus signalé service. »
Comme récompense de ce signalé service, le gouvernement fait perquisitionner ceux qu’il soupçonne de sabotage, en attendant qu’il les fasse emprisonner.
« Il serait singulièrement imprudent de dire que Clemenceau a invité des équipes d’ouvriers des lignes à mettre bas les fils. »
Ce ne serait pas de l’imprudence, ce serait de la niaiserie, digne de notre mère l’oie L’Humanité ou du citoyen Pauron.
« On se demande pourtant quel but peuvent poursuivre ceux qui opèrent sur toute la surface du territoire, au sommet des poteaux, cisailles en main. »
Nous ne sommes pas dans le secret des dieux... ni des saboteurs... Mais il est visible que leur but est de venger les 650 révoqués des postes, de troubler dans ses affaires et dans ses plaisirs la classe riche et aisée qui, seule, se sert beaucoup du télégraphe et du téléphone... classe qui a applaudi aux exécutions des postiers. Peut-être aussi leur but est-il de se faire la main, de s’entraîner pour le jour où le sabotage des fils serait une nécessité révolutionnaire, par exemple, comme dit, paraît-il, l’instruction sur le sabotage, en cas de menace de guerre.
« La grève des PTT est terminée, impossible de la galvaniser. La grève générale n’a pu s’organiser. Il semble que les travailleurs devraient s’organiser pour les luttes futures, et que les engagements d’arrière-garde devraient cesser sous peine de donner plus de force à l’ennemi. »
Ces engagements d’arrière-garde n’empêchent nullement la masse des travailleurs de s’organiser pour les luttes futures : ceux qui livrent ces engagements d’arrière-garde en ce moment seront probablement ceux qui seront comme toujours à l’avant-garde le jour des batailles prochaines.
La peur du sabotage
Le plumitif qui a rédigé dans un quotidien de l’Ouest, La Charente — journal qu’un de nos lecteurs nous envoie —, un véhément article de tête portant pour titre virulent : « Actes abominables », exagère quelque peu : « Fanfaronnades à part, nous sommes donc entrés dans une nouvelle phase de l’action révolutionnaire. Battus sur le terrain de la grève générale, où l’immense majorité de la classe ouvrière a refusé de les suivre, les anarchistes ont entrepris la destruction régulière et méthodique des lignes et des commandes de signaux sémaphoriques sur les voies ferrées. »
Mais non ! mais non ! il ne s’agit que des fils télégraphiques et téléphoniques appartenant à l’Etat, et de ceux-là seuls !
« Sous prétexte de "sabotage", ils se livrent à de véritables attentats, dont la conséquence pourrait être la mort de milliers de personnes innocentes et totalement étrangères aux débats économiques ou politiques en raison desquels ces messieurs de la CGT croient urgent de faire dérailler les trains. »
C’est toi qui déraille ! La CGT n’est absolument pour rien dans le sabotage des fils télégraphiques !
« Nous reconnaissons que la réparation de ces tentatives criminelles est difficile. »
Je te crois.
« D’abord, parce que les auteurs procèdent avec une extrême prudence et se dissimulent dans l’ombre, avec un soin infini. Ces gens, qui font si peu de cas de la vie des autres, ont un profond respect pour leurs précieuses personnes et s’arrangent toujours de façon à courir le minimum de risques. »
S’ils s’y prenaient autrement, ce seraient des imbéciles.
« D’une part, il serait presque impossible de les pincer sur le fait parce qu’on ne peut organiser une surveillance générale et permanente des lignes télégraphiques et des voies ferrées. »
C’est évidemment plus facile de sabrer de paisibles manifestants désarmés dans une plaine, comme à Villeneuve-Saint-Georges.
« Un journal parisien a proposé un moyen de venir à bout des fous furieux qui se croient à peu près sûrs de l’impunité, ce serait de promettre des primes élevées à ceux qui les feront prendre.
Ce n’est pas très noble, ce n’est pas très chevaleresque, ce n’est pas très français, observe notre confrère, mais vous voulez rire ? Est-ce que ces bandits se soucient de noblesse quand ils ruinent l’outillage qui sert à faire vivre tout le monde ? Est- ce qu’ils sont chevaleresques et français quand ils essaient d’écraser sous les débris d’un train des centaines de pauvres diables, de femmes et d’enfants ? Il n’y a aucun scrupule à avoir avec de lâches assassins comme ces gens-là. »
Décidément, cet imbécile exagère !
Le sabotage n’est pas « français »
Le Progrès de la Côte-d’Or, qu’un de nos amis nous communique, ne manque pas lui non plus de fins aperçus sur la question- :
« Un service comme celui des communications électriques remplit dans la vie économique du pays un rôle trop primordial pour que le gouvernement puisse laisser jouir d’une plus longue impunité les sinistres personnages qui ont juré d’en empêcher le fonctionnement. »
C’est aussi notre avis ! Mais encore faut-il les attraper !
« Que si, parfois, il est dans nos habitudes, en France, de nous gausser des agents ou des auxiliaires de la justice, quand ils rentrent bredouilles de leurs expéditions, c’est un penchant auquel le grand public ne cédera certainement pas dans le cas qui nous occupe. »
Ça dépend de quel public ; le public bourgeois, qui se sert journellement du téléphone, trouve en effet la plaisanterie de fort mauvais goût.
« Il y cédera d’autant moins que les chefs et les professeurs du sabotage en question n’ont pas même cette sorte de courage, en soi peu recommandable d’ailleurs, par où certains malfaiteurs trouvent le moyen de faire impression sur la foule. »
La prochaine fois, ils opéreront en plein jour, après avoir prévenu 48 heures à l’avance le commissaire de police le plus voisin.
« Le sabotage lui-même, qui consiste à s’en prendre à des choses sans défense, apparaît déjà comme le plus lâche, et à coup sûr le moins français, des procédés qui puissent être mis au service d’une cause. »
Ah ! tu nous froisses dans notre patriotisme ! Sûrement, quand ils sauront que le sabotage n’est pas un procédé français, nos saboteurs ne manqueront pas d’y renoncer !
Le jeu de la réaction
Dans le Réveil du Nord, journal des socialistes jaunes et des radicaux tricolores du Nord, M. Desmons, ancien médecin militaire, officier de la légion d’honneur, n’est pas content des saboteurs et il ne nous l’envoie pas dire :
« Quant à nous, nous ne cesserons de nous élever avec tout ce que nous avons de vigueur contre ces actes de barbares indignes de la classe ouvrière, d’une "classe ouvrière sortie des langes du premier âge" comme l’écrit le camarade Marius André. Nous stigmatiserons ces énergumènes qui font trop bien le jeu de la réaction en préconisant ouvertement la violence, le sabotage, l’insurrection, au sein d’un parti dont c’était l’honneur et la force, d’avoir inscrit à la base de sa constitution qu’il poursuivait, par le bulletin de vote, la conquête des pouvoirs publics. »
Ces bourgeois repus sont tous les mêmes. Maintenant qu’ils sont installés confortablement autour de l’assiette au beurre, ils n’aiment pas les énergumènes, ils sont pour la légalité. On comprend la répugnance de M. Desmons pour la révolution.
Signe particulier : ce M. Desmons, qui parle avec tant d’amour du Parti socialiste, refuse d’en être. C’est un des suiveurs de l’ancien énergumène Briand.
Propos d’un unifié
Dans le journal socialiste que dirige le citoyen Ringuier, à Saint-Quentin, on s’élève avec force contre le sabotage qui, à Chauny, non loin de là, a abouti à couper 27 des 33 importants fils qui reliaient Paris à la région du Nord :
« Ces actes de sabotage sont complètement idiots. Si ceux qui se livrent à ce jeu dangereux se figurent qu’ils sont intelligents, ils se trompent. C’est de la malfaisance bête. On a interrompu pendant une demi-journée toutes les correspondances téléphoniques et télégraphiques et porté préjudice au commerce et au grand public. A qui cela profite-t-il- ? A personne. Et puis le sabotage est malhonnête et ne peut être le fait d’hommes conscients. »
Signe particulier : le socialiste conservateur qui a accouché de ce réquisitoire est un socialiste unifié.
Il est vrai que notre mère l’oie, L’Humanité, lui avait dėjà donné le la.
Nous le connaissons pas
Presque tous les journaux ont publié une note à peu près ainsi conçue au sujet de Roussel, l’un des camarades anarchistes arrêtés sous l’inculpation de détention de dynamite : « On affirme, à la CGT, qu’il ne fait plus partie de cette organisation depuis plus d’un an. »
D’autre part, l’Union des syndicats siégeant à la Bourse du travail, déclare que Roussel a été rayé de la liste de ses membres, depuis au moins une année.
Possible ! Que Roussel, qui était l’un des signataires du manifeste de la CGT « Gouvernement d’assassins », dont douze seulement furent récemment poursuivis, n’ait plus rien de commun avec la CGT.
Tout de même cette unanimité et cet empressement à le renier, au moment où il est coffré, dénotent, dans certains milieux syndicalistes, une prudence et une diplomatie qui commencent à devenir inquiétantes.
L’organisation de combat reprend la parole
Communication non officielle
transmise par fil non coupés.Nous avons reçu cette nuit le document suivant :
L’organisation de combat qui s’est occupé d’organiser le sabotage à l’occasion de la grève générale tient à rappeler au public une fois pour toutes :
1°) Que les cheminots n’ont rien à voir dans cette affaire ; que le sabotage s’accomplit à leur insu et qu’il est entièrement inutile que certains orateurs se désolidarisent publiquement d’avec les saboteurs, lesquels sont des militants révolutionnaires, soucieux de prendre part à la besogne nécessaire ;
2°) que le sabotage qui se pratique dans l’intérêt des cheminots et des autres corporations en grève continuera à s’exercer, même lorsque la grève sera terminée, en représailles contre un gouvernement de jaunes et de traîtres ;
3°) que toutes les mesures prises — perquisitions, arrestations, emprisonnements, poursuites — contre les saboteurs sont entièrement inutiles et que rien ne pourra empêcher le sabotage de se poursuivre méthodiquement tant que les salariés en révolte n’auront pas obtenu complète satisfaction.
L’ORGANISATIONPS : nous croyons que les auteurs de ce communiqué, membres de l’organisation de combat, nous l’ont transmis pour répondre aux notes aussi tendancieuses qu’idiotes parues ça et là dans les journaux vendus à Aristide-la-crapule.
—
PREMIER AVERTISSEMENT... AVEC FRAIS [27]
(13 octobre 1909)
Nous avions averti charitablement qui de droit que nous étions quelques-uns décidés à ne pas nous laisser assommer par les cosaques de la République. Nous avons tenu parole.
Ce ne sont pas des malandrins, des apaches qui ont résisté, revolver au poing, aux brutes de la garde républicaine et des brigades centrales.
C’est nous, les révolutionnaires.
Nous en avons assez de nous laisser cravacher, assommer à coups de casse-tête, sabrer, par les apaches de l’Ordre chaque fois que nous nous livrons à une manifestation pacifique.
Sous la République même bourgeoise, nous avons le droit de manifester dans la rue, tout comme les citoyens de la monarchie belge ou de la monarchie anglaise.
Et si on nous conteste ce droit, nous le prendrons.
Et nous avons la prétention d’exercer ce droit sans être traités comme des moujiks russes.
Le gouvernement avait le droit — et le devoir si l’on veut — d’entourer l’ambassade d’Espagne et nous empêcher de la saccager.
Pour cela, il n’avait qu’à accumuler d’importantes forces de police autour de l’hôtel du représentant de l’assassin d’Espagne.
Nous n’avions pas du tout l’idée folle de forcer les barrages, ni de mettre en déroute des forces d’infanterie et de cavalerie, armées de fusils et de carabines Lebel.
Nous venions, boulevard de Courcelles, conspuer les rois d’Espagne et son ambassadeur.
Il n’y avait qu’à nous laisser crier notre colère à cent mètres de l’ambassade ; puis, nous serions allés continuer notre manifestation sur les grands boulevards.
M. Lépine et ses apaches en avaient décidé autrement, paraît-il.
Le premier groupe, celui que conduisaient Laisant et Charles Albert [28], a été chargé et assommé sans aucune violence, ni sans avoir riposté.
Le second groupe, celui que conduisait la rédaction de La Guerre Sociale, a été chargé au trot, sans sommations, sans invitation à nous arrêter ; ils ont lancé leurs chevaux sur nous ; ils nous ont piétinés ; alors, alors seulement, pour se défendre, nos amis ont sorti « leur bulletin de vote », et, comme les gardes municipaux dégainaient et essayaient de les frapper à grands coups de sabre, ils les ont arrêtés nets par quelques coups de revolver.
Les autres groupes qui ont tiré, n’ont tiré que lorsqu’ils ont été chargés, assommés, sabrés.
Quelques policiers ont « trinqué ».
Il y a assez longtemps que nous « trinquons », nous !
Chacun son tour.
Nous sommes décidés à continuer, si la police continue.
S’il faut se battre, pour conquérir le droit élémentaire de manifester notre opinion dans la rue, on se battra.
Si Briand-la-Jaunisse ne veut pas que le sang coule une autre fois, qu’il mette une muselière à ses cosaques.
Gustave Hervé
—
POUR DES SALAUDS
(3 novembre 1909)
Il y a quinze jours, L’Anarchie publiait un article — très courageusement signé Karakol — où, entre autres cochonneries, il était dit que la manifestation pacifique du dimanche 17 octobre avait été organisée de concert entre « Jaurès, Hervé et Lépine » [29].
Nous avons laissé passer cette saleté. L’Anarchie a sans doute jugé que ce n’était pas suffisant. Dans son dernier numéro, un autre pur — qui, non moins courageux que le premier, signe Lux — déverse un nouveau flot de bave.
Voici un échantillon de cette ordure :
« C’est fait. Malgré les meetings bruyants, les ordres du jour comminatoires, les manifestations burlesques en automobiles, les menaces, les prières, les suppliques ; malgré tout cela, ou plutôt à cause de cela, Ferrer a été fusillé. (...)
Nous n ’avons rien dit pendant que nos guignols révolutionnaires agitaient leurs grelots pour effrayer les fusilleurs espagnols. Nous étions sans illusions, sachant très bien que le bluff des manifestations cocasses, dissimulant une faiblesse réelle, n’empêcherait rien. (...)
« Les rodomontades ridicules de ces pitres et de ces fausses-couches sociales n’avaient aucune chance d’aboutir au résultat qu’elles prétendaient viser. C’était du bluff, du tam-tam pour la galerie, comme tout ce que font ces messieurs. »
(...)
Nous admettons parfaitement que des militants anarchistes aient refusé de prendre part à une manifestation dont ils désapprouvaient le caractère. Nous comprenons que des anarchistes critiquent et blâment La Guerre Sociale pour la part qu’elle a prise à la démonstration du 17. Nos amis de Germinal, d’Amiens, l’ont fait en termes nets mais amicaux, et nous leur avons répondu ici avec une égale cordialité.
Mais ce que nous n’admettons pas, c’est d’être diffamés, calomniés, par des gens qui se frottent journellement à nous, et, de ce fait, savent pertinemment qu’ils mentent lorsqu’ils écrivent ou laissent imprimer les saletés d’un Lux ou d’un Karakol !
Il faut d’ailleurs à L’Anarchie une certaine effronterie pour nous traiter de « fausses-couches sociales » et de « non-agisseurs ». _ Quand, dans sa propre maison, et jusque dans sa « ligne directrice », on a des moineaux comme l’Anarchie en possède, on évite de parler d’« agisseurs ».
C’est peut-être un « agisseur » ce crétin vantard qui a nom Mauricius et qui, de l’avis de quiconque l’approche, est la poltronnerie et la lâcheté personnifiées ? « Agisseur », Le vieux [sic] cette poche à fiel, ce diffamateur chronique qui, éloigné de tout groupement, en marge de toute action, loin de Paris, mystérieux et inconnu, tance, censure, critique, outrage (par la plume) avec une méchanceté de bouledogue et une mauvaise foi de jésuite, tout ce qui n’a pas l’heur de lui plaire ? « Agisseur » Armand, ce théoricien (pas sans valeur, d’ailleurs) qui a le goût de la bataille — je parle de la bataille où l’on risque sa liberté ou sa peau — à peu près comme le chat a le goût de l’eau bouillante ?
Des « agisseurs », ça ? Ah !... Ah !...
Tous ces gens, qu’on ne voit jamais, lorsqu’il y a un risque à courir, passent le plus clair de leur temps, soit à philosopher, à discutailler sur des sujets mille fois rebattus, soit à dénigrer tout ce qui ne porte pas leur firme.
Que ces « agisseurs » mènent leur propagande à leur guise : nous n’y voyons d’inconvénient que pour l’anarchisme dont ils ont réussi à détacher bien des sincérités et bien des énergies. Mais qu’ils nous foutent la paix : il y a des saletés que les « fausses-couches » que nous sommes ne supporteront pas !
Miguel Almereyda
Ces lignes ne s’appliquent pas à quelques bons camarades qui fréquentent à L’Anarchie comme Cachat et Dulac, lesquels m’ont présenté personnellement, et en toute camaraderie, leurs critiques. Ma protestation est dirigée contre les deux salauds qui signent Lux et Karakol et contre les responsables moraux de L’Anarchie. Je tiens également à déclarer qu’il fut un temps où les militants de L’Anarchie, s’ils usaient dans leur propagande de moyens que je juge fâcheux, savaient à l’occasion payer de leur personne.
—
L’EXEMPLE DE L’APACHE
(12 janvier 1910)
Je vais encore scandaliser les honnêtes gens et les imbéciles. Savez-vous que cet apache qui vient de tuer l’agent Deray ne manque pas d’une certaine beauté, d’une certaine grandeur.
C’est un apache, c’est entendu ; c’est-à-dire un malheureux qui, à dix-neuf ans, a filouté, peut-être un jour de chômage ; la prison a commencé à le pourrir, le Bat d’Af [30] l’a achevé. Sorti de là, rentré à Paris, il a vécu en marge du Code, traînant son casier judiciaire comme un boulet.
Un beau jour, des bourriques des « mœurs » l’ont arrêté, sous l’inculpation de vagabondage spécial et l’ont fait condamné à trois mois de prison et à cinq ans d’interdiction de séjour.
Or, l’apache était tout ce qu’on voudra, excepté un souteneur.
Les « mœurs » se sont-ils trompés ? C’est possible.
Ont-ils menti, fait un faux témoignage, pour se venger de la femme avec laquelle ils ont trouvé notre homme ?
C’est probable : la plupart des bourriques des mœurs cumulent cette honorable profession avec celle de souteneur et ne reculent pas devant un faux témoignage pour se débarrasser d’un rival. L’apache fit sa prison.
Il en sortit à la mi-décembre.
Une fois libre, il n’eut plus qu’une idée : la vengeance.
Il n’avait pas d’arme ; pour pouvoir en acheter, il travailla, nuit et jour, de son métier de cordonnier, avec acharnement, économisant pièce à pièce son salaire : ce fut son réveillon à lui.
Quand il eut cent francs, il alla acheter un bon revolver, se fabriqua une étrange cuirasse. Avec du cuir hérissé de pointes de fer, il affila deux de ses tranchets et, ainsi armé de pied en cap, enveloppé dans un manteau, il se mit à la recherche des deux policiers qui l’avaient fait condamner.
On sait le reste et la façon magistrale dont il reçut les agents en bourgeois qui voulaient l’arrêter.
Je ne demande pas pour cet apache le prix Montyon.
Mais je trouve que dans notre siècle d’aveulis et d’avachis, il a donné une belle leçon d’énergie, de persévérance et de courage, à la foule des honnêtes gens ; à nous-mêmes, révolutionnaires, il a donné un bel exemple.
Tous les jours, il y a d’honnêtes ouvriers qui sont victimes de brutalités policières, d’ignobles passages à tabac, de condamnations imméritées, d’erreurs judiciaires grossières : avez-vous jamais entendu que l’un d’entre eux se soit vengé !
Il y a parmi nous des militants qui ont été insultés, giflés, assommés dans les postes de police, par les cosaques de la République ; avez-vous entendu dire qu’un seul ait, avec la témérité de cet apache, passé des jours et des nuits à ruminer sa vengeance, à rechercher ses insulteurs et ses assommeurs ?
Tous les jours, les magistrats, avec une légèreté, une inconscience ou une férocité sans nom, dans des jugements rendus le cœur léger et par-dessous la jambe, promènent la ruine, la douleur, le déshonneur dans les familles ; avez-vous jamais ouï qu’une seule de leurs victimes se soit vengée ?
Ohé ! les honnêtes gens ! Passez donc à cet apache la moitié de votre vertu et demandez-lui en échange le quart de son énergie et de son courage.
G. Hervé
—
Dans le Parti socialiste
L’ATTITUDE DES INSURRECTIONNELS
(19 janvier 1910)
Bien qu’antiparlementaires, les insurrectionnels présentent des candidats. Pourquoi ?
Les réformistes de la fédération de la Seine nous ont reproché au congrès de dimanche dernier de faire, dans notre motion, une place à l’action électorale. Ils voudraient, ces bons apôtres, nous voir d’une pureté impeccable, et cela les chiffonne que nous prenions parti dans la question.
- Voyons, des antiparlementaires ! Que diable cela peut-il bien vous faire que le Parti présente ou ne présente pas de candidats ? qu’il se maintienne, se désiste ou se retire au deuxième tour ?
En ce qui me concerne personnellement, j’avoue que cela ne m’empêche pas de dormir. Seulement, il n’y a pas que moi, il n’y a pas que les insurrectionnels ; il y a le Parti, il y a la masse. Et lorsqu’il s’agit d’amener la masse à soi, il faut commencer par aller vers elle. On ne commande aux foules qu’en leur obéissant dans une certaine mesure.
Certes, le parlementarisme est discutable ; mais il n’est pas mort encore. Dans quelques mois, la foule reprendra le chemin des préaux d’école ; elle se passionnera pour et contre les candidats. Pense-t-on pouvoir l’arrêter, la contraindre à venir dans nos réunions où nous lui exposerons la nécessité absolue de la destruction systématique par la subversion totale ?
Nous serons entendus, certes, mais de combien ? Secte restreinte, nous resterons sans action sur l’ensemble du pays et notre intransigeance simpliste n’aboutirait qu’à nous réduire à l’impuissance.
Certes, notre foi en la gymnastique révolutionnaire n’a pas diminué, nous l’avons bien prouvé au 13 octobre et nous le prouverons demain si l’occasion s’y prête. Ne tenant ni à être élus ni à faire élire, nous ne nous gênerons pas pour prêcher la nécessité de ladite gymnastique dans les réunions électorales. Mais force nous est de parler à la grande foule là où elle est ; notre incohérence est celle de qui veut agir.
C’est pourquoi, bien qu’antiparlementaires, nous participons à l’agitation électorale.
Mais nous nous arrêtons là, parce que nous savons quel revers est à la médaille dont nous venons de montrer le beau côté.
Au revers, il y a les compromissions du candidat socialiste forcé, pour être élu, de châtier le socialisme.
Il y a l’élu lui-même qui, tant que le scrutin d’arrondissement fonctionnera, sera toujours, en fait, à peu près indépendant du Parti et qui, après, continuera encore trop souvent à mener le Parti.
Il y a la dégringolade fatale des ministrables du socialisme révolutionnaire au réformisme, du réformisme au socialisme indépendant, du socialisme indépendant au radicalisme et à l’opportunisme.
C’est pourquoi, forcés, pour trinquer avec la masse, de tremper nos lèvres dans l’alcool frelaté du parlementarisme, nous avons étendu fortement d’eau le poison, et réduit ainsi à son minimum le danger de l’action électorale.
Cette dernière a un avantage : la propagande qu’elle permet de faire. _ Nous intensifierons donc la propagande et demandons qu’il y ait des candidats socialistes partout.
L’action électorale présente un gros danger : le second tour avec toutes les corruptions, les maquignonnages qu’il permet. Nous coupons donc court à toutes ces malpropretés en maintenant nos candidats, quelles que soient leurs chances.
Mais les réformistes alors s’égarent.
Vaillant (pardonne-lui, ombre de Blanqui !) s’écrie que nous allons empêcher nos candidats d’être élus.
Cela, c’est le cadet de nos soucis.
Moins il y aura d’élus, plus le Parti sera propre, et plus il sera révolutionnaire.
Je n’irai pas jusqu’à dire comme Jobert que les élus sont des fripouilles, mais c’est un peu parce que, en ma qualité d’intellectuelle, j’éprouve toujours quelque hésitation d’appeler un chat un chat. Mais enfin, comme disait une vieille chanson anarchiste (ne soyez pas trop difficile à la rime) :
« Mettre une belle poire dans les gâtées,
C’est un sale truc pour la garder. »
Un bon et actif militant au Parti vaut mieux qu’un socialiste assagi à la Chambre.
Dr Madeleine Pelletier
**
La motion des insurrectionnels
Voici la motion sur laquelle se compteront, à Nîmes, les insurrectionnels du Parti unifié, et que tous nos amis de la Seine et des fédérations des départements auront à cœur de défendre dans leurs sections respectives :
Le Congrès :
Constatant l’inefficacité et l’inutilité de l’action parlementaire et la faillite complète et irrémédiable du parlementarisme.
Considérant que la conquête électorale du pouvoir politique par le bulletin de vote est une chimère et une duperie dans notre régime capitaliste où l’opinion de la majorité sera toujours faite fatalement par la presse à gros tirage, tout entière aux mains des riches, et que la conquête de ce pouvoir ne peut avoir lieu que par les seuls moyens révolutionnaires (grève générale insurrectionnelle, etc.).
Qu’en république bourgeoise et radicale, comme en monarchie, les parlements sont les instruments dociles des puissances d’argent qui font et défont les ministères et les majorités et qui achètent un à un les chefs des partis parlementaires à mesure que ces partis arrivent au pouvoir, comme le prouve l’exemple des républicains opportunistes, des radicaux et des socialistes indépendants.
Que les préoccupations électorales des partis socialistes de tous les pays ont tué en eux tout sens révolutionnaire.
Que l’application de la représentation proportionnelle — qui n’est qu’une diversion plus ou moins habile pour reconquérir leurs sièges aux candidats compromis par leurs lourdes fautes dans la précédente législature — ne changera rien à l’impuissance parlementaire.
Considérant que toutes les réformettes compatibles avec l’existence du régime capitaliste — nationalisation des mines, des chemins de fer, impôt sur le revenu, retraites ouvrières — seront faites par les partis bourgeois eux-mêmes, intéressés à replâtrer l’édifice social, ainsi que le montre l’exemple de l’Angleterre et de l’Allemagne monarchiques, en possession déjà de l’impôt sur le revenu et des retraites ouvrières.
Que les lois dites ouvrières, comme la réduction des heures de travail, dépendent, non de la bonne volonté d’un parti politique parlementaire, quel qu’il soit, ni de la composition des Chambres, mais du degré de développement économique du pays et de l’action directe des organisations syndicales sans lesquels aucune loi ouvrière n’est appliquée.
Le Congrès décide :
1°) Que le Parti présente des candidats dans le but unique de profiter de l’effervescence des périodes électorales pour développer sans réticences ni réserves, son programme nettement collectiviste ou communiste et une tactique nettement anti-parlementaire et insurrectionnelle.
2°) Qu’également ennemis de tous les partis bourgeois entre lesquels, après la conduite des radicaux sous le ministère Clemenceau, il lui est impossible de faire aucune distinction, le Parti maintient tous ses candidats au deuxième tour sans les autoriser à se désister, ni pour un réactionnaire sous prétexte de représentation proportionnelle, ni pour un radical sous ce même prétexte, ou sous prétexte de laïcité et de défense républicaine.
3°) Que d’ailleurs, pour éviter toute accusation de marchandage électoral, le Parti déclarera, dès avant le premier tour de scrutin, que tous ses candidats seront maintenus au deuxième.
—
Avant le congrès de Nîmes
LA CLASSE OUVRIÈRE CONTRE LES RETRAITES
(2 février 1910)
Le rejet de la loi loi sur les retraites ouvrières par le congrès fédéral de la Seine tenu dimanche dernier (81 voix à la motion Flancette et 71 voix à la motion Méric [31]) va mettre les réformistes et surtout les élus parlementaires dans un bien cruel embarras.
Ils espéraient retourner devant les électeurs avec l’appât de cette mirifique réforme et voilà que la classe ouvrière ne veut pas de cette réforme !
C’est vexant !
Aussi faut-il voir les parlementaires et parlementaristes se démener.
Tantôt ils se font suppliants : « Voyons, soyez gentils, dit Renaudel [32], votez la loi ; toutes les améliorations que vous y voudrez, on vous les fera... après les élections ! »
« Voyons, dit Sembat [33], voulez-vous que des ouvriers fassent partie du Conseil de gestion des capitaux ! Voulez-vous être assurés que même en cas de guerre désastreuse vos capitaux seront respectés ? voulez-vous... ? voulez-vous... ? Mais, je vous en conjure, veuillez d’abord ce que nous voulons ! »
La conciliation ne prenant pas, ils entrent alors en grande colère : « Comment, puérils que vous êtes ! On vous élabore une belle loi et vous la repoussez ! Vous voulez donc nous forcer à nous déjuger devant le pays ? Ah, non ! par exemple ! cela ne se passera pas comme ça ou nous verrons ».
On ne verra rien du tout, et si le congrès de Nîmes décide que les élus auront à repousser le projet des retraites, je voudrais bien savoir comment ils feront pour le voter.
Je sais bien des décisions de congrès qui sont restées lettre morte. Mais, pour celle-ci, il faudrait désobéir de suite, et à la veille des élections. Ce serait trop scabreux, les élus n’oseront pas.
Et tout fait prévoir qu’on se prononcera dans le sens que nous indiquons. Au congrès de la Seine, des syndicalistes plutôt modérés comme Flancette, des guesdistes qui ne sont nullement antiparlementaires se sont élevés contre la loi. C’est qu’en même temps que membres du parti ils sont aussi syndiqués, et que, sous l’éperon de la CGT, force leur est bien de marcher.
Les élus socialistes auraient pu avoir un beau rôle s’ils avaient eu le courage de rester vis-à-vis du pouvoir dans une opposition constante, irréductible, violente.
De la tribune de la Chambre, grâce à la grande presse, la voix porte loin, infiniment plus loin que celle qui se fait entendre dans des réunions publiques. Si nos députés s’en étaient servis pour dénoncer à tout instant les iniquités sociales, pour faire le procès de la bourgeoisie, pour évoquer la guerre des classes et les violences prochaines, on leur eût pardonné bien des choses, peut-être même les quinze-mille [34].
Mais, pour se maintenir, pour pistonner parents et amis, pour ne pas dire un définitif adieu aux fonctions ministérielles, ils se sont faits les replâtreurs de la société qu’ils étaient chargés de démolir.
Ils ont estompé le programme du Parti, transformé le collectivisme subversif en un vague démocratisme... Escomptant l’inertie naturelle des masses, ils ont déconseillé la violence et prêché la paix sociale.
Tant pis pour eux s’ils n’ont plus la confiance du prolétariat !
Aujourd’hui, la classe ouvrière les place avec les Ribot [35] de l’autre côté de sa barricade...
La bourgeoisie prenant peur, veut, pour avoir la paix, jeter au prolétariat un os à ronger, de fallacieuses réformettes : un repos hebdomadaire qu’on n’applique pas, une retraite de quelques sous par jour, à un âge que la majorité des ouvriers ne peut pas atteindre.
Et les élus socialistes se sont faits les mandataires de cette bourgeoisie. Plus près de la classe ouvrière, ils entament avec elle, avant tout combat, la négociation d’un traité ridicule.
Tant pis !
Ce que la classe ouvrière repousse, il est vrai à l’heure actuelle, ce n’est pas le principe des retraites, c’est seulement la capitalisation.
Mais nous n’en assistons pas moins à une évolution décisive du syndicalisme.
Aux offres de la bourgeoisie radicalisante et du Parti socialiste, la classe ouvrière répond par une fin de non-recevoir. Elle fait son premier pas dans la voie du refus des réformes.
Que nos élus se tirent de là comme ils pourront.
Dr Madeleine Pelletier
—
COMMENT ON LES DRESSE
(9 mars 1910)
L’Union des syndicats des transports avait organisé, hier soir, salle Vazeille, à Boulogne-sur-Seine, une grande réunion. A la sortie, une cinquantaine d’exaltés voulant faire du bruit se trouvèrent en présence des agents cyclistes qui, insultés et menacés, reçurent du renfort. Une collision s’ensuivit.
Les manifestants, repoussés jusqu’à l’avenue des Moulineaux, tirèrent sur les agents plusieurs coups de revolver sans les atteindre, puis se dispersèrent dans toutes les directions. (Petit Parisien, 3 mars).
Et voilà comment la presse à grand tirage raconte l’histoire ! Or, la voici, en toute sincérité, après une enquête sérieuse. Mercredi soir, 2 mars, 600 ouvriers sortent d’une conférence à Boulogne-Billancourt où l’Union des syndicats de la Seine les a convoqués pour leur raconter un acte de sauvagerie inouïe commis quelques jours auparavant par un chef d’équipe et des jaunes de la maison Dessoucher et Cie, qui a un entrepôt de marchandises dans la localité : au moment où les deux délégués du syndicat des Transports haranguaient les grévistes de cette maison, cinq jours auparavant, un chef d’équipe, sans provocation, s’était jeté sur eux à l’aide de quelques jaunes, et les avaient assommés sans qu’aucun des 200 grévistes présents, ahuris et intimidés, ait bougé pour les protéger.
A la sortie de la réunion de protestation contre cet attentat, des camarades remarquent deux ou trois des jaunes qui y avaient pris part et qui avaient eu l’aplomb de venir à la réunion ; en un clin d’œil, on les entoure et on leur administre une correction qui les guérira à tout jamais de leur jaunisse... si elle n’est pas incurable.
Quatre gendarmes et huit agents cyclistes accourent.
Ils dégainent.
Si les camarades se sauvent, qu’est-ce qu’ils vont prendre !
Heureusement, ils étaient venus à la réunion avec de bonnes intentions... et beaucoup d’entre eux avec des revolvers, non point de ces méchants pétards qui font plus de bruit que de besogne, mais avec de bons brownings, qui valent toutes les armes de nos frères flics.
En voyant le geste de nos frères flics, un camarade crie :
« A moi, les copains ! »
En une seconde, il a autour de lui plus de 40 camarades, revolver au poing, qui s’alignent et barrent la route.
La flicaille s’arrête net.
Un copain prend le brigadier de gendarmerie au collet, un autre un agent cycliste, et tous crient : « Salauds ! assassins, on n’est pas à Draveil [36], ici ! Rengainez illico ou on vous descend ! »
Ah, mes amis ! Quel tableau !
L’un des flics dit en auvergnat : « Nous sommes des pères de famille comme vous ! Ne nous cassez pas la gueule ! »
C’est le mot des gendarmes de Béziers lorsque les balles du 17ème [37] commencèrent à siffler au-dessus de leurs têtes.
Les autres se laissèrent arracher les nerfs de bœuf qu’ils portaient à la ceinture.
Tous, flics et pandores, rengainèrent prestement.
« Et puis, maintenant, filez, oust ! et vivement ! Et surtout si vous faites mine de nous suivre, on vous brûle la gueule ! »
Pour leur montrer qu’on était armé, les copains tirent en l’air : ce fut une belle pétarade.
Penauds, flics et pandores se retirèrent, sans se retourner et sans demander leur reste.
Un comble : à cent mètres de là, derrière le cimetière, se trouvaient une cinquantaine de flics. En entendant la pétarade, pas un ne broncha ; pas un ne fit un pas en avant pour venir au secours de leurs collègues en danger.
Comme ils ont été gentils, nos amis ne veulent pas être en reste d’amabilité avec eux ; ils nous ont apporté deux des nerfs de bœuf arrachés à leurs frères flics. Nous avons trop le respect de la propriété et de la police pour les garder.
Ils sont à la disposition de leurs légitimes propriétaires, dans les bureaux de La Guerre Sociale, jusqu’au 1er mai. Passé ce jour, nous les mettrons comme gros lot à la loterie que nous comptons organiser prochainement au bénéfice des brigades centrales.
Signalés...
À la bienveillance du frère Aristide... et au respect des militants ouvriers : Le BRIGADIER n°10 du XIIème qui, lors de la manifestation des commis-épiciers, dimanche, frappa un manifestant d’un coup de sabre sur la tête.
Le FLIC n°136, du XIème qui, le même jour, se distingua entre tous ses collègues par sa brutalité et frappa à coups redoublés deux femmes coupables de protester contre l’arrestation d’un de leurs parents.(15 décembre 1909)
—
Après la défaite
(4 mai 1910)
La veille du 1er mai, nous avons tiré une édition spéciale, toute à la paix, pour nous mettre à l’unisson des déclarations pacifiques de l’Union des syndicats, seule organisatrice, seule responsable de la journée.
Le lendemain, nous avons tiré une autre édition spéciale, dans laquelle, malgré notre désir de masquer le désastre, nous ne pouvions nous empêcher de dire que la journée était une défaite, une défaite plus douloureuse que la tragique affaire de Villeneuve qui, celle-là, avait été glorieuse et réconfortante.
Nous nous sommes paraît-il grossièrement trompés.
Il paraît en effet, c’est notre camarade Luquet [38] qui nous l’affirmait le lendemain en tête de L’Humanité, que cette journée atteste « la clairvoyance et la décision » de nos amis de l’Union des syndicats, « la forte discipline des organisations syndicales » ; quoi encore ? « leur conscience et leur sang-froid ! »
Mesdames et Messieurs, « ils ont par une tactique habile, dont l’opportunité prouve la souplesse des organismes, rendu ridicules et vaines les dispositions prises au bois [de Boulogne] ».
Apprenez de notre camarade Luquet, qu’« une classe ouvrière organisée qui peut au dernier moment, en l’espace de quelques heures, par une discipline ferme et librement consentie, réfréner son désir et modifier ses projets peut, à plus forte raison, discipliner une manifestation longuement préparée ».
Toujours d’après le même, savez-vous ce que prouve la journée de dimanche ? Tenez-vous les côtes, mes amis. Eh bien ! elle prouve « que les travailleurs organisés gagnent en force, en adresse et en conscience ».
Non, vraiment, ça dépasse les bornes !
Au moins, lorsque nos patriotards ont calé sur l’affaire de Fachoda [39] devant les menaces du gouvernement anglais, ils ont eu la pudeur et l’intelligence de ne pas crier victoire !
Si bouchés que soient les électeurs de La Patrie, ils auraient compris qu’on se payait leur tête.
Les ouvriers, qui ont mis avec raison toute leur confiance dans la CGT, et qui lisent L’Humanité, ne sont pas plus bêtes que les lecteurs de La Patrie.
Ils savent très bien que si quelqu’un a été ridicule dans cette affaire, ce n’est pas le gouvernement, c’est la CGT ; qu’on ne feint pas le mercredi d’ignorer le gouvernement pour aller, le samedi, faire une démarche auprès de lui ; que le fait de décommander le dimanche matin une manifestation annoncée à grand fracas est une preuve de prudence si on veut, c’est une preuve de tout ce qu’on voudra, excepté une preuve de force.
Un esprit de décision qui se traduit par de perpétuelles hésitations s’appelle en bon français de l’indécision.
Une clairvoyance qui consiste, pour les chefs les plus batailleurs et les plus écoutés, à partir en province, à ne pas décommander les conférences qu’ils y ont organisées, s’appelle de l’aveuglement.
Un sang-froid qui amène les gens à tomber dans le traquenard de Briand et de Lépine, à prendre à la lettre les racontars alarmistes de la presse policière sur les ordres donnés à la troupe de tirer porte un autre nom : cela s’appelle de l’affolement.
Une adresse et une conscience qui consiste à croire qu’un gouvernement, républicain d’étiquette, sauf en face d’une révolution déchaînée, a l’intérêt, surtout entre deux tours de scrutin, à préméditer un massacre, s’appellent de leur vrai nom maladresse et inconscience ou, si on veut, intelligence politique.
Ce n’est pas des cris de triomphe qui donneront le change à qui que ce soit.
Je préfère Kouropatkine [40] faisant, après la défaite, son examen de conscience et l’aveu des fautes commises ; c’est plus courageux et plus intelligent.
C’est surtout le meilleur moyen de préparer la revanche et de montrer aux troupes qu’on a derrière soi que, si on a commis des fautes, — tout le monde en commet — on n’est quand même pas tout à fait un imbécile.
Quant au « citoyen Browning », ce n’est pas le monstre altéré de sang qu’un tas de bons badauds se figurent, et si on peut, en la circonstance, lui reprocher quelque chose, ce ne sont pas ses rodomontades, mais ses déclarations pacifiques.
Le « citoyen Browning » n’intervient d’ailleurs jamais pour son plaisir, mais parce qu’il ne peut supporter que des hommes libres, des citoyens français, dont les pères ont fait quatre révolutions victorieuses, soient traités comme des moujiks, soient à la manifestation la plus pacifique, assommés à coups de matraques, ignominieusement passés à tabac, sabrés ou révolvérisés, sans provocation, sans sommation par des brutes saoules d’alcool, ou énervées par l’attente, la peur ou la colère.
Le « citoyen Browning » ne croit pas qu’à lui tout seul il puisse jamais faire une révolution ; il a suffisamment conscience de sa faiblesse pour savoir qu’il n’est pas de taille à se frotter à des Lebels et encore moins à de l’artillerie ; sa plus grande tristesse serait d’ailleurs d’avoir à tirer, pour se défendre, sur des pioupious, car il aime les pioupious comme des frères, au point de ne pouvoir les contempler un jour de manifestation sans les acclamer aux cris de « Vive le 17ème ! ».
Le « citoyen Browning », plus modeste, n’a qu’une seule prétention : c’est de corriger instantanément les policiers qui, sans rime ni raison, voudraient l’assommer, lui ou les femmes, les enfants, les hommes, venus manifester pacifiquement dans la rue ; c’est de les guérir, eux et leurs chefs, de leurs mœurs de cosaques qui sont le déshonneur de notre grand Paris républicain, socialiste et révolutionnaire.
Au surplus, le citoyen Browning constate que les roquets qui affectent d’en rire aujourd’hui parce qu’il n’a pas élevé la voix le premier mai, n’en riaient pas le soir de Ferrer, autour de l’ambassade espagnole, ni le lendemain ; que les officiers et les gardes municipaux qui ont voulu le sabrer ce soir-là n’en riaient pas non plus ; et que ce soir-là enfin, aucun des collègues de l’agent Dufresne ne l’a confondu avec M. Chou-fleuri.
G.H.
—
édition spéciale
LIABEUF... & CASERIO
(29 juin 1910)
Le crime est consommé. Ils ont assassiné Liabeuf. Mais il leur a fallu toute une armée pour protéger leur guillotine, leur bourreau et les aides de leur bourreau : policiers, gendarmes et magistrats.
Pour que ce matin il n’y ait pas d’émeutes dans les quartiers populaires, pour éloigner d’eux les représailles qu’ils sentent menaçantes, ils en sont réduits à ouvrir tout grands les égouts de leur grande presse, à faire rééditer par elle les infâmes mensonges que nous leur avions rentrés dans la gorge, et à faire certifier effrontément par toutes les grandes feuilles prostituées à la police que Liabeuf était vraiment un apache et un souteneur.
Nous étions naïfs de croire que cette bande de peaux-rouges [41] et de requins était capable de pitié, d’humanité et de justice.
Nos appels à leur générosité, de l’hébreu pour eux !
Ils ne connaissent que la raison d’État, en bon français, la défense de leur auge.
Ils ont besoin de la po1ice pour défendre leur république d’exploiteurs et d’assassins contre le flot montant du prolétariat.
Elle exigeait la tête de celui que, par de faux témoignages et une monstrueuse erreur judiciaire, elle avait elle-même acculé au meurtre.
Les hommes d’État qui ont la garde de l’écuelle capitaliste ont eu peur d’une grève de leurs policiers, que les chefs de la Préfecture auraient eux-mêmes fomentée sournoisement.
Ils ont capitulé devant ceux qui leur assurent, à eux et à toute la bourgeoisie, une paisible digestion.
Liabeuf a été exécuté, non pas parce qu’il était coupable.
On l’a tué parce que l’élite de la classe ouvrière est coupable de rébellion contre le patronat et contre « l’ordre » capitaliste.
On l’a tué parce que les grèves continuelles qui éclatent de toutes parts, depuis quelques années, font de la police la première institution de la République, la plus sacrée et la plus inviolable.
On prend d’ailleurs la précaution de nous en avertir, car on ne nous cache pas que c’est, notamment, l’attitude de la classe ouvrière aux obsèques de Cler [42], dimanche, qui a décidé l’exécution de Liabeuf.
Oui, on a raison ; c’est de la faute aux dix mille travailleurs qui ont suivi le cadavre d’une autre victime de la police, si Liabeuf a été exécuté ; c’est de leur faute, ils n’auraient pas dû montrer la moindre indignation de la mort de leur camarade- ; et ils auraient dû, au Pont-de-Flandre, se laisser sabrer sans riposter.
Et même, ce n’est pas seulement de leur faute.
C’est de la faute aussi des cheminots dont la grève est menaçante.
C’est de la faute des postiers qui, il y a un an, ont épouvanté la bourgeoisie.
C’est de la faute des quinze mille serruriers qui, en ce moment, se dressent comme un seul homme contre leurs patrons dans un admirable mouvement de solidarité et de révolte.
Liabeuf est le bouc-émissaire, la victime expiatoire.
Il paie pour tout le monde !
Et c’est parce que toute la classe ouvrière le sent plus ou moins confusément, parce qu’elle va se sentir atteinte dans sa chair et au fond de sa conscience que l’exécution de Liabeuf n’est pas seulement un crime, mais une lourde faute politique.
« L’Affaire » Liabeuf sera pour la police ce qu’a été pour l’armée l’affaire Dreyfus.
Ah ! on a voulu faire un exemple pour protéger à l’avenir gardiens et bourriques !
Que l’on prenne garde d’avoir seulement ravivé et décuplé le mépris et la haine séculaire des policiers au cœur de la classe ouvrière, et peut-être même d’avoir rouvert l’ère sanglante des Ravachol, des Vaillant, des Émile Henry et des Caserio !
Le président Carnot ne s’était pas montré plus féroce à l’égard de Vaillant [43] que le président Fallières à l’égard de Liabeuf quand un de nos camarades italiens lui rappela brutalement que le droit de grâce comporte certaines responsabilités personnelles et qu’il y a d’autres couteaux que celui de Deibler [44].
Un Sans-Patrie
[1] Président du conseil (chef du gouvernement) entre 1906 et 1909. Il se surnommait lui-même « -premier flic de France- » [Nde].
[2] Cette remarque est prémonitoire- : trois des plus importants conflits des années 1907-10 se dérouleront justement dans ces secteurs.
[3] Contrairement aux craintes de l’auteur, on a vu que, tout au long du XXème siècle, l’État aura préféré assurer « -la continuité du service public- » par des garanties d’emploi nettement supérieures à celles du privé, ne se conservant la possibilité de la réquisition qu’en dernier ressort.
[4] Depuis les récentes lois de séparation de l’Église et de l’État, les écoles tenues par les congrégations religieuses devaient être agréées par le ministère de l’Intérieur.
[5] En fait, l’arrangement, intervenu en 1911, portera sur une partie du Congo, laissée à l’Allemagne
[6] ahem... mouais... [Nde].
[7] Sénateur de la Seine, directeur du National.
[8] Lancée en mars 1903 comme organe de combat anticlérical et aussi féministe.
[9] Journaliste socialisant, directeur de La Petite République en 1897. Il en partagea la direction avec Jaurès, soutenant le gouvernement Waldeck-Rousseau. En 1903, le tribun s’en fut, indigné que l’on fit de la publicité pour les 100 Paletots, maison qui exploitait particulièrement ses ouvrières. Gérault-Richard sera chassé du journal en 1906.
[10] La première révolution anglaise fut menée sous l’égide de Cromwell à partir de 1638 ; elle fut notamment marquée par la décapitation de Charles Ier en 1649. Une restauration monarchique suivit la mort du Lord Protector, en 1659. Mais, après les menaces de retour au catholicisme qui se manifestèrent sous le règne de Jacques II, un deuxième mouvement, beaucoup moins populaire, et appelé « la Glorieuse Révolution », porta au pouvoir le Stathouder des Pays-Bas, Guillaume d’Orange, en 1689.
[11] Contrairement à ses intentions exprimées quelques paragraphes plus haut, Bruckère parle ici du Parti socialiste tel qu’il devrait être, et non tel qu’il est.
[12] Affiche antimilitariste, qui valut à ses 25 auteurs un séjour à la prison de Clairvaux, et duquel est issu la Guerre sociale (cf. le premier article) [Nde].
[13] Jules Guesde, fondateur du Parti Ouvrier de France. Stalinien avant l’heure, ses positions doctrinaires et autoritaires masquaient mal son fond réformiste. Malgré tout, les guesdistes auront une certaine influence dans la CGT [Nde].
[14] Préfet de police de Paris, cf. l’article « -Le prestige de la fonction- » [Nde].
[15] Oui, bon, d’accord... [Nde].
[16] Ce magistrat, prénommé René et surnommé « le Père-la-pudeur » avait mené une campagne pour la répression accrue des délits de « mœurs ».
[17] Secrétaire générale de la compagnie du Gaz de Paris, hostile aux révolutionnaires, dont il est la bête noire.
[18] Le préfet de police avait en effet un certain courage physique. C’est ainsi qu’en poste en Alger lors des pogroms de 1897, il serait intervenu seul avec quatre agents pour défendre les commerçants juifs.
[19] Un des hommes du Risorgimento italien.
[20] On repérait à cela les bordels, au début du XXème siècle.
[21] Une des putains de la IIIème République, maîtresse de Félix Faure, entre beaucoup d’autres.
[22] Ministre de la Justice en 1905.
[23] Le parent par alliance de Jules Grévy, président de la république de 1879 à 1887, fut néanmoins acquitté en dernière instance, en 1889, au motif qu’il n’avait pas le pouvoir d’accorder des décorations, mais simplement de les promettre.
[24] Anticlérical, minsitre du Travail de 1906 à 1910 [Nde].
[25] Aristide Briand fut d’abord proche du socialisme révolutionnaire (il fut même l’avocat d’Hervé dans une affaire de délit de presse en 1900), avant de devenir ministre dans un gouvernement radical, ce qui lui vaudra le surnom de « -jaune- » et en fera une cible de choix des révolutionnaires [Nde].
[26] Selon Gilles Heuré [Biographiste d’Hervé], 3000 faits de sabotage ont été recensés par la police entre octobre 1910 et juin 1911.
[27] Ce texte fut écrit le lendemain de la manifestation qui suivit l’exécution, à Madrid, du pédagogue libertaire espagnol Fransisco Ferrer. Elle fit plusieurs centaines de blessés — dont le préfet Lépine, atteint par une balle tirée du groupe de la GS, qui lui effleura la joue — et causa la mort d’un policier. Il y eut aussi des pillages.
[28] Anarchistes animant la défense en France de Ferrer.
[29] Après l’émeute du 10 octobre, Hervé renonça à faire monter les enchères et persuada ses amis d’organiser pacifiquement une nouvelle démonstration, qui se déroulera le 17 octobre. La Guerre Sociale reçut alors diverses critiques, dont celles de L’Anarchie qui reprochait à ceux qu’elle nommait des « politiciens de la révolution » de n’avoir pas tenu des « promesses » de représailles contre certaines personnalités bourgeoises. Ulcérés, un groupe de militants, mené par Almereyda et Durupt, organisa une descente dans les locaux du journal rival pour infliger « une correction » à ses rédacteurs.
[30] Bataillon d’Infanterie Légère d’Afrique, où étaient affectés les « délinquants » lors de leur service militaire [Nde].
[31] Victor Méric, un des fondateurs de la Guerre sociale.
[32] Jauressiste, administrateur à l’Humanité.
[33] Député socialiste guesdiste.
[34] Dans un article précédent, Hervé s’était élevé contre l’augmentation de traitement (de 9 000 à 15 000 francs annuels) que les députés, socialistes inclus, venaient de se voter.
[35] Ribot fut l’un des négociateurs de l’alliance franco-russe, premier ministre en 1892-93, puis en 1917, pendant l’offensive Nivelle sur le Chemin des Dames.
[36] Au cours de l’été 1908, une grève d’ouvrier du bâtiment à Draveil et Villeneuve Saint-Georges à été le théâtre d’affrontements sanglants entre grèvistes et forces de l’ordre, (notamment 2 ouvriers tués le 2 juin) [Nde].
[37] Lors de la grève des vignerons de 1907, les soldats du 17ème régiment d’infanterie de ligne refusèrent de tirer sur les grévistes et déclenchèrent une mutinerie. L’épisode est devenu une référence en matière de propagande révolutionnaire, notamment grâce à la chanson de Montheus Gloire au 17ème.
[38] guesdiste, fut secrétaire de la CGT par intérim pendant l’incarcération de Griffuelhes en 1908.
[39] affaire diplomatique entre la France et le Royaume Uni, sur fond de conquête coloniale, dont s’étaient emparés les nationalistes de chaque côté de la Manche pour leur propagande [Nde].
[40] général russe [Nde].
[41] Ok, ok, ça va... [Nde].
[42] Ouvrier anarchiste tabassé à mort par la police au cours d’une manifestation. Son enterrement sera suivi par plusieurs dizaines de milliers de personnes.
[43] Auguste (1861-1894), militant anarchiste, guillotiné après un attentat contre la Chambre des députés qui ne fit que des blessés. Il servit de prétexte au vote des "lois scélérates", attentatoires aux libertés publiques.
[44] La famille Deibler, de père en fils et genres, fournissait la IIIème République en bourreaux.
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (3.5 Mio)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (2.8 Mio)