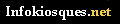Brochures
Entre océans, forêts et volcans. La lutte radicale mapuche
mis en ligne le 27 avril 2025 - Avis de Tempêtes , Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) , Éditions La Souterraine , Groupe autonome révolutionnaire du Maule , Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) , Weichan Auku Mapu (WAM)
Sommaire :
– En guise d’introduction
– Entre océans, forêts et volcans. Un aperçu de la lutte radicale mapuche
– C’est dans le feu du weichan que nous te commémorons, weichafé Toño ! Coordinadora Arauco-Malleco (CAM)
– Communiqué commun après la mort de Pablo Marchant Weichan Auku Mapu (WAM) & Resistencia Mapuche Lafkenche (RML)
– Sur la participation à la convention constituante Comunidades mapuche en resistencia de Malleco
– Sabotage contre l’industrie gravière Groupe autonome révolutionnaire du Maule
– L’État chilien déclare l’état de siège Octobre 2021
– Communiqué de Liberacion Nacional Mapuche Novembre 2021
– Communiqué de Weichan Auku Mapu Novembre 2021
– Attaque incendiaire contre un camion forestier à Penco Décembre 2021
– Communiqué de la Resistencia Mapuche Lafkenche Décembre 2021
– Communiqué de la Coordinadora Arauco-Malleco Décembre 2021
– Chronologie d’actions et de sabotages (2021-2022)

En guise d’introduction
Dans les territoires habités par les communautés mapuche, dont les terres furent accaparées par des investisseurs capitalistes, défigurées par les exploitants forestiers, ravagées par les entreprises énergétiques, polluées par les industriels et colonisées par des suppôts de l’État chilien ; les dernières décennies ont été marquées par une lutte incessante. S’il existe une riche hétérogénéité et diversité parmi les organisations de lutte mapuche et les communautés mapuche en résistance, la lutte dans le Wallmapu se déroule principalement autour de deux axes. D’un côté l’occupation de terres investies par des entreprises capitalistes ou par l’État, afin de les arracher à leur contrôle et de les restituer aux communautés mapuche ; et de l’autre, une pratique constante et diffuse de sabotage, d’action directe et de lutte armée, visant tout ce qui matérialise la domination étatique et capitaliste sur les territoires du Wallmapu qui s’étendent des côtes du Pacifique (au Chili) à celles de l’Atlantique (en Argentine).
Si cette publication n’a ni la prétention, ni l’ambition d’expliquer en détail la cosmovision mapuche, leurs coutumes ancestrales, leur spiritualité, les rapports au sein de leurs communautés, elle vise plus modestement à donner un aperçu de l’ampleur de la lutte qui s’y déroule, principalement à travers les communiqués et des déclarations faites par les organisations de lutte ou les communautés mapuche en résistance. Une chronologie qui ne prétend pas non plus à l’exhaustivité accompagne cet recueil de textes – que nous publions non pas parce que nous y adhérons sans critique, mais parce qu’ils permettent de se faire une idée du panorama et des différentes expressions de la lutte radicale mapuche.
Soulignons donc d’emblée deux grandes lacunes dans cette publication. En premier lieu l’absence d’un approfondissement plus analytique de ce qui là-bas est rassemblé dans le concept de « reconstruction nationale mapuche », à savoir, la reconstruction de leurs communautés, la récupération de leurs savoirs et coutumes ancestraux, la tentative de recentrer leurs rapports sur les valeurs, l’éthique et la spiritualité propres à leur cosmovision. Et en deuxième lieu, le fait que ces textes, comme la chronologie des actions et sabotages, ne permettent peut-être pas de saisir les nombreuses expressions de la conflictualité qui agite le Wallmapu. Ainsi, les actions de blocage, manifestations, affrontements avec la police, les combats lors des expulsions, mais aussi les pratiques plus durables visant par exemple l’autonomie alimentaire par une approche non-productiviste et non-capitaliste de l’agriculture, ou l’abandon du consumérisme de masse en faveur de petites productions artisanales, ou encore les activités culturelles approfondissant la cosmovision mapuche et les rapports sociaux qui en découlent,… constituent une vaste et importante trame de cette lutte virulente, et ne sont possiblement pas assez mis en relief dans ce recueil qui ne couvre qu’un an de lutte (de 2021 à 2022) et qui se focalise surtout sur la lutte d’un seul côté des Andes, celui sous domination de l’État chilien.
A l’heure où ces lignes sont écrites, le Wallmapu se trouve toujours sous état d’urgence. En plus d’importantes forces policières, des troupes militaires sont également déployées afin de mater, ou au moins de freiner, la lutte radicale mapuche en pleine expansion ces dernières années, notamment depuis la vaste révolte sociale qui a secoué le Chili à partir d’octobre 2019. Elle va maintenant devoir faire face à un nouveau président, de gauche cette fois-ci, investi en mars 2022, et dont la mission ne pourra qu’être de désamorcer ces processus insurrectionnels avec une politique de pacification et d’intégration. Ce nouveau président est épaulé par une convention constitutionnelle, instaurée après la révolte de 2019 – 2020 pour réécrire la constitution, laquelle semble indispensable pour essayer de reconstruire un consensus social autour de l’État chilien, secoué par cette formidable révolte dans ses centres urbains et par la lutte acharnée dans les territoires mapuche.
La lutte radicale mapuche nous inspire pour sa continuité, pour son rejet catégorique de toute tutelle étatique, pour son combat acharné contre l’exploitation et la spoliation capitaliste, pour son choix de l’action directe contre l’extractivisme et la dévastation de la terre et du vivant. A l’heure où dans le monde entier, les conséquences de l’avancée folle de la machine industrielle et technologique se ressentent chaque jour un peu plus, où les changements climatiques provoqués par l’industrialisation pourraient bien inaugurer des scénarios inouïs, risquant de reconfigurer drastiquement les assises de la domination, cette lutte dans un coin « perdu » du monde où des habitants et habitantes porteurs de façons de vivre antagonistes avec le capitalisme et l’étatisme se battent pour conserver ou retrouver chaque mètre accaparé et exploité par des entreprises et l’État, pourrait avoir une signification qui dépasse le territoire du Wallmapu. C’est un conflit où la critique anti-industrielle et le refus du développement capitaliste réussit à faire vivre un monde différent, un monde de communautés autonomes qui tentent de vivre dans et avec la nature, et non sur son dos. Certes, ces communautés ne sont pas exemptes de structures hiérarchiques, ni de créer des oppressions en leur sein, et leurs organisations de lutte sont traversées elles aussi par des hiérarchies, des divisions basées sur le genre, des tendances à l’hégémonie ou une méfiance envers d’autres expressions plus libertaires de lutte radicale contre l’État et l’industrialisme. Mais elles n’ont en tout cas pas le culte de la domination étatique, de l’exploitation de la faune et de la flore, d’une folle course en avant vers un monde toujours plus artificiel et vers une vie toujours plus assistée.
En ces temps de militarisation du Wallmapu sous état d’urgence et marqué par l’acharnement irréductible de la part de celles et ceux qui y affrontent les forces de la domination étatique et capitaliste, le tissage de liens de solidarité entre ici et là-bas, entre le combat auquel les weichafé, les combattants et combattantes mapuche, répondent présent et les modestes batailles ici que les anarchistes et d’autres rebelles cherchent à mener contre le cauchemar industriel et le monstre étatique, ne peut être vain. Une solidarité qui ne cherche pas à effacer les différences, qui n’exige de personne de mettre entre parenthèse sa particularité, son exigence, son éthique, mais qui cherche une complicité dans l’action, dans l’attaque directe et sans médiation contre ce qui dévaste la terre et étouffe la liberté.
Premier jour du printemps 2022
Entre océans, forêts et volcans. Un aperçu de la lutte radicale mapuche
Carahue se trouve à 60 kilomètres au
nord de Temuco, capitale de la région
de l’Araucania située au cœur du Wallmapu, « la terre entourée » habitée
par les communautés mapuche et dominée par
l’État chilien. Vendredi 9 juillet 2021 vers 17h, un
groupe de weichafé (« combattants » mapuche) de
l’Organisation de Résistance Territoriale Lafkenche-Letraru, — organismes locaux armés qui font partie de
la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) —, pénètre
sur le domaine Santa Ana-Tres Palos. Le domaine
est exploité par l’entreprise forestière Forestal Mininco, filiale du géant de la cellulose CMPC. Les assaillants menacent le personnel présent, blessent un
employé récalcitrant et mettent le feu à un minibus,
un skidder et un camion-citerne. Les carabiniers affectés à la surveillance du site sonnent alors l’alarme. Lors de leur retraite, les weichafé tombent sur une
de leurs patrouilles, qui ouvre le feu. Un weichafé reçoit une balle en pleine tête et meurt sur place. Le lendemain, la CAM revendique son weichafé mort :
Pablo Marchant, « Toñito », 29 ans, ex-étudiant en anthropologie qui avait rejoint la lutte mapuche cinq ans plus tôt.
Depuis cet énième assassinat dans le Wallmapu, la
région s’est enflammée. Aux dires du gouvernement
chilien, plus de 150 attaques auraient été accomplies en moins de trois semaines. Sabotages des installations de l’agro-industrie, attaques incendiaires
contres des convois de bois, blocages de route avec
des tirs contre les forces de l’ordre, embuscades
contre des patrouilles de carabiniers, incendies de
propriétés de latifundistes et de membres de l’État,
sabotages d’installations énergétiques,… Une partie d’entre elles sont revendiquées par différentes organisations radicales mapuche, qui sortent un
communiqué commun « déclarant la guerre » aux
entreprises exploitant les ressources de la région et
à l’État chilien.
Cette intensification du conflit historique dans le
sud du territoire chilien se passe au moment même
où l’État traverse une période de modification législative avec son projet de nouvelle constitution destinée à calmer les ardeurs insurrectionnelles de la
révolte de l’année 2019-2020, tout en profitant de la
pandémie mondiale pour forcer d’importants pans
de la société à marcher au pas, et semble soudain saper les souhaits de pacification et d’intégration qui animent la classe politique et son nouveau pendant
citoyen issu de la contestation.
Au cœur d’un territoire conflictuel
« [Les indigènes] chiliens ne voulurent se soumettre à aucun roi. Leur âme orgueilleuse et vaillante ne saurait reconnaître aucune domination ni seigneurie. […] Pour cette même raison, non seulement ils résistèrent
à la domination de l’Inca, mais ils n’ont jamais voulu
admettre un roi, ni un gouverneur, ni même une Justice
de leur nation. Ils ont toujours fait prévaloir entre eux
la voix de la liberté et n’acceptèrent aucune sujétion de
leur impatience naturelle. C’est pour cela que chacun
d’eux suit son propre chemin, ou que chaque famille ou
clan suit le sien, choisissant parmi eux le plus digne ou le
plus vieux pour qu’il les gouverne. Les autres l’acceptent
alors, mais sans domination, oppression ou vasselage. »
Voilà ce qu’écrivait le missionnaire jésuite Diego
de Rosales dans son Histoire générale du royaume
du Chili en 1674, rédigée en pleine guerre opposant les mapuche à l’envahisseur espagnol. Devançant la colonisation hispanique, l’empire de l’Inca
avait en effet déjà tenté en vain entre 1479 et 1485 de conquérir ces communautés férocement autonomes au sud-ouest du continent, à cheval entre
ce qui constitue aujourd’hui le territoire des États
argentin et chilien. Dès 1536, une bataille opposa
ainsi près du confluent des rivières Ñuble et Itata
l’expédition royale espagnole menée par Diego de
Almagro à des groupes de mapuche bien organisés,
ce qui inaugura ce que l’historiographie nommera la guerre d’Arauco : un conflit interminable, avec des intensités variées, opposant les communautés
mapuche aux différents envahisseurs et États
jusqu’en 1883, lorsque la résistance s’effondra et que
la région fut finalement occupée de force.
La particularité de la tactique employée par les
combattants mapuche consistait non seulement à
déployer une mobilité qui ne cessa de surprendre l’ennemi, mais aussi à raser systématiquement au sol les villes établies par le colonisateur. Le 11 septembre 1541, ils incendièrent par exemple la ville de Santiago, puis réussirent à détruire entre 1599
et 1604 les sept villes les plus importantes établies par la Couronne espagnole au Chili. Face à l’impossibilité de conquérir les territoires mapuche, cette
dernière décida alors d’ouvrir des négociations qui
menèrent à une série de traités qui ne furent respectés qu’occasionnellement par les deux côtés, en alternant avec des épisodes d’affrontements. Cette
hostilité permanente, l’absence ou le rejet d’institutions capables d’instaurer un ordre « intérieur » sur l’ensemble des communautés mapuche comme
d’engager des accords « extérieurs » avec l’État
colonisateur, une géographie spécifique moins favorable à la croissance d’un pouvoir centralisateur, permirent aux communautés mapuche de préserver
une autonomie vivante pendant de longs siècles.
En 1818, la République du Chili déclare finalement son indépendance au bout d’une longue
guerre contre les armées de la métropole, et maintient pendant quelques décennies ces mêmes rapports ambivalents avec les communautés du sud de
son territoire. Puis, en 1861, le nouvel État chilien
donne au colonel Saavedra le commandement
d’une expédition visant à pacifier définivement ces
territoires lors d’une énième révolte de mapuche,
inquiets face à l’augmentation du nombre de colonisateurs venus s’emparer des terres par la ruse ou la violence. Cette mise au pas sera menée par un corps
militaire sanguinaire qui réussira, au bout de vingt-deux ans de campagne, à briser la résistance ma-
puche et à détruire l’autonomie des communautés.
Ce volet militaire allait bien entendu de pair avec
un aménagement des territoires, l’octroi de vastes
terres à des colons chiliens et européens, l’extension
urbaine, puis la construction d’infrastructures routières afin de faciliter l’exploitation des ressources agricoles et forestières. De son côté, l’État argentin lança à son tour une campagne similaire afin de conquérir les territoires du sud de son côté des
Andes. Nommée « conquête du désert », elle commença en 1878 pour se conclure en 1885. Comme au Chili, elle s’apparenta à un véritable génocide :
de nombreuses communautés indigènes (mapuche
mais pas que) furent exterminées, et leurs survivants dispersés ou soumis. Du côté chilien, certains chiffres parlent ainsi d’une population d’un demi-million de mapuche réduite à quelques dizaines de milliers lors de cette « pacification ».
Malgré cet immense traumatisme, les territoires mapuche continuèrent régulièrement à être le théâtre de révoltes et de soulèvements. En 1934 par exemple, des paysans mapuche de Lonquimay se révoltèrent en formant des bandes insurrectionnelles armées qui marchèrent sur Temuco, la capitale de l’Araucanie. Le gouvernement envoya alors un régiment entier, soutenu par des mercenaires de communautés vendues au winka (« usurpateur ») afin d’écraser les insurgés. Encerclés sur le domaine de Ránquil par les forces gouvernementales, près de 500 d’entre eux furent
massacrés et des centaines d’autres faits prisonniers. Cette histoire de révoltes et de soulèvements tisse jusqu’à nos jours une riche trame de résistances dans
laquelle celles d’aujourd’hui continuent de puiser
inspiration et orgueil. On pourrait même dire qu’une
partie de l’identité « mapuche » contemporaine — qui est elle-même déjà un dépassement abstrait, voire politique (dans le cadre du projet de lutte de libération
nationale), de la diversité et de la non-homogénéité des différentes communautés et individus, acceptée seulement assez récemment —, repose sur cette mémoire de révolte permanente qui a commencé contre les invasions des armées de l’Inca et court
jusqu’aux hostilités actuelles contre les entreprises extractivistes et l’État chilien.
De la dictature de Pinochet au régime démocratique
Au cours de la période d’agitation sociale qui a précédé le putsch militaire de Pinochet de 1973 contre le régime d’Allende, différentes organisations
de la gauche révolutionnaire se mirent en contact
avec les terres du sud, et notamment au sein de quelques communautés mapuche survivant à l’écart. Ces organisations portaient un discours assez classique de répartition des terres en faveur des communautés très
appauvries, faisant fi de toutes les différences les caractérisant afin
de mieux les assimiler à la catégorie de « prolétariat agricole ». Sur place, de nombreux mapuche avaient d’ailleurs déjà quitté des terres devenues trop réduites pour
subvenir à leurs besoins, en allant grossir les rangs du prolétariat urbain des grandes villes chiliennes.
De façon générale, si le régime social-démocrate
d’Allende procéda effectivement à quelques répartitions de terres sous l’égide de l’Etat, y compris en faveur des communautés mapuche, la dictature de
Pinochet prit à l’inverse l’habitude d’offrir d’immenses domaines aux fidèles serviteurs du régime, en piétinant leurs éventuels habitants (quels qu’ils soient). D’autres amis du régime, comme des officiers français, des anciens nazis allemands réfugiés
en Amérique-Latine, des chefs d’entreprises internationaux, de hauts responsables ecclésiastiques, etc. reçurent également des terres pour services rendus. Avec les agro-exploitants, tous allaient vite former
cette couche dirigeante particulièrement odieuse
du sud du Chili, dont le mépris, voire la haine, pour
les mapuche et les pauvres en général est resté un de leurs signes distinctifs jusqu’à aujourd’hui, malgré les quelques couches de « démocratisme » et
de « droits des peuples indigènes » qui se sont rajoutées par la suite.
A partir des années 1980, de nombreux investissements internationaux ont commencé à confluer vers
le Chili dans le cadre d’une course toujours plus frénétique pour exploiter les matières premières. Déjà premier exportateur mondial du cuivre, ce pays va
ainsi accueillir de grosses multinationales attirées
par les conditions néolibérales particulièrement favorables à l’exploitation des ressources. Au sud du
Chili, c’est surtout l’industrie forestière qui s’étend, tandis qu’on assiste du côté argentin à une ruée sur les minerais des Andes. Avec la transition chilienne
vers un régime démocratique qui s’amorça à la fin
des années 1980, l’exploitation de ces ressources ne va
pas baisser, mais bien au contraire s’accélérer : de
vastes plans de constructions de barrages pour faire
tourner les turbines de centrales hydroélectriques
furent lancés et réalisés, poussant même le vice
jusqu’à la construction de centaines de « mini-centrales » disséminées un peu partout sur le territoire. De son côté, l’industrie forestière continua de ravager les terres en plantant de vastes monocultures de pins et d’eucalyptus, asséchant les terres, pompant
l’eau des nappes phréatiques en engendrant de véritables « déserts » dépourvus de diversité végétale. Le Chili se transforma aussi au fil du temps en un
des plus grands exportateurs mondiaux de graines
de plantes génétiquement modifiées.
Du côté mapuche, la transition démocratique de
l’État chilien fera adopter en 1993 une « Loi Indigène » visant à réancrer les différentes communautés au sein des institutions, tout en les rendant plus
dépendantes encore de l’économie nationale.
Cette loi s’inscrivait ainsi classiquement dans la
perspective de l’idéologie du développement et
du progrès, saupoudrée d’une volonté de leur
faire bénéficier des bienfaits sociaux de la société
moderne capitaliste. Elle prévoyait également
une représentation légale des mapuche au niveau
national comme international, ce qui engendra
bien entendu toute une bureaucratie locale récitant
la chanson des « droits des peuples indigènes » à
l’intérieur de l’État, afin de mieux s’opposer à toute lutte radicale.
A partir des années 1990, des organisations politiques mapuche en phase avec les partis politiques de gôche resurgis sur le devant de la scène, multiplient alors d’un côté les interpellations politiques, et d’un autre les « occupations symboliques » de
terres traditionnelles. Plutôt que de véritables actions directes, il s’agissait au fond d’actions visant à exercer une pression afin d’obtenir des résultats
plus favorables lors des négociations avec l’Etat, soit
une sorte de syndicalisme indigène. Ce mécanisme
va engendrer petit à petit au sein des communautés
mapuche toute une couche de politiciens plus ou
moins clientélistes, de bureaucrates entremetteurs,
de fins connaisseurs des manœuvres para-étatiques pour se remplir ses poches, etc. : soit toute une gangrène politique qui ronge parfois jusqu’à aujourd’hui les communautés et la lutte.
Le projet de libération nationale mapuche et la naissance de la CAM
Vers le milieu des années 1990, à côté de ces actions
de récupérations symboliques de terres axées sur la
négociation, d’autres commencent aussi à se produire en empruntant plus franchement le caractère de l’action directe, comme celles récupérées par
les communautés Juana Millahuel et Pascal Coña,
au sein desquelles différents groupes de lutte vont
émerger. Ce type d’expériences servirent ainsi clairement d’entraînement au combat pour les futurs weichafé. Dans ce contexte plus agité, certains mi-
litants d’organisations de lutte armée [1] qui avaient combattu contre la dictature et continué lors de la transition, reviennent ou s’installent dans les terres mapuche. Ils participeront à élaborer un projet de « libération nationale mapuche », qui sera l’axe central de l’organisation la plus connue : la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco (CAM).
Le 1er décembre 1997, trois camions appartenant à une entreprise forestière sont
incendiés sur un domaine à Lumaco. Cette action marqua une telle rupture avec les pratiques jusque-là employées au sein des communautés mapuche en lutte, que leurs organisations politiques pensèrent qu’il s’agissait plutôt d’une action accomplie par un groupe de lutte armée non-mapuche. Ce fut pourtant à travers cette attaque que la CAM se
fit connaître publiquement, et illustra, dans les faits, son projet. Elle affirma l’abandon de toute voie d’intégration institutionnelle en préconisant l’emploi de la « violence politique » pour conquérir et défendre l’autonomie des communautés mapuche.
Il faut préciser ici que dès le départ, le projet de
« libération nationale mapuche » exprimé par la
CAM ne consista nullement en la construction d’un
État mapuche, ni à une représentation institutionnelle centralisatrice de toutes les communautés. Il consiste plutôt à reconstruire une « nation mapuche », entendue comme un tissu culturel et social commun entre les différentes communautés, à retrouver une cosmovision liée à des coutumes sociétales et spirituelles constitutives d’un rapport spécifique (non-productiviste et non-objectiviste) avec la faune et la flore, à préserver la langue mapuche (le mapudungun) et les mondes qu’elle exprime, ainsi qu’à l’autonomie complète des communautés mapuche face à toute tutelle. A l’image de ce premier
sabotage incendiaire à Lumaco, le projet de la CAM se veut radicalement anti-capitaliste et anti-développement (contre l’extension de l’agro-industrie, des infrastructures énergétiques industrielles, les mines, etc.) et préconise un autre rapport à la propriété (plus communautaire) que celui capitaliste.
Cependant, il faut également insister sur le fait
que cette autonomie n’est pas synonyme d’absence
de toute autorité (communautaire, familiale ou religieuse), et que les expériences communautaires mapuche ne sont en ce sens pas une « version indigène » de l’autogestion libertaire, et ne prétendent de toute façon pas l’être. Même s’il s’agit de formes
sociétales qui ne préconisent pas la conquête
d’autres communautés, qui n’aspirent pas à établir
une domination sur d’autres, qui entretiennent
un rapport différent avec la nature, qui ne visent
pas une croissance matérielle illimitée mais plutôt
une « autarcie durable », cela n’empêche pas que,
comme dans toute structure sociétale, les individus
qui ne rentrent pas dans certains cadres ou qui ne
sauraient accepter certaines formes de hiérarchie
sociale s’y trouvent en conflit. Mais peut-être faudrait-il là, et sans jamais cautionner ni relativiser des oppressions, s’interroger sur le fait que la liberté telle que nous la désirons comme fondement et seule référence dans l’agir des êtres humains, n’implique pas aussi de changer un imaginaire peut-être trop universaliste vers un imaginaire plus ouvert à la
diversité (fondée non pas sur la coercition et la domination, mais sur l’autonomie et la liberté). Bref, il s’agit d’un vaste débat, mais ce qu’on veut souligner
ici, est qu’il est peut-être possible de concevoir la
lutte contre l’État et le capital telle qu’elle est menée
aujourd’hui au Wallmapu comme une expression
réelle et indéniable de la liberté, même si elle n’est
d’évidence pas une expression de l’anarchie et se
trouve égaalement traversée par des déterminismes
politiques empruntés au gauchisme, à un leaderisme qui nuit à l’autonomie ou à des logiques d’alliances politiques, etc.
Pour en revenir au projet de « libération
nationale mapuche », la CAM l’a principalement construit autour de la conquête et
de la défense de l’autonomie des communautés ainsi du dit « contrôle territorial ».
C’est-à-dire non seulement en limitant et en contrant l’influence et l’ingérence de l’État chilien et ses institutions, ou celles de l’économie capitaliste et ses entreprises au sein des communautés, mais aussi en développant des structures autonomes alternatives (pour la santé, l’éducation, la résolution de conflits,…) et en soutenant tout type d’activité culturelle qui approfondit et reconquiert la cosmovision mapuche. Tout cela incluant en même temps un conflit direct contre tout ce qui fait obstacle à cette autonomie, soit une lutte violente et sans médiation contre les entreprises forestières et agro-industrielles, les entreprises énergétiques, les latifundistes, etc. Au niveau tactique, cela a donné d’un côté de longues séries d’attaques incendiaires contre les installations des entreprises forestières, agro-industrielles et énergétiques, et en même temps des occupations de terres.
A partir de 2002, face à l’escalade d’actions directes menées par des groupes proches de la CAM, mais aussi par toujours plus de communautés mapuche qui se sont déclarées « communautés en conflit », l’État chilien déclenche une vaste campagne contre-insurrectionnelle pour y répondre, nommée « Paciencia ». C’est dans ce cadre qu’un
sympathisant de la CAM, Alex Lemún (17 ans), sera
assassiné par des carabiniers lors d’une récupération
de terres au détriment de l’entreprise forestière Mininco en novembre 2002 à Ercilla. Cet assassinat est suivi d’une opération répressive au cours de laquelle
une dizaine de cadres de la CAM sont arrêtés et accusés sous la loi anti-terroriste. Les territoires mapuche sont alors militarisés avec une augmentation de la
présence de forces policières et paramilitaires comme
le « Commando Hernán Trizano », qui commence à
lancer une « guerre sale » à coups de séquestrations
et d’assassinats. Les expulsions de terres occupées
s’intensifient, et de plus en plus de comuneros mapuche (habitants des communautés) font l’objet de procédures judiciaires, d’arrestations et d’incarcérations. Dans un même mouvement, selon la technique de la carotte et du bâton, l’État chilien tente de séduire certaines communautés avec des projets d’intégration et de soutien, des plans sociaux, des projets de développement et d’investissements par des entreprises privées, ainsi que des négociations autour de terres disputées en échange d’un renoncement à la
violence et à la résistance. Afin d’isoler les « intransigeants » et les communautés en lutte, l’État instaure également des « zones rouges » dans lesquelles l’accès est régulé voire interdit (pour les non-habitants), en faisant l’objet d’une surveillance militarisée.
A cette période, et pas plus qu’aujourd’hui, bien que porteuse d’un projet se voulant fédérateur, la CAM n’était pas la seule expression de la lutte mapuche. Il existait déjà une vaste hétérogénéité non seulement au niveau général de la lutte (avec des
« communautés en conflit » côtoyant d’autres
penchant vers un peu plus d’institutionnalisation,
ou certaines organisations politiques mapuche prônant plutôt l’inclusion culturelle et professant des discours victimistes, etc.), mais également au sein
même des secteurs les plus radicaux. Cela a donné
à maintes reprises des conflits, des distanciations
et des scissions entre la CAM et certaines communautés ou autres groupes, concernant autant les tactiques de lutte que les contenus du projet de résistance mapuche. Il faut dire qu’avec la distance et avec des situations qui sont souvent très liées à des
enjeux locaux précis, à l’intérieur d’un mouvement
de lutte prônant lui-même l’hétérogénéité et l’autonomie comme des valeurs éthiques pour rejeter régulièrement les tendances plus centralisatrices
(la CAM en a aussi fait les frais lorsqu’elle tendait
vers une centralisation de la résistance), il nous est
ici impossible d’esquisser un tableau complet des divergences et des débats qui ont traversé et traversent les expressions radicales de la lutte. Des divergences
qui, à notre avis, ne sont pas des points de faiblesse,
mais souvent des signes d’une vitalité tendant vers
plus d’autonomie.
La radicalisation du conflit à partir de l’année 2008
En quelques années, cette militarisation a poussé une partie des communautés à se déclarer « en conflit » de gré ou de force, augmentant par là-même le nombre de foyers de lutte et les actions de sabotage. Pour faire face à une répression anti-terroriste ciblée contre les groupes de sabotages, mise au point par les forces policières conjointement avec
les services de renseignements chiliens, de nombreux comuneros ont aussi peu à peu été contraints à la clandestinité, et la CAM elle-même a dû s’y résigner, ce qui a impliqué selon ses propres dires, de considérables revers opérationnels [2]. Elle mettra alors plusieurs années pour réadapter son organisation aux conditions d’une clandestinité assez rigoureuse.
Le 3 janvier 2008, la communauté en conflit
Lleupeco de Vilcún, va occuper des terres du do-
maine Santa Margarita, propriété de Jorge Luchsinger. Comme à de nombreuses autres occasions, des weichafé de la CAM se joignent alors aux comuneros
et comuneras afin de mener ensemble l’action à bien. Vu qu’il s’agissait de terres traditionnelles revendiquées, ce domaine était placé depuis quelques temps
sous protection policière, et c’est lors de l’occupation
qu’un carabinier tua le weichafé Matías Catrileo. Né
dans une famille de la classe moyenne (avec un père
d’origine mapuche), Catrileo s’approcha des cercles
anarchistes de la capitale, puis décida de rejoindre
la lutte dans le sud du pays au sein de la CAM. Suite
à son assassinat, les incendies de terrains exploités
par les entreprises forestières se multiplièrent, tout
comme les attaques contre leurs engins. Dans les villes mêmes, des manifestations tournèrent également en affrontements très violents. A Santiago et
ailleurs, de nombreuses attaques incendiaires et explosives contre des cibles étatiques et capitalistes, revendiquées par des anarchistes, des mapuche ou des
anticapitalistes autonomes, firent allusion à la mort
du weichafé dont le parcours soulignait l’intensification des échanges entre anarchistes, anticapitalistes autonomes et mapuche [3]. Dans la capitale, un inconnu tira aussi contre un ingénieur-gérant responsable d’un barrage hydro-électrique dans le Wallmapu, alors qu’il
sortait de chez lui : tant au sud que dans les villes chiliennes, le
conflit mapuche allait clairement vers une extension. Quelques mois après l’assassinat de Matías Catrileo, c’est dans le quartier périphérique de Pudahuel à Santiago
qu’un second anarchiste mapuche, Johnny Cariqueo Yañez, mourut, cette fois suite à un tabassage par la police, ce qui donna à nouveau lieu à de nombreuses
attaques vengeresses dans la capitale et ailleurs.
Au sein de la CAM, la mort de Catrileo et
l’extension du conflit qui s’en suivit générèrent de
vastes débats sur la viabilité des tactiques préconisées jusque-là, finissant toujours principalement par tourner autour de la question de « l’action de masse », c’est-à-dire les récupérations de terres soutenues par des actions de sabotage. Ces occupations « de masse » exposaient par exemple les participants à une féroce répression, qui pourrait devenir plus mortelle avec la hausse du conflit en cours. Face
aux réactions toujours plus armées des propriétaires
et des carabiniers, il n’existait de même ni préparation, ni l’armement nécessaire au sein des communautés pour y répondre de façon massive. C’est alors
que tout en continuant ces « actions de masse », la
CAM opta pour la création de groupes spécifiques,
nommés Órganos de Resistencia Territorial (ORT).
Dédiés à la préparation physique, mentale et militaire des weichafé afin de devenir en quelque sorte les noyaux d’une guérilla armée, les ORT furent
d’emblée conçus comme des entités autonomes
au niveau logistique et de prise d’initiative, tout en
étant bien entendu liés au projet général de la CAM.
Cette autonomie et compartimentation devait aussi offrir une protection supplémentaire contre le renseignement et la répression. On peut également
souligner que les ORT et les autres groupes disposaient généralement d’un armement assez rudimentaire, consistant principalement en fusils de chasse
et pistolets, voire en carabines artisanales, et que ce
n’est que très récemment que des fusils d’assaut ont
fait leur apparition lors des sabotages. De même, il
n’y a eu que peu d’actions avec emploi d’explosifs,
et celles-ci datent de ces dernières années et vise
principalement des infrastructures énergétiques ou
de télécommunication.
Á partir de 2009, les ORT de la CAM furent
à même d’augmenter le nombre et la qualité des
attaques contre les structures des entreprises
forestières et hydro-électriques, ainsi que contre
les domiciles et propriétés des latifundistes situés
sur les territoires disputés par les communautés.
La continuité de leurs actions, combinée avec un
processus de « contrôle territorial » exercé par
les communautés en conflit qui occupaient les
terres de façon plus durable (en y construisant des
habitations, en y organisant agriculture ou élevage,
etc.), commença à déstabiliser sérieusement les
structures de la domination étatique et capitaliste
dans plusieurs zones du Wallmapu.
Face à cette offensive, la réponse étatique ne se
fit une nouvelle fois pas attendre, avec cette fois
des escadrons militarisés faisant des descentes dans des communautés en conflit, non seulement dans les zones d’Arauco et de Malleco mais aussi à Ercilla, Collipulli, Vilcún et dans les environs de Temuco, afin de « démanteler les écoles de guérilla » et les « foyers du terrorisme rural ». Vers la fin de 2009, 80% des cadres
de la CAM se retrouvèrent ainsi
derrière les barreaux, et une partie de la lutte allait désormais se concentrer sur la libération des « prisonniers politiques mapuche », tandis que la répression incessante ne cessait de
provoquer de vastes débats au sein de
la lutte mapuche, ainsi qu’à l’intérieur
de la CAM même. D’âpres conflits éclatèrent, des prises de distance se succédèrent et des scissions se produisirent.
Scissions et autonomies de lutte
En 2010, l’État chilien proposa finalement un « espace de dialogue », auquel il convia l’ensemble des organisations politiques mapuche, y compris la CAM. Le but recherché était clairement de mettre fin aux hostilités en échange de miettes, comme l’octroi d’une autonomie locale très relative. Fort affaiblis, une partie des cadres de la
CAM commencèrent alors à ouvrir la possibilité
d’une négociation avec le gouvernement. Cette
ouverture au dialogue avec l’ennemi au sein de
la CAM donna lieu à de nouvelles importantes
scissions. Opposés à une telle ouverture, des
récalcitrants créèrent en 2010 le Weichán Auka
Mapu (« Lutte du territoire rebelle », WAM),
une organisation de guérilla mapuche qui déploie
jusqu’à aujourd’hui une capacité tentaculaire de frappe visant de nombreuses expressions de la domination (y compris des attaques contre des églises, des temples protestants et des écoles, pratiques que la CAM ne manqua pas de qualifier de « contre-productives »). Contrairement à la CAM qui se conçoit comme une coordination
de groupes organiques, la WAM se voit plutôt
comme une « alliance » de différents groupes,
et il existerait ainsi une influence anarchiste
grandissante en son sein, grâce à la présence de
compagnons et compagnonnes libertaires au sein de ses groupes d’action.
En 2011, une autre organisation vit le jour, nommée Resistencia Mapuche Malleco (RMM), exclusivement dédiée à la lutte armée, mais qui ne semble pas avoir de structure organique définie. L’organisation s’est fait connaître en abattant des pylônes à haute-tension à l’aide de scies électriques, une pratique « nouvelle » au sein de la lutte au Wallmapu. Enfin, de l’autre côté de la cordillère des Andes, sur le territoire dominé par l’État argentin, naquit l’organisation Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), plus proche du projet de la CAM.
En 2013, pour commémorer le cinquième anniversaire
de l’assassinat de Catrileo, une attaque fut menée
par un groupe de weichafé contre la villa du couple de
propriétaires Luchsinger-Mackay (la famille latifundiste Luchsinger a une longue histoire d’usurpation des terres mapuche). A leur arrivée, Luchsinger sort
immédiatement de la maison et ouvre le tir. Les assaillants le repoussent puis mettent le feu à la maison, où le couple mourra dans l’incendie. Si cette attaque
ne fut revendiquée par aucune organisation existante,
elle marqua clairement un pas supplémentaire dans
les hostilités. Au cours de ces années-là, d’autres « types » d’actions moins habituelles commencèrent également à se répandre sous impulsion de différentes
ORT, de différentes organisations (WAM et RMM)
et d’autres groupes radicaux mapuche plus éphémères ou moins structurés. Il s’agit notamment d’attaques armées contre les carabiniers, d’embuscades
de convois de bois et leur destruction incendiaire,
d’attaques contre des domiciles de latifundistes ou
d’exploitants, d’incendies d’églises, d’écoles ou de mairies, ainsi que de sabotages contre des infrastructures énergétiques comme les pylônes ou de télécommunications comme les antennes-relais de la zone. Cela n’empêcha pas que les attaques contre les engins
des entreprises forestières continuent, dont beaucoup ne furent pas revendiquées spécifiquement, où les assaillants se contentèrent souvent de laisser une simple
banderole ou des tracts sur place avec quelques slogans. De temps en temps, des organisations comme la CAM ou le WAM révendiquèrent par voie d’un
communiqué unique l’ensemble des actions réalisées
par leurs groupes au cours d’une certaine période. Il
faut aussi souligner que d’autres actions, notamment
des blocages de route, mais aussi des rassemblements
et des manifestations, se succédèrent presque quotidiennement dans certaines parties du Wallmapu lors des périodes plus « chaudes ».
Si les ORT continuèrent à fleurir et à organiser un
harcèlement permanent des entreprises capitalistes,
la CAM se concentra donc pendant ces années-là
sur la question des prisonniers politiques mapuche,
et perdit en influence en faveur d’autres groupes
radicaux mapuche, notamment à cause de sa prise
de distance contre certaines pratiques (comme les incendies d’églises ou les attaques contre des personnes) et suite à des conflits avec certaines communautés en lutte.
Ce n’est qu’en janvier 2017 que la CAM recommença à revendiquer une attaque incendiaire contre des camions d’entreprises forestières, suivie d’une
seconde quelques mois plus tard contre un convoi
de l’entreprise Trans-Cavalieri lors de laquelle 19 camions et 9 rampes pour bois furent détruits sur la route entre Temuco et Lautaro. Au cours de cette
année 2017, c’est cependant la WAM qui fit preuve
d’une plus grande vitalité et revendiqua plusieurs attaques et embuscades. En septembre, l’État chilien déclencha de son côté l’opération répressive baptisée « Huracán », conduisant à l’arrestation de huit personnes très connues de la résistance mapuche. Le
procès finit par tomber à l’eau, et fut dénoncé comme
un montage typique concocté par les services de
renseignement chiliens. Du côté argentin, l’année
fut marquée par l’assassinat de l’anarchiste Santiago
Maldonado en août. Ce compagnon participait
aux blocages de route que menait la communauté
mapuche en lutte Pu Lof de Cushamen, lorsqu’il fut
enlevé par des policiers, puis assassiné. Son cadavre
ne fut retrouvé qu’en octobre, près de l’endroit d’où
il avait été enlevé. Sa disparition et sa mort donna
lieu à d’importantes mobilisations (dont une bonne
partie puisait aux sources du victimisme et du droit-de-l’hommisme pour dénoncer « un abus » tout en taisant que Santiago était un compagnon anarchiste) et affrontements.
D’une autre tentative de pacification à la révolte de 2019
Quelques mois après son investiture en 2018, le nouveau président du Chili, Sebastían Piñera, présenta le « Plan Impulso Araucanía », le troisième
projet gouvernemental en moins de dix ans pour
tenter de pacifier les terres mapuche. Il convia
à la table de négociations les représentants des
organisations sociales et politiques mapuche, à
l’exclusion de radicaux comme la CAM. Alors que
des négociations étaient entamées à Santiago avec
les interlocuteurs raisonnables de la lutte, un nouvel
escadron de carabiniers fut déployé dans le sud.
Ayant reçu des entraînements en tactiques de contre-guérilla en Colombie, cet escadron que les mapuche vont vite nommer « comando Jungla » à l’instar de
son confrère colombien, représenta une escalade de
plus dans la militarisation des zones mapuche. Si les
différents gouvernements chiliens ont toujours nié
avoir déployé l’armée en zone mapuche contre des
civils, ils y ont par contre militarisé à outrance le
corps des carabiniers, menant là une sorte de guerre
larvée qui ne dit pas son nom afin de ne pas trop
heurter les éventuelles sensibilités internationales,
et surtout ne pas effrayer les investisseurs.
Le 14 novembre 2018, c’est le comunero Camilo
Catrillanca, actif au sein de sa communauté dans la
résistance mapuche, qui est assassiné à Temucuicui
d’une balle dans la nuque par ce commando Jungla. La situation monte vite d’un cran en réaction : d’énormes manifestations de mapuche et de personnes solidaires virent à l’émeute à Santiago et dans d’autres villes chiliennes. Dans la seule capitale, on
dénombre pas moins d’une centaine de barrages de
route. Sur les terres mapuche, les groupes radicaux
multiplient attaques et sabotages. Mais cette fois-ci, nombre d’actions incendiaires sont également entreprises « en dehors » des principales organisations de lutte, ce qui est aussi un résultat de l’autonomie grandissante des ORT au sein de la CAM,
comme de la multiplication des différents groupes
et mini-organisations au sein des communautés en lutte. La rage incendiaire vise tout ce qui représente l’État chilien et l’investissement capitaliste, y compris des centres communautaires, des écoles, des résidences secondaires, des filiales bancaires,… En
ville, des attaques incendiaires et explosives, revendiquées par des anarchistes en solidarité avec la résistance mapuche, ciblent des institutions étatiques et capitalistes.
Alors que le conflit au Wallmapu est rythmé par
une continuité persistante de sabotages et d’attaques, en octobre 2019 la situation sociale explose à travers tout le Chili, donnant lieu à une révolte
incontrôlable qui durera plusieurs mois [4]. Dans les zones mapuche, la révolte qui secoue les villes
chiliennes se répand également, avec des occupations, manifestations et affrontements dans tous les principaux centres urbains du Wallmapu. Cependant, il faut quelques semaines encore avant que les groupes de lutte mapuche décident à leur tour de se
lancer dans la bataille, multipliant une fois de plus les attaques. Plusieurs d’entre elles furent d’ailleurs accomplies à l’explosif contre des infrastructures, comme l’attaque à Contulmo contre un pylône à haute-tension.
Entre intégration et résistance radicale
Juillet 2020. En plein état d’urgence sanitaire, le
parlement chilien approuve une résolution visant
à « augmenter la présence des forces de l’ordre et de
sécurité [en Araucania] afin de freiner les actes terroristes et de désarticuler les bandes criminelles derrière ces actes, vu que les efforts actuels ne sont pas suffisants et n’ont pas donné de bons résultats ». Ce vote intervient dans un contexte de militarisation des
territoires mapuche, notamment après la mort d’un
camionneur en février 2020, lorsque que des weichafé mirent le feu à son camion près de la commune de Victoria. En même temps, le gouvernement compte
ainsi répondre à l’agitation croissante qui accom-
pagne la grève de la faim du machi [guérisseur]
Celestino Córdova, en grève avec sept autres prisonniers mapuche contre sa condamnation dans le procès pour le meurtre du couple Luchsinger-Mackay de 2013. Pour les soutenir, des manifestants mapuche occupent des mairies, les attaques contre les
entreprises forestières se multiplient, les actions de sabotage et les embuscades des ORT et de la WAM s’étendent à travers une bonne partie des zones
mapuche. Un nouveau groupe, nommé Resistencia
Mapuche Lafkenche (RML), réalise également des
actions de guérilla plus complexes, comme la tentative de sabotage du pont autoroutier stratégique de Lleu Lleu (interruption de la circulation par des
combattants armés, puis explosion d’une voiture
bourrée d’explosif), des fusillades avec les forces
spéciales des carabiniers ou la destruction à l’explosif d’antennes-relais et d’émetteurs. Fin juillet, quelques jours après le vote, le déraillement d’un
train de marchandises, marqua encore un pas dans la
lutte : les saboteurs avaient coupé un rail puis enlevé
les traverses, et auraient également tiré sur le train.
L’annonce du gouvernement de l’envoi de troupes
supplémentaires jetta de l’huile sur le feu d’une situation déjà très tendue, notamment à cause des différents états de siège et d’urgence promulgués par le gouvernement au prétexte de la pandémie. La puissante organisation patronale du transport routier organisa à cette occasion des grèves contre l’insécurité dans le sud, puis conclut en septembre 2020 un accord visant à renforcer la protection des convois de camions. En octobre 2020, eut lieu le référendum national plusieurs fois repoussé sur l’instauration ou
non d’une nouvelle Constitution, présentée comme
l’issue politique de la révolte de 2019-2020. Cette
question référendaire divisa également le conflit
mapuche, toujours tiraillé entre rupture définitive
et radicale avec l’État et intégration- inclusion en
son sein en tant que « peuple indigène » doté de
garanties et droits supplémentaires. Cependant, les
semaines avant et après le référendum n’en restèrent
pas moins intenses, avec un nombre grandissant
d’irruptions de weichafé armés dans les domaines
forestiers pour y brûler engins et camions, d’embuscades tendues aux camions le long des routes, ainsi que de tirs contre les carabiniers.
« On peut récupérer plusieurs apprentissages pour nous-mêmes en regardant la continuelle lutte radicale mapuche, des éléments que nous pouvons sans doute insérer dans la lutte insurrectionnelle contre toute autorité. Son rythme de guerre est déjà un exemple à suivre, intensifiant et diversifiant le combat, d’un côté contre la dépossession séculaire et de l’autre en réponse aux coups répressifs. »
Contra Toda Autoridad, n°4, mars 2017.
Puis, début 2021, l’État chilien annonça finalement la tenue d’élections pour le congrès chargé de rédiger la nouvelle Constitution, prévues en
mai. Une partie des représentants politiques mapuche s’étant déjà déclarés favorables à une nouvelle Constitution, ils se préparèrent alors à participer au processus en espérant y arracher une plus grande place. Du côté des communautés en lutte et
des organisations radicales, le rejet de ce processus
constituant resta par contre ferme, arguant que ce
dernier ne pouvait que mener à l’intégration plutôt
qu’à l’autonomie, et qu’il ne changerait rien à la dévastation en cours des terres du sud. C’est une des explications de ce que le président Piñera allait qualifier à partir de février 2021 de « vague irrationnelle de violence », avec la multiplication d’incursions
armées dans les domaines forestiers pendant que
les résidences secondaires de notables locaux et
non-locaux étaient systématiquement attaquées et
brûlées (pendant l’été chilien de 2020-2021, plus de cinquante résidences et chalets de vacances furent brûlés).
Dès le 10 février 2021, lors de sept
attaques incendiaires en quelques
heures sur les routes de Cañete,
Contulmo et Tirúa, des weichafé interceptent et brûlent 12 camions des entreprises forestières et 4 fourgons, non sans détruire une sous-station électrique, ce qui provoqua des coupures de courant dans la zone. Lors des interventions au bord des routes et sur
les domaines, des weichafé font de plus en plus usage
d’armes à feu. Plusieurs carabiniers et gardes sont
blessés, mais également des ouvriers qui tentent de
défendre les outils de l’exploitation forestière, ou
des latifundistes qui essayent de chasser les weichafé à coups de fusil.
Le 6 mai 2021, à moins d’une semaine des élections pour le congrès constitutionnel, huit attaques incendiaires sont de la même façon menées en moins
de 6 heures, de midi à 18h, contre 26 engins de tout
type (camions de transport, camionnettes, porteurs,
skidders) de l’industrie forestière, sur la route P90
qui mène de Lumaco à Tirúa, sur les domaines de
Los Laureles, le chemin vers Rilún, à Rilún même et
à Pichi Pellahuén, exploités par l’entreprise CMPC.
Au milieu des cris d’orfraie de différents larbins de
l’Etat qui demandent au choix de réinstaurer l’état de
siège dans le coin ou de faire intervenir l’armée pour
protéger les exploitants forestiers — notamment
parce qu’un carabinier venu stopper les attaques s’est
pris un tir dans son gilet pare-balles —, cette attaque
d’ampleur de Weichán Auka Mapu (WAM) est sans
aucune ambiguité : « Liberté pour les prisonniers politiques mapuche et ceux de la révolte. A bas industrie forestière, gravières, latifundistes, barrages hydroélectriques. A bas les yanaconas [terme péjoratif qui désigne les « traîtres », soit les mapuche travaillant pour l’industrie forestière ou l’Etat]. Marichiweu ». Ce dernier mot, cri de bataille de la lutte mapuche, signifie « Dix et mille fois nous vaincrons. » Le 10 mai suivant, cinq
autres engins sont incendiés et détruit sur la route
R-444 entre Los Sauces et Lumaco. Le 21 mai, 11 engins forestiers sont incendiés à Teodoro Schmidt par des personnes masquées et armées à deux endroits
d’une l’exploitation forestière. L’attaque sera reven-
diquée par l’ORT Lafkenche. Ce même jour, sur le
territoire de la commune de Victoria, des personnes
armées expulsent un couple de propriétaires de leur
maison, puis la brûlent. Trois jours plus tard, le 24
mai, des weichafé tendent une embuscade sur la route
R-35 près de Collipulli. Au passage d’une patrouille
de carabiniers, ils ouvrent le feu. Un carabinier meurt sur place.
Le Wallmapu s’enflamme après l’assassinat de Pablo Marchant
Tout au long du mois de juin 2021, les incursions
armées dans les domaines forestiers continuent de
plus belle, ainsi que des attaques contre les demeures
de notables, comme celle de la résidence secondaire
de l’archevêque de Concepción à Contulmo. Au
cours de la première moitié de l’année, le nombre
d’arrestations dépasse les 300 selon les chiffres gouvernementaux, et les carabiniers affirment avoir saisi pas moins de 320 armes à feu en zone mapuche tout
en faisant face à un nombre d’attaques doublé comparé à l’année précédente.
Dans ce contexte toujours plus tendu et avec une
grande hétérogénéité d’organisations clandestines,
de groupes et de communautés, le weichafé Pablo
Marchant est tué par un carabinier le 9 juillet lors
de l’attaque contre une exploitation forestière de
Mininco. Dès le lendemain, les territoires mapuche
s’enflamment. En moins d’une semaine, les forces
de l’ordre comptabilisent 44 blocages de routes,
22 attaques par armes à feu (des tirs contre des patrouilles de carabiniers ou des vigiles) et 11 attaques incendiaires lors desquelles 39 véhicules et engins
des exploitations forestières sont détruits, ainsi que
5 bâtiments. Trois semaines plus tard, le porte-parole des carabiniers fait état de « 150 attentats » depuis la mort de Pablo Marchant. [Dans le texte
original suivait alors une chronologie des actions
allant jusqu’à fin juillet ; une chronologie plus étoffée a été rédigée pour cette publication].
Un monde entier
Malgré la présence de logiques politiciennes, malgré certaines forces qui tendent vers une hégémonie au sein de la lutte mapuche, une forte tension vers
l’autonomie anime toujours ce conflit. C’est peut-être ce qui explique en partie sa continuité, malgré les périodes de militarisation du territoire ou les
moments de négociations offrant une issue politique pour tenter de mettre fin aux hostilités. Certes, un nombre considérable de communautés mapuche
ont accepté au fil des années les conditions de l’Etat
chilien, préférant plutôt l’inclusion dans le monde
capitaliste qu’une vie de bataille pour le refouler
des terres où elles vivent. Aujourd’hui, il existe pas
mal d’organisations politiques et sociales mapuche,
parfois chaperonnées par des ONG ou des organi-
sations politiques de gauche, qui semblent prêtes
à entrer, de concert avec une partie de la « société civile chilienne », dans la danse perdante de la transformation de l’État chilien, qui a senti dans
son cou la chaude haleine du soulèvement diffus de
l’autonome 2019. Mais d’un autre côté, la multiplication des attaques, l’explosion d’initiatives de protestations, de blocages, d’occupations et de manifestations, ne cesse d’indiquer d’autres chemins, dont l’issue inconnue reste encore incertaine et ouverte.
A l’heure où dans le monde entier, les conséquences de l’avancée folle de la machine industrielle et technologique se font ressentir chaque jour davantage, où les changements climatiques induits par l’industrialisation pourraient bien inaugurer des
scénarios inouïs risquent de reconfigurer drastiquement les assises de la domination, cette lutte dans un coin « perdu » du monde où des habitants et habitantes porteurs de façons de vivre antagonistes avec le capitalisme et l’étatisme se battent pour chaque
mètre accaparé et exploité par des entreprises et
l’État, peut avoir une signification qui dépasse le
territoire du Wallmapu. C’est un conflit où la critique anti-industrielle et le refus du développement capitaliste réussit à faire vivre un monde, un monde
de communautés autonomes qui tentent de vivre
dans et avec la nature, et non sur son dos. Certes, ces
communautés ne sont pas exemptes de structures
hiérarchiques, ni d’oppressions en leur sein, mais
elles n’ont en tout cas pas le culte de la domination
étatique, de l’exploitation de la faune et de la flore, de la folle course en avant vers un monde toujours plus artificiel et vers une vie toujours plus assistée,
celle de la civilisation marchande.
Sur un autre versant, il est indéniable que la plupart des organisations radicales mapuche s’inscrivent dans un projet de « libération nationale ». Si
celui-ci ne semble pas inclure une construction étatique mapuche quelle qu’elle soit, se distinguant de fait assez nettement d’autres luttes de libération nationale sous la coupe de forces politiques cherchant à construire un nouvel État, cela a aussi pu engendrer certaines fermetures identitaires, le cautionnement d’oppressions au nom de la récupération des « traditions ancestrales », voire de la méfiance envers des expressions de solidarité critique (notamment anarchiste) avec la lutte en cours.
Quant à la « territorialité » de cette lutte, le fait
qu’elle s’inscrive dans et se déroule sur un territoire
précis — renforçant ainsi le discours de « libération » et de « récupération » de terres — cela en constitue assurément une des pierres angulaires. Souligner
alors les limites d’un tel ancrage territorial dans un
monde qui ne connaît ni ne tolère aucun « en-dehors », un monde qui a fait de la dévastation et de l’assimilation de tout ce qui lui est extérieur sa
trajectoire principale, ne devrait pour autant pas
conduire à nier toute potentialité réelle d’autonomies territoriales en conflit permanent avec la domination étatique et capitaliste. On pourrait même, au contraire, voir ces dernières comme autant d’expressions d’une liberté en acte, vivante et forte, liée à des
espaces-temps concrets et vulnérables.
Qui sait même si de leur côté, les anarchistes — comme certains le font déjà, au Chili et peut-être aussi ailleurs — ne pourraient pas non seulement
apporter leur grain de sel à la lutte mapuche, à travers
leurs suggestions d’attaques auto-organisées, leurs
méthodologies de sabotage et de luttes en armes,
leur critique incessante de tout leaderisme et de
toute hiérarchie, mais également apprendre quelque
chose, accueillir les expériences réelles de quelques
décennies de lutte sur un territoire donné contre la
dévastation capitaliste et la domination étatique, apprécier des autonomies territoriales qui ne sont pas forcément les nôtres ? Non seulement pour s’inspirer de la ténacité qu’on y retrouve, mais aussi de comment la vie et le combat tendent à y coïncider,
comment chaque acte de guerre, chaque attaque, chaque sabotage, y exprime un monde entier, un monde qui vit — certes souvent difficilement et encerclé par des forces qui veulent le détruire —, un monde avec un autre horizon que celui de la civilisation qu’on nous impose aux quatre coins du globe.
Repris de Avis de tempêtes, bulletin anarchiste pour la guerre sociale, n° 43-44, août 2021
(...)
C’est dans le feu du weichan que nous te commémorons, weichafé Tono !
À notre peuple-nation Mapuche, aux peuples
opprimés du monde et à l’opinion publique
nationale et internationale, la Coordination
Arauco Malleco – CAM, déclare :
Kiñe : Que nous revendiquons notre weichafé Pablo Marchant, militant de premier plan de la Coordination Arauco Malleco et membre de l’Organe de
Résistance Territoriale – ORT Lafkenche-Leftraru,
tombé au combat contre les laquais du grand capital le vendredi dernier 9 juillet au Wallmapu. Nous voulons être clairs et précis : dans ce contexte de
lutte frontale contre les investissements capitalistes dans notre territoire et pour la libération national mapuche, Pablo Marchant a laissé un souvenir d’un engagement militant et d’un dévouement irréductible, que nous honorerons dans chaque action de résistance que nous, weichafé, effectuons aux quatre coins du Wallmapu.
Epu : Que les responsables directs de la mort de
notre weichafé sont les forces policières de l’État du
Chili et les entreprises forestières transnationales,
dans ce cas l’entreprise forestière Mininco, qui agissent de concert et à tout prix pour assurer les intérêts du grand capital au Wallmapu. Ce sont eux les responsables historiques de la spoliation, du pillage, du génocide et de la domination coloniale de notre peuple, des logiques que le weichafé Pablo Marchant ffronta avec une intégrité révolutionnaire et exemplaire, jusqu’à y donner sa propre vie.
Küla : Qu’à la différence de ce que pensent les entités hésitants et serviles mapuche et non-mapuche, la mort de notre weichafé s’est produite dans un contexte où la démocratie bourgeoise et coloniale montre son véritable visage, en intensifiant la politique répressive, ce qui signifie de l’acceptation pour le mapuche docile et du plomb pour l’insurgé. C’est dans ce contexte socio-politique qu’il s’agit aujourd’hui de continuer à créer les conditions pour avancer dans la reconstruction nationale mapuche.
Mais selon les « représentants plurinationaux », ces
conditions seraient limitées aux avancées et régressions dérivées de la convention constitutionnelle, une question totalement fallacieuse qui finira en
nouvelle illusion et tromperie pour notre peuple.
Meli : Que face au processus de la convention
constitutionnelle, et toutes ses instances de légitimation institutionnelle, nous affirmons qu’historiquement nous, les mapuche, avons remis en question de faire partie de l’État oppresseur et d’accepter la soumission coloniale que cela implique. Ainsi,
la participation mapuche à la convention perçue
comme une opportunité pour « refonder » le pays est en réalité en acte de soumission au pacte colonial, qui offre une possibilité de réajustement à la
gouvernance néolibérale laqeulle a exacerbé la dévastation du Wallmapu ces dernières décennies. Le choix de cette voie institutionnelle cherche à faire
rentrer la souveraineté de notre projet politique
émancipateur dans une camisole de force et de la
soumettre à la géopolitique d’un État criminel. Cela
remet en cause tout ce qui a été accumulé en matière
de territoire par le mouvement autonomiste, d’autant plus que cette voie est liée aux partis politiques traditionnels qui historiquement ont représenté les
intérêts de la bourgeoisie nationale et internationale. C’est une illusion totale de croire que dans ce contexte, le « pragmatisme politique » et l’« opportunité historique » de la convention constitutionnelle permettraient de créer un meilleur rapport
de force pour la cause mapuche. C’est même tout
le contraire : par cette voie on n’a jamais obtenu
d’avancées importantes en matière de territoire et
de politique, ce qu’on constate avec l’échec qu’a été
l’initiative d’achat et de vente de terres poussée par
les différents gouvernements de service et qui n’a été
qu’exclusivement au service du système de propriété usurpée et de l’extractivisme.
Kechu : C’est dans ce sens que nous réaffirmons que la sortie plurinationale [5] ne sera jamais un véritable processus de décolonisation et de libération de notre peuple ; c’est un artifice tactique afin d’obtenir la nouvelle légitimation dont l’ordre politique-économique de la bourgeoisie et des latifundistes colons ont besoin. C’est-à-dire, la pluri-nationalité ne touche pas à la reproduction du capital dans notre territoire, ni l’interrompt-t-elle. La participation à la convention constitutionnelle, malgré les avantages que les entités hésitantes croient y déceler, renforcera le système de
propriété sur lequel l’usurpation du Wallmapu se
base. Elle cherche en même temps à saper les possibilités du weichan et de la lutte révolutionnaire mapuche, car par là on ne sort pas de la logique de domination, elle prévoit plutôt d’annuler la confrontation politico-militaire mapuche qui, selon la classe hégémonique, n’aurait plus de viabilité dans le contexte d’un Chili plurinational.
Kayu : Nous réaffirmons que la seule voie possible
pour la libération nationale mapuche est le weichan
et la confrontation directe contre les expressions du
capitalisme dans le Wallmapu. Ainsi, nous lançons
un appel aux lof, aux communautés en résistance et
à tous les organes révolutionnaires de notre peuple
à converger dans des nütram [conversations] différents, en trawun [réunions] territoriaux pour décider d’actions conjointes de résistance, pour accumuler
des forces et pour s’accorder sur une stratégie d’affrontement pour le nouveau cycle qui s’ouvre. Tout cela en ayant comme but d’avancer dans un grand
Koyagtun [assemblée] des territoires du Wallmapu
où nous prendrons les accords nécessaires afin de
matérialiser et de renforcer la stratégie de libération nationale mapuche et de récupération totale de notre territoire. En tant que CAM, nous affirmons
que la base concrète de cette stratégie doit être, en
premier lieu, de mener une guerre directe contre les
exploitations forestières et contre toute expression
du capitalisme sur notre territoire.
Nous lançons donc un appel à tout notre peuple
mapuche à rester fermes, avec tout le newen [force]
et feyentun [croyances] pour la défense du monde
mapuche. La récupération et la reconstruction de
notre nation implique la défense et la protection de notre itrofil mongen [environnement vivant], le renforcement de notre rakiduam [pensée] et de notre ad kimun ka mongen [sagesse du vivant] pour assumer ce weichan mapuche.
Et dans ce cadre, nous nous engageons en tant
qu’organisation à ne pas transiger avec les principes
et avec la ligne de la reconstruction nationale mapuche, nous ne trahirons pas le sang versé par nos weichafé tombés, nous n’abandonnerons pas nos prisonniers politiques et nous n’ignorerons pas le sacrifice et l’engagement de pu peñi pu lamngen [frères et soeurs] qui résistent quotidiennement et avec dignité dans leurs communautés.
Regle : Comme organisation nous revendiquons une vingtaine d’actions de résistance qui ont eu lieu ces derniers mois et qui furnet principalement dirigées contre les intérêts du grand capital :
28 décembre 2020. Sur l’exploitation forestière de Cuyinpalihue-Cañete, deux stocks de bois ont été détruits, ainsi que deux chargeurs frontaux de l’entreprise Kupal, prestataire de services de l’entreprise forestière Arauco. Action menée par l’ORT Lafkenche Lefraru.
4 janvier 2021. Sur l’exploitation forestière Santa Olga-Panguipulli ont été détruits des engins forestiers et un fourgon de l’entreprise Besalco, prestataire de services de CMP (Compagnie Minière du Pacifique). Action menée par l’ORT Huilliche Kallfulikan.
7 janvier 2021. Sur l’exploitation forestière Galvarino, située dans le secteur de Lolenco, cinq camions et trois engins forestiers ont été détruits par l’ORT
Wenteche Mañil Wenu.
8 janvier 2021. A Los Sauces, un camion forestier a été détruit par l’ORT Wenteche Kvlapan.
18 janvier 2021. Sur la route entre Imperial et
Carahué, deux camions et un camion-grue ont été
détruits. Action menée par l’ORT Wenteche Kilapan.
23 février 2021. Dans le secteur Huilinco-Cañete, deux tours de bois, deux chargeurs frontaux, deux fourgons, une abatteuse et deux algécos ont été détruits lors d’une action de l’ORT Lafkenche Leftraru.
14 mars 2021. Dans Río Bueno-Osorno, deux engins foresteurs, trois camions et un fourgon ont été détruits. Action menée par l’ORT Huilliche Kallfulikan.
5 avril 2021. A Toltén, sur l’exploitation forestière Santa Lucía, huit engins forestiers et un fourgon de l’entreprise forestière Mininco ont été détruits. Action menée par l’ORT Wenteche Matías Catrileo.
26 avril 2021. Dans le secteur Rucahue Ayipen-Freire trois engins forestiers ont été détruit. Action menée par l’ORT Wenteche Kvlapan.
29 avril 2021. Sur l’exploitation forestière Portahué-Galavarino, cinq engins forestiers ont été détruits par l’ORT Nagche Anganamun.
10 mai 2021. Sur la route entre Los Sauces et Lumaco, deux camions forestiers, un camion agricole, une moissonneuse-batteuse, un véhicule tout-terrain et un pick-up ont été détruits. Action menée par l’ORT Nagche Pelontraru.
22 mai 2021. Quatre trois-roues, un engin de billonnage, un skidder, deux abatteuses, un broyeur, un engin de treuil, trois stocks de bois, un fourgon et
une camionnette à ont été détruits à Teodoro Schmidt. Action menéepar l’ORT Lafkenche Leftraru.
22 mai 2021. A Carahué, sur l’exploitation forestière Santa Ana, deux engins forestiers et des infrastructures ont été détruits par l’ORT Lafkenche Leftraru.
5 juin 2021. Sur la route entre Los Sauces et Lumace deux camions forestiers, un hangar et une maison patronale ont été détruits. Action menée par l’ORT Nagche Pelontraru.
10 juin 2021. Sur la route entre Caramavida et Los
Álamos, trois camions, deux fourgons, deux grues et
deux porte-véhicules ont été détruit lors d’une action par l’ORT Lafkenche Leftraru.
9 juillet 2021. Sur l’exploitation forestière Santa
Ana à Carahué, un skidder, un camion-citerne et un
minibus ont été détruits. Le weichafé Pablo Marchant est mort lors du combat avec les flics. Action menée par l’ORT Lafkenche Leftraru.
C’est dans le feu du weichan que nous te comémorons, weichafé Toño !
Liberté pour Daniel Canio, prisonnier politique
de la CAM, liberté pour tous les prisonniers politiques mapuche.
A travers la résistance et le contrôle territoriale, nous avançons vers la libération nationale mapuche.
Amulepe taiñ weichan !
¡Weuwaiñ, Marrichiweu !
[Notre lutte continue. Nous vaincrons, mille fois nous vaincrons !]
Coordinadora Arauco Malleco (CAM)
15 juillet 2021
Communiqué commun après la mort de Pablo Marchant
À notre peuple-nation mapuche, au peuple chilien conscientisé,
aux organisations révolutionnaires proches, aux peuples opprimés du monde. A l’opinion publique nationale et internationale :
Le weichafé Pablo Marchant, « Toño » est tombé au combat. Nous
saluons son choix de se dévouer à la cause des opprimés et son engagement illimité dans notre lutte frontale. Dans ces moments douloureux, nous envoyons nos condoléances à sa famille et à son organisation, la CAM.
Si nous appartenons à des organisations différentes, nous sommes
des weichafé du même peuple et nous affrontons un ennemi commun.
Les responsables directs de la mort de notre frère sont les intérêts capitalistes qui se matérialisent dans l’industrie forestière extractiviste dont les acteurs principaux sont CMPC Mininco, Forestal Arauco et leurs opérateurs politiques sur zone.
Nous honorons la mémoire et l’exemple du weichafé Pablo Marchant, sa marche conséquente sur le sentier de l’action directe et du sabotage. En accord avec nos kuivikecheyem [ancêtres] et en mémoire
des weichafé tombés, nous affirmons notre décision catégorique de rester sur la même voie que le peñi Pablo.
Nous revendiquons les attaques armées contre les forces policières
dans le secteur de Lleu Lleu et dans le secteur La Herradura-Tirua
[quelques jours après l’assassinat de Pablo].
Nous salons aussi la famille Vergara Toledo, et nous embrassons le
parcours conséquent dans le weichan [lutte] de la lamuen [soeur] Luisa Toledo [6].
Dehors les entreprises forestières, les latifundistes, les barrages hydroélectriques, les yanaconas et tous les investissements capitalistes du Wallmapu.
Amulepe taiñ weichan
Marrichiwew
Weichan Auku Mapu & Resistencia Mapuche Lafkenche
Lakfenmapu, 10 juillet 2021
(...)
Octobre 2021. L’État chilien déclare l’état de siège
Dans les territoires habités par les communautés mapuche dont les terres ont été accaparées par des investisseurs capitalistes, défigurées par les exploitants forestiers,
ravagées par les entreprises énergétiques, polluées par les
industriels et colonisées par des suppôts de l’État chilien,
les dernières décennies ont été marquées par une lutte
incessante. Une lutte complexe, puisant sa force dans un irrépressible désir de liberté et dans la cosmovision mapuche ; une lutte parfois contradictoire, mais revendiquant
toujours l’autonomie des communautés mapuche, l’affranchissement de la tutelle étatique et l’arrêt de l’exploitation capitaliste. Depuis la déclaration de l’état de siège dans ces
territoires le 12 octobre 2021, la lutte mapuche se trouve à un carrefour crucial.
L’assassinat de Pablo Marchant
Dès le lendemain de l’assassinat du weichafé Pablo Marchant, abattu par un flic lors d’une action de sabotage, les territoires mapuche s’enflamment. En
moins d’une semaine, les forces de l’ordre comptabilisent 44 blocages de routes, 22 attaques par armes à feu (des tirs contre des patrouilles de carabiniers ou
des vigiles) et 11 attaques incendiaires au cours desquelles 39 véhicules et engins des exploitations forestières ont été détruits, de même que 5 bâtiments. Trois
semaines plus tard, le porte-parole des carabiniers fait
état de « 150 attentats » : sabotages des installations
de l’agro-industrie, attaques incendiaires contres des
convois de bois, blocages de route avec des tirs contre
les forces de l’ordre, embuscades contre des patrouilles
de carabiniers, incendies de propriétés de grands propriétaires terriens et de membres de l’État, sabotages d’installations énergétiques, ... Cette intensification
du conflit historique dans le sud du territoire chilien se déroule au moment précis où l’État est dans une période de modification législative avec son projet de nouvelle constitution destinée à calmer les ardeurs insurrectionnelles de la révolte de l’année 2019-2020.
L’hiver 2021
Tout au long de l’hiver au sud de l’équateur, les
mobilisations de résistance mapuche se poursuivent.
Pendant que les blocages de route et les occupations
de terre se multiplient, le nombre d’attaques et de sabotages explose. Le gouvernement de Piñera envoie alors de nouveaux renforts pour épauler les carabiniers
débordés. Les autorités locales affectent ces forces supplémentaires à des missions de protection des convois forestiers et de surveillance des exploitations forestières. Plutôt que de freiner les attaques, cette surenchère répressive ne fait qu’inciter les saboteurs et saboteuses à s’équiper davantage d’armes à feu pour faire face aux sbires de l’État chilien.
En septembre, les attaques deviennent quasi quotidiennes. Les entreprises forestières et les autorités locales appellent le président chilien à prendre des mesures énergiques pour freiner et mater la résistance mapuche. En même temps, de l’autre côté des Andes, plusieurs communautés mapuche dans les territoires dominées par l’État argentin, passent à l’offensive et occupent des terres propriétés de latifundistes ou d’entreprises comme Benetton ou EDF. Là-aussi, ces mobilisations terminent systématiquement en affrontements
avec les forces de l’ordre. Plusieurs attaques incendiaires ciblant l’industrie du tourisme ont lieu.
Les réponses des États
Face à la recrudescence de la résistance mapuche,
l’État argentin envoie immédiatement des renforts
pour parer à « l’urgence terroriste ». Du côté chilien, la
convention constitutionnelle, élue en mai 2021 pour rédiger une nouvelle constitution suite à la révolte, s’enlise autour du sujet des mapuche et décide de n’inclure qu’une reconnaissance formelle de leur existence en tant que « peuple » dans la nouvelle constitution. Le gouvernement de Piñera, à l’affût d’un prétexte pour agir énergiquement contre la lutte mapuche, estime le terrain mûr et ne veut surtout pas paraître laxiste à l’approche de l’anniversaire de la révolte (19 octobre). Piñera déclare alors l’état de siège dans la zone Macrosud (comportant les provinces Bío Bío, Arauco, Malleco et Cautín) à partir du 12 octobre.
Des milliers de soldats sont déployés. Le commandement suprême pour maintien de l’ordre public incombe à l’armée. Les soldats, appuyés par des blindés et des hélicoptères, sont dépêchés dans de nombreuses communautés mapuche pour effectuer des perquisitions et des arrestations. Des check-points et des barrages routiers
sont instaurés pour sécuriser certaines zones et exploitations. Des forces paramilitaires, embauchées par des grands propriétaires terriens et des entreprises, et actives depuis longtemps, sortent de l’ombre et viennent suppléer les forces de l’ordre.
Si cette militarisation vient changer des choses, tout
en perpétuant la même logique de répression et de
contrôle, les organisations de résistance mapuche, les
différents groupes de lutte armée, les communautés
mapuche en conflit, ne semblent pas se faire prendre
au dépourvu. Face à une occupation militaire, leurs
stratégies de lutte diffuse, multiforme et axée principalement sur le sabotage des intérêts capitalistes et étatiques et sur l’occupation de terres pourraient donner du fil à retordre aux étatistes. L’autonomie, qui est au cœur de la lutte mapuche, se traduit aussi dans la multiplicité des groupes, communautés et organisations
de résistance, et paraît offrir les meilleures possibilités
pour continuer la lutte diffuse, pour échapper à l’encerclement militaire, pour ne pas tomber dans le piège d’une lutte symétrique perdue d’avance.
Le 19 octobre, jour-anniversaire de la révolte qui a secoué le Chili en 2019-2020, des milliers de personnes descendent dans les rues des villes chiliennes. Contrairement à ce que pouvait espérer la gauche citoyenne en pleine participation à l’écriture de cette nouvelle
Constitution, la journée vire au désordre. Des centaines
de commerces sont mis à sac et pillés, les affrontements
entre révoltés et policiers sont durs : au moins 7 personnes sont assassinés par les policiers. Quelques jours plus tard, Piñera prolonge l’état de siège dans le sud du
pays. Sans doute un hasard du calendrier, mais dans
l’Hexagone ça cause aussi Chili à ce moment-là : dans le
cadre de sa stratégie d’investissement dans les énergies
renouvelables, EDF annonce la finalisation du financement à hauteur de 840 millions d’euros, du plus grand parc solaire, d’une surface équivalente à 370 terrains de
football, au nord du Chili, dans le désert d’Atacama.
Une signification toute particulière…
A l’heure où dans le monde entier, les conséquences de l’avancée folle de la machine industrielle et technologique se font ressentir chaque jour davantage, où
les changements climatiques induits par l’industrialisation pourraient bien inaugurer des scénarios inouïs risquant de reconfigurer drastiquement les assises
de la domination, cette lutte dans un coin « perdu »
du monde où des habitants et habitantes porteurs
de façons de vivre antagonistes avec le capitalisme et
l’étatisme se battent pour chaque mètre accaparé et exploité par des entreprises et l’État, pourrait avoir une signification qui dépasse le territoire du Wallmapu. C’est un conflit où la critique anti-industrielle et le refus du développement capitaliste réussit à faire vivre
un monde, un monde de communautés autonomes qui
tentent de vivre dans et avec la nature, et non sur son
dos. Certes, ces communautés ne sont pas exemptes de
structures hiérarchiques, ni d’oppressions en leur sein,
mais elles n’ont en tout cas pas le culte de la domination étatique, de l’exploitation de la faune et de la flore, de la folle course en avant vers un monde toujours plus
artificiel et vers une vie toujours plus assistée, celle de
la civilisation marchande.
Aujourd’hui, la lutte mapuche doit faire face à une énième offensive répressive. A tout cœur qui aspire à la liberté, à celles et ceux qui se battent contre le cauchemar bien réel du monde industriel : ne laissez pas la répression rompre les fils qui relient nos combats avec la lutte mapuche.
Kidu ngünewün
Publié dans anarchie !, n° 19,
novembre 2021 (France)
(...)
Communiqué de Weichan Auku Mapu
Marri marri pu machi, lonko, pu werken, pu wunen, pu weichafé, pu compuche, pu che meli witran mapu. Au peuple-nation Mapuche, aux peuples en résistance, à l’opinion publique nationale et internationale.
En tant que weichafé de Weichan Auka Mapu qui cohabitons le territoire lafkenche, nous déclarons que :
L’actuel état d’exception, avec la présence de
troupes de l’armée, de l’infanterie et de la marine, et
de policiers, dans notre Wallmapu historique, n’est
pas quelque chose de nouveau pour notre peuple et
cela correspond à un plan stratégique politique de
contre-insurrection, appliqué par le gouvernement
actuel, mais poussé et dirigé par les pouvoirs économiques qui ont des intérêts dans le territoire et qui sont le pouvoir réel derrière la classe politique,
ce sont eux qui ont gouverné, qui gouvernement et
aspirent à continuer de gouverner au Chili.
Nous comprenons ce nouveau cadre comme un
renforcement de la force politico-militaire existante
que l’État chilien à mis à disposition du pouvoir
économique pour qu’il puisse protéger ses intérêts
capitalistes dans le Wallmapu historique. Surtout au
moment où la résistance mapuche a forcé des entreprises forestières, des latifundistes, des entreprises hydroélectriques et autres expressions capitalistes à quitter le territoire.
Ce durcissement de la répression est une réponse
à la croissance du peuple mapuche en résistance,
une croissance que l’on voit reflétée dans la hausse
des récupérations de terres sans médiation, dans
l’augmentation de la capacité d’autodéfense dans
les territoires, dans l’apparition de nouvelles expressions et organisations qui effectuent des sabotages et enfin dans le renforcement de la vie mapuche au sein des communautés.
Cette réalité est le résultat de la continuité de la
lutte et de la résistance mapuche depuis plus ou
moins 30 ans, mais qui comme tout processus aux
caractéristiques révolutionnaires souffre de l’apparition « d’expressions opportunistes » qui salissent les processus de lutte.
Ainsi, si nous sommes conscients de l’avancée
du mouvement de résistance, des actions de sabotages et de la validité du weichan, nous le sommes aussi des erreurs qui ont été commises dans ce long
processus. Ces erreurs permettent actuellement à l’ennemi, à travers son monopole sur la communication, de tenter de délégitimer la lutte en la dénigrant
et la traînant dans la boue devant l’opinion publique.
Nous croyons qu’il faut assumer cette réalité :
dans tout processus révolutionnaire de libération
où il existe un enjeu territorial, des groupes et des
personnes apparaissent, et commettent des actes de délinquance commune qui nuisent aux communautés et qui, avec l’analyse actuelle, ne s’inscrivent pas dans la lutte.
Pour nous aider à affronter cette réalité, nous
croyons qu’il est important de comprendre les
causes de ce phénomène qui n’est pas nouveau, mais
qui a été rendu visible parallèlement au processus révolutionnaire mapuche, afin de salir le mouvement. Nous estimons qu’il n’est pas correct de prendre ses
distances des problèmes en s’abritant derrière une
certaine hauteur morale.
En tant que mouvement de résistance, nous devons être capables, surtout tous ceux qui ont eu des responsabilités et des postes de leader dans les 25 dernières années de lutte, de s’occuper non seulement des aspects bénéfiques de ce processus, mais aussi de ses aspects négatifs, qui se sont développés parallèlement au conflit.
Si nous ne le faison pas, nous pourrions difficilement prétendre trouver des solutions pour ce qui nous afflige en tant que peuple. Nous ne résoudrons
rien en imposant des codes moraux, ou en s’accusant les uns les autres de qui serait le plus responsable, alors que la permissivité et le fait de cacher les
saletés sous le tapis ont été des pratiques habituelles
au sein de la lutte dans ce territoire.
A propos de la militarisation du territoire, nous
pensons qu’il y a plusieurs raisons pour son implémentation :
Premièrement, comme initiative populiste à
l’approche des élections de novembre [2021], et
comme manœuvre de distraction suite à l’ouverture
d’une enquête judiciaire pour corruption à l’encontre du président Piñera.
Deuxièmement, comme expression du renforcement d’une ultra-droite hésitante et sensationnaliste. Nous sommes bien conscients et conscientes que
l’ultradroite et le centre-gauche servent les patrons
du Chili. En voyant leurs intérêts menacés, ceux-ci
ont mis la pression à Piñera pour qu’il envoie des militaires au Wallmapu.
Ces forces militaires et policières se sont tâchées
de sang à travers l’histoire, et le peuple chilien
les connaît bien. Nous savons qu’ils idolâtrent
l’argent, la preuve en est avec l’affaire du Pacogate,
qui fut entre 2006 et 2017 la plus grande affaire de
fraude et de corruption de l’histoire du Chili : des
détournements de plus de 35 milliards de pesos
durant le commandement de l’ancien directeur
de la police, le général Eduardo Gordon. Ou avec
la méga fraude des forces armées pour plus de 3 milliards de pesos. Ou sinon avec les détournements concoctés par leurs hauts commandements,
comme celui du commandant en chef Oscar Izurieta dans l’affaire de Frasim et Tecnometal et de la loi spéciale sur le cuivre.
Mais la PDI [7] n’est pas en reste, comme le démontre l’affaire
de l’ancien directeur Héctor Espinoza, accusé de
détournement de fonds publics, de blanchissement
et de falsification. La forme effective de la logique
délinquante poursuivie par les forces armées et
policières, qui opèrent en sacrifiant les besoins du
peuple chilien, n’est plus à démontrer.
Mais les mains de ces sbires ne se salissent pas que
d’argent, rappelons à la mémoire collective son historique de crime…
Le 21 décembre 1907, le « massacre de l’école Santa Maria ». Selon leurs propres chiffres, 126 ouvriers sont assassinés par des militaires chiliens, mais les historiens estiment qu’il y a eu plus de 2000 morts, ensanglantant les rues d’Iquique. Ces
meurtres furent commandités par le patronat du salpêtre afin d’en finir avec le mouvement ouvrier dans le nord du Chili.
Ou le rôle trop bien accompli par ces institutions
de la honte lors du coup d’État de 1973 : massacrer
et assassiner leur propre peuple, et c’était encore
avant de se charger des détenus desaparecidos.
Plus récemment, en octobre 2019, pendant la
« révolte sociale » : mutilations, viols, assassinats et plus de 541 affaires de violation des droits de l’homme contre des mineurs, classés sans suite
par les procureurs. Et tant d’autres affaires non-résolues, comme l’assassinat de Manuel Rebolledo à Talcahuano le 22 octobre 2019, ou la disparition de
José Huenante, 16 ans, de la main des carabiniers de
Puerto Mont le 3 septembre 2005.
Bref, la force policière et militaire est un laquais
des intérêts politiques, eux-mêmes au service des
patrons capitalistes. Ce sont surtout les chiens de
garde des riches. Des riches qui ont leurs intérêts
dans le Wallmapu sous la forme d’investissements
dans l’exploitation forestière, dans l’hydroélectrique, dans le latifundisme, dans le secteur immobilier et extractiviste.
Nous invitons à analyser et à assumer la réalité actuelle, en reconnaissant le positif aussi
bien que le négatif qui se déroule dans
le territoire pendant les processus de
lutte. En communion avec les éléments
propres à notre culture, guidée par le Az Mapu [droit invisible], Az mongen [vie
mapuche] à travers le malon [attaque
surprise] et le weichan, reconnaissant le
nutram [narration], trawun [réunion]
et kelluwun [solidarité] comme des
pratiques quotidiennes et valides pour
contribuer à la lutte et au contrôle de nos territoires. Des pratiques qui permirent à notre kuivekecheym de pouvoir mener le weichan contre les envahisseurs inka, espagnols et de l’État chilien, mais sans perdre de vue le
contexte dans lequel le weichan se livre maintenant.
En tant que Weichan Auka Mapu :
Nous réaffirmons notre engagement révolutionnaire dans les actions
de sabotage contre les intérêts capitalistes qui détruisent et dévastent la
ñuke mapu, ainsi que dans les actions
armées qui concordent avec les besoins de nos lof et de nos communautés, les garants réels de notre légitimité territoriale.
Pour les weichafé tombés au combat. Liberté aux prisonniers politiques mapuche. Liberté aux prisonniers politique du peuple chilien.
Ñielole mapu muleay aukan [8]
[Ce n’est pas un montage, c’est du sabotage !]
(...)
Attaque incendiaire contre un camion forestier à Penco. 20 décembre 2021
« Les gens veulent prendre leurs propres
décisions pour des petites choses, mais prendre
des décisions sur des problèmes difficiles et cruciaux nécessite d’affronter des conflits psychologique et la plupart des gens détestent ça ».« Pour tout être humain ayant grandi au
bord d’une rivière la liberté est le concept le plus élevé ».
Au petit matin du 20 décembre
2021, une attaque incendiaire a été
réalisée contre un camion forestier
sur la Route d’Itata à la hauteur de Penco,
dans la région Bio Bio. A cause de complications techniques, il n’a pas été possible
d’émettre ce communiqué le jour de l’action, cependant les motivations de notre
agir restent plus actuelles que jamais, c’est pourquoi nous ne considérons pas ce retard comme un problème et encore moins comme une limite pour communiquer les raisons qui alimentent nos attaques.
Nous revendiquons cette attaque, faite
en réponse au pillage et à la destruction
systématique qu’exercent les entreprises
forestières à l’intérieur du territoire, ce qui
entraîne une indéniable dévastation de la terre.
En premier lieu, cette action s’inscrit
contre l’avancée progressive du projet minier Aclara, précédemment appelé Biolantanidos, qui s’installe en prenant pour prétexte le développement pour la région, tout
en étant directement responsable de la destruction du territoire. Ces agissements sont
soutenus par un système capitaliste et avec la complicité de l’État du $hili, qui finance ce projet minier depuis le début par le biais de la CORFO [9], imposant ainsi des politiques extractivistes pour leurs intérêts économiques et pour le bénéfice de la classe entrepreneuriale qui porte atteinte à la dignité des personnes et à la terre.
La Société Minière Aclara en est encore
aux procédures légales qu’elle doit remplir
en tant qu’entreprise minière pour pouvoir extraire des minéraux (dont des terres
rares), et pourtant les travaux ont déjà commencé. Ils ont détruit les montagnes pour
installer les lieux de stockage et extraire des échantillons des sols sans prendre en
compte les raisons plus que suffisantes pour
interrompre les travaux et renoncer à l’installation définitive du projet minier. Une
de ces raisons est la présence sur la zone touchée par le projet d’espèces végétales originaires et anciennes telles que le queule et le naranjillo qui se trouvent sur la liste des espèces menacées et en danger d’extinction. Si le projet minier procède, leur habitat risque d’être mis à mal. En plus, chaque écosystème est associé à une infinité d’espèces, aussi bien végétales qu’animales, de champignons et de micro-organismes divers. Cela démontre, sans aucun doute, que ces entreprises et leurs représentants légaux ne portent aucun intérêt aux soins et à la conservation des écosystèmes, et que bien au contraire elles font preuve d’une soif cupide d’exploitation qui engendre la dévastation de la terre.
Ces pratiques extractivistes mettent en
évidence les conséquences néfastes, comme
c’est le cas avec l’installation de mines de terres rares aux États-Unis et en Chine au Mountain Pass et à Baotou. Ces deux puissances mondiales
ont permis la dévastation et la destruction totale
de territoires qui aujourd’hui ne sont plus que des
foyers chimiques, toxiques et radioactifs. C’est cette
dynamique impérialiste et néolibérale en vigueur au niveau mondial et qui se déploie aussi en Amérique Latine, que nous refusons et que nous attaquons, par l’action directe et en totale autodéfense face à la violence imposée.
Nous évoquons avec chaque action nos compagnon-ne-s séquestré-e-s dans les prisons de l’État $hilien, qui tire profit d’un système carcéral où l’abus de pouvoir est le principe d’organisation fondamental des geôles étatiques. En plus des persécutions, tortures et assassinats permis par chaque gouvernement en place, l’État prive de liberté quiconque qui tente de remettre en question leur faux progrès et leur dévelopment économique qui repose sur la spoliation de la mer et de la terre.
Nous saluons tous les lof en résistance qui continuent à affronter la militarisation mise en place par l’État oppresseur, les entreprises forestières réparties sur tout le wallmapu et les méga-projets énergétiques, tous complices de l’écocide des territoires.
Nous agissons aujourd’hui en solidarité avec la compagnonne Carolina Marileo, werken [messagère] de la communauté Boyen Mapu, emprisonnée dans la
prison de Angol, en grève de la faim depuis 30 jours
pour exiger des conditions normales de détention.
Elles lui ont été refusées et elle continue à faire l’objet de vexations et de violences racistes (comme subissent les comuneros du lof Elicura, incarcérés
suite à ce qui est clairement un montage). Nous exigeons l’acceptation immédiate des
demandes de la werken ainsi que la libération de la totalité des prisonnniers mapuche incarcérés dans les différents centres d’extermination sur l’ensemble du territoire appelé $hili, et des compagnons emprisonnés en guerre. En effet, il est très clair pour nous que le système carcéral a pour vocation d’enfermer toutes celles et ceux qui, comme nous, s’opposent à toutes les entreprises et personnes qui veulent que le modèle néolibéral, qui n’est ni durable, ni soutenable, se perpétue. Nous considérons que la violence est une pratique nécessaire pour détruire ce qui nous détruit.
« Aujourd’hui nous luttons à nouveau avec nos corps comme armes, face à celles et ceux qui souhaitent enfermer et enterrer sous le ciment la rébellion, la dignité, l’amour et la solidarité. La société autoritaire policière a créé le panoptique carcéral où, historiquement, ils ont enfermé les êtres qui se révoltent face à la dite paix sociale, ils ont créé des structures punitives qui recherchent le contrôle physique et mental en visant à réduire l’être
par la violence brutale de l’isolement et des matons, mais aucune prison avec ses murailles pleines de barbelés, de haute sécurité ou de sécurité maximale, pas plus que les laquais armés ne pourront soumettre celles et ceux qui ont dédié leur vie entière à la cause de la libération totale »
Par cette action, nous voulons aussi rappeler, commémorer et venger par le feu l’assassinat du compagnon anarchiste Sebastian Oversluij « Angry » le
11 décembre 2013 par un des sicaires de la banque Banco Estado dans la commune de Pudahuel [10]. Cela fait déjà 8 ans, mais
sous aucun motif nous n’oublierons le nom et le visage de ton bourreau. Nous savons que la mort est présente comme une possible conséquence de nos
actions, cependant, tout comme l’ont été les compagnon Angry et compagnon Mauricio Morales, nous
assumons les risques qu’implique la lutte contre
l’État-capital, ses défenseurs et ses faux critiques. En
leur mémoire et en celle des compagnons tombé-e-s au cours de la lutte, nous continuerons à attaquer chacun des piliers et des symboles de ce système patriarcal et capitaliste.
Nous lançons un appel à ne pas garder le silence
face aux lois répressives appliquées par l’État et sa
force policière-armée, face à leur zèle incessant pour
préserver les intérêts du capital à travers le contrôle
social et la dévastation du territoire. Nous avons
pour but l’unification et la solidarité constante avec
le peuple mapuche pour faire face à un ennemi commun.
¡¡Inkayaiñ taiñ mapu mew !!
¡¡Newentuleymun pu che, pu lamuen !!
[Nous défendrons notre terre ! Tenez bon, frères et sœurs !]
Communiqué de la Resistencia Mapuche Lafkenche. 22 décembre 2021
Ce vendredi 24 décembre, huit personnes de la vallée d’Elicura seront jugés. Huit pu peñi [frères] et pu lamuen [soeurs] de lutte devront subir la
punition par l’État raciste et oppresseur. Ils ont dû faire
face aux mensonges des traîtres, des procureurs et des
médias qui n’ont jamais, mais jamais, enquêté sur les faits
pour lesquels nos pu peñi, pu lamuen sont condamnés aujourd’hui [11].
Le gouvernement et le pitre coordinateur de la « Macro zone », Pablo Urquizar, continuent à parler d’un crime à Mansalva, mais omettent le fond de l’affaire qui verra nos peñi, lamuen de Elicura, être condamnés aujourd’hui à des dizaines d’années de prison. Elicura est un lof qui, grâce à la dignité de ses hommes et femmes, a ralenti l’avancée des barrages hydroélectriques, récupéré du territoire et redonné de la dignité à
la lutte et à la vie mapuche dans une zone où le capitalisme forestier et touristique n’ont amené que misère et pauvreté pour les mapuche et les chiliens pauvres.
Nous savons que l’État condamnera nos frères et
soeurs, humiliera leurs familles et présentera les traîtres,
yanakonas [personnes serviles et minables], comme des victimes. Mais le peuple mapuche sait que Playa
Blanca est un territoire mapuche, de même que
le lac Lanalhue, et qu’une poignée de yanakonas
alliés au winka [usurpateur] Héctor García essayeront d’imposer leurs idées néfastes en évinçant la légitimité mapuche sur ces terres.
Devant cette farce juridique et médiatique nous
montons au weichan et saisissons nos tralkas [fusils] et notre feu justicier. Car s’il n’existe pas de justice winka, il y aura toujours de la justice mapuche. Ceux qui cherchent aujourd’hui à se présenter comme des victimes devant nos actions
sont les mêmes qui ont justifié la spoliation territoriale en érigeant une fausse vérité, se croyant les maîtres d’une histoire qui ne leur appartient pas.
Ce sont les mêmes qui, acclamant la présence militaire, insistent à nous traiter comme des narco-terroristes, favorisent le désastre forestier et justifient
l’incendie des rukas [maison] et l’assassinat de nos kuivekecheyem [combattants]. Ceux-là ont toujours cru que les mapuche seraient un peuple soumis et pacifique.
Mensonges. Nous sommes wentru [homme] et
zomo [femme] weichafé. Nous sommes un peuple
rebelle. Nous sommes un peuple qui avance vers sa
libération et cela implique, qu’ils le sachent, d’expulser les usurpateurs historiques, les véritables terroristes, car ce n’est qu’ainsi que resurgira la vie
mapuche, confiante en notre feyentum [croyances],
itrofil mongen [l’ensemble du vivant] et reconstrui-
sant par là une proposition d’humanité.
Face aux discours de paix que cherche à imposer
cette fausse démocratie, nous affirmons que nous
ne lâcherons pas nos tralkas. Tant que les entreprises forestières et les gravières continueront à dévaster notre territoire, tant que les entreprises
touristiques continueront à faire du profit avec nos
ressources et tant que les prisons du sud continueront à se remplir de mapuche, le weichan ne s’arrêtera pas. Ni avec Piñera, ni avec Boric [12].
C’est en tant que RML que nous revendiquons les actions suivantes :
Mercredi 24 novembre. Incendie de quatre camions venant de la gravière sur la rivière Trongol et d’un fourgon forestier de l’entreprise forestière Arauco. Secteur Los Ríos, Los Álamos.
Jeudi 9 décembre. Incendie de quinze engins forestiers sur l’exploitation Coihué-Yeneco de l’entreprise forestière Arauco. Lebu.
Mardi 14 décembre. Incendie de quinze engins
forestiers sur l’exploitaiton El Tesoro de l’entre-
prise forestière Arauco. Curanilahue.
Mardi 22 décembre. Incendie de 31 chalets d’été
dans le secteur Lincuyin. Contulmo.
Par la contondance de nos actions, nous revendiquons nos prisonniers et nos morts. D’un pas ferme nous continuons à avancer vers la libération du Wallmapu. Nous savons que cette marche continuera à amener sacrifice et ouleur, prison et mort. Mais
nous n’abandonnerons pas.
Liberté pour Matías Leviqueo, Elíseo Reiman, Cesar Millanao, Guillermo Camus, Oscar Pilquiman, Orlando Ancalao, Victor Llanquileo et pour tous les prisonniers politiques mapuche et de la révolte chilienne.
Territoire et autonomie communautaire.
Resistencia Mapuche Lafkenche (RML)
Lavkenmapu-Nahuelbuta.
Communiqué de la Coordinadora Arauco-Malleco. 28 décembre 2021
Face aux événements qui se produisent actuellement dans le cadre institutionnel de
l’État chilien, de la convention constitutionnelle au début du gouvernement dirigé par
Gabriel Boric (résultant d’en accord pris au sein de la bourgeoisie nationale et internationale), nous déclarons que :
Kiñe.- Il existe un négationnisme constant, un
parti pris et une ignorance massive concernant
l’histoire de notre nation mapuche, qui sont orchestrés et imposés par l’État chilien pour justifier l’usurpation du Wallmapu. Ce discours cherche à
faire ignorer qu’en tant que peuple mapuche, nous
avions une vaste indépendance et exercions notre
souveraineté sur notre territoire ancestral, à tel
point que les structures coloniales et républicaines
se sont tenus à l’écart de nos vies pendant de plusieurs siècles, sans réussir à imposer leurs modèles culturelles, économiques et politiques. La seule
voie que trouvèrent les winka pour s’approprier
notre territoire fut la spoliation, la tromperie, la tutelle raciste et la militarisation, des phénomènes qui se répètent aujourd’hui.
Epu.- D’autant plus, dans l’ambiance actuelle où surgissent des voix qui cherchent à amener notre autonomie dans un cadre institutionnel et paternaliste, nous répondons à cette nouvelle gauche « hippie, progressiste et de buena onda » qui célèbre
aujourd’hui l’avènement d’un gouvernement social-démocrate ou, pour être plus précis, d’un
gouvernement de centre-gauche, que le peuple mapuche possède sa propre structuration politico-militaire qui date d’avant la formation de l’État
chilien. Cette structuration s’exprime à travers du
koyang, du weichan et de la présence de nos autorités ancestrales comme les machi, les lonko, les
werken, les weichafé ; des rôles qui sont maintenus
au sein de notre mouvement, sans idéologies
étrangères, et qui participent activement aux processus de reconstruction et de libération nationale vers le kizügunewün [l’autodétermination].
Küla.- Nous pensons que si les formes du pouvoir
et de la domination peuvent évoluer, elles restent au
fond les mêmes structures contre lesquelles nous
luttons depuis longtemps ; par conséquent, personne ne nous enseignera comment les affronter ; c’est notre histoire de lutte, ce sont nos réussites et
nos erreurs, c’est la parole de nos autorités culturelles qui nous ont aguerris en tant que peuple en résistance et qui nous motivent à continuer à combattre les expressions du capitalisme dans le Wallmapu. Le pouvoir colonial qui nous a soumis il y a
plus d’un siècle suit la même logique aujourd’hui.
Ainsi, Saavedra, Pinochet et Kast représentent la
continuité historique d’un projet de domination
fasciste, et profondément raciste. Nous qui coexistons en longue et en large du territoire disputé avec cette caste de dominants le savons bien. Devant ceci,
nous mentionnons encore une fois l’exemple de nos
ancêtres, les futakechekuifi, et nous réaffirmons que
nous continuerons à lutter pour la reconstruction nationale mapuche sans dévier du moindre centimètre de notre ligne et de nos principes de lutte.
Meli.- Dans l’actualité et comme expression
concrète de ces structures de domination, la
soi-disant lutte contre « la violence en Araucanía » s’organise dans une tactique transversale soutenue par le patronat, la droite, les médias
et aussi par la Convention constitutionelle et
Gabriel Boric. Cette tactique est destinée à préserver le système tel quel, quitte à employer la répression et la militarisation afin de faire face au
mouvement mapuche autonomiste révolutionnaire qui exerce le contrôle territorial. Il semble
que quand on touche aux intérêts du grand capital, il n’y a pas de différence entre « la gauche et la droite », les deux secteurs ont un discours homogène face aux propos politiques et matériels de nos revendications. Ces secteurs oublient que
dans notre histoire, ce fut la violence politique et la résistance qui fit de nous un peuple souverain et que c’est notre droit légitime de l’employer pour nous préserver dignement comme peuple mapuche.
Kechu.- Que cette tactique fait partie d’une
stratégie contre-insurrectionnelle qui se fraye un chemin dans le panorama politique actuel à travers l’instauration d’une narration narco-terroriste, destinée à acculer et discréditer politiquement, économiquement et médiatiquement nos
expressions de lutte révolutionnaire. Ce sont des
attaques désespérées des classes dominantes et du
fascisme pour sauvegarder leurs intérêts face au renforcement du weichan. En même temps, de la même façon, nous prenons catégoriquement nos distances, dans ce contexte, avec certaines déviations qui se sont produites au sein du mouvement
mapuche en général et qui ont fini par être utiles
au pouvoir de la domination, telles que le trafic
de drogues, les mafias liées à l’exploitation du
bois, le paramilitarisme yanacona et la servitude
des « nouveaux micro-entrepreneurs » mapuche.
En ce moment historique, il est fondamental
d’étouffer ces expressions utiles au capital, et en
tant qu’organisation, nous le ferons en réaffirmant
notre éthique politique qui va de pair avec notre
tradition de lutte.
Kayu.- Nous lançons un appel à notre peuple
Mapuche rebelle pour continuer à résister et à revendiquer la violence politique comme un instrument légitime de notre lutte, peu importe qui est
en train de gouverner et qui préserve le modèle
de l’accumulation capitalisme et de son échafaudage colonial. Freiner la destruction du Wallmapu, créer les bases pour l’émancipation définitive
en multipliant les sabotages et en intensifiant le
contrôle territorial afin de libérer les territoires
du pouvoir winka. Nous n’effacerons pas les coûts
de ce nouvel élan autonomiste de notre mémoire
collective : on le paie avec de la persécution politique et des weichafé tombés et animés par un vaste sentiment d’engagement pour notre peuple.
Ne nous laissons pas bercer par des fausses promesses et ne tombons pas dans la vision court-termiste et mesquine de la pseudo-gauche.
Avec Matías et Toñito toujours en la mémoire !
La résistance n’est pas du terrorisme !
Kizugūnewtun pour la Nation Mapuche !
Liberté pour Daniel Canío et tous les prisonniers politiques mapuche !
Amulepe taiñ weichan
Weuwaiñ – Marrichiweu
Coordinadora Arauco-Malleco
(...)
[1] Il s’agit surtout de militants du Frente Patriotico Manuel Rodriguez (FPMR),
le bras armé marxiste-léniniste disposant d’une marge opérationnelle militaire au sein
du Parti Communiste, puis totalement autonome à partir de 1987. Le FPMR a effectué des centaines de sabotages, des attentats et des éliminations de responsables politiques, militaires et capitalistes. Son projet fondamental pour abattre la dictature de Pinochet était une guerre populaire de libération nationale du Chili, menée par le FMPR et des milices populaires. Il y aurait aussi eu d’anciens militants du Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR) et du Movimiento Juvenil Lautaro (MAPU Lautaro).
[2] Voir 21° Años de la Coordinadora Arauco Malleco : Apuntes para una historia de la CAM, communiqué de la commission politique de la CAM, décembre 2018.
[3] Si pas mal de jeunes nés dans les communautés mapuche sont partis en ville pour y étudier et trouver du travail, d’autres comme Matías Catrileo firent le chemin inverse, portant avec eux des expériences et des idées libertaires au cœur du conflit mapuche.
[4] Pour en savoir plus sur la révolte de 2019, voir par exemple le numéro spécial du bulletin anarchiste Avis de tempêtes n° 23 bis, « Danser avec les flammes ».
[5] A l’instar de ce qui s’est passé récemment dans d’autres pays latino-américains comme la Bolivie, la convention constitutionnelle semble vouloir proposer la refondation de l’État chilien comme un État « plurinational », composé de plusieurs nations et peuples. Une telle politique vise bien sûr à garder les peuples indigènes dans le giron de l’État et de renforcer sa légitimité institutionnelle par l’intégration et la reconnaissance de droits.
[6] Luisa Toledo (21 juin 1939 – 6 juillet 2021) lutta toute sa vie contre l’oppression. Elle était la mère des frères Rafael et Eduardo Vergara Toledo, étudiants
et militants de l’organisation d’extrême gauche MIR (Mouvement de la Gauche
Révolutionnaire), qui furent tués par des policiers le 29 mars 1985. Depuis ces
assassinats sont commémoré chaque année lors de la Journée du Jeune Combattant, qui donne systématiquement lieu à des manifestations émeutières et des attaques diffuses et armées contre la flicaille dans de nombreuses villes du Chili. La famille Vergara est devenu un symbole de la continuité de la lutte radicale depuis la dictature jusqu’à aujourd’hui et de la solidarité entre différentes tendances révolutionnaires. Jusqu’à sa mort, Luisa Toledo était notamment actif dans la poblacion de Villa Francia, un quartier particulièrement combatif.
[7] Service d’enquêtes de la police chilienne,
ndt.
[8] Ce slogan fut employé dès 2016 par le WAM
et puis par d’autres lors d’une polémique autour des attaques contre des églises et des temples évangéliques (dont une partie fut accompli par
des weichafé du WAM). Certaines organisations
se distancièrent de telles actions, mirent en doute
qu’ils furent accomplis par la résistance mapuche
et restent jusqu’aujourd’hui critiques de telles pratiques (comme la CAM ou la LNM).
[9] Corporación de Fomento de
la Producción, organisme étatique de promotion du développement industriel.
[10] Lors
d’un braquage de banque.
[11] Le 21 décembre 2021, huit prisonniers et prisonnières mapuche de la vallée d’Elicura à des peines allant de 20 à 25 années de prison pour l’homicide du propriétaire d’un camping dans la vallée
d’Elicura lors d’une récupération de terres en décembre 2019. Lors de la récupération, le propriétaire refusa de s’en aller. Des coups assenés sur sa tête par des weichafé lui auraient été fatals.
[12] Le nouveau
président du Chili, qui est entré en fonction en mars 2022.
Entre océans, forêts et volcans. La lutte radicale mapuche
Printemps 2022 // 56 pages // Éditions La Souterraine
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (10.5 Mio)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (10.5 Mio)