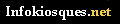C
C’est la dose qui fait le poison...
mis en ligne le 9 août 2025 - Anonyme
« C’est la dose qui fait le poison... »
Tout herboriste qui se respecte vous le dira.
NB : Ce texte cherche à nuancer certaines évidences, à remettre du doute dans nos jugements, à questionner la méfiance qui existe dans nos espaces, nos débats, nos relations. Il ne vise pas, ni ne doit servir à minimiser des actes/comportements/idées tout à fait problématiques qui doivent être désapprouvés et pris en charge. C’est une question d’échelle et de mesure, ce que ce texte se propose de discuter. Par ailleurs, je prends pour contexte un « milieu » sans doute trop vague. Il conviendra à chacun.e de sentir les endroits où il.elle se sent concerné.e par les dynamiques qui sont mentionnées.
Tout au long de leur histoire, (je l’espère, et au moins en partie) les anarchistes ont réfléchi à la question des dynamiques de Pouvoir [1] qui peuvent s’installer entre compagnon.nes, et à comment les combattre. Ces réflexions, qui concernaient sans doute plus des modèles organisationnels que le domaine de l’intimité, sont un élément central de l’Anarchie, et doivent le rester. Mais je me demande si, pour différentes raisons, notre attention au comportement et aux idées des un.es et des autres ne s’est pas mue en une véritable obsession...
Obsession pour traquer la moindre parcelle, le moindre germe d’un virus qui pourrait porter en son sein des mécanismes favorisant l’installation (ou le renforcement) du Pouvoir d’un individu sur un autre. Obsession pour traquer la moindre situation qui ne garantirait pas une égalité parfaite entre deux individus. Je grossis le trait (quoique…) pour visibiliser une tendance. Alors on assiste, au-delà de la critique déjà intransigeante de comportements que les plus véhément.es qualifient d’autoritaires, à des critiques d’actes ou de pensées qui ne sont pas autoritaires/porteuses de Pouvoir en soi mais qui pourraient entraîner du leader ship/du suivisme/une relation toxique/une nouvelle norme/mettez n’importe lequel des démons à abattre du moment. Donc non seulement le spectre des comportements/pensées et idées qui sont critiqués s’est élargi, mais également nous sommes devenu.es suspicieux.ses envers des formes d’agir ou de penser, ou envers des idées, qui ne sont pas problématiques en soi, mais qui pourraient le devenir. Il est bien sur intéressant que le regard s’affine pour décortiquer des mécanismes, mais alors gare ensuite à ne pas tout niveler. A ne pas donner la même gravité à toutes choses. A ne pas confondre un risque, une potentialité, avec la chose que l’on redoute.
Est-ce le fait de baigner dans une époque qui nous rabâche sans cesse à quel point le Pouvoir circule en nous, et s’incarne dans nos rapports, qui a rendu exponentielle la liste des choses qui sont vues comme problématiques ?
Est-ce face à la peur de voir nos idées se faire récupérées par le Pouvoir, que nous avons autant de méfiance dans nos débats ?
Face à un constat d’impuissance, que nous avons ainsi retourné notre colère contre nous-mêmes, nos proches ou nos compagnon.nes ? Face au constat que certes, le pouvoir n’est pas que dans les institutions, que nous avons juré de le pourchasser jusqu’à la dernière trace, et ce, quoi qu’il en coûte ?
Quoi qu’il en coûte, parce que pour le coup, voilà bien un domaine pour lequel, chez certain.es anti-autoritaires, la fin peut justifier les moyens. Entendons-nous bien, j’ai ardemment défendu cette façon de voir, et de faire les choses. Confrontation, rupture, exclusion, jugements hâtifs, procès d’intentions, rien ne devait pouvoir stopper nos envolées anti-autoritaires. Aujourd’hui j’ai l’impression que n’importe quelle amitié, n’importe quelle dynamique, n’importe quelle relation, risque de s’arrêter du jour au lendemain si l’une de nous a l’outrecuidance de sortir un orteil de la zone de ce qui communément admis comme étant « ok » [2]. Et parce qu’on a des ennemi.es politiques partout, une phrase, un geste, peut nous envoyer direct dans la case des idéologies à abattre. Et s’il ne semble parfois ne plus y avoir de limites à nos écrits, à nos paroles, à nos actes, c’est parce que rien ne semble plus horrible que les dynamiques de Pouvoir que nous reproduisons : l’ennemi.e est partout : ton salon, le squat d’à coté, ton bosquet de conspiration [3]. Et il semble que l’on peut passer d’ami.e à ennemi.e (ou à ennemi.e en puissance) en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. Je sais bien quelle pertinence il y a eu à poser des mots forts sur des réalités vécues. Mais une personne ne peut pas être à la fois mon ennemi.e et mon.ma compagnon.ne. Mon.a compagnon.ne ne peut pas être mon ennemi.e au même titre qu’un juge, ou qu’un ingénieur du nucléaire. Et même si nos réflexions anti – autoritaires nous poussent parfois à la mesure et à la réflexion, bien souvent nos émotions, elles, débrident toute retenue.
Il serait sans doute sage par ailleurs, et je ne développerai pas parce que ça n’est pas le propos de mon texte, que de questionner la place des émotions dans nos vies et nos comportements, et de bien les distinguer de nos raisonnements politiques. D’arrêter de penser agir en cohérence avec ses idées, alors que bien souvent on agit plus en cohérence avec nos émotions, lesquelles façonnent certes nos idées (et heureusement !), mais sont aussi le résultat d’un tas d’autres choses.
Alors comme en médecine, j’en arrive à me dire que dans nos mécanismes, nos valeurs, nos outils, nos exigences, c’est la dose qui fait le poison. Une attention à nos comportements est essentielle, et les débats d’idées sont la vitalité d’une pensée politique. Mais une surveillance suspicieuse est malsaine, problématique, paralysante.
Je suis de cette génération qui s’est drillée à chercher le mal autoritaire partout, et qui s’est persuadée que c’était là la seule façon d’être en cohérence avec ces idées. Au point de ne plus savoir parler, penser, baiser, bouffer, agir, combattre. Je suis aussi d’une génération qui ne croit plus tellement à la révolution. Alors, parce qu’il faut bien trouver un guide quand même, nous nous sommes obnubilé.es par la recherche de cohérence. Par le fait d’éliminer toutes traces du vieux monde en nous. Parce que si peu importe la fin (que nous n’atteindrons pas de toutes façons), alors concentrons nous sur les moyens. Et c’est vrai qu’être anarchiste, c’est exigeant. Ça demande à mon sens un minimum de cohérence. Mais on ne peut pas exiger qu’elle soit totale dans dans un monde qui ne nous offre guère d’autres choses que des compromis. Or, insidieusement, nous l’avons exigé. De nous et des autres. Parce que c’est aussi un moyen de lutter contre notre impuissance face à un monde dont les rouages nous échappent, comme un repli de notre agir sur nous-même, à une échelle qui nous soit tangible, comme une chose sur laquelle on pourrait encore avoir prise, pour garder du sens. Mais cette voie nous étouffe.
Et petit à petit nous avons créé un monstre, qui dicte qu’un geste, une parole, peut faire de nous l’incarnation d’une pensée/idéologie à abattre. Que l’on peut devenir un.e ennemi.e à n’importe quel moment. Comme si l’individu tout entier disparaissait à cet instant, et qu’il n’était plus rien d’autre que l’acte, ou l’idée, qui suscite notre méfiance/colère. Et, admettons le, certain.es d’entre nous ont pris goût, au passage, au pouvoir que procure l’inquisition anti – autoritaire.
Oui, j’exagère. Pour le moment nous ne brûlons que des livres ; et rares sont les personnes qui se servent de l’anti-autoritarisme pour obtenir elles-mêmes du Pouvoir ou régler des comptes (voire faire payer aux autres leur frustration de s’astreindre à des comportements qu’elles-mêmes jugent adéquats ?) – Ces quelques exemples provocateurs pour que ne soit pas oublié le fait que nous sommes aussi pétris d’enjeux qui ont plus trait à la psychologie qu’à la politique…
Les années de lutte pour se faire entendre l’importance de porter une attention aux dynamiques que nous reproduisons ; de souffrance liées aux déceptions, aux ruptures ; la frustration de n’être finalement rien d’autre que des produits de ce monde ; la perte du sentiment de faire partie de quelque chose qui nous dépasse ; et le bain dans lequel nous sommes, qui distille cette idée que le pouvoir circule en nous, nous ont rendu complètement paranoïaques à certains égards, et extrêmement méfiant.es. Et force est de constater que notre méfiance s’avère à des égards justifiée, que les histoires d’abus ne manquent pas, et renforcent ce processus. L’excès de confiance peut aussi être problématique, je me dois de l’écrire. Mais j’ai l’impression que nous avons parfois tout mélangé, et trop généralisé. Nous voyons le mal autoritaire partout.
Et j’insiste là principalement sur les comportements, mais il en va de même des idées. On lisait que le féminisme pourrait « dévitaliser » l’anarchie. On entend que parler de préparation individuelle, c’est forcément exclure la question sociale. Que faire de la propagande, c’est chercher à manipuler.
On condamne une initiative, un texte, au prétexte qu’il ne prend pas suffisamment ses distances avec telle ou telle idée que l’on ne partage pas. On se méfie d’une idée, parce que d’autre manipulent le même sujet, peut importe s’il.elles en disent des choses tout à fait différentes.
Finalement, peut-être que de la même façon que la menace du réformisme et du repli identitaire a détourné de nombreuses personnes des questions soulevées par l’analyse des oppressions systémiques, d’autres, ou les mêmes, voient dans une idée ou l’autre les prémisses d’une prise de pouvoir, d’une manipulation, d’un calcul politicien, d’alliances nauséabondes. Il semble alors qu’il n’y ait plus aucune confiance, mais bien cette même suspicion, cette même crainte de participer à nourrir la Bête autoritaire. Et que nos débats, précieux s’ils en sont, sont gangrenés par des procès d’intentions. On passe tellement d’énergie à gérer nos tensions internes et nos impulsivités pendant des discussions, qu’il ne nous en reste plus tellement pour prendre le recul nécessaire à se comprendre..
Parlons de ces risques potentiels, puisqu’ils existent. Mais parlons sans se sentir menacé.es, sans faire de raccourcis, sans accusations, sans jugements hâtifs, en ayant le souci de se comprendre, de valoriser aussi les éléments qui rassurent…
Voilà des questions que j’ai envie de poser : pourquoi sommes-nous devenu.es si méfiant.es ? En avons-nous conscience ? Et surtout, surtout, quel est le prix à payer de cette méfiance ? Que coûte t’elle à nos dynamiques, à nos espaces, à nos relations, à nos perspectives, à notre santé mentale ?
Quelles conséquences sur les individus, que de sentir cette suspicion constante, que de se sentir potentiellement jugé.e en permanence ? Que de sentir le regard du groupe qui analyse potentiellement chacun de nos gestes ? Des initiatives, des envies qui ne sont pas réalisées, parce que « la flemme de devoir se justifier » ?
N’avons-nous pas poussé le bouchon un peu loin avec nos craintes de reproduire des facettes du monde que l’on déteste ? Pourquoi ne pas se méfier aussi de la production d’un modèle de pensé étriqué, uniforme ? De modes de se relationner, d’individus, uniformes ?
Nous voulons tendre vers la liberté, vers l’autonomie, vers la chose juste. Mais je ne pense pas que c’est en abusant de prévention, en pourchassant avec autant d’acharnement des spectres que nous y parviendrons, ni même que nous nous en approcherons.
Croyez-bien que ça me fait mal de l’écrire, mais on manque de foutue tolérance ! De confiance, de respect, de considération pour les tentatives des un.es et des autres. Qu’elles soient « politiques », « individuelles » ou bien les deux.
Pour un milieu qui se targue de lutter contre les croyances, nous en sommes pétri.es. Ainsi, quand nous croyons quelque chose, que nous avons de la méfiance envers une personne, des idées ou des initiatives, nous voyons tout sous le prisme de cette méfiance, et ajoutons (aveuglément ?) tous les éléments à notre disposition qui nous confortent dans notre pensée. Nous discutons avec d’autres, et propageons notre analyse. Nous réconfortant ainsi dans notre jugement, et le transmettant par la même occasion. La réalité est bien souvent interprétable, et la vérité une chimère lointaine. Alors n’avons-nous pas oublié d’essayer de prendre du recul, de questionner nos jugements, de se méfier de nos évidences, de s’interroger sur nos enjeux, d’essayer de voir au-delà des présupposés, d’écouter, ou de laisser une chance au débat contradictoire ? Avons-nous tellement aiguisé nos regards qu’ils ne nous permettent plus de voir autre chose que ce que l’on cherche tant à démasquer ?
Et si l’on admet aussi le rôle de notre sentiment d’impuissance collective dans tout ça, ne serait-il pas pertinent de se demander si cette méfiance ne participe pas à nous maintenir dans cette impuissance ? Et, un tout petit peu plus loin dans la réflexion, est-ce que ce rejet de l’autoritarisme et du Pouvoir, ne se transforme pas aussi en rejet de la puissance, de la force, de l’ambition, de la réussite, choses qui à première vue pourraient sembler nécessaires à un mouvement qui se targue de vouloir bouleverser l’Existant et la Normalité ?
Nous avons tou.tes de bonnes raisons d’être sur les dents. Mais nous avons d’aux moins aussi bonnes raisons de questionner ces réflexes. D’en saisir les travers. Moi-même j’échoue bien souvent à déposer les armes quand c’est possible. Mais j’ai envie d’essayer, parce que ça me semble vital si l’on veut que nos idées et nos révoltes perdurent.
Comme nous essayons d’user de justesse avec nos remèdes et nos potions, de les préparer avec le soin et l’amour qui convient, remettons aussi une juste mesure et de la douceur dans nos jugements.
[1] J’écris Pouvoir avec un P majuscule (Pouvoir sur), pour le distinguer du pouvoir d’agir (pouvoir de).
[2] Évidemment certains actes exigent des réponses fermes. Mais tout les actes ne se valent pas, et ne méritent pas les mêmes réactions.
[3] Nos compagnon.nes ont bien sur le potentiel d’incarner la catégorie sociale qui fait d’eux.elles des oppresseurs. Et parfois, dans des situations, il.elles l’incarnent vraiment. Pour autant deviennent-il.elles des ennemi.es à abattre ?
Première parution dans La Houle #1 : Printemps 2024.
Une réponse à ce texte a été publiée dans le numéro 2 de la revue La Houle. Des exemplaires sont disponibles sur demande en écrivant à bouteillealamer@@@riseup.net.
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (75.2 kio)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (97.4 kio)