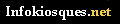K
Kourou ville des astres
Escale au port spatial de l’Europe
mis en ligne le 16 août 2020 - Celia Izoard
« Et qu’est-ce qui t’a donné envie de travailler dans le spatial ? » Il est midi sur la terrasse ensoleillée du Karting Relais Spatial, situé à quelques ronds-points de l’entrée de la base de Kourou. Guillaume, jeune ingénieur du Centre national d’études spatiales (Cnes), avec ses grands yeux bleus et son air impeccable de garçon de bonne famille, vient d’expliquer que les fusées qu’on assemble ici se suivent et se ressemblent. Dans « cette gare », comme il appelle la base, les fusées n’envoient pas des humains mais des satellites dans l’Espace. La société ArianeGroup (Airbus et Safran) vend ce service à des clients internationaux pour une bonne dizaine de lancements par an – la plupart à vocation commerciale ou militaire. Mais cette fois, interrogé sur ses rêves, il répond sans hésiter : « Christophe Colomb a découvert les Amériques en 1492 – ça a généré ce que ça a généré, on ne va pas refaire l’Histoire –, et l’étape d’après, c’est hors de la Terre. On a conquis le sol et maintenant, depuis cent ans, on va voir au-dessus. »
Dans le monde de l’industrie spatiale, impossible de faire un pas sans cogner la figure de Christophe Colomb. Le module de recherche européen de la Station spatiale internationale s’appelle Columbus. En 2019, il sera rejoint par Bartolomeo, prénom du frère de Christophe, un module externe qui permettra à Airbus de vendre à ses clients des expériences orbitales clés en main [1]. À la Cité de l’Espace de Toulouse – cette ville dominée par l’aéro spatiale et les commandes de satellites –, le visiteur est accueilli par un hologramme résumant les enjeux de l’exploration spatiale :
« Pourquoi envoyons-nous de coûteux objets dans un environnement aussi hostile que l’Espace ? Pourquoi les hommes veulent-ils sortir de leur cadre de vie habituel ?... Souvenez-vous de l’esprit de découverte de Christophe Colomb et de Magellan. Les satellites explorateurs seront les grands découvreurs du XXI e siècle... Les aventuriers de demain et de jadis sont les astronautes qui se préparent à la conquête de l’Espace. »
À Kourou – ville au nom amérindien érigée sur un territoire de savanes autrefois densément peuplé, dont les habitant·es furent contraint·es, après la conquête, de refluer vers l’intérieur des terres, décimé·es par le choc microbien ou massacré·es par les Européens –, on peut s’étonner que la figure de l’explorateur légendaire qui longea les côtes guyanaises dès 1498 puisse être convoquée aussi naïvement comme étendard de l’insatiable curiosité humaine. Guillaume, cependant, n’a pas manqué de tempérer la référence par une allusion gênée à la découverte des Amériques. Il ne fréquente pas d’Amérindien·nes, mais il a vu un jour à la télé un reportage où s’exprimait leur regard sur le spatial et ne l’a pas oublié : « Ils ont une approche de la vie qui est différente, ils voient des choses qui sont plus métaphysiques, mais qui sont aussi intéressantes que les confins de l’Univers. On est un peu concons, d’un côté, parce qu’on veut toujours aller voir plus loin, mais on ne regarde pas comme il faut les choses qui sont déjà là. »
La brève histoire de Kourou illustre de façon saisissante ce troublant décalage entre
« l’esprit de découverte » et cette manière de ne pas « regarder comme il faut les choses qui sont déjà là ». Les explorateurs regardent-ils où ils marchent ?
Le destin de Kourou est indissociablement lié à l’indépendance de l’Algérie. Conformément aux accords d’Évian de mars 1962, l’État français doit déplacer la base de lancement de missiles, devenus des fusées, constituée depuis 1947 dans le village saharien de Béchar (rebaptisé Colomb-Béchar, en hommage à un officier de l’armée française). En 1964, le site de Kourou est choisi pour la recevoir, autant en raison de sa proximité avec l’équateur [2] que pour sa faible densité de population : la Guyane compte alors un peu plus de 30 000 habitant·es. « Au cas où notre gros pétard pète, ça ne tuera personne », dit alors Yves Dejean, l’un des responsables de la construction du Centre spatial guyanais (CSG), devenu par la suite conseiller municipal de Kourou. Ainsi, « l’échec répété des Français, au fil des siècles, pour accroître la population du territoire, se métamorphosa en un vide opportun » [3].

La base spatiale, d’où décollera la première fusée-sonde en avril 1968, est établie sur une zone de 700 km2, soit presque sept fois la superficie de Paris. Mais le site choisi n’est pas la terra nullius dont rêve le général de Gaulle. Quoique faiblement peuplée, la commune de Kourou compte tout de même 660 habitant·es réparti·es entre le bourg et de nombreux hameaux dont les terres environnantes sont des lieux de pêche, de chasse et d’agriculture itinérante sur abattis [4]. À partir de 1964, les familles paysannes des petits villages de Renner, Malmanoury et Karouabo, 300 à 400 personnes au total, sont expulsées et relogées dans des lotissements, provoquant un traumatisme durable qui alimente jusqu’à aujourd’hui le malaise de Kourou [5].
La nouvelle ville, surnommée Kourou la blanche par les Guyanais·es, est construite de toutes pièces pour loger les quelques milliers d’employé·es du CSG. Son plan urbain est un calque des rapports hiérarchiques existant au sein de la base. Dans les bureaux du CNRS, à Cayenne, Marianne Palisse, anthropologue à l’université de Guyane, et Bettie Laplanche, en master 2 de géographie, nous montrent une carte tirée d’un atlas de 1979 : « Les bâtisseurs de Kourou sont arrivés avec leur vision métropolitaine des années 1960 : “Le bord de mer, c’est agréable.” Donc la villa du directeur du CSG a la plus belle vue sur la mer. Derrière, les villas des hauts cadres. Derrière, les villas des cadres de rang inférieur, puis les ouvriers de maîtrise. Enfin, les logements de chantier pour Brésiliens et Colombiens... C’est une vision complètement stratifiée socialement. » Kourou n’est pas une ville, mais un organigramme.
Autre problème, les constructeurs ont ignoré une caractéristique essentielle du lieu : l’extrême mobilité du littoral. Les côtes de la Guyane sont situées dans le bassin de l’immense Amazone, dont le débit est le plus élevé du monde. Les sédiments charriés par le fleuve s’accumulent et forment d’immenses bancs de vase qui se déplacent. En quelques décennies, le littoral alterne entre des phases de sédimentation pendant lesquelles la mangrove s’installe et des périodes d’érosion spectaculaires du trait de côte.
« Ce n’est pas un hasard si le vieux bourg créole de Kourou n’a pas été construit sur la côte, mais en fond d’estuaire, explique Marianne Palisse. Toutes les habitations situées sur la côte, qu’elles soient créoles ou amérindiennes, étaient construites en matériaux légers : murs en gaulettes [branchages croisés, ndlr], toits en palmier waï. Ces gens étaient très mobiles, et cette mobilité était facilitée par le fait que la terre n’était pas sous le régime de la propriété privée : sur ces terres “vacantes et sans maîtres”, Amérindiens et Créoles s’installaient où ils voulaient. Si un banc de sable se formait, que le littoral devenait pourri parce qu’une mangrove arrivait, ils allaient un peu plus loin, recentraient leurs activités sur les ressources de l’intérieur. C’était une vie en harmonie avec le milieu extrêmement mobile qu’est l’Amazonie. Mais quand le CSG s’est installé, les savoirs des populations locales ont été complètement ignorés. »

Aujourd’hui, Kourou prend l’eau. En quelques années, la côte a reculé de plusieurs centaines de mètres, et la mer a déjà englouti une route et plusieurs maisons du « village amérindien », un quartier où ont été relogés, après plusieurs déplacements, les familles amérindiennes venues défricher la forêt pour la construction du centre spatial. Totalement enclavées dans la ville, elles sont désormais cernées par la mer et le béton. Un peu plus loin, toute une bande d’habitations côtières appartenant à des entreprises sous-traitantes du CSG – aujourd’hui constitué principalement du Cnes, d’ArianeGroup et de l’Agence spatiale européenne – est menacée.
Au bord de la plage, un amoncellement de big bags de sable témoigne des efforts de la mairie pour empêcher l’érosion. Peine perdue. Une première digue a récemment été emportée. Les ingénieurs du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) préconisent maintenant l’installation sur les plages de caméras de haute précision dont les images seraient « téléchargées en temps quasi réel pour analyse et
traitement ». Pour sonder l’évolution des fonds marins, Shell – détenteur initial du permis de forage pétrolier au large de la Guyane – a financé un sonar à balayage latéral et un système de « sismique réflexion » pour le BRGM. Mais ce véritable tir de barrage high-tech, s’il peut constater et anticiper l’évolution, ne résout pas le problème : que faire face à la submersion des habitats ? Le BRGM [6] envisage deux options, moins sophistiquées : la construction d’une digue pérenne ou semi-pérenne, ou, plus simplement, un « repli stratégique ».
« Les architectes et ingénieurs métropolitains ont construit cette ville avec une volonté très pionnière de maîtrise de l’environnement, poursuit Marianne Palisse. Ils ont creusé des lacs, bouché les marais en prenant du sable sur la plage. Mais la suppression des pripris par exemple, ces zones tour à tour marécageuses et sèches selon la saison, crée des inondations accrues en saison des pluies. Cette artificialisation pose de grands problèmes de vulnérabilité. »
Autre ratage, de taille : le barrage hydroélectrique de Petit-Saut, construit par EDF et Vinci de 1989 à 1994 pour satisfaire les besoins d’une population croissante désormais équipée en électroménager, mais aussi, en premier lieu, afin d’« assurer l’alimentation électrique de la base pour le programme Ariane V » [7]. Car le CSG reste aujourd’hui le premier consommateur du territoire (20 % de l’électricité guyanaise [8]). Situé à une trentaine de kilomètres du centre, le lac du barrage, de loin le plus vaste de France, a fait disparaître plus de 370 km2 de forêt primaire et toute la faune et la flore associées [9]. Mais si les associations environnementales qualifient le barrage de
« Tchernobyl guyanais », c’est pour d’autres raisons.
Dans le lac, l’ensemble de la biomasse végétale engloutie, en se décomposant, a entraîné des dégagements de gaz à effet de serre inattendus, si bien qu’« en un siècle, le barrage (...) est susceptible de produire autant de gaz à effet de serre en équivalent carbone qu’une centrale thermique à gaz de même puissance » [10]. Cette décomposition a également désoxygéné les eaux : en 2014, seize ans après la fin de la mise en eau du barrage, plus de la moitié des espèces de poissons avaient disparu [11]. Autre phénomène gravissime qu’EDF reconnaît avoir négligé : à l’interface entre la couche d’eau oxygénée de la retenue et l’autre, plus profonde, sans oxygène, des bactéries ont la propriété de transformer le mercure, naturellement présent dans les sols et accumulé par plus d’un siècle d’orpaillage, en méthylmercure, la forme la plus toxique du mercure car assimilable par les organismes des êtres vivants [12]. Selon le géochimiste Bogdan Muresan Paslaru, le barrage peut donc être comparé à « un véritable réacteur biogéochimique » : à sa sortie, l’eau affiche un taux de méthylmercure trois fois plus important qu’à l’entrée [13].
Le sort de Kourou offre pleinement à méditer sur « l’esprit de découverte » dont ses promoteurs se réclament. Pour ses bâtisseurs, happés par le projet grandiose de la conquête spatiale, le territoire fabuleux où ils ont élu domicile ne semble jamais avoir été autre chose qu’un tremplin. Ici, la technocratie étatique à la française a fait table rase du passé pour lui substituer le modèle de la monoactivité industrielle et de l’urbanisation hors-sol.
« Une brillante fresque d’avant-garde »

Le visiteur naïf qui débarque pour la première fois à Kourou en espérant découvrir la ville à pied comprendra bien vite qu’il n’a rien compris. Le soleil tape dur sur les avenues interminables bordées de casernes et d’immeubles. On cherche le centre-ville. Il n’y en a pas. Bientôt, on erre dans un puzzle de cités HLM qu’on imagine être une banlieue, on passe un MacDo et un Super U en ayant le sentiment d’être le dernier piéton de l’humanité. Kourou, c’est ici, voilà tout. Vous y êtes. La ville est « sans cœur », comme on dit ici. Il faut atteindre la mer pour avoir l’impression d’être arrivé quelque part, mais là aussi, la plage s’étend le long d’un espace urbain fragmenté que rien ne tisse à part le goudron et le ciment. Comme les « villes
nouvelles » du pourtour parisien, bâties dans les années 1960 sur décision de De Gaulle, Kourou, plus de 26 000 habitant·es aujourd’hui, est une ville-dortoir dont tout le monde se plaint. Du fait des écarts de richesse considérables entre professionnels qualifiés du CSG – qui gagnent aux alentours de 5 000 euros par mois – et le reste de la population, souvent venue des pays frontaliers et parfois employée au noir pour quelques dizaines d’euros par jour. La délinquance est considérable. Ici, me dit-on, les gens ont peur et restent entre eux – les Créoles, les Saramakas, les Amérindien·nes, les légionnaires, et bien sûr les « missionnaires » du spatial, installés pour des contrats de trois à six ans dans des quartiers de villas clos et silencieux.

La médiathèque pourrait servir de refuge, mais elle est loin, elle aussi, bordée par un immense lac et de grandes artères, un peu comme un château fort. Dans la veine contemporaine, le bâtiment est plutôt réussi, avec sa charpente en bois tropical et ses coursives intérieures. « Elle est belle, mais vide », lâche le bibliothécaire à l’entrée.
« La moitié des livres ici sont à jeter, et nos commandes de nouveautés ne sont pas prises en compte. » J’ai demandé des livres sur le spatial, et dans la ville d’Ariane, baptisée « le jardin des étoiles » par son maire actuel, François Ringuet, je m’attendais à en trouver des rayonnages entiers, comme dans les bibliothèques toulousaines. « Je n’en ai que deux », indique le bibliothécaire, blasé. Le premier est du Cnes, Cinquante ans d’aventure spatiale [14], et le second est une brève monographie du CSG datant des années 1990. Sur sa quatrième de couverture, je lis :
« L’installation du CSG en Guyane a aidé à la transformation de la vieille image malsaine et galvaudée de cette contrée (de l’enfer vert au bagne) en une brillante fresque d’avant-garde. » [15] Les Kourouciens apprécieront la modestie de nos élites.
À l’heure de son 50 e anniversaire, le récit de cette brillante épopée est revisité à l’envi dans les publications du CSG, qui met à l’honneur « les pionniers de l’aventure Ariane », « la formidable aventure humaine » des lancements des cargos ATV (engins automatiques de ravitaillement) pour approvisionner les astronautes de la SSI entre 2008 et 2014, jusqu’à l’actuel chantier titanesque de construction du pas de tir d’Ariane 6. Du point de vue de l’État français, le succès est indéniable : les fusées de Kourou l’ont bel et bien propulsé au rang de puissance mondiale et de leader spatial européen.
Côté guyanais, le CSG est un sujet de controverse permanent. En 1994, la décision, pour sécuriser les activités spatiales, de fermer l’accès du public à l’unique route nationale du territoire sur le tronçon reliant Kourou à Sinnamary provoque une crise politique qui ne s’apaisera qu’avec la promesse gouvernementale d’augmenter la contribution du spatial à l’économie locale [16]. Pour traverser la Guyane de Cayenne à Saint-Laurent-du-Maroni, la route de contournement rallonge depuis le trajet d’environ 17 kilomètres. De plus, nombre de Guyanais·es n’ont pas fait le deuil des terres encloses par la base : aujourd’hui encore, malgré la fermeture de la nationale, rebaptisée Route de l’Espace, « les gens essaient d’aller pêcher ou chasser sur le CSG et se font arrêter par les gendarmes », explique Marianne Palisse.
Évoquant l’installation de la base, Robert Vignon, premier préfet puis sénateur de Guyane, dans les années 1960, décrivait le chantier du centre spatial comme un « coup de fouet salutaire dont bénéficia toute la population alentour » [17]. L’image du coup de fouet est éloquente : elle ouvre sur tout un imaginaire colonial, la nécessaire mise au travail de populations indigènes nonchalantes. Face à l’hostilité latente des locaux, le CSG, plus délicat, se présente aujourd’hui comme « une opportunité pour la Guyane » qui bénéficie de ses « retombées » [18] (terme restant malgré tout assez maladroit, vu les pollutions induites et le risque bien réel de l’explosion d’une fusée à son lancement). Dans sa communication, le CSG rappelle à l’envi son rôle de « moteur économique » : « Les 1 700 emplois directs répartis dans une quarantaine d’entreprises sur la base génèrent 5 fois plus d’emplois induits dans l’économie guyanaise, soit 12 % de la population active. Avec plus de 300 fournisseurs et 10 % du PIB [de la Guyane, ndlr], le spatial contribue largement aux recettes fiscales des collectivités », peut-on lire dans le fascicule distribué pendant la visite gratuite du centre.
Pour les Guyanais·es, des poussières d’étoiles ?
Au milieu des barres d’immeubles et des longues avenues de Kourou, le « village saramaka » est le quartier d’habitation des communautés marronnes venues du Suriname voisin dans les années 1960 pour édifier le centre spatial. Initialement quartier auto-construit, qualifié de « bidonville » par Mitterrand lors de sa visite de 1985 (« On tire des fusées des toits des bidonvilles »), le village saramaka est rénové à partir de 1994 dans le cadre d’une opération Résorption de l’habitat insalubre à laquelle les habitants ont participé [19]. Dans ses ruelles bordées de maisons en planches et en ossature bois, avec leurs porches qui rappellent les habitations des quartiers noirs du Mississippi, on retrouve un espace à taille humaine. C’était manifestement aussi l’avis de l’ingénieur du Cnes qui m’a proposé de le retrouver « dans ce quartier sympa » devant un stand de brochettes. « La moitié des locaux n’ont pas une bonne image du centre spatial, explique-t-il. Les prix en supermarché, dans l’immobilier, sont fait pour les missionnaires, alors quand tu n’y es pas, tu rames. Pendant le mouvement social de 2017, j’avais vraiment l’impression d’être un pestiféré, un profiteur qui vient ici prendre l’argent et qui s’en va. La Mission Guyane distribue des sous aux écoles et aux assos pour apaiser ce sentiment. »
Créée en 2000, la Mission Guyane regroupe les subsides distribués sur le territoire par le CSG. La manne n’est pas négligeable : le centre annonce 50 millions d’euros de fonds débloqués pour la période 2014-2020, soit un peu plus de 8 millions par an. Pour sa part, la commune de Kourou – qui affichait il y a quelques années quelque 20 millions d’euros de déficit – reçoit 150 000 euros par an du centre spatial qu’elle se charge de redistribuer aux associations. Mais l’une des revendications du mouvement social de 2017 porte sur l’immunité fiscale du secteur spatial : l’Agence spatiale européenne, maître d’ouvrage des infrastructures et des programmes de lanceurs, est exonérée de toutes taxes et autres impôts ; l’importation des lanceurs et des satellites est elle aussi défiscalisée (pas d’octroi de mer [20]) ; et le Cnes ne paie que 150 000 euros par an de taxes foncières [21]. « Bien que le CSG soit dominé par le privé (ArianeGroup), le Cnes n’assurant plus qu’un rôle de contrôle et de sécurisation, il faut voir la base spatiale comme une base militaire, explique Nico, lui aussi ingénieur au Cnes. C’est une zone où la réglementation française ne s’applique pas de manière ordinaire. »
Du fait de ce régime d’exception, l’argent versé par le CSG sur le territoire s’apparente en partie à du mécénat d’entreprise. Il finance un concours d’
« oiseaux bioniques » dans les lycées guyanais ; des start-up du numérique ; une
« pirogue de l’Espace » pour sensibiliser les jeunes Amérindien·nes de l’intérieur des terres à la culture spatiale... La manne du spatial fait moins l’objet d’une redistribution – au sens d’un impôt perçu et redistribué par les pouvoirs publics – que d’une gestion philanthropique qui lui permet de « travailler » la société en fonction de ses priorités.
Où un grand projet inutile de 650 millions d’euros passe inaperçu
« Merci d’avoir pris place à bord du bus de l’Espace... » Dans l’autocar qui sillonne les installations du CSG sur l’ancienne nationale, deux jolies jeunes employées du CSG se relaient au micro pour présenter l’histoire de la conquête spatiale, les caractéristiques des trois lanceurs – Ariane 5, Vega et Soyouz –, les conditions de sécurité sur la base, etc. Abordée en fin de visite par un exposé suivi d’un film, la question de la pollution par l’activité spatiale est traitée avec un soin particulier.
« Comme toute activité industrielle, le centre spatial a un impact sur l’environnement » : à chaque lancement, un immense nuage de combustion dégage du gaz chlorhydrique et des particules d’alumine sur plusieurs kilomètres à la ronde, mais cela serait indétectable au-delà de 8 kilomètres. Des fosses en béton de 18 mètres de profondeur recueillent les particules acides du nuage au moyen d’un gigantesque rideau d’eau d’un débit de 9 m 3 par seconde – dit « le Déluge » – qui permet de retraiter les eaux acides à la soude avant de les rejeter dans l’environnement.
Des organismes indépendants effectuent plusieurs fois par an des prélèvements dans les cours d’eau environnants, sur les ruches d’abeilles mélipones, les plumes des oiseaux, les poissons. Tous les résultats d’analyse sont disponibles en mairie et sur le site Internet du Cnes... Un petit film sur la « biodiversité au Centre spatial guyanais » achève de nous rassurer : non seulement « l’impact reste mineur » sur le site, mais « l’interdiction du port d’armes et l’accès réglementé permettent le développement d’une biodiversité très riche ». « Ici, on arrive à observer des espèces qu’on ne trouve plus hors du centre spatial », renchérit un expert de l’Office national des forêts (ONF). Singes hurleurs, tamanoirs, rongeurs capybaras, une population stable de 2 000 couples d’ibis rouges, deux jaguars pucés baptisés Spoutnik et Galilée... Une véritable arche de Noé ! Le quasi-documentaire animalier s’achève sur ce slogan métaphysique : « Au Centre spatial guyanais, nous gagnons l’Espace sans perdre la Terre. »
On quitte le CSG avec le sentiment d’avoir été, littéralement, baladées. Plus tard, dans Kourou, rencontrant par hasard un jeune naturaliste de chez Hydréco, l’un des organismes chargés de la surveillance des eaux, je m’empresse de lui demander un état des lieux. « Je ne suis absolument pas autorisé à t’en parler. Toutes nos données appartiennent au Cnes, et lui seul a le droit de les publier. » En somme, les experts sont indépendants, mais muets comme les carpes des rivières alentour : le Cnes reste totalement maître de la diffusion des données.
Mars Habitat
La NASA travaille à investir la planète Mars, et chez les architectes, les cerveaux fument. En 2015, l’agence Foster + Partners, déjà mise à contribution pour concevoir un immense viaduc au-dessus de Millau, propose de magnifiques modules. Ceux-ci devraient être construits sur Mars par des robots avant même l’arrivée des conquistadores de l’Espace.
Et le chantier Ariane 6 ? Étonnant, en trois heures de visite, il a été très peu évoqué, sinon pour vanter les avantages commerciaux du nouveau lanceur, conçu dans l’espoir de concurrencer les fusées réutilisables de la société états-unienne SpaceX. Dommage ! Car à l’heure du débat public sur le projet de méga-mine de Montagne d’or, la construction du neuvième pas de tir du centre spatial, pour un coût annoncé de 650 millions d’euros, est de loin le plus grand chantier actuellement en cours en Guyane. Le nouveau complexe de lancement s’étendra sur 170 hectares (340 terrains de football), dont 18 de bâtiments et de plateformes. Il comprendra une structure en béton de 200 mètres de long, 20 de haut et 20 de large, un portique mobile de 8 200 tonnes, un bâtiment d’assemblage doté d’une charpente métallique de 6 500 tonnes (celle de la tour Eiffel en pèse 8 000), un château d’eau, une centrale frigorifique... Cette opération pharaonique a déjà nécessité 14 tirs de mines pour creuser le granite, la création de deux carrières de sable sur le site, le déplacement de près d’un million de mètres cubes de matériaux et, sur les seuls cinq premiers mois, 6 600 rotations de camions dumpers et la circulation de 500 poids lourds chaque jour [22].
Or notre visite dans le bus de l’Espace nous l’a rappelé : ce chantier se déroule dans une zone à la biodiversité prodigieuse, un véritable refuge animalier où la forêt tropicale jouxte les clairières ouvertes sur les savanes et les pripris. Comme le relèvent méticuleusement les services du Cnes, la zone, située sur la commune de Kourou, est habitée, excusez du peu, par 32 espèces différentes d’amphibiens, 16 de reptiles, 128 d’oiseaux et 16 de grands mammifères particulièrement protégés tels que le jaguar, le puma, l’ocelot, le tamanoir... Malgré deux avis défavorables (mais purement consultatifs) du Conseil national de la protection de la nature (CNPN), les travaux ont commencé à l’été 2015, un an avant l’enquête publique organisée en juillet 2016, sur Internet, à propos du « volet environnemental » du chantier [23].
Pour se conformer à la loi française sur la biodiversité, le porteur d’un projet de ce type doit, faute de renoncer à détruire des milieux naturels, les « compenser », c’est-à-dire financer la gestion conservatoire ou la restauration d’une zone d’intérêt écologique « équivalente ». À l’heure du réchauffement climatique et de la sixième extinction de masse des animaux, le principe de ce droit à polluer est en lui-même d’une inconséquence cynique, d’autant que les industriels arrachent souvent aux services étatiques des compensations au rabais. Mais dans le cas du chantier Ariane 6, avec l’État aux commandes par le biais du Cnes, on aurait tout de même pu s’attendre à des mesures exemplaires pour la destruction de ce joyau amazonien. Surprise : le Cnes a eu l’étrange idée de céder, en échange, au Conservatoire du littoral deux parcelles dont l’une, une zone de 700 hectares, est située pour moitié sur... le champ de tir de la Légion !
Mis·es devant le fait accompli alors que le chantier avait débuté depuis plusieurs mois, certain·es élu·es de Kourou se sont insugé·es, mais aussi le général de division Pierre-Jean Dupont, commandant de la base de défense guyanaise, qui exprime sa perplexité dans un courrier au directeur du Cnes. En toute logique, il s’attendait à ce que cette cession implique l’arrêt immédiat de toute activité militaire sur le site. Mais non ! Le Cnes ne prévoit aucune reconversion de la zone, qu’il entend simplement faire valoir, telle quelle, en tant qu’espace naturel préservé. Début août 2016, le préfet entérine par arrêté cette « compensation », jugeant que « les activités d’entraînement des Forces armées de Guyane sont compatibles avec le maintien en zone naturelle ». Pour éviter les tirs, les animaux pourront toujours aller se réfugier sur les terres du CSG, où la chasse est interdite.
Une ville hors-sol
Dans un article consacré à Kourou qui met en rapport la dimension impérialiste de la conquête spatiale et l’histoire coloniale de son territoire d’implantation [24], l’anthropologue états-unien Peter Redfield analyse une affiche diffusée en 1994 par le CSG. Sur la droite de l’image, sous le slogan « L’Espace : les enjeux du futur ! », trois portraits en médaillons d’astronautes français dans le ciel, loin au-dessus de la forêt amazonienne. Sur la gauche, suspendus au milieu des étoiles, des astronautes achèvent la construction d’une immense tête de cyborg doré qui occupe le tiers de l’image. « Significativement, commente Peter Redfield, on n’aperçoit aucune silhouette humaine dans la forêt, alors que l’image de l’un des astronautes se reflète dans la joue scintillante du géant qu’ils sont en train de créer. Ce nouvel être transcende à la fois la chair et le territoire (...). Les acteurs locaux du centre spatial témoignent d’aspirations extra-locales, d’un désir de mobilité hérité d’une longue histoire coloniale. »

La « brillante fresque d’avant-garde » que les dirigeants du CSG se targuent d’avoir enluminée à Kourou est un projet singulier issu d’une soif platonicienne d’élévation hors de la matière, de la nature et de l’animalité. Malgré les efforts du CSG pour augmenter la part d’ingénieurs guyanais dans les équipes de la base, le projet reste fondamentalement hors-sol, tourné vers le Graal céleste de la grande épopée occidentale, le rayonnement universel de la « civilisation ». De ce fait, la poursuite de la « dernière frontière », encore totalement soumise à ses démons impérialistes, se heurte douloureusement à l’histoire des habitant·es de la Guyane.
Rien d’étonnant, donc, à ce que les Guyanais·es aient un beau jour décidé de clouer les fusées au sol en occupant le rond-point du CSG « pour que la Guyane décolle ». Certes, le slogan du printemps 2017 témoigne de l’ambivalence de la population vis-à-vis de ce projet occidental de
« développement ». Dans l’esprit d’une partie du mouvement, qui rassemblait toute les élites politiques et économiques locales, ce « décollage » renvoie à la revendication d’une pleine participation au modèle capitaliste jusque dans sa soif de marchandises et d’artificialisation.
Mais pour la majorité, « pou la Gwiyann dékolé » est un pied-de-nez jubilatoire, une exigence d’infrastructures minimales correctes dans un monde, déjà installé, qui les rend indispensables. Une réaction au voisinage exaspérant du superflu (des convois exceptionnels transportant des satellites à 200 millions d’euros) dans un monde où manque le nécessaire (des hôpitaux, des collèges, des transports publics). Plus rares sont ceux qui, comme Cindy, une jeune Amérindienne venue occuper le rond-point en vêtements traditionnels, contestent l’utilité sociale de l’industrie spatiale : « Une fois, au lycée, j’ai dit que ce n’était pas forcément utile de déployer tous ces moyens pour envoyer des fusées dans l’Espace et avoir des satellites. J’ai été huée par toute la classe ! Et ridiculisée par le prof. Mais pour moi, le spatial c’est pareil que le projet Montagne d’or. Des morceaux de fusées qui retombent un peu partout, de la pollution dans l’Espace. Les fusées nous en mettent plein les yeux, mais au final, la nature est laissée dans un état désastreux. »
La fusée, concentré d’industries extractives
Nico, la trentaine, est technicien chez Cegelec, l’un des sous-traitants du CSG à Kourou. Pour lui, comparé à l’industrie chimique où il a travaillé dix ans, près de Lyon, « le spatial ne pollue pas ». À l’inverse de Cindy, il considère ce secteur comme une forme d’antithèse de l’industrie : « Le spatial, c’est le truc le plus cool qu’on sait faire avec la technologie. C’est exactement l’opposé d’une grande mine d’or en Guyane. Plutôt que de faire un méga-trou dans le sol pour de la thune, je trouve ça plus intéressant de connaître l’Univers et de trouver des nouvelles technologies qui vont sauver des vies. » Nous aurions enfin développé une technologie vertueuse qui nous laverait de nos péchés. Quels péchés ? L’extractivisme, au sens large : la chimie pétrolière, la mine. Le spatial nous donnerait enfin l’occasion de tourner le dos aux industries destructrices de notre passé pour produire des objets salutaires (Nico cite « l’airbag et la couverture de survie » [25]).
Le problème est que la fusée, objet de puissance par excellence, est justement un condensé d’extractivisme. Pour gagner le ciel, il a fallu mettre au point les carburants les plus concentrés qui soient : les ergols. Un décollage d’Ariane 5 nécessite 130 tonnes d’oxygène liquide et 25 tonnes d’hydrogène liquide pour l’étage supérieur de la fusée, 14 tonnes des mêmes substances pour l’étage inférieur, ainsi que deux boosters contenant le carburant, énormes tubes de 4 mètres de diamètre et de 20 mètres de long chargés de 237 tonnes de perchlorate d’ammonium, de polybutadiène et d’aluminium, lesquels, une fois vides, atterrissent au fond de l’océan pour s’y dégrader très lentement [26]. À chaque lancement (une dizaine par an à Kourou, donc, et une centaine dans le monde), ce sont des quantités astronomiques de précieuses substances extraites du sous-sol et raffinées selon des processus complexes et polluants qui partent littéralement en fumée, dans l’atmosphère et dans le cosmos. Sans parler de l’ensemble des métaux et de l’énergie utilisés pour produire les innombrables pièces des satellites et des lanceurs dont la fabrication est éclatée sur cinq continents. Ainsi, c’est en partie pour les besoins de la filière aérospatiale dans le quart sud-ouest français qu’une mine de tungstène risque de rouvrir à Salau, en Ariège. Et comme toute la filière électronique sur laquelle il repose, le secteur spatial est un grand consommateur de terres rares [27] et autres métaux précieux, aux rangs desquels l’or figure en bonne place. Ces dernières années, le cours de celui-ci est d’ailleurs resté stable, malgré les aléas de la finance, du fait de la demande croissante du secteur industriel [28].
Quoi de plus éloigné, en apparence, de l’activité consistant à creuser les profondeurs terrestres que celle de s’élever vers les cieux ? Pourtant, loin de pouvoir être opposée au modèle extractiviste, l’activité spatiale n’en serait-elle pas le couronnement – la convocation de toutes les puissances extractivistes concentrées en un seul gigantesque tube de métal pointé vers le ciel ? Car si les grandes puissances fouillent frénétiquement le sous-sol, c’est pour édifier un monde hors-sol, un monde de béton et de métal qui recouvre les espaces naturels d’un habitat entièrement fait de main d’homme, dont la version « colonie spatiale » serait l’aboutissement. C’est là l’une des caractéristiques essentielles de notre modernité : une « révolte contre les conditions dans lesquelles la vie est donnée à l’homme », écrivait Hannah Arendt. Le projet industrialiste tel qu’il se déploie aujourd’hui est sous-tendu par le désir de reconstruire entièrement, par la technologie, l’habitat terrestre et l’humanité elle-même. Quiconque s’est promené dans les shopping malls de Los Angeles ou de Singapour a pu constater que nous habitons déjà la Terre comme s’il s’agissait d’une autre planète.
Et ce sont bien sûr les ressources puisées dans le sous-sol qui permettent de matérialiser ces rêves capitalistes de vie encapsulée et d’humanité cyborg. Chez l’une des premières puissances pétrolières du monde, le projet a même pris une forme littérale : en septembre 2017, le gouvernement de Dubaï a annoncé dans un communiqué le lancement du projet Mars Science City, la construction d’une ville sous dôme de quasiment 18 hectares destinée à « fournir un modèle viable et réaliste pour simuler la vie à la surface de Mars ». Elle comportera « un musée exposant les grandes prouesses spatiales de l’humanité », dont « les murs seront conçus par des imprimantes 3D à partir du sable du désert des Émirats. (...) Le Mars City Project s’inscrit dans la Stratégie Mars 2117 fixée par la fédération des Émirats arabes unis pour la construction des premières colonies sur Mars d’ici cent ans. » Certes. Mais n’est-ce pas là le délire d’une poignée de dirigeants aux cerveaux détraqués par la rente pétrolière, pendant oriental des richissimes Elon Musk et consorts, rendus fous par les milliards de la Silicon Valley ? Les satellites qui décollent de Kourou ne permettent-ils pas, en dehors de leurs usages militaires et commerciaux, d’explorer l’Univers et le fonctionnement de la Terre à des fins, en soi plus respectables, de connaissance ?
« L’Espace est l’avenir de l’humanité »
L’ouvrage Cinquante ans d’aventure spatiale est préfacé par Yannick d’Escatha, ancien président du Cnes, ingénieur des Mines et polytechnicien. En exergue de son texte, il a choisi cette célèbre formule de Konstantin Tsiolkovski, instituteur russe qui dessina dès la fin du XIX e siècle les premières fusées à étages et décrivit les futurs vols habités : « La Terre est le berceau de l’humanité, mais nul ne peut éternellement rester dans son berceau. » D’où vient cette idée de la vie terrestre comme stade infantile de l’humanité ?
Comme l’a montré l’historien états-unien David Noble, l’histoire de la conquête spatiale est imprégnée d’une mystique d’élévation depuis la Terre, lieu de l’animalité première, jusqu’au Ciel – qu’on appelle aujourd’hui Espace. Ainsi, Konstantin Tsiolkovski, qui avait pour mentor un mystique russe du nom de Nikolaï Fedorov, concevait l’ascension vers les cieux comme une manière pour l’humanité d’accomplir sa destinée en renouant avec sa nature divine. Ce millénarisme est aussi largement présent chez Wernher von Braun, père fondateur de la conquête spatiale [29], concepteur pour la Nasa de la fusée Juno qui plaça le premier satellite états-unien dans l’Espace, puis des lanceurs Saturn des missions Apollo sur la Lune. Pour lui, satellites et vaisseaux spatiaux devaient permettre de libérer « l’Homme », « conçu à l’image de Dieu », de « la forme animale dans laquelle il a été condamné à s’incarner ».
« Si l’Homme est l’alpha et l’oméga, écrivait-il en 1959, alors il est fondamental, pour des raisons religieuses, qu’il voyage vers d’autres mondes, d’autres galaxies ; car c’est peut-être le destin de l’Homme que de conquérir l’immortalité, non seulement celle de sa propre race mais aussi de l’étincelle de vie elle-même. (...) En ce jour futur où nos vaisseaux satellites encercleront la Terre, les guerres fratricides seront bannies de l’étoile sur laquelle nous vivons. » [30] Alors que, fait bien connu, les scientifiques français sont peu enclins aux accès de mysticisme, on peut s’étonner de retrouver, dans la préface de l’ancien président du Cnes, la trame d’un même millénarisme qui affirme sans ambages que « l’Espace est l’avenir de l’humanité » [31].
Ici, la conquête du ciel promet de nous libérer, non plus des « guerres fratricides », mais de la crise écologique planétaire, grâce aux « satellites qui seront nos anges gardiens en nous permettant de comprendre le fonctionnement complexe de notre planète, de maîtriser son avenir et de la garder habitable pour les générations futures, ce qui aujourd’hui n’est pas assuré pour une raison simple : nous savons comment la Terre fonctionne, mais nous ne savons pas comment nous pouvons la protéger, et donc protéger la vie. » La nature religieuse du scientisme contemporain s’énonce ici clairement : ce qui menace notre habitat terrestre n’est pas, comme on pourrait le penser, le modèle industriel et son rapport de force écrasant, mais un défaut de connaissance. Le salut viendra de l’omniscience divine offerte par les satellites, couplée avec des technologies démiurgiques.

« Terre sous surveillance »
Retour à Toulouse. En ce moment, à la Cité de l’Espace, une grande exposition initie les visiteurs aux enjeux actuels du secteur spatial : « Terre sous surveillance ». Aujourd’hui, les plus de 1 400 satellites opérationnels présents autour de la Terre permettent d’« assurer une collecte complète et permanente de ses données physiques et géographiques... afin de mieux gérer les catastrophes d’origine humaine ou naturelle ». Ils nous offrent des outils pour anticiper certains événements climatiques, mesurer l’évolution du niveau de la mer, localiser les ressources marines et assurer la sécurité des citoyens. Dans une salle, on peut géolocaliser des bébés lynx du Jura ou des ours polaires grâce à des balises de géolocalisation. Dans une autre, le visiteur peut faire une expérience de télémédecine : « Vous êtes infirmier en forêt guyanaise. Vous allez intervenir grâce aux satellites. »
Pas de chance pour le malade, l’écran tactile ne fonctionne pas. Ailleurs, on nous montre comment surveiller le déboisement de la forêt amazonienne grâce aux satellites, et sur un panneau « Exploiter les ressources », on peut lire que « les satellites d’observation révèlent les différents types de végétation ou de ressources naturelles comme les écoulements d’hydrocarbures. Grâce aux mesures radar, il est possible de détecter les différents minerais du sous-sol ; autant d’informations qui permettent une exploitation plus responsable du sol. »
La prétention de l’industrie spatiale à nous apprendre à « protéger la vie » en mettant la Terre sous surveillance pourrait sembler simplement hypocrite : une opération de com généralisant les effets de quelques secteurs réellement utiles – comme la surveillance météorologique – à l’ensemble de l’activité, alors que, rappelons-le, l’écrasante majorité des satellites envoyés depuis Kourou sont commerciaux ou militaires (ArianeGroup protège-t-il la vie en mettant les satellites de l’Arabie saoudite sur orbite ? Et à quelles finalités pacifiques sont voués les satellites militaires russes qui partent depuis la base Soyouz ?). Au retour de Guyane, on ne peut que méditer sur le fait que les satellites lancés à Kourou n’ont aucunement permis de freiner le boom de l’orpaillage illégal [32]. Sur place, tous les observateurs le constatent : seule la mobilisation de personnes sur le terrain peut dissuader les garimpeiros d’installer leurs chantiers. Ce sont avant tout des mesures politiques qui pourraient empêcher les compagnies minières de dévaster l’Amazonie, or pour l’instant l’État français leur déroule le tapis rouge. En l’absence d’un quelconque rapport de force, tous ces engins technologiques ne sont que des outils supplémentaires que le secteur spatial met à la disposition des multinationales pour servir leurs finalités propres.

Cette prétention à sauver la planète depuis une perspective extraterrestre prêterait à rire si elle n’était pas en elle-même porteuse d’une véritable menace, inscrite dans le prolongement d’une « Terre sous surveillance ». Dans son essai La Terre vue d’en haut, Sebastian Vincent Grevsmühl retrace l’histoire de cette vision de notre planète comme « vaisseau spatial » héritée de la guerre froide et montre comment elle débouche à mesure de l’aggravation de l’état de la Terre sur une dangereuse tentation de gestion technocratique du globe – « dont la géoingénierie constitue une approche absolument centrale » [33]. Depuis les déclarations d’Obama et le premier grand rapport de la Royal Society sur la géoingénierie, en 2009, les dirigeants sont de plus en plus nombreux à soutenir la préparation d’un plan B au cas où les politiques actuelles de réduction des gaz à effet de serre échoueraient – ce qui a en retour pour effet de décourager les arguments et les combats en faveur d’une réduction drastique des politiques de croissance.

Car nous savons très bien comment « protéger la vie ». En Guyane, c’est ce que font depuis bien longtemps les populations amérindiennes et bushinenguées et les gangans [34], comme, depuis des millénaires, la plupart des sociétés paysannes de la planète. C’est ce que tentent de faire toutes celles et ceux qui défendent face aux entreprises extractivistes des modes de vie soutenables. Les seuls à ne pas savoir comment protéger la vie sont précisément les héritiers de cet étrange projet occidental qui rêve d’affranchir l’humanité de sa finitude terrestre, de l’arracher à son
« berceau » au nom d’une prétendue civilisation supérieure de machines et de post-humains.

[1] « Avec Bartolomeo, Airbus et l’ESA veulent ouvrir l’ISS aux expériences d’opérateurs privés », L’Usine nouvelle, 9/02/18.
[2] La proximité de l’équateur permet de bénéficier d’une augmentation de l’effet de fronde gravitationnelle (vitesse initiale fournie par la rotation de la Terre) et donc de la puissance des fusées.
[3] « The Half-Life of Empire in Outer Space », Peter Redfield, dans la revue Social Studies of Science, 2002, p.
[4] Centre de ressources de la politique de la ville de Guyane (CRPV), « CUCS Kourou 2007-2009 », annexe 1.
[5] Voir Histoire des communes. Antilles-Guyane, vol. 6, Jacques Adélaïde-Merlande (dir.), éd. G. Naef, 1993, p. 173 ; appendice de La Question créole. Essai de sociologie sur la Guyane française, Marie-José Jolivet, éd. de l’Office de la recherche scientifique et technique outre-mer, 1982, p. 443.
[6] « Synthèse pour les techniques sur le suivi du trait de côte et adaptation dans le contexte de la Guyane », BRGM, mai 2016 « La sismique réflexion est une méthode d’exploration qui consiste à ébranler le sol et à observer en surface les ondes réfléchies », selon le BRGM.
[7] « Quarante ans de spatial en Guyane : une domination contestée », Stéphane Granger, dans L’Amazonie, un demi-siècle après la colonisation, Jean-François Tourrand, Doris Sayago, Marcel Bursztyn et José Augusto Drummond (coord.), éd. Quæ, 2010, p. 132.
[8] Pour l’année 2015. Selon Le Mag, Afnor Certification, 16/06/2015 (afnor.org).
[9] Le Lac de Petit-Saut. Haut lieu de l’observation de la faune en Guyane, Compagnie des guides de Guyane, septembre 2014.
[10] « En Guyane, le barrage de Petit-Saut agit “comme un réacteur chimique” », Laurent Marot, Le Monde, 18/04/2011 (lemonde.fr).
[11] Le Lac de Petit-Saut, op. cit.
[12] Selon Daniel Cossa, géochimiste à l’Ifremer, cité dans « En Guyane, le barrage de Petit-Saut agit “comme un réacteur chimique” », art. cité.
[13] Géochimie du mercure dans le continuum de la retenue de Petit-Saut et de l’estuaire du Sinnamary, Guyane française, Bogdan Muresan Paslaru, thèse sous la direction de Daniel Cossa, Université de Bordeaux 1, 2006, p. 14-15 ; « Guyane : le barrage favorise l’intoxication au mercure », Hélène Huteau, 97320.com, 10/04/2007 (97320.com).
[14] Cinquante ans d’aventure spatiale, Cnes, éd. Michel Lafon, 2007.
[15] CSG. Centre spatial guyanais, Jean-Michel Desobeau, éd. Saga, 1990.
[16] Cette crise est racontée en détail dans « The Half-Life of Empire in Outer Space », art. cité.
[17] « L’Insee et le spatial en Guyane », Michel Guillemet, Courrier des statistiques n o 94, juin 2000.
[18] « Guide du Centre spatial guyanais », document du CSG destiné au public.
[19] « Le village saramaka de Kourou », David Redon, Une saison en Guyane, n o 11, août 2013 ; Peuple saramaka contre État du Suriname, chapitre « Les fusées de Kourou », Richard Price, coéd. IRD-Karthala-Ciresc, 2012.
[20] La TVA n’a pas cours en Guyane. Par contre tous les produits importés font l’objet d’un octroi de mer d’un montant à peu près équivalent (sauf, donc, les produits exemptés comme les lanceurs).
[21] « L’impact économique de l’activité spatiale en Guyane », Cnes, 15/06/2009.
[22] « Ariane 6 : la construction du pas de tir en chiffres », Rémy Decourt, Futura Sciences, 7/08/17 (futura-sciences.com) ; « Pas de tir d’Ariane 6 : un chantier et des ambitions immenses », Euronews, 14/12/17 (euronews.com) ; « Eiffage Travaux Publics remporte les terrassements généraux (Ariane 6 ) », Zonebourse, 30/06/15 (zonebourse.com).
[23] « Ariane 6 : étape environnementale pour la construction du pas de tir », Matthieu Leman, France-Guyane, 18/07/16 (franceguyane.fr).
[24] « The Half-Life of Empire in Outer Space », art. cité.
[25] Exemples courants de la dizaine d’objets issus de la recherche spatiale « qui nous facilitent la vie au quotidien », comme aiment à le marteler les journalistes de la presse scientifique grand public, parmi lesquels on trouve des indispensables tels que le four à micro-ondes, le joystick, la nourriture lyophilisée, les appareils de fitness, etc.
[26] Ariane 5-ECA Launch Vehicle », Patrick Blau, sur spaceflight101.net
[27] Lire p. 8.
[28] « Boudé par les investisseurs, l’or revient à l’industrie », Myrtille Delamarche, L’Usine nouvelle, 15/02/18 (usinenouvelle.com).
[29] Scientifique allemand né en 1912, concepteur des célèbres missiles V2 pour le régime nazi. Fabriqués notamment par les prisonnier·ères du camp de concentration de Dora, les V2 dévastèrent diverses villes européennes avant de servir de modèle aux fusées interplanétaires. Exfiltré par les États-Unis en 1945, Wernher von Braun est devenu l’un des principaux ingénieurs de la Nasa.
[30] Extrait de l’excellent chapitre « L’exploration spatiale : l’ascension des saints », dans The Religion of Technology. The Divinity of Man and the Spirit of Invention, David Noble, éd. Penguin Books, 1999, p. 115-142 (non traduit en français).
[31] Sur l’histoire des grandes écoles d’ingénieurs françaises à travers leur rapport au millénarisme, lire « David Noble, critique de la religion de la technologie », Celia Izoard, revue Agone n o 62, 2018, p.143-169.
[32] Lire p. 54.
[33] La Terre vue d’en haut. L’invention de l’environnement global, Sebastian Vincent Grevsmühl, éd. Seuil, 2014, p. 311.
[34] Lire « Les petits agriculteurs en abattis font du bio depuis longtemps », p. 140.
Texte paru dans Z, revue itinérante d’enquête et de critique sociale, n°12 sur la Guyane.
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (904.2 kio)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (978.6 kio)