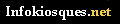S
Squatter ou sauver ? Il faut choisir
Comment le libéralisme infiltre les squats anarchistes
mis en ligne le 28 novembre 2022 - Sauver ou squatter
Sommaire
JUSTE UNE MISE AU POINT
IL ÉTAIT UNE FOIS
CALL-OUT ET RÉPRESSION
L’IMPOSSIBLE ALLIANCE ENTRE MODÉRÉ.E.S ET RADICALES
LEXIQUE
RESSOURCES
« No pride for some of us whithout liberation for all of us »
« Pas de fierté pour quelques un-es sans l’émancipation de toustes »
Marsha P. Johnson
JUSTE UNE MISE AU POINT
À l’origine, nous voulions écrire une brochure pour nous définir politiquement
(en tant que squat queerféministe et antiraciste) et raconter l’histoire de notre
lutte afin qu’elle contribue, comme d’autres brochures l’ont fait pour nous, à la
(trans)formation de futurs collectifs. Entretemps, un conflit larvé a fini par faire
éclater le collectif en deux groupes. Nous, le groupe restant, avons alors choisi
de profiter du répit pour retrouver le but initial du squat où ses membres y
partagent le temps et les moyens pour créer, se reposer, bricoler, jouer,
organiser des actions, lire, réfléchir...
Pendant ce temps, le groupe dissident a préparé et mené une démarche de call-
out (dénonciations arbitraires, individuelles et collectives) auprès du milieu
militant local. Cette démarche de vengeance a généré des pressions
interpersonnelles (chantage, exclusions d’autres groupes) et collectives
(désolidarisation), bien au-delà des personnes concernées, allant jusqu’à la prise
de position de personnes n’étant jamais venues dans le squat, pour exiger des
justifications, des réponses ou des excuses. Contre ces attaques, nous avons
enfin pris le temps (long) d’écrire cette brochure pour raconter collectivement les
débuts de notre histoire jusqu’à la scission puis aux call out.
Nous avons été sommé-es de nous justifier sur nos pratiques et nos décisions
collectives. Nous refusons de rentrer dans des explications qui racontent
l’intimité des individus et nos stratégies politiques. Laver son linge en public est
la marque d’un privilège, celui de ne pas avoir à craindre la répression de l’État
et des institutions.
Aussi, nous refusons de rentrer dans des stratégies de clash interpersonnelle.
En tant que féministes et queers, nous considérons que tous nos rapports
sociaux sont politiques, collectifs et structurels avant d’être individuels. Par
principe d’autonomie et de solidarité, nous refusons de devoir nous justifier
individuellement pour des dynamiques collectives et dans la duplicité des
discussions interpersonnelles.
Notre démarche n’a pas vocation à être manichéenne, pour dire que nous
serions dans le "Bien" et les autres dans le "Mal". Nous cherchons à comprendre
les positionnements politiques, les intérêts et motivation des groupes et des
individus, y compris les nôtres, y compris ceux qui peuvent encore subsister
entre nous. Mais nous assumons nos choix, qu’ils aient mené à des erreurs ou à
des réussites.
IL ÉTAIT UNE FOIS...
... À Bourgetown, une ville isolée aux murs blancs dans une contrée froide et
politiquement plutôt à droite de Far Far Away. Joyeux et optimiste, un groupe
d’individus se réunit pendant plusieurs mois avec le projet dément et
éminemment politique d’ouvrir un squat. Mais pas n’importe lequel ! Celui-ci
sera en mixité choisie sans mec cis, queer, féministe et antiraciste ! Un lieu pour
habiter, lutter, pratiquer une entraide radicale entre femmes, gouines, trans*
galérien-nes. Un endroit pour se former et se transformer qui allait donner
naissance au squat La Bonne Poire. Un projet galvanisant sur le papier.
Cependant, tout au long de sa préfiguration, de sa création et jusqu’à sa
concrétisation, La Bonne Poire a été le théâtre de conflits et de fêlures
personnelles et politiques. Ce qui suit raconte son histoire, celle qui a précédé le
clash et la scission du collectif. Au début de notre histoire nous pensions
partager les mêmes idées et les mêmes pratiques politiques, avant de nous
apercevoir que nos positions étaient incompatibles. Si le libéralisme a intoxiqué
les individus et sucé le sang du collectif, la Bonne Poire n’a pas été réduite en
compote, mais il s’en est fallu de peu.
Pour comprendre ce qui est parti en sucette, nous avons besoin de mettre sur
papier notre histoire. Comment n’avons-nous pas pu voir les problèmes dès le
début ? Comment les a-t-on niés ? Comment avons-nous tenté de les résoudre ?
Avons-nous appris de nos erreurs ? Qu’est-ce que toi, lecteurice, tu peux tirer de
nos leçons ? Nous racontons ce qui nous a valu de nombreuses nuits
d’insomnie, de disputes, de larmes et de nerfs tendus. Toute ressemblance avec
des situations ou des personnes existantes ou ayant existé est volontaire.
BIENVENUE A BOURGETOWN
Toute tentative d’explication d’une situation ne peut pas faire l’économie
de la prise en compte du contexte. Le premier élément que nous aurions dû
prendre en compte en imaginant ce lieu était contextuel. À Bourgetown, le
dernier squat anarchiste avait été expulsé il y a plusieurs années. Les autres
squats, qu’ils soient d’habitation ou d’activités, avaient été régularisés par des
baux ou conventions d’occupation précaires. Et globalement, la gentrification
progresse quasiment sans entraves…
Plusieurs femmes, déçues par leurs expériences en tant que militantes au sein
de squats d’hébergement sans mode d’organisation horizontale, se retrouvent
dans la réunion de préfiguration d’un nouveau lieu queer féministe antiraciste.
Peu de personnes avait l’expérience pratique d’un squat autogéré (c’est-à-dire
un lieu de vie et un lieu d’organisation politique). Pour la majorité des militant-
es de gauche, un squat c’était un bâtiment qui comblerait les manques de l’État
à moindre frais en abritant un maximum de personnes, sur le modèle des centres d’hébergement sociaux.
Quelques festivals et manifestations avaient permis de faire de chouettes
rencontres et d’avoir quelques expériences d’organisation entre féministes.
L’automne 2038 était encore lumineux à Bourgetown. De nombreuses femmes et
queers en galère étaient à la rue, ou avec des solutions d’hébergement précaires
et temporaires, dans des squats craignos ou chez des gens.
Des militant-es féministes issu-es du milieu associatif déployaient beaucoup
d’énergie pour aider des femmes en galère, avec des moyens limités. Des gouines
venues
de
l’anarcha-féminisme
et/ou
des
luttes
autogestionnaires
commencèrent à formuler le besoin d’ouvrir un squat. Un lieu en mixité sans
mecs cis relous et de culture anarchiste n’était pas du luxe à Bourgetown... Les
gouines en parlèrent autour d’elles. De bouches à oreilles, l’idée se propagea
avec enthousiasme dans les cercles féministes et queers.
Une première réunion s’organisa, rassemblant des personnes de classe populaire
comme bourgeoise, à majorité cis, avec des femmes hétéros ou bies, des trans,
des gouines, racisées et blanches, venues de cultures politiques très différentes.
Ce jour-là, on évoque deux besoins fondamentaux pour les luttes féministes et
queers :
1/ l’urgence matérielle pour des femmes et personnes queers galérien·nes
d’avoir un toit sur la tête,
2/ la nécessité d’avoir un lieu d’organisation, de réflexion et de formation
politique.
Un lieu d’habitation et un lieu politique par et pour les personnes concernées,
où l’hébergement serait prioritairement réservé aux femmes et aux personnes
queers, notamment migrant·es et sans papiers.
TROUVER UN LIEU et BOUGER SON CUL
Dans la culture anarcha-féministe, la formation est importante. Quand on n’est
pas un mec cis, la société patriarcale nous inculque que nous sommes moins
capables, moins fort·es, moins compétent·es. Les bonnes intentions ne suffisent
pas à déconstruire ce que le régime oppressif a mis dans nos têtes. Cela
demande un travail conscient.
Ensemble, nous voulions dépasser nos craintes, nos peurs, nos limitations en se
formant collectivement. Dès le début, on évoque l’importance du processus de
transmission de savoirs : les personnes expérimentées dans certains domaines
transmettent ce qu’elles ont appris aux autres, en restant dans un processus
horizontal et dans une forme de co-construction des savoirs où tout le monde
participe, anticipe en cherchant de la doc, en se renseignant un minimum sur
les sujets abordés. Chacun-e disposant de savoirs qu’elle peut transmettre dans
l’élaboration du projet.
Tout au long de la création de ce lieu, ce sont pratiquement toujours les mêmes
personnes qui se sont impliquées, qui ont donné du temps, qui ont pris sur elles
quand paradoxalement ce sont aussi elles qui avaient le moins de temps
disponible (travail et autres), ce qui entraîne de l’épuisement et des inégalités.
A noter qu’il s’agissait aussi d’une majorité de meufs racisées.
Il y avait une flemme, une réticence à s’auto-former, et le besoin que les
« savoirs » tombent tout cuits de la bouche des personnes plus
« expérimentées ». Avec la sensation qu’il fallait mettre à l’aise et divertir
gratuitement les plus privilégiées des militantes pour que le projet avance.
Malgré ces dysfonctionnements, nous savons que l’autogestion n’est pas
naturelle, qu’elle s’apprend, en commençant à la pratiquer, en communiquant
sur ce qu’on fait.
LA GAUCHE, LES ANARCHISTES et CELLES QUI ONT VU DE LA LUMIERE
Dès les premières discussions, on parle de nos stratégies et de questions
politiques. On envisage comment on va s’organiser, quels seront nos principes
de fonctionnement et les bases politiques du lieu. Cependant, lorsque les sujets
politiques, théoriques sont prévus à l’ordre du jour, plusieurs réunions sont
annulées par manque de monde pour traiter une question aussi importante. La
théorie n’influence-t-elle pas la pratique ? Et vice et versa ? Cela ne semble pas
important pour plusieurs militant-es, bizarrement.
Le projet de La Bonne Poire s’imaginait comme un lieu autogéré, par et pour les
personnes concernées où on réfléchissait à ses pratiques pour contrer cette
société de domination et d’exploitation. L’idée c’était que les personnes
concernées - les femmes, les queers, les galérien-nes - décident et
s’autodéterminent.
Pourquoi ? Parce que dans le militantisme mainstream, les personnes qui
subissent les oppressions (les racisé-es, les trans, les personnes handicapées
par exemple) sont souvent mises de côté. Ce sont les groupes dominants qui
décident des objectifs de la lutte (cf. le white cisfeminism) en confisquant
l’autonomie organisationnelle de celleux qui subissent de plein fouet les
oppressions et y résistent quotidiennement. Ça a été le cas pour les luttes
antiracistes gérées et menées par des Blancs, ça a aussi été le cas pour la
Marche des Fiertés, véritable parade néolibérale qui a mis de côté les
revendications des personnes racisées, pauvres et transféministes. (voir annexe
pour en savoir plus sur l’autogestion).
Au fur et à mesure des discussions, on établit que le squat sera un lieu
féministe et queer, autogéré sans hiérarchie, an@rchiste, antiraciste et
anticapitaliste.
Ce qui aurait dû sembler bizarre déjà – et qui se vérifiera par la suite - c’est que
la majorité des personnes qui ne voulaient pas participer aux moments
d’élaboration politique valident tout de même ces principes, à la va-vite, sans les mettre en discussion, pour l’esthétique, sans se rendre compte que ces principes
sont liés à des pratiques en cohérence avec nos idées. Au final, cela donne une
illusion de consensus, mais on s’apercevra plus tard qu’il n’y en avait pas.
Le collectif était composé d’habitant·es, et en majorité, de militant-es. Dès les
premières réunions, nous avions invité les personnes à conscientiser leurs
privilèges. Il n’était pas question de les nier ou de se morfondre dans une
culpabilité inutile mais d’apprendre à les détourner afin d’en faire profiter le
collectif et les personnes les plus vulnérables. Par exemple, dans les
confrontations avec la police, les personnes cis blanches avec des papiers ont
moins de chance de subir des violences que les personnes racisées sans papiers
ou avec des titres de séjour, aussi, les conséquences juridiques sont
complètement différentes.
Pendant la recherche du squat, on constate déjà que beaucoup de personnes
privilégiées se mettent à l’écart quand il s’agit de prendre des risques. Lorsque
celles qui donnent beaucoup de leurs nuits au projet demandent une meilleure
répartition des tâches en réunion, c’est mal reçu et la situation ne change pas.
Le point positif c’est qu’il y a quand même des efforts faits par certaines
personnes blanches et de classe supérieure. Mais nous remarquons que la
plupart des militant-es n’avaient pas idée de l’engagement réel que demandait
un tel projet.
Les lignes de fracture étaient déjà visibles, et nous aurions pu les voir si nous
n’avions pas mis tous nos efforts dans la préservation du groupe et le besoin
vital de l’existence d’un tel lieu. Le collectif voulait tellement atteindre son
objectif que tout le monde préférait taire ses doutes.
Il faut rappeler que les personnes qui se sont impliquées régulièrement dans le
collectif se sont rassemblées sur des bases affinitaires féministes. Toustes se
retrouvaient régulièrement sur des actions communes (manifs, organisations de
festivals DIY ou associatifs) et partageaient certains éléments de vocabulaire.
Certaines étaient d’ailleurs dans des groupes radicaux, sans connaître ni
appliquer les bases politiques inhérentes à ces formes d’action directe.
Tout pour l’esthétique de la lutte, le vocabulaire choc, au diable la pensée et
l’histoire, puisque les « bonnes intentions » suffisent. Nous remarquerons au fur
et à mesure que des personnes adhèrent à ce genre d’organisation parce que
c’est divertissant, « cool » ou parce qu’elles ont « vu de la lumière ». En soi, ce
n’est pas grave de ne pas tout connaître en termes de bases politiques, on est là
pour se former mutuellement. Mais rejeter les formations, militer avec son ego,
saboter de l’intérieur un collectif, vouloir le vider de sa substance critique
radicale, c’est une pratique des dominant•es qui a eu cours dans les luttes
autonomes depuis longtemps et se répand comme la peste.
Formuler ses idées politiques n’est pas du luxe, cela nous permet de savoir où
on se situe dans le champ politique. Si la lutte anarchiste n’est pas pour toi camarade, pars en paix ! On se retrouvera peut-être sur d’autres fronts.
BIENVENUE A LA BONNE POIRE !
Enfin, nous avons trouvé notre nid idéal !
Les habitantes arrivent et certaines découvrent le fonctionnement en
autogestion, la mixité choisie et/ou la vie en squat.Le collectif de La Bonne Poire
se construit alors avec des personnes qui habitent dans le lieu et d’autres qui ne
vivent pas sur place mais s’investissent en apportant de l’aide au quotidien
(récup’, chantiers, etc.), en organisant des moments de formation et de
discussion, des ateliers et des événements. Les personnes qui n’habitent pas sur
le lieu ne sont pas censées prendre de décisions à la place de celles qui y
habitent. Cependant, elles s’engagent à prendre les risques judiciaires et
amènent les ressources dans le lieu, ce qui leur confère un certain pouvoir de
fait. Par exemple, le fait de concentrer toutes les informations rend les
habitantes dépendantes des personnes "ressources". Les personnes précaires,
exilées sont déjà habituées à être maintenues dans des rapports inégalitaires par
les organismes sociaux et la plupart reproduisent ces rapports dans le squat.
Comment équilibrer les rapports ?
Une des pratiques mises en place a été d’intégrer les habitantes à toutes les
prises de décision, après à chacun-e de participer selon ses disponibilités, sa
situation et ses envies.
Au-delà des principes politiques et organisationnels qui sont à la base du lieu,
on veut que tout le monde soit impliqué dans toutes les décisions, tout se
discute donc, même si c’est parfois chiant et long.
AUTOGESTION IS THE NEW AUTORITARISM
À partir de là, des positionnements difficilement conciliables vont nous diviser.
Aussi des personnes ne sachant pas vraiment où se placer demeuraient
silencieuses, d’autres faisaient la girouette ou suivaient les idées de leur «
meilleure copine » sans avoir d’avis propre. Certaines d’entre nous affrontions
doutes et contradictions. Dans ce zine, nous pointons des postures et des
pratiques politiques avec lesquelles nous sommes en désaccord. Il n’exprime pas
les ressentis et nuances individuelles forcément complexes et en construction
permanente. Il n’a pas pour but non plus de pointer des erreurs que tout un
chacun peut faire, mais de révéler des mécanismes récurrents qui nous ont usé-
es et les manoeuvres de sabotage intentionnel.
Comme la culture politique de la majorité du collectif de La Bonne Poire n’était
pas radicale, les pratiques les plus "intuitives", "spontanées" et "naturelles"
héritées du contexte associatif ont très rapidement pris le dessus. Dans la suite
de ce texte, nous allons utiliser les termes "associatives", "sauveuses" et
"travailleuses sociales" pour évoquer des personnes de gauche ayant développé
ces pratiques politiques.
Dès les premiers jours, nous avons vu débarquer des personnes qui étaient
venues une fois en réunion voire pas du tout et ne connaissaient ni nos
stratégies, ni nos bases politiques. Alors que dès le début, nous avions posé que
l’intégration de nouvelles personnes devait être discutée en réunion, certaines
agissaient comme si le lieu était ouvert à qui le veut, au bénévolat, à la copine
d’untel, et ceci sans mesure de sécurité. Aussi des informations précises et
précieuses sur le lieu ont été divulguées.
Nous luttions quotidiennement contre l’emploi de termes comme « bénévole », «
permanence », « bénéficiaire », « public cible », « entretien médico-social » qui
nous semblaient incompatibles avec le féminisme queer antiraciste que nous
défendions et avec l’organisation en autogestion.
Nous ne voulions pas de bénévoles associatifs qui viennent sur un lieu de vie
faire leur bonne action du dimanche, s’exotiser, consommer un lieu autogéré
avec une vision individualiste et libérale.
Pour certaines, l’autogestion consiste à naviguer sans règle dans le chaos. Elles
croient fermement en un principe universel, logé dans leur petit cœur de femme
gentille qui connaît la vérité vraie. Les gentilles réguleront automatiquement les
relations de pouvoir afin de créer un monde meilleur. (Tu peux aller vomir, on
t’attend.)
C’est, bizarrement, le même argument que les missionnaires chrétiens.
L’autogestion, c’est chiant. Ce sont des débats, des discussions dans le but de
sortir des systèmes d’exploitation capitalistes, racistes et sexistes qui se mettent
en place dans les espaces où l’organisation n’est pas réfléchie. On le suce pas de
notre pouce.
En discutant avec les associatives, on se rend compte qu’elles ne « croient »
même pas en l’autogestion ! Elles en ont une vision tantôt utopique «
l’autogestion est impossible », « l’autogestion c’est pas efficace », « l’autogestion
ça prend du temps et c’est chiant de discuter de tout », tantôt chaotique-
individualiste « l’autogestion c’est chacun avec soi-même et Dieu pour tous », «
l’autogestion c’est chacun fait ce qu’il veut ».
Wesh ! L’autogestion c’est pas le chaos.
Du « chaos » renaît l’ordre, celui qu’on redoute, celui qui se met en place
insidieusement, celui contre lequel on lutte. (voir plus loin, on développe une
partie sur l’autogestion)
SQUAT POLITIQUE OU CENTRE D’HEBERGEMENT ?
Vivre dans un squat est une situation à risque, pas idéale pour tout le monde.
Beaucoup de personnes précaires préfèrent être prises en charge dans le
système mis en place par l’État en espérant y garder un minimum de sécurité
administrative.
C’est pourquoi nous préférons rester hors du fonctionnement de ces solutions
qui existent, et y rediriger les personnes concernées lorsqu’elles le peuvent et le
préfèrent : nous ne prétendons aucunement « sauver » des gens par nos propres
et faibles moyens. Un squat ne doit pas, selon nous, se substituer aux
structures d’hébergement et de travail social financées par les subsides de l’État,
tant qu’il existera. Les personnes qui viennent vivre à La Bonne Poire sont celles
qui ne peuvent pas bénéficier des solutions sociales de droit commun et/ou qui
souhaitent vivre dans un squat féministe queer antiraciste.
Allant à l’encontre des principes d’autonomie, les "sauveuses" du collectif
souhaitaient plutôt accueillir un maximum de personnes à la Bonne Poire, dont
des personnes qui pouvaient pourtant prétendre à un hébergement social.
Elles voulaient « faire du chiffre », entasser des femmes et des familles sans se
soucier de savoir si elles auront de l’eau chaude, du chauffage, se sentiront en
sécurité. Pour elles, l’intimité n’est pas une condition matérielle essentielle pour
une galérienne. Cela ne peut s’expliquer que par une tendance des militantes à
rechercher la reconnaissance et la satisfaction personnelle sur le dos des
personnes en galère. Parce qu’elles ne remettent pas en cause leurs propres
privilèges, cela leur semble ok de reproduire dans un squat féministe le système
d’hébergement de masse et d’urgence mis en place par l’État.
Mais le but d’un tel lieu, c’est aussi que chaque personne puisse prendre la
place et le temps de se consolider, de se reconstruire, de se renforcer, de
développer des relations d’amitié, de trouver des outils, de se former.
Pour cela, il faut de l’espace à soi. Pour les "sauveuses", la mise en place de
pratiques émancipatrices est inutile : les femmes migrantes sont perçues comme
n’ayant pas besoin du féminisme ni d’aucune théorie libératrice, juste de
conditions matérielles servant à les intégrer dans le système.
Les "sauveuses" raisonnent en terme de quantité et imaginent qu’on ne peut pas
exister en tant que squat si on ne remplace pas l’État. C’est son rôle d’assurer
un logement aux plus vulnérables (pauvres, femmes et enfants). Cependant, il
n’a jamais été question de remplacer ou participer à l’État, ni au tissu associatif,
ni à aucune entité qui use de son pouvoir pour maintenir le système de
domination et d’exploitation.
Si nous avons conscience des urgences sociales et humanitaires, nous ne
sommes pas dupes. Nous ne voulons pas reproduire ce système à notre échelle.
Nous refusons d’être exploité-es par une poignée d’individus pour un travail
gratuit de bonne conscience, quasi-religieuse, inspiré du travail humanitaire, au
service de l’ordre. Nous serions légitimes de squatter uniquement selon leurs
termes : nous sacrifier dans un but humaniste, avec des codes sucés de la
gauche sauveuse, en étant de bonnes citoyennes, matrixées par des valeurs
bourgeoises, paternalistes et d’héritage colonial.
SABOTAGES ET MANIGANCES – et si on défonçait les fondamentaux du
lieu ?
Les sauveuses, non contentes d’être dogmatiquement contre l’autonomie et
l’émancipation, pratiquaient une politique digne de politicien-nes de partis.
Monter des cabales avec ses copines, manipuler les opinions en dehors des
réunions, utiliser des éléments intimes pour attaquer des individus leurs
paraissent être des pratiques convenables. Pour elles, c’était probablement «
faire de la politique ». Par contre discuter ouvertement, poser des arguments,
trouver un consensus, c’est du folklore.
Pour comprendre la suite d’événements qui ont mené au clash, nous allons citer
des exemples en anonymisant les protagonistes.
Il y a un exemple fondateur éloquent qui montre comment certaines sauveuses
étaient prêtes à remettre en question tous les fondements du squat pour
satisfaire
une
pulsion
de
sauvetage
complètement
irréfléchie.
Une femme en galère, Rose, est venue habiter brièvement à La Bonne Poire en
attendant
qu’un
hébergement
social
se
libère.
Rose reste plusieurs jours, contente du lieu, à l’aise parmi le collectif. Elle n’a
plus envie de partir mais elle se sent écartelée parce que son mari ne peut pas
venir dans un squat en mixité choisie sans mecs cis. Elle commence alors à
parler à toustes les occupant·es, les un·es après les autres, pour essayer
d’obtenir une exception et que son mec puisse venir dormir au squat.
C’est de bonne guerre : son insistance est parfaitement compréhensible vu
combien iels sont dans la merde. Compte tenu de leur situation de grande
vulnérabilité, Rose et sa famille se voient proposer très rapidement une place
d’hébergement. Une occupante, Marguerite, remet alors en question la mixité
choisie du lieu, car elle aurait voulu que Rose et sa famille puissent rester au
lieu de bénéficier d’un dispositif de droit commun. On voit toute l’absurdité
hallucinante de la logique de sauveuse, prête à remettre en cause les
fondamentaux féministes du lieu pour pouvoir intégrer un homme cis lambda.
Bien sûr, La Bonne Poire a gardé son mode d’organisation. Depuis, Rose et sa
famille ont obtenu un appartement social à Bourgetown.
À partir de ce moment, on a aussi pu voir s’installer une censure intentionnelle
de l’identité féministe et queer du lieu, accompagnée d’un discours raciste et
infantilisant. Marguerite et ses copines affirment que le féminisme n’est que de
la théorie (oui, oui, vous lisez bien) et que les queers migrant-es ne peuvent pas
comprendre et n’ont pas besoin des luttes queer.
Si on balayait d’un coup une partie de la population et ses luttes, tiens ?
Dans l’esprit de nombreuses "associatives", toustes les migrant·es sont a priori
hétérosexuel-les et cisgenres. Il ne faudrait pas partager des outils féministes et
queers, qui selon elles sont pour les personnes privilégiées et blanches. Elles ne
font pas le lien entre les oppressions et les conditions matérielles d’existence.
Choc et colère pour celles d’entre nous à travers toute la France qui sommes
prolos,
racisé-es,
arabo-musulman-es,
précaires
économiquement
et
administrativement, enfants de femmes en luttes, d’immigré-es révolutionnaires,
lesbiennes, gouines, trans qui contredisent sous son nez le racisme colonial à la
française. On a l’habitude d’être effacé·es de l’Histoire, mais pas dans son propre
collectif !
Un jour, une femme nommée Lilas arrive au squat avec ses enfants. Elle ne
parle pas français mais elle nous explique, avec l’aide de son fils qui, lui, le
parle, qu’elle est hébergée chez des personnes qui lui demandent de partir parce
que la situation s’éternise. Tout de suite, Eucalyptus entreprend de lui expliquer
ce qu’est La Bonne Poire, en essayant d’utiliser des mots faciles à traduire. Là,
une autre occupante, Géranium, lui coupe la parole pour l’empêcher d’évoquer
le caractère queer du lieu : « Ne parle pas de ça, elle ne peut pas comprendre ! ».
C’est une double violence : c’est exiger qu’un lieu et des personnes queers se
placardisent parce que l’on pense qu’une personne étrangère ne doit pas
connaître l’existence des personnes lesbiennes, trans, non-binaires, intersexes.
On peut très bien utiliser des mots simples pour se comprendre. C’est essentiel
que les personnes qui souhaitent vivre dans le lieu soient informées en amont,
plutôt que cela se passe mal par la suite !
Géranium avait rendu manifeste un comportement insidieux, qu’elle n’était pas
la seule à avoir : un certain nombre d’occupant·es « oubliaient »
systématiquement de présenter l’identité queer du lieu aux potentielles
habitantes migrantes. La tâche de cette explication retombait inévitablement sur
les personnes cis gouines ou sur les personnes trans.
Le projet est critiqué par les sauveuses en dehors du collectif mais ces critiques
ne sont jamais mises à l’ordre du jour des réunions, empêchant dès lors une
véritable discussion. Plus dangereux, ces blablas de couloir sortent du collectif
sans égard pour la sécurité et la confidentialité.
Courgette, une femme cishet du collectif, va se plaindre des conflits internes à
l’un de ses potes, du ouin ouin sur la mixité choisie qui ne fonctionne pas,
d’après elle. Elle bave. Les infos et des noms tournent. Une fois attrapée à son
propre jeu, Courgette présente vite fait ses excuses en réunion, prétextant avoir
fait de la merde parce qu’elle avait besoin de parler et n’avait personne auprès de
qui le faire… Pourtant plusieurs de ses ami.es proches font partie du collectif.
Qu’est-ce qui se passe ? Est-ce que nous devenons dans sa bouche de
méchantes sorcières lesbiennes séparatistes le temps de boire un verre ?
Si la trahison est grave, en tant que féministes nous n’avions pas de pratique de
tribunal populaire ou d’exclusion. Nous lui avons fait confiance pour s’amender
et nous lui avons simplement rappelé pourquoi la confidentialité était un gage de
protection essentiel pour toustes les membres du squat, habitant-es ou
occupant-es.
La fuite d’informations autant que la trahison des principes de sécurité d’un lieu
illégal était fréquente. Alors que l’intégration de nouvelles personnes dans le
collectif devait toujours faire l’objet d’une discussion en réunion, sous prétexte
qu’elles se sentaient fatiguées et avaient envie de faire un "break" avec le lieu,
Marguerite et Géranium ont par exemple intégré en catimini des amies à elles,
les ajoutant autoritairement dans le planning. Plus grave, elles leur ont
communiqué des informations internes et des principes de sécurité. La
procédure a été intentionnelle, cachée précisément aux personnes squatteuses
perçues comme radicales dans le collectif. Lorsque ces faits ont été critiqués, des
larmes blanches ont ruisselé dans tout Bourgetown générant des semaines de
conflits et impliquant là encore des personnes hors du collectif.
POURQUOI NOUS SQUATTONS ?
Il devenait impératif de revenir aux bases. Une des questions qui remontait sans
cesse et divisait le collectif était la question du but profond du squat. Pourquoi
nous squattons ? Pour lutter, résister, et pas uniquement héberger !
Nous refusons d’être exploité-es par un système qui nous utilise pour combler
ses failles, nous voulons miner ses brèches pour le faire exploser. La différence
est de taille et fondamentale. Le squat en tant que lieu d’organisation politique
des marginalisé-es et d’expérimentation collective était inenvisageable pour les
"associatives".
En tant que radicales, nous ne pouvons pas lutter contre le mal-logement ou la
rétention de logement sans critiquer profondément le système qui permet cette
situation et l’organise au quotidien : le capitalisme et l’État ; le néolibéralisme.
Nous ne pouvons pas squatter sans prendre conscience que la propriété privée
et l’individualisme sont les sacro-saintes bases du système économique qui
organise nos oppressions. C’est dans ce sens-là que nous sommes radicales,
nous prenons le problème à la racine, nous luttons contre les causes des
phénomènes, nous sommes intransigeantes, nous ne nous contentons pas
d’absorber les problèmes et d’en atténuer les conséquences comme le font les
bonnes mères de famille. Nous ne sommes pas des bonnes poires ! De plus, il
existe des dizaines d’endroits à Bourgetown qui rêvent d’accueillir des sauveuses
bénévoles, pourquoi ne pas les investir ?
Nous sommes persuadé·es qu’il est possible d’être à la fois un squat d’habitation
et un squat politique, plein de lieux comme ça existent et ont existé. Ce sont des
endroits de résistance et de construction très importants. Mais, pour cela, nous
devons vivre avec des gens qui sont un minimum d’accord sur les principes de
base du lieu.
Dans les faits, tous les squats ne sont pas politisés, certains sont discrets et
hébergent quelques personnes. D’autres sont des hôtels avec des gestionnaires,
des associatifs et en collaboration avec la mairie voire les flics. Ces squats
d’hébergement privilégient les personnes exilées mais leur politique de gestion de
squat est très patriarcale et libérale, c’est la loi du plus fort sans pratique
collective égalitaire. Puis il y a aussi des squats d’artistes blancs qui contribuent
à la gentrification des villes... Avec toutes ces pratiques différentes, nous avions
probablement chacun·e en tête des choses différentes avec des expériences
différentes. Cependant, il a fallu à un moment donné cesser de courir sans tête
dans tous les sens et assumer un projet cohérent…
Squatter est politique. Une pratique sans affirmation politique est la porte
ouverte à toutes les reproductions et récupérations systémiques ! Personne n’a
le privilège d’être neutre ou de militer éternellement sur une base esthétique
sans s’interroger sur les fondamentaux. Un squat d’hébergement de masse, sans
pratiques et questionnements autour de l’émancipation et de l’autonomie
fonctionnera grâce à la loi du plus fort et on retrouvera alors les mêmes
pratiques dégueulasses que les institutions : surveillance de masse, fichage,
contrôle social, achat de consentement, rétention d’informations et de
ressources, etc. Voilà ce à quoi mènent les pratiques dites "sociales" et la volonté
de sauver comme seule boussole militante.
PRATIQUES DE CONTRÔLE SOCIAL
Avoir des pratiques de travailleuses sociales ne signifiait pas forcément que les
personnes bossaient dans ce domaine. Beaucoup de ces pratiques étaient tout
simplement inspirées de ce qui se passait dans d’autres squats de Bourgetown,
dans lesquels des assos faisaient de l’entrisme et soutenaient la mise en place de
structures calquées sur les institutions : un gérant de squat, des caméras, des
rations alimentaires, beaucoup d’informations s’échappant du squat, un pouvoir
centralisé et sous clef, une intégration économique qui correspond aux besoins
du marché maintenant un salariat précaire et sans droit, facilement exploitable.
Cela se retrouvait aussi dans les conversations virtuelles. Beaucoup de
sauveuses n’hésitaient pas à parler de trucs personnels concernant des
habitantes alors même que celles-ci étaient présentes dans le groupe de
discussion, ou encore à tenir des fichiers sur les situations personnelles de
celles-ci. Un peu comme quand des médecins ou des travailleureuses sociaux
parlent de toi à la troisième personne à des tiers alors que t’es présent·e dans la
pièce ou font des rapports sociaux sur toi sans t’informer du contenu.
Humiliantes, déshumanisantes et infantilisantes, ces violences symboliques
issues des structures de contrôle social vont à l’encontre de l’autonomie des
personnes.
Avec ces pratiques viennent celles de gestion individuelle, où les militantes
deviennent des héroïnes en sauvant personnellement telle ou telle femme, avant
même de chercher des solutions collectives qui pourtant existent !
Certaines habitantes avaient pris l’habitude de considérer les militant-es comme
des bénévoles, sachant quelle personne dirait oui ou non pour apporter tel ou tel
service. Ça faisait que d’autres membres du collectif se retrouvaient à devoir
gérer des situations problématiques sans y avoir consenti. D’autant plus
dangereux lorsqu’on se retrouvait, par surprise, à avoir la responsabilité de
mineur·es, parfois plusieurs jours à la suite, même dans un contexte de menace
d’expulsion. Une autre encore pouvait fournir de l’argent, ou était sensible aux
larmes. Cela instaurait de fait la mise en concurrence des habitantes. En effet, le
soutien offert est conditionné par le caractère soi-disant « bon » ou «
mauvais » des agissements de la personne, un jugement basé sur des
valeurs morales qu’on contrechie en tant qu’anarcha-féministes.
Ce qu’on voudrait, c’est se soutenir collectivement, arrêter de se juger les unes
les autres, se dire directement les choses en face pour transformer nos
pratiques.
À la Bonne Poire, les pratiques sociales d’une partie du collectif ont ainsi
instauré un rapport biaisé avec certaines habitantes. Quand il y avait des
problèmes liés aux tâches collectives, beaucoup d’habitant·es attendaient que les
militant-es fassent le travail ou gèrent le problème, comme s’iels étaient des
arbitres. Il n’y avait plus de réflexe d’auto-organisation collective puisque la
plupart pensait qu’elles n’avaient qu’à se reposer sur les « bénévoles ». Du coup,
beaucoup de militant-es s’épuisaient à faire les tâches collectives à la place des
autres et nourrissaient de la colère et de la frustration.
L’arrivée de Chicorée est un bon exemple des gros travers des travailleuses
sociales. Une militante associative contacte la Bonne Poire pour accueillir une
femme avec enfants. Dès le départ, impossible de parler directement avec la
première concernée. Nous n’avons accès qu’aux intermédiaires, notamment son
assistante sociale. Toutes ces personnes affirment que la concernée ne parle pas
français et laissent planer un mystère autour de la vie de Chicorée. Il suffira
d’une simple discussion avec elle – qui parle très bien français - pour
comprendre ses besoins et sa situation. Toutes ces intermédiaires voulaient
contrôler la situation et nous empêchaient de communiquer sereinement,
engendrant des craintes inutiles et de l’énergie perdue. On s’aperçoit aussi que
Chicorée correspond très bien au projet de par son expérience dans des lieux
collectifs et ses multiples galères qui ont forcé sa débrouillardise et son
autonomie. Une image totalement différente du portrait victimaire qui nous avait
été présenté. Ça montre la vision raciste des pauvres et des migrant-es dans les
structures sociales, perçues comme des « bénéficiaires », victimes car au fond,
elles seraient incapables !
La plupart des galériennes et migrantes sont des femmes badass qui ont
déjà vécu mille vies et encore plus de violences, qui ont eu un parcours
migratoire plein d’épreuves. Elles n’ont pas besoin d’être sauvées, et
encore moins par des gens qui n’ont même pas vécu ¼ de leurs
expériences.
LE MÉNAGE, C’EST POLITIQUE ?
Dans le cadre d’une société patriarcale où les personnes assignées femmes à la
naissance sont préposées aux tâches ménagères et au care, pas mal de
problèmes internes se sont cristallisés sur le ménage à La Bonne Poire.
Dès le début, il y avait des soucis de partage des tâches ménagères. La
recherche d’une organisation la plus autogestionnaire et égalitaire possible a
pris de longs mois. En tous cas, la règle était simple : à la mesure de ses
capacités physiques, chacun·e devait participer aux tâches collectives (ménage,
récup’, réparations, etc.).
L’une des Bonnes Poires, Argousier, avait trois enfants : une adolescente,
Cosmos, et deux garçons ados, Navet et Panais. Nous considérions que si les
personnes adultes devaient prendre la grande majorité des tâches quotidiennes
en charge (en fonction de leurs capacités), les adolescent·es devaient aussi
participer. Cosmos ne rechignait pas à faire un peu de ménage collectif, alors
qu’elle aidait déjà sa mère à préparer les repas et à réaliser toutes les tâches
quotidiennes. Par contre, Navet et Panais refusaient la moindre tâche ménagère
et ne respectaient pas les espaces collectifs (toilettes sales, crachats dans l’évier,
restes de nourritures dans les espaces communs, ordures, etc). Dès les
premières semaines d’ouverture de la Bonne Poire, les habitantes et les
militant·es s’en plaignent réunion après réunion, au point que ça devient un
sujet récurrent.
Dès le départ, il y a un souci de communication. Comme Argousier n’a pas de
langue en commun avec les autres membres du collectif, Cosmos se charge
généralement de la traduction, ce qui la met dans une position super
inconfortable. Pour le reste, nous avions plusieurs langues de communication
possibles avec les adolescent-es. Alors nous mettons en place des explications en
trois langues, accompagnées de dessins et traduisons toutes les
communications par écrit et à l’oral. Pour les deux adolescents, on réduit les
tâches à la sortie des poubelles et au nettoyage des escaliers une fois par
semaine. Nous voulions qu’ils participent – à leur mesure certes – mais on ne
pouvait pas se retrouver dans un squat féministe avec plusieurs femmes
nettoyant leur merde à tous les étages. Il est à noter que ce sont encore les
mêmes personnes qui prennent la charge de trouver les solutions.
Malgré tout ça, rien ne change. Tout le monde s’en plaint. Mois après mois, la
situation devient de plus en plus tendue. À chaque réunion, le comportement
des deux garçons revient à l’ordre du jour.
Argousier propose qu’on vienne la voir systématiquement lorsqu’ils ne veulent
pas faire quelque chose ou qu’ils ont fait une connerie. Mais, d’une part, c’est
fastidieux au quotidien (ça s’appelle la charge mentale), et d’autre part, il y a
toujours le souci de la langue qui complexifie la communication.
Les tensions vont culminer dans un conflit majeur, durant lequel plusieurs
habitantes et occupant-es (dont certaines sauveuses) sont intervenu-es lors
d’une dispute entre Argousier et ses fils au sujet du ménage. Ce conflit a plus
tard été instrumentalisé par les sauveuses (et plusieurs personnes de leur bord)
en dehors du collectif.
Le partage des tâches collectives s’est transformé en tentative de « convertir des
femmes à l’égalité ». Nous avons reçu des critiques dignes d’un camp de
vacances pour masculinistes convaincus, où faire le ménage nuit gravement à la
construction de la masculinité chez les adolescents...
Ce qui était au départ un désaccord sur la répartition des tâches est interprété
comme un désaccord culturel infranchissable. Cet argument récurrent en
fRance utilise une rhétorique raciste et coloniale où la situation n’est pas
analysée d’un point de vue politique, économique ou social, mais ramenée à une
vulgaire incompatibilité et opposition des cultures. Les personnes racisé-es
(musulmanes en particulier) et sans paps sont perçues comme figées dans une
culture forcément antiféministe, antiqueer, pas moderne, incapables de
comprendre et de fonctionner dans une culture dite égalitaire. Pour les
sauveuses, Argousier serait incapable de fonctionner au sein d’un lieu autogéré.
De plus, animées par un sentiment sacré de culpabilité, de dévouement, les
pratiques humanitaires empêchent toute organisation collective et autonome
avec et pour des personnes sans paps.
Alors qu’Argousier hésite à partir du squat, plusieurs personnes, ayant
largement pris part au conflit vont se dissocier et instrumentaliser l’affaire. Elles
vont prétexter que les radicales s’en prennent à une famille exilée en s’appuyant
sur le fait que l’une d’entre nous avait attrapé un des ados par le bras ! C’est
tellement facile... Tout cela est discuté lors d’une réunion : Eucalyptus se remet
en cause sur le fait d’avoir attrapé Navet par le bras (ce n’est pas parce que c’est
un ado qu’on peut le toucher sans lui demander son avis !). Des excuses
collectives sont présentées à Argousier sur la manière dont le conflit s’est
déroulé mais pas sur le fond. Argousier les accepte, mais explique qu’elle préfère
que ses enfants ne fassent pas le ménage. Nous voyons bien qu’elle ne bougera
pas de ses positions, alors nous maintenons la seule tâche de sortir les
poubelles et de l’aide ponctuelle (porter des meubles par exemple).
Après cela, la situation ne s’apaise malheureusement pas. Malgré les tensions, le
comportement de Navet et Panais empire ! Nous nous retrouvons à nettoyer
derrière des garçons méprisant sans respect des espaces collectifs, alimentant
les tensions et les frustrations. Toutes les autres habitantes étaient donc
démotivées, et en conflit permanent avec la famille d’Argousier.
SOLIDARITÉ ENTRE « FEMMES » ?
S’il y avait des moments collectifs chouettes, la logistique du quotidien prenait
une place écrasante dans le lieu. En contexte de confinement et de menace
d’expulsion, il y avait de surcroît de nombreuses sources de stress. Pourtant, les
moments les plus tendus étaient pris en charge par des personnes en grande
partie racisées et dans des situations personnelles plus compliquées ou moins
privilégiées. Les personnes qui bossaient à temps plein par ailleurs ont pris la
charge des choses les plus fatigantes psychologiquement et physiquement. Cela
a joué par la suite lors de la prise de position et de l’affirmation de soi lors de
conflits. Quand on est fatigué, qu’une partie des personnes nous ont usé,
comment arrive-t-on à gérer le conflit ? Nous ne sommes pas dans les meilleures
conditions et notre disponibilité mentale et physique est largement entamée.
Mais il est hors de question de lâcher l’affaire et de céder la place à des pratiques
hiérarchiques ! Ainsi, des personnes crevées et surexploitées se retrouvaient face
à d’autres personnes qui faisaient du militantisme de distraction en venant juste
donner des leçons en réunion. Et ce sont toujours les mêmes !
Dans les espaces féministes, les rapports de race et de classe amènent plusieurs
formes d’inégalités et des attentes différentes. Certaines femmes blanches et/ou
issues d’un milieu privilégié recherchent un espace sans conflit. Ce sont leurs
intérêts qui sont préservés, leurs avis qui sont pris en compte. Seulement, ce qui
les libère, ne libère pas les autres femmes et personnes queer automatiquement.
Le féminisme n’est pas une recette universelle. Elles imposent de parler
doucement, accusant la parole d’autres personnes de "leur faire violence", par
exemple. Consciemment ou non, elles imposent des codes et des modes de
fonctionnement blancs bourgeois et pourrissent l’agenda féministe, en
invisibilisant le travail et les luttes menées par d’autres personnes en tension
dans la catégorie « femme ». Elles mettent en place une charité à l’encontre des
personnes queer, trans, lesbiennes, musulmanes, noires, pauvres, folles-fous ou
handicapé-e-s.
CONFLITS ET AGRESSIONS
À plusieurs moments, surtout lorsqu’il y a des désaccords et des conflits, les
blanc·hes parlent beaucoup de "care" dans le collectif. Elles envisagent ce "care"
entre militantes, pour consoler les blanches qui pleurent. Ben oui, les
racisé·es/galérien·nes n’ont pas besoin de care, n’est-ce pas ? Leur objectif
affirmé est de bénéficier d’un espace pacifié et lisse, exempt de frictions et
d’engueulades. Dans le texte « Tu me fais violence », Jack Halberstam dénonce
justement cet accent porté sur la "blessure" et le ressenti individuel comme une
forme de néo-libéralisation des luttes queers et féministes. Il dit que la volonté
d’avoir des « espaces protégés et rassurants fonctionne de concert avec une
gentrification qui masque toutes les problématiques de classe et de race locales
et globales ».
En tant que racisées, il nous arrive fréquemment d’être accusée d’agresseuses
quand on s’exprime lors d’un conflit avec des blanches ou des personnes
racisées ayant intériorisé et intégré ces mêmes codes. Nous avons l’habitude de
devoir nous justifier mille ans sur la forme face à des interlocutrices qui évitent
le fond de nos propos. Pour être simplement entendues, il faut faire des efforts
énormes et prendre mille pincettes afin de contrecarrer la vision raciste des
blanches qui nous perçoivent d’emblée comme des menaces lorsque nous
affirmons des oppositions. Nous connaissons le tableau classique de la
méchante femme racisée qui agresse la blanche éplorée. Nous savons que le
commun des mortels accourt pour la sauver et l’ériger comme victime. Cette
interprétation ne laisse aucune place au fond du conflit, aux faits qui ont eu lieu
ou à une analyse des rapports de pouvoir dans une situation. Une femme
racisée ou de classe inférieure qui parle sèchement, qui n’adopte pas les codes
bourgeois, qui s’exprime d’une voix forte, même si elle parle sur un ton affirmé
n’est pas autoritaire. Nous avons le droit de parler fort et d’être en colère. Être
perçue comme une figure d’autorité, parce qu’on a des facilités à exprimer ses
idées ou parce qu’on est plus âgée ou expérimentée dans un domaine ne fait pas
de cette personne une dictatrice tortionnaire. D’autant plus si on appartient à
des groupes minorisés car les idées qu’on exprime ne sont pas diffusées
largement dans la société et seront moins admises par la majorité du groupe.
Nous avons des tactiques inhérentes à nos expériences sociales et nous refusons
de nous intégrer en nous écrasant.
L’autoritarisme, c’est imposer une décision sans avis collectif préalable, c’est
contraindre des personnes à aller dans son sens, c’est s’ériger comme chef et
forcer ses décisions au mépris de tout mode de fonctionnement collectif. Étant
donné que nous sommes dans un contexte culturel national autoritaire, que
nous en sommes imprégné.es depuis la maternelle jusqu’aux structures mêmes
de nos groupes militants, il est essentiel de rester vigilant.es sur notre façon de
prendre les décisions et de partager le pouvoir. Mais crier à l’autoritarisme
quand les choses ne vont pas dans son sens, face à des personnes qui
participent à mettre en place des outils de gestion collective, qu’est-ce que
c’est ?
Les personnes qui criaient à l’autoritarisme des réunions et des radicales avaient
d’autres méthodes : détourner les propos, jouer sur l’émotionnel pour rallier les
personnes à leur cause et aller à l’encontre des décisions prises collectivement.
C’était leur manière de "faire de la politique", ne jamais débattre en assemblée,
mais "convertir" le plus de personnes à leurs causes, de préférence des
personnes avec des liens "affinitaires" aka du même groupe social.
Un beau matin, les Bonnes Poires organisent une réflexion sur les conflits.
Quelques sauveuses ne se sentent pas bien dans le collectif. Elles missionnent
quelques amies à elles pour organiser un atelier de gestion de conflit. Il n’y a pas
de conflit déclaré. Une habitante, Coquelicot, se propose d’y participer. Les
radicales ne savent pas quelles personnes se sentent mal et de quel conflit il
s’agit. Les radicales expriment alors le besoin d’outils féministes et antiracistes
pour toute gestion de conflit. Au lieu de cela, les sauveuses vont utiliser des
méthodes inspirées du management et du développement personnel, un atelier
pour partager du "care" et du "love" en "mettant les "conflits sur la table". Au
passage, elles évincent de cette démarche Coquelicot, une habitante racisée et
sans papiers qui avait proposé à plusieurs reprises de faire des médiations dans
le collectif. Elle est remplacée par Fuschia, une militante blanche très peu
impliquée à La Bonne Poire.
Cette mise à l’écart des habitantes (qui avaient aussi des conflits à gérer), le
langage bisounours pour mieux aplanir les tensions et le fait de mettre au centre
le confort émotionnel des personnes les plus privilégiées plutôt que la discussion
politique sont critiqués par les radicales, qui insistent encore sur la nécessité de
reprendre des outils anarchaféministes pour régler les conflits. Peut-on se
remémorer que l’anarchisme n’est pas qu’une étiquette, mais un mouvement
politique qui a des méthodes et n’a pas besoin d’en emprunter au libéralisme ?
Face à cette demande, Marguerite insulte copieusement les membres du collectif
et les traite encore et toujours d’autoritaires. Forcément, si le pouvoir n’est pas
entre ses mains, il est entre de mauvaises mains. Marguerite n’est pas en accord
avec les bases du lieu, elle prend ses distances, boycotte les rares et précieux
moments festifs ainsi que les ateliers d’autoformation, mais ne quitte pas le
collectif. L’antiracisme ? Pas besoin. La théorie des privilèges blancs, c’est du
caca. Autodéfense féministe ? Rien à foutre. Je suis une femme forte, mouâ. Un
atelier de fond politique ? Rienâfout’. Un atelier sur la sécurité avec Eucalyptus ?
Si j’allais la pourrir ? Bref, Marguerite manœuvre le coeur serré et l’ego en
bouillie pour rester dans un projet qui ne lui convient pas, menant dans son
sillage sa meuf, sa meilleure amie et ses colocataires.
LA CHARTE
Les conflits liés à la vie collective et aux règles de fonctionnement du lieu
s’accumulant, nous proposons d’établir un fonctionnement interne clair du lieu.
Nous croyions encore que les dissensions venaient du fait que rien n’était
formalisé, couché sur le papier, tout était formulé à l’oral. Le groupe décide
collectivement de rompre avec la tyrannie de l’absence de structure, qui faisait
tourner tout le monde en bourrique, et de rédiger une charte. Pour cela, on fit
un tour de table lors d’une réunion collective et chacun-e partagea les principes
qui lui semblaient importants à faire figurer dans la charte. Cette assemblée fut
suivie de différents ateliers de travail en petits groupes, de relectures et de
modifications laissées à tout un chacun. Chaque étape de la réflexion était mise
à la disposition de toustes sur un espace en ligne.
Ce chantier de réflexion, aurait pu être un moment de discussion et de re-
définition du projet, mais il a été déserté unanimement par les sauveuses y
compris celles qui remettaient en question les fondements politiques au
quotidien, et laissé à la charge des personnes qui portaient déjà énormément de
choses depuis le début.
Lors du dernier atelier, par exemple, les personnes qui menaient leur petite
bataille de l’ombre contre le projet politique avaient tout simplement décidé
d’organiser une réunion militante sur un tout autre sujet, exactement à la même
heure et à quelques rues de là. Au final, nous n’étions que cinq à se taper le
travail assez relou de formulation et de rédaction. Quand nous avons été
contentes des résultats, nous avons présenté les textes rédigés en réunion et
nous les avons également mis en ligne afin que chacun-e puisse y apporter des
commentaires et des amendements.
De manière plutôt surprenante, à part une ou deux modifications marginales,
personne n’avait d’amendement à proposer. D’un côté, c’était super satisfaisant
de se dire qu’on s’accordait enfin autour du projet… Mais de l’autre, après
autant d’embrouilles, cela paraissait presque trop beau pour être vrai…
C’était finalement une autre manière de boycotter et saboter tous les processus
de décision et d’élaboration collectives en comptant sur l’épuisement progressif
des plus radicales.
S’AGRANDIR… AU RISQUE D’EXPLOSER
Les sauveuses continuaient à mettre des coups de pression pour accueillir de
nouvelles personnes dans le collectif. Intégrer n’importe qui, à tout prix, en se
disant que les gens se formeront sur le tas et en se foutant totalement de
connaître les positions politiques de machinette ou de bidulon.
Depuis le début du projet, les personnes venues d’une culture associative très
socdem persistaient contre vents et marées à envisager leur implication au squat
à l’image de permanences bénévoles, pas si éloignées d’un investissement dans
un centre socio-culturel.
En parallèle, une minorité de Bonnes Poires insistait pour faire des ateliers
d’autoformation à la fois pratiques et politiques. Il devenait de plus en plus
évident que même les personnes déjà membres du collectif étaient nombreuses à
être un peu voire très à la ramasse sur les questions d’autogestion,
d’anticapitalisme, ou sur les moyens de lutte et d’émancipation collective.
Comment transmettre à de nouvelles recrues alors que l’on n’a pas fait l’effort de
se former soi-même, en dépit des outils mis à disposition par d’autres ?
Les risques étaient énormes de fragiliser encore plus le groupe et de
communiquer des informations confidentielles à des personnes non fiables qui
voulaient accomplir leur petit service humanitaire dominical. Cherchant
fébrilement dans leurs carnets d’adresse militants, des Bonnes Poires
proposèrent des noms, souvent sans même avoir consulté les premier-es
concerné-es au préalable.
Des personnes déjà proches du collectif ont finalement été intégrées. Beaucoup
n’étaient même pas disponibles et leur « formation » consistait en quelques infos
filées à la va-vite sur un coin de table. Ce qui s’avéra une véritable perte de
temps et aussi, on le verra, une mise en danger du lieu.
Les véritables motivations de personnes qui rejoignent un projet sur le tas ne
sont jamais faciles à cerner. Au début, on pense que c’est pour filer un coup de
main ou pour dépanner. Mais il y a des gens qui cherchent à se faire mousser à
moindre effort, en fournissant une aide minimale mais en ayant un avis sur tout
et en prenant, très rapidement, en quelques semaines à peine, beaucoup de
place dans les discussions…surtout numériques, voire exclusivement
numériques.
C’est l’exemple de Tournesol, qui avait vaguement participé à une ou deux
réunions au tout début du squat, mais qui n’était jamais venue aux temps de
formation collective. Tournesol ne participait pas aux tâches quotidiennes et
n’avait pas fait l’effort minimal de s’informer sur les principes fondamentaux du
lieu. D’ailleurs, Tournesol n’était pas en accord avec la notion même
d’autogestion, remettant en cause dès son arrivée dans des discussions
(toujours informelles bien sûr) la pertinence et l’efficacité de cette forme
d’organisation. Tournesol avait quand même la langue bien pendue en-dehors…
trahissant toutes les règles de confidentialité en livrant des informations à des
tiers.
Il y a eu aussi Pimprenelle, dont l’arrivée dans le lieu a été encore plus
problématique car elle n’a jamais été actée en réunion. Pimprenelle connaissait
le squat par Acacia. Pimprenelle se montre tout de suite hyper volontaire. À la
fin d’une soirée, à minuit trois-quarts, alors que tout le monde est à moitié
bourré-e et en train de tout ranger, Pissenlit propose entre deux portes, de
manière totalement informelle et à l’arrache, d’inclure Pimprenelle comme
nouvelle occupante. Eucalyptus, qui part le lendemain pour quelques temps, lui
répond qu’il faut en décider collectivement et la former… Dans la foulée,
Pimprenelle est directement intégrée sans que cela n’ait jamais été décidé en
réunion. Dans le contexte d’épuisement collectif, les procédures de décision
étaient finalement de moins en moins respectées, ce qui ouvrait grand la porte
aux abus et aux problèmes.
Dans l’urgence et sans véritable réflexion, le collectif s’est précipité à accepter
des gens par simple utilitarisme, sans jamais avoir de discussion de fond avec
ces personnes pour voir si elles pouvaient être des squatteuses, avec tout ce que
cela implique en termes de positionnements radicaux. Nous ne savions même
pas jusqu’où celles-ci souhaitaient s’engager, ce qu’elles étaient prêtes à risquer
et quelles étaient leurs limites. Plus risqué encore, nous avons partagé des
informations confidentielles, donné des accès à des espaces numériques secrets
à des personnes qui, même si elles étaient des camarades de manifs, étaient aux
antipodes des luttes squat.
VOLER, C’EST MAL
Chicorée est accusée d’avoir volé de l’argent à une de ses riches patronnes.
Celle-ci l’emploie au noir et la sous-paye depuis quelques temps. La patronne la
vire et fait un scandale. Chicorée avait trouvé ce taff par l’entremise d’une
militante, qui connaissait la patronne. Mme Bourgeoise décide donc de mettre
un gros coup de pression au squat pour récupérer ses thunes, menace d’appeler
les flics, la préfecture, les services sociaux.
Les radicales sont en PLS, certaines ont quitté le collectif. Les sauveuses veulent
rembourser la patronne, critiquent le vol (alors même qu’on est dans un squat),
font la morale à Chicorée et ne lui apportent aucun soutien. Des informations
personnelles sont dévoilées à la patronne et sur les réseaux sociaux, elles
s’organisent avec elles avant même de s’organiser avec la première concernée.
Certaines proposent carrément de rembourser la pauvre petite riche patronne et
d’avancer la somme personnellement pour répondre à l’urgence.
Il est évident que la critique politique du capitalisme, de la propriété privée et
des systèmes d’exploitation n’est pas du tout partagée par les travailleuses
sociales/sauveuses du collectif. Elles en reviennent à leurs réflexes de classe et
au jugement des « mauvais pauvres ». Seule une minorité défend le vol comme
moyen légitime de survie. Isolée face à ce déferlement de discussions
numériques sans queue ni tête, face à des personnes qui ne savent même plus
qui elles sont et qui tour à tour la culpabilisent, Chicorée ne se sent plus
soutenue par le collectif.
Encore une fois, la position des sauveuses est contre les bases du squat
anticapitaliste. Elles soutiennent les patron-nes, les bourgeois-es, les blanc-he-s
et participent à criminaliser les pauvres et les racisé-e-s.
SAUVER, SAUVER, TOUJOURS SAUVER
À ce moment-là, tout va mal au squat, l’histoire de Chicorée a porté un coup au
moral et a déstabilisé le collectif, et puis sur le plan de la vie collective, tout est
crade : les ados ne veulent toujours pas lever le petit doigt, les tâches collectives
reposent sur une toute petite minorité et, cerise sur le gâteau, il y a des menaces
d’expulsion qui flottent encore. Alors que les plus radicales s’éloignent peu à
peu, ne se sentant plus aucune adéquation politique avec le lieu, les "sauveuses"
ne vont pas pour autant s’impliquer davantage. Tout au contraire, elles
abandonnent carrément les lieux, venant quelques heures sur place pour faire
des leçons de morale et inspecter les travaux finis, à la manière de
"gestionnaires".
Marguerite se dit que c’est le moment parfait pour accueillir une nouvelle
famille. Deux habitantes, Bouton-d’or et Coqueliquot s’expriment fermement
pour dire que cela leur semble hors de propos d’accueillir une famille avec
plusieurs jeunes enfants dans ces conditions. Il faut d’abord régler les problèmes
en cours ! De plus, la famille s’était vu proposée une autre solution
d’hébergement. Encore une fois, pour le désir d’une militante de sauver la
planète, les habitantes ne sont pas écoutées, les règles de bases du squat sont
bafouées et l’autonomie des femmes précaires est sabotée. Marguerite se déplace
au squat le soir-même et met la pression sur les habitantes pour qu’elles
acceptent l’accueil de cette nouvelle famille. Finalement, la nouvelle habitante ne
restera pas longtemps car elle sera très vite relogée dans le droit commun, ce
qu’elle souhaitait dès le début.
"OUTREPASSEMENT DE CONSENTEMENT"
Au milieu de ce marasme politique, un message de Pissenlit appelle à une
réunion d’urgence, pour parler « d’un outrepassement de consentement » ayant
eu lieu à la Bonne Poire. Depuis des jours, nous parlions du consentement
(nécessaire) des habitant-es pour la prise des décisions concernant leur lieu de
vie.
Quelques jours plus tôt, les moindres détails de la situation personnelle de
Chicorée avaient été jetés en pâture sur les canaux de discussion du collectif. Ce
soudain souci de confidentialité interroge Eucalyptus et Sauge, profondément en
colère contre les agissements du reste du collectif. Chacune de leur côté, elles ne
comprennent pas ce intitulé évasif, pensant que cet "outrepassement de
consentement" concerne encore ces mêmes histoires de vol ou bien d’une
nouvelle manipulation ayant eu lieu.
Sauge demande s’il est possible d’avoir plus de précisions sur la situation. On
lui répond qu’il n’est pas nécessaire de développer puisque le sujet est trop grave
et que l’intitulé se suffisait à lui-même. Eucalyptus pète un câble sur la
discussion en disant que c’est inadmissible que tout à coup une réunion puisse
être convoquée dans l’urgence pour un motif non précisé, alors que le collectif
est en crise grave et que personne ne voulait se réunir pour la résoudre. Dans sa
rage, elle ne prête aucune attention à Tournesol qui poste un message vocal ,
signalant qu’il s’agit d’un dépassement de consentement physique.
C’est alors qu’Eucalyptus apprend, via Cactus, qu’Acacia a agressé sexuellement
Tournesol à la Bonne Poire. Cependant, cette dernière, ne souhaite pas que son
identité soit divulguée. Pour respecter cette demande, Eucalyptus demande
qu’on transmette un message à Tournesol pour lui dire qu’elle est choquée et
désolée d’apprendre cette agression, et qu’elle regrette de s’être énervée sur tous
les problèmes du squat dans ce contexte. Selon toute probabilité, Tournesol
aurait reçu ce message. Pour autant, pour des raisons inconnues, elle va choisir
de le taire et demander ensuite des comptes.
QUELLE JUSTICE ?
Il faut évoquer des éléments importants lorsque l’on veut faire de la justice
transformatrice dans les milieux féministes et queers. Tout d’abord, il faut
signaler un élément positif : la démarche de soutien et d’écoute immédiates des
personnes à qui Tournesol a choisi de se confier, car c’est loin d’être toujours le
cas dans les milieux militants. À sa demande, ce sont ces personnes de
confiance, ainsi qu’une personne extérieure au collectif de gérer, qui ont mis en
place une médiation avec la personne agresseuse. Tout a donc été géré en amont
et il s’agit pour ce groupe d’informer La Bonne Poire de ce qui a été décidé.
Lors de la réunion d’urgence, dès le départ, les personnes ayant pris part à la
médiation annoncent aux habitantes migrantes du squat que cette réunion est
facultative pour elles, que cela ne les "concerne" pas (pourtant elles sont tout
autant que les autres militant·es, premières concernées par les violences
sexuelles). L’une d’elles, alarmée et concernée par les problèmes de plus en plus
énormes dans le squat, choisit de prendre quand même part aux discussions.
À l’invitation du groupe de médiation, la réunion s’ouvre avec la personne ayant
commis l’agression, Acacia, qui lit un texte au collectif. Celui-ci revient à peine
sur ce qui s’est passé : il ne qualifie ni ne nomme les faits. Il évoque les
réparations demandées par la victime (qui ont déjà été actées) : Acacia devra
s’auto-exclure de La Bonne Poire et de tous les espaces militants et/ou collectifs
fréquentés par Tournesol, ainsi que de tous les événements où cette dernière
serait susceptible de se trouver. Enfin, elle s’engage à respecter le processus de
réparation et à se former sur les questions de consentement. Une fois le texte lu,
elle quitte la réunion.
On se rend donc compte que la médiation a déjà eu lieu, toutes les décisions ont
déjà été prises, et qu’on vient juste nous en informer. Mais l’événement est arrivé
au squat. Aussi la gestion de ces violences ne devraient-elles pas être discutées
avec le collectif ?
Que la personne agressée choisisse des personnes de confiance extérieures pour
faire la médiation est tout à fait compréhensible. Par contre, que le collectif soit
totalement exclu des prises de décision et qu’aucune information sur l’agression
sexuelle (que le groupe continue à nommer "consentement outrepassé" lors de la
réunion), ne soit communiquée aux personnes qui vivent dans le lieu ou qui
l’occupent, ce n’est pas acceptable. Surtout, dans toute gestion collective des
violences, même si c’est souvent difficile et qu’en tant que personne ayant subi
l’agression, c’est ultra difficile de trouver les mots, il est nécessaire de qualifier
clairement les faits. Ainsi quand on parle "d’outrepassement de consentement",
c’est vague. Cela peut faire référence à des situations totalement différentes les
unes des autres : allant de pousser quelqu’un à donner un objet à force
d’insistance, à embrasser la joue d’une personne sans lui demander, jusqu’à
imposer une relation sexuelle à quelqu’un (le viol). En fonction de la nature des
faits, les réparations et les réponses données collectivement seront
différentes.
Lorsque l’agression a lieu dans un milieu queer et féministe et que la victime
souhaite faire appel à une gestion communautaire plutôt que de porter plainte,
il est primordial de faire appel à des outils comme ceux de la justice
transformatrice, pour éviter des erreurs récurrentes. Car souvent, on agit sous
le choc évident de l’agression et dans l’urgence, au risque de reproduire des
schémas punitifs et carcéraux. En premier lieu, il faut écouter et prendre
prioritairement en compte le besoin essentiel de réparation de la personne
ayant subi l’agression. Ensuite, si nous souhaitons mettre en place une justice
transformatrice et réparatrice, aux antipodes de la justice punitive pratiquée par
le système hétérocapitalopatriarcal raciste, il est également important de tenir
compte des oppressions systémiques dont souffrent à la fois la personne ayant
subi l’agression et la personne agresseuse.
Pourquoi faut-il prendre en compte les oppressions systémiques (sans les mettre
en concurrence) ? Parce que l’on remarque fréquemment dans les cas de gestion
communautaire des violences, que les agresseur-euses cisgenres bénéficent
davantage du soutien de la communauté. Ainsi, il est très rare que des mecs cis
het blancs soient exclus des milieux militants, parce que ce sont des personnes
privilégiées bénéficiant souvent d’un fort capital social. Les personnes trans, en
revanche, sont facilement bannies des seuls espaces qu’iels peuvent fréquenter,
et qui leur sont donc vitaux. Or, le bannissement ne doit pas être pris à la
légère : cela peut constituer une véritable mort sociale pour des personnes déjà
isolées.
Ceci étant dit, le besoin de Tournesol de ne plus être mise en présence de la
personne qui l’a agressée est légitime. La réparation de l’agression est
primordiale. Si l’agresseur·se refuse de reconnaître les faits ou de réparer ce
qu’iel a commis, l’exclusion (temporaire, cadrée et circonscrite) peut s’avérer
impérative. D’autant qu’une personne peut récidiver si elle n’entame pas un
profond travail de remise en question. Dans le cas présent, l’agresseur·se a
immédiatement reconnu les faits et a accepté toutes les demandes de Tournesol.
Il reste que l’exclusion totale et illimitée dans le temps d’une personne trans de
notre communauté queer et féministe comme premier recours, la solution la
plus facile en soi, nous a beaucoup posé question. Cela entrait en contradiction
avec les idées anarcha-féministes anti-carcérales que revendique le collectif.
Un partage des espaces soigneusement pensé, laissant certains espaces de
sociabilité et de lutte à la personne ayant commis l’agression, semblait plus
juste. Rappelons-nous encore et toujours que la punition n’est pas la justice.
QUELS ESPACES "SAFE" ?
Une bonne partie des Bonnes Poires sont donc placé·es devant le fait accompli
de cette gestion de l’agression sexuelle. Lors de cette réunion très tendue, Sauge,
meuf trans, se sent obligée de s’excuser platement et à moult reprises d’avoir osé
demander plus d’informations sur les faits. S’ensuit un acharnement sur
Eucalyptus, absente à cette réunion, pour les propos qu’elle a tenu sur la
conversation virtuelle. Elle est alors montrée du doigt comme une anti-féministe,
une alliée accablement décevante. Toute personne qui a tenté de défendre
Eucalyptus ce jour-là s’est vue remettre également à sa place et a été considérée
comme une autre personne « problématique » et pas « safe ».
Cette volonté absolue de créer des espaces « safe » dénués de conflits et
d’agressions montrait une absence de réflexion et beaucoup de confusion. La
réalité est évidemment plus complexe : il y a des agresseur·ses dans tous les
espaces, et plein de personnes sont à la fois autrices et survivantes de
violences.
De plus, en hétéropatriarcat, la grande majorité des femmes et des personnes
queers ont subi des viols et des agressions sexuelles. C’est aussi le cas à La
Bonne Poire, où la majorité des personnes ont vécu des traumas graves. Il est
donc absurde d’ériger une personne en victime à défendre ou à sauver.
De la même façon qu’il s’agit d’une erreur que d’essentialiser les femmes, queers,
racisées, etc., la condition de victime d’agression sexuelle n’exempte pas d’être
en conflits politiques, ni n’accorde une légitimité absolue à qui que ce soit.
Pourtant, l’agression de Tournesol va être utilisée par Pissenlit et Marguerite
pour imposer à chacun-e de se positionner : soit avec les "méchantes"
féministes, "pro-agressions" parce qu’elles demandent des comptes, soit avec
elles, les gentilles féministes "safe". La gravité de la situation nous avait
apparemment plongé dans un monde binaire et fait oublier toutes les réalités
politiques liées aux violences sexuelles.
SCISSION
La réunion qui suivit marqua la scission nette et franche du collectif. Une partie
du collectif, composée majoritairement de personnes anarchaféministes, décide
d’aller au clash, de percer l’abcès et de mettre tous les problèmes sur la table.
Au début de la réunion collective suivante, elles mettent cette discussion en
point prioritaire, reprenant méthodiquement la charte du lieu, en critiquant
point par point les pratiques qui avaient trahi ses principes. Sans que leurs
noms soient cités, les personnes concernées par ces reproches ont préféré
rapidement quitter la réunion en gros clash au bout de quelques minutes plutôt
que de nous écouter et de discuter.
Finalement, au lieu d’une discussion politique, c’est une division "affinitaire" qui
se produit. Celleux qui partent ne partagent pas forcément toustes les mêmes
positions, mais iels choisissent de suivre leurs ami·es, colocataires, amoureuxes.
Elles quittent alors la conversation virtuelle ce soir-là et envoient plus tard des
lettres de démission.
Au vu des événements des semaines précédentes, il n’y a de toute façon plus
aucune confiance entre nous. Celleux qui restent prennent acte de la rupture.
Nous revenons alors aux principes de fonctionnement de départ en se
débarrassant définitivement (on l’espère !) des postures de bénévoles-sauveuses.
Difficile, cette scission aura des conséquences importantes sur les mois à venir,
puisque celles qui sont parties vont ensuite faire pression sur le lieu pour l’isoler
et obtenir des "réparations" du "préjudice" subi. Malgré ça, après des mois de
conflits internes et de manoeuvres dissimulées, nous nous sentons comme
libéré-es d’un véritable poison quotidien, on se rapproche toustes, la joie revient
au quotidien et de nouvelles envies avec.
DEPART D’ARGOUSIER
Après le départ d’une partie des militantes, nous formulons collectivement la
nécessité de trouver une autre solution d’hébergement pour Argousier, qui avait
déjà évoqué son désir de partir de la Bonne Poire. Dans l’ambiance pourrie qui
prévalait les derniers temps, la famille d’Argousier, en plus des conflits liés au
ménage, n’est pas dans une attitude de coopération ni d’entraide collective.
Les anarchaféministes demandent souvent de l’aide aux libérales de gauche, qui
s’en lavent les mains voire instrumentalisent la situation (voir plus haut). Les
conflits avec la famille vont se multiplier autour d’autres questions – notamment
une question importante qui met en danger le lieu et les autres habitantes et
nous fera péter les plombs : la sécurité. Les adolescent-es oublient quasi-
systématiquement de fermer la porte du squat à clés ainsi que les fenêtres.
Panais, un ado, laissera même entrer une
meuf inconnue dans le squat (fautcroire qu’il avait l’habitude de voir débarquer des nouvelles « bénévoles » sans
être prévenu) et déambuler dans le lieu ! Par chance ce n’était ni l’huissier-e ni
un-e keuf...
La famille désire faire sa vie de son côté, sans contribuer aux règles de vie
collective, mais en profitant des ressources collectives (espaces, récup’, matos).
Lors des conflits avec les autres habitant-es, il va se produire des
comportements
irrespectueux
récurrents
(accusations
de
mensonge
systématiques quand quelqu’un dénonce un comportement, accusations portées
sur d’autres habitantes quand une connerie est faite, narguer les membres du
collectif en disant qu’il n’y aura aucune conséquence au bafouement des règles
collectives). Cela instaure un climat d’individualisme, sans doute accentué par le
manque d’échanges qui était (partiellement) dû au problème de la langue (même
si nous utilisions des traducteurs automatiques).
Ayant compris les failles de l’autogestion et du collectif, Argousier et les ados
s’approprient les « meilleurs morceaux », privatisent les objets collectifs, au
détriment d’autres femmes et enfants disposant de moins de moyens voire
d’aucun. Les conflits avec d’autres habitantes, notamment celles fraîchement
arrivées, sont quotidiens et intolérables, jusqu’à ce qu’Argousier pousse l’une
des habitantes pour l’empêcher de prendre un meuble collectif. Nos multiples
tentatives d’accords entre les besoins de la famille et les principes du lieu
avaient échoué.
En plein clash du collectif, le conflit de longue haleine avec Argousier explose
également. Nous sommes démuni-es et épuisé-es, en colère. Ce n’est pas le
meilleur moment pour discuter et, là encore, parce que nous ne parlons pas la
même langue, la dispute n’est pas égalitaire. C’est comme un gros bouton plein
de pus qui explose.
Cela fait longtemps déjà qu’Argousier, consciente que ça ne fonctionne pas,
cherchait une autre solution de logement. Lors de la dispute, nous lui proposons
de l’aider dans sa recherche et de trouver une solution alternative d’hébergement
pérenne, dans le droit commun. On lui dit que rien ne presse, que tout le monde
a conscience que cela prendra du temps et que tant qu’elle n’a pas de solution
qui lui convienne, nous continuerons à cohabiter. Nous lui proposons diverses
solutions (institutionnelles ou chez d’autres personnes). Mais c’est trop tard, le
conflit a pourri depuis des mois et, de son côté aussi, Argousier a nourri du
ressentiment contre le collectif. Bref, c’est encore plus tendu.
Un jour, l’une d’entre nous lui propose une solution de relogement. Argousier
refuse et informe à ce moment le collectif qu’elle a en fait décidé de partir vivre
dans un squat conventionné. Comme il n’y a pas encore de chambre libre, elle
dit qu’elle aura une place en priorité en dormant sur place, dans un espace froid
et insalubre (la cave) en attendant ! On avait déjà entendu parler de cette façon
de procéder dans ce lieu, confronté à un nombre énorme de demandes, qui s’est
donc retrouvé à héberger des personnes en galère dans le couloir ou dans le hall
en attendant que d’autres partent.
Tour à tour, on va voir Argousier pour lui faire part de notre inquiétude. On
avait déjà passé des mois avec elle, on n’était pas à des semaines ou à des mois
près, y avait pas urgence ! Nous ne sommes pas du tout rassuré-es à l’annonce
de leur départ dans un tel contexte. On partage les informations qu’on a avec la
famille, rappelant à de nombreuses reprises que si la solution n’est pas
sécurisante et pérenne pour elleux, iels n’ont pas à partir précipitamment, alors
qu’iels pourraient prétendre à un logement dans le droit commun. Peine perdue.
Argousier est une personne fière et intraitable, elle a pas digéré notre dernier
clash, ce qui se comprend obviously. Elle ne veut plus avoir affaire aux Bonnes
Poires, on est des "menteur-ses" et "des racistes". On est totalement opposé-es,
la discussion est un cul de sac.
C’est le point final de mois de tentatives de cohabitation, de compromis, de
négociations de terrains d’entente et de partages réciproques. Bref, on n’arrive
pas à s’organiser ensemble, c’est tellement dommage mais c’est comme ça.
Son départ du squat est mis en scène par les anciennes membres du collectif,
qui viennent cette fois-ci de manière spectaculaire, en nombre, avec des
véhicules (quand d’autres habitantes ne méritaient pas une telle aide semble-t-
il...). Apparemment ce sont elles, les "sauveuses", qui lui ont proposé cette
"solution" vraiment géniale. Au final, Argousier est responsable de ses choix, ce
n’est pas une victime, elle décide et privilégie toujours son autonomie.
Cependant cela prendra plus de temps que prévu pour qu’une chambre se
libère, les quelques jours escomptés deviendront plutôt des semaines dans des
conditions vraiment pourraves.
Les sauveuses vont utiliser cette situation merdique, en disant que c’est de la
faute des Bonnes Poires qui restent (elles, en revanche, sont les "gentilles" bien
sûr, elles oublient fort avantageusement leur participation aux différents conflits
durant les mois de cohabitation).
Comme au zoo, les sauveuses organisent carrément des visites dans la cave où
dorment Argousier et ses enfants, pour convaincre des militant-es de
Bourgetown de la grande méchanceté des "radicales" de la Bonne Poire.
Argousier affirmera même avoir été mise à la rue. De notre côté, nous
conservons la certitude que nous ne pouvons nous organiser et habiter avec
celleux qui ne veulent pas s’organiser avec nous. Là encore, on a pas pour
mission de sauver toustes les galérien-nes de Bourgetown.
EXCLUSIONS ET HARCELEMENTS ou LA POLITIQUE DU CALL-OUT
Un jour, Courgette, qui n’avait pas assisté aux dernières réunions, nous informe
qu’elle veut récupérer quelques affaires à la Bonne Poire. Nous lui ouvrons la
porte. Puis nous vaquons à nos occupations. Alors, des anciennes entrent pour
l’aider, ainsi que des associatives non membres du collectif.
Quand on engage la discussion, ces dernières nous accusent d’être «
politiquement problématiques » et ne souhaitent plus « travailler avec nous ». Les
faits reprochés sont plutôt vagues. On nous parle de positionnement
problématique sur un groupe de discussion concernant un viol (même si ce n’est
pas précisé, cela vise logiquement Eucalyptus et Sauge, voir plus haut). Nous
apprenons alors par la même occasion que ce qui avait été nommé «
outrepassement de consentement »
était en
réalité
un
viol !
Aussi, ces personnes nous accusent d’avoir mis Argousier à la porte. La preuve :
elle est dans une cave. Par contre Chicorée, qui a dû partir dans des
circonstances intolérables, est complétement oubliée de l’histoire... Tiens, tiens...
Même si c’est très gros, les anciennes membres du collectif, cachées à l’entrée,
n’interviendront pas.
Pourquoi se justifier face à des personnes qui ne font pas partie du collectif et
qui ne sont pas de notre bord politique ? Comment se défendre quand on est
déjà condamné-es, sans en dire trop ? Ce sera le début d’une cabale contre la
Bonne Poire.
Dans les milieux militants, notamment féministe et queer, il se développe depuis
quelques années une gestion très nocive des conflits et des violences. Au lieu de
se responsabiliser collectivement et de mettre en place une justice
transformatrice, les militant·es se rassemblent en clans affinitaires plutôt que de
mener une réflexion, en bashant publiquement et en menant des vengeances.
Après la scission, les punitions commencent : plusieurs membres du collectif de
La Bonne Poire restant ont été exclu-es d’espaces ou de collectifs féministes et
queers. Des manifestations sont également organisées en excluant
volontairement de l’organisation les Bonnes Poires qui étaient impliquées
jusque-là. Les ami-es commun-es sont pris-es à partie individuellement, sommé-
es de se "positionner" dans un conflit qui ne les concernent en rien et dont iels
ne connaissent pas les circonstances. Nous commençons à comprendre que les
sauveuses ont raconté tout ce qui se passe dans le squat et selon leurs propres
termes, dans un but précis : nous isoler et nous faire payer leur auto-exclusion
du collectif.
Puisque nous ne répondons pas aux agressions, alors les "sauveuses" tissent
des récits, passant au niveau des ragots. Lorsque Tournesol croise par hasard
Eucalyptus à vélo, celle-ci la remarque à peine. Plus tard Tournesol racontera
qu’Eucalyptus l’aurait "empêchée de passer", c’est sûrement plus captivant. Elle
raconte également que Cactus l’aurait attaqué lors d’une réunion, alors qu’il en
est rien.
Plus problématique encore, les anciennes membres du collectif vont comparer
Eucalyptus à un mec cishet blanc violeur et pédocriminel : Polanski. Plus tard,
elles nous assimileront à des fachos. Bref, elles accumulent les points Godwin
pour recevoir plus de soutien, et ça marche plutôt bien apparemment.
Plus tard, les sauveuses vont aller jusqu’au bout de leur logique de travailleuses
sociales : elles auraient effectué au squat un travail (qui mériterait salaire –
même pas du bénévolat !). Cet « investissement » mérite selon elles une
compensation matérielle et financière. Elles réclament également des matelas
pour Argousier, qui pourtant dit ne pas en vouloir de notre part lorsque nous la
contactons directement.
C’est intéressant de voir que ces mêmes sauveuses ayant été impliquées dans un
autre squat masculiniste, pro-flic, où ont eu lieu des violences sexistes et du
harcèlement n’ont jamais dénoncé publiquement ce squat, au contraire de la
Bonne Poire, lieu ouvertement féministe, queer et antiraciste. Les féministes
n’ont pas le droit à l’erreur. Et leurs vulnérabilités sont facilement exploitables.
Enfin, les sauveuses sont allé-es pleurer auprès de collectifs militants de leur
cercle proche. Ceux-ci dans une logique affinitaire et "clanique", sans aucun
souci de justice transformatrice ou de médiation quelconque, n’ont pas fait
l’effort de nous contacter, mais ont signé un courrier hallucinant, dans lequel les
anciennes demandent carrément de l’argent à un squat pour payer les séances
de psy de Tournesol (!!!) et indemniser à la fois Argousier et les ex "bénévoles".
CALL-OUT ET RÉPRESSION
Parler de ce qui fonctionne ou non dans nos modes d’organisation et d’actions
politiques est important : pour nos retransmissions et évolutions. La parole est
un acte fort politiquement, surtout dans une culture patriarcale et raciste du
tabou. Par contre il semble évident et important de mesurer l’usage qu’on fait de
cette parole.
En tant que militant-e-s anarchistes, nous engageons nos responsabilités et nos
corps dans des batailles politiques. Nous refusons que d’anciennes camarades à
l’ego froissé soient celles qui nous mettent en danger en divulguant des
informations qui seront utilisées contre nous par la justice et la police. C’est une
honte pour tout le mouvement social. Nous dénonçons la trahison pure et simple
de nos valeurs en tant que squatteureuses et militant-es dans un contexte où la
violence d’État a déjà tous les droits. La solidarité dont bénéficie la Bonne Poire
n’a jamais été un luxe, elle est vitale pour toustes celleux qui y sont lié-es : les
habitant-es, les militant-es, comme les personnes qui profitent de ce lieu
accueillant, quelques heures ou quelques jours. Ce n’est pas parce qu’une
poignée de mécontentes n’en profiteront plus que la Bonne Poire doit être exclue
des luttes et espaces féministes.
On ne peut pas prétendre dénoncer (call-outer) un lieu précaire et illégal comme
un squat, avec des personnes marginalisées (précaires, femmes, lesbiennes,
trans, racisées, sans papiers) – même en milieu restreint – comme on dénonce
une personnalité publique, un politicien, ou une institution. Les conséquences
ne sont pas du tout les mêmes. Et un minimum de réflexion rendrait cela clair
dans n’importe quel esprit (d’ailleurs, elles l’ont compris d’elles-mêmes
puisqu’elles prétendent ne nous dénoncer qu’au « milieu féministe »). Nous
dénonçons des gens de pouvoir qui échappent à la justice par l’omerta et le
soutien des institutions. Pas ceux dont l’existence est déjà quotidiennement
menacée. La déception personnelle et le ressenti sont sûrement réels, mais ils ne
sont pas les bases d’une politique pour la justice.
Nous avons reçu des lettres de dénonciation publique, d’autres dans la boîte aux
lettres agrémentées de menaces d’exclusion d’une partie du milieu féministe de
Bourgetown. Dans ces lettres, on nous demande de l’argent pour « réparations »,
des excuses publiques. Qui prétend faire la justice ? Pour quels faits ? Pour
qui ? Même la justice patriarcale accorde un droit de parole aux accusé-es avant
de les juger. Nous ne sommes pas dans des démarches de justice, mais dans des
manœuvres basses de vengeance qui ne servent que l’ego de quelques
personnes.
En soi, le call out n’a qu’un seul objectif : isoler. Quand on choisit d’isoler les
membres de notre propre communauté, avec des mensonges et une
instrumentalisation des faits, sans s’inclure soi-même dans la responsabilité
collective qui peut être portée, c’est qu’on ne considère plus les call-outé-es
comme des membres de notre communauté, plus comme nos adelphes. Alors
ielles ne mériteraient qu’une chose : la punition par l’exclusion.
Ce qui va également contribuer à la réussite d’un call-out, c’est le manque de
réaction du milieu militant. Généralement, lorsqu’il y a call-out, ce n’est pas le
nombre de personnes qui y sont à l’origine qui compte mais le laisser-faire qui
domine les milieux féministes et militants (source : Joreen, "Trashing : the dark
side of sisterhood"). Les gens vont boycotter un lieu dit « problématique » sans
jamais faire référence à des faits renseignés. Ces pratiques sont répandues. Elles
marquent une certaine binarité et une impossibilité de remise en question
collective. Nous serions alors dans un monde avec des valeurs morales claires
dénué de complexité où il y a des gentilles et des méchantes. Nous avons
dépassé ces explications simplistes. Il n’existe pas de héros ni d’héroïnes comme
il n’y a pas de chef-fe. Nous ne croyons pas aux espaces « safe » ni aux individus
politiquement « purs ». Cependant, nous voulons maintenir une certaine
cohérence et définir clairement un but commun. Aussi, quand un projet foire, il
est essentiel de reconnaître ses propres responsabilités.
LE LIBÉRALISME NOUS INTOXIQUE
Durant nos nombreuses discussions informelles avec nos anciennes camadares
soc-dems, nous avons pu entendre que l’anticapitalisme et le féminisme étaient
de belles théories enfermées dans des bâtiments universitaires. Il s’agit d’une
méconnaissance flagrante de l’histoire des luttes et des pratiques politiques qui
serait trop longue à détailler ici.
Nous nous sommes beaucoup interrogé-es sur nos mécanismes et ceux de nos
anciennes camarades. Et nous avons reconnu une idéologie contre laquelle nous
luttons : la logique néolibérale de la sauveuse. Nos milieux politiques sont
envahis par un ennemi historique, de plus en plus virulent : le libéralisme. Plus
exactement, ce sont les croyances qui ont infiltré nos sociétés, permettant au
système économique (le capitalisme) de perdurer et de transformer les individus
pour qu’ils conviennent au système. Au lieu de changer le système pour qu’il
convienne mieux aux individus, qu’il leur permette de vivre, de partager et de
cultiver la diversité, les individus sont sommés de s’adapter au système. Depuis
la maternelle, nous sommes dans ces logiques : celles de la compétition entre
individus, celles d’un marché global où tout - même nos émotions, notre
performance de race ou notre genre - est devenu une marchandise !
Dans un système capitaliste ayant construit ses bases sur des idéologies
racistes, coloniales et patriarcales, les luttes sociales (et plus spécifiquement
pour le soutien des personnes migrantes) se retrouvent gangrénées par du
travail social, des pratiques humanitaires, de la gestion de masses, d’individus,
sans aucune possibilité émancipatrice. Sauver, c’est d’abord sauver le système
établi, tuer les révoltes et les autres possibles en volant l’autonomie des
personnes.
C’est le même système qui va obliger les gens à être productifs, ou à « servir à
quelque-chose », tout en nous empêchant de rêver, de flâner, de nous reposer ou
d’imaginer un autre monde.
C’est cette idéologie qui va mettre les groupes d’individus en compétition : les
racisé-e-s contre les féministes, par exemple. Nourrissant des échelles entre les
oppressions et la course à qui en additionnera un maximum.
Ce sont ces valeurs qui veulent nous forcer à entretenir un squat rentable, à
entasser des gens, faire du chiffre, à juger les individus pour savoir qui mérite
un logement et qui ne colle pas à l’image d’une bonne précaire. Sans jamais
prendre en compte quelles sont les ressources des personnes et les besoins
qu’elles expriment. On a pu aussi entendre des éléments de langage renvoyant
au monde associatif, lui-même s’inspirant du marketing (et marketing
associatif / social) comme « public cible » ou "bénéficiaires" pour parler de
personnes que l’on peut accueillir dans le lieu. En marketing, le terme "public
cible" renvoie aux caractéristiques principales des consommateurs d’un produit
donné.
Le libéralisme ne détruit pas les rapports de pouvoir, puisqu’il vogue dessus. Il
faut une hiérarchie entre les individus pour pouvoir les exploiter, comme on
exploite la nature et les animaux considérés comme inférieurs. Le projet
capitaliste conditionne les femmes racisées et migrantes à accepter des jobs
précaires et sous-payés et des positions sociales subalternes en leur faisant
croire qu’il s’agit de bienfaits dans un processus d’intégration normal. Par
exemple, pour que les femmes blanches puissent travailler et remplir les rôles
que leur position sociale exige (ménage, enfants, soin des personnes âgées ou
handicapée, soin du mari et du foyer), la modernité capitaliste exige que d’autres
femmes (pauvres, racisées et/ou exilées) puissent travailler presque
gratuitement pour elles (source Sara R. FARRIS, Au nom des droits des femmes ?
Fémonationalisme et néolibéralisme).
Ce n’est jamais purement altruiste de proposer un job de soin en échange d’une
maigre rétribution non déclarée. Cela détruit l’autonomie des individu-e et la
solidarité entre femmes. Même si un salaire régulier est une aide matérielle
précieuse pour les femmes, le travail dans l’économie capitaliste ne libère pas. Et
encore moins quand il est sous-payé et conditionné à une performance de bonne
pauvre travailleuse. Dans la pratique, les abus sont nombreux (chantage,
harcèlement sexuel, maltraitances etc). Et lorsque des femmes se retrouvent
opprimées et domestiquées par d’autres femmes, cela sape la solidarité
féministe.
Le capitalisme tente toujours de nous rendre complice de l’exploitation qu’il met
en place pour soit-disant « nous libérer ». Pour le système capitaliste, intégrer
des femmes racisées dans le monde du travail permet de garder le marché du
37travail en tension et profite toujours aux plus puissants. Le secteur du travail
domestique ne peut pas être remplacé par les machines, ni délocalisé, aussi
l’État ne veut prendre en charge les métiers du « care ». L’économie capitaliste
s’arrange des nombreuses femmes migrantes prêtes à travailler à bas salaire,
sans droit ni statut.
Cette question nous semble essentielle dans un mouvement comme le nôtre où
cette question du travail et de l’autonomie des personnes précaires est
omniprésente.
Les travailleuses sociales et les sauveuses doivent s’interroger sur leur
participation à l’exploitation des femmes quand elles poussent à « l’intégration »
des migrantes dans la sphère reproductive (soin, travail social et éducation). Ce
secteur valorise certaines compétences que les femmes migrantes sont sensées
avoir : être à l’écoute, être présente sans déranger, travailler dur sans broncher
etc. Ironiquement, on dit à ces femmes que l’émancipation viendrait en
travaillant ! Pour les femmes pauvres et/ou racisé-e-s, qui ont toujours travaillé,
ce discours est réservé aux femmes blanches bourgeoises persuadées de faire
"une bonne action". Et sans même se soucier que les femmes migrantes ont
d’autres compétences : elles connaissent plusieurs langues, ont appris des
métiers autres, peuvent se former, ou simplement ne peuvent pas ou ne veulent
pas travailler. Les sauveuses doivent s’interroger sur leur besoin vital d’intégrer
d’autres femmes dans la nation et dans le capitalisme par le travail. L’idéologie
libérale nous force à croire que le travail apporte plus de richesse et de liberté. Il
en apporte oui, aux riches, pas à nous.
Pour nous squatter, cracher sur la propriété privée fait aussi partie du combat.
Et non, un squat n’a pas à être plein à craquer et à s’apparenter à un
hébergement social de masse pour justifier son existance ! Pourtant c’est ce qui
ressort beaucoup à Bourgetown, dans une conception classiste, libérale et
nationaliste de l’intégration et de l’ascension sociale : le squat serait le plus bas
niveau de logement, immoral (car c’est du vol, et ouloulouh c’est mal) et crade (et
donc réservé aux classes sociales les plus pauvres, précaires et vulnérables,
comptant les personnes sans paps). Si un squat peut être beaucoup de choses, il
en reste fondamentalement politique. Nous ne pouvons pas nous résoudre à en
faire une opportunité à bas coût pour nous saucer socialement (personnellement
ou collectivement d’ailleurs), pour faire du contrôle social ou de la gestion de
masse, et y prolonger les pratiques intégrationnistes et libérales, coloniales,
racistes et patriarcales d’un système capitaliste qu’on dégueule.
Nous sommes toustes intoxiqué-es par cette culture libérale à des niveaux
différents. Nos luttes consistent aussi à trouver des alternatives et des failles à
ce système qui veut nous contrôler et nous ranger dans des cases où nous
crevons. Si nos allié-es vont dans le sens du système, de l’État et de ses
institutions, ce ne sont plus nos allié-es.
En tant qu’anarchistes, nous cherchons la liberté, pas celle d’un petit groupe
d’individus qui en exploite d’autres, mais celle d’un maximum de personnes.
Nous pensons que la solidarité et la mutualisation des ressources est plus
intéressante que de s’intégrer dans un système qui est en phase de
pourrissement et de mort. Nous ne voulons pas vendre un peu de liberté pour
plus de sécurité. Car ce choix est un leurre.
En tant qu’anarchiste nous savons que tout cela demande beaucoup
d’implication, de temps, de discussions, de moments de réflexion,
d’apprentissage et de pratique. Un lieu qui est transparent dans son
fonctionnement, un lieu où le conflit peut être utilisé pour la libération. Nous ne
pouvons demeurer tiraillé-es entre libéralisme et anarchisme. Notre
positionnement est clair. Le libéralisme a assez de tenants pour que nous lui
cédions un centimètre carré de notre espace. C’est dans ce sens que notre lutte
est radicale.
L’IMPOSSIBLE ALLIANCE ENTRE MODÉRÉ.E.S ET RADICALES
Lutter fait du bien au moral. Être dans le caritatif c’est valorisant socialement.
Certain·es cherchaient (sans doute inconsciemment) de la gratification dans leur
engagement à la Bonne Poire. Et les anarcha-féministes sont des sorcières
ingrates, c’est bien connu ! Le sentiment de faire dans le "caritatif" peut paraître
inoffensif ou anodin, mais cela n’a rien à voir avec la transformation de la
société. Considérer qu’on fait œuvre charitable sans se remettre en question, en
pensant que l’acte du don se suffit en lui-même c’est considérer qu’il est normal
d’avoir une société de classes et qu’en tant que privilégié-e, il suffit d’être
généreuxe pour contrebalancer les inégalités. En tant qu’anarchiste, nous
nourrissons le rêve fou d’une société sans classe et avec une égalité effective.
Une des raisons pour lesquelles nous avons continué avec des personnes
visiblement pas du même bord politique, est l’idée (utopique ?) que des
personnes d’horizons différents pouvaient s’allier dans un même but. En plus de
s’adapter au contexte peu radical, nous voulions expérimenter la diversité des
stratégies en mettant en commun des pratiques et des ressources (matérielles et
relationnelles). Nous l’avons testé pour vous et nous ne pouvons pas vous
recommander une telle balle dans le pied !
Cette stratégie aurait dû se contenter d’être une tactique ponctuelle. En tant que
telle, elle s’est avérée efficace à plusieurs reprises, surtout lorsqu’il s’agit de
s’unir contre une menace extérieure forte comme celle de l’État et de sa police.
Comme lors de manifestation, le besoin de se solidariser est plus fort que les
dissensions politiques. Face à la menace extérieure, qu’il s’agisse de poulagas ou
de fafs, le groupe se ressoudait instantanément pour sécuriser et protéger le
lieu. Dans ces moments-là, on se disait qu’il y avait quand même du gros
potentiel, qu’on tenait toustes à notre Bonne Poire et que les embrouilles allaient
se résoudre.
Par contre, avoir un collectif – avec certes un but commun – mais des gens qui
sont foncièrement contre les radicaux, leurs idées comme leurs méthodes, est la
porte ouverte au sabotage interne intense ! Il ne s’agit pas d’un manque de
connaissance, mais d’un positionnement conscient et ferme. Dans cet espace où
nous devions prendre des décisions ensemble, cela a été un échec. De plus, par
la suite, les manœuvres de dénonciation et de mise en danger du lieu et de ses
habitant-es ainsi que des militant-es qui y sont lié-es nous confirme qu’il s’agit
d’une erreur encore plus importante.
Nous pouvons être des allié-es tactiques à certains moments, mais nous n’avons
pas les mêmes pratiques, pas le même horizon, pas le même vocabulaire, pas les
mêmes objectifs politiques. Il est dès lors - en tant qu’anarchistes - impossible
d’ouvrir un squat avec des soc-dems, au risque d’y perdre à la fois sa santé
mentale et son squat. La rupture était inévitable et d’un grand soulagement.
Nous aurions pu maintenir des relations respectueuses comme nous le faisons
avec bon nombre de personnes avec qui nous ne sommes pas d’accord
politiquement, encore faudrait-il avoir un fonctionnement mature et sain.
Nous sommes heureuxes d’avoir retrouvé une cohérence et une bonne ambiance
dans le collectif. Bien que nous soyons aujourd’hui isolé-es d’une partie du
milieu militant, nous avons résisté à la récupération du lieu et cela est déjà une
victoire pour nous. Nous faisons partie du paysage politique et nous ne partirons
pas.
Toustes radicales que nous sommes, nous admettons que les libérales de gauche
et les sociales-démocrates existent, quelque part (loin de nous !) et qu’elles ont
leur rôle à jouer dans la création d’un autre monde. Mais elles doivent
comprendre que nous ne luttons pas pour des miettes, des réformes ou la bonne
conscience. De là où nous parlons, ce n’est absolument pas notre rôle, et cette
société a toujours eu besoin d’éléments radicaux pour faire bouger les lignes,
même parmi les institutions. On ne balaie pas des siècles de luttes
anticapitalistes, anticolonialistes et antipatriarcales en un revers de main. La
combinaison de ces luttes est vertigineuse et politiquement complexe. Elle exige
de transformer tous nos rapports sociaux, souvent au prix de clash, de larmes et
de colère ; mais tout aussi souvent dans le rire, la joie et la puissance. Pour
nous, elle nécessite d’être radical-e et ne peut se contenter d’un militantisme
dominical et de la satisfaction des egos des un-es et des autres pour avancer.
Un autre élément important est l’idée que partager les mêmes oppressions
suffirait à rassembler des individus dans une lutte. Subir le racisme ne rend pas
automatiquement, par essence, conscient-e de ce système ni ne nous infuse
magiquement de l’histoire de cette lutte. Les mots qui sortent de la bouche de
personnes racisées ne sont pas tous des mots antiracistes. Comme toutes les
décisions prises par des femmes ne sont pas forcément féministes. Ne soyons
pas crédules. Les façons de lutter contre le racisme sont nombreuses et
beaucoup ont été détournées, déradicalisées, intégrées dans le capitalisme et
utilisées par des Blanc-hes. Car c’est ce que font les Blanc-hes : iels nous
utilisent. L’idéologie de l’antiracisme libéral permet aux Blanc-he-s d’utiliser des
porte-paroles racisés pour tenir des discours profondément racistes ("je peux pas
être raciste, j’ai une amie racisée" ou encore "je ne vois pas les couleurs, je suis
humaniste et gentille"). Nique les gentil-les. Ce sont les pires ! L’actualité sur
l’islamophobie en France pullule de tels exemples de racisé-es porté.e.s en
étendard pour justifier son non-racisme.
À l’inverse, l’antiracisme politique interroge, pose des questions, prend position,
se met en danger face à l’État et dans des positions inconfortables. Il veut un
engagement anticapitaliste. De fait, il est intrinsèquement lié aux luttes
anarchistes. Nos luttes et nos vies dans ce mouvement ont été maintes fois
effacées, même par nos camarades.
Même si nos positions sociales sont censées nous rassembler parce que nous
luttons contre les mêmes oppressions, cela nécessite un travail politique de
conscientisation, de savoir comment on veut lutter, à quel endroit, et avec qui.
Ce n’est pas parce que plusieurs personnes sont catégorisées femmes qu’elles
vont vibrer en symbiose en partageant le même espace. Il n’y a pas un équilibre
chimique naturel qui prendrait le dessus. Nous baignons dans une culture
patriarcale qui influence nos relations depuis toujours. S’il n’y a pas de remise
en question individuelle et de volonté d’autoformation, l’organisation
politique est impossible.
Même si à Bourgetown, le milieu anarchiste est – comme dans bien d’autres
endroits – marginalisé, cela ne nous empêchera pas de revendiquer les idées et
politiques d’un anarchisme féministe, queer et antiraciste. Nous tentons d’agir
en cohérence avec cette ligne politique, pas celle que la masse socio-démocrate
veut nous imposer.
Nous avons, depuis le début, été dans la pédagogie de ces pratiques, nous avons
avancé le visage découvert parmi nos adelphes. Ce n’était pas le cas en face.
Dans l’histoire des luttes collectives, et celles dans lesquelles nous nous sommes
engagé-es individuellement, nous savons que les rapports de pouvoir nous
desservent. Dans les conflits, les espaces reviennent toujours aux plus privilégié-
es. Dans notre histoire, ça n’a pas été le cas. Et nous espérons être soutenu-es
par d’autres anarchistes autant que par d’autres qui ne se disent pas
anarchistes mais œuvrent pour la justice sociale et contre les oppressions de
sexe, de race et de classe. À l’intérieur des murs de la Bonne Poire ou à
l’extérieur, nous ne partirons pas, nous sommes partout, nous sommes
ingouvernables et nous résistons.
LEXIQUE
AUTOGESTION - L’organisation "par et pour"
Pour nous, l’autogestion, c’est le fait de s’organiser collectivement, c’est-à-dire
décider et exécuter, hors de tout rapport de hiérarchie. Cela suppose des
pratiques concrètes bien loin de ce qu’on peut trouver au sein de la société
capitaliste et libérale. Dans ce cas-là, en général, une poignée de personnes
décide. C’est ce qui se passe de manière caricaturale dans les conseils
d’administration des entreprises composées de personnes cumulant beaucoup
de privilèges. Cela dit, c’est aussi le cas dans d’autres structures censées être
"plus humaines" telles que des assos ! A côté de ça, une majorité de personnes
exécutent leurs décisions et ces personnes ont en général beaucoup moins de
privilèges comme les employés d’une entreprise ou d’une asso.
L’autogestion suppose une réelle implication de toutes les personnes du collectif
à la fois dans les prises de décision et dans la mise en place des décisions prises.
Cela suppose aussi une grande prise en compte des privilèges et des oppressions
afin de ne pas retomber dans des pratiques organisationnelles oppressives. En
effet, plus on cumule de privilèges, et plus on a pu avoir l’habitude dans nos vies
d’être dans des instances (plus ou moins formelles) dirigeantes. Réciproquement,
plus on cumule d’oppressions, moins on a été habitué.e à cela. Les personnes
cumulant des privilèges ont donc une grande responsabilité dans le fait de ne
pas en abuser et de laisser la place aux autres.
Principes de base :
* Les règles sont fixées par les personnes concernées.
* Principe opposé à l’autoritarisme
* Suppression de la distinction entre dirigeant.e.s et dirigé.e.s
* Recherche de consensus.
* Tout est sujet à débat.
* Il peut y avoir beaucoup de débats, des réunions, des autocritiques, des
discussions à rallonge, qui prennent du temps
* L’autogestion s’inscrit dans un projet politique de base : contre le système et
l’idéologie capitaliste et ses fonctionnements sexistes et racistes.
ANARCHISME
L’anarchisme, ce n’est pas le désordre et le chaos, contrairement à ce que
prétendent malhonnêtement la plupart des dictionnaires ! L’anarchisme, c’est
une théorie politique visant simplement la destruction de l’État et de tout
rapport de hiérarchie et d’exploitation afin de se libérer individuellement et
collectivement. Puisqu’il ne peut y avoir de liberté sans égalité, l’anarchisme se
bat contre toutes les formes de domination ou oppressions systémiques
(racisme, queerphobie, sexisme, classisme, âgisme, validisme, spécisme...)
L’anarchisme suppose des pratiques spécifiques telles que l’autogestion, l’auto-
formation, la lutte pour l’autonomie et prône les actions contre le système
capitaliste et l’État. L’anarchisme, c’est radical, c’est-à-dire que les anarchistes
cherchent à comprendre les racines des problèmes de la société et à s’y attaquer
directement. L’anarchisme, c’est s’attaquer aux causes plutôt qu’aux
conséquences, à la différence des soc’ dem (voir définition plus bas).
QUEER
Queer est un mot anglais signifiant "étrange, bizarre" utilisé pour désigner les
personnes hors des normes de genre et de sexe que sont la cisidentité et
l’hétérosexualité. Queer se réfère donc aux minorités de genre (trans, non
binaire), aux lesbiennes, aux gays, aux bi, aux personnes intersexes etc... Iels
ont récupéré ce terme à l’origine injurieux pour le porter désormais comme une
fierté, une revendication. Dans la société patriarcale, ces personnes subissent
des oppressions systémiques liées à leur genre et/ou leur orientation sexuelle.
Cela va de l’invisibilisation au meurtre. Pour exemple, en écoutant les médias
mainstream, on a l’impression que le monde ne se compose que de personnes cis
het ! Autre exemple : une femme trans a 1500 fois plus de risques d’être
assassinée qu’une femme cis. Nous ne pouvons tolérer cet état de fait et c’est
pourquoi le mouvement queer revendique une opposition claire au système
normatif sexuel et genré ainsi qu’une lutte acharnée contre toutes les
institutions et les personnes qui maintiennent le cis-hétéro-patriarcat !
ANTIRACISME
Racisme : système de domination des personnes blanches sur les personnes
racisé-es.
Antiracisme politique : Lutte des premier-es concerné-es contre le racisme
venant des différentes strates de la société et de l’État, lutte contre l’utilisation
politique de la race comme outil de division, lutte contre les discriminations
(violence policières, à l’emploi, au logement, dans le milieu médical,
administratives etc) liées à la race : distinction biologique, éthnique ou culturelle
entre les personnes. La race n’existe pas, mais le racisme est bien réel.
LIBERALISME
Idéologie du capitalisme qui repose sur le primat des libertés individuelles et de
la propriété privé. Il donne la priorité à l’accomplissement de chacun-e dans
l’appareil (re)productif. Selon cette croyance, si chaque individu est libre de se
réaliser, la société dans son ensemble progresse et l’économie fleurit.
L’enrichissement privé profiterait alors au développement de tous. Pour garantir
cette liberté individuelle, l’État intervient pour assurer des droits (libertés,
sécurité, ouverture du marché…), imposer des devoirs (travail, instruction,
administration…), réprimer les déviances, fournir des infrastructures aux
capitalistes et continuer la marchandisation du vivant. Le libéralisme s’appuie
sur un socle moraliste hérité des valeurs chrétiennes et des Lumières. Il s’agit
d’entretenir une société de classes inégalitaire profitant aux bourgeois
(privatisation, individualisme, compétition, droit d’entreprendre, travail,
accumulation des richesses, etc). La société dans son ensemble est influencé par
les idéaux de la classe dominante libérale.
EN MIXITÉ CHOISIE QUEER ET FEMMES CISHET PRÉCAIRES
L’espace social est organisé pour nous invisibiliser et nous ôter tout pouvoir.
S’organiser en mixité choisie ce n’est pas éviter les problèmes, c’est en affronter
de nouveaux. Ce mode d’organisation est une bulle d’air qui nous permet de
nous renforcer entre nous et d’inventer d’autres possibles, d’autres types de
relations. Notre énergie est mise ailleurs que dans la gestion des mecs cisgenres
pour développer des solidarités entre nous, partager nos vécus entre personnes
concernées. Et nous travaillons aux rapports de pouvoir qu’il peut y avoir entre
femmes cishet et personnes queer, entre personnes blanches et racisées et entre
personnes privilégiées et précaires. Mais encore faut-il que le travail soit effectué
par toutes les personnes impliquées dans les rapports de pouvoir et les
dominantes ont tendance à éviter l’écoute, la remise en question et les
réparations. La mixité choisie (ou contrôlée) n’est pas une fin en soi, elle permet
de créer des espaces où les rapports de pouvoir sont réfléchis et limités (mais ils
ne sont pas absents car il n’existe pas d’espace "parfaitement safe"). Ce type
d’organisation ne constitue pas une fin en soi mais un espace alternatif aux
espaces hiérarchiques, où l’on gagne des forces.
SQUAT
Un squat est un lieu politique anarchiste ; le nôtre est anarcha-féministe, queer
et antiraciste. Il exprime nos idées dans l’action, dont celle de rejeter la propriété
privée afin de partager les ressources (temps, espaces, outils, connaissances
etc.) librement. Nous voulons faire de la politique autrement que par les urnes
ou les moyens étriqués qui nous sont proposés. Nous ne pouvons pas laisser à la
seule initiative des propriétaires le privilège d’expérimenter ou de laisser vivre
des utopies, des zones d’autonomie.
SOCIALE-DEMOCRATIE
Le terme de sociale démocratie désigne la gauche modérée qui ne remet pas en
question le système capitaliste libéral fondé sur le racisme, le colonialisme, le
patriarcat... Donc être soc’ dem’, c’est être d’accord avec tous ces rapports de
domination et d’exploitation, au fond. La politique, c’est pas que de la théorie
mais c’est aussi des pratiques ! On peut se dire progressiste mais avoir des
pratiques de merde quand il s’agit d’agir. Historiquement, les mouvements
sociaux modérés et réformistes se sont toujours désolidarisés des mouvements
radicaux révolutionnaires, voire les ont mis en danger. La sociale-démocratie est
une réelle menace lorsqu’elle prétend s’allier avec les franges radicales pour leur
sucer la moelle.
RESSOURCES
Brochures
Interface ou intersquat, une histoire de chartes
Les "espaces safe" nous font violence ?
Si vous pensez qu’ils doivent mourir… - Le village
La tyrannie de l’absence de structure - Jo Freeman
Trashing : le côté obscur de la sororité - Jo Freeman
Bouquins/articles
David Vercauteren, Micropolitiques des groupes. Pour une écologie des pratiques collectives, Amsterdam, 2018.
Sarah Schulman, La gentrification des esprits, B42, 2018.
Sarah Schulman, Le Conflit n’est pas une agression, B42, 2020.
Shi-Shi Chi - La souffrance individuelle (et collective) est-elle un critère politique ?
Vous pouvez nous contacter à l’adresse :
sauverousquatter [at] riseup [point] net
Nous pouvons vous envoyer un/des exemplaire.s à prix libre + frais de port par la poste !
Novembre 2020 - Janvier 2021
Cimer à Libreoffice, Riseup, framasoft et cryptpad.org, infokiosques.net, squat.net.

ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (2 Mio)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (2 Mio)