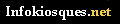E
Empire et ses pièges
Toni Negri et la déconcertante trajectoire de l’opéraïsme italien
mis en ligne le 21 février 2008 - Claudio Albertani
Extrait de : A contretemps N° 13, septembre 2003
Empire et ses pièges - Toni Negri et la déconcertante trajectoire de l’opéraïsme italien
« On a cru jusqu’ici que la mythologie chrétienne sous l’Empire romain ne fut possible que parce qu’on n’avait pas encore inventé l’imprimerie. C’est tout le contraire.
La presse quotidienne et le télégraphe qui diffusent leurs inventions en un clin d’oeil sur toute l’étendue du globe, fabriquent plus de mythes en un jour qu’on pouvait autrefois en fabriquer en un siècle. »
Marx à Kugelmann, 27 juillet 1871.
BAUDELAIRE qualifiait les auteurs de traités qui exposent en un tournemain l’art de devenir riches, savants et heureux, d’« entrepreneurs de bonheur public ». Il me semble que la définition pourrait parfaitement s’appliquer aux auteurs d’Empire, lesquels nous assurent avoir des réponses satisfaisantes aux grandes questions de notre temps (1). Présenté comme la bible du mouvement anti-mondialisation, le livre a fait l’objet d’une opération publicitaire de grande ampleur, aux Etats-Unis d’abord (en 2000), puis en France et, enfin, en Italie et dans le reste du monde. Bénéficiant d’un véritable succès international (avec un demi-million d’exemplaires vendus à ce jour), traduit dans de nombreuses langues – dont le chinois et l’arabe –, Empire a été reçu par la presse américaine et européenne comme une contribution de premier ordre à la compréhension du nouvel ordre mondial. Le quotidien néo-conservateur The New York Times n’a pas hésité à le qualifier d’« oeuvre la plus importante de cette dernière décennie », ce qui ne manque pas de sel si l’on songe que ses auteurs se tiennent pour des radicaux et se proposaient de faire rien de moins qu’une actualisation du Manifeste communiste. En Amérique latine, en revanche, les réactions ont été plus tièdes et même parfois franchement hostiles bien que, comme on le verra plus loin, pour de mauvaises raisons.
UN VERNIS NEUF POUR UNE VIEILLE IDEOLOGIE
Précisons d’emblée que si Empire ne relève en rien du manifeste, il est encore moins un manuel pour activistes.
C’est un livre long (plus de 500 pages) et bourré de concepts obscurs comme bio-pouvoir, commandement global, souveraineté impériale, auto-valorisation, déterritorialisation, production immatérielle, hybridation, multitude, et beaucoup d’autres, d’accès difficile pour des lecteurs non initiés. Une compréhension parfaite du livre requiert sans doute une certaine familiarisation avec diverses écoles de pensée : le poststructuralisme français, les théories sociologiques d’Amérique du Nord et, comme on va le voir, l’opéraïsme italien. A tout cela, il convient d’ajouter, outre la meilleure bonne volonté du monde, une certaine connaissance de la philosophie politique, d’Aristote à John Rawls, en passant par Polybe, Machiavel et Carl Schmitt.
Je dois avouer que, dans mon cas, lire l’ouvrage en entier m’a coûté quelques mois d’efforts, y compris les longues interruptions nécessaires.
Selon ses propres auteurs, Empire se prête à de multiples lectures : les lecteurs peuvent procéder du début à la fin, de la fin au début ou encore par thèmes partiels, en divisant l’ouvrage selon leurs centres d’intérêt.
On me permettra d’y ajouter une autre suggestion : la lecture par slogan ou par mots-clés, ces mots-clés dont le maniement élégant est aujourd’hui le signe d’appartenance à la nouvelle gauche ou, plus prosaïquement, celui d’un aggiornamento intellectuel indispensable pour qui veut faire bonne figure dans les salons littéraires à la mode.
Le livre prétend explorer la nouvelle configuration du système capitaliste induite par la mondialisation néo-libérale et remettre en question les catégories fondamentales de la politique léguées par la modernité. Les auteurs se situent dans la tradition marxiste, bien qu’ils admettent, sans le dire explicitement, que le marxisme-léninisme orthodoxe a cessé d’être pertinent. Si on se doit de saluer ce renoncement à une idéologie qui servit si bien les intérêts du totalitarisme, comment ne pas s’étonner, cependant, de constater qu’il manque à ce livre non seulement une analyse économique sérieuse, mais encore et surtout le point de vue de la critique de l’économie politique qui demeure, à mes yeux, le seul héritage vivant de cette même tradition marxiste. En outre, il faut noter que, alors qu’Empire consacre des dizaines de pages à l’étude de la Constitution des Etats-Unis, il ne contient aucune réflexion sérieuse sur la révolution russe et sur le léninisme. Pourtant, il est clair aujourd’hui que le modèle soviétique ouvre et ferme, à la fois, l’espace des révolutions du XXe siècle. Son échec n’est d’ailleurs pas sans rapports avec le surgissement du nouvel ordre mondial, qui est précisément le thème de l’ouvrage.
Le débat sur la tragédie des révolutions qui se dévorent elles-mêmes n’y est pas non plus évoqué, et on n’y trouve aucune tentative pour juger à sa juste mesure l’apport des courants critiques du socialisme, tant marxistes que libertaires, passé jusqu’ici sous le boisseau. Dans les rares pages consacrées à la chute du bloc soviétique, les auteurs se bornent à remarquer que la discipline y « agonisait » et affirment, sans plus, qu’on n’était pas en présence de sociétés totalitaires mais d’une dictature bureaucratique (2).
Procédons par ordre. Empire fut écrit entre 1994 et 1997, c’est-à-dire après le début de la révolte zapatiste et avant la bataille de Seattle. Une fois le livre achevé, Negri, dirigeant politique de la gauche extraparlementaire italienne des années 1970, professeur d’université, auteur de volumineux traités sur Marx et sur Spinoza, se livra, après quatorze ans d’exil en France, à la justice italienne pour répondre devant elle de délits en rapport avec la lutte armée. Depuis quelques mois, il vit en résidence surveillée dans son appartement romain, où il travaille au tome II d’Empire. Hardt, lui, est professeur de littérature à l’université de Duke, en Caroline du Nord. J’ignore quelle est sa trajectoire, et je ne me propose donc pas d’analyser ici sa contribution.
Puisque nous nous trouvons en présence d’un livre d’une énorme ambition, il convient de se demander d’entrée en quoi il pourrait aider à une meilleure compréhension du monde actuel. Ma réponse est qu’il y contribue bien peu, en vérité. Sa thèse principale, énoncée dès les premières lignes, et reprise par la suite de façon presque obsessionnelle, peut s’énoncer ainsi : avec le surgissement de la mondialisation et la crise de l’Etat-nation, apparaissent de nouvelles formes de souveraineté et un système social inédit, l’« Empire », dont il faut mettre les attributs en lumière. Nos auteurs expliquent que les Etats-Unis y occupent une place importante mais non centrale, pour la simple raison que l’Empire n’a pas de centre. Il s’agirait en quelque sorte d’un Empire sans impérialisme, illusion partagée avec la pensée néo-conservatrice. L’Empire, nous disent-ils, en effet, est un non-lieu sans limites, décentralisé et « déterritorialisé », qui s’approprie la totalité de la vie sociale. Aucune frontière ne peut restreindre son pouvoir puisqu’il est « un ordre qui suspend effectivement le cours de l’histoire et fixe par là même l’état présent des affaires pour l’éternité » (3). Il ressort de telles affirmations que l’Empire ne coïncide pas avec le système impérialiste des Etats souverains en concurrence entre eux. A la différence de ceux-ci, il n’a ni centre ni périphérie, et pas plus de « dedans » que de « dehors », ce qui implique qu’on ne puisse plus parler des vieilles divisions entre premier et tiers monde ou même de guerres impérialistes. Si Negri et Hardt admettent l’existence de contradictions inter-impérialistes, ils soutiennent qu’elles ne sont pas réductibles aux mécanismes classiques. Qu’en est-il, par ailleurs, des classes sociales dans l’Empire ? Il n’y a plus de prolétariat, et encore moins de paysannerie (4). Ce qui existe, en revanche, c’est un nouveau – et mystérieux – sujet révolutionnaire, la multitude (au singulier, comme le Saint-Esprit), dont les auteurs célèbrent l’existence dès l’introduction, sans se soucier de préciser les contours du concept.
Une fois lus ces préambules, plusieurs choix s’offrent au lecteur critique. Il peut, bien sûr, renoncer à s’attaquer à un texte aussi abscons, mais il peut aussi s’armer de patience et passer au crible le contenu des 470 pages (sans compter les quelque 40 pages de notes) qui suivent l’introduction. C’est ce qu’a fait Atilio Boron qui, atterré par les extravagances de Negri et Hardt, leur consacre un livre entier (5). Toutefois, si ce choix a pour mérite de mettre à la disposition du lecteur un inventaire fourni, quoique non exhaustif, des sottises du livre, Boron fait fausse route quand il qualifie les auteurs de post-modernes, alors que, en vérité, s’ils empruntent des concepts à Foucault (bio-pouvoir, bio-politique) ou à Deleuze (déterritorialisation, nomadisme), leur argumentation est directement tributaire de ce qu’on a appelé l’opéraïsme italien, un courant auquel Negri adhéra dans les années 1960 et qu’il n’a jamais renié.
La réflexion des auteurs de l’ouvrage ne procède ni du désir de remettre en cause les « grandes narrations » ni d’une sensibilité post-moderne, « attentive à la singularité des événements » (6), mais avant tout d’une vorace et totalisatrice volonté hégélienne : également opposés à la modernité et à la post-modernité, les auteurs se situent en fait dans une sorte d’éther « post-marxiste » (7).
C’est pourquoi, plutôt que de reprendre point par point les thèses du livre – parfois franchement délirantes –, la critique peut choisir une autre voie et opter pour l’exploration des origines du champ dans lesquelles elles s’inscrivent. La tentative est d’autant moins oiseuse que, après les Etats-Unis et l’Europe, l’arsenal idéologique de Negri et Hardt est en train d’envahir l’Amérique latine. A notre sens, on ne peut comprendre Empire si on ne connaît pas, au moins dans ses traits les plus significatifs, les forces et les faiblesses de l’opéraïsme italien.
En des temps déjà lointains, ce courant apporta une contribution indéniable à la reconstruction de la pratique révolutionnaire et de la pensée critique. Son interprétation du marxisme a marqué une époque du conflit social en Italie, mais il existe une assez grande confusion quant à sa nature profonde. Dans la littérature de langue espagnole, par exemple, on parle de « marxismo autonomista » et, dans l’anglaise, de « autonomist marxism » (8), termes qui évoquent l’idée d’une revendication de l’« autonomie » des mouvements sociaux à l’égard des organisations et partis politiques, ce qui, s’agissant des seuls Toni Negri et Mario Tronti – les deux représentants les plus connus de ce courant hors d’Italie – est loin de correspondre à la vérité.
IL ETAIT UNE FOIS LA CLASSE OUVRIERE
Le courant marxiste qu’on connaît en Italie sous le nom d’opéraïsme est né dans les années 1960 autour des revues Quaderni Rossi et Classe Operaia. Parmi leurs collaborateurs les plus importants, on peut citer Raniero Panzieri, Romano Alquati, Mario Tronti, Sergio Bologna, Alberto Asor Rosa, Gianfranco Faina et Antonio Negri lui-même (9). A l’époque , l’Italie vivait la fin du capitalisme agraire et du miracle économique.
C’étaient les années sombres de la guerre froide et le pays subissait la double ingérence des Etats-Unis
et de l’URSS. Derrière une façade menaçante, le Parti communiste italien acceptait de bon gré les règles du jeu qu’impliquait son éloignement permanent du pouvoir central, en échange d’une part (réduite) de pouvoir local.
La figure dominante dans les luttes sociales était l’ouvrier professionnel, c’est-à-dire ce travailleur qui
exerce encore un certain contrôle sur le processus productif, qui possède un bagage important de connaissances techniques et qui est conscient de pouvoir administrer l’entreprise mieux que le patron. On avait affaire en l’occurrence à des travailleurs dotés d’une forte mémoire et d’une conscience antifasciste très marquée, qui déclaraient avec fierté « appartenir à la nation ouvrière » (10).
Les choses ne tardèrent pas à changer. L’exode rural, le décollement industriel, la croissance du secteur tertiaire et la diffusion de la consommation de masse, tout cela modifia profondément la structure sociale du pays. L’existence de secteurs d’ouvriers non qualifiés n’était certes pas une chose nouvelle, mais à ce moment-là les industries du nord éprouvaient un besoin croissant de main-d’oeuvre bon marché afin d’impulser le développement des secteurs automobile et pétrochimique. La production fut fragmentée et, avec la diffusion de la chaîne de montage, surgit une nouvelle génération de jeunes émigrants en provenance du sud, qui n’avaient ni la culture politique ni les valeurs de la Résistance. Ils vivaient une situation particulièrement difficile, puisque la société locale ne les acceptait pas et que le syndicat se méfiait d’eux. Pourtant, ils allaient devenir bientôt les acteurs d’importants mouvements de protestation sociale.
La réflexion de Quaderni Rossi, dont le premier numéro parut en 1961, fut consacrée à l’analyse de cette nouvelle et complexe réalité. La revue était éditée à Turin, centre nerveux de Fiat et des formes inédites d’organisation du travail. Son directeur, Raniero Panzieri, était un ex-dirigeant du Parti socialiste, de tendance luxemburgiste, qui maintenait des relations avec la gauche internationale non stalinienne. Quelques années avant, dans de polémiques Thèses sur le contrôle ouvrier, il avait défendu l’idée d’une démocratie ouvrière de base et soutenu l’idée que « le parti, conçu d’abord comme instrument de classe devient une fin en lui-même, un instrument pour l’élection de députés […] et un élément de conservation » (11).
Panzieri chercha à émanciper le marxisme du contrôle des partis politiques et à assumer un « point de vue ouvrier », en relisant Marx à partir de la lutte des classes (12). Il concentra son attention sur la planification, et interpréta le capital comme pouvoir social et non plus seulement comme propriété privée des moyens de production. Intervenant directement dans la production, l’Etat n’était plus seulement le garant, mais l’organisateur de l’exploitation. Dans la quatrième section du tome I du Capital, il trouva les concepts de « commandement capitaliste », d’« ouvrier social » (« travailleur collectif », dans la traduction espagnole que j’ai consultée) (13) et d’« antagonisme », qui sont restés, depuis, des références théoriques incontournables de l’opéraïsme. Il fut, de surcroît, un des premiers à étudier des oeuvres de Marx jusqu’alors pratiquement inconnues, comme les Grundrisse (en particulier, le passage sur la machinerie) et le VIe chapitre (inédit) du Capital, en récupérant le concept fondamental de « critique de l’économie politique » et les catégories de
« soumission formelle » et « réelle » du travail au capital (14).
Alors que la gauche officielle s’embourbait dans l’idéologie du développement, Panzieri étudia l’entrelacs de la technique et du pouvoir, qui l’amena à cette idée que l’incorporation de la science dans le processus productif est un moment-clé du despotisme capitaliste, et de l’organisation de l’Etat. De la sorte, Panzieri réalisa une inversion du marxisme orthodoxe – une véritable révolution copernicienne – et ouvrit la voie à la critique des idéologies sociologiques, de la théorie des organisations notamment, qu’il interpréta comme des techniques destinées à neutraliser les luttes ouvrières (15). Bien plus que d’autres, cet auteur prématurément disparu (il mourut en 1964) essaya de construire une pensée politique distincte de la pensée communiste, en s’émancipant du schéma de l’« intellectuel organique », où l’intellectuel est beaucoup moins l’expression organique de la classe ouvrière que du seul parti.
Autre personnage important de cette première phase de l’opéraïsme, Romano Alquati se chargea d’entreprendre des enquêtes empiriques dans les usines, en recourant à la méthode de l’« enquête participative » (en italien, conricerca), laquelle impliquait une rencontre d’égal à égal entre le sujet et l’objet de la recherche – c’est-à-dire entre les intellectuels et les ouvriers – en vue d’une libération commune. Alquati baptisa du nom d’« ouvrier-masse » (en anglais, unskilled worker ou mass production worker) le nouveau sujet politique : le travailleur migrant non qualifié et totalement séparé des moyens de production, lequel était en train de supplanter l’ouvrier professionnel. L’ouvrier-masse était la concrétisation de trois phénomènes parallèles : 1) le fordisme, c’est-à-dire la production de masse et la révolution du marché ; 2) le taylorisme, soit l’organisation scientifique du travail et la chaîne de montage ; 3) le keynésianisme, autrement dit les politiques capitalistes à grande portée de l’Etat- providence. L’ensemble de ces mesures exprimait la réponse du capital aux ouvriers qui avaient entrepris de prendre « le ciel d’assaut » au cours des années 1920-1930.
Les opéraïstes pensaient que, en Italie comme ailleurs, les grandes transformations fordistes avaient déjà été menées à leur terme et qu’on était en train de passer à l’étape du « refus du travail », autrement dit à cette aliénation totale de l’ouvrier à l’égard des moyens de production, qui débouchait sur l’absentéisme et une remise en question plus radicale du mécanisme de l’exploitation. De ce point de vue, l’histoire de la classe ouvrière apparaissait comme un formidable roman épique où les grandes transformations productives, de la révolution industrielle jusqu’à l’automation, semblaient promettre la réalisation progressive du plus vieux rêve de l’humanité : se libérer de l’effort au travail.
Une telle approche s’écartait radicalement de l’éthique du travail, cheval de bataille du PCI. D’après Sergio Bologna, « Quaderni Rossi a broyé l’hégémonie sur les presses de Mirafiori », ce qui était une façon de dire que la revue s’éloignait de la pensée du fondateur du Parti, Antonio Gramsci (16). A mon sens, la relation des opéraïstes avec Gramsci était plus complexe qu’il n’y paraît : s’ils n’approuvaient guère l’historicisme de ce dernier (Tronti et Asor Rosa, par exemple, avaient été des élèves de Galvano Della Volpe, un antigramscien convaincu), ils appréciaient les notes sur « Américanisme et fordisme », où Gramsci pressentait la transition vers les nouvelles formes de domination capitaliste. Comme lui, ils suivaient attentivement les transformations du capitalisme américain : « En Amérique, écrivait Gramsci, la rationalisation a déterminé la nécessité d’élaborer un nouveau type humain conforme au nouveau type de travail et de processus productif. » (17)
Bientôt, les opéraïstes eurent la certitude que le phénomène de l’émigration intérieure tendait à rendre caducs les anciens déséquilibres entre nord et sud, axe des préoccupations de Gramsci. Et ceci non pas parce que le capitalisme italien les avait supprimés mais, au contraire, parce que la « question méridionale » était en train de s’étendre au pays entier, en particulier aux usines du nord, où s’accumulait la rage de ce nouveau prolétariat.
Une des réussites de ces auteurs fut l’élaboration du concept de « composition de classe ». De même que, chez Marx, la composition organique du capital exprime une synthèse entre composition technique et valeur, pour les opéraïstes, la composition de classe met l’accent sur le lien entre traits techniques « objectifs » et traits politiques « subjectifs ». La synthèse des deux aspects détermine le potentiel subversif des luttes, et cela permet de découper l’histoire en périodes, chacune d’entre elles étant caractérisée par la présence d’une figure « dynamique ». Chaque fois, le capital répond à une certaine composition de classe par une restructuration à laquelle succède une recomposition politique de la classe, autrement dit le surgissement d’une nouvelle figure « dynamique » (18). De même, les différentes expressions de cette recomposition favorisent une « circulation des luttes ».
A l’été 1960, on avait pu observer une première manifestation de cette nouvelle composition quand, à
l’occasion d’une convention du parti néo-fasciste – qui participait alors à un gouvernement de centre droit – devant se tenir à Gênes, une série de manifestations violentes avaient secoué cette ville et quelques autres.
Elles se soldèrent par plusieurs morts, presque tous des jeunes gens, et la presse avait parlé, sur un ton méprisant, d’« une rébellion de rockers criminels » (de « teddy boys », selon l’expression alors à la mode). En revanche, dans une chronique écrite par un auteur proche de l’opéraïsme, nous lisons que « les faits de juillet sont la manifestation de classe de cette nouvelle génération élevée dans le climat de l’après-guerre. […] Une génération située hors des partis » (19).
En 1962, éclata l’affaire Fiat. Une fois expirés les contrats de travail du secteur automoteur, la corporation se trouva au centre d’un grave conflit du travail qui déboucha sur les violents affrontements de la Piazza Statuto (7, 8 et 9 juillet), à Turin. Accusés d’avoir signé des contrats-poubelle, les syndicats officiels furent ignorés par des dizaines de milliers d’ouvriers en grève qui déclenchèrent une véritable révolte urbaine. La police ne put reprendre la Piazza Statuto qu’après trois jours d’affrontements et après avoir reçu des renforts en provenance d’autres villes. Les protagonistes des événements, une fois de plus, étaient de jeunes méridionaux.
Le PCI prit immédiatement position, en dénonçant les insurgés comme des « provocateurs fascistes ». C’était le début d’une nouvelle étape de l’histoire italienne : au fur et à mesure qu’apparaissaient de nouvelles pratiques d’affrontement des classes, on voyait augmenter la distance entre la gauche historique et les mouvements contestataires. La discussion fut très vive au sein de Quaderni Rossi et elle déboucha, en 1963, sur une première rupture. Si tous ses membres étaient d’accord sur la potentialité révolutionnaire de la nouvelle situation, il existait de sérieuses différences quant à l’attitude à adopter. Panzieri optait pour la prudence, quand Tronti, Alquati, Negri, Bologna, Asor Rosa et Faina voulaient passer à l’action. En 1964, ces derniers fondèrent Classe Operaia, « périodique politique des ouvriers en lutte ». Le groupe se proposait non seulement de contribuer à la recherche théorique mais aussi de consolider le réseau de relations et de contacts ébauchés les années précédentes (20).
LES PARADOXES DE MARIO TRONTI
Signé par son directeur, Mario Tronti, l’éditorial du premier numéro de Classe Operaia – « Lénine en
Angleterre » – indiquait le chemin à suivre : « On voit pointer une nouvelle époque de la lutte des classes. Les ouvriers l’ont imposée aux capitalistes avec la force objective des forces organisées en usine. […] La classe ouvrière conduit et impose un certain type de développement du capital. […] Un nouveau commencement est nécessaire. » (21)
Penseur discuté et paradoxal, Tronti était convaincu que la récente intensification des luttes ouvrières ouvrait la voie à une transformation révolutionnaire. Mais, au lieu de se fier à la spontanéité des masses, à l’instar de Panzieri, il croyait plutôt à l’intervention du parti. Ses idées trouvèrent leur formulation définitive en 1966, avec la publication de Operai e Capitale, un livre plein d’intuitions brillantes et d’images suggestives, qui condensait les splendeurs et les misères de la seconde étape de l’opéraïsme. Alors qu’ailleurs les néo-marxistes se perdaient dans d’interminables discussions sur les théories de la crise et l’effondrement du capitalisme du fait de ses propres contradictions, Tronti affirmait la centralité politique de la classe ouvrière, mettait l’accent sur le facteur subjectif et proposait une analyse dynamique des relations de classe. L’usine n’était plus le lieu de la domination capitaliste, mais le coeur même de l’antagonisme. Son approche allait à rebours de la tradition réformiste : la lutte pour le salaire était considérée comme une lutte immédiatement révolutionnaire dès l’instant qu’elle parvenait à faire plier le pouvoir du capital. La crise n’était plus comprise comme le produit d’abstraites contradictions intrinsèques, mais résultait de la capacité ouvrière d’arracher des revenus au capital.
Le discours de Tronti se concentrait sur les tendances, ce qui allait être à l’avenir une constante de la pensée opéraïste : il s’agissait de construire un modèle théorique qui permettrait d’anticiper le cours des choses. C’est pourquoi il fallait mettre « Marx à Detroit », c’est-à-dire étudier les comportements du prolétariat dans le pays le plus avancé, là où le conflit apparaissait sous sa forme la plus pure.
Une telle approche pourrait paraître séduisante, mais les propositions pratiques qu’on en tirait étaient, elles, franchement décevantes : « La tradition d’organisation de la classe ouvrière américaine est la plus politique au monde, parce que la force de ses luttes annonce la défaite économique de l’adversaire et la rapproche non de la conquête du pouvoir pour construire une autre société dans le vide, mais de l’explosion du salariat pour réduire le capital et les capitalistes à une position subalterne dans cette même société » (22). Défaite de l’adversaire ? Aux Etats-Unis ? Non, précisait Tronti : de toutes façons, « la pure lutte syndicale ne peut nous faire sortir du système […], il faut une organisation de type léniniste » (23).
Plus intéressante était, en revanche, l’analyse de la relation entre usine et société : « Au niveau le plus élevé du développement capitaliste, la société entière devient une articulation de la production. Autrement dit, toute la société vit en fonction de l’usine, et l’usine étend sa domination à toute la société. » (24) Contre l’interprétation selon laquelle l’extension du secteur tertiaire signifiait un affaiblissement de la classe ouvrière, Tronti soutenait qu’avec la généralisation du travail salarié, un nombre toujours plus élevé de personnes était en voie de prolétarisation, ce qui ne faisait qu’amplifier l’antagonisme au lieu de le réduire.
Bien qu’Operai e Capitale soit devenu une référence obligée pour les militants de 68, on peut noter curieusement que l’auteur de cet ouvrage ne quitta jamais le PCI et qu’aujourd’hui encore, il demeure membre du post-communiste PDS. Mieux même : il y a peu, Tronti a expliqué que l’interprétation gauchiste de son livre avait été le fruit d’une erreur. « Je n’ai jamais été spontanéiste. J’ai toujours pensé que la conscience politique devait venir du dehors. » (25)
Indépendamment des opinions que professent Tronti aujourd’hui, il est, cependant, évident que, dans les années 1960, lui et les opéraïstes ouvrirent un front contre la tradition nationale-populaire de la gauche italienne, qui embrassait non seulement la politique, mais aussi la culture (philosophie, littérature, cinéma et sciences humaines), et qu’ils donnèrent une première réponse aux théories de la « domination totale » acceptées par tous, y compris par la gauche critique. Ce qui semble le plus actuel dans Operai e Capitale, c’est sûrement la critique du logos technico-productiviste, tant marxiste que libéral, et de l’idée – déjà présente chez Panzieri – que la connaissance est liée à la lutte, qu’elle n’est pas neutre, mais partisane (26).
Le livre de Tronti demeure une tentative sérieuse de rénovation du marxisme, même si elle n’a débouché sur rien (27). Son « subjectivisme » exprima une rébellion contre l’objectivisme du marxisme vulgaire, celui de l’Ecole de Francfort compris, si on y excepte Marcuse. Tronti perçut le « projet » du capital de contrôler la société dans sa totalité, mais, à rebours d’Adorno, il l’interpréta comme une stratégie pour contenir la protestation ouvrière (28). Ce subjectivisme fut, en même temps, la source de nombreuses erreurs, la plus grave étant de considérer que la logique du développement capitaliste ne reposait pas sur l’extraction du profit, mais sur la combativité ouvrière. Une telle approche l’éloignait de Panzieri et du premier opéraïsme qui concevait le capital et la classe ouvrière comme deux réalités antagoniques également « objectives ». Panzieri, en outre, ne commit pas la bévue de penser que les augmentations de salaire pouvaient provoquer la rupture du système (29).
Sans vouloir à tout prix revendiquer un « vrai » marxisme, il semble évident que l’approche de Tronti repose sur une lecture partielle de Marx et, davantage encore, sur une grossière simplification de la réalité. S’il est bien vrai que Marx a écrit que la lutte des classes est le moteur de l’Histoire, son analyse se centre sur la relation sociale entre deux pôles contradictoires : d’un côté, le capital comme puissance sociale, travail « mort », objectivité pure, esprit du monde, et, de l’autre, le travail « vivant », la classe ouvrière qui, partie et fondement de la relation, fonde, en même temps, sa négation. L’origine de la contradiction est due à la double nature du travail ouvrier qui est à la fois travail abstrait, producteur de plus-value, et travail concret, producteur de valeurs d’usage. Le problème – ajoutait-il – est que « la valeur ne porte pas inscrite sur son front ce qu’elle est » (30). Selon Marx, les antinomies entre « subjectivisme » et « objectivisme » ne peuvent pas être résolues dans la théorie, mais dans la pratique (31), puisque seule la création d’un nouveau mode de production – la fameuse négation de la négation ou expropriation des expropriateurs – peut y parvenir.
Chez Tronti, en revanche, il y a bien hypostase du pôle subjectif : « le capital comme fonction de la classe ouvrière » (32). Cela le conduisit à transformer la classe ouvrière en fondement ontologique de la réalité. La subjectivité n’était plus la force concrète d’individus conscients qui s’organisent pour changer le monde, mais – pour Tronti – une simple catégorie herméneutique pour la compréhension du capitalisme. Quant au négatif, il était parti en fumée.
Il convient de signaler que, presque quarante ans plus tard, le même schéma est constamment à l’œuvre dans Empire. Ici, le subjectivisme extrême, la lecture de l’Histoire à partir de la « puissance » ouvrière, devient pur délire : « De la manufacture jusqu’à l’industrie à grande échelle, du capital financier à la restructuration transnationale et la mondialisation du marché, ce sont toujours les initiatives de la main-d’oeuvre organisée qui déterminent les configurations du développement capitaliste. » Ou encore : « Nous arrivons ainsi au délicat passage par lequel la subjectivité de la lutte des classes transforme l’impérialisme en Empire. » C’est pourquoi il est nécessaire de comprendre « la nature mondiale de la lutte des classes prolétarienne et sa capacité à anticiper et préfigurer les développements du capital vers la réalisation du marché mondial » (33). Dans ce passage, et tant d’autres similaires, la dialectique ouvriers-capital – cette « grammaire de la révolution »,
selon la magnifique expression d’Alexandre Herzen – s’évanouit dans l’apologie d’un présent sans contradictions.
Si les ouvriers sont d’ores et déjà si forts et puissants, pourquoi devraient-ils faire la révolution ?
RUPTURES
La principale fonction de Classe Operaia fut sans doute d’impulser l’articulation de divers groupes locaux ,qui travaillaient sur la question ouvrière en divers lieux du pays. Le groupe, cependant, eut une vie brève, puisqu’il se saborda en 1966 (34). Pourquoi ? Au cours d’une réunion tenue à Florence vers la fin 1966, Tronti, Asor Rosa et Negri lui-même se posèrent la question de l’urgence d’un virage politique. Le thème central était la relation classe-parti : la classe incarnait la stratégie et le parti la tactique. Il y avait un problème, néanmoins : si la première était très consciente du travail de démolition qui l’attendait, le second était en train de perdre le nord. Dans ces conditions, plutôt que de jeter de l’huile sur le feu des protestations ouvrières, il fallait faire de l’entrisme dans les syndicats, et surtout dans le PCI. L’idée était de former une sorte de direction ouvrière afin de lui faire jouer le rôle de « cale » (telle était l’expression utilisée) dans le Parti et modifier du coup son équilibre interne (35).
Il faut signaler que, jusqu’alors, l’opéraïsme avait été un laboratoire collectif, une sorte de réseau informel formé d’intellectuels, de syndicalistes, d’étudiants et de révolutionnaires de tendances diverses qui avaient tous en commun une sensibilité anti-bureaucratique, et la découverte d’un nouveau monde ouvrier en lutte. A l’exception de Tronti, personne n’y avait affronté ouvertement la question du léninisme. On acceptait le Lénine qui avait compris la convergence entre crise économique, crise politique et tendance ouvrière vers l’autonomie, mais on n’abordait pas la question du parti.
Une minorité libertaire – intégrée par Gianfranco Faina, Ricardo d’Este et d’autres militants de Gênes et de Turin – n’accepta pas ce choix en faveur de l’entrisme. Tel qu’eux l’entendaient, l’opéraïsme était fondé sur l’idée que les forces subversives se regroupaient hors de la logique des partis et des syndicats officiels. Ils trouvèrent une source d’inspiration dans le communisme des conseils (36), chez les anarchistes espagnols et chez Amadeo Bordiga (37). Les années suivantes, ils partagèrent les positions libertaires du groupe Socialisme ou Barbarie et de l’Internationale situationniste, et rompirent définitivement avec toute prétention à « diriger » le mouvement (38). Une autre tendance, dirigée par Sergio Bologna, essaya de s’en tenir à l’opéraïsme originel, en revenant à son travail de fourmi au sein de la Fiat et de quelques usines lombardes (39). De sorte que le virage annoncé n’eut pas lieu et que Tronti dut reconnaître qu’on n’était pas parvenu à « réaliser le cercle vertueux de la lutte, de l’organisation [et non de l’auto-organisation, NdA] et de la possession du terrain politique » (40).
Au même moment, des événements importants compliquèrent le projet de convertir le PCI à l’opéraïsme (41). En 1968, la température sociale en Italie commença à monter à des niveaux préoccupants. Des ferments culturels nouveaux et de plus en plus intenses commençaient à se propager. Les problèmes nationaux se mêlaient à la situation internationale de la fin des années 1960 (manifestations contre la guerre au Vietnam, Black Panthers, etc.), en inaugurant une période de grands changements. Les premiers à entrer en mouvement furent les étudiants qui occupèrent les principales universités du pays : Trente, Milan, Turin et Rome. Ils commencèrent par mettre en cause l’autoritarisme universitaire et terminèrent par faire la critique du capitalisme, de l’Etat, de la patrie, de la religion, de la famille, etc. Ils manifestaient un mépris tout particulier pour les partis de gauche qu’ils accusaient d’être devenus des engrenages fondamentaux du régime. A la fin de l’année 1968, et surtout en 1969, quand les protestations ouvrières s’intensifièrent, le système entra en crise. La grande rupture sociale, qui ailleurs s’était consumée en quelques mois, s’étendit, en Italie, sur près de dix ans, et c’est là que réside sans doute la singularité de ce mouvement.
Il va sans dire que cette explosion de radicalité légitimait les hypothèses opéraïstes les plus audacieuses. La « stratégie du refus » était en train de se réaliser. Pourtant, Tronti affirma alors qu’on n’assistait pas à la naissance d’une nouvelle époque, mais plutôt à la dernière des poussées – et la plus désespérée d’entre elles – d’un cycle de luttes qui touchait à sa fin.
Il est loisible aujourd’hui de percevoir d’indéniables éléments de vérité dans ce pessimisme, mais, à l’époque, tout semblait encore en suspens. Soudain, Tronti accordait à l’Etat des attributs qui constituaient la négation de tout ce qu’il avait écrit jusqu’alors. Il n’y a plus, précisait-il « d’autonomie, d’autosuffisance, d’autoreproduction de la crise hors du système de médiation politique des contradictions sociales ». Traduit dans un langage plus clair, cela voulait dire que la lutte économique ne pouvait plus être politique, et que la classe ouvrière, considérée jusque-là comme une force antagoniste, devenait la « seule rationalité de l’Etat moderne » (42). En vérité, aux yeux de Tronti, l’utopie touchait à sa fin, et c’est cela qu’il cherchait à signifier en parlant d’« autonomie de la politique », une idéologie qui eut une vie courte, bien qu’elle accompagnât l’évolution d’une partie des opéraïstes – le critique littéraire Alberto Asor Rosa ou le jeune germaniste Massimo Cacciari – vers l’académisme et le PCI, où ils furent accueillis comme des repentis. La croyance en l’existence d’une sphère politique « pure » à l’intérieur de l’Etat servit de justification à d’autres pour entamer une longue marche au sein des institutions.
A l’intérieur du PCI, se déroula un (court) débat sur l’opportunité de chevaucher le tigre du mouvement, mais, à la fin, prévalurent les positions les plus conservatrices, au point qu’on en vint à exclure le groupe du Manifesto (Rossanda, Pintor, Magri). C’est ainsi que, de manière peu glorieuse, conclut le trajet d’un secteur des « marxistes autonomistes ». Quant aux autres, la majorité d’entre eux, dont Antonio Negri, vit dans la nouvelle situation la possibilité d’impulser une politique révolutionnaire hors des partis de gauche, et même contre eux.
En 1969, on assista à la multiplication de groupes et de groupuscules d’extrême gauche qui se proposaient tous de reproduire en Italie la stratégie bolchevique –dans ses différentes versions : léniniste, trotskiste, stalinienne et maoïste –, par la création d’un parti pur et dur visant à la prise du pouvoir. Les opéraïstes fondèrent Potere Operaio et Lotta Continua, formations qui gravitaient également dans l’orbite du marxisme-léninisme bien qu’elles n’aient pas manifesté une sympathie particulière pour le modèle soviétique ni même, reconnaissons-le, pour le chinois.
Si le projet était irréel, les conflits, eux, étaient bel et bien authentiques, et à mesure que les groupes subversifs gagnaient du terrain, l’Etat devenait de plus en plus agressif. Le dénouement fut la « stratégie de la tension », soit une série d’attentats et d’assassinats commis par les services secrets italiens entre 1969 et 1980 avec la complicité des gouvernements successifs. Il n’y a pas le moindre doute, en effet – et il existe des dizaines de documents pour le prouver –, que, en Italie, le terrorisme fut, dans un premier temps, l’apanage de l’Etat lui-même, et non des mouvements d’extrême gauche (43).
L’histoire de ces événements tragiques étant hors des objectifs de la présente étude (44), je me contenterai ici de signaler les trois points suivants : 1) en adoptant en 1974 la stratégie du compromis historique – laquelle visait, pour les communistes, à entrer au gouvernement grâce à une alliance stratégique avec les démocrates-chrétiens –, le PCI se déplaça encore plus vers la droite, en contribuant ainsi à légitimer la criminalisation de toute dissidence ; 2) cette évolution, ainsi que les massacres d’Etat finirent par convaincre un grand nombre de militants que la seule voie praticable était la voie militaire et qu’il fallait un parti structuré de manière verticale, hiérarchique et clandestine ; 3) la lutte armée fut une erreur aux conséquences incalculables, qui entraîna le mouvement vers un affrontement sanglant – et voué à l’échec – avec l’Etat.
LES MESAVENTURES DE L’OUVRIER SOCIAL
C’est dans ce contexte que nous devons analyser la pensée de celui qui prit le relais de l’opéraïsme : Antonio Negri. Il a souvent raconté lui-même sa trajectoire. Originaire d’une famille modeste, il étudia à l’université de Padoue, où il fit une thèse sur l’historicisme allemand, avant de prolonger ses études en Allemagne et en France. Il a connu une brillante carrière universitaire, et a publié quelque vingt livres, ainsi qu’un nombre impressionnant d’articles dans des revues du monde entier. A partir de la fin des années 1950, et à côté de ses activités d’enseignement, il s’engagea dans l’action politique, d’abord dans les secteurs catholiques, puis au sein du Parti socialiste et enfin dans la mouvance opéraïste (45).
Dans sa première étape, et jusqu’à Classe Operaia, l’apport de Negri ne fut pas décisif, mais il devint déterminant avec la fondation de Potere Operaio. Le groupe naquit pendant l’été 1969, dans le contexte d’une crise du mouvement étudiant, dont la cause, du point de vue marxiste-léniniste, tenait au fait que les révoltes étudiantes n’avaient de sens que subordonnées à une « hégémonie ouvrière », c’est-à-dire à la ligne de l’organisation. Il était donc urgent, dans cette optique, de construire une direction politique pour les canaliser en ce sens. Negri impulsa, alors, l’idée d’édifier un parti centralisé, « compartimenté » et vertical. « Notre analyse se fonde sur l’oeuvre des classiques, de Marx, de Lénine, de Mao. Il n’y a pas de place, dans notre organisation, pour les états d’âme ni pour les velléités », écrivait-il dans un texte qui ne permet guère d’interprétations « autonomistes » (46).
Contrairement à Lotta Continua (LC), un groupe plutôt porté sur l’activisme, Potere Operaio (PO) accordait une certaine importance à l’élaboration théorique tournant autour d’une interprétation extrémiste de l’opéraïsme des origines. La subjectivité ne résidait plus dans la classe, mais dans l’avant-garde communiste, c’est-à-dire dans le groupe PO. Il convenait donc de centraliser et de radicaliser les antagonismes spontanés pour les transformer en action insurrectionnelle contre l’Etat. Une fois de plus, la tentative échoua. Le cycle de luttes entamé au début des années 1970 entra dans sa phase déclinante et l’une de ses dernières manifestations fut l’occupation de la Fiat Mirafiori (à Turin) qui, en mars 1973, mit fin à l’époque des grands affrontements entre les ouvriers et le capital. Un des legs de cette lutte fut le Statut des travailleurs, un ensemble de dispositions favorables au monde du travail, aujourd’hui réduit à une coquille vide.
Pendant la fin de la décennie, les conflits sociaux persistèrent, mais leur centre de gravité ne se trouvait
plus dans les usines. Dans le même temps que les principales formations extra-parlementaires entraient en crise (PO se dissout en 1973 et LC en 1976), naissait une constellation de petits groupes autour du slogan « Prenons la ville ». Quelques-uns de ces groupes prirent le nom d’« Indiens métropolitains » ou de « Prolétariat juvénile ». Ils occupaient des immeubles, formaient des centres sociaux, fondaient des revues, mettaient en marche des projets de communication alternative, créaient des associations féministes et écologistes.
Avec une base militante située tant dans les usines que dans les quartiers, ces groupes commençaient à abandonner les vieilles conceptions du parti séparé et du dirigisme léniniste pour aller à la recherche d’alternatives dans l’organisation d’espaces de coexistence et d’échange social autonomes par rapport à la légalité dominante. Pour mettre en valeur leur indépendance politique, ils utilisaient des sigles où apparaissait le mot « autonome » – par exemple, « Prolétaires autonomes » ou « Assemblée autonome » – de telle sorte qu’on commença à les identifier sous le nom de « zone de l’autonomie ouvrière » (47).
Negri interpréta la nouvelle étape avec un triomphalisme militant qui était à l’extrême opposé du pessimisme de Tronti (et de son « autonomie du politique »). Pour lui, il n’y avait plus de retour en arrière possible : le refus du travail tayloriste avait jeté à bas les murs qui séparaient l’usine du territoire. Tout le processus social était maintenant mobilisé pour la production capitaliste, augmentant de la sorte l’importance du travail productif. Dans cette nouvelle situation, l’ouvrier-masse sortait de l’usine pour se déplacer vers le territoire, l’usine diffuse, et devenir l’ouvrier social, le nouveau sujet dont notre auteur commença de proclamer la centralité. Techniciens, étudiants, enseignants, ouvriers, émigrés, squatters finissaient tous dans le même sac, sans que Negri porte la moindre attention à leurs différences, à leurs spécificités et à leurs contradictions.
Se proposant de renverser (en italien, rovesciare) les catégories de Marx, il introduisit dans son analyse la catégorie d’auto-valorisation (la même que celle qui réapparaîtra, sans autres explications, un quart de siècle plus tard, dans Empire) (48). De quoi s’agit-il ? Alors que la valorisation capitaliste se fonde sur la valeur d’échange, l’auto-valorisation – pivot de l’édifice théorique de Negri – serait fondée, elle, sur la valeur d’usage et sur les nouveaux besoins des prolétaires. Généralisant sur tout le territoire – l’usine diffuse – les pratiques d’auto-valorisation, l’ouvrier social devait désormais lutter pour le « salaire garanti ».
Dès lors, chez Negri, le noyau du conflit (et, partant, de l’analyse) se déplaçait vers l’Etat. Il pensait que l’Etat keynésien – qu’il appelait l’Etat-plan – avait inscrit les acquis de la révolution d’Octobre au cœur du développement capitaliste, en transformant le « pouvoir ouvrier » en une « variable indépendante ». Pour lui, la lutte principale avait lieu maintenant sur le terrain de l’auto-valorisation et, puisqu’il n’y avait plus de reproduction du capital hors de l’Etat, la « société civile » cessait d’exister, en laissant seuls, face à face, deux grands adversaires : les prolétaires et l’Etat (49).
En dépit de son apparente cohérence, ce raisonnement partait d’une interprétation erronée du concept marxiste de valeur. Pour Negri, la valeur d’usage exprimait la radicalité ouvrière, sa potentialité subjective, en tant qu’antagoniste de la valeur d’échange. Elle était en quelque sorte le « bon » côté de la relation. Pourtant, si on adopte le point de vue de la critique de l’économie politique, une telle approche n’a pas de sens, car, comme l’expliquait Marx dans le premier chapitre du tome I du Capital, la valeur d’usage n’est en aucune manière une catégorie morale, mais la base matérielle de la richesse capitaliste, la condition de son accumulation.
Si, à un moment quelconque du procès de circulation, les valeurs d’usage ne se transforment pas en valeurs d’échange, elles cessent d’être des valeurs et, en ce sens, elles limitent et conditionnent le processus de valorisation.
Une des sources de Negri était Agnès Heller, une des exposantes les plus connues de l’école de Budapest, laquelle avait mis au centre de sa réflexion sur Marx le concept de besoins radicaux. Elle prenait bien garde, toutefois, de tomber dans l’apologie des besoins immédiats. « Le besoin économique, écrivait-elle, est une expression de l’aliénation capitaliste dans une société où la fin de la production n’est pas la satisfaction des besoins, mais la valorisation du capital, où le système des besoins repose sur la division du travail et la demande du marché. » (50) Negri, lui, n’évita pas l’apologie, et s’écarta ainsi du marxisme critique, en oubliant qu’on ne peut pas combattre un monde aliéné d’une façon aliénée. L’autonomie, en outre, ne peut s’exprimer dans la condition immédiate de la classe. Sous la domination du capital, l’autonomie est un projet, une tendance ou, plus précisément, une tension. Elle ne peut se constituer en réalité pratique que dans les moments de rupture, dans les espaces décolonisés. Quand cette réalité pratique se socialise, viennent alors les grands moments de crise de l’administration, comme en France en 1968 ou en Italie en 1977. Contrairement à ce que pense Negri, le communisme n’est pas « l’élément dynamique constitutif du capitalisme » (51), mais une autre société sans antagonismes de classes, sans pouvoir d’Etat et sans fétichisme mercantile.
Et le parti ? « Dans ma conscience et ma pratique révolutionnaire, je ne peux ignorer ce problème », écrivait celui qui se voyait lui-même comme le Lénine italien, en précisant qu’il était « urgent de lancer le débat sur la dictature communiste » (52). Le parti, en effet, restait une tâche en suspens, bien qu’il existât déjà en embryon, avec l’Autonomie organisée (avec une majuscule, pour bien la distinguer de l’autre autonomie), c’est-à-dire l’ensemble des organisations semi-clandestines et leurs services d’ordre militarisés qui, poussés par la répression étatique, pratiquaient la lutte des classes avec l’intention de « filtrer » et de « recomposer » l’antagonisme des masses dans l’attente de la lutte finale (53).
Le résultat fut catastrophique. Le rêve de la prise de pouvoir se heurta bien vite contre les brisants de la réalité. A partir de 1977, dernière grande saison créative du « laboratoire Italie », le PC fit front uni avec la démocratie-chrétienne au pouvoir. La répression entra dans une nouvelle phase, écrasant tout ce qui se plaçait au-delà de la gauche parlementaire, et annulant la différence entre terrorisme et protestation sociale.
Chacun de son côté, et souvent en concurrence l’une contre l’autre, l’Autonomie organisée – ou, plutôt, certaines de ses organisations (54) – et les néo-staliniennes Brigades rouges continuèrent leur absurde assaut contre le « coeur de l’Etat » (comme si l’Etat avait un coeur !), entraînant dans leur ruine le riche et complexe tissu de l’autonomie avec un « a » minuscule (55).
Encore en 1978, à l’occasion de l’exécution d’Aldo Moro par les Brigades rouges (une des erreurs les plus néfastes et les plus lourdes de conséquences négatives jamais commises par un groupe révolutionnaire), et tout en manifestant son désaccord, Negri pouvait écrire que le côté positif de l’action était d’avoir imposé au mouvement la « question du parti » (56). Le 7 avril 1979, l’hallucination prit fin de la façon la plus tragique, quand Negri et des dizaines de militants de l’Autonomie furent emprisonnés sous la (fausse) accusation d’être les idéologues des Brigades rouges. Ils allaient passer entre deux et sept ans en prison, désignés par la mesquinerie du pouvoir comme des victimes dignes d’être sacrifiées sur l’autel de la paix sociale (57). En 1980, la dernière tentative d’occupation de l’usine Mirafiori marquait la fin symbolique d’un long cycle de conflits sociaux où, cas unique dans l’histoire européenne, les luttes ouvrières et étudiantes, les mouvements pour la réinvention de la vie avaient évolué ensemble dans une formidable tentative de libération collective (58).
LES EXPLOITS DE LA MULTITUDE
Dans les deux décennies suivantes, Negri n’abandonna pas l’habitude de lire les mouvements sociaux comme vérification de ses thèses, écrivant de nombreux (et cryptiques) ouvrages, sans jamais esquisser la moindre autocritique.
De Foucault, Deleuze et Guattari, notre auteur a hérité une forte aversion pour la dialectique (59). Déjà, dans son étude sur les Grundrisse, fruit d’un séminaire à Paris, il écrivait que « l’horizon méthodique marxien ne se centre jamais sur le concept de totalité ». Au contraire, il « se trouve caractérisé par la discontinuité matérialiste des procès réels », de telle sorte que le matérialisme se subordonne la dialectique à lui-même (60).
Negri voit la société capitaliste comme un champ de forces en lutte constante. A la différence des poststructuralistes français, néanmoins, il pense que le moteur des processus sociaux est la séparation ou, en d’autres termes, l’antagonisme social. Il revient à la réflexion d’identifier l’antagonisme déterminant, de scruter ses tendances et de le mener à l’explosion. Aussitôt après, l’analyse se déplace vers un nouveau champ, le redéfinit, et ainsi de suite (61). Le capital n’est plus conçu comme contradiction en procès (Marx) mais comme l’affirmation progressive d’un sujet connu à l’avance.
Dans Spinoza, l’anomalie sauvage, écrit en prison, Negri précisa peu à peu son projet : travailler à la constitution matérielle de la subjectivité radicale en Occident, en creusant le fossé entre les philosophies du pouvoir et celles de la subversion. Autour de Spinoza, il voyait se condenser une tradition « anomale » qui, affirmant la productivité du sujet, va de Machiavel à Marx, contre l’axe incarné par la triade Hobbes-Rousseau-Hegel (62). Negri trouvait chez Spinoza une critique anticipée de la dialectique hégélienne, ainsi que la naissance du matérialisme révolutionnaire. De telle sorte qu’à l’invention stalinienne du diamat, Negri oppose un nouvel horizon ontologique qui se fonde sur la catégorie spinoziste de puissance. Cette approche ignore les critiques au marxisme soviétique formulées cinquante ans avant par les communistes de gauche, à savoir que le matérialisme marxien n’est ni une philosophie ni une économie, mais la théorie révolutionnaire du prolétariat en lutte. Le mouvement dialectique, pour les radicaux de gauche, n’a jamais exprimé une loi de l’histoire universelle, et encore moins une science, mais « la logique spécifique d’un objet spécifique », le capitalisme, un système social opaque qui se fonde sur le « fétichisme » (63).
C’est dans son livre sur Spinoza qu’apparaît pour la première fois, chez Negri, le concept de multitude, autrement dit, le nouveau sujet global qui, peu à peu, va supplanter l’ouvrier social et le transformer, presque vingt ans plus tard, en héros indiscutable d’Empire (64). D’où vient-elle cette multitude annoncée à grand fracas (65) ? A l’aube de la modernité, Hobbes et les philosophes de la souveraineté nommèrent ainsi l’ensemble humain avant qu’il ne devienne peuple (66). La multitude, cependant, était pour eux quelque chose de purement négatif qui renvoyait à un ensemble humain indifférencié et sauvage, pas encore organisé au sein d’un Etat. Negri renverse le concept, le prenant comme fondement indispensable d’une démocratie radicale (67). La multitude contemporaine serait la forme de l’existence sociale et politique des « plus nombreux », de « l’ensemble ouvert » qui s’érige en alternative de la constellation peuple-volonté générale-Etat.
Alors que le peuple tend à l’identité et à l’homogénéité, explique Negri, la multitude renverrait à cet au-delà de la nation qui, face à la crise de l’Etat, serait le sujet pluriel d’un nouveau pouvoir constituant ouvert, incluant et post-moderne (68).
Ici, une question se pose : comment notre auteur aborde le problème du saut du XVIIe siècle à nos jours ? Et, plus concrètement, comme passe-t-on de l’ouvrier social à la multitude ? De fait, Negri ne se la pose pas. Il tente, en revanche, de donner un corps et une épaisseur sociologique à sa nouvelle création, en se servant, d’une part, de Marx et, de l’autre, de l’abondante littérature qui accompagne la révolution informatique.
Avec la crise du fordisme, argumente Negri, la classe ouvrière industrielle perd sa position centrale dans la société. Une part consistante de la force de travail se voue aujourd’hui au travail immatériel, c’est-à-dire à l’ensemble d’activités consacrées à la manipulation de signes, au savoir techno-scientifique, aux messages et aux flux de communication (69). Progressivement, d’après Negri, l’élément du savoir humain accumulé tend à devenir prépondérant.
Il n’y a rien à objecter à ces affirmations qui se fondent sur le fameux fragment des Grundrisse consacré aux machines, où Marx note que, avec le développement de la grande industrie, la création des richesses « n’entretient plus de relation avec le temps de travail immédiat nécessaire à sa production, mais dépend plutôt de l’état général de la science et du progrès de la technologie ou de l’application de la science à la production » (70). Et Marx d’ajouter : « Aussitôt que le travail, dans sa forme immédiate, cesse d’être la source principale de la richesse, le temps de travail cesse, et doit cesser, d’être sa mesure ; par conséquent, la valeur d’échange cesse d’être la mesure de la valeur d’usage. Le surplus de travail de la masse a cessé d’être la condition du développement de la richesse sociale, de même que le non-travail de quelques-uns a cessé de l’être pour le développement des pouvoirs généraux de l’insecte humain. De la sorte, la production fondée sur la valeur d’échange s’effondre, et le procès de production immédiat perd sa forme de besoin urgent et son antagonisme. » (71) Il est bon de préciser que ces phrases de Marx, souvent évoquées et incontestablement
visionnaires, sont néanmoins quelque peu obscures. Elles le sont parce que le sens de l’affirmation « la production fondée sur la valeur d’échange » n’est pas d’une grande clarté. Cela signifie-t-il que, dépassé par son propre développement, le capitalisme touche à sa fin ? Ou que l’antagonisme ouvriers-capital est finalement résolu ? Personnellement, je ne le pense pas, mais la question reste ouverte. Quant à l’aspect visionnaire de ce passage, il est indéniable. Ces phrases nous donnent de stimulantes clés pour lire le temps présent et, en particulier, le sens de la révolution informatique.
Marx continue : les produits de l’industrie deviennent maintenant des « organes du cerveau humain créés par la main humaine : une force objectivée de la connaissance. Le développement du capital fixe révèle jusqu’à quel point la connaissance, ou knowledge, sociale générale est devenue une force productive immédiate et, par conséquent, jusqu’à quel point les contradictions du processus de la vie sociale elle-même sont entrées sous le contrôle du general intellect et (ont été) remodelées en rapport avec celui-ci » (72). De ce passage de Marx, on peut comprendre que les contradictions de la production manufacturière s’étendent à la sphère du travail « immatériel ». Negri a donc raison quand il affirme que, dans une telle situation, le problème du sujet révolutionnaire se pose différemment. Une fois dépassée la centralité de l’usine, les possibles sujets antagonistes se multiplient, en même temps que tombe toute idée de « nécessité ». Mais alors, pourquoi proposer une catégorie unique, la multitude, qui annule forcément toute différence ?
Il y a davantage. Interprétant de façon unilatérale les affirmations de Marx, Negri semble soutenir que le capitalisme s’est déjà éteint en tant que mode de production et qu’il survit uniquement comme pure domination ou « dispositif de contrôle » (73). Et comme si cela ne suffisait pas, il lorgne vers toutes les utopies technologiques, depuis la « fin du travail » jusqu’aux mythes de la société post-industrielle et les anthropologies du cyberespace. « Dans l’expression de sa propre énergie créatrice, le travail immatériel semble ainsi fournir le potentiel pour une sorte de communisme spontané et élémentaire. » (74)
Dans l’interprétation de Negri, le communisme ne jaillit plus de l’antagonisme ou du refus collectif de la coopération capitaliste mais, au contraire, de sa plus grande extension grâce à la science et à la technique. Il en vient à soutenir les plus vieilles causes néo-libérales : le nouveau fédéralisme, l’Union européenne et même les « entrepreneurs socialisés » (en italien : imprenditorialità comune) de Vénétie, « tous ceux qui ont mis leur énergie, leur intellectualité, leur force de travail et leur force d’invention [s’agirait-il là d’une nouvelle catégorie « marxiste » ? NdA] au service de la communauté » (75). Ainsi, le cercle se referme : l’opéraïsme de Negri débouche sur une apologie des forces productives très semblable à celle que Panzieri avait si justement refusée quelque quarante ans auparavant. Et, exactement comme chez Tronti, disparaît toute notion d’une autonomie concrète fondée sur l’action indépendante des sujets sociaux en lutte, de telle sorte que les deux adversaires d’il y a trente ans se retrouvent à nouveau ensemble (76).
Il est, enfin, pour le moins cocasse de voir Negri et Hardt évoquer, à la fin de leur livre, saint François comme figure paradigmatique du nouveau militant (77). Dans les mouvements sociaux actuels, on lui préfère le mot « activiste », qui est moins effrayant et renvoie davantage à l’action directe. Les actions festives des jeunes (et moins jeunes) qui, depuis les journées de Seattle, empêchent de dormir les puissants de la Terre ont peu de rapports avec la « militance » (78). Ce qui les soutient, au contraire, c’est une volonté ludique de « renverser la perspective », d’en finir avec la politique traditionnelle et de créer de nouvelles formes communautaires (79).
Pour en revenir au thème du concept de multitude et mesurer son efficacité, il est important de signaler que l’ensemble des changements connus par le capitalisme au cours de ces dernières décennies a entièrement dissous tout centre de gravité dans les luttes anti-système. Le marxisme lui-même n’est plus qu’une parmi les multiples théories dont peuvent user les nouveaux mouvements pour s’armer conceptuellement. Il en est d’autres : l’anarchisme, les cosmo-visions traditionnelles, la théologie de la libération, etc. L’Histoire, par ailleurs, ne se fait plus uniquement en Occident. Aujourd’hui, les mouvements sociaux sont pluriels par définition.
Qu’ont en commun les indigènes du Chiapas et les ouvriers de Fiat, les agriculteurs écologistes français et les émeutiers argentins, les paysans du Karnakata et les cyberpunks des métropoles post-modernes ?
Sans doute beaucoup, comme nous l’explique, par exemple, le commandant Mister, de l’Armée zapatiste de libération nationale (EZLN) : « Les gouvernements pensent que, nous les Indiens, nous ne connaissons pas le monde. Eh bien, qu’ils sachent que nous le connaissons et que nous sommes au courant des plans de mort qu’on dresse contre l’humanité et aussi des luttes des peuples pour leur libération. Nous connaissons le monde, et même le Japon. Parce que nous connaissons tous ces hommes et toutes ces femmes qui sont venus dans nos villages et qui nous ont parlé de leurs luttes, de leurs mondes et de tout ce qu’ils font. A travers leurs paroles, nous avons voyagé, vu et connu plus de terres que n’importe quel intellectuel. » (80)
Il importe de refaire au plus vite ce monde qui ne nous appartient pas. Chaque sujet, chaque mouvement, chaque communauté en lutte cherche la rencontre avec l’autre, en exigeant dans le même temps de conserver une perspective et une identité propres. Et cela me paraît un grand pas en avant. Ce n’est pas par hasard si, par exemple, dans les mouvements indigènes méso-américains, on parle de moins en moins d’interculturalité et de plus en plus de multiculturalité. Alors que le premier concept postule une synthèse obligatoire, le second conserve les tensions et les particularités.
Il est incontestable que nous avons besoin de concepts nouveaux pour mettre ces différences en valeur, et c’est à juste titre que Negri critique celui de « peuple ». Mais, pourquoi, en ce cas, les écraser en les annulant au sein d’une abstraction philosophique vieille de trois siècles ? Comme son antécédent, l’ouvrier social, la multitude est un concept forcé. A la fin de son parcours, Negri en revient au péché originel de l’opéraïsme italien : la recherche incessante d’une « centralité », quelle qu’elle soit, le fétichisme du travail productif, l’incapacité de sortir de l’horizon de l’usine (81). Le résultat en est un sujet sans histoire, une forme sans contenu, dernière adaptation de la vieille torsion par laquelle la classe ouvrière ne cesse jamais de harceler le capitalisme.
EPILOGUE. LA FIN DE L’ETAT-NATION ?
Malgré son aversion déclarée pour la pensée dialectique, la construction théorique de Negri n’a jamais cessé d’être hégélienne (82). Tant dans Empire que dans ses livres précédents, on trouve toujours, sous-jacente chez Negri, l’idée d’une théologie nécessaire, d’un mouvement circulaire et d’une fin heureuse, déjà présente dans les débuts. On nous y indique, par exemple, que les révolutions du XXe siècle ne furent jamais vaincues, mais qu’elles « ont toutes poussé en avant et transformé les termes des conflits de classe, posant les conditions d’une nouvelle subjectivité politique » (83). Autrement dit, qu’elles préparèrent l’événement de la réalité ultime de notre temps, l’Empire, et de son nécessaire ennemi, la multitude. De la même façon que l’esprit du monde se manifeste progressivement dans l’Histoire en sautant d’un côté à l’autre du monde, l’épiphanie impériale s’incarne dans des étapes et des figures remarquables qui, à chaque moment, lui accordent des caractères distinctifs.
L’épopée commence dans la boutique de Spinoza et l’un de ses épisodes centraux est, semble-t-il, la Constitution américaine parce qu’elle repose sur « l’exode, sur des valeurs affirmatives et non dialectiques, et sur le pluralisme et la liberté » (84). On assiste ici au retour du vieil attachement opéraïste pour les Etats- Unis, assaisonné à présent à quelques (malheureuses) affirmations de Hannah Arendt sur la révolution américaine (85).
Noam Chomsky, sans doute un des meilleurs analystes des Etats-Unis, nous a pourtant enseigné que « la Constitution de ce pays n’est qu’une création conçue pour maintenir la populace à sa place et éviter que, ne serait-ce que par erreur, elle puisse avoir la mauvaise idée de prendre son destin entre ses mains » (86). Dans le même sens, Boron affirme que, contrairement à ce que croit Negri, ce document nous offre un clair exemple du haut degré de conscience anti-populaire et anti-démocratique qu’avaient ses créateurs. Alors, faut-il voir, chez Negri et Hardt, de l’ingénuité, de l’opportunisme ou un sens du marketing ? Et est-ce qu’au bout du compte, l’anarchiste Chomsky ne serait pas en train de donner une leçon de marxisme au bolchevique Antonio Negri ?
Une autre des fantaisies néo-libérales avalisées par les auteurs d’Empire tient à l’affirmation que l’Etat-nation serait en voie d’extinction. Avouons qu’il est pour le moins amusant que Negri – un admirateur de Lénine et, en outre, un vieux stratège de la prise du pouvoir étatique – tire aujourd’hui une telle absurdité de sa manche (87). D’autant qu’au nombre des rares propositions pratiques d’Empire, on retient celles du salaire social (resucée du vieux « salaire garanti » de Potere Operaio) et celle la citoyenneté globale. Autrement dit, des revenus et des papiers garantis à tout le monde, indépendamment de la nationalité, de la classe et de la condition sociale de tout un chacun. Sans vouloir entrer ici dans la discussion autour du sens politique et de l’opportunité de telles revendications, on peut néanmoins signaler leur aspect paradoxal : si, d’ores et déjà, l’Etat n’existe plus, à qui s’adressent donc Negri et Hardt ?
Le processus d’évolution de l’Etat est, en réalité, terriblement contradictoire. D’un côté, la vague de privatisations a érodé ses fonctions re-distributives, et sa crédibilité, détruisant les sphères publiques en faveur du secteur privé. De l’autre, en élevant le niveau de conflictualité, il a été contraint d’augmenter ses fonctions répressives. C’est pourquoi nous n’avons pas affaire aujourd’hui à ces Etats dégraissés dont parlent les néo-libéraux avalisés par Negri, mais plutôt à une sorte de keynésianisme de guerre qui dévore les ressources publiques, ôtant aux pauvres pour donner aux riches dans des proportions jamais atteintes auparavant (88), et c’est dans ce but qu’on agite éternellement l’épouvantail de la guerre contre les « Etats voyous » (Irak, Corée, Libye, Liban, etc.) ou contre les ennemis de l’intérieur (89). De tout cela, on peut conclure que, tant dans les domaines économique que politique, les fonctions remplies par l’Etat demeurent indispensables pour le capitalisme, puisque celui-ci ne pourrait pas survivre une semaine si celui-là cessait de lui fournir non seulement les garanties politiques et militaires dont il a besoin, mais aussi d’énormes ressources économiques. De ce point de vue, le cas des Etats-Unis est significatif : les astronomiques subsides pour l’agriculture ou les mesures de soutien au secteur du transport aérien après le 11-Septembre prouvent aisément que l’appétit pour ce genre de subventions n’a pas l’air de faiblir.
Sur la question de l’impérialisme, la réflexion de Negri part, comme toujours, d’inquiétudes légitimes. On ne peut être, évidemment, que d’accord avec lui sur la nécessité de revoir les vieilles théories, mais pour ce faire, il faudrait d’abord reconnaître que – bien que la dynamique de leurs rapports change constamment (90) – tous les Etats sont potentiellement impérialistes. Ensuite, il faudrait admettre qu’aucun Etat ne se trouve aujourd’hui en condition de concurrencer les Etats-Unis dans les domaines militaire, économique, politique ou culturel, ce qui rend caduque une des principales caractéristiques de l’impérialisme classique, tel que l’analysait Rosa Luxemburg, à savoir l’existence d’un certain niveau de concurrence entre Etats pour la conquête de marchés, de territoires ou de matières premières (91). Depuis la chute du bloc soviétique, aucun Etat ou région géopolitique n’a pu contrecarrer le pouvoir des Etats-Unis. Comment désigner cette nouvelle réalité ? Empire ? Impérialisme ? Le nom, en fait, importe peu, dès l’instant qu’il apparaît très clairement qu’un seul pays, les Etats-Unis, est en train d’imposer un système planétaire d’Etats vassaux organisés en souverainetés limitées, système qui, ironie de l’Histoire, ressemble énormément à celui que, pendant des décennies, l’Union soviétique imposa à ses satellites (92). Ce système exige des Etats qui le composent qu’ils soient faibles vers l’extérieur, c’est-à-dire malléables et sensibles aux besoins américains, mais forts à l’intérieur, autrement dit, répressifs et capables d’imposer ces mêmes besoins à leurs subordonnés.
Ce nouvel ordre mondial ne cesse, cependant, d’engendrer des frictions et du malaise, en particulier – mais non exclusivement – entre les « classes dangereuses » d’un monde de plus en plus en proie à la pauvreté, à l’insécurité et aux problèmes environnementaux. Les zapatistes du Chiapas, les piqueteros argentins, les cocaleros de Bolivie, Lula au Brésil, Chavez au Venezuela, le cours nouveau en Equateur, sont autant de signes de crise dans l’arrière-cour même de l’Empire. En Europe, le vent de Gênes 2001 n’a pas cessé de souffler et les manifestations contre la guerre se sont multipliées. Les ruptures, quand il y en a, surgissent des mouvements sociaux, comme un « ya basta » généralisé, et non par l’entremise des partis politiques qui, à quelques rares exceptions, acceptent, même quand ils sont de gauche, l’ordre établi. Nous sommes donc bien loin de cet Empire dé-centré et déterritorialisant théorisé par nos auteurs. Les événements du 11-Septembre et la réaction qu’ils suscitèrent dans l’administration Bush prouvent, une fois de plus, l’échec de leur modèle théorique : cette réaction est celle d’un Etat impérialiste qui prétend ajuster la planète à ses interêts (93).
« Aujourd’hui, note Eric Hobsbawm, de même que tout au long du XXe siècle, il y a une absence totale d’autorité mondiale effective qui soit capable de contrôler ou de résoudre des disputes armées. La mondialisation a avancé dans presque tous les domaines – économique, technologique, culturel et même linguistique – excepté en un seul, le domaine militaire et politique. Les Etats territoriaux sont encore les seules autorités effectives » (94). Proclamer la fin de l’Etat ne nous est donc d’aucune utilité. C’est même une idée néfaste puisqu’elle ne contribue en rien à l’action. Et si cette affirmation peut paraître d’une terrible banalité, il n’est pas inutile de la rappeler quand nous lisons, dans la revue Rebeldía, que ceux qui la font se sentent partie prenante d’une « gauche qui n’est plus disposée à continuer de perdre son temps autour de la dispute d’un pouvoir national qui n’existe plus » (95) (souligné par moi). Car rien n’est plus faux. Une chose est de dire, comme John Holloway – et avant lui les zapatistes, et bien avant encore les libertaires de toutes les tendances – que le monde ne peut être changé en « prenant » le pouvoir d’Etat, et une autre, très différente, est de déclarer que le pouvoir national n’existe plus (96).
Qui envoie les tanks au Chiapas ? Qui arme les para-militaires ? Qui est derrière le plan Puebla Panama ? Le fameux appareil dé-centré et déterritorialisant ? Pas le moins du monde ! C’est bien un pouvoir national très identifiable : l’Etat mexicain. Les Etats-nations continuent d’exister, et ils sont à la fois nos ennemis et nos interlocuteurs. Face à eux, nous ne pouvons pas baisser la garde : nous devons faire pression sur eux, livrer bataille contre eux, les harceler. Nous devrons, à l’occasion, négocier avec eux, et nous le ferons en toute autonomie. Les zapatistes ont démontré que cela était possible et, si les résultats obtenus n’ont pas été à la hauteur de leurs espérances, ils leur ont au moins permis, contrairement à d’autres, d’avoir conservé leur dignité.
Notre voie, celle des mouvements pour l’humanité et contre le néo-libéralisme, n’est pas exempte d’obstacles. Comme le suggère Michael Albert, animateur de la revue Z Magazine (et du site Znet), elle implique, outre de la radicalité théorique et pratique, de la ductilité, de la patience et une certaine dose de pragmatisme (97). Car il faut le répéter encore : le capitalisme et l’Etat-nation, ces deux monstres créés par l’Occident, sont venus ensemble et ils disparaîtront ensemble. Et si nous ne savons pas les noyer dans un océan de rires, ils nous tiendront encore compagnie pendant quelque temps, comme le dinosaure de Tito Monterroso (98).
Claudio Albertani
Tepoztlán, Morelos, México,
novembre 2002-janvier 2003.
Texte (inédit) traduit de l’espagnol par Miguel Chueca.
* Je remercie Gianni Armaroli, Gianni Carrozza, Clara Ferri, Malena Fierros, John Holloway, Furio Lippi, Raúl Ornelas et Tito Pulsinelli pour leurs commentaires et leurs suggestions.
Notes :
(1) Michael Hardt et Antonio Negri, Empire, Harvard University Press, 2000. [Nous suivrons ici la version française (Exils Editeurs, 2000), NdT.]
(2) Empire, « L’agonie de la discipline soviétique », pp. 337-341.
(3) Empire, p. 19.
(4) M. Hardt, « Il tramonto del mondo contadino nell’Impero » dans la revue Posse. Política. Filosofia. Moltitudini, Manifestolibri Edizioni, mai 2002.
(5) Atilio A. Boron, Imperio. Imperialismo. Una lectura crítica de Michael Hardt y Antonio Negri, Buenos Aires, CLACSO, 2002.
(6) Michel Foucault, Microfísica del poder, Ediciones de la Piqueta, 1978, p. 7.
(7) Negri et Hardt avaient déjà pris leurs distances à l’égard du post-modernisme dans leur livre Il lavoro di Dioniso. Per la critica dello Stato postmoderno, Manifestolibri, 1995, pp. 25-28. Dans Empire, ils précisent : « Les divers courants de pensée postmodernistes [sont] les symptômes d’une rupture dans la tradition de la souveraineté moderne », qui « indiquent le passage vers la constitution de l’Empire » (p. 186).
(8) Il y a quelques années, Negri était l’auteur de référence de certains marxistes américains. L’un d’entre eux, Harry Cleaver, écrivit que « si Marx ne voulait pas dire ce que dit Negri, eh bien, tant pis pour Marx » (sic). (Cf. George Katsiafikas, The Subversion of Politics. European Autonomous Social Movements and the Decolonization of Everyday Life, Humanities Press International, New Jersey, 1997, p. 226).
(9) Cette brève reconstruction se fonde sur le livre de Nanni Balestrini et Primo Moroni, L’Orda d’Oro. 1968-1977. La grande ondata rivoluzionaria e creativa, politica ed esistenziale, Feltrinelli, Milan, 1997, et sur celui d’Oreste Scalzone et Paolo Persichetti, la Révolution et l’Etat. Insurrections et « contre-insurrection » dans l’Italie de l’après-68, Dagorno, 2000. On lira aussi Futuro Anteriore. Dai Quaderni Rossi ai movimenti globali : ricchezze e limiti dell’operaismo italiano, Derive/Approdi, Roma, 2002. J’ai également consulté le site http://www.intermarx.com (en particulier les excellents écrits de Maria Turchetto et de Damiano Palano), les revues Vis-à-Vis et Primo Maggio, ainsi qu’un vieil essai que j’avais publié anonymement sous le titre « Proletari se voi sapeste » dans Al tramonto. Operaismo italiano e dintorni, supplément de la revue Insurrezione (Renato Varani editore, Milan, 1982).
(10) Franco Alasia, Danilo Montaldi, Milano, Corea, Feltrinelli, 1978, p. 184.
(11) R. Panzieri, La crisi del movimento operaio. Scritti, interventi, lettere, 1956-1960, Lampugnani, 1973. Panzieri fut directeur de la revue théorique du PSI, Mondo Operaio.
(12) Cf. R. Panzieri, Spontaneità e Organizzazione. Gli anni dei Quaderni Rossi. Scritti Scelti, Biblioteca Franco Serantini, 1994.
(13) K. Marx, El Capital, Editorial Librerías Allende, 1977, pp. 328-330. [C’est cette même expression de « travailleur collectif » qui figure dans la version française, NdT].
(14) Cf. K. Marx, Le Capital. Livre I, Chapitre VI (inédit), Union générale d’éditions, 1971.
(15) R. Panzieri, « Sull’uso capitalistico delle macchine nel neocapitalismo » et « Plusvalore e pianificazione. Appunti di lettura del Capitale », dans Spontaneitá…
(16) Sergio Bologna, « Il rapporto fabbrica-società come categoria storica », Primo Maggio, n° 2, Milan, 1974.
(17) Antonio Gramsci, Quaderni del Carcere, édition de Valentino Gerratana, Einaudi, Turin, 1977, cahier 22, « Americanismo e fordismo », p. 2146.
(18) R. Alquati, Composizione organica del capitale e forza-lavoro alla Olivetti, Quaderni Rossi, n° 2, 1962, pp. 63-98. En 1975, cet auteur a rassemblé ses écrits dans Sulla Fiat e altri scritti, Milan, Feltrinelli.
(19) Danilo Montaldi, « Il significato dei fatti di luglio », Quaderni di Unità Proletaria, n° 1, 1960. Montaldi était un intellectuel libertaire proche du groupe Socialisme ou Barbarie. Sans appartenir au réseau, il exerça une forte influence sur les premiers opéraïstes.
(20) En plus des protagonistes déjà cités, il faut mentionner, parmi les membres de Classe Operaia, Giairo Daghini, Luciano Ferrari-Bravo, Guido Bianchini, Enzo Grillo (traducteur des Grundrisse en italien), Oreste Scalzone, Franco Piperno, Franco Berardi, Gianfranco Della Casa, Gaspare de Caro, Gianni Amaroli et Ricardo d’Este.
(21) Classe Operaia, n° 1, janvier 1964. Repris in Mario Tronti, Operai e Capitale, Einaudi, Turin, 1966 (nouvelle édition, 1971), pp. 89-95. (Une version française de ce texte a paru chez Christian Bourgois.)
(22) Tronti, op. cit., pp. 298-299.
(23) Tronti, op. cit., pp 81 et 84.
(24) Tronti, op. cit., p. 53.
(25) Tronti, entrevue parue dans L’Unità, Rome, 8 décembre 2001. Dans un entretien précédent, daté du 8 août 2000, Tronti déclara : « Nous fûmes victimes d’une illusion optique. »
(26) Tronti, op. cit., p. 14.
(27) Dans ses Considerations on Western Marxism (New Left Book, Londres, 1976), Perry Anderson ne consacre pas une ligne à l’opéraïsme italien.
(28) Dans Dialectique négative, Adorno affirma la suprématie de l’« objet » (traduction en italien, Einaudi, 1975, pp. 156-157).
(29) Voir, par exemple, R. Panzieri, « Plusvalore e capitale », op. cit., où l’auteur signale l’unité du capitalisme comme fonction sociale.
(30) Marx, El Capital, tome I, p. 88.
(31) Pages de Karl Marx. Choisies, traduites et présentées par Maximilien Rubel. 1. Sociologie critique, Payot, 1970, p. 103.
(32) Tronti, op. cit., p. 221.
(33) Empire, pp. 261 et 291.
(34) Le dernier numéro de la revue parut en mars 1967.
(35) Gianni Armaroli (collaborateur génois de Classe Operaia), lettre à l’auteur, 30 décembre 2002.
(36) Les principaux théoriciens des conseils ouvriers furent les tribunistes hollandais (ainsi nommés à cause du périodique qu’ils éditaient, De Tribune) Anton Pannekoek et Herman Gorter ; à côté des Allemands Karl Korsch, Otto Ruhle et Paul Mattick.
(37) Contrairement à ce qu’on dit souvent (voir, par exemple, Octavio Rodríguez Araujo, Izquierdas e izquierdismos. De la Primera Internacional a Porto Alegre, Siglo XXI editores, 2002, p. 115), Bordiga n’était pas un conseilliste, mais un partisan convaincu de l’idée bolchevique de parti. Voir là-dessus la polémique qu’il soutint avec Gramsci in Antonio Gramsci-Amadeo Bordiga. Debate sobre los consejos de fábrica, editorial Anagrama, 1973. Cependant, c’est Bordiga – fondateur et premier secrétaire du PCI –, et non Gramsci, qui s’opposa à la bolchevisation des partis occidentaux, imposée par l’Internationale communiste à partir de 1923.
(38) Vers 1967 naquirent, à Gênes, le Circolo Rosa Luxemburg, la Lega Operai-Studenti et Ludd-Consigli Proletari (présents aussi à Rome et Milan). A Turin, l’Organizzazione Consiliare naît en 1970 et Comontismo en 1971. Minoritaires, mais significatifs, ces groupes furent pratiquement effacés des histoires du mouvement de 1968.
(39) En 1969, Sergio Bologna et d’autres créèrent La Classe, une revue qui servit de porte-parole aux luttes ouvrières de Fiat. Bologna participa à la fondation de Potere Operaio, avant d’animer, dans les années 1970 et 1980, la revue Primo Maggio, un bastion de l’opéraïsme original.
(40) Tronti, entrevue citée, 8 août 2000.
(41) Entre 1968 et 1971, la tentative déboucha sur la création de la revue Contropiano, dirigée par Asor Rosa et Cacciari, à laquelle collaborèrent aussi bien Tronti que Negri.
(42) M. Tronti, Sull’autonomia del politico, Feltrinelli, 1977, pp. 7, 19 et 20.
(43) Eduardo di Giovanni, Marco Ligini, La strage di Stato, Samonà e Savelli, 1970 (réédition Avvenimenti, 1993).
(44) Parmi les idées les plus curieuses de Negri, on retiendra l’éloge de l’ « absence de mémoire ». Voir Antonio Negri, Du Retour. Abécédaire biopolitique, Calmann-Lévy, 2002, p. 111.
(45) Cf. A. Negri, Du retour.
(46) Antonio Negri, Crisi dello Stato-piano, comunismo e organizzazione rivoluzionaria, Feltrinelli, 1972, p. 181. Ce « néoléninisme insurrectionnel » sera systématisé in A. Negri, La fabbrica della strategia. 33 lezioni su Lenin, Libri Rossi, 1977.
(47) Un des groupes les plus connus de cette tendance était le Collettivo di via dei Volsci, de Rome, qui allait bientôt fonder Radio Onda Rossa, une station du mouvement qui existe encore.
(48) Negri a développé le thème de l’auto-valorisation dans Il dominio e il sabotaggio. Sul metodo marxista della trasformazione sociale. Feltrinelli, 1978. Cf. aussi Empire, pp. 491 et 493.
(46) Antonio Negri, Crisi dello Stato-piano, comunismo e organizzazione rivoluzionaria, Feltrinelli, 1972, p. 181. Ce « néoléninisme insurrectionnel » sera systématisé in A. Negri, La fabbrica della strategia. 33 lezioni su Lenin, Libri Rossi, 1977.
(47) Un des groupes les plus connus de cette tendance était le Collettivo di via dei Volsci, de Rome, qui allait bientôt fonder Radio Onda Rossa, une station du mouvement qui existe encore.
(48) Negri a développé le thème de l’auto-valorisation dans Il dominio e il sabotaggio. Sul metodo marxista della trasformazione sociale. Feltrinelli, 1978. Cf. aussi Empire, pp. 491 et 493.
(49) A. Negri, Proletari e Stato. Per una discussione su autonomia operaia e compromesso storico, Feltrinelli, 1976, p. 30. La question de la dissolution de la société civile dans l’Etat est reprise dans Empire, pp. 51, 398-399.
(50) Agnès Heller, La teoria dei bisogni in Marx, Feltrinelli, 1977, p. 26.
(51) A. Negri, Marx oltre Marx. Quaderno di lavoro sui Grundrisse, Feltrinelli, 1979, p. 194.
(52) A. Negri, Il dominio…, pp. 61 et 70.
(53) Dans les années 70, il y eut en Italie des dizaines, et probablement des centaines, de groupes qui pratiquèrent la lutte armée. Outre les Brigades rouges, on peut citer, parmi beaucoup d’autres, les Nuclei Armati Proletari (NAP), Prima Linea, Mai più senza fucile, Azione Rivoluzionaria et Proletari Armati per il Comunismo.
(54) Contrairement à ce que je lis dans Memoria, n° 167 (janvier 2003, p. 5), il n’a jamais existé en Italie un groupe appelé « Autonomie ouvrière ». Negri dirigeait une des nombreuses organisations qui formaient le camp de l’autonomie ouvrière.
(55) Sur le bilan tragique de la lutte armée, on lira Cesare Bermani, Il nemico interno. Guerra civile e lotte di classe in Italia (1943-1976), Odradek, 1997.
(56) Rosso, mai 1978. La revue, éditée à Milan, était l’organe du Gruppo Gramsci, une organisation dirigée par Negri.
(57) Après deux années d’emprisonnement, Negri fut mis en liberté grâce à son élection comme député sur les listes du Parti radical. En 1983, il s’exila en France.
(58) Dans les années 1980 et 1990, le projet d’un opéraïsme libertaire est resté vivant dans la réflexion de quelques collectifs comme Primo Maggio, Collegamenti-Wobbly et Vis-à-Vis.
(59) Empire, pp. 183 et 187.
(60) A. Negri, Marx oltre Marx, p. 55.
(61) A. Negri, Marx oltre Marx, pp. 24-25.
(62) A. Negri, Spinoza, p. 394. Cette édition inclut : L’anomalia selvaggia (1980), Spinoza sovversivo (1985) et Democracia e eternità in Spinoza (1994), les principaux textes spinozistes de Negri.
(63) Voir par exemple : Karl Korsch, Karl Marx, Laterza, 1970, p. 101.
(64) A. Negri, Spinoza, p. 35.
(65) J’ai cherché, sans succès, une explication satisfaisante du concept de « multitude » dans l’oeuvre de Negri. Un de ses disciples, Paolo Virno, s’est apparemment chargé de la tâche dans : Grammatica della moltitudine. Per un analisi delle forme di vita contemporanee, Derive/Approdi, 2002.
(66) Norberto Bobbio-Michelangelo Bovero. Sociedad y Estado en la filosofía moderna. El modelo iusnaturalista y el modelo hegeliano-marxiano, FCE, México, 1994, p. 94.
(67) A. Negri-M. Hardt, Il lavoro di Dioniso, p. 27.
(68) Empire, p. 140.
(69) Empire, pp. 354-359.
(70) K. Marx, Grundrisse, tome II, p. 228.
(71) Grundrisse, pp. 228-229.
(72) Grundrisse, p. 230.
(73) Consultable sur www.intermarx.com : Maria Turchetto, « Dall’operaio massa all’imprenditorialità comune. La sconcertante parabola dell’operaismo italiano ».
(74) Empire, p. 359.
(75) Lettre de Negri écrite de la prison de Rebibbia (Rome), datée du 10 septembre 1997, d’après la version diffusée sur Internet.
(76) Dans Il lavoro di Dioniso, pp. 29-30, Negri avoue accepter les théories de Mario Tronti sur l’autonomie du politique. Dans Empire, en revanche, il nous informe de la disparition de « la notion de l’autonomie du politique » (p. 375).
(77) Empire, p. 496.
(78) D’après le dictionnaire de la Real Academia, un « militant » est quelqu’un qui se voue à la milice… Les premières critiques de la figure du militant remontent à 1966 et sont dues à l’Internationale situationniste. Voir De la misère en milieu étudiant, traduit dans une vingtaine de langues.
(79) Ce n’est pas le fait du hasard si les principaux disciples de Negri, les Désobéissants (connus précédemment sous le nom de Tute bianche – Combinaisons blanches – ou Association Ya Basta), sont un facteur de grande confusion dans le mouvement dit altermondialiste. Ils conjuguent le pire de la politique de la vieille gauche et le pire de l’activisme médiatique. Radicaux à l’étranger (ils furent expulsés à grand fracas du Mexique en 1998), ils sont disposés à tous les compromis en Italie ; pacifistes convaincus, ils diffusent de délirantes déclarations de guerre à l’adresse du gouvernement italien (mais ne savent pas être conséquents) ; zapatistes déclarés, ils sont à la recherche de charges électives… Sur les inconséquences des Tute bianche (aujourd’hui Disubbidienti), on se reportera à « Paint it Black. Blocchi neri, tute bianche e zapatisti nel movimento contro la globalizzazione », de Claudio Albertani, paru simultanément dans Collegamenti-Wobbly, n° 1, janvier 2002 et, en version française, dans le n° 12 des Temps maudits (janvier-avril 2002). Une version anglaise a paru dans New Political Science, Londres, décembre 2002). Pour de plus amples informations sur l’activité des Disubbidienti, voir www.ecn.org/movimento.
(80) « Discours zapatistes, manifestation à San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 1er janvier 2003 » à consulter sur le site http://chiapas.indymedia.org
(81) Sur le fétichisme du travail chez Negri, cf. G. Katsiafikas, op. cit., pp. 225-232.
(82) Je reprends cet argument de l’essai de Maria Turchetto, « L’impero colpisce ancora » (http://www.intermarx.com).
(83) Empire, p. 474.
(84) Empire, p. 459.
(85) Hannah Arendt, On Revolution, (réédition : Vicking Press, 1996), surtout le chapitre III. Negri avait déjà fait l’apologie de la Constitution américaine dans Il potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno, SugarCo, 1992.
(86) Cité in : Boron, op. cit., p. 110.
(87) Dans une tentative de ménager Dieu et le diable, Negri formule la question qui suit : « Que faire du léninisme dans les nouvelles conditions de la force de travail ? […] Quelle subjectivité faudra-t-il produire pour la prise du pouvoir, aujourd’hui, par le prolétariat immatériel ? ». Et il répond : « Il faut mener Lénine au-delà de Lénine, […] vers la démocratie absolue de la multitude »
(!) Cf. Toni Negri, « Che farne del Che fare ? Ovvero il corpo del General Intellect », Posse, mai 2002, pp. 123-133.
(88) Voir à ce sujet les récentes mesures de Bush en faveur des spéculateurs financiers, qui prévoient une réduction de 300 milliards de dollars d’impôts sur les dividendes des actionnaires.
(89) Guerre contre un seul individu, parfois, comme on l’a vu avec Ben Laden. Si l’on en croit des déclarations récentes de la Maison-Blanche, ce cycle risque de durer au moins une trentaine d’années.
(90) Une des erreurs de Lénine fut de croire que l’impérialisme était simplement une « étape » du capitalisme alors que, en réalité, il était inscrit dans sa logique dès le début.
(91) Stefano Capello, « L’imperialismo da Disraeli a Bush », Collegamenti n° 2, 2002.
(92) Tito Pulsinelli, « Sobre el señor y los vasallos. Estados Unidos en el atardecer del neoliberalismo ». A consulter sur le site www.lafogata.org/02inter/8internacional/sobre.htm
(93) Negri s’est d’ailleurs senti très peu à l’aise face à ces événements. Il a d’abord interprété la chute des tours jumelles comme une affaire interne à l’Empire, quelque chose « qui lui appartient » en propre, avant de rectifier, en soutenant que nous sommes face à une réaction impérialiste contre l’Empire. Hardt a soutenu, lui, cette seconde version dans un article récent où il exhortait « les élites à agir dans leur propre intérêt comme réseau impérial dé-centré, interrompant de la sorte le processus de conversion des Etats-Unis en un “pouvoir impérialiste selon le vieux modèle européen” ». Curieux appel, en vérité, venant d’un prophète de la « multitude » ! Du retour, p. 185 et p. 209. Entrevue parue dans Il Manifesto, 14 septembre 2002.
(94) Eric Hobsbawm, « La guerra y la paz en el siglo XX », La Jornada, México, 24 mars 2002.
(95) Rebeldía, éditorial du n° 1, México, nov. 2002.
(96) John Holloway, Change the World without Taking Power, Pluto Press, 2002. C’est à tort que de nombreux commentateurs ont voulu mettre Holloway et Negri dans le même sac.
(97) Benedetto Vecchi, « Democrazia in Movimento », Il Manifesto, 18 janvier 2003.
(98) Claudio Albertani fait ici allusion à une fameuse nouvelle du romancier Tito Monterroso, qui présente cette particularité de ne contenir qu’une seule phrase : « Al día siguiente, cuando despertó, el dinosaurio seguía todavía ahí », proprement intraduisible du reste, puisque le sujet de la subordonnée n’est pas explicité et qu’on ne sait pas s’il s’agit de « él », de « ella », voire de « Usted » : « Le lendemain, quand il s’éveilla [ou : « quand elle s’éveilla » ou : « quand vous vous êtes éveillé » ou « éveillée »], le dinosaure était encore là. » (NdT).
ce texte est aussi consultable en :
- JPEG par téléchargement, en cliquant ici (1020.4 kio)
- JPEG par téléchargement, en cliquant ici (866 kio)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (568.9 kio)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (569 kio)