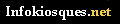U
Un jour dans ma vie
Ecrit de prison
mis en ligne le 8 mai 2008 - Bobby Sands
Préface de Gerry Adams [1]
Bobby Sands avait vingt-sept ans et avait accompli soixante-six jours de grève de la faim quand il mourut le 5 mai 1981 dans le bloc H de la prison de Long Kesh.
Ce jeune volontaire de l’IRA [2] avait passé les neuf dernières années de sa courte vie en prison et son nom était connu dans le monde entier au moment de sa mort. Il avait été élu au parlement britannique [3] et avait supporté des pressions aussi bien politiques que morales pour abandonner sa grève de la faim, dont son but était de contrer le gouvernement britannique et ses tentatives de briser la lutte pour la liberté irlandaise en criminalisant les prisonniers politiques irlandais. […]
Des centaines de prisonniers étaient détenus dans la prison de Long Kesh sous un régime de prisonnier politique ou de catégorie spéciale. Ce statut avait été introduit par le gouvernement britannique en juin 1972 à la suite d’une grève de la faim de prisonniers républicains dans la prison de Belfast. Suivant sa nouvelle stratégie absurde, le gouvernement londonien adopta une législation dans laquelle tous les prisonniers arrêtés et condamnés après le 1er mars 1976 tombaient dans la catégorie de criminels. Prisonniers politiques le 28 février, criminels le 1er mars !
Ma première rencontre avec Bobby Sands se fit dans les cages de Long Kesh où nous étions détenus de catégorie spéciale en tant que prisonniers politiques. De notre cage, la cage 11, nous pouvions voir le chantier des blocs H, en construction pour recevoir les prisonniers incarcérés sous la nouvelle législation londonienne de criminalisation. […]
Mais qui était Bobby Sands ? Simplement un jeune Irlandais ordinaire qui vécut et mourut dans les conditions extraordinaires qui existent dans la partie occupée de l’Irlande. Au cours de sa brève vie, il est parvenu à défier ces conditions injustes de façon extraordinairement courageuse.
Il est né en 1954 à Rathcoole, un quartier du nord de Belfast à prédominance loyaliste [4]. Il s’était toujours intéressé à l’histoire de l’Irlande et, quand le mouvement des droits civiques sortit dans la rue en 1968, la réaction du RUC [5] à cette protestation non-violente réveilla le nationalisme dans le cœur de nombreux jeunes catholiques.
Bobby quitta l’école en juin 1969 et fut employé comme apprenti carrossier pendant trois ans. Il n’était pas du tout sectaire – au contraire, il courrait pour un club protestant bien connu, les Willowfield Temperance Harriers. Mais au travail, il fut de plus en plus victime d’intimidations et en 1972 la famille Sands fut obligée de quitter son foyer sous les menaces et les attaques. Ils emménagèrent à Twinbrook, une nouvelle cité des quartiers nationalistes de l’ouest de Belfast. Bobby avait dix-huit ans et était l’aîné de ses frères et sœurs, Marcella, Bernadette et John.
Bobby rejoignit l’IRA à cette époque et, en 1973, à l’âge de dix-huit ans, il fut arrêté et inculpé dans le cadre d’un dossier d’armes. Il fut condamné à cinq ans de prison. C’est là que je l’ai connu. On m’avait pris lors d’une tentative d’évasion du camp d’internement de Long Kesh et je purgeais une peine de prison. Nous partagions la cage 11 avec beaucoup d’autres hommes, dont certains joueraient plus tard des rôles clés dans la lutte du bloc H : Brendan Hughes, Brendan (Bik) McFarlane, Larry Marley et Pat Beag Mc Geown entre autres.
Bobby fut relâché de la cage 11 en avril 1976 et rejoignit la lutte. Il était engagé dans des activités de l’IRA mais travaillait aussi dans sa communauté locale à Twinbrook. Il participa à la création d’une association de locataire et d’une maison de jeunes. Il était marié et avait un fils de trois ans, Gérard.
Six mois après être sorti de prison, Bobby fut arrêté de nouveau à la suite d’un attentat à la bombe dans un entrepôt de meubles. Il s’en était suivi une fusillade entre l’IRA et la RUC et deux des camarades de Bobby furent blessés. On trouva une arme dans la voiture et ses quatre occupants furent tous inculpés du recel de ce même pistolet. Bobby fut conduit à Castlereagh où il fut interrogé pendant sept jours. Il refusa de parler aux détectives de la Spécial Branch et refusa de reconnaître le tribunal lors de son procès. Un de ceux qui furent arrêtés avec lui était Joe McDonnel, l’homme qui remplaça Bobby en grève de la faim après sa mort et qui mourut à son tour au bout de soixante et un jours le 8 juillet 1981.
Bobby fut condamné à quatorze ans de prison en septembre 1977. Cette fois-ci, conformément aux tentatives britanniques de faire passer le républicanisme irlandais militant pour une conspiration criminelle, on lui refusa la catégorie spéciale ou le statut politique et il fut interné comme un prisonnier ordinaire dans les blocs H de Long Kesh.
Cela faisait plus d’un an que le gouvernement britannique faisait pression sur les prisonniers politiques des blocs H et de la prison de Armagh afin qu’ils se plient au règlement pénitencier : qu’ils portent l’uniforme du criminel britannique et qu’ils exécutent les travaux obligatoires dégradants.
Les prisonniers républicains irlandais qui avaient été arrêtés dans le cadre de lois spéciales, interrogés dans des centres spéciaux et condamnés par des tribunaux spéciaux sans jury refusèrent de se laisser criminaliser, de porter l’uniforme ou d’effectuer le travail obligatoire. Pour essayer de se réchauffer, ils portaient une couverture : ainsi commencèrent les « blanket protests » ou protestations-couverture.
Pendant des années, les prisonniers furent tenus en isolement total et battus. A la longue, leur grand nombre fit que beaucoup de blanket-men se retrouvèrent ensemble en cellule. Dans la prison de Armagh, les femmes républicaines, elles aussi, résistèrent au programme de criminalisation et furent persécutées par les autorités pénitentiaires.
En mars 1978, le personnel pénitencier alla plus loin dans ses efforts pour casser le mouvement des prisonniers du bloc H en leur refusant l’accès aux toilettes et aux salles de bain, les obligeants ainsi à vivre dans des conditions d’insalubrité extrême. Cette protestation « no wash / no slop-out » continua jusqu’en mars 1981.
Peu de temps après son arrivé dans les blocs H, Bobby Sands fut délégué Officier aux Relations Publiques des hommes-couvertures. Ses témoignages suivent les événements dans la prison : le développement du phénomène des couvertures, le début des protestations concernant la toilette, les passages à tabac, les mauvais traitements en général, les fouilles au corps. Ils nous montrent aussi la détermination et la dignité de ces hommes qui persévérèrent envers et contre tout, dans la plus longue protestation pénitentiaire de républicains irlandais jamais connue, malgré la violence et la propagande du gouvernement britannique.
[…]
En 1980, malgré les luttes considérables et la campagne de soutien populaire de grande envergure, et après des années de protestation dans la prison, le gouvernement britannique persistait dans sa stratégie de criminalisation. A l’automne, des hommes du bloc H et des femmes d’Armagh commencèrent une grève de la faim qui dura cinquante-trois jours et qui cessa, sans qu’il y ait eu de victime, quand le gouvernement britannique promit d’introduire un régime carcéral plus libéral. Bobby ne fit pas partie de cette grève ; il avait succédé à Bendan Hughes dans la position d’Officier Commandant des prisonniers.
Le gouvernement Britannique n’honora pas sa promesse et Bobby et ses camarades entamèrent une deuxième grève de la faim, le 1er mars 1981. Bobby fut le premier à cesser de s’alimenter, deux semaines avant Fancis Hughes. Il espérait que le sacrifice de sa vie et les retombées politiques pousseraient le gouvernement britannique à négocier un accord avant que d’autres camarades ne meurent. Quelques temps plus tard, le MP (Membre de Parlement) indépendant de Fermanagh et Tyrone-sud, Franck Maguire, qui fut très actif pour la cause des prisonniers, mourut d’une crise cardiaque. Des élections furent organisées suite à ce décès et c’est Bobby qui fut élu MP de Fermanagh et Thyrone-sud sur la liste des "prisonniers politiques", faisant la une des journaux dans le monde entier.
Cette action historique montra bien le soutien qui existait pour les prisonniers parmi les nationalistes. La propagande britannique prétendait le contraire. L’élection de Bobby au Parlement aurait du être l’occasion pour le premier Ministre Britannique, Margaret Thatcher, de résoudre la crise de la grève de la faim. Il n’en fut rien. Non seulement les britanniques refusèrent de négocier, mais en plus ils firent voter une législation pour changer la loi électorale afin que toute candidature provenant d’un prisonnier républicain fût irrecevable dans les élections à venir.
Autant pour la démocratie britannique !
[…]
Les nationalistes reconnaissaient les prisonniers républicains comme étant des prisonniers politiques et soutenaient leur lutte en prison.
Et malgré ce résultat, le gouvernement britannique demeura intransigeant.
Le Volontaire de l’IRA et Membre de Parlement Bobby Sands mourut le 5 mai, soit le soixante-sixième jour de sa grève de la faim. Toute l’Irlande connaissait son nom et son sacrifice, comme celui des grévistes qui le suivirent, renversa la propagande britannique et contribua réellement à faire avancer la cause de la liberté irlandaise.
Au cours des trois mois suivants, neuf autres hommes-couvertures, Francis Hughes, Raymond McCreesh, Patsy O Hara, Joe McDonnell, Martin Hurson, Kevin Lynch, Kieran Doherty, Thomas McElwee et Micky Devine moururent aussi en grève de la faim.
Le 3 octobre 1981, les prisonniers se sentirent contraints à abandonner leur grève de la faim après que plusieurs familles, encouragées par l’Eglise catholique, eurent sanctionné l’intervention médicale lorsque leur fils ou mari perdit connaissance.
[…]
Bobby Sands fut donc à la tête des hommes-couvertures et il mena la seconde grève de la faim, mais il fut aussi l’écrivain le plus prolifique du bloc H. Il écrivit des déclarations et des articles de presse et, sous le nom de "Marcella", prénom de sa sœur, il composa des poèmes et des nouvelles qui furent publiés dans Republican News et ensuite dans An Phoblacht / Republican News [6], après la fusion de ces derniers en février 1979.
Ses écrits couvrent les quatre dernières années de sa vie, passées dans les blocs H 3, 4, 5, et 6. Il les rédigea sur des feuilles de papier hygiénique de la prison ou sur du papier à cigarette avec une recharge de stylo à bille qu’il gardait dissimulée dans son corps. Il écrivit aussi en tant que "jeune républicain de Belfast-Ouest" et en tant que responsable des Relations Publiques des hommes-couvertures des blocs H 3, 4 et 6.
UN JOUR DANS MA VIE
Il faisait encore nuit et il neigeait doucement quand je me suis réveillé. Je ne pense pas avoir dormi plus d’une heure durant cette longue nuit tortueuse et sans répit. Le froid était intense et mordait cruellement mon corps nu. Je me roulai sur le côté pour la millième fois au moins, serrant mes couvertures le plus fort possible. Le froid glacial m’avait empêché de dormir et j’étais fatigué et vaseux. Tous les os de mon corps semblaient dénoncer mon épuisement d’avoir passé encore une nuit d’épreuve sur un matelas-mousse humide à même le sol. Encore une nuit sans sommeil ! J’étais frustré et en colère. Je me roulai en boule en tentant de me réchauffer. Si j’avais pu shooter dans quelque chose, j’aurais shooté - voilà comment je me sentais. J’avais essayé toutes les positions possibles pour avoir un peu plus chaud, mais toujours le froid pénétrait. Mes trois pauvres couvertures ne pouvaient rien contre le terrible froid qui se faufilait entre les barreaux de la fenêtre située au-dessus de ma tête.
Bon Dieu, un jour de plus, me dis-je, et c’était loin d’être une pensée agréable.
Quelqu’un cria "Wing shift !" et cela ne laissait aucun doute sur ce qui se produirait ensuite.
"Bon ! Toi ! Dehors et dépêche-toi !", hurla Grande-gueule. Je sortis de ma cellule et le couloir était noir d’uniformes, chacun assorti d’une matraque menaçante.
"Pas assez vite !" cria-t-il encore, et soudain, deux paires de mains m’agrippèrent comme des étaux. On me poussa les bras dans le dos et mes pieds quittèrent le sol. Une masse noire s’affairait autour de moi et avançait tout d’un coup, m’entraînant avec elle.
"Bon !" cria le premier, "Lâche la serviette, tourne-toi, touche tes pieds !"
Je lâchai ma serviette, fis un tour complet et restai planté là, gêné dans ma nudité, leurs yeux rivés sur moi.
"T’as oublié quéqu’chose !" grogna le porte-parole.
"Pas vrai." bégayai-je.
"Touche tes pieds, saleté !" siffla-t-il à deux doigts de mon visage, d’une voix menaçante. Je me cramponnai à moi-même, sachant ce qui m’attendait. "Je ne le ferai pas." dis-je.
Une éruption de rires forcés et de blagues salaces suivit. "Fera pas !" se moqua-t-il.
"Fera pas ! Ha ! Ha ! Il ne le fera pas, les mecs !" lança-t-il à ses collègues impatients.
Mon dieu, ça y est, me dis-je. Il se mit à côté de moi, toujours en rigolant, et me frappa. En quelques secondes, au milieu de mille chandelles blanches, je tombai par terre sous les coups qui pleuvaient sur moi de toutes parts. Ensuite, je fus soulevé et balancé comme un quartier de viande sur une table. On m’étala comme une peau de bête, des dizaines de mains m’écartant au maximum les bras et les jambes, me tirant la tête en arrière. Un sale pervers commença à me fouiller l’anus. C’était très amusant : tout le monde se tordait de rire - sauf moi - pendant que les coups pleuvaient sur mon corps nu. Moi, je me tordais de douleur. J’étais pris comme dans un étau et tabassé impitoyablement. Sous mon visage, la table était maculée de mon sang. J’étais complètement sonné. Ensuite, on me tira de tous les côtés et on me laissa tomber brutalement par terre. Ma première réaction fut de me couvrir de ma serviette, la serrant autour de ma taille meurtrie. Des mains invisibles me forcèrent violemment les bras derrière le dos et me traînèrent vers l’autre aile de la prison. J’aperçus un de mes camarades. On le battait et on le traînait vers la table à son tour. Derrière lui, un autre que l’on sortait de sa cellule à coups de pied. Une porte de cellule s’ouvrit brusquement et je fus jeté à l’intérieur. Elle se referma dans un bruit de tonnerre et je restai seul. Allongé par terre sur le béton, épuisé, je reprenais péniblement mon souffle et faisais le bilan des dégâts. En guise de consolation, je me dis que ça aurait pu être pire, mais mon corps meurtri refusa de se laisser convaincre.
Le froid était si intense que je ne pus rester plus longtemps allongé sur le sol. En me levant, lentement et douloureusement, chaque muscle criait sa protestation. Un filet de sang coula de ma bouche sur ma longue barbe et fit une petite flaque par terre. Ma peau était bariolée de bleus et d’égratignures. Je tremblais. Je n’avais pas vraiment eu le temps d’avoir peur ; tout s’était produit si vite. Heureusement que je ne dormais pas quand ils étaient arrivés.
Un jour on les aura, ces salauds, me dis-je. Et là, on verra s’ils sont grands et forts. Avec cette pensée réconfortante, je crachai un caillot de sang dans un coin.
On verra s’ils sont grands et forts.
Je me mis à faire les cent pas. Le froid glacial inondait la cellule par la fenêtre ouverte et, avec ma seule serviette, je le sentais jusqu’aux os. Dieu que j’avais mal. D’autres corps se faisaient traîner dans le couloir dans un bruit d’enfer.
Les salauds gueulaient comme des malades, ivres de notre sang et de notre douleur. Les sadiques ! Dieu seul sait combien de temps il faudra attendre avant qu’ils décident de nous jeter une couverture. Bordel ! Une cellule vide et glaciale, un corps à vif et noir de bleus, transi par le froid, une meute de psychopathes qui battent des hommes en bouillie de l’autre côté de la porte ... et ce n’est pas encore l’heure du p’tit-déj !
Doux Jésus, est-ce que ça peut être pire que ça ? Mais la réponse était connue d’avance : je savais très bien que ça pouvait l’être et c’est justement ce qui m’inquiétait.
J’essayai de faire abstraction de mon corps meurtri et continuai à tourner en rond pour tenter de trouver un semblant de chaleur. Mes pieds étaient maintenant bleus de froid et je craignais que mon corps ne survive pas à ces conditions polaires. Le choc du passage à tabac était passé et à présent j’étais rongé par la douleur et le froid sans merci. De nouveau, la neige se mit à tomber et dehors, sur le fil, il n’y avait pas le moindre corbeau.
Quelques camarades étaient en train de partager leurs expériences par la fenêtre des cellules voisines.
J’entendis le bruit du chariot qui nous apportait le petit déjeuner - et toujours pas de couvertures ou de matelas. N’oublie pas de regarder qui sont les matons de garde aujourd’hui quand la porte s’ouvrira, me rappelai-je. Cela nous ferait du bien d’en avoir des calmes après l’épisode de ce matin. Deux auxiliaires ouvrirent la porte et me lancèrent leur habituel regard narquois. Ils me donnèrent le maigre repas matinal : une chope de thé dans une main, un bol de bouillie d’avoine recouverte de deux tranches de pain dans l’autre. Une tête de rat coiffée d’un chapeau noir apparut dans l’entrebâillement de la porte et, d’un ton sarcastique, me dit :
"Bonjour ! Voudriez-vous mettre votre habit de prison et aller travailler, nettoyer votre cellule, faire votre toilette ou cirer mes bottes ?... Non ? Eh, bien, on verra ça plus tard !" et il partit en claquant la porte. "Salaud !" dis-je en retournant dans le coin de ma cellule pour inspecter la deuxième catastrophe de la journée, le petit déjeuner. Je réussis à extraire les deux tartines de la bouillie gluante et balançai le bol avec le restant de son contenu contre le mur du fond. Dégoûté, je me forçai à ingérer ma maigre croûte et le thé tiède. Il faisait tellement froid que je dus faire les cent pas entre mes gorgées de thé. Je repensais aux trois matons qui se tenaient près de ma cellule pendant qu’on me donnait mon petit déjeuner : les matons A, B et C. C’était vraiment tout ce qu’il me fallait aujourd’hui. Trois tortionnaires primaires – et ils seraient ici toute la journée. Merde et double merde, me dis-je.
Celui qui venait de m’adresser la parole était A. Il était cruel, sournois et intelligent quand il s’agissait de torturer un homme nu. Avec lui, il n’y avait rien de physique, mais des ruses et des attaques purement psychologiques. Dans le genre formé à Auschwitz, il devait être premier de la classe et, comme la plupart des matons, il prenait grand plaisir à démolir la dignité de prisonniers de guerre nus. C’était un vrai mégalo mais, finalement, ne l’étaient-ils pas tous quand ils revêtaient leur petit costume noir aux boutons brillants et tenaient leur matraque et leur pistolet ?
Le deuxième était B, bigot et sectaire. De taille moyenne, il était beau, brun et plein d’énergie. Il était aussi alcoolique et très adroit avec sa matraque, surtout sur les plus jeunes. C’était une pratique habituelle chez lui.
Le dernier, et peut-être le pire des trois, était C. Il nous détestait plus encore que le bigot B et il redoublait d’imagination pour nous le montrer. Il ne souriait jamais et ne parlait que pour insulter ou hurler sa haine.
Trois vrais salauds, me dis-je, en maudissant le froid, mon corps meurtri et la faim qui ne cessait de me ronger. Je continuai mon voyage vers nulle part en tournant dans ma cellule comme un cochon d’Inde, m’arrêtant de temps à autre pour identifier les noms griffonnés sur la porte et les murs : témoignage simple s’il en était et rappel poignant que d’autres avaient été dans la même situation que moi – et que certains l’étaient encore. Il y avait une certaine fierté dans ces noms gribouillés aux auteurs torturés. Ils avaient de quoi être fiers aussi, me dis-je en me tournant vers les phrases grattées en gaélique. Je remarquai les progrès faits dans les cours de gaélique.
"Cours de gaélique", répétai-je, et je trouvai cela bizarre. Mais c’était bien bizarre quand on considère qu’il nous fallait nous tenir à la porte de la cellule pour entendre la leçon du jour criée à tue-tête par le camarade-professeur, de l’autre bout du couloir, quand les matons prenaient leur repas.
Je continuai toujours. Le froid semblait s’intensifier. Si on ne me donnait pas bientôt une couverture ou deux, j’aurai des problèmes. J’avais appris depuis longtemps qu’il ne fallait surtout pas en demander. Montrer le moindre signe de faiblesse, c’était creuser sa propre tombe. Et puis, de toute façon, il y avait quarante trois de mes camarades exactement dans la même situation que moi. Alors, je me dis qu’il valait mieux essayer de me réchauffer un peu au lieu de m’apitoyer sur mon sort. Il était dangereux de trop penser à mon malheur. Cela fait déprimer et la déprime est bien pire que le froid et mon corps meurtri réunis. Je me mis à rêver de nourriture. Vendredi / jour de poisson. Patates froides et "pois-boulets de canon". Mais il me restait une lueur d’espoir qu’ils seraient servis chauds et avec du sel. J’espérais, oui, pourtant cela n’arrivait jamais. Sans doute avais-je besoin d’espoir et d’espérance, comme ceux qui rêvent de gagner au loto. J’avouais qu’il y avait plus de chance de gagner au loto. Ne faisions-nous vraiment que vivre d’un repas froid et infect à l’autre, en nous créant de faux espoirs, en nous accrochant à la moindre rumeur qui circulait ? Scéal , Scéal , Scéal ! Le terme irlandais pour nouvelles ou info, était tellement employé que même les matons le disaient.
"As-tu des Scéal ?"
"Avez-vous entendu des Scéal ?"
"Les Scéal sont mauvaises, ou pénibles ou fantastiques."
C’était tout à fait compréhensible. Il nous fallait pouvoir espérer, spéculer, nous projeter, nous accrocher. C’était incroyable comme des Scéal juteuses mettent de l’ambiance chez nous. Après la marche de Coalisland à Dungannon, quand un des jeunes nous a rapporté une estimation des effectifs et une photo, j’ai failli en pleurer et je suis sûr que je n’étais pas le seul. Je n’oublierai jamais ce moment, en plein milieu d’un véritable cauchemar, sans ami aucun, et quand arriva mon tour de voir l’image j’avais l’impression que c’était l’instant le plus merveilleux de toute ma vie. Je restai à fixer la photo, voulant la tenir à la main à tout jamais. Ne sont-ils pas formidables, ces gens, me dis-je et j’étais fier de lutter avec eux. Encore maintenant, j’ai la gorge serrée à y penser. Ah, bon Dieu, s’il faisait moins froid et si j’avais moins mal, je pourrais peut-être chanter une petite chanson ou deux pour passer le temps. Mais là, vraiment, je n’en ai ni l’envie, ni les moyens physiques.
Personne ne bavarde aux fenêtres. Trop occupés à faire les cent pas et à panser leurs blessures.
"Maton dans le rond !" cria quelqu’un pour nous prévenir qu’un gardien rôdait dans les parages. C’était comme cela qu’on donnait l’alerte quand on entendait un tintement de clés ou un bruit de pas ou quand on voyait une ombre passer, je m’aplatis contre la porte et tentai de regarder par une petite fente dans le béton. Je l’avais aperçue plus tôt et, comme je l’espérais, elle me donnait un panorama restreint mais bienvenu de quelques mètres de couloir. La silhouette bien familière de A s’approchait des cellules avec une poignée de lettres et de paquets de mouchoirs en papier.
"Maton distribue le courrier !" criai-je en gaélique pour rassurer tout le monde. A sursauta quand ma voix brisa le silence lugubre. Il continua son chemin.
C’était une pratique courante de prévenir en criant dès qu’on était au fait de quelque chose : c’était notre moyen d’être tous égaux, d’avoir les mêmes infos. Car il n’y avait rien de plus terrifiant que de rester assis, nu, derrière une porte verrouillée, sans savoir ce qui se passait quand le danger se présentait - et chez nous le danger se présentait constamment.
Les matons n’aimaient pas que l’on emploie le gaélique. Cela les éloignait, leur donnait l’impression d’être étrangers et les gênait, même. Ils ne savaient pas ce que nous disions. Ils nous soupçonnaient d’être en train de parler d’eux tout le temps et ils n’avaient pas tort !
Je recommençai mon voyage vers nulle part. Je me tournais vers la fenêtre quand soudain j’entendis une clé frapper contre du métal. Une froide sensation de peur m’envahit et ma porte s’ouvrit. A était là avec quelques paquets de mouchoirs et des lettres.
"J’ai un paquet pour toi." dit-il de son accent détestable, me fixant de son regard arrogant.
Super, pensai-je, des Kleenex.
"T’as de la chance ; t’es le seul à avoir un paquet aujourd’hui", continua-t-il. Jésus ! J’avais envie de vomir ! Voilà ce qu’était A, le psy de service. Il m’observa un moment avant de poursuivre : "Pourquoi tu ne mettrais pas ton habit de prison ? Comme ça tu pourrais avoir tes privilèges."
J’avais envie de lui dire où fourrer ses privilèges de merde - et son paquet aussi, d’ailleurs - mais les mouchoirs seraient bien utiles comme patins sur le sol gelé.
Garde ton calme, Bobby, me dis-je lorsqu’il me tendit un stylo Parker pour que je signe dans le grand livre pour le paquet. Il était dans son élément, ça lui plaisait de jouer cette comédie. Comme si je recevais un chèque d’un million de livres au lieu de trois misérables paquets de Kleenex. Il y avait une lettre aussi. Je l’avais vue tout de suite mais il attendait que je la lui demande. Je me refusai à le faire. Je fis comme si de rien n’était. Il remit son stylo coûteux dans sa poche, me fit un large sourire et me gratifia d’un commentaire sur l’odeur de mon corps sale et le relent de ma cellule dégoûtante. Il se retourna pour fermer la lourde porte en acier. "Au fait, dit-il, j’ai une lettre pour toi." Et il me la donna, je la pris dans mes bras comme un nouveau-né. La porte claqua derrière A. Je regardai par le petit trou pour voir s’il retournait dans son bureau. Oui. De nouveau, je criai en gaélique "Maton parti !" pour en avertir les autres.
Je retournai m’installer dans le coin comme un homme neuf avec mon trésor - une lettre et trois paquets de mouchoirs ! J’étalai les mouchoirs par terre sous mes pieds. C’était comme un tapis de luxe, comparé au béton nu. Je sortis de leur enveloppe ouverte les pages de ma lettre, maintes fois lues et, bien sûr, censurées. Elles étaient défigurées à cause du gros crayon noir du censeur, mais moins que celles du mois dernier, me dis-je. Je reconnus tout de suite la main familière de ma mère. Ma vieille mère fidèle qui ne me laisse jamais tomber ! Je me mis à lire :
Mon cher fils,
J’espère que tu as bien reçu ma dernière lettre. Je me fais beaucoup de soucis pour toi et tes camarades. Est-ce qu’il fait très froid là-bas, fiston ? Je sais que tu n’as que trois couvertures et j’ai lu dans le Irish News que vous êtes nombreux à souffrir d’une mauvaise grippe. Couvre-toi comme tu pourras, fiston. Je prie pour vous tous.
Ta sœur Marcella a fait un goûter d’anniversaire pour Kevin l’autre jour. Ils fêtaient ses un an. C’est un enfant adorable. Tu ne l’as pas encore vu, je crois. Ton père et ton frère demandent de tes nouvelles, ainsi que Bernadette et M. et Mme Rooney.
Je suis allée à la marche dimanche dernier et il y avait XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Censuré ! Les salauds ! Je lançai un juron contre eux.) Tout va bien, fiston. Peut-être qu’on n’aura plus trop longtemps à attendre.
Les Brits sont venus perquisitionner deux fois la semaine dernière et ils ont fracassé la harpe Celtique toute neuve que les gars de la Cage m’ont envoyée à Noël. Je ne pense pas que les Brits soient très contents en ce moment, fiston, avec tout le XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ils doivent en avoir plein la tête, fiston.
Ton frère Sean a été à Killarney et il y a des slogans sur toutes les routes et tous les murs XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (bloc H ! ! Salopards ! ! médis-je.)
Eh bien, fiston, je dois terminer maintenant. Il commence à neiger. J’espère que tu vas bien. Nous sommes tous avec toi, fiston. J’ai eu l’enfant à la maison dimanche et il dit qu’il sera Volontaire quand il sera grand et qu’il ira te sortir de là. Que Dieu le garde. Je viendrai avec ton père et Marcella pour ton prochain parloir, le 12. Bon, fiston, que Dieu te bénisse. Je te verrai bientôt. Nous pensons tous à toi.
Ta mère qui t’aime.
Que Dieu la bénisse, dis-je.
Parloir aujourd’hui !
"Hourra !"
"Ça va, là, Bobby ?"
"Ça va, Sean", répondis-je à mon voisin. "Je viens juste de me rappeler que j’ai un parloir aujourd’hui. Cela m’était sorti de la tête après le massacre de ce matin.
Et toi, tu t’en es sorti comment ?"
"Je crois que j’ai le nez cassé, Bobby. Tu es blessé, toi ?"
"Oh, comme d’hab. Plein de bleus et des égratignures. J’peux pas me plaindre.
Tiens, j’ai eu une lettre. J’ai l’impression qu’il y avait plein de bombes et pas mal de monde à la marche. Elle est censurée, bien sûr, mais je saurai tout à l’heure au parloir. Je m’en vais marcher un peu, Sean, je dois me réchauffer. Il fait vraiment froid, camarade. Courage ! A plus !"
Hourra ! Parloir aujourd’hui ! Mais où sont donc ces fichues couvertures ? Je crève de froid.
Je verrai peut-être le petit aujourd’hui. Cela va faire neuf mois que je ne l’ai pas vu. C’est le risque sanitaire. Même si c’est risqué, j’ai vraiment besoin de le revoir. Avant notre unique parloir mensuel d’une demi-heure, nous subissions de strictes fouilles corporelles. C’était complètement démoralisant.
"Matons dans le rond ! Matons dans le rond !"
J’étais contre la porte en un éclair, l’œil devant le petit trou. Rien ! Je ne voyais rien ! Je les entendais mais ne les voyais pas.
"Fouille ! Fouille !"
Seigneur, ils fouillent les cellules ! Mais il n’y a rien à trouver. On nous avait déjà passés au peigne fin le matin même.
J’entendis le bruit métallique d’un verrou de porte en acier et aperçus B et C entrer dans la cellule d’en face. La cellule de Pee Wee. Les cris de C me parvenaient mais je ne pouvais les distinguer. Tout d’un coup, je compris ce qui se passait en entendant B hurler "Baisse-toi, connard !"
Jésus, ils fouillaient Pee Wee. Il avait tout juste dix-huit ans et ils le forçaient en avant pour lui fouiller l’anus. J’entendis le bruit sourd des coups qu’on infligeait sur son corps nu.
B et C sortirent de la cellule, roulant des mécaniques comme deux cowboys, tout sourire.
"Pauvres salauds !" cria Sean de la porte de sa cellule.
"Monsieur A. Un véhicule pour le bloc-Punition, s’il vous plaît. Pee Wee O’Donnell vient de frapper Monsieur C", dit B en rigolant.
Cela doit être mauvais, me dis-je. Cela doit être vraiment mauvais pour qu’on l’envoie aux planches pour l’inculper. Tout ça fait partie de la désinformation. Si on les accuse, on aura encore une charge de faux témoignage sur le dos. Criminels de guerre ! me dis-je. Ils ne sont qu’une sale bande de criminels de guerre puants, jusqu’au dernier.
Ils sortirent Pee Wee de sa cellule. Petit, anodin, il avait le visage en sang. Son œil droit était gonflé et son nez pissait le sang.
Ils vont le laver de force et lui couper les cheveux sur les planches. Autrement dit, ils vont le tabasser pour la troisième fois de la journée !
Le silence régnait. C’était très tendu, mais l’ambiance malsaine ne nous quittait jamais et la tension ne se dissipait jamais.
On t’aura, C, me dis-je. On t’aura. Et jamais de ma vie je n’y avais mis autant de conviction.
Je grelottais, mais je restais à épier par le petit trou au cas où ils reviendraient pour quelqu’un d’autre, je les entendais dans le bureau rire et se vanter de ce qu’ils avaient fait à Pee Wee, de comment ils l’avaient amoché.
La nouvelle commençait à circuler dans la prison. B secouait bruyamment un seau et criait son intention à C de faire la tournée pour les seaux hygiéniques. Il voulait que nous l’entendions tous. Ils débarqueraient dans les cellules avec le seau et shooteraient dans les pots de chambre pour en étaler le contenu. Nous ne pouvions les vider par la fenêtre que très tard la nuit. Mais je savais que B essayait d’envenimer une situation qui était déjà explosive. C’était A le responsable. Il ne s’y risquerait peut-être pas. Les gars étaient très en colère après la bastonnade de Pee Wee. Il y aurait encore des ennuis. Et puis, la literie n’était pas encore dans les cellules pour être trempée, j’étais en train de penser aux matelas et aux couvertures et au froid tranchant quand les plantons arrivèrent avec le chariot de literie.
"Couvertures dans le couloir !" criai-je en gaélique pour prévenir les autres. Il y eut une explosion de cris et d’applaudissements. Les portes s’ouvrirent une à une et après une attente qui me sembla éternelle, ce fut mon tour. Le froid s’intensifiait. On me jeta trois minces couvertures et mon matelas dégoûtant en lambeaux.
C me jeta son regard de haine et claqua la porte. Je t’aime, moi non plus, C, murmurai-je en me jetant sur le tas de couvertures. J’en serrai une autour de ma taille et une autre sur mes épaules comme un poncho, avec la serviette en écharpe. Je poussai le matelas-mousse, sale et humide, le long du mur et m’assis dessus, essayant d’emmitoufler mes pieds dans la dernière couverture. Je faisais figure d’un prisonnier du Stalag ou de Dachau. Pour tout vous dire, j’avais vraiment l’impression d’en être un. La serviette irritait ma barbe et les couvertures en crin de cheval tourmentaient mon corps malmené. Il faisait très froid et un des gars nous apprit qu’il s’était remis à neiger. Il pouvait neiger sur moi comme la nuit dernière et celle d’avant, je ne bougerais pas. Je me demande comment va Pee Wee. Probablement à moitié mort dans le bloc-punition. Jésus, quelle journée ! me dis-je, et je me sentais épuisé. Mes deux nuits blanches me rattrapèrent à cet instant. Je sentis mes pieds se réchauffer légèrement et je pensai au parloir de cet après-midi. Tout était calme, à part les rires hideux de B et C. B reviendrait sûrement après le dîner, ivre et dangereux, me dis-je. Je fermai les yeux, cherchant l’évasion par le sommeil, au moins jusqu’à l’heure du repas. Dieu, mais c’est dur. C’est vraiment dur.
Doucement, je me levai, testant chaque mouvement de mon corps. Je réussis à me mettre debout et plaçai le matelas contre le mur. J’étendis une couverture par terre et me remis en marche pour mon voyage vers nulle part, une couverture autour de la taille et une serviette sur la tête.
Il faisait toujours froid mais l’air mordait moins que le matin. Dehors, un épais manteau de neige couvrait le sol et il y avait très peu de lumière pour un milieu de journée.
Bientôt l’heure du repas, pensai-je, et ensuite quelques petites heures avant le parloir. L’idée de revoir ma famille me réconfortait. C’était le seul et unique rayon de soleil dans chaque long mois de torture. Douze rayons de soleil par an ! Une demi-heure de bonheur relatif à chaque fois. Cela fait six heures de bonheur relatif par an. Je fis un rapide calcul mental : six heures sur 8760 dans l’année. Six misérables heures et ils te harcèlent, toi et ta famille, pendant chaque précieuse seconde - jusqu’au dernier instant !
Je continuai à marcher et la colère commença à monter. "Salauds", dis-je et je m’arrêtai pour regarder par la fenêtre sans carreau quadrillée de béton. Je me rappelai que même cette vue minable me serait enlevée bientôt. Ils avaient commencé à couvrir de bois et de tôles ondulées les fenêtres des autres ailes, cachant ainsi le ciel et la lumière du jour. Sûr, il n’y avait pas grand chose à voir à part les oiseaux, le ciel nocturne et les nuages. Tout le reste n’était qu’une verrue déprimante. Pourtant, à présent, la neige était de nature particulière, pendouillant sur les kilomètres de barbelés sinistres et accrochée à tout ce métal gris et triste à perte de vue. Tout était ou bien grisaille ou bien blancheur éclatante. La nuit, il y aurait un peu de couleur tant que la neige durerait, des milliers de lumières vives et de spots impudiques réfléchis sur le tapis blanc.
Oh ! Le bonheur et le soulagement de me promener dans un champ d’herbe verte et tendre et de toucher la verdure et de sentir la texture d’une feuille dans un arbre. Ou encore de m’asseoir sur une colline et d’admirer la vallée remplie de la nouvelle vie du printemps, en humant la saine fraîcheur verte et la grandeur de la nature.
La liberté, voilà. C’était ça. La liberté de revivre. Je me détournai de la fenêtre pour continuer mon interminable route, un peu découragé par mes pensées de liberté. Je regardai les murs dégueulasses, les tas d’ordures puantes et de restes pourrissants empilés dans les coins sur le sol humide. Le matelas noir de crasse en lambeaux, mutilé par mille fouilles. Le plafond, taché de thé pour atténuer la lumière violente de l’ampoule. La porte raclée et abîmée, le pot de chambre immonde juste à côté. C’était de plus en plus dur de retrouver l’image de ce champ d’herbe verte. A chaque instant, mon environnement de cauchemar m’en empêchait. Il n’y avait pas d’autre issue que de céder ! Quelques-uns - pas beaucoup - l’avaient déjà fait. Ils avaient mis la tenue de prison conforme. Ils n’avaient pas voulu le faire. Mais ils n’en pouvaient plus. Torture, ennui, tension, peur, privations, solitude… ils ne pouvaient plus supporter tout cela.
La déprime, les bastonnades, le froid - qu’y a-t-il d’autre, me demandai-je ? Regarde par la fenêtre et ça pue le camp de concentration. Regarde autour de toi, dans cette espèce de tombe et tu sombres en enfer, avec des petits diables noirs, A, B et C, prêts à te sauter dessus à chaque instant de chaque journée-cauchemar.
Je remis mon matelas par terre et m’assis. Les premiers nuages de déprime noire m’entouraient. J’essayai de penser au parloir pour me remonter le moral. Mes pensées se centrèrent sur Pee Wee et j’étais sur le point de tuer B et C dans un élan fantasmatique quand résonna un bruyant hourra qui annonçait l’arrivée de notre repas tant attendu. Le "fourgon fendard", comme on surnommait le camion qui transportait les repas, était arrivé. Et Dieu soit loué, me dis-je, oubliant aussitôt la dépression menaçante. On entendit tout d’un coup des signes de vie dans les tombes alentour. Quelques camarades commencèrent à bavarder près des fenêtres. Pour nous, l’arrivée du repas signifiait bien plus que la nourriture : elle nous signalait que les matons partiraient bientôt pour leur pause-déjeuner de deux heures et que nous serions relativement tranquilles pendant ce précieux laps de temps. Elle nous rappelait aussi qu’il ne restait plus que la moitié de la journée pour trimer avant la nuit. Un léger crachin tombait dehors. Pourvu qu’il ne pleuve pas trop ! Si la neige fondait, ils nous sortiraient les tuyaux d’arrosage et ils arroseraient les murs extérieurs des cellules et la cour. On serait tous douchés aux appareils à haute pression, notre literie et nous-mêmes serions complètement trempés et on crèverait de froid. C’est atroce d’essayer de se cacher dans le coin de sa cellule, de se faire tout petit, pour tenter d’éviter le jet d’eau glacée. Sans verre aux fenêtres, il n’y avait rien pour nous protéger.
Une vibration, une porte s’ouvrit.
"A la soupe !" cria un gars en gaélique.
J’oubliai subitement l’arrosage haute pression et me dirigeai vers le petit trou. Ils étaient de l’autre côté de l’aile : je serais parmi les derniers. Les assiettes en plastique étaient empilées les unes sur les autres dans le chariot. Les plantons les distribuaient dans les cellules. B se tenait à proximité. Il se servait dans toutes les assiettes, choisissant tranquillement les meilleurs morceaux de poisson et les dégustant d’un air nonchalant. Je fumais de rage !
"Steaks Fenians, plat du jour" criait B. Il se marrait de son humour grotesque.
"J’espère qu’ils s’étrangleront avec !" ajouta C avec sa gentillesse habituelle. L’équipe-repas poursuivait sa tournée, A à l’arrière. Au bout de l’aile, ils tournèrent et commencèrent la distribution de mon côté. J’entendais le bruit métallique des portes et des serrures de plus en plus près.
B cria : "Monsieur A, il me semble qu’il manque un poisson."
C’était comme un coup de poing dans le ventre. J’étais le dernier. Ce salopard de B avait mangé mon poisson ! J’avais envie de le crier par la porte, mais c’est ce qu’ils attendaient. C’est ce qu’ils voulaient. Je ne jouerais pas le jeu. Et puis il reprit : "Ah ! Monsieur A ! Je me suis apparemment trompé !" Je poussai un soupir de soulagement. "… Il en manque deux, Monsieur A ! !"
Sean faillit exploser. Je m’empressai de frapper sur le mur mitoyen pour lui rappeler qu’il n’était pas tout seul. Je l’entendais grommeler en maudissant les matons. J’en étais malade. Ce poisson devait se sentir aussi comme ça quand il s’est fait attraper, me dis-je. C’était catastrophique : il nous manquerait la partie comestible du repas. Sean le savait aussi bien que moi. La porte de Sean s’ouvrit et se referma. Puis la mienne. Je faisais comme si de rien n’était. En prenant le repas désolant que me tendait le planton, j’entendis A dire de sa voix traînante : "il semble qu’il nous manque quelques poissons. J’en informerai la cuisine centrale afin qu’on nous les envoie dès que possible."
En réalité, il voulait dire : "Tant pis pour toi, t’en auras pas."
Je vis B se lécher les doigts avec cérémonie et un sourire détestable. Je me retournai sans rien dire et sans montrer mon dégoût ni mon désarroi total. Derrière moi, la porte se referma dans un bruit de canon. De l’autre côté, ils riaient bien en retournant dans leur petit bureau - même les plantons.
Je m’assis et inspectai mon maigre déjeuner : une pomme de terre froide non épluchée, accompagnée de trente ou quarante petits pois froids et durs. Les plantons entamèrent leur bœuf quotidien de chants ringards et de siffleries qu’ils rythmaient en tambourinant sur tout ce qui leur tombait sous la main. B les récompenserait à tous les coups avec des cigarettes, partagerait quelques blagues sectaires avec eux et les encouragerait à continuer leur boucan infernal. De leur coté, ces chiens de plantons lui léchaient son cul sectaire et rampaient sans honte comme seuls les indics savent le faire. Ils vendraient leur propre mère pour une clope. Ce qu’ils nous faisaient pour le même prix et une vie facile ferait pleurer leur pauvre mère, j’en suis sûr.
Je commençai à récupérer ce qui était récupérable dans mon assiette, en mangeant ce que je pouvais. Il fallait vraiment le vouloir. Ensuite je jetai les restes dans le coin, sur le tas de saletés pourrissantes.
Le tapage des plantons cessa pour être remplacé par des cris de "Ramassage de vaisselle !" et des bruits de portes qui résonnaient le long du couloir. Je me mis à marcher et ne pris même pas la peine de regarder par le petit trou. Ils continuèrent leur chemin, allant d’une cellule à la suivante en ramassant les assiettes. J’entendis Sean dire à son voisin qu’il faudrait réclamer du PQ (papier hygiénique) au maton.
J’étais sur les nerfs en train de penser au parloir de l’après-midi et l’excitation commençait à faire de l’effet sur mes intestins constipés depuis cinq jours.
Ils arrivèrent à la porte de Sean. "Z’auriez pas un bout de papier toilette, Monsieur ?" demanda Sean.
"Essuie avec ta main !" rétorqua C et il claqua la porte.
Tous les autres s’écroulèrent de rire à l’humour malsain de C. La porte de ma cellule s’ouvrit et le planton prit mon assiette dans l’hilarité générale. Rien du tout sur mon poisson manquant, juste les commentaires débiles de B : "Elle était bien bonne, celle-là, Monsieur C !", suivis de rires hystériques.
"Ah, pas de doute, Monsieur C, une perle ! Ha, ha, ha, ha !" et la porte claqua. C se délectait à nous humilier. Pour B, c’était différent : il avait la mentalité d’un idiot. A se réjouissait et les quatre plantons en rajoutaient pour se faire bien voir. Je frappai sur le mur qui me séparait de Sean.
"Sean ! Je vais installer une ligne avec un bout de fil de serviette et te balancer quelques mouchoirs, mo chara", lui dis-je. "Attends que les matons aillent manger."
"Maith thù, Bobby", répondit-il. Je m’installai pour fabriquer la ligne, arrachant de longs fils à ma serviette usée, et repensai à la bonne blague de C.
I1 avait vraiment gagné sa journée avec celle-là, me dis-je.
"Monsieur B, faites-vous partie de l’équipe de garde cette nuit ?" demanda un maton au loin.
"Oui, en effet" répondit B du bureau.
Oh ! Bon ou mauvais signe ? M’interrogeai-je. Il rentre chez lui maintenant mais il sera de retour à 20h30 pour la garde de nuit. Il sera ivre - et je sais très bien ce que ça signifie.
"T’as entendu, Bobby ?" cria Sean.
"J’ai entendu, camarade", répondis-je, en me disant que Sean en était arrivé à la même conclusion que moi. "Ça va barder cette nuit !"
Je me levai et pris dans le tas de saletés une petite pomme de terre à moitié pourrie que j’attachai au bout de la ligne pour faire un poids. La porte du bureau ferma bruyamment et il y eut un tintement de ces clés tant détestées. Ils s’en allaient et bon débarras, me dis-je, tout en me dirigeant vers la fenêtre avec plusieurs mouchoirs attachés au bout de ma ligne. Je frappai sur le mur.
"T’es là, Sean ?"
"J’suis ici, Bobby", dit-il.
"Bon. Sors ta main par la fenêtre et je te balancerai des mouchoirs", dis-je.
Je tendis mon bras dans le vide et commençai à décrire de larges arcs avec la ligne plombée, afin de franchir l’intervalle d’environ cinq pieds. Il fallut m’y reprendre à plusieurs fois avant que Sean ne l’attrape.
"Ça y est, je l’ai, Bobby" dit-il.
"Maith thù, Sean. Sers-toi", lui dis-je, "à toi de jouer."
Il rentra la ligne, prit les précieux mouchoirs et frappa sa reconnaissance sur le mur. Je répondis de même et retournai à mes pensées. Je n’avais qu’une chose en tête, le parloir tant attendu. J’avais tellement envie de revoir ma famille ! En plus, je pourrai fumer - une raison de plus de me réjouir. Ça faisait longtemps que je n’avais pas vu la couleur d’une cigarette. Avec un peu de chance, j’en aurais ce soir et je pourrais les partager avec les gars. Ce serait un événement et un bon moyen de nous remonter le moral !
Mes boyaux remuèrent de nouveau. Ça y est, me résignai-je (et en vérité c’était le bienvenu après cinq jours de constipation), je vais être obligé d’aller aux toilettes. C’est quand même ridicule. Je pris quelques mouchoirs et me repliai dans le coin de ma cellule qui n’était pas visible de l’œil de Judas dans la porte. En dépit du grand soulagement de ma constipation, j’avais l’impression d’être une bête sauvage, accroupi ainsi dans le coin de la cellule au milieu d’un tas d’ordures et de saletés. Mais je ne pouvais pas faire autrement. C’était horriblement dégradant et humiliant. Mais, au moins, j’avais un peu d’intimité, tout seul dans ma cellule. Cela était pire pour les camarades qui étaient à deux !
Qui, parmi tous ces soi-disant humanitaires qui avaient gardé le silence dans le bloc H, qui parmi eux pourrait nommer ce genre de torture et d’humiliation ? Cette torture qui pousse des hommes à bout, au point qu’ils entament une grève décrasse pour montrer l’inhumanité qu’on leur inflige. Que de souffrances ! Un corps sale, nu, secoué de douleur, accroupi dans un coin, dans un trou d’infection, contraint à déféquer par terre où ses excréments resteraient à se décomposer et dont le relent insupportable irait rejoindre l’odeur déjà écœurante d’urine et de nourriture pourrie. Qu’ils essaient de mettre un nom à ce genre de torture, me dis-je en me levant pour prendre un bol d’air frais à la fenêtre. Les passages à tabac, les arrosages, les privations... qu’ils essaient un peu de trouver un nom à ce cauchemar des cauchemars !
Le crachin avait cessé et la neige restait intacte. Il faisait un peu moins froid. Plusieurs moineaux cherchaient de la nourriture dans la neige et ça me rappela le poisson qu’on m’avait refusé et que je ne mangerai jamais ! Je ramassai quelques croûtes de pain sur le sol et les jetai par la fenêtre à ces petits citoyens. Je restai à observer les moineaux s’en donner à cœur-joie. Je passais beaucoup de temps ainsi à cette fenêtre à les observer, me fis-je remarquer. Les moineaux et autres étourneaux, corbeaux et goélands étaient mes compagnons constants. C’était ma seule distraction pendant les longues journées ennuyeuses et ils venaient tous les jours depuis que j’avais commencé à leur jeter des croûtes de pain. Ils aimaient les asticots, me dis-je, pensant aux mois d’été où on étouffait de chaleur dans les cellules chaudes comme des fours et où l’odeur était réellement insoutenable. C’est là qu’apparaissaient, dans les tas de saletés, des milliers d’asticots blancs.
Jamais je ne pourrais oublier le matin où je m’étais réveillé transformé en masse grouillante d’asticots. Ils étaient partout : dans mes cheveux et ma barbe, remuant, nauséabonds, sur mon corps nu. Mes couvertures et mon matelas n’étaient qu’un océan d’asticots répugnants et terrifiants. Au moins au début. Mais, comme pour tout le reste, il a fallu que je m’habitue à partager ma cellule avec eux. La nuit, je les entendais même se déplacer sur le sol et déranger des petits morceaux de papier avec un bruit de froissement, en route pour mon matelas où ils se nichaient bien au chaud et durcissaient en autant de minuscules œufs avant l’éclosion. Ils explosaient avec un petit crac quand je les écrasais sous mes pieds nus, la nuit. Evidemment, le produit fini était difficile à supporter. Des centaines de grosses mouches accrochées au plafond et aux murs et affairées à me harceler sans merci nuit et jour. Torturant mon corps nu, s’agglutinant autour de mon visage quand j’essayais de dormir, me réveillant le matin. Je voyais s’élever hâtivement un nuage noir quand je remuais. Mais je découvris rapidement que les asticots pouvaient servir à quelque chose. J’y étais tellement habitué que je les ramassais par terre et sur les tas d’ordures avec mes mains. Ils grouillaient par milliers entre mes paumes. Je les jetais par la fenêtre et, tout blancs, ils s’éparpillaient sur le macadam noir de la cour, bien visibles. C’était jour de fête pour les bergeronnettes ! Elles arrivaient frénétiquement et sautillaient sur leurs petites pattes agiles d’un asticot à l’autre jusqu’à la fin du festin. En deux ou trois minutes, c’était terminé et il n’en restait pas un seul. Voilà, ça m’occupait. Ça passait le temps. Qui le croirait si on disait qu’on passait l’été à ramasser des asticots pour nourrir les oiseaux ?
Je pris quelques croûtes de pain dans le coin et les jetai par la fenêtre, pensant de nouveau à mes petits amis. L’hiver était une période dure pour les oiseaux, la terre cachée sous un manteau de neige. Je repartais faire les cent pas lorsqu’un des jeunes cria "rang anois" pour annoncer un cours de gaélique. Le professeur se trouvait à l’autre bout de l’aile. Il se mit à crier la leçon à tue-tête, posant des questions, épelant des mots et des phrases et les élèves, assidus et enthousiastes, grattaient et gribouillaient sur les murs sales et délabrés. C’était folklo comme méthode pédagogique, mais ça marchait. Tout le monde s’appliquait à parler en gaélique et à employer tout ce qu’on avait appris, si bien que les mots et phrases devenaient monnaie courante et s’employaient de façon naturelle. Le cours se poursuivait, lointain, et je me plongeai dans mes pensées. J’imaginais ma famille en train de se préparer pour le voyage jusqu’ici, s’ils n’étaient pas en route. Ils devaient attendre le parloir avec autant impatience que moi. Ils étaient sans doute en train de compter les minutes. Ce serait une longue journée pour eux et ils seraient mis à rude épreuve. Ballottés d’une fouille dégradante à la suivante, les visiteurs au parloir étaient traités comme des bêtes. Avant même d’y arriver, ils étaient la cible d’insultes et de regards dédaigneux et haineux des matons. Et rebelote avant de pouvoir sortir de la prison.
Un maton se mit à crier des moqueries de l’autre bout de l’aile, cherchant à déranger le cours de gaélique, mais les gars tinrent bon et firent comme si de rien n’était. Ça se passait souvent comme cela. Les matons, bredouilles, finissaient par se fatiguer et nous laisser tranquilles. Je m’assis de nouveau sur mon matelas, réveillant ainsi des douleurs dans mon corps malmené. Les bleus se développaient de plus en plus au fil des heures. J’étais très fatigué et je m’épuisais rapidement par manque d’exercice et d’air frais. Ça faisait si longtemps ! Je m’ennuyais à périr. L’idée même du parloir de tout à l’heure faillit me faire perdre mes moyens, je n’arrivais plus à réfléchir. Mais il y a toujours quelqu’un de plus mal loti, me dis-je, me souvenant de mes camarades morts et de leurs familles.
"Au moins, je peux te voir une fois par mois", aimait à dire ma mère, "t’es mieux là que dans le cimetière de Milltown." [7]
Mais, par moments, Milltown semblait une alternative préférable, quand les choses devenaient si insupportables que la vie et la mort n’avaient plus d’importance. Seulement la fin du cauchemar.
Et n’étions-nous pas en train de mourir, de toute façon, me demandais-je, notre corps n’est-il pas en train de dégénérer complètement ? Je suis un mort-vivant maintenant - qu’est-ce que je serai dans six mois ? Est-ce que je serai encore en vie dans un an, encore une année de ça ? Tout cela me tracassait avant, me tourmentait l’esprit pendant des heures et des heures. Mais plus maintenant ! Parce que c’est la seule chose qui leur reste à me faire : me tuer. Cela fait un bon moment que j’en suis conscient et Dieu sait que ce n’est pas faute d’essayer qu’ils n’ont pas encore réussi à achever l’un d’entre nous. Mais je suis fermement décidé à ne jamais céder. Ils feront de moi ce qu’ils voudront, mais je ne m’inclinerai jamais devant eux et je ne les laisserai pas me criminaliser.
Je m’étonne moi-même de ce constat : je préfère mourir plutôt que de succomber à leur torture opprimante et je sais que je ne suis pas le seul, que beaucoup de mes camarades ont le même sentiment. Je repensai à mes collègues morts. Mes amis, debout à mes côtés un jour, morts le lendemain. Des jeunes nés et élevés, tout comme moi, dans les ghettos nationalistes de Belfast pour se faire tuer par des soldats étrangers et des suppôts sectaires. Combien ont péri de leurs mains dans les Six Comtés occupés ! Beaucoup trop ! Un seul garçon ou fille était un de trop ! Et combien d’autres Irlandais mourraient ? Combien d’autres vies seraient perdues avant que les Britanniques ne décident qu’ils avaient assez tué et qu’on les oblige à quitter l’Irlande pour toujours ? En prison ou à l’extérieur, c’était pareil : oppression de toutes parts. Des soldats britanniques armés à chaque coin de rue, chaque rue ayant enduré sous leurs mains sa part de souffrances et de tristesse.
J’étais fier de résister, de me battre. Ils ne pouvaient pas nous vaincre dehors, alors ils nous torturent sans merci dans leurs trous infernaux et nous les tenons encore en échec. J’avais peur mais je savais que jamais je ne céderais. Je supporterais leur autorité dominatrice, tout leur arsenal de torture plutôt que de succomber. Je me couvris tant bien que mal et me retournai, espérant dormir un peu. Les matons ne reviendraient pas avant deux heures, au moins. B serait de retour à 8h30 ce soir et je me demandai qui le remplacerait entre temps. Je le saurai d’ici peu, me dis-je, fermant les yeux et l’esprit sur mon environnement pénible.
"Vide-chiottes ! Vide-chiottes !"
Je me réveillai en sursaut.
"Vide-chiottes ! Vide-chiottes !"
J’entendis le raffut du seau métallique et fus immédiatement envahi par une écrasante sensation de froid qui me laissa vide et épuisé. Tout de suite, je me remis debout, craignant surtout l’idée d’avoir des crampes. Ça va, me dis-je, quand bien même mes yeux luttaient pour dissiper les ombres noires et j’eus beaucoup de mal à ne pas céder à l’évanouissement.
Je me ressaisis et bondis devant le petit trou dans la porte. A côté de la cellule de Pee Wee, une porte s’ouvrit. A, B et D, le remplaçant de C, formaient un demi-cercle dans l’entrée, avec quatre plantons. L’un de ces pauvres morveux tenait dans la main un racloir en caoutchouc fixé à un long manche. John O’Brien apparut dans l’entrée de sa cellule, une couverture autour de la taille. Il vida son pot de chambre plein d’urine par terre dans le couloir et, d’un pas en arrière, rentra dans sa cellule. Le planton au racloir s’exécuta aussitôt. Il avança et il repoussa l’urine dans la cellule de John en balayant et en prenant soin de l’étaler jusqu’au matelas.
Maintenant, la plupart des gars étaient en train de vider leur pot sous leur porte, tant bien que mal, en s’aidant du seau pour en envoyer le contenu dans le couloir. Mais le bas de ma porte épousait trop bien le sol. Pour moi, cette technique ne pouvait pas marcher. Il y avait bien de la place, mais au-dessus et autour de la porte – beaucoup trop compliqué, comme manoeuvre. Je serais obligé de faire comme John et de tout balancer dans le couloir dès que la porte s’ouvrirait. Obligé. S’ils arrivaient à renverser un pot entier d’urine dans la cellule, on en aurait plein partout et le matelas aussi. Il y a plus d’une façon de casser un prisonnier de guerre et celle-ci avait déjà fait ses preuves. Ils passaient de cellule en cellule, zigzaguant le long du couloir. Peu leur importait, de toute évidence c’était juste un autre exercice de harcèlement, prélude à d’autres tortures. Je saisis mon pot et me mis en position, prêt à agir ! Ce serait mieux à deux, me dis-je, rêvant au soutien moral d’un camarade de cellule. Mais Sean était tout seul, lui aussi, et Pee Wee l’était ce matin. Ils allaient s’en prendre à un autre prisonnier, c’était sûr. Je me doutais que c’était l’objectif principal de l’opération vide-chiottes - aucun de nous n’était dupe, d’ailleurs.
Un bruit à ma porte m’alerta que mon tour était arrivé. Je me tins prêt, le pot à la main, espérant que ça se passerait bien. La porte s’ouvrit et je ne les regardai même pas. Je me baissai avec le pot et en envoyai le contenu vers le milieu du couloir, priant pour que leurs bottes brillantes de matons ne soient pas atteintes. Je reculai d’un pas et levai la tête, mais le coup n’arriva pas. Je leur lançai un rapide coup d’œil. C et D étaient ivres morts et A souriait comme d’habitude. Le planton commença à pousser le liquide malodorant dans ma cellule et le matelas en était saturé avant qu’il ne décide d’arrêter. La porte claqua. Je soulevai mon matelas et me mis à essorer cette mousse infecte par terre. Ensuite, je tentai vainement de racler la flaque vers la porte. C’était long. Cela n’allait vraiment pas vite. L’ouverture était étroite et la porte arrivait jusqu’au sol. Un filet d’urine sortait tout de même, mais très lentement. Et ça continuait plus loin : le bruit du seau, l’ambiance de danger, l’urine éclaboussant par terre, la tension palpable était presque nausée.
Soudain, une explosion de bruits éclata. Des cris de haine, des hurlements, les rebondissements métalliques du seau qui tombait par terre et un barrage de coups sourds résonnaient d’un bout du couloir à l’autre. Et une tête frappée violemment contre la tuyauterie en acier sonnait jusque ma cellule. Je laissai tomber mon pot et m’approchai du petit trou dans la porte. Quelqu’un cria : "Il leur en faut encore !
Donne-leur encore !" et le tollé continua jusqu’à ce que j’entende A crier : "Ça suffit !" Plusieurs matons arrivèrent en courant de l’autre aile, éclaboussant tout autour l’urine puante avec leurs lourdes bottes.
"Va chercher un fourgon pour le bloc-punition !" cria D de sa voix haineuse et stupide. D’autres coups suivirent, et puis des bruits de pas et des rires de hyènes, encore des bottes qui couraient et de l’eau... Quatre uniformes noirs passèrent rapidement devant mon champ de vision. Ils traînaient par les pieds un corps nu, raclant son dos contre le béton et cognant sa tête à chaque pas. En un instant, ils étaient partis et je ne pus reconnaître le pauvre malheureux. Il était couvert de sang, en tout cas.
Pendant plusieurs secondes, rien ne bougea. Un lugubre silence d’attente s’installa. Les flaques d’urine retrouvaient leur aspect calme et stagnant quand tout à coup le même boucan s’éleva. Une course de bottes dans le couloir, les vibrations de menaçante augure, une autre masse de figures noires passant devant le petit trou de la porte. Un autre corps en sang traîné par les pieds devant ma cellule. Et, encore, ce silence de chambre mortuaire. La tension, suspendue comme une guillotine. On avait peur de respirer trop fort, peur de la rompre le premier. C’était totalement démoralisant et ça paraissait interminable. Un cri trancha cette atmosphère de cauchemar.
"Tiocfaidh àr la !" Il bondit et rebondit sur tous les murs, fracassant le silence comme une brique à travers une vitrine, soulevant les espoirs, attisant la haine et l’amertume rivées à chaque syllabe. "Notre jour viendra !" Voilà ce que ça voulait dire et oui, me dis-je, notre jour viendrait. Et que Dieu vous préserve, A, C et D, et toi aussi, B, et tous les autres salopards, jusqu’au dernier, car vous êtes tous pareils : vous êtes des tortionnaires.
"Tiocfaidh àr la !" criai-je à tue-tête. Quelqu’un se mit à chanter Une Nation Retrouvée et, derrière chaque porte, tout le monde lui fit écho pour mieux rompre cette atmosphère diabolique. Notre moral à zéro décolla un peu et notre cœur en fut allégé. Les relents d’urine traversèrent la porte et m’irritèrent les yeux et la gorge. Les plantons tentèrent un refrain de The Sash mais aussitôt s’éleva une explosion de bruits de pots de chambre vides, de défiance et de colère. Impossible qu’ils se fassent entendre avec ce tintamarre.
"Tiocfaidh àr la ! Tiocfaidh àr la !" répétai-je, "le plus tôt sera le mieux !"
Je me remis à pousser sous la porte ce qui restait de la flaque d’urine à mes pieds. Le bruit commençait à s’atténuer et le dernier filet malodorant disparaissait sous la porte. Je balançai le pot vide sur le tas d’ordures dans le coin et m’assis sur le matelas, prenant soin de poser mes pieds au sec. J’étais complètement bouleversé et épuisé. Mes nerfs à vif imploraient un soulagement qui n’arriva pas.
Plus de bruit. Sean me fit signe en frappant sur le mur, inquiet comme d’habitude.
"Ça va, Bobby ?" demanda-t-il.
"Ça va, Sean. Et toi ?"
"Ils ne sont pas venus ici", répondit-il.
"Qui a été emmené ?" demandai-je.
"Je ne sais pas" dit-il, ajoutant qu’il avait fait passer le mot dans tout le couloir pour avoir la réponse. "Mais je crois que c’est C et D qui frappaient."
"Ça ne m’étonnerait pas" consentis-je.
"Hé, Sean !" interpella un camarade plus loin, "c’était Liam Clarke et Sean Hughes ! C et D les ont tabassés et le planton les a matraqués avec son racloir. Sans raison, Sean. Comme d’habitude. Ils les ont chopés alors qu’ils rentraient dans leur cellule."
Je laissai Sean discuter des événements avec les autres à la fenêtre et me remis à faire les cent pas, toujours conscient que le parloir pouvait avoir lieu à tout moment. Le tabassage des deux camarades - et de Pee Wee O’Donnell plus tôt – avait temporairement atténué mon enthousiasme. Je ne pouvais pas m’empêcher de penser à eux, allongés maintenant sur les planches du bloc-punition, où on les avait presque certainement frappés encore. Les matons affectés là-bas étaient particulièrement sadiques.
Je n’en étais que trop conscient, ayant moi-même souffert entre les mains de ces bourreaux abrutis.
Tous, nous vivions dans la crainte d’y être envoyés. Le bloc-punition signifiait torture, brutalité et inhumanité. Même les matons le savaient, mais ils ne disaient rien. J’y ai passé trois jours il y a quelques mois - les trois journées les plus longues et les plus insupportables de toute ma vie. Les matons me prirent nu dans ma cellule et me conduisirent au bloc dans un fourgon aux vitres noircies. Dès que j’en descendis, on me roua de coups de toutes parts. Personne n’avait prononcé le moindre mot, ni même de menace. J’étais un homme-couverture républicain et, pour eux, ce seul fait était un feu vert. J’étais à peine conscient quand ils me traînèrent par les cheveux sur les gravillons jusqu’au portail du bloc. L’un d’eux s’identifia à la porte pour prévenir de notre arrivée ses collègues à l’intérieur. J’étais par terre à leurs pieds, sonné, choqué et haletant. Mon cœur s’emballait douloureusement et mon corps était en feu, réduit en une masse de chair ensanglantée sur le béton brut. Mon visage me paraissait chaud et humide à cause d’une plaie ouverte sur mon front qui pissait le sang. Je restai totalement immobile, espérant qu’ils se satisferaient de mon état inconscient. Ma joue reposait contre une surface noire, froide et dure mais mon corps ignorait le froid glacial. Tout bas, je murmurai un Je vous salue Marie et une pénitence, lorsque j’entendis sonner des clés. Plusieurs gants me prirent et me serrèrent les bras et les pieds, soulevant mon corps et à la fois le balançant en arrière. Soudain, je fus projeté en avant et ma tête se fracassa contre la tôle ondulée du portail, le poids de mon corps aidant. On me relâcha à terre sans cérémonie et le ciel entier me tomba dessus. Avec le deuxième impact, je vis trente six mille chandelles exploser devant mes yeux comme autant de feux d’artifice, abruptement éteints par un nuage d’encre noire. Quand je repris conscience j’étais allongé par terre dans une des cellules du bloc-Punition.
J’ouvris les yeux. La tête me tournait. La lumière vive de la cellule m’aveuglait. La douleur était terrible et me soulevait le cœur. Mon corps tout entier semblait à vif. Je restai collé au sol, trop terrifié pour bouger, le goût de sang sur mes lèvres enflées, et je luttai pour me rappeler où j’étais et ce qui m’était arrivé. Le froid par terre était si intense que je me résignai péniblement à me lever, de peur d’en souffrir les conséquences plus tard. Je réussis à m’agenouiller et les murs s’écroulèrent sur ma tête. Je tombai. Au bout d’une éternité je refis une tentative malgré des spasmes de douleur qui me neutralisaient presque totalement. J’arrivai à me mettre à genoux. Ma peau brûlait et ma chair à vif restait collée au sol. Je continuai. J’arrivai enfin à me tenir debout et faillis retomber aussitôt mais, en m’appuyant contre le mur, je titubai jusqu’au bloc de béton qui faisait office de tabouret et m’y affaissai, j’avais l’impression de mourir. J’étais fou de douleur et en état de choc et je n’arrivais pas à réfléchir. Le moindre mouvement de mon corps me faisait souffrir le martyre. J’étais sur le point de crier ma douleur quand la porte s’ouvrit et un planton en blouse blanche entra dans la cellule. Il commença à m’examiner, me tripotant partout et jouant au médecin pour impressionner sa galerie de matons, amassés à l’entrée.
Il finit sa comédie et m’informa sèchement qu’avant de voir un médecin ou de recevoir des soins, il fallait que je prenne un bain. Je le regardai, totalement incrédule. Il réitéra l’information d’une voix menaçante. Il savait bien ce qu’il faisait. J’étais blessé et j’avais besoin de soins immédiats, mais me voilà contraint et forcé. Pas de bain, pas de soins. De plus, j’avais tellement mal que je n’arrivais même pas à bouger - encore moins à me baigner ! Et de toute façon, je n’avais pas l’intention d’arrêter ma protestation. Blessé ou mourant, je ne céderais pas. Je savais ce qui arriverait. Il reformula son ordre.
"Crève !" criai-je en colère. La meute me souleva comme un sac de chiffons et me porta à la baignoire pleine. On me jeta dedans comme une savonnette et le choc de l’eau glaciale faillit me couper le souffle.
Chaque centimètre de mon corps fut torturé sans merci par le contact de l’eau fortement désinfectée. J’essayai de m’en extraire mais les matons me tinrent fermement et l’un d’eux se mit à frotter vigoureusement avec une brosse à chiendent mon dos déjà en lambeaux. Je n’en pouvais plus. Je tressaillais, tentais vainement de sortir de la baignoire, mais plus je luttais, plus l’étau se resserrait autour de mes bras et jambes. Les larmes arrivèrent, inondant mes yeux. J’aurais probablement crié, si j’avais pu rassembler suffisamment de souffle. Ils continuèrent à me frotter tout le corps, versant sur ma tête des seaux d’eau savonneuse glacée. Le maton sadique me saisit les testicules et me frotta vicieusement les parties. Je me souviens vaguement d’avoir été soulevé et sorti de l’eau froide. Après, plus rien. Je m’évanouis.
On me conduisit à l’hôpital de la prison emmitouflé dans une grande couverture beige, et un médecin m’examina. Je restai là deux heures et fus pansé comme une momie. Ensuite, avec un œil au beurre noir et sept points de suture à la tête, on me ramena dans ma cellule du bloc-punition. Je m’assis, habillé seulement d’une couverture usée et très sale aux relents d’urine et de tabac froid. J’avais un peu repris mes esprits mais restais désorienté et quelque peu amnésique. Avec beaucoup de difficulté, je tentai de me rappeler ma terrible épreuve, mais la question de ce qu’il adviendrait de moi se fit plus pressante. Personne ne pouvait rien pour moi à présent. Je ne pouvais parler à quiconque. J’étais seul, isolé et vulnérable. J’étais tout simplement à leur merci - et me considérais bien placé pour savoir qu’ils ignoraient jusqu’au sens de ce mot. Pire que tout, je mourais de froid et me trouvais incapable de marcher ou même de bouger pour me réchauffer. Et je broyais du noir. Plus tard dans la journée, les matons revinrent et m’extirpèrent de nouveau de ma cellule pour paraître, nu, devant un des Administrateurs de la prison dans une mise en scène de tribunal. Je me tins nu devant ces gens, humilié et gêné, la tête prête à exploser de douleur. On m’inculpa de "désobéissance et refus d’exécuter un ordre", autrement dit mon refus de coopérer avec le maton qui entreprenait de me fouiller l’anus. J’avais refusé net cela. Mais on m’inculpa parce qu’il avait fallu qu’ils se mettent à trois ou quatre pour m’immobiliser et arriver à leurs fins. Le maton en question était celui à la blouse blanche. Même s’il avait été neurochirurgien, ça n’aurait rien changé à ma réaction, puisque leur motivation était purement la dégradation et l’humiliation. Cela faisait partie de leur technique de torture pour essayer de casser notre résistance. On me jugea coupable - je ne m’attendais pas à autre chose - et on me condamna à passer trois jours dans une cellule du bloc-punition au régime "numéro un", terme édulcoré qui signifiait régime sec. Je perdis aussi un mois de remise de peine, l’équivalent d’une prolongation de deux mois en prison ! Le comble : on m’inculpa de coups et blessures sur les quatre matons qui avaient failli me tuer ce matin-là et, pour en rajouter une couche on m’inculpa aussi de blessures auto-infligées. On me fit comprendre que, si j’osais porter plainte je serais inculpé pour faux témoignage contre des officiers de prison. Comment gagner dans ces conditions-là ? J’avais envie de vomir. On me traîna le long des couloirs et on me remit dans ma cellule.
La cellule était glaciale, vide et triste. J’étais déjà venu ici une fois et je savais à quel point ce serait isolé et insupportable. Une planche de bois à même le sol de béton faisait office de lit, deux blocs en ciment servaient de table et de tabouret. Une Bible, un pot et un récipient d’eau étaient les seuls autres articles visibles. J’y restai trois jours et fus tabassé deux fois, mais moins fort. Lorsque je demandai à vider mon pot puant, ils essayèrent le chantage.
"Mets ta tenue de prison pour le vider !" dirent-ils.
Je refusai et le pot déborda. Je n’y fis pas attention. Ma priorité était de me réchauffer : mon corps tout entier était dans un état d’engourdissement constant. J’étais transi par le froid arctique. Les deux premiers jours, j’arrivais à peine à marcher et je devenais de plus en plus faible par manque de nourriture. Mon régime quotidien consistait en deux tranches de pain, sec et rassis, avec une tasse de thé noir et tiède pour le petit déjeuner et un petit bol d’eau fade en guise de soupe à midi. Le soir, on me donnait la même chose que le matin. Le troisième jour, je perdis connaissance encore une fois et restai allongé sur le sol froid jusqu’à ce que je reprenne mes esprits.
A mon retour au bloc H, je ressemblais à un rescapé d’Auschwitz. Même les matons furent choqués de voir mon état cadavérique. J’étais physiquement démoli et mentalement épuisé. La sous-alimentation, les passages à tabac, les bains forcés, l’ennui et le froid me rongèrent l’esprit, me remplissant de haine, d’amertume et de désirs de revanche. Deux semaines plus tard, je dus supporter quinze jours supplémentaires là-dedans. C’était le même cauchemar, mais multiplié par cinq. Je l’ai vécu comme une bête enragée, mangeant avec mes mains. Au rythme de trois jours de régime sec alternés de trois jours de privation totale, au milieu de la saleté et des excréments, j’essayai de bouger un peu pour me réchauffer, pris des coups de poing et de pied, priai dans mon cœur et pleurai dans mon sommeil, luttant constamment contre la soumission.
Et j’y arrivai. J’en sortis vainqueur. Les donjons de torture et les sadiques qui y opéraient avaient détruit mon corps mais ils n’avaient pas réussi à casser mon esprit. Il m’a fallu trois semaines avant de me remettre de ma terrible épreuve, mais intérieurement je resterai marqué à jamais. Dieu seul sait combien de nous ont souffert ce cauchemar. Le pauvre Pee Wee et les deux autres jeunes doivent y être maintenant. Combien d’autres le subiront et combien de temps avant que l’un de nous soit battu à mort. A quand la fin de tout ça, me demandai-je, et je me rassis sur mon matelas.
L’heure avançait et les premières craintes me traversèrent l’esprit. Et mon parloir ? Je tendis l’oreille et voulus de toutes mes forces que le téléphone au bout de l’aile sonnât pour prévenir A de l’arrivée de ma famille. Je me mis à arracher des fils de mes couvertures usées et à les tresser pour passer le temps, fabriquant ainsi une longue ficelle qui servirait peut-être plus tard. Quelques flocons de neige entrèrent par la fenêtre ouverte et atterrirent dans ma cellule. Je scrutai le ciel, des chutes de neige importantes menaçaient. La lumière du jour commençait à diminuer et avec chaque minute qui passait il faisait de plus en plus sombre. J’entendis le croassement des corbeaux dans les champs voisins, amené intact jusqu’à ma cellule par une légère brise du soir. Je restai à les observer voler vers l’horizon et remarquai les milliers de lumières de couleurs différentes éclairant le chemin. Bientôt il n’y eut devant mes yeux qu’une masse de lumières brillantes qui faisaient scintiller la neige sur les fils barbelés. La journée hivernale mourut et l’obscurité prit place. Il se fait très tard, me dis-je, cachant ma ligne tressée dans un trou du matelas et me sentant envahi par une panique croissante. Je me demandai ce qui était arrivé à mes visiteurs. Il doit être au moins 16h30, me dis-je. Que s’est-il produit ? Le téléphone sonna. Je me tendis, espérant entendre les mots tant attendus. Un maton au bout de l’aile fit signe à A. Cela y est, me dis-je tout excité et je m’assis impatiemment pour attendre la suite. Le temps traîna longuement et toujours pas de confirmation de ma visite. Cinq minutes ! Dix minutes maintenant ! Enfin un bruit de clés et de pas qui s’approchaient de ma cellule. Le tintement métallique de la serrure et ma porte s’ouvrit sur C et D.
"Parloir, connard !" cria C de sa voix âpre, chaque syllabe imbue de toute la haine qu’il pouvait y exprimer. Si ça ne tenait qu’à lui, je serais traîné dehors et fusillé. Je me levai et me dévêtis de mes couvertures, les laissant tomber par terre. Je mis une serviette autour de ma taille et sortis dans le couloir parsemé de flaques d’urine.
Je remarquai tout de suite qu’il y faisait plus chaud que dans les cellules. Je poursuivis mon chemin à travers l’urine jusqu’à la dernière cellule, dans laquelle on stockait les tenues de prison. Le parloir était la seule occasion pour laquelle nous mettions l’uniforme de la prison. Je jetai un coup d’œil autour de moi et pris le premier habit qui me tomba sous la main. Je m’apprêtai à enfiler la chemise quand D annonça : "Bon ! Lâche la serviette et mets-toi à côté de la glace !" indiquant une grande glace posée sur le sol. J’exécutai. Il m’ordonna ensuite de me baisser et de toucher mes doigts de pied. Je refusai. Il appela A et, tous les trois, ils me plièrent en deux et me tinrent fermement pendant que A m’inspectait l’anus. Au bout d’un moment ils me relâchèrent et je me redressai pour m’habiller.
"Salauds !" me dis-je. Ils ne m’avaient même pas demandé d’ouvrir la bouche.
Ce qui les intéressait n’était pas de fouiller, mais d’humilier !
Je quittai la cellule, habillé et dégoûté, ruminant dans ma tête ce qui venait de se passer et me disant que le pire était sans doute encore à venir ! Ils m’enfermèrent dans le sas de barreaux d’acier au bout de l’aile. Je faisais pitié à voir : visage sale, cheveux et barbe ébouriffés et une tenue de prison dans laquelle je nageais. Je n’en avais que faire. Mais plus vite je l’enlèverais et mieux je me porterais. Je me moquais bien de mon look ! C’était de la torture, pas une séance de manucure. Un maton arriva pour ouvrir une porte dans la grille et, aussitôt, un deuxième apparut pour me conduire au parloir. Il me sortit et me fit monter dans un fourgon aux vitres noires. Le moteur était en marche et une épaisse fumée acre s’échappait dans les ténèbres. Je frissonnai en m’asseyant sur le banc dur. J’espérais qu’il y aurait quelques gars des autres ailes ou blocs de la prison en route pour le parloir, mais le fourgon était vide et sombre. Mon maton-escorte monta à côté de moi et ferma la portière, plongeant l’habitacle dans le noir total.
"C’est bon !" cria-t-il au conducteur et nous partîmes. Nous passâmes le portail principal du bloc H - la porte de l’enfer, me dis-je. Le maton pesta contre la portière bruyante et garda la main dessus pour l’empêcher de s’ouvrir. Il essaya d’entamer la conversation.
"Ça fait combien de temps maintenant que t’es dans les couvertures ?" demanda-t-il, puis poursuivit aussitôt : "Tu crois pas que ça serait aussi bien d’arrêter ?"
"Non. Je ne le crois pas", répondis-je sèchement.
"Ça vous mène nulle part", continua-t-il.
"Tout mène nulle part en attendant d’y arriver" dis-je sévèrement.
"Vous êtes fous. J’ferais pas ça si j’étais à vot’ place" dit-il.
"Non. Je n’en doute pas", rétorquai-je, "et c’est sans doute parce que t’es maton et moi, j’suis prisonnier politique."
Celle-là ne lui a pas plu, me dis-je, quand il s’abstint de commentaire. Je parie qu’il rougit dans le noir.
"Et puis", poursuivis-je, y allant franco maintenant, "en fin de compte, c’est vous qui serez les plus lâchés dans l’affaire."
"Comment ça ?" grommela-t-il.
"Eh bien," dis-je, "quand le gouvernement britannique brandira son stylo politique et nous accordera de nouveau le statut politique ou, mieux encore, déclarera son intention de partir - et la nécessité lui fera prendre cette décision tôt ou tard - vous aurez bonne mine, vous.
Qu’est-ce que vous ferez alors ?"
"Ça n’arrivera jamais." dit-il nerveusement.
"Oh que si, ça arrivera." continuai-je, "Et, mieux encore, c’est déjà arrivé. En Chypre, Aden et Palestine et ailleurs. Et ça arrivera encore, c’est sûr."
Le fourgon s’arrêta brusquement. Le maton ouvrit la portière et sortit, me faisant signe de le suivre. Maintenant il était moins bavard, remarquai-je. Cela leur faisait peur à tous. Aucun n’aimait penser à ce qui adviendrait si on les laissait en plan, surtout après avoir commis tant d’atrocités. Ils auraient à répondre de tout cela ! Je passai devant les boxes à fouilles, qui étaient totalement occupés avec ceux qui revenaient du parloir. C’était tous des prisonniers en préventive ou de droit commun. La cabane spéciale pour fouiller les "couvertures" était située à part, sinistre et mauvaise. Des plaques de neige s’accrochaient aux parois en bois, lui conférant un air encore plus désolé et désespéré. Des bruits de coups sourds et des cris venant de l’intérieur me confirmèrent que les lieux étaient occupés.
J’entrai dans le bâtiment-visiteurs et attendis sous la lumière violente que le maton vienne renseigner mon escorte sur le numéro de mon box. Des douzaines de matons me regardèrent fixement au passage et certains firent des remarques sarcastiques ou narquoises. Je ne leur prêtai pas attention. Le remue-ménage autour de moi me surprit et me désarçonna un peu. Je n’avais pas l’habitude de tels changements. Ce n’était plus l’ambiance meurtrière de haine et de tension qui régnait sur nous, tous les jours, dans le bloc H. Ce n’était pas que les matons méchants manquaient ici, mais ils étaient concentrés sur autre chose - et pas sur moi, pour changer un peu !
Le maton revint et me conduisit dans une grande salle de visite.
"Box 7", dit-il.
Seigneur, me dis-je, le box 7 se trouve au bout, là où rôdent la plupart des matons. Il m’ouvrit la porte et j’entrai. C’était comme si j’entrais dans une salle de théâtre : la première chose qui me frappa fut le ronronnement de conversations chuchotées. Puis la fumée épaisse et les vêtements de couleurs vives que portaient les visiteurs, réunis en groupes serrés autour des tables dans chaque box. Ensuite, la masse noire des matons faisant le va-et-vient, écoutant une conversation ici et là, se lançant des blagues entre eux et remplissant l’air de leurs rires braillards. Je regardai les chiffres sur les boxes - 12, 11, 10, 9 - et me dirigeai vers le 7. Dans tous les boxes, des visages compatissants et sympathiques me sourirent des encouragements.
Des femmes âgées, des épouses, des filles, des sœurs et des frères, les enfants et les parents de mes camarades. Je répondais à leurs sourires tant bien que mal, ressentant beaucoup plus que de la tristesse ou de la compassion pour eux.
"Dieu te bénisse, jeune homme !" me cria une vieille femme, "Courage, courage !"
J’eus envie de pleurer.
"Circule !" grogna un maton dans mon oreille. Déboussolé, je balayai du regard les boxes en passant devant chacun. Mes camarades et leurs familles me souriaient et me lançaient des mots gentils. J’arrivai dans le box 7 et, sans réfléchir, m’assis du mauvais côté. Les matons prédateurs à proximité faillirent m’avaler tout cru.
"Dégage de cette chaise et amène-toi de ce côté !" crièrent-ils, semblant rivaliser de méchanceté et d’autorité dominatrice.
Je changeai de côté.
"Salauds !" me dis-je.
"Comment ça va, petit ?" cria un vieux avec l’accent de Derry en passant devant mon box.
"Je tiens le coup", répondis-je, ce qui correspondait à peu près à la réalité !
"Tant mieux pour toi, jeune homme, et que Dieu prenne soin de vous tous !" dit un autre passant, une femme d’un certain âge avec, je crois, l’accent de Tyrone. Une sacrée distance à faire, me dis-je, pour un parloir d’une demi-heure.
Les matons continuèrent à rôder devant les boxes, écoutant de près ce qui se disait. Mon escorte et trois autres matons bavardaient à côté de mon box. Trois ou quatre personnes en firent le tour et approchèrent. Puis je vis ma mère, suivie de mon père et de ma sœur. Je me levai pour les saluer alors qu’ils avançaient vers moi. Je vis ma mère jeter un regard furtif autour d’elle juste avant de m’embrasser en me serrant dans ses bras et je sentis sa main contre la poche de mon grand manteau. Mon père et ma sœur se trouvaient entre ma mère et une meute de matons et les autres matons avaient tous le dos tourné à cet instant précis. Le mouvement fut rapide comme un éclair. Je compris tout de suite de quoi il s’agissait et je sus qu’il se trouvait à présent dans la poche gauche de mon manteau. Ma sœur avança vers moi et m’enlaça tendrement tandis que mon père me serra la main, je balayai du regard les visages des matons, scrutant des signes de découverte. Il n’y en avait pas, mais mon cœur faillit s’arrêter quand ils se mirent à avancer vers nous. Ma mère s’assit et je me mis à côté d’elle. Mon père et ma sœur firent le tour pour s’installer de l’autre côté de la table en bois simple, qui servait de séparation entre les visiteurs et les prisonniers.
"Bon !" cria un maton.
Je faillis tomber de ma chaise, croyant qu’on nous avait repérés. Mon cœur battait à tout rompre.
"Faudra vous éloigner du prisonnier et vous mettre de l’autre côté de la table", dit le maton à ma mère.
Je n’en pouvais plus. J’avais des nausées, des douleurs à la poitrine, si grande était ma peur d’être attrapé. Cela aurait vraiment été le comble de la journée.
"Prisonnier ?" reprit ma mère, exaspérée. "Mais c’est mon fils ! Je ne peux pas me mettre à côté de mon fils ?"
"Non. Désolé", répondit le maton.
"C’est comme ça. C’est le règlement", ajouta un autre.
J’étais trop occupé à reprendre mes esprits pour discuter. Ma mère, craignant qu’on ne nous supprime le parloir, déplaça lentement sa chaise de l’autre côté de la table, avec mon père et ma sœur. Les matons restèrent dans le box pendant l’exécution de leur ordre avant de s’éloigner à un mètre de nous, à peine ; là ils se mirent à chuchoter entre eux tout en nous fixant des yeux. Je leur tournai le dos et commençai à parler avec ma famille.
"Comment ça va, fiston ?" demanda ma mère.
"Pas trop mal, ’man", répondis-je, voyant son angoisse devant mon piteux état.
"Ta barbe a poussé depuis la dernière fois qu’on s’est vus", plaisanta mon père, tandis que ma sœur me posait des questions sur le confort des cellules. Mon père sortit un paquet de cigarettes et me le tendit. J’en pris une et l’allumai avec l’unique allumette qu’on leur permettait d’apporter au parloir. Ma mère tenait mon autre main dans la sienne, j’entendis un bruit de pas derrière moi. Je me doutais bien que les matons surveillaient mon moindre geste et pesaient chaque mot que nous prononcions.
"Et comment allez-vous tous ?" repris-je, ajoutant qu’ils avaient l’air en pleine forme. La cigarette me faisait tourner la tête, mais j’en avais rêvé trop souvent pour l’écraser maintenant.
"Comment vont tous les autres ?" demandai-je. Quel plaisir d’avoir des nouvelles ! Mes trois visiteurs rivalisèrent pour me mettre à jour et par moments nous parlions tous à la fois. Il y avait tant de choses à nous dire et tant de questions que je voulais leur poser. C’était vraiment une conversation animée. Nous fîmes comme si les matons n’étaient pas là et baissâmes la voix jusqu’à être à peine audibles quand le sujet le nécessitait. J’aurais préféré tout cela avec les oreilles indiscrètes en moins, mais que faire ? Mon père et ma mère leur jetèrent un coup d’œil de temps à autre, mais je savais que cela ne les ferait pas partir, ni même s’éloigner d’un seul centimètre. Ma sœur me tenait à jour de l’actualité locale et me parlait de choses et d’autres. Pendant ce temps, j’essayais de tout retenir pour pouvoir raconter aux autres plus tard, sans toutefois oublier les questions que je voulais leur poser. Ma mère me chuchota de faire très attention avec le petit paquet dans ma poche. Elle me dit qu’il contenait un peu de tabac, tassé pour prendre le moins de place possible, quelques feuilles et un petit mot de ma sœur Bernadette. J’étais en émoi et j’avais du mal à tout saisir. Untel était mort ou mourant, les soldats étaient encore venus tout casser dans la maison, le fils d’untel avait été inculpé et je perdis le compte de ceux qui préparaient leur mariage. Il y avait beaucoup de grèves ici et l’Angleterre en était paralysée. On parlait de nous dans tous les journaux : l’épidémie de grippe, les bains forcés et la tonte obligatoire dans le bloc H. On avait dressé un sapin de Noël décoré des noms de tous les hommes-couvertures sur la Falls Road, à côté de Dunville Park.
Je gravai dans ma mémoire la moindre bribe d’information, tout le temps conscient de la poudrière dans ma poche gauche. Je passai rapidement en revue les événements du bloc H, leur disant d’aller en faire part au Bureau d’Information du Bloc H sur la Falls Road, surtout pour ce qui concernait Pee Wee O’Donnell, Liam Clarke et Sean Hughes, ainsi que les tabassages de la garde du matin. Les traces que je portais au visage étaient cachées par ma barbe, mais ma mère et ma sœur scrutaient ma tête et mes mains à la recherche de signes de mauvais traitements et me demandaient sans arrêt si j’étais sûr que j’allais bien. J’allumai une deuxième cigarette avant d’éteindre la première, déjà réhabitué à l’effet de la nicotine.
Les autres boxes se vidaient maintenant et j’entendais les gens se diriger vers la sortie derrière moi. Je ne me retournai pas. J’avais eu maintes fois l’occasion de voir tous ces visages tristes et piteux et n’avais aucune envie de renouveler l’expérience. Ma sœur était en train de me raconter les progrès de son petit garçon. Ma mère enchaîna avec un résumé du Republican News de la semaine précédente et mon père compléta.
Je leur donnai les quelques messages que les camarades m’avaient confiés pour leur famille. J’écoutai attentivement le récit de la manifestation. Mon père s’empressa de me parler de l’inquiétude et du soutien croissant qu’on exprimait à notre sujet en Amérique, en France et dans d’autres pays européens.
Nous continuâmes à parler et j’allumai une autre cigarette. Plus que douze minutes, remarquai-je, gardant l’œil sur la montre de mon père.
"Bonne Chance à vous tous et que Dieu vous bénisse !" cria un visiteur à la ronde en partant. Je commençai à me rendre compte que mon corps négligé et sale devait sentir mauvais, mais je fis comme si de rien n’était. Ma famille ne fit jamais de commentaire à ce sujet. Ma sœur me parlait maintenant de choses et d’autres chez moi, de gens qui étaient venus prendre des nouvelles de moi et de la santé de son mari. Ma mère s’apprêtait à me raconter la dernière émeute du coin lorsque le maton la coupa.
"Bon, ça y est. C’est fini", aboya-t-il par-dessus mon épaule et il tendit à ma mère le permis de visite, lui signifiant clairement qu’il fallait qu’ils partent tous les trois.
"Il reste encore huit minutes de ma demi-heure", lui dis-je froidement.
"Dommage. Va voir le directeur", fit-il en guise de réponse.
Ma mère et ma sœur me regardèrent avec inquiétude.
"Ce n’est pas grave, fiston. C’est seulement quelques minutes", concéda ma mère, redoutant ce qui m’arriverait après si je discutais. Je me levai de ma chaise, sachant que c’était foutu : la visite était terminée, quelles que soient mes réclamations. J’étais dégoûté et en colère mais je ne voulais pas inquiéter ma famille. On avait déjà largement assez d’ennuis comme ça. Ma mère et ma sœur se mirent à m’embrasser et de grosses larmes coulèrent sur leurs joues, semblant jaillir de nulle part. J’en étais atterré.
Les matons derrière moi me harcelèrent. "Circulez, circulez ! Bon, ça suffit !
Circulez !"
"Je vous verrai le mois prochain", leur dis-je, serrant brièvement la main de mon père, avant que les matons me poussent sans cérémonie vers la porte des prisonniers. J’aperçus quelques groupes épars serrés autour des dernières tables, chuchotant leurs précieuses nouvelles. Dans certains boxes, le maton semblait plaqué au visiteur. Il s’agissait ici de ces "visites en appel" si notoires : si un seul mot de la conversation n’était pas en rapport avec l’appel, le maton se précipitait pour terminer la visite sur le champ. Je regardai une dernière fois ma famille qui me faisait signe de la main et la porte me claqua brusquement au nez.
"Bon, toi !" brailla le maton, "attends là !"
Ce n’était pas mon escorte de tout à l’heure mais un salopard mal luné qui partit aussitôt émarger, suivant le protocole des fins de visite. Je restai là à trembler, quelque peu désarçonné et nauséeux de me trouver en dehors de ma petite cellule puante et glaciale. Le fait de côtoyer des gens joyeux et souriants, habillés de couleurs gaies, au visage compatissant, et le réconfort d’être enfin avec ma famille étaient paradoxalement difficiles à supporter pour mon corps affaibli et mon esprit torturé. Autour de moi, les matons s’affairaient en grand nombre. Il y en avait partout.
Sacré nom de Dieu ! Le petit paquet ! Je vérifiai avec ma main de l’autre côté de mon manteau, complètement paniqué. Il y était toujours ; je le sentais bien.
Je regardai furtivement autour de moi et quand il n’y eut pas de risque, je pris le paquet et le sortis. Un maton passa, me regardant de travers. Le paquet était comme une bombe dans ma main. Il était dissimulé dans mon poing. Je priai pour que mon escorte n’arrivât pas maintenant.
Personne. Il me fallait agir vite. En un éclair, je mis le paquet discrètement dans ma bouche. Il était assez petit et emballé dans un film plastique. Je scrutai mon reflet dans la fenêtre toute proche, mais vis avec satisfaction que ma barbe cachait tout. Il ne me restait plus qu’à suer à présent. D’autres matons passèrent et j’eus l’impression qu’ils me dévalisaient des yeux comme si j’avais été quelque chose d’extraordinaire. Mais je le suis, me dis-je, en me regardant de nouveau. En haut, mes cheveux poisseux et ébouriffés, plus bas, ma barbe sauvage comme un roncier et quelque part entre les deux apparaissait un visage de fantôme taillé à la serpe et vieilli avant l’heure. J’avais du mal à me reconnaître ; je me faisais peur. Mes joues creuses et mes yeux ternes appartenaient à d’autres tragédies, en d’autres lieux.
"Bon, toi ! Circule !" Le même aboiement interrompit mes pensées et mon auto-évaluation et me catapulta vers les cabanes à fouilles, dehors. Je passai devant la première et la deuxième, dans lesquelles les prisonniers de droit commun se faisaient fouiller. La troisième cabane nous était réservée. Elle était éloignée des autres, triste, délabrée et sinistre et servait exclusivement aux hommes-couvertures, prisonniers de guerre républicains. Derrière moi, me suivant de près, mon escorte aboya un nouvel ordre : "Bon, toi ! Rentre !"
J’arrivais à peine à déglutir avec mon paquet dans la bouche. Je percevais une grande hâte dans la voix de l’escorte ; il avait du mal à attendre que je fusse à l’intérieur. Il faillit me balancer dans la cabane, prenant tout juste le soin d’ouvrir la porte. Dedans, la cabane était tout aussi lugubre. Un groupe de matons se réchauffaient les mains au-dessus d’un poêle. Il faisait très froid dehors. Un manteau de neige glacée recouvrait encore le sol. Chaque maton me scruta longuement et je sentis la panique monter, menaçant de me paralyser. J’attendais les mots fatidiques - "Qu’est-ce que t’as dans la bouche ?" - mais ils n’arrivèrent pas. Pendant une éternité, je restai planté là, balayant la pièce de mes yeux. En tout cas, il faisait meilleur ici que dans l’espèce de tombe arctique et puante que je retrouverais plus tard. Il y avait quelques chaises disposées dans la pièce, et une bassine en plastique remplie de désinfectant bleu trônait sur le poêle avec des serviettes en papier. Par terre, incongrue, se trouvait une grande glace avec un manche en bois. Les matons rôdaient autour de moi, matraque lourde de menaces pendouillant à la hanche. Pourquoi me firent-ils penser soudain au cabinet dentaire ? Tous les dentistes que j’aie jamais connus étaient gentils !
"Bon, connard ! A poil !" cria une voix rauque.
Je me déshabillai et me tins nu devant eux. Ils restèrent à m’observer, gêné et humilié dans ma nudité. Je cherchai vainement une signification à cette attente. Ma plus grande préoccupation était ma gorge douloureusement sèche et la bombe potentielle que j’avais dans la bouche. Si on me faisait cracher ma contrebande...
Doux Jésus ! me dis-je, qu’est-ce qu’ils ne nous feraient pas pour mettre la main sur une lettre d’amour d’une petite amie de temps en temps. Ou sur quelques mots d’encouragement gribouilles par une mère inquiète ou alors sur un misérable petit paquet de tabac ! C’est juste pour nous harceler ! C’est juste pour nous torturer !
"Tourne-toi !" grogna un autre maton. Je fis un tour de 360° et la panique me prit en les voyant inspecter tous les coins et recoins de mon corps. J’attendais à tout instant l’ordre fatidique : "Ouvre la bouche !"
"Tourne-toi encore !" renchérit mon escorte.
Voilà, pensai-je, aujourd’hui ils mettent le paquet sur l’humiliation ! Si j’avais pu parler, je leur aurais dit qu’ils m’avaient déjà suffisamment humilié pour une journée et que, s’il y avait encore des humiliations, elles seraient pour eux. Ils m’avaient forcé à me dégrader et à me rabaisser. Assez !
Je restai silencieux et immobile. Il me menaça et brailla son ordre de nouveau.
Je fis comme si de rien n’était. On aurait dit qu’ils avaient reçu le toit sur la tête. Un moment, ils restèrent sans voix, bouche bée, totalement incrédules qu’on puisse désobéir. Ils étaient perplexes et leur colère croissante était presque palpable. Ça va barder, me dis-je, ça va barder !
"Contre le mur et écarte les jambes !" marmonna l’un d’eux finalement, rompant le long silence. Je tins bon, mais non sans inquiétude. Je tremblais et ce n’était pas à cause du froid ! J’étais pétrifié, terrorisé jusqu’à la limite de la panique. J’étais sûr que j’allais vomir par terre et éjecter ma précieuse bouchée.
Ils m’empoignèrent violemment les bras et me lancèrent contre le mur de bois. L’impact fit un bruit sourd. Ils me maintinrent ainsi en me tirant sur les bras comme s’ils voulaient me les arracher. Quelqu’un me donna un coup de poing dans les côtes et on s’acharna sur mes pieds nus pour me faire écarter les jambes. Une forte douleur déchira mes bras et tous les bleus de mon corps furent réveillés et ravivés. Ils continuèrent à me donner des coups de pied dans les chevilles avec leurs grosses bottes réglementaires, criant tout le temps leurs injures et braillant constamment leurs menaces.
Je sentis la glace froide qu’on me forçait entre les jambes. Ils me scrutaient l’anus et la glace leur permettait de voir de tous les côtés. Une main impudique me tripota et me fouilla l’anus mais cela ne leur suffit pas : ils me tapèrent sauvagement derrière les genoux, me forçant à m’accroupir et ils réinstallèrent la glace, avant de terminer par une ruade de coups de poing et de pied sur mon corps à vif. Je m’écroulai sur le sol humide et sale et tentai immédiatement de me relever, seulement à moitié conscient de la vive douleur qui me tranchait le corps. J’essayai désespérément d’avaler ma salive et faillis m’étouffer avec mon petit paquet. Pire, je faillis le cracher par terre. Je luttai de toutes mes forces pour ne pas tousser. J’attrapai rapidement mes vêtements et me rhabillai le plus vite possible, voulant à tout prix terminer avant que ces sadiques aient fini de se laver les mains dans la bassine de désinfectant.
"Peut-être ça t’aidera à retrouver ta langue !" beugla l’un d’eux, se séchant avec une serviette en papier. Doux Jésus, me dis-je, car toute référence à cet endroit du corps me faisait paniquer sérieusement ! je m’empressai de terminer. Une main derrière moi souleva mes cheveux pour vérifier qu’il n’y avait rien de dissimulé dans le pli de mes oreilles. Ma peur était si grande que je faillis transférer le petit paquet de ma bouche à une poche qu’ils ne fouilleraient plus. Mais, enfin, la main retourna à une place libre près du désinfectant.
Tout déglingué et conscient maintenant de ma douleur, je me dirigeai péniblement vers la porte, mon accompagnateur-beugler à mes trousses. Je franchis le seuil, attendant à tout moment "Où tu vas ? On n’a pas fini avec toi !", mais rien ne se passa.
J’avais la gorge en feu. Je sortis et l’air frais me rafraîchit et me raviva un peu. A proximité se tenaient des camarades des autres blocs, pâles comme des fantômes, blancs comme la neige sous leurs pieds, qui attendaient leur tour. Ils avaient dû entendre les cris et les coups et ils savaient ce qui les attendait.
"Ça va, Bobby ?" demanda l’un d’eux.
Je ne pus répondre. Je hochai la tête en signe de reconnaissance et de compassion, pensant à leur sort et me consolant du fait que le pire était passé, au moins pour moi. J’avançai péniblement vers le bloc H. Il n’y avait pas de fourgon en vue et j’étais content de pouvoir marcher un peu et de respirer à pleins poumons l’air frais et propre. Le premier des obstacles à négocier avec mon petit paquet était passé, et tant mieux, car il était de loin le pire.
La route devant moi était large et perdue sous une couverture blanche. La neige semblait suspendue aux sombres boiseries grises et accrochée aux kilomètres d’infâmes barbelés enchevêtrés. Partout autour, s’étendaient grillages et fils de fer barbelés. Il y en avait toute une jungle, interrompue à intervalles réguliers par des miradors camouflés et sinistres d’où les soldats britanniques armés surveillaient le camp de périmètre en périmètre. Cela me rappela un extrait de film que j’avais vu plus jeune au sujet des camps de concentration nazis en hiver. Je me souvins d’avoir été choqué malgré mon jeune âge, mais en même temps sécurisé, blotti dans mon fauteuil près du feu à la maison, pensant qu’il s’agissait là de terreurs du passé qui ne devaient plus être ni ne seraient tolérées en aucun pays. Surtout pas en Irlande. Surtout pas à mon encontre.
Je repensai aux familles discutant à voix basse autour des tables de la salle des
visites, les visages des mères marqués par leur chagrin, les pères incapables de s’exprimer et les enfants inconsolables, pleurant quand les monstres en uniforme noir poussaient leur papa vers la sortie. Je repensai à ces mêmes monstres noirs sans cœur qui restaient collés à votre épaule pour écouter chaque syllabe de chaque mot, qui faisaient attendre les visiteurs debout en rang pendant des heures pour un parloir d’une demi-heure, les poussant de porte en porte, de fouille humiliante en fouille humiliante, les traitant comme des bêtes.
Ils méprisaient nos proches autant qu’ils nous méprisaient et qu’ils nous haïssaient nous-mêmes. Ils les insultaient, les harcelaient et leur brisaient le cœur en torturant leurs fils et leurs filles. J’étais naïf quand j’étais plus jeune. Me voilà ici maintenant sur la route du retour vers une tombe immonde en béton, en pleine lutte pour ma survie. Une lutte pour mon droit à être reconnu comme prisonnier politique de guerre, un droit pour lequel je ne cesserai jamais de lutter.
Devant moi, à ma droite, s’élevait le bloc H, noir et sinistre. J’attendis que la porte s’ouvre – la porte de l’enfer. Tout était silencieux : pas le moindre soupir de vent, pas le moindre chant d’oiseau. D’un autre côté, il n’y avait pas lieu de chanter à Belsen non plus, me dis-je, franchissant la porte de l’enfer. Je traversai la cour jusqu’à l’entrée principale du bloc H. A gauche, dans l’autre aile, des jeunes se tenaient à la fenêtre. La lumière brillait dans quelques cellules, les autres étaient dans le noir complet, si bien que les cellules éclairées ressemblaient à des cavernes habitées par des hommes préhistoriques, avec leur couverture de guenilles. Ils faisaient peur à voir, visages pâles et longues barbes derrière les barreaux de béton. Dans le noir, je distinguai des ombres ici et là.
"Ça va, Bobby ?" cria un des jeunes. Etant incapable de répondre, je fis signe de la main, un peu gêné.
"C’est pour bientôt, sûr !" cria un autre et un groupe se mit à plaisanter tandis que de nouvelles têtes vinrent se montrer aux fenêtres. Je comparai avec mon aile, le côté droit du H. Ici, pas de fenêtres et pas la moindre lueur à discerner. Toute la longueur était comme ensevelie dans les tôles ondulées et les planches de bois. C’était l’occultation totale : aucun rayon de lumière ne passait et il était impossible de voir dehors. Par bonheur, ils n’avaient pas encore fait mon côté de l’aile, pensai-je, mais ils y arriveraient bientôt !
J’entrai dans le bloc et attendis devant la grille de fer. Mon escorte aboyeur disparut. On me fit passer d’une grille à la suivante jusqu’à ce qu’arrivât A pour m’admettre dans mon aile. Un bruit aigu et plaintif se réverbérait dans les couloirs et m’annonçait la présence de l’aspirateur en train de débarrasser les dernières flaques d’urine. Le chariot-repas était garé devant la porte de la cellule à fouilles. En passant, je remarquai le film huileux à la surface d’une tasse de thé froid et la montagne de tartines rassies et racornies. Dans les assiettes, la nourriture attendait : un morceau de viande pas tout à fait entouré d’une vingtaine de haricots.
Je franchis le seuil de la cellule à fouilles et toute idée de nourriture me quitta subitement en voyant C et D. Pendant le trajet entre la salle des visites et ici, marchant devant mon escorte, j’avais pu tourner le petit paquet dans ma bouche et déglutir, mais à présent j’étais assoiffé et ma gorge était sèche. Je commençai à me déshabiller. Encore deux minutes et je serais en sécurité – deux petites minutes ! J’enlevai mon pantalon et me couvris d’une serviette. Aussitôt, D me lança : "Lâche la serviette et tourne-toi !" J’attendis qu’on m’ordonne de me baisser. Je laissai tomber ma serviette et me tournai mais, à ma grande surprise, il ne se produisit rien. Pas d’ordre, pas de coup, même pas d’insulte. Je repris hâtivement ma serviette et l’attachai autour de ma taille, tout en me dirigeant vers la porte de la cellule. Ça y est, me dis-je, presque jubilant, j’y suis à deux doigts près maintenant ! Je franchis le seuil, attendant toujours qu’on me rappelle pour m’arracher mon trésor, mais il n’en fut rien. Quelle chance ! J’avais du mal à y croire ! A ricana et me lança : "Rentre vite dans ta cellule avec ton repas avant qu’il ne refroidisse !" et C et D trouvèrent cela très amusant. Les plantons autour s’écroulèrent de rire. Je demeurai impassible et pris mon assiette et ma tasse avec leur maigre contenu.
Je continuai le long du couloir, presque sec maintenant par endroits. Le maton avait pratiquement fini avec l’aspirateur et il se trouvait à l’autre bout de l’aile. Le bruit était abrutissant mais j’avais le cœur en joie. J’avais hâte de me retrouver seul dans ma cellule, même si l’idée en était pénible, pour pouvoir cracher enfin ma contrebande. A m’ouvrit la porte et je me retrouvai soudain dans la pénombre de mon enfer glacial. La porte claqua derrière moi et ce fut le noir complet. Victoire !
J’aurais aimé leur dire que j’avais eu le dessus, que j’avais gagné, surtout à ce salaud de C. J’arrivais à peine à le croire !
Hourra !
Je posai mon repas froid par terre et enlevai le petit paquet de ma bouche.
Quel soulagement ! Il était mouillé et je le séchai avec le bout de ma serviette. Je ne pus l’examiner dans le noir. Je le ferais plus tard. Je m’enveloppai dans mes trois couvertures et dissimulai le petit paquet dans un des plis autour de ma taille. Tout autour de moi régnait un brouhaha de lourdes portes de cellule qui claquaient et de couverts qui circulaient pendant la distribution des repas. En arrière-plan, l’aspirateur geignait sa complainte ; ils le laisseraient en marche inutilement, me dis-je, rien que pour essayer de nous rendre fous. Je me demandai s’il y avait eu d’autres changements pendant mon absence. Je jetai le thé froid par la fenêtre et regardai rapidement dans les coins les tas d’ordures, juste au cas où un rat téméraire serait passé par là quand la cellule était inoccupée. Ça n’aurait pas été la première fois que cela m’arrivait ; une fois, un rat était même venu la nuit. Je m’assis sur le matelas et me mis à manger, pensant au point fort du mois que je venais de vivre, mon parloir.
Je terminai mon maigre repas froid et posai les couverts en plastique à côté de la porte. Me revoilà en pleine lutte pour la survie, me dis-je, frissonnant de ce froid qui mordait de plus en plus fort et me levant pour reprendre, là où je l’avais interrompue mon interminable promenade, vers nulle part, dans le noir. Je vérifiai que mon précieux petit paquet était sain et sauf et je me réjouis, satisfait d’avoir réussi. Je n’arrivais pas à comprendre pourquoi C et D n’avaient pas essayé de me faire baisser de force pour me fouiller le corps à mon retour. Ils semblaient particulièrement pressés de m’enfermer dans ma cellule et d’être débarrassés de moi.
II faisait terriblement froid par terre et je m’arrêtai pour étaler une couverture sur le sol avant de poursuivre ma promenade sans fin. Tout était encore blanc dehors et la neige se remit à tomber lentement. De petits flocons rentrèrent par la fenêtre et semblèrent circuler au ralenti avant de se poser sur le béton. Et toujours le bruit insupportable de l’aspirateur qu’on n’avait pas encore daigné éteindre. Je tentai de passer outre ce harcèlement par la réflexion, pour me rendre ainsi imperméable au bruit. J’aurais aimé faire part de ma victoire à Sean, mais avec ce boucan infernal en continu ce n’était même pas la peine d’y penser. Je pensai à tout le Scéal que j’avais entendu au parloir et que je raconterais aux camarades plus tard. L’heure du souper viendrait vite, comme le thé avait été servi très tard, mais il n’y avait sans doute pas de quoi s’exciter : il consisterait probablement en une tasse de thé tiède et du pain avec de la margarine. En fait, tout ce que cela signifiait pour nous était que le moment de la fermeture des cellules pour la nuit approchait et que les matons rentreraient chez eux. Personne ne circulerait plus avant demain matin.
Je regardai par la fenêtre, me disant que je pourrais me distraire en observant les rats batifoler dans la cour, plus tard, quand tout serait vraiment calme. Il ne me serait pas possible de me coucher tôt ce soir - le froid ne me permettrait pas de dormir. J’étais fatigué ; à vrai dire, j’étais épuisé, mais la journée était loin d’être terminée. Je me demandai comment allaient les jeunes sur les planches. Peut-être que quelqu’un d’un autre bloc ou aile en était revenu aujourd’hui et qu’il y aurait des nouvelles plus tard. La communication à travers toute la prison commencerait après le départ des matons.
J’entendis un bruit sourd de la cellule d’en face. Avec le bourdonnement infernal, c’était à peine audible. On ramassait les couverts, sans doute.
Ma porte s’ouvrit et on alluma. Le planton prit les assiettes et claqua la porte derrière lui. Momentanément aveuglé par la lumière intense, je ne vis pas les matons. Soudain, mes yeux agressés purent de nouveau reconnaître mon environnement misérable. Le paysage familier d’ordures empilées dans les coins était dérangé par des carrés blancs de pain rassis. Je remarquai des traces bleutées sur les tartines et allai en inspecter une de plus près : c’était de la moisissure. Heureusement que je n’en avais pas mangé, me dis-je, examinant les autres morceaux et voyant qu’ils étaient tous pareils. Et puis je me rendis compte de ce qui s’était produit et de la raison pour laquelle C et D ne m’avaient pas fouillé et pourquoi ils semblaient si pressés de me voir regagner ma cellule pour manger dans le noir. J’étais trop occupé à penser à ma bouche pleine de contrebande pour scruter le pain sur mon assiette en retournant dans ma cellule.
La machine à nettoyer continuait à geindre en fond sonore. La lumière de ma cellule était très vive et j’avais mal aux yeux. Je sentais les signes précurseurs d’une migraine tant redoutée se développer dans ma tête. Je continuai à faire les cent pas et me mis à respirer profondément, remplissant mes poumons d’air frais à la fenêtre pour tenter d’évacuer la sensation de nausée étouffante qui me gagnait. Le bruit de la machine me dérangeait de plus en plus. Dehors, la température baissait rapidement et la couche de glace sur le fil s’épaississait. Je sortis mon petit paquet et y jetai un coup d’œil. Il était intact. Je voyais le contenu à travers le film en plastique : le petit mot, le papier à cigarette et le tabac brun. Je ne pouvais pas l’ouvrir maintenant, alors je le remis dans le pli de ma couverture pour plus tard. Mais je les avais ! Un petit mot de ma sœur, du papier à cigarette et quelques grammes de tabac et j’étais plus fort qu’un roi !
Qu’est-ce que ce serait si on m’ouvrait la porte maintenant et me rendait ma liberté ? Je n’arriverais pas à le supporter. Bon Dieu ! Je pouvais tout juste assurer le temps d’une visite ! Je ne sais pas dans quel état je serais si on me relâchait de cette torture. J’arrivais à apprécier de toutes petites choses qui semblaient sans importance alors qu’en d’autres temps je ne les aurais probablement même pas remarquées. Quand avais-je bien mangé pour la dernière fois ? Etonnant comme on peut s’habituer à tout - surtout quand on crève de faim, me dis-je, pensant à l’été quand les matons et plantons avaient mis des asticots dans notre nourriture. Tout ce que nous pouvions faire était de les repêcher, avant de manger notre repas, comme si de rien n’était ! C’était ça ou mourir de faim !
La plainte de l’aspirateur s’arrêta tout d’un coup et un terrible silence irréel descendit sur la prison. Le long du couloir j’entendis résonner les pas du maton qui venait de débrancher la machine. Je m’approchai du petit trou dans la porte et vis que c’était A. Il continua vers le bureau. Je distinguai vaguement le bruit de la télévision mais ne pus comprendre de quoi il s’agissait. Les plantons discutaient et s’amusaient entre eux. J’entendis C crier : "Bon !" et le tapage des plantons fut immédiatement remplacé par le bruit du chariot de couverts.
"Casse-croûte !" crièrent quelques camarades en gaélique. Les portes des cellules s’ouvraient et se refermaient. La procession passa devant ma cellule de l’autre côté du couloir et poursuivit sa tournée. Un des jeunes à quelques cellules de la mienne se mit à chanter doucement et un semblant de vie fut insufflé dans l’aile. Enfin le chariot arriva à ma porte. Quand elle s’ouvrit, je vis l’assemblée habituelle de visages haïs m’observant, nonchalants. Un planton me tendit une tasse de thé et une tartine pliée en deux. Je vis D ricaner en me voyant examiner le pain de peur qu’il soit moisi. Il ne l’était pas.
La porte claqua et je me repliai vers mon pauvre matelas, sentant une chaleur inhabituelle et regardant incrédule la vapeur se dégager de mon thé. Il était chaud !
Je n’en revenais pas ! Je m’assis pour le goûter, méfiant. Il était totalement insipide, de l’eau chaude colorée, mais je me résignai quand même à le boire. C’était chaud et c’était le principal par une nuit pareille. Je mangeai la tartine de pain et bus le thé à petites gorgées. Bientôt l’heure des verrous, me dis-je, savourant la pensée de mon précieux petit paquet et anticipant la cigarette que j’allais fumer.
Ma mère, mon père et ma sœur seraient à la maison maintenant et ne devaient pas avoir une grande forme. Après un si long voyage, une si dure journée et après avoir vécu la rude épreuve de voir la détérioration de mon état, ils s’inquiétaient certainement à mon sujet. Je pensai aux familles qui avaient deux ou trois fils en taule et à celles dont les fils étaient hommes-couvertures, ou encore aux familles dont les filles protestaient à Armagh. Ça devait être vraiment très dur pour toutes ces familles. Que de cœurs brisés et de chagrin ! C’est tout ce qu’il y avait dans ces atroces trous d’enfer !
Je renonçai à boire ce qui restait de mon thé fadasse. Il refroidissait et devenait écœurant. Je me levai et le jetai par la fenêtre sur la neige, d’où un petit nuage de vapeur s’éleva comme le liquide s’enterrait dans la blancheur éclatante.
Ensuite, je posai ma tasse vide près de la porte et continuai à tourner en rond, quand des bruits de tasses et de portes résonnèrent de nouveau.
"Ramasse-tasses !" cria quelqu’un.
J’avais de plus en plus froid aux pieds et essayai vainement de me les réchauffer en les tapant par terre sur la couverture. Le froid allait mordre très fort cette nuit, c’était sûr. Le chanteur à l’autre bout de l’aile se mit à fredonner une nouvelle chanson. Il est vrai qu’il n’y avait aucune raison de chanter mais il fallait bien trouver une façon ou une autre de rompre la monotonie. Je m’ennuyais, moi aussi, mais dans mon cas c’était plutôt de l’impatience qui me travaillait : mon petit paquet brûlait dans le pli de ma couverture.
On ouvrit ma porte et on enleva ma tasse. Je ne tournai même pas la tête. On la referma bruyamment et j’entendis les matons et les plantons poursuivre leur procession jusqu’à l’autre bout de l’aile. Je repris place sur le matelas pour tenter de me reposer. Ils étaient huit fumeurs de l’autre côté de l’aile et neuf de ce côté-ci, mais trois étaient encore aux planches, alors ça nous faisait un total de quatorze fumeurs avec moi. J’aurais assez de tabac pour une cigarette chacun ce soir et il en resterait peut-être un peu. Il faudrait installer une ligne à travers le couloir pour faire parvenir les cigarettes aux camarades d’en face. Il n’était pas possible d’utiliser les fenêtres de ce côté-là pour faire passer nos petites choses avec ce système parce qu’elles étaient bouchées. Mais les camarades avaient pratiqué de petits trous dans les murs ou agrandi les trous des canalisations afin de pouvoir transmettre ce qu’il fallait. Ainsi feraient-ils passer les cigarettes et du feu le long du couloir. Le feu en question viendrait d’un morceau de verre, d’un petit silex et d’une toute petite boule de coton. On fabriquerait une mèche et la matière incandescente serait prudemment passée de cellule en cellule jusqu’au bout. Ce serait difficile et dangereux, comme toujours. Les matons savaient que cela se faisait et ils redoublaient de vigilance, faisant souvent leur tournée sans bruit au milieu de la nuit. B serait là ce soir dans l’équipe de nuit, alors on serait obligé de multiplier les précautions. Je vérifiai que la ligne tressée plus tôt était encore à sa place. Elle y était.
Sean frappa sur le mur.
"Approche-toi du tuyau", lui dis-je en me baissant pour coller ma tête contre le mur près des tuyaux. Ils ne dégageaient pas beaucoup de chaleur et le peu qu’il y avait sortait directement par la fenêtre ouverte et se perdait dans la nuit froide et noire.
"Eh bien alors, Bobby", dit Sean par le petit trou, sa voix trahissant son interrogation.
"Va h-an mhaith, Sean", répondis-je, ravi. "J’ai réussi à rapporter l’autre".
Il me comprit tout de suite.
"Maith thù", dit-il et je commençai à lui raconter mon parloir et à le mettre au courant des derniers événements avec les fouilles et tout le reste. Je sentais son excitation monter dans ses questions quand je lui parlai de l’énorme foule à la manifestation et de la grande offensive dans l’effort de guerre. On pouvait dire que les choses se passaient mieux que jamais jusque-là. Le gouvernement britannique avait complètement échoué dans ses tentatives de criminaliser le Mouvement Républicain et maintenant tout le monde se rendait parfaitement compte des raisons pour lesquelles on torturait dans le bloc H. Je continuai ma conversation avec Sean pendant quelque temps, jusqu’à ce que ma position inconfortable me provoque des crampes. Alors, je décidai de me remettre à ma promenade sans fin. Mes pieds étaient engourdis par le froid. Sean le comprit. C’était pareil pour lui. Je lui dis que je l’appellerais plus tard et nous nous levâmes tous les deux de notre côté du mur, soulageant ainsi nos membres endormis, pour démarrer une énième série de cent pas.
Les matons commencèrent à fermer les portes et les grilles en préparation de l’heure du verrouillage total nocturne. Les plantons avaient quitté l’aile et regagné leurs dortoirs, deux grandes pièces à proximité de notre aile équipées d’objets de luxe comme la radio, la télévision, une chaîne hi-fi et plein d’autres choses : prix pour la sale besogne qu’ils exécutaient quotidiennement avec beaucoup de zèle.
Quelques-uns ne nous dérangeaient pas trop, mais il y en avait très peu de cette sorte et ils étaient difficiles à trouver.
A, C et D rôdaient à l’autre bout de l’aile, attendant l’heure du verrouillage en discutant et en rigolant entre eux. Ça ne devrait plus tarder, me dis-je, quinze minutes maximum. Il y aurait alors deux appels, deux "comptages" comme on dit, un par les matons partants, A et compagnie, et le deuxième par l’équipe de nuit qui arriverait incessamment. Dans l’équipe de nuit, il n’y avait que quatre matons.
Parfois ils regardaient la télévision ou jouaient aux cartes ou alors ils se saoulaient à mort et nous laissaient tranquilles. Mais la plupart du temps il y avait des ennuis, et plus encore si quelqu’un comme B était de garde. B était de garde cette nuit !
Je m’ennuyais à tourner en rond et me décidai alors à m’asseoir pour risquer un coup d’œil à mon petit paquet. Il y avait peu de chances qu’on vienne me fouiller maintenant, mais le danger était toujours là et il nous fallait être prudents à tout moment. Ce serait terrible de me faire prendre maintenant après tout ce que j’avais subi aujourd’hui, mais j’étais très impatient de lire mon petit mot. Je sortis donc le trésor et commençai à éplucher le film plastique lisse et brillant jusqu’au papier. Mais avant de lire la lettre de ma sœur, je retendis le film autour du contenu du petit paquet, au cas où. Je restai silencieux et immobile pendant quelques minutes, absorbé par chaque mot de son écriture. Quand j’eus fini, je la relus aussitôt. Cela faisait vraiment du bien d’avoir de ses nouvelles. Il me semblait que ça faisait une éternité depuis que nous ne nous étions vus mais elle avait l’air en forme. Elle s’inquiétait surtout de savoir comment j’allais et elle demandait des nouvelles de camarades qu’elle connaissait. J’essaierais de lui répondre dès que possible. Nous avions pour tout outil d’écriture un misérable crayon et une recharge de stylo à bille qui servaient en permanence dans l’aile, passant de cellule en cellule de part et d’autre du couloir et couvrant de leur passage des feuilles de PQ (papier hygiénique) pour les petits mots doux aux épouses inquiètes, aux mères et aux copines ; pour les lettres aux journaux et au Bureau d’Information du Bloc H, leur racontant les passages à tabac et autres horreurs quotidiennes. Il faudrait que j’attende mon tour pour utiliser le crayon ou la recharge.
Je déchirai la lettre de ma sœur en mille morceaux avant de la jeter par la fenêtre et je regardai longtemps jusqu’à ce que les petits bouts de papier fussent autant de flocons de neige. A et compagnie étaient toujours en place à la grille, à en juger par les bruits de clés et les mots échangés que j’entendais de temps en temps. Je me décidai à tenter ma chance encore une fois en ouvrant le petit paquet, cette fois pour rouler les cigarettes afin qu’elles soient prêtes pour les camarades lorsque la ligne serait installée. J’enlevai donc le film plastique pour la deuxième fois et pris le petit morceau de tabac, bien comprimé et très frais pour me faciliter la tâche. Je commençai à écarter et à détasser les brins de tabacs enchevêtrés, démêlant les fils pour pouvoir rouler les cigarettes. Le petit morceau devint bientôt un petit tas filandreux. L’arôme qui en échappait contrastait agréablement avec les habituels relents immondes qui remplissaient ma cellule. Délicatement, je décollai les feuilles les unes des autres. Il y en avait suffisamment pour nos besoins et quelques-unes en plus. Quand tout cela fut prêt, je me mis à les rouler, les oreilles dressées pour entendre le moindre bruit de clés ou de pas, savourant d’avance la fumée de la cigarette que j’étais en train de fabriquer.
En voilà cinq de faites ! Je commençai la sixième, pensant à l’inestimable valeur d’une misérable cigarette et à quel point elle pouvait nous remonter le moral, même à ceux qui ne fumaient pas. D’une façon ou d’une autre, tout le monde se rendait compte qu’une cigarette équivalait à une victoire sur les salopards comme A et C, et cela était source d’une grande satisfaction. C’était vraiment énorme pour nous. Je pris une autre feuille pour commencer la septième cigarette...
"Matons dans le rond."
J’entendis un tintement de clés et en un éclair j’étalai ma couverture sur la contrebande au moment même où ma porte s’ouvrit brusquement. J’étais complètement paniqué mais j’essayai de garder mon sang-froid. A regarda brièvement dans ma cellule.
"Un !" dit-il et C claqua la porte.
"Comptage !" criai-je à tue-tête et j’entendis la terreur dans ma voix.
"Deux" fit la voix de A et la porte de Sean claqua.
"Quatre. Six. Huit" continuèrent-ils le long du couloir.
Une sueur froide me glaça le corps. Il s’en était fallu de peu, me dis-je en regardant la couverture. Une cigarette dépassait de la moitié de sa longueur mais ils ne l’avaient pas vue. Je restai figé, assis sur le matelas, jusqu’à la fin de la vérification.
"Vingt-deux, vingt-quatre, vingt-six", compta A.
"Matons hors du rond", cria un des jeunes pour nous annoncer que le danger était passé. Je repris mes esprits et ma contrebande et je recommençai à rouler des cigarettes. Je pensai pouvoir finir avant le prochain comptage, qui serait aussi le dernier pour la nuit. Et puis, de toute façon, on entendrait B bien avant qu’il arrive dans l’aile car il serait certainement ivre. Je continuai à rouler jusqu’à ce qu’il ne restât plus de tabac et ensuite je partageai les cigarettes en deux paquets : un avec les cigarettes pour les gars d’en face et l’autre avec une cigarette pour chacun de ce côté.
Je pris la longue ligne que j’avais tressée plus tôt et y attachai les deux paquets, ainsi qu’un morceau de pain dur et moisi en guise de poids, avant de frapper sur le mur pour appeler Sean.
"Salut", cria-t-il.
"Tends la main par la fenêtre", lui dis-je et je me mis à balancer la ligne vers lui. Lorsqu’il l’attrapa, je lui expliquai le contenu des deux paquets et lui dis de faire passer la ligne et le paquet le long du couloir jusqu’au gars qui devait l’envoyer de l’autre côté, pour qu’il puisse préparer ses affaires. Sean frappa sur le mur de son voisin et organisa la suite. Je plaçai ma cigarette sous l’oreiller, avec une autre à partager entre Sean et moi.
Le grincement de la grille et un bruit de clés rapidement suivis de pas chancelants, et un barrage d’injures annoncèrent l’arrivée de B. Le bruit s’intensifia et le dernier comptage de la journée commença de l’autre côté de l’aile, accompagné de l’habituelle cacophonie de portes qui claquent. Ils vérifièrent toutes les cellules une à une et arrivèrent enfin à la mienne. Ma porte s’ouvrit et B passa sa tête pour me regarder. Il tenait à peine debout et il était très peu probable qu’il fût en mesure de compter. Il tituba bêtement avant de refermer la porte.
"Matons hors du rond", entendit-on, le signal habituel. Personne n’avait pris la peine d’annoncer leur arrivée, tellement elle fut bruyante. Le silence regagna l’aile et un camarade à l’autre bout dit à la ronde : "Bon, les gars. On va dire le rosaire maintenant.
Qui dira la première dizaine ?"
"Moi, je veux bien", cria quelqu’un. "Et pour la deuxième ?"
"Moi", dit Sean et trois autres gars se portèrent volontaires pour dire les dernières dizaines.
"Ce soir, c’est le rosaire triste", précisa le premier en faisant le signe de la croix pour commencer les prières. Le rosaire poursuivit son cours le long du couloir, chacun répondant à travers sa porte. Au milieu de la troisième dizaine un maton se mit à taper sur les grilles avec sa matraque. Nous continuâmes comme si de rien n’était et le maton finit par se lasser et partit, comme d’habitude. A la fin du rosaire, l’aile était en ébullition et les conversations allaient bon train.
Les gars à l’autre bout décidèrent de lancer la ligne avant que B ou un autre maton ne vînt rôder.
"Hé, Bobby, tu veux bien faire le guet ?" cria l’un d’eux.
"Oui, d’accord", répondis-je et je m’installai devant le petit trou.
Ce serait une opération délicate.
"Hé, Sean, tu vois quelque chose par ta porte ?"demanda le même.
"Non, rien du tout", répondit Sean.
"Moi, si", intervint un des jeunes du fond.
"Tu vois la porte de Gérard ?"
"Sans problème", fit-il aussitôt.
"Maith thù", dit celui qui s’apprêtait à exécuter l’opération. "Tu pourras nous guider."
"T’es là, Bobby ?" vérifia un autre pour être tout à fait sûr. Si on apercevait la ligne ce serait une catastrophe.
"Oui. Je suis là", répondis-je, gardant l’œil collé au petit trou et osant à peine en cligner. La longue ligne serait envoyée sous la porte au moyen d’un bouton, comme dans un jeu de puce. L’homme en face tâterait sous sa porte avec une bande de papier jusqu’à ce qu’il le sente. A ce moment-là, il glisserait le papier sous le bouton pour pouvoir l’attraper. Et, ensuite, on commencerait nos échanges de lettres, cigarettes et toutes sortes de choses ! On accrocherait les cigarettes à la ligne à la queue-leu-leu et elles traverseraient le couloir comme un long train.
"T’es prêt, Gérard ?" demanda le "tireur".
"Vas-y, Pat", vint tout de suite la réponse. Aussitôt on entendit le bouton tomber par terre et rouler sur le béton.
"Tu le vois, Brian ?" s’enquit le tireur, essayant de guider les autres.
"Trop loin à gauche," avisa celui-ci, "recommence."
On rentra la ligne et on refit une tentative. Le crac ! de l’impact du bouton retentit comme une balle. Toute l’aile était silencieuse, chaque oreille tendue pour déceler le moindre bruit.
"Et cette fois-là, Brian ?"
"Trop court", répondit-il d’une voix éprouvée.
De nouveau on ramena la ligne. Le troisième coup fut fort et rebondit aussitôt sur la porte d’en face. Un quatrième essai brisa le silence.
"Et là ?" interrogea nerveusement le tireur. Tout le monde écoutait et anticipait, retenant son souffle.
"Oui ! Laisse-le comme ça !" Cette fois, c’était bon.
"Avance ton bout de papier, Gérard", dirigea celui qui avait la meilleure vue du couloir.
Il y eut un bruissement.
"Un peu plus à gauche !" recommanda-t-il. Encore quelques pouces. Voilà.
Laisse-le là. Maintenant, avance le plus loin possible. Non, c’est raté. Essaie encore.
Mon œil commençait à me faire mal, écrasé contre le petit trou. Le silence régnait. En dehors de l’équipe de travail, personne n’osait parler. On entendit un nouveau froissement de papier.
"Avance-le maintenant, Gérard. Tout doux, tout doux. Voilà, c’est ça !
Attention, doucement ! Maith thù, Gerard. Ca y est. Le bouton est en plein sur le papier. Ramène-le doucement vers toi ! Vas-y ! Vas-y ! Attention ! Pas trop vite !"
"Je l’ai !" s’éleva enfin le cri de victoire.
"Ça va là-haut, Bobby ?"
"Oui, je crois, Pat."
"Tire la ligne vers toi, Gérard", reprit Pat, "mais pas trop fort."
Les cigarettes coulèrent sous la porte du tireur et traversèrent le couloir en file indienne.
"Doucement, doucement ! Sinon elles se coinceront sous la porte."
Toutes les cigarettes passèrent sous la porte de Gérard, à part la dernière qui s’emmêla dans la ligne.
"Ne tire pas dessus", dit Brian. "Donne plutôt un petit coup de travers sur la ligne. Oui, comme ça. Voilà, elle s’est démêlée maintenant. Essaie encore de la tirer vers toi", conseilla-t-il.
Je perçus soudain une ombre bouger et le bruit d’une botte.
"Maton dans le rond !" criai-je alors que sa présence se confirmait dans mon champ de vision.
"Rentre-le, Gérard, vas-y !" hurla Brian et il y eut un bruit violent du maton qui essayait d’arracher la ligne. Puis ce fut le silence et enfin le bruit des pas du maton qui s’atténuèrent. Je le vis brièvement lorsqu’il passa devant ma cellule.
C’était un étranger.
"Ça va, Gérard ?" demanda Pat.
"Ça va, Pat. J’ai réussi à rentrer toutes les clopes mais il a chopé le bouton."
Au moins les cigarettes étaient saines et sauves ! La perte du bouton n’était pas une catastrophe mais une perte, tout de même, dans ces conditions.
"Okay, les mecs. Vide-chiottes maintenant", dit le planton. Nous commençâmes à filtrer l’urine puante sous les portes. C’était ça ou en laisser le soin aux matons à la première lueur du lendemain. Ce n’est pas très agréable de se faire réveiller par le contenu d’un infâme pot d’urine ! Il ne restait plus grand chose dans les pots, comme on les avait vidés plus tôt. Je m’affairai au pied de ma porte pour pousser un maximum de liquide fétide dans le couloir et ensuite j’allai m’asseoir sur le matelas. J’étais complètement essoufflé et haletant ; un bon indicateur de mon lamentable état de santé général, me dis-je, si je m’épuise aussi facilement. Je m’installai pour attendre la mèche qui me fournirait du feu. Une chance pour les clopes, pensai-je. Si le maton était arrivé quelques instants plus tôt, il aurait tout attrapé. Sean frappa sur le mur.
"Bon, Bobby, t’es prêt ? Voilà l’effort."
Je compris tout de suite et tendis ma main par la fenêtre pour recevoir la ligne au bout de laquelle se balançait la mèche improvisée. Je la rentrai et allumai ma cigarette.
"A toi, Sean", dis-je.
"Vas-y", répondit-il et je lui balançai la ligne. Il frappa sur l’autre mur pour faire passer la mèche dans l’autre sens et je m’allongeai sur le matelas, fumant enfin cette cigarette tant attendue ! C’était un grand soulagement et très réconfortant de savourer quelque chose sans craindre l’interruption des matons. Les clés ne restaient pas dans le bloc H mais étaient gardées ailleurs. Les gars des autres ailes verraient tout de suite tout mouvement suspect de matons inconnus avec des clés et ils donneraient l’alerte.
"Matons dans la cour." L’avertissement fit sursauter tout le monde mais il n’y avait pas vraiment lieu de s’inquiéter, sauf si quelqu’un était en train de balancer quelque chose dans une autre cellule. Les matons se trouvaient au fond de la cour, en train d’injurier les prisonniers de là-bas. Je finis ma cigarette et me levai pour aller voir qui c’était. Ils avancèrent en titubant. B était en train de hurler et de postillonner à tout-va. Il était accompagné de deux autres matons et ils semblaient rivaliser d’obscénités. Ils traversèrent la cour et poursuivirent leur chemin en direction de l’autre aile.
Le O.C demanda l’attention de tous, et le monde se tut immédiatement lorsqu’il demanda si quelqu’un avait vu ou entendu ce qui s’était produit plus tôt, pendant les incidents concernant le vide-chiottes ou avec Pee Wee O’Donnell. Je lui expliquai ce que j’avais entendu et vu par la porte. Plusieurs autres témoins ajoutèrent des détails et des bribes. Il demanda ensuite la description des blessures reçues pendant la faction du matin. Les témoignages relatant coups et sang fusèrent de toutes les cellules.
"Bon", dit-il quand tout le monde eut fini, "autre chose ?" Comme ça tout fut enregistré et diligemment noté pour le Centre d’Information à l’extérieur.
"T’as du Scéal , Bobby ?" demandèrent des gars. Il me fallut bien cinq minutes
pour raconter tout ce que j’avais entendu.
"Je crois que c’est à peu près tout", conclus-je lorsque j’eus vidé mon sac et crié toutes les nouvelles.
Quand la joyeuse excitation générale que les nouvelles fraîches avaient provoquée finit de s’exprimer, les conversations plus confidentielles reprirent bon train pour en disséquer les détails aux fenêtres, portes et tuyaux. Le Scéal était bon et, pour nous, c’était énorme. Des informations arrivaient aussi des deux autres ailes du bloc. Un prisonnier avait été sévèrement battu et gravement blessé, six cellules arrosées et les témoignages quotidiens d’atrocités s’allongeaient. Le relent du couloir était insupportable et je me levai pour m’approcher de la fenêtre et avoir de l’air. Dehors, la neige scintillait sous les lumières brillantes et la brise portait les rires et les chants provenant de camarades hommes-couverture dans d’autres blocs. Des centaines d’hommes nus et physiquement cassés vivaient de nouveau. Il faisait terriblement froid maintenant. Je m’emmitouflai tant bien que mal dans les couvertures et enroulai la serviette autour de ma tête comme un foulard. Les gars des autres blocs criaient leurs nouvelles et faisaient passer leurs messages dans tous les sens. Petit à petit nous commençâmes à recevoir d’autres informations inquiétantes.
Plusieurs hommes sévèrement battus pendant un changement de faction ; deux prisonniers conduits au bloc-punition pour avoir rapporté du tabac du parloir ; trois gars brûlés dans une autre aile ; un homme battu dans le bloc-punition et mis de force dans la baignoire ; Pee Wee O’Donnell à l’hôpital ; d’autres bien amochés.
"T’as entendu ça, Sean ?" demandai-je.
"Oui, j’ai entendu, Bobby", répondit-il. Et les histoires d’horreur continuèrent à arriver : quarante-quatre hommes battus, tondus et immergés de force dans la baignoire dans une autre aile, deux gars à l’hôpital et deux autres dont on était sans nouvelles. Les témoignages en gaélique se poursuivirent. H5 commença à raconter à H3 que plusieurs hommes avaient subi des blessures pendant un vide-chiottes effectué par les matons et que l’un d’eux avait été envoyé au bloc-punition. H3 recevait six nouveaux hommes-couvertures, emprisonnés la veille. Les cris continuèrent. La distance qui séparait les blocs était considérable mais le son portait et résonnait à travers la nuit et la neige, et autour des boiseries grises et par-dessus les barbelés. Parfois il fallait répéter plusieurs fois et épeler certains mots avant de se faire comprendre. Mais en persévérant et avec un peu de patience, notre système de communication marchait. Quand les fenêtres seraient bouchées, c’en serait terminé !
"Extinction des feux", cria quelqu’un de l’autre côté de l’aile. Les matons étaient en train d’éteindre les lumières. Il y avait de fortes chances pour qu’ils reviennent au milieu de la nuit pour les rallumer, mais, de toute façon, on ne dormirait pas beaucoup cette nuit avec un froid pareil, me dis-je, alors que le maton éteignait dans ma cellule. Je frappai sur le mur pour appeler Sean.
"Allô", dit-il.
"Attrape l’effort avec la ligne", lui dis-je. "Maith thù", répondit-il et il fit passer le mot pour que la mèche improvisée revienne vers nous.
"Tu écoutes, Sean ?" demandai-je avant de lui préciser ; "je te passerai une clope en renvoyant la ligne. OK ?"
"Maith thù", répondit-il encore.
La ligne arriva chez Sean et il me la passa pour que j’allume ma deuxième cigarette. J’attachai la dernière et lui renvoyai le tout.
"OK, camarade ?"
"Impec’", répondit-il.
Je retournai m’asseoir sur le matelas, pensant avec satisfaction que les risques avaient valu la peine d’être pris. La fumée montait vers la lumière faible et sortait par les fenêtres et pendant quelques minutes la puanteur fut masquée par l’arôme du tabac. Il faisait vraiment très froid. Je décidai de me remettre à faire les cent pas quand j’aurais fini ma cigarette. Pauvre Pee Wee, me dis-je. Souffrant dans l’hôpital de la prison ou peut-être même au "Musgrave" ! Les autres gars concernés devaient souffrir aussi. Je ne me sentais pas au top, moi non plus. Mes blessures me faisaient de plus en plus mal mais je me savais chanceux par rapport à d’autres. Par terre la cendre rougeâtre de ma cigarette mourut sur le béton noirci et je me relevai, étalai une couverture sur le sol et recommençai à marcher.
"Matons dans la cour !" entendis-je au loin, dans un autre bloc. Il faisait de plus en plus froid et la neige recouvrait tout de son épais manteau et continuait encore à tomber. Je me demandai ce que faisaient nos tortionnaires maintenant. A était sans doute en train de boire dans le club des matons à la caserne avec tous ses copains mercenaires et soldats britanniques ; C et D seraient chez eux en famille et je me demandais bien ce qu’ils répondraient si leurs enfants demandaient : "Qu’est-ce que tu as fait aujourd’hui, Papa ?" Ou, plutôt, que diraient leurs femmes et enfants s’ils connaissaient la réponse et s’ils se rendaient compte de toute la souffrance, toute la torture et tout le chagrin causés et perpétrés par ceux-là sur des centaines d’hommes nus.
Je poursuivis mon chemin circulaire vers nulle part. Les camarades riaient et bavardaient encore et quelques-uns chantonnaient ou sifflaient tout bas. J’étais sur le point de me rasseoir sur mon matelas quand j’entendis le cri d’avertissement :
"Matons dans le rond ! Gros moyens !"
Je mesurai tout de suite l’ampleur de la mise en garde. D’un geste, je ramassai mon matelas et le posai debout contre le mur, à l’endroit le plus éloigné de la porte.
Je fis un paquet serré de toutes les couvertures et le posai à l’abri derrière le matelas.
Ensuite, j’enroulai la serviette autour de ma taille oubliant le froid glacial, et cachai mon tout petit paquet de tabac dans les plis contre mon ventre. J’entendis le premier impact de liquide sur la porte en face de la mienne.
Pour des gros moyens, c’était des gros moyens ! Je les sentais déjà d’ici : un détergent à base d’ammoniaque, un désinfectant très puissant et extrêmement dangereux. Les matons le projetaient dans les cellules par les fentes autour et en dessous des portes. J’osai un rapide coup d’œil par le petit trou - une très grande imprudence, car, si le liquide m’avait atteint, il m’aurait brûlé les yeux et aveuglé en quelques secondes. La lumière était vive dans le couloir. B était en train de vider un seau entier du liquide répugnant sous la porte de la cellule d’en face. Il hurlait aux autres matons de se dépêcher d’en apporter d’autre. L’homme dans la cellule se mit à tousser et à s’étouffer. Ça se présentait mal pour les gars de l’autre côté de l’aile : leurs fenêtres étaient toutes bouchées. Les émanations du désinfectant ressemblaient au gaz lacrymogène : elles attaquaient les yeux et la gorge provoquant vomissements et cécité temporaire. J’entendis le bruit de déroulement du tuyau d’eau à l’autre bout de l’aile.
"Tuyau ! Tuyau !" criai-je avant de reculer de la porte. B était en train de balancer du désinfectant sur les portes en ricanant de façon hystérique comme un fou furieux. Il avait un masque qui le protégeait des effluves nocifs et sans doute portaient-ils tous, lui et ses suppôts, leur tenue imperméable en nylon bleu. Le tuyau d’arrosage s’anima soudain sous l’effet de la pompe à pression et les jets d’eau firent trembler les portes sous leur puissant matraquage. J’entendis vider un autre seau plus près et aussitôt un liquide verdâtre commença à envahir ma cellule. Avant même que je puisse réagir, les gaz m’avaient déjà atteint et je me mis à étouffer et à tousser violemment, des larmes plein les yeux. Je me dirigeai vers la fenêtre et tentai de respirer de l’air frais. Mon corps essaya de vomir et mes poumons de se vider de ce poison. Je restai ainsi, la tête appuyée contre les barreaux en béton à tousser jusqu’à l’épuisement, comme tous les autres prisonniers. On n’entendait que ça : des gens tousser à en mourir et des jets d’eau puissants. Puis l’eau s’engouffra dans ma cellule et inonda le béton noirci. Je n’en avais que faire, j’étais totalement vidé, la gorge brûlante et les yeux en feu. Je savais que l’eau diluerait le désinfectant, mais il faudrait plusieurs minutes avant que les gaz se dispersent. La marée montait toujours sous la porte, et puis le maton trouva une autre victime et elle cessa. Je toussais encore mais ça commençait à aller mieux. J’entendis Sean vomir violemment. L’aile tout entière était remplie de gémissements et de toux. B criait, il braillait : "Voyez si ça vous plaît, ça ! Voyez si ça vous plaît, ça !" et il se mit à chanter la seule chanson de son répertoire : "The Sash".
Les matons arrêtèrent l’eau. Je m’aventurai jusqu’au petit trou et vis B patauger dans une rivière d’eau, de désinfectant et d’urine, son masque dans une main et un seau vide dans l’autre. Il riait comme un possédé. L’autre maton le suivait avec le tuyau dégonflé et un troisième nous hurlait des injures et des obscénités de l’autre bout de l’aile. Mes yeux me brûlaient mais je n’allais pas trop mal. Dans les autres cellules on toussait beaucoup. Il y avait plus de deux centimètres d’eau par terre et l’extrémité de mon matelas était submergée, mais les couvertures étaient à l’abri sur les tuyaux, coincées derrière le matelas. Je commençai la longue tâche épuisante de me débarrasser de l’eau de ma cellule : je raclai et poussai sous la porte tant bien que mal.
"Ça va, Sean ?" criai-je.
"Non ! J’suis crevé !" répondit-il. Petit à petit, le bruit de toux provenant des autres cellules fut remplacé par les grattages et raclages des efforts pour repousser l’eau sous les portes. Diverses ordures et pourritures flottaient partout et empêchaient l’écoulement, bouchant régulièrement la fine fente sous la porte. J’étais obligé de les enlever sans arrêt à la main, des poignées entières de pain détrempé, de saletés et d’excréments, avant de les balancer à leur place dans le coin. Le niveau d’eau commença à baisser. Les émanations de désinfectant restaient dans l’air mais elles étaient supportables. Je jetai un coup d’œil vers la fenêtre. La neige tombait très fort maintenant et une légère brise la faisait rentrer dans la cellule.
Bon Dieu, pensai-je, qu’est-ce que nous pourrions subir de plus ? Mes pieds étaient trempés et engourdis par le froid, mais je transpirais sur tout le corps, épuisé à racler inlassablement pour me débarrasser de toute cette eau puante. Quand le maximum fut sorti, je pris mon matelas et tentai d’essorer la partie trempée. Ensuite, j’en arrachai un morceau avec lequel j’épongeai ce qui restait de flaques par terre. Je laissai le matelas contre les tuyaux en espérant qu’il sécherait un peu. Je le regardai de nouveau par le petit trou et contemplai la rivière d’urine et de saletés dans l’aile. Sans doute viendraient-ils au milieu de la nuit avec la machine pour tout nettoyer et sécher. Je jetai le morceau de mousse dans le coin et repris mon souffle à la fenêtre. J’étais épuisé mais ne pouvais tenir longtemps sur le sol froid. La neige rentrait toujours dans la cellule et je n’avais toujours qu’une serviette sur le dos. Je pris les couvertures et m’enroulai à ma façon. Le sol était encore poisseux et humide, mais je n’avais pas d’alternative : je serais bien obligé de poser le matelas dessus pour passer la nuit, sachant que l’humidité traverserait la mousse et m’attaquerait le corps. C’était ça ou marcher toute la nuit, et j’en étais incapable. L’attente jusqu’à demain matin serait terriblement longue, terriblement froide et sans repos. J’écoutai les gars raconter leur situation par les fenêtres. Beaucoup avaient le matelas complètement saturé. Pour d’autres, c’était les couvertures trempées. Je n’étais pas à plaindre, avec seulement le bas du matelas mouillé.
Le bruit s’était atténué et tout le monde était occupé à sécher sa literie comme il pouvait. Quelqu’un posa la question habituelle : qui a envie de chanter ? Après ce que nous venions de vivre, nous avions grand besoin de nous remonter le moral et, de toute façon, tout le monde était debout en train de marcher en rond. Les gars applaudirent et le premier volontaire se mit à chanter The Old Alarm Clock dans une ambiance bon enfant. Ensuite, ce fut le tour d’un des jeunes de Derry et il enchaîna avec My Old Home Town on The Foyle et, après, les chanteurs s’approchèrent de leur porte tour à tour. Quand mon tour arriva, je me collai à la fente autour de ma porte pour donner ma version de The Curragh of Kildare, imaginant tout le temps que B reviendrait me balancer un seau de désinfectant en plein visage. Essoufflé, je terminai ma chanson et fus applaudi à mon tour. Le chanteur suivant entama sa mélodie et je me remis à faire les cent pas. Mes pieds étaient transis de froid et le sol poissait encore. Je n’en pouvais plus. Je posai mon matelas par terre et me recroquevillai, dans le coin, sur la partie sèche. Les bleus et contusions que j’avais partout sur le corps depuis la fouille se réveillèrent.
Je fus tenté de rouler une autre cigarette pour moi et une pour Sean, mais je changeai d’avis : elles seraient plus précieuses et certainement plus appréciées demain, surtout vu le tournant qu’avaient pris les choses. Les chansons fusèrent, rompant la monotonie et soulageant la tension et, pendant quelques minutes elles nous aidèrent à nous échapper de notre situation et de notre environnement. Pas de trace de B. Sans doute s’était-il évanoui dans le club des matons ou alors il était toujours en pleine beuverie. Quelqu’un chantait sa propre composition sur le thème des hommes-couvertures et c’était très réussi. Puis un des jeunes embraya avec Ashdown Road. Toute l’aile devint subitement calme et je restai immobile et frissonnant à écouter chaque parole et chaque note de sa superbe prestation et de sa triste voix. Je sentis mon courage revenir et, une fois de plus, je fus heureux d’être résistant. Mieux vaut souffrir en résistant que se faire torturer sans même se battre, me dis-je. Le chanteur arriva à la fin de sa chanson et on l’applaudit à tout rompre. Puis on en demanda une dernière et le même chanteur conclut la session avec The Wind that Shakes the Barley.
La neige rentrait toujours par la fenêtre sans carreaux et cela me rappela la nuit où nous fûmes obligés de les casser de nos propres mains, quand les matons nous avaient projeté d’importantes quantités de ce désinfectant immonde dans les cellules à travers les portes. Les gars de l’autre côté de l’aile ont vraiment dû souffrir ce soir. Je les avais entendus pester contre les fenêtres bouchées quand B avait commencé à les attaquer avec le désinfectant.
Le chanteur termina la dernière chanson de la nuit et fut vivement applaudi par tous. Ensuite, il y eut un moment de bavardages et quelqu’un de l’autre côté fit passer un message en gaélique pour qu’on le fît suivre au délégué. Il y avait eu une urgence dans l’autre aile : un jeune homme très malade. Ils avaient tiré la sonnette d’alarme... les matons l’avaient éteinte et avaient laissé le malade sans soins. Un autre jeune avait perdu sa mère hier et il s’était vu refuser la permission, comme tous les autres qui avaient vécu la même situation lamentable avant lui.
Je me levai et me mis debout sur le matelas pour reprendre position à la fenêtre. La couche de givre sur le fil me fit penser un peu à l’intérieur d’un frigo. Des jeunes en dessous se disaient bonne nuit, d’autres disaient qu’ils voulaient marcher le plus longtemps possible car leur matelas était trempé. Ici et là, quelques rares individus restaient à discuter aux fenêtres. Sean frappa au mur.
"Oiche mhaith, Bobby", cria-t-il.
"Oiche mhaith, Sean", répondis-je à mon tour, avant d’ajouter : "Ton matelas est mouillé ?"
"Non, pas trop", dit Sean. "Je vais essayer de me réchauffer sous les couvertures."
"Maith thù. Oiche mhaith, a chara", lui dis-je.
"Oiche mhaith", cria-t-il encore.
La neige ne tombait plus maintenant et seule une petite brise soufflait. La surface, tout à l’heure lisse et intacte de la couverture blanche, était maculée par les traces des matons. Les jolis nuages de coton étaient partis et le ciel d’encre noire revint, légèrement parsemé d’étoiles scintillantes. La plupart des gens dorment en ce moment, me dis-je. Je me demande comment ils réagiraient demain s’ils se réveillaient dans notre situation. Quel trou d’enfer ! Pas étonnant que j’aie fait des cauchemars ces dernières semaines, tous au sujet de cette horreur. Seigneur Dieu, où est la fin de tout ça ? Quand on ne peut même plus s’en évader par le sommeil c’est que ça va vraiment mal, pensai-je.
Il n’y avait plus du tout de bruit venant des autres blocs et ceux qui étaient restés aux fenêtres avaient fini par s’endormir ou tournaient en rond à cause de l’état de leur matelas. Tout était très calme. La neige reflétait mille lumières multicolores.
Ce silence était laid et sinistre. Un oiseau le déchira de son chant en nous survolant dans le noir. Le projecteur d’un hélicoptère au loin dansa dans l’immense océan sombre de la nuit et je me demandai si ma famille se portait bien. Ils s’inquiéteraient tous jusqu’au parloir du mois prochain. Cette journée avait été rude mais ne l’étaient-elles pas toutes ? Dieu seul pouvait savoir ce que demain nous réservait comme événements. Qui seraient les pauvres malheureux qu’ils enverraient au bloc-Punition, battus et tout en sang ? Qui viseraient-ils avec leurs canons à eau, leurs matraques et leurs bottes ? Demain ne nous apporterait que douleur et torture, souffrance et ennui, peur et humiliation et Dieu sait quelles horreurs et inhumanités.
Le noir, le froid intense, le ventre vide, les quatre murs de cette tombe immonde pour me rappeler mon sort, voilà ce qui attendait demain des centaines de prisonniers de guerre Républicains nus. Mais s’il était certain que notre lendemain serait dur, il était tout aussi certain que notre volonté le serait plus encore. Nous continuerions. C’était dur, c’était très, très dur, me dis-je, et je m’installai sur le matelas humide et tentai de me couvrir. Mais un jour la victoire serait nôtre et alors plus jamais d’homme ou de femme irlandais ne croupirait dans un enfer anglais.
Il faisait tellement, tellement froid. Je me tournai sur le côté et dissimulai mon petit morceau de tabac précieux sous le matelas. Le froid et l’humidité engourdirent mes pieds.
Un jour de moins avant la victoire, me dis-je, sentant une terrible faim se réveiller.
J’étais squelettique, comparé à ce que j’étais avant, mais cela n’avait pas d’importance. Rien n’avait d’importance à part la résistance. Le froid me mordit et je me tournai encore. Dans tout leur arsenal de domination, ils n’ont rien pour casser l’esprit d’un seul Républicain prisonnier de guerre politique qui refuse de se faire casser, pensai-je, et c’était tout à fait vrai. Ils ne peuvent, ils ne pourront jamais nous casser. Je me tournai de nouveau, gelé, et la neige rentrait par la fenêtre et se posait sur ma couverture.
"Tiocfaidh àr là", me dis-je, "Tiocfaidh àr là."
[1] Gerry Adams est le président, depuis 1983, du parti Sinn Féin ("Nous Seuls" en gaélique), mouvement indépendantiste créé en 1905 et qui fit ses premiers pas sur la scène politique dès 1908.
Le Sinn Féin cherchait l’indépendance de l’Irlande en s’appuyant sur la résistance passive et non-violente, contrairement à L’IRB (Irish Republican Brotherhood – La Fraternité Républicaine Irlandaise, ancêtre de l’IRA, société secrète fondée à Dublin en 1858), partisane de la stratégie armée qui organisa un soulèvement en 1867 et une insurrection le jour de Pâques 1916 (ces deux tentatives de révoltes furent réprimées par l’armée anglaise). Le Sinn
Féin, qui est la branche légale et politique du mouvement indépendantiste irlandais, s’impose au cours du XXe et XXIe siècle comme une force politique majeure en Irlande avec qui le gouvernement britannique tente de négocier une solution au conflit.
[2] L’IRA (Irish Republican Army – Armée Républicaine Irlandaise) organisation clandestine créée en 1919 dans le but de débarrasser l’Irlande, par la pratique de guérilla, de la présence britannique, que celle-ci se manifeste sous une forme militaire, économique ou politique. L’IRA a officiellement déposé les armes en 2002.
[3] Le 16 mars 1981, le député de la circonscription de Fermanagh-Tyrone-Sud, Frank Maguire (militant républicain dans les années cinquante, élu député de Westminster en 1974), meurt d’une crise cardiaque. Sa mort donna lieu à une élection dans cette circonscription considérée comme l’un des fiefs nationalistes. Les républicains désignèrent Sands comme candidat étant donné le fort mouvement de soutien à la lutte des prisonniers. L’objectif de cette élection pour les républicains était purement symbolique : "Les hommes et les femmes en état de protestation ne font qu’emprunter la voie électorale pour tenter de mettre en évidence le soutien populaire en faveur des prisonniers ainsi que l’opposition de la population au gouvernement britannique." (An Phoblacht-Republican News, 4 avril 1981). Le 17 avril, Bobby Sands est élu député au Parlement de Westminster.
[4] Le terme "loyalistes" désigne les protestants en Irlande (majoritaires dans la partie Nord-Est du pays ; ce sont, à l’origine, des colons venus des côtes anglaises et écossaises. La colonisation de l’Irlande remonte au règne élisabéthain) qui sont loyal envers la couronne d’Angleterre, et donc pour la domination britannique sur le pays. On les appelle aussi « les unionistes » car ils cherchent à préserver l’union avec la Grande-Bretagne.
[5] La RUC (Royal Ulster Constabulary) est la police nord-irlandaise à prédominance protestante. Elle témoigne de mesures discriminatoires à l’égard de la population catholique.
[6] An Phoblacht (La république) est le journal de l’IRA.
[7] Bobby est enterré à Miltown cemetery.
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (801.9 kio)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (752.7 kio)