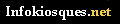A
À l’assaut des centres de rétention
mis en ligne le 27 novembre 2009 - anonymes
Toucher au cœur – À propos des rackets sur les immigrés
Les luttes autour de la question de l’immigration, qu’il s’agisse de celles de sans-papiers pour leur régularisation, de celles autour du logement dans les quartiers pauvres, contre les rafles dans les rues et les transports ou contre les centres de rétention ont vu ces dix dernières années la participation de nombreux compagnons dans différents pays. Elles conduisent souvent à une répétition d’impasses ou à une impuissance en terme d’interventions possibles.
S’il n’existe pas de recette, il nous semble pourtant indispensable de briser certains mécanismes militants qui nous ont trop souvent amenés à lutter sur des bases activistes sans perspectives ou bien au contraire à bouger à la remorque de groupes autoritaires, avec ou sans papiers. Ces quelques réflexions se veulent simplement un bilan d’expériences de luttes et quelques pistes pour développer une projectualité subversive qui nous soit propre, autour des migrations et
contre leur gestion.
Au-delà des illusions sur « l’immigré »
Une façon classique de tenter de comprendre le contexte d’un conflit social afin d’y intervenir est de scruter à la loupe ses protagonistes et de les soumettre à des analyses sociologiques plus ou moins militantes. Outre qu’elles reviennent d’avantage à creuser ce mystérieux « qui sont-ils ? » qu’à nous interroger sur ce que nous voulons, ces analyses sont souvent biaisées par quelques dogmes qui troublent toute réflexion critique.
Si les habituels racketteurs gauchistes recherchent désespérément n’importe quel sujet politique à même de les porter à la tête d’une contestation, beaucoup d’autres s’engagent sincèrement aux côtés des sans-papiers. Mais parce qu’ils considèrent leur situation particulière comme extérieure, ils sont souvent plus portés par une indignation que par le désir de lutter avec ceux qui partagent une condition qui, si elle n’est pas totalement similaire, reste commune : l’exploitation, le contrôle policier dans la rue ou les transports, les conditions de logement dans les mêmes quartiers en voie de restructuration ou en périphérie, ou encore des illégalismes propres aux techniques de survie. Les uns comme les autres finissent alors bien souvent par reproduire toutes les séparations fonctionnelles à la domination. En recréant une figure générique de l’immigré-victime-en-lutte qui aurait ses qualités particulières, ils introduisent en effet une mystification sociologique qui non seulement finit par empêcher toute lutte commune, mais renforce encore l’emprise de l’État sur chacun d’entre nous.
Bien souvent, les activistes libertaires ou radicaux, pourtant mus par quelque intui-tion de ce qui pourrait devenir un parcours commun, ne sont pas les derniers à avaler à leur tour cette pilule au nom de leur envie de collectif ou de l’autonomie des luttes, comme si cette dernière était menée par un bloc homogène et non plus par des individus, complices potentiels, au moins face à une oppression particulière. Des méthodes de lutte (l’auto-organisation, le refus des médiations institutionnelles, l’action directe) deviennent alors soudain beaucoup plus relatives lorsqu’il s’agit de sans-papiers. Reprenant quelques classiques de la diatribe militante, il y a toujours un bon samaritain pour expliquer que fracasser la vitrine d’une compagnie aérienne d’expulseurs dans une manif de sans-papiers les mettrait « en danger », eux qui pourtant bravent quotidiennement la flicaille ; que le combat contre les fascistes (comme des membres des Loups Gris turcs), les nationalistes (comme certains réfugiés qui arrivaient lors du déchirement de l’ex-Yougoslavie) ou les curetons (de celui qui « accueille » les sans-papiers dans « son » église avant de les en expulser, aux associations chrétiennes chargées des basses œuvres de l’État comme la Cimade, Caritas International ou la Croix Rouge) s’arrêterait à la porte des collectifs de sans-papiers ; qu’on peut cracher à la gueule d’un ambassadeur français ou belge mais pas à celle d’un ambassadeur malien lorsqu’il vient médier une lutte qui menace de se radicaliser (idem pour tous les politiciens de gauche, généralement non grata, mais tolérés cette fois au nom de la fausse unité demandée par quelque leader de collectif de sans-papiers).
Si chacun sait qu’une lutte part toujours de l’existant et que les différences initiales y sont souvent importantes (prenons simplement le rapport aux syndicats dans la plupart des luttes liées à l’exploitation), la question pour nous est justement celle de leur dépassement dans une dynamique subversive, et ce n’est certainement pas en acceptant les divers carcans autoritaires qu’on pourra le faire, la fin étant déjà contenue dans les moyens qu’on se donne. D’autant que ce relativisme ne conduit pas à une confrontation à l’intérieur de la lutte, mais à une sorte de colonialisme à rebours, à réifier une fois encore les immigrés dans une altérité supposée (« ils » seraient comme ça). La misère servant cette fois non pas de repoussoir mais d’excuse à tous les renoncements.
L’une des figures les plus marquantes de ce réductionnisme idéologique est ainsi celle de l’ « immigré innocent », l’éternelle victime passive, exploitée, raflée, enfermée puis déportée. En réaction à une propagande raciste quotidienne qui vise à faire endos-ser aux immigrés le rôle d’un ennemi social coupable de tous les maux (du chômage à l’insécurité en passant par le terrorisme), beaucoup finissent de fait par leur nier toute capacité criminelle. On les voudrait tous dociles, en train de mendier leur intégration en vue d’une place un peu moins abjecte dans la communauté du capital. Ainsi, les milliers de réfugiés sont transformés en victimes bienveillantes, et donc intégrables : victimes de guerre, de catastrophes « naturelles » et de la misère, de trafiquants d’êtres humains et de marchands de sommeil. C’est pourtant oublier que ces parcours transforment aussi les individus, créant des solidarités, des résistances et des luttes qui permettent à certains de rompre la passivité à laquelle ils sont assignés.
Quand il arrive ainsi que ces « innocents » se défendent bec et ongles contre le destin qui leur est imposé ici (révoltes dans les centres fermés, affrontements lors de rafles, grèves sauvages…), c’est alors la stupéfaction et le silence gêné qui règne dans le camp de la gauche et de son antiracisme démocratique. Quand cette révolte s’exprime de manière collective, il y en aura peut-être encore pour « comprendre ces gestes de désespoir », mais quand un prisonnier boutera tout seul le feu à sa cellule, on parlera alors d’un « fou » et ça ne fera surtout pas partie de la « lutte ». On veut bien des grévistes de la faim dans une église, pas des incendiaires ou des évadés de centres fermés, on comprend des défenestrés ou des noyés, pas des raflés qui résistent à la police, on aide volontiers des parents d’enfants scolarisés, pas des voleurs célibataires. Car la révolte et les individus qui se rebellent n’entrent plus dans ce cadre sociologique de l’immigré-victime construit par la bonne conscience militante avec l’appui des parasites d’État universitaires.
Cette mystification empêche une compréhension plus précise de la migration et des flux migratoires. Il est clair que ces migrations sont d’abord une conséquence de la terreur économique ordinaire qu’exerce le capital et de la terreur politique des régimes en place et leur bourgeoisie locale, au plus grand bénéfice des pays riches. Cependant, il serait faux de prétendre que des prolétaires pauvres se déplaceraient vers les pays les plus riches, comme le serinent à leur tour les chœurs tiers-mondistes pour construire leur sujet de l’immigré-victime. Les migrants qui parviennent à franchir clandestinement les portes de l’Europe ne sont en effet pas forcément les plus pauvres (contraints, eux, à des migrations internes vers les villes ou vers des pays voisins au gré des fluctuations du marché et de ses désastres), rien que par le coût (pécuniaire et humain) d’un tel voyage ou la sélection culturelle et sociale au sein d’une famille de ceux/celles qui peuvent entreprendre la démarche.
Ainsi, si on cherche à comprendre tout ce qui constitue et traverse chaque individu plutôt que de figer la différence et l’altérité afin de justifier une position extérieure de « soutien », on peut découvrir toute une complexité et des rapports de classe, constatant que les collectifs de sans-papiers sont aussi composés de surdiplômés universitaires, de politiciens ratés, d’exploiteurs locaux qui ont récolté l’argent sur le dos des autres… et migrent vers cette partie du monde pour prendre la place dont ils peuvent bénéficier dans le capitalisme démocratique. Beaucoup de groupes de sans-papiers sont ainsi dominés par ceux qui détenaient déjà du pouvoir (social, politique, symbolique) ou y aspiraient. Cette différence de classe est rarement prise en compte par les compagnons qui s’engagent dans une lutte avec des sans-papiers, la langue constituant une barrière aussi infranchissable qu’elle est invisible, propulsant automatiquement les immigrés issus des classes les plus aisées dans leurs pays d’origine dans le rôle de porte-parole/interprète. Aiguiser ces contradictions de classe, à l’intérieur des regroupements de sans-papiers comme partout, est non seulement une contribution que peuvent apporter des compagnons, mais aussi l’une des conditions indispensable pour développer une solidarité réelle.
Pour comprendre ces dynamiques de lutte, il est également nécessaire de jeter à la poubelle quelques confortables illusions. Seul un déterminisme acharné pourrait en effet prétendre qu’une certaine condition sociale implique nécessairement la révolte contre celle-ci. Ce type de raisonnement offrait certes la certitude d’une révolution, certitude qui a longtemps tenu au cœur de beaucoup, tout en écartant comme aventuriste la perspective de rébellions individuelles se généralisant vers l’insurrection. La critique d’un déterminisme qui a montré sa faillite dans le vieux mouvement ouvrier vaut cependant aussi pour les prolétaires qui migrent de ce côté là du monde. Pour beaucoup d’entre eux, l’Occident est perçu comme un oasis où on peut bien vivre, tant qu’on est prêt à fournir de gros efforts. Subir des conditions d’exploitation qui ressemblent à celles qu’on a fuies, avec des patrons qui savent aussi parfois user de la fibre paternaliste de l’appartenance à une même communauté supposée, être traqué, n’avoir pas ou peu de perspectives de monter dans l’échelle sociale et vivre un racisme latent qui tente de canaliser le mécontentement des autres exploités, est une confrontation avec la réalité qui n’en est que plus rude. Face à la résignation qui peut naître de cette confrontation douloureuse, ou face à l’enfermement dans des communautés autoritaires basées par exemple sur la religion ou le nationalisme, la perspective reste alors de se lier non pas avec tous les sans-papiers de façon générique, mais avec celles et ceux qui, refusant de se conformer à leur destin d’exploité, ouvrent aussi le chemin vers l’identification de l’ennemi. Afin qu’au jeu de dupes entre l’universalisme capitaliste et les particularismes s’oppose une guerre sociale où on pourrait se reconnaître entre soi, au-delà de la question des papiers et des différents degrés d’exploitation, dans une lutte continue vers une société sans maîtres ni esclaves. Comme dans n’importe quelle autre lutte, en somme, si celle-ci n’était pas plus souvent qu’à son tour biaisée par le poids de l’affectif culpabilisant, par l’urgence d’éviter une expulsion et ses conséquences possibles et, surtout, par un rapport qui se construit souvent sur la base de l’extériorité et non pas de la révolte partagée.
L’impasse des luttes pour la régularisation
On se souvient que le tournant du nouveau siècle a été marqué par des vagues de régularisations « massives » provisoires dans plusieurs pays européens [1]. Si l’État suit toujours ses propres logiques, les sans papiers ont pu, par leur lutte, se frayer un passage et influencer les critères de régularisation ou accélérer leur rythme. On avait assisté au même phénomène pour des « grandes lois sociales », certaines ayant été acquises au prix du sang, d’autres pour acheter la paix sociale ou tout bonnement octroyées en fonction des besoins du capital, pour fixer la main d’œuvre et augmenter la consommation intérieure. Le débat avait alors aussi fait rage au sein de la classe ouvrière entre des revendications qui accompagnaient ou devançaient le mouvement du capital d’un côté, et les tentatives insurrectionnelles d’un autre. Nombre de révolutionnaires n’acceptaient alors ces revendications que dans un but d’agitation permanente tout en posant que la question sociale ne pourrait pas être résolue dans le cadre capitaliste.
Avant ces vagues de régularisation, les États étaient en fait partagés entre deux logiques contradictoires : d’une part l’afflux plus important d’immigrés en situation irrégulière répondait à un besoin réel de main d’œuvre flexible (bâtiment, restauration, nettoyage, agriculture, hôtellerie, domesticité) dans des économies à la population vieillissante, d’autre part cette population en partie méconnue (dans les pays d’immigration récente comme l’Espagne et l’Italie), mais surtout par nature beaucoup moins gérable, entravait la volonté drastique de gestion de l’ordre public. Si ce point a été rapidement traité, notamment par une collaboration plus étroite entre les diverses autorités (aussi bien à travers des échanges de bons services entre imams et préfets que par une répartition des tâches entre les différentes mafias immigrées et autochtones, malgré quelques premiers jeux sanglants liés à une concurrence inévitable), la question des besoins de main d’œuvre a été résolue par une corrélation plus étroite entre flux migratoires et marché du travail. Une des tendances lourdes au niveau européen semble en effet viser à une gestion au plus près, alignée en temps réel sur les besoins de l’exploitation. Cette forme qui lie strictement carte de séjour et contrat de travail pour les nouveaux arrivés vient s’ajouter à la forme classique de travail des migrants, le travail au noir, et viserait à terme à s’y substituer, dans le cadre d’une réorganisation des précarités salariées qui s’étend à tout le monde.
L’État a ainsi quasi tari la reconnaissance de l’asile politique, durci le regroupement familial ou l’acquisition de la citoyenneté par le mariage, supprimé les cartes de long séjour (celle de 10 ans en France), tandis qu’il étendait d’un autre côté sa main de fer sur les fichés volontaires déboutés des régularisations et s’orientait vers ce qu’un Président a défini comme une « immigration choisie ». On en revient donc au temps où les sergents-recruteurs des patrons chargeaient directement par camions entiers des immigrés dans les villages en fonction de leurs besoins. La formule moderne veut simplement une rationalisation de ce recrutement aux frontières en cogestion entre les États et les employeurs [2], la main d’œuvre n’étant en rien destinée à rester et à s’installer. En même temps, les différents États construisent donc des camps aux frontières extérieures de l’Europe, pour ceux qui n’auront pas eu la bonne grâce d’être sélectionnés par les nouveaux négriers.
Car il y a tous les autres. Tous ceux qui se sont vu refuser le précieux sésame et ceux qui continuent d’arriver. Là se situe tout l’enjeu du changement d’échelle dans la rationalisation policière du système d’expulsion qui, pour ceux qui auront franchi le sas des zones d’attentes et le racket des passeurs et autres mafias, part des rafles, continue avec la multiplication des camps, et se termine par des déportations qui se veulent plus massives, quotas nationaux ou charters européens à la clé. Personne ne se fait pourtant d’illusions : tant que les causes économiques persisteront, et malgré tous les dispositifs du monde (comme on le voit à la frontière entre le Mexique et les États-Unis où un mur de 1200 km est en construction) qui ne font que renchérir le passage et augmenter le nombre de morts, le nombre d’immigrés sans-papiers continuera d’augmenter. Ce ne serait qu’au prix d’une multiplication des déportations que l’État pourrait réellement appliquer ses lois en matière d’éloignement forcé du territoire. Mais là n’est pas la question, car ces dispositifs ont pour principal objectif non pas d’expulser tous les sans-papiers, mais de terroriser l’ensemble de la main d’œuvre immigrée (celle qui est régularisée et celle qui est sélectionnée pour des durées de séjour toujours plus courtes), afin de la maintenir dans des conditions d’exploitation proches de celles qu’elle a fuies (des délocalisations internes en quelque sorte) tout en faisant pression à la baisse sur l’ensemble des conditions d’exploitation. Le prétexte raciste servant quant à lui également à déployer un arsenal de contrôle social qui touche tout le monde.
N’oublions pas non plus que quelque chose est en train de changer dans la nature même des migrations. Le capitalisme industriel déplaçait des forces de travail comme des pions sur un jeu. La logique était simple : ici on a trop de force de travail et là ils en ont besoin. S’il n’y avait pas trop de besoins, d’autres aspects de cette politique de gestion de population entraient en ligne de compte. Mais cette forme spécifique de migration s’est transformée avec les restructurations du système économique et les conséquences de la croissance industrielle. Ainsi, on commence à se rendre compte qu’il n’y a souvent plus de point de départ ni de destination. Les premiers sont dévastés par la famine, les guerres, les désastres tandis que les secondes changent continuellement. Les migrations deviennent alors plus un parcours interminable entre différents étapes ; et ne se limitent pas au passage d’un point A à un point B. Ces nouvelles formes de migration ne sont pas seulement déterminées par les besoins d’un capital toujours plus flexible et adaptable. Des millions de gens, déracinés par la dévastation des endroits où ils sont nés, errent sur cette planète, corvéables à merci. Et les dispositifs de gestion sont bien visibles : les camps humanitaires de réfugiés, les camps aux frontières, les bidonvilles et les favelas. Face à cette nouvelle donne, les luttes autour des régularisations semblent poser peu de questions…
L’exemple belge nous fournit une bonne illustration des impasses actuelles de la lutte pour des régularisations. Lorsque la tension montait en 1998 autour des centres fermés, l’État s’est fait à la fois lion et renard. En lion, il a déchaîné sa répression contre les secteurs les plus rebelles du mouvement (assassinat de Semira Adamu [3] qui se battait férocement à l’intérieur des centres, perquisitions et arrestations de camarades actifs dans cette lutte). En renard, il s’est engagé à négocier des régularisations avec l’autre partie du mouvement. Il est évident que réclamer des régularisations, à part que ça revient à réclamer l’intégration, requiert une certaine crédibilité, celle d’un interlocuteur reconnu. En peu de temps, c’est ainsi que ce mouvement a été torpillé. Les régularisations, qui étaient au départ une réponse de l’État à une tension et une agitation qui contestaient l’ensemble de sa politique en matière d’immigration (avec des slogans pour la fermeture de tous les camps ou la libre circulation), sont vite devenues le but à atteindre pour la plupart des groupes d’immigrés. Au lieu d’obliger l’État à concéder des régularisations par la lutte, les collectifs se sont engouffrés dans la brèche et ont entamé un dialogue suivi de négociations, attirant une armada de négociateurs professionnels et de charlatans juridiques censés résoudre les problèmes. Avec la répression d’un côté et le début d’un dialogue bureaucratique de l’autre, la dynamique était brisée, et ni les automutilations successives (comme les grèves de la faim hors des camps) ou les plus basses humiliations ne seront par la suite suffisantes pour arracher ce qui avait été à l’époque dans une certaine mesure une réponse de l’État à l’agitation, réponse suivie d’une rationalisation des centres fermés et d’une adaptation plus forte de l’octroi des permis de séjour aux besoins de l’économie (l’État leur a même attribué des couleurs différentes).
La situation actuelle, avec le cycle occupations/grèves de la faim/expulsions, nous a empêtrés ces dernières années dans des expériences de luttes qui offrent peu de possibilités de dépassement dans une perspective que nous pouvons partager : des expériences d’auto-organisation qui ne tolèrent ni politiciens ni leaders syndicaux ou religieux, d’actions directes qui permettent de créer un rapport de force réel et d’identifier l’ennemi de classe sous tous ses aspects. Ce constat nous met face au besoin et au désir de développer une projectualité subversive qui part sur nos bases plutôt que de rechercher le dépassement, qui semble toujours plus lointain, de luttes basées sur la revendication de régularisations. Cette projectualité pourrait trouver ses premiers points d’ancrage dans la révolte de fait partagée entre ceux qui luttent pour la destruction des centres et ceux qui, comme les rebelles de Vincennes et Steenokkerzeel, ont mis en acte la critique de l’enfermement et ont bouté le feu à leur prison.
Contre la machine à expulser
Face à ces difficultés surgit alors un débat qui court jusqu’à aujourd’hui, celui de la solidarité. Nombre de camarades défendent en effet la nécessité de notre présence à tout prix au sein des groupes d’immigrés, jusqu’à ce que couleuvre après couleuvre, ils finissent souvent par se retirer dégoûtés de toute lutte de ce type. Les justifications sont variées et sont souvent plus marquées par le confort des recettes sans imagination ou par l’activisme mouvementiste que par un réel désir de subversion. Là encore, si le caractère collectif d’une action n’est pas pour nous un critère, nous comprenons le besoin que peuvent ressentir certains compagnons de « rompre l’isolement ». Cependant, nous doutons que ceci passe par le fait de se retrouver dans des réunions interminables à une trentaine enfermés dans un squat ou un foyer avec des sans-papiers et des gauchistes. Nous serions plutôt enclins à développer un projet propre et nous retrouver alors sur nos bases.
Tant que la solidarité ne peut être comprise que comme rapport de soutien avec certaines catégories sociales, elle restera une illusion. Même si elle se dote de méthodes plus radicales, elle restera à la remorque d’un conflit dont ni les bases, ni les méthodes, ni les perspectives ne nous conviennent. La seule justification consiste alors à prétendre qu’en participant à ces conflits, on pourrait « radicaliser » les gens parce que leur condition sociale les amènerait à partager nos idées. Tant que ce concept de « radicalisation » sera interprété comme un travail de missionnaires qui essayent de faire avaler leurs idées aux autres, elle restera dans l’impasse qu’on voit partout gagner du terrain. La « radicalisation » peut cependant à l’inverse être comprise comme une ouverture envers d’autres, autour de notre propre dynamique, et donc en gardant l’autonomie de notre projectualité. Mais ceci exige que pour être « ensemble » dans une lutte et avancer tant au niveau des perspectives qu’au niveau des méthodes, il y ait déjà une affinité de base, une première rupture, un premier désir qui va au-delà des revendications habituelles. C’est ainsi que notre exigence de réciprocité peut prendre sens. Plutôt que de continuer un lien qui n’a d’autre raison d’être que de maintenir la fiction d’un sujet politique qui aurait, au nom de son statut de principale victime, le monopole de la raison et de donc de la lutte, il nous reste bien d’autres pistes à explorer.
Pour être plus clairs, on pourrait dire que la solidarité nécessite une reconnaissance réciproque dans les actes et/ou dans les idées. Il est en effet difficile d’être solidaire avec un sans-papier « en lutte » qui revendique sa régularisation et celle de sa famille sans être aucunement intéressé par une perspective de destruction des centres de rétention. Peut-être pourrait-on encore se retrouver de fait, mais ça serait alors sur une seule base pratique : nous n’avons pas besoin d’analyser les motifs et les perspectives qui poussent quelqu’un à se révolter pour nous reconnaître au moins en partie dans des gestes d’attaque qui s’en prennent directement aux responsables de cette misère. Il en va de même pour la plupart des luttes intermédiaires : l’intérêt de participer à un conflit dans une usine qui part sur des revendications salariales et ne déborde pas l’encadrement syndical ni ne développe le moindre germe d’action directe est très limité. Limité parce qu’il n’y a simplement pas de base sur laquelle se retrouver. Quand par contre ces mêmes ouvriers passent au sabotage (même s’ils le considèrent simplement comme un outil pour faire pression sur le patronat) ou mettent à la porte leurs délégués (même si c’est simplement parce qu’ils se sentent trahis), de nouvelles possibilités communes s’ouvrent…
Donc, au lieu d’en rester à des slogans de plus en plus vagues de « solidarité avec les immigrés / en lutte » (mais quelle lutte ?), nous pourrions développer une projectualité contre les centres de rétention avec les méthodes et les idées qui nous sont propres et qui est subversive dans le sens où elle remet en question les fondements de ce monde (l’exploitation et la domination). Cette projectualité serait alors autonome, et elle serait renforcée par et renforcerait à leur tour tous les gestes de révolte qui se démarquent vivement de la résignation généralisé. Encore une fois, s’il n’existe pas de recettes, il importe aujourd’hui de sortir des impasses d’un activisme plus ou moins humaniste qui voudrait mettre en sourdine toute autonomie radicale au profit d’une agitation qui ne ferait que suivre les échéances du pouvoir ou les logiques des seuls acteurs supposés légitimes des luttes, alors que c’est la liberté de tous qui est par exemple en jeu avec les rafles. Tout comme il importe aussi de proposer des perspectives qui, au-delà des objectifs partiels développés dans ces luttes intermédiaires, soient capables d’élargir la question en proposant un horizon qui remette enfin en question l’ensemble de ce monde et de ses horreurs, c’est-à-dire capables de poser à chaque fois la question de la domination et de l’exploitation. Les attaques diffuses seraient au cœur de cette projectualité, offrant non seulement l’avantage de dépasser l’impuissance ressentie face aux murs et aux barbelés des camps ou face à un dispositif policier qui sait s’adapter en matière de rafles et compter sur la passivité et la peur des passants, mais aussi et surtout l’intérêt de pouvoir à la fois développer notre propre temporalité, rendre vulnérables aux yeux de tous les dispositifs de la machine à expulser qui se trouvent à tous les coins de rue, et offrir des possibilités d’action réelles à tout un chacun, quel que soit le nombre.
Des internationalistes enthousiastes
A l’assaut de Ceuta et Melilla
Malgré une longue tradition de poncifs militants, on aurait tort de continuer à parler d’ « Europe forteresse ». Si l’expression est commode, elle fait oublier que les étrangers riches n’ont pas de problème d’accès au territoire européen. Elle cache aussi surtout le fait que le continent reste une terre d’immigration légale ou légalisée, comme elle l’a toujours été, en fonction des besoins de main d’œuvre. Le décalage croissant entre des immigrés choisis par nationalités, quotas ou durée de survie avant régularisation et tous ceux qui continuent d’arriver sans demander d’autorisation a ainsi souvent pu conduire à cette simplification.
Les deux enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla au Maroc constituent l’une des seules voies terrestres pour accéder en l’Europe. Si on sait que la Méditerranée constitue un des plus grands cimetières européen en raison du nombre de réfugiés noyés lors de la traversée vers l’Italie (Lampedusa et la Sicile), l’Espagne (le détroit de Gibraltar, les Canaries), mais aussi vers Chypre ou Malte, cette frontière a longtemps offert l’avantage d’un passage gratuit et plus sûr, pour peu que l’auto-organisation et la détermination soient au rendez-vous.
Ce n’est qu’en 1998 que la ville de Melilla, 65 000 habitants, a construit un centre de rétention particulier, dit CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes), semi-ouvert mais à détention illimitée, contre 40 jours dans les dix autres camps de déportation, les CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros), créés à partir de 1985. La Granja, cogéré par la Croix-Rouge et l’association Maria Immaculada, est d’une capacité de 250 places et sert de centre de tri entre ceux qui seront relâchés dans une ville espagnole du continent avec un avis d’expulsion, et tous les autres, refoulés par bateau ou par avion. Cette même année a aussi débuté la construction d’une barrière métallique autour de la ville, sur l’exemple de Ceuta l’année précédente. Depuis 1994 en effet, les traversées par bateau de « subsahariens » à partir du Maroc (Sidi Ifni, El Aaiun, Dajla) vers les Iles Canaries d’un côté et le sud de l’Espagne (Cadiz, Málaga, Almeria) de l’autre ne vont cesser d’augmenter. Parallèlement, les attaques individuelles ou par petits groupes de la frontière terrestre qui mène vers Ceuta et Melilla vont également se multiplier.
C’est cependant à partir de 2005 que tout va s’accélérer de ce côté-là. Des milliers de migrants, peut-être las d’attendre un passage victorieux par bateau contre les 1500 dollars dus aux passeurs (la surveillance technologique et humaine des voies maritimes a beaucoup augmenté), à bouts de ressources (dépouillés par la police, rackettés par les mafias, enfermés et tabassés dans les prisons marocaines ou libyennes à chaque échec) ou tout simplement plus pauvres, vont alors lancer des vagues d’assauts massives afin de franchir en force le périmètre qui marque le passage vers les deux enclaves espa-gnoles. Si nous nous attarderons sur les assauts de cette année particulière, ce n’est pas parce qu’ils ont été plus médiatisés suite aux morts qu’ils ont causées, mais parce que de nombreux migrants ont pu raconter ensuite leur aventure, et surtout parce que cette expérience d’auto-organisation et de détermination qui brise les schémas victimistes parle à tout individu qui a la liberté et la rage au cœur.
La bonne entente hispano-marocaine
La frontière, longue de plus de 8 kilomètres à Ceuta et 10 à Melilla, est protégée par un double grillage en acier renforcé (contre les sécateurs), haut de 3 à 6 mètres selon les endroits, la Valla. Elle comporte une trentaine de miradors, des caméras thermiques et des appareils de détection à infrarouge. Une fois le premier grillage franchi avec des barbelés à son sommet, il faut se jeter dans la zone de l’entre-deux et soit chercher à forcer le passage des rares portes, soit escalader le second. A Melilla, il faut encore courir et se cacher pour gagner le centre ville, où seule la préfecture enregistre les demandes d’asile. Tous les autres sont impitoyablement rendus aux marocains après un tabassage en règle. Les gardes espagnols sont notamment équipés de bal-les en caoutchouc qui font des ravages, et disposent en outre d’une bonne motivation pour s’en servir : une prime de 500 à 800 euros par mois pour occuper ce poste.
L’ensemble du dispositif de sécurité, sur terre mais aussi en mer, a été dénommé Sive (Système intégré de vigilance externe). Créé en 1998, il est devenu opérationnel en août 2002 le long d’Algésiras, à l’embouchure du détroit de Gibraltar, puis s’est étendu à Malaga et l’île de Fuerteventura (Canaries) en décembre 2003, avant Cadiz et Grenade en novembre 2004, puis Ceuta, Melilla et Lanzarote (Canaries) en janvier 2005. Et enfin Tenerife, La Gomera, El Hierro, Valence, Alicante, Murcia et Ibiza en 2007. C’est à Cadiz que se trouve El Mando, le centre opérationnel de la guardia civil qui gère le Sive, passé d’un système de contrôle exclusivement terrestre à un dispositif très complexe en temps réel intégrant bandes vidéo, liaison satellitaire, radars, caméras thermiques et infrarouges, lecteurs automatiques de plaques d’immatriculations et détecteurs de pulsations cardiaques dans les ports, le tout appuyé par des unités d’intervention rapide comme des vedettes maritimes et des hélicoptères équipés d’aides à la navigation nocturne. L’aire d’influence du Sive couvre, dans les textes adoptés à Bruxelles en novembre 2003 sur les centres de contrôle des flux migratoires du Sud, toutes les eaux du Portugal, de la France et de l’Italie (Maroc, Algérie, Tunisie comprises, qu’elles le veuillent ou non). Le second Sive, basé en Grèce, doit voir le jour face à la seconde route des trafics de marchandises (humaines ou matérielles) utilisée dans les Balkans, la Turquie, l’Egypte et la Libye. Notons aussi qu’une des deux entreprises qui a installé le Sive, Amper, a déjà exporté son système à la Serbie et la frontière russo-lettone, tandis que l’autre, Indra, l’a exporté à Hong Kong.
C’est donc à un véritable bouclier européen de surveillance pour la Méditerranée que le Maroc se trouve associé par sa frontière de Ceuta et Melilla (et les nombreuses îles partagées dans le détroit), effectuant ainsi la fonction de gendarme extérieur. Dès 1999, ce pays faisait il est vrai déjà partie de la liste de ceux désignés comme prioritaires par l’Union Européenne afin d’élaborer des plans d’action visant à stopper les migrants (aux côtés de l’Albanie, de la Somalie ou de l’Afghanistan). Il a ainsi adopté en novembre 2003 une loi « relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Maroc et à l’immigration et l’émigration irrégulières » créant notamment le délit d’émigration illégale (articles 50 à 52, prévoyant jusqu’à 20 ans de réclusion). C’est en échange de ce genre de lois et des camps qui s’en suivent que l’Union Européenne monnaye son « aide au développement » et sa « coopération », un marché que dispute la Libye au Maroc pour l’Afrique du Nord. Le programme de La Haye (novembre 2004) a entériné officiellement pour cinq ans ce lien étroit entre politiques (anti)migratoires et subventions en tout genre.
On notera aussi en passant que si l’absence de papiers en règle, pendant longtemps un simple délit administratif, était déjà devenu un délit pénal en soi pour les immigrés en Europe, les États comme le Maroc, sur le modèle de l’ancien bloc de l’Est, sont à présent en train de créer en Afrique le délit pénal d’émigration. Ils posent encore une fois clairement que les individus leur appartiennent (et pas le contraire), et qu’ils ne peuvent quitter leur territoire qu’en fonction de leur bon vouloir. Sur l’exemple marocain, la Mauritanie a ainsi signé un accord avec l’Espagne visant à construire en 2006 un camp militaire à Nouadhibou pour y enfermer les candidats à l’exil de son propre pays. Le Sénégal a conclu un accord identique…
En 2004, les sources officielles parlaient de 55 000 escalades individuelles ou à petits groupes des seuls grillages de Melilla. Si ces chiffres marocains sont certainement gonflés en vue de montrer l’efficacité de la police locale et surtout de faire pression sur les subventions européennes en agitant sans cesse de nouveaux besoins de financement, ils témoignent cependant d’un mouvement réel qui était déjà loin d’être négligeable. Cette année 2004 a en effet vu une accélération du rapprochement hispano-marocain, pays en froid depuis le conflit autour de l’îlot de Leila-Perejil en juillet 2002 : accords sur le rapatriement des exilés subsahariens en février, première visite officielle à l’extérieur de Zapatero en avril, aide supplémentaire annoncée de 950 000 euros (s’ajoutant aux 70 millions promis) en octobre, extension du SIVE aux côtes marocaines près de sa frontière avec l’Algérie en janvier 2005, adhésion du Maroc à l’OIM (Organisation Internationale des Migrations, qui gère l’aide au retour) en février, signature de l’accord de pêche gelé depuis 2001 avec l’Union Européenne en juillet.
Une des contreparties sera bien sûr la politique marocaine contre les immigrés, et en particulier autour de Ceuta et Melilla.
Ratissages et pression policière
Ces villes offrent en effet un aspect singulier pour les exilés, qui est d’être bordées de montagnes et de forêts. Des campements informels vont donc s’organiser sur le mont Gourougou, dans la forêt de la ville Nador qui surplombe Melilla, comme dans celle de Ben Younech, au nord de Ceuta. Du 12 au 14 janvier 2005, trois jours avant la visite du roi Juan Carlos, près de 1200 membres des forces de sécurité marocaines, aidés de 25 véhicules militaires et de 3 hélicoptères démantèlent les campements informels de Gourougou, et arrêtent des dizaines de migrants. En février, c’est la forêt de Bel Younech qui est encerclée et assiégée, la principale source d’eau à l’entrée de la forêt bloquée. En mai se produisent de nombreux ratissages aux alentours pour capturer des réfugiés affamés qui tentent les allers-retours de la forêt vers des villages distants d’une petite dizaine de kilomètres (comme Fnidq) pour s’approvisionner, quant ils ne poussent pas jusqu’à la décharge municipale de Nador. Le 5 juillet, c’est le campement lui-même qui est investi et ratissé.
Chassés vers les montagnes escarpées, cachés dans des grottes ou des trous aménagés, réfugiés dans les agglomérations proches, une partie des migrants commence à se réorganiser du côté de Melilla et, le 29 août à partir du mont Gourougou, près de 300 d’entre eux tentent l’assaut des grillages. Ils sont repoussés à coups de balles en caoutchouc. Un petit groupe, encerclé par la guardia civil, fait l’objet d’un acharnement particulier dans le tabassage, provoquant des blessés graves et un mort (un Camerounais décédé suite à une hémorragie du foie). Malgré l’échec collectif, d’autres tentatives suivront pourtant du côté de Melilla, par petits groupes cette fois comme auparavant, notamment les 8 et 15 septembre. Tandis que plusieurs journaux locaux lancent une campagne raciste (Le Matin puis Ashamal, parlant de « ces gens-là » qui « polluent partout » ou de « criquets noirs » envahissant le pays), la police marocaine augmente la pression et procède à de grandes rafles : le 7 septembre dans le nord du pays puis le 27 septembre dans les quartiers populaires de Rabat, Casablanca, Tanger et Fès (1 100 arrestations).
De l’auto-organisation…
Au-delà de ces vastes opérations qui se sont de toute façon limitées techniquement et temporellement, l’approche de l’hiver, la pression des descentes de police en ville comme dans les bois et une bonne dose de rage vont pousser non seulement à regagner rapidement les forêts perdues au début de l’année, mais aussi à y préparer des vagues d’assaut qui seront cette fois massives et déterminées.
Selon les différents témoignages, l’auto-organisation se fait aussi bien par nationalités que par langues ou par réseaux de 10-15 personnes construits au fil d’un périple qui dure parfois depuis plusieurs années. De nombreux groupes se dotent de porte-parole ou chairman (pour les anglophones), qui regroupent les plus anciens selon l’ordre d’arrivée – certains ayant vécu plus d’un an dans la forêt. La coordination entre groupes ou communautés concerne les divers aspects matériels des campements : toilettes collectives improvisées et déchets (pour éviter la multiplication des maladies et épidémies), autoconstruction d’habitats précaires collectifs nommés « ghettos », équipes de secouristes pour soigner les blessés qui rentrent tous les soirs des tentatives discrètes de passage (jambes cassées, coupures profondes des barbelés) ou les malades, aidés en cela par des contacts irréguliers avec quelque ONG pour se procurer de rares médicaments. Enfin, concernant les conflits, plusieurs témoignages indiquent soit la présence de « sages », soit celle de « casques bleus » internes, créés à partir de juin suite aux tensions internes grandissantes générées par la pression policière.
On l’a dit, les premières attaques massives commencent en août à Melilla à partir du mont Gourougou. C’est un échec, mais elles provoquent de nombreux allers-retours de Bel Younech (Ceuta) à Gourougou (Melilla), et enclenchent à la fois un processus de réflexion collective (réunions informelles et assemblées) qui déboucheront malgré tout sur la poursuite de ce mode opératoire, mais aussi vers une vaste coordination technique : fabrication de nombreuses échelles artisanales de bois et de caoutchouc allant jusqu’à 10 mètres de hauteur, approvisionnements en gants ou substituts pour des centaines de personnes, choix d’un emplacement sur une bande de grillage qui fera jusqu’à 50 mètres de large en fonction de sa hauteur et de sa surveillance, organisation de groupes d’assauts et appel aux migrants des autres zones éloignées de la forêt. Des récits parlent aussi d’autres thèmes de débat abordés pendant les deux jours à Bel Younech comme la participation des femmes, qui aura finalement lieu, ou l’opposition entre certains chairman, certainement plus désireux de conserver leur petit pouvoir que de voir la forêt se vider en une sorte de tout pour le tout. Ces recompositions internes vont donc aussi voir l’apparition d’individus plus décidés, pour lesquels la liberté hors du piège marocain et le rêve de l’eldorado européen seront plus forts que les fragiles médiations établies pour gérer la survie quotidienne. Ce sont eux qui mèneront les groupes d’assaillants et seront les premiers à entendre siffler les balles de la guardia civil.
… aux attaques massives
Un mois après l’échec de la tentative de passage de 300 personnes à Melilla le 28 août 2005, ce sont près de 800 migrants qui cette fois se lancent dans un assaut en deux temps la nuit du 27 au 28 septembre. Près de 300 personnes parviennent à passer. Cette attaque victorieuse va donner des ailes à ceux de Ceuta, et forcer la décision collective.
La veille de l’ouverture du Sommet hispano-marocain à Séville, comme un pied de nez aux puissants qui eux sont bien capables de défendre leurs intérêts, en cette nuit du 28 au 29 septembre aux alentours de 23h, ce sont donc près de 500 migrants de la forêt de Bel Younech qui préparent leurs affaires. A 1h, ils partent en file indienne en direction de Ceuta. Arrivés devant les grillages vers 3h, là où justement il n’est encore haut que de trois mètres, le premier des cinq groupes lance les échelles et tout le monde suit. Les militaires marocains, alertés par les chiens, tirent à vue avec leurs fusils. Ils feront immédiatement deux morts et de nombreux blessés. Sous la lumière aveuglante des spots qui éclairent l’enclos, le deuxième groupe s’élance à son tour et attaque les grilles, puis les rouleaux de barbelés, mais ils sont déjà attendus par les gardes qui les cueillent en bas et commencent à les matraquer. Les réfugiés des deux groupes courent dans l’étroit boyau entre les deux clôtures, cherchant un passage vers Ceuta sans avoir à faire une nouvelle escalade et être tirés comme des lapins par les espagnols. La guardia civil obstrue rapidement les portes du second grillage avec ses véhicules. Ils tirent des gaz lacrymogènes mais aussi des balles en caoutchouc sur ceux qui y grimpent, tuant trois autres personnes sans toutefois empêcher la masse de passer. D’autres militaires espagnols sortent carrément du côté marocain et tirent dans le tas pour dissuader les hésitants des trois derniers groupes. Près de 225 personnes sont entrées dans Ceuta. Elles seront encerclées et s’asseyeront dans un coin contre la promesse de les conduire en ville (où elles pourront déposer une demande d’asile). Les forces anti-émeutes arrivent vers 4h du matin et tous les exilés sont durement tabassés puis directement remis aux autorités marocaines.
Face à ces attaques qui font du bruit et aux cinq morts qui gâchent un sommet qui avait pour but d’afficher la réussite des efforts conjoints des deux pays, des renforts sont aussitôt déployés à la frontière. Ils se montent à 1600 hommes côté marocain et 480 militaires espagnols, en plus des moyens techniques supplémentaires (comme 130 appareils de détection à infra-rouge). Tandis que les autorités marocaines multiplient les rafles, le secrétaire d’État espagnol à la Sécurité, Antonio Camacho déclare que « si ces avalanches se poursuivent, cela sera très difficile d’y faire front et je n’écarte pas d’autres situations non voulues », soit l’assassinat à bout portant de ceux qui viennent vendre leur force de travail à vil prix. Chacun sait pourtant qu’une fois enclenchée, aucune coercition n’est à même de briser aussi facilement une telle détermination collective, forgée au cours de mois de souffrances, de résistances et d’espoirs déçus. Et qu’il faudra y mettre le prix…
Une semaine pleine d’espoirs
Malgré tout cet arsenal, moins d’une semaine après, 650 nouveaux migrants repartent à l’attaque de Melilla le 3 octobre, vers 5h du matin. Cette fois, c’est un grillage de six mètres de haut plus ses barbelés qui est escaladé avec les échelles artisanales. Près de 300 parviendront une nouvelle fois à pénétrer dans Melilla, mais le nombre de blessés (tailladés, matraqués, touchés par les projectiles ou les coups de crosse) est important : 135, dont 5 dans un état grave. Sept policiers et militaires ont aussi été blessés dans l’affrontement (l’un souffre d’un traumatisme crânien), souvent à coups de pierres, tandis qu’une portion de la clôture métallique a été abattue. En représailles, l’État marocain promet de creuser un fossé de 3 mètres de profondeur aux abords de Ceuta, qui n’aura donc connu qu’une nuit de folie collective, et y poursuit sans trêve sa chasse à l’homme : la forêt de Bel Younech est investie, les campements brûlés, les militaires sont postés tous les 100 mètres, les patrouilles de jeep incessantes. 130 migrants y seront arrêtés. Quant aux abords de Melilla, c’est une autre paire de manche, puisque la montagne Gourougou couvre les réfugiés…
Le 5 octobre, pour la cinquième fois en huit jours, une vague de 500 personnes divisée en deux groupes monte à l’attaque du dispositif militarisé de Melilla, profitant d’un des derniers endroits de grillage situé à « seulement » trois mètres de hauteur. La bataille est rude, mais près de 65 migrants réussissent à franchir le double obstacle, tous dans un état pitoyable. Dans la mêlée, une jeep est retournée et un garde civil espagnol blessé dans l’opération. Deux nouvelles unités anti-émeutes de la Guardia civil sont aussitôt envoyées en renfort, tandis que Zapatero annonce la construction d’un troisième grillage, « ultrasophistiqué », « infranchissable » et… « inoffensif ». Demandant l’aide de l’Union Européenne, il obtient une promesse de 40 millions d’euros pour le Maroc contre la réadmission par ce dernier de tous les illégaux passés par son territoire pour entrer en Espagne (en fait la même chose que les pays de l’espace Schengen appliquent déjà entre eux), selon un accord de 1992 rarement appliqué.
Le 6 octobre, une dernière vague massive tentera le passage en force de la frontière de Melilla à partir du point de Rostrogordo, vers 3h du matin. La presse parlera initialement de 1 500 personnes, chiffre improbable vu le contrôle intense de la zone de partance, les rafles à grande échelle (85 arrêtés la veille et 134 le jour précédent à Nador, près de Melilla) et toutes les arrestations lors des tentatives passées. Ils étaient probablement autour de 500, comme la fois précédente, qui déjà avait vu fondre, et à quel prix, le nombre de migrants réussissant à passer malgré leur acharnement. Cette fois, personne ne passera et six exilés de plus seront assassinés par les forces de l’ordre (soit 17 à cette frontière depuis le début de l’été). Tout l’effectif marocain (gendarmerie et « forces auxiliaires » du ministère de l’Intérieur comprises) et espagnol attendait de pied ferme au bord les clôtures. Ce fut un massacre. Peu d’informations ont évidemment filtré sur cette dernière nuit tragique, et seul le nombre d’assassinés a fait quelques lignes. Juan José Imbronda, le gouverneur de Melilla, se contentera de déclarer sur une radio privée : « Les forces marocaines ont collaboré, c’est ce que nous attendions »…
Déportations de masse
L’Espagne a rapidement organisé la déportation vers le Maroc de toutes celles et ceux qui avaient franchi cette frontière terrestre si symbolique (la plupart des sans-papiers arrive en effet en Europe par les ports et les aéroports), via Malaga ou Algesiras, à l’exception d’un groupe de 140 personnes. Beaucoup ont ensuite été convoyés vers Oujda, à la frontière algérienne, par l’Office des Migrations Internationales et la Fédération internationale du Croissant Rouge, d’où ont décollé plusieurs charters : six avions de 140 expulsés vers le Sénégal du 10 au 12 octobre sur Royal Air Maroc, un boeing 747 affrété spécialement pour 400 expulsés le 11 octobre vers le Mali, suivi d’un autre avion de 200 le lendemain. 2400 autres Africains (Congolais, Ivoiriens, Guinéens, Gambiens,…) ont été dès début octobre déportés par cars vers le Sahara Occidental, dans le désert frontalier avec la Mauritanie ou l’Algérie.
Le 9 octobre, un mini-scandale éclatera ainsi lorsque 500 d’entre eux, convoyés par treize autobus, seront retrouvés dans la zone de Bouarfa, après avoir été abandonnés plusieurs jours avant à la frontière algérienne dans le désert, sans eau ni vivres. Ils seront ensuite détenus sur la base de Taouima et de Berden (près de Guelmim). Là, malgré ou peut-être à cause des conditions inhumaines infligées par les militaires, ils lutteront encore par une grève de la faim, demandant leur libération. Ce ne sera le cas qu’après un mois et demi de détention, tous expulsés vers le pays d’origine (Sénégal, Mali, Cameroun, Guinée, Gambie) ou vers les camps algériens. Et de la même façon, début décembre, l’Algérie procédera à des rafles massives et videra ces camps de réfugiés, comme celui de Maghnia (ville frontalière en face d’Oujda), en en déportant à son tour certains dans le désert, près de la frontière malienne.
Tout continue…
Inutile de dire que faire reculer la frontière n’a rien changé, sinon le nombre de morts, vu l’accroissement des difficultés : les pateras partent désormais plus nombreuses de Mauritanie et du Sénégal vers les Iles Canaries que du Maroc, et dans ce dernier cas plus d’El Ayoune que de Ceuta. Quant aux migrants parvenus au Maroc et en attente d’un passage, ils ont de la même façon reculé de la forêt du mont Gourougou, près de Melilla, vers celle de Mariwari, près de Nador. Ce qui n’a pas bougé, ce sont en effet les lumières de la ville espagnole, qui continuent d’attirer les exilés malgré le renforcement du dispositif (le Maroc annonce 960 arrestations dans la zone pour les 5 premiers mois de 2008).
Ce dernier comprend en effet désormais un premier système de piquets mobiles pour empêcher les échelles de se poser, suivi d’un enchevêtrement de câbles et de filins de 6 et 12 mm qui se tendent avec le poids de la personne pour l’immobiliser. Le premier grillage dispose pour sa part d’un système d’alarme et surtout de diffuseurs de gaz lacrymogène au piment sous pression. L’alarme déclenche aussi de très puissants spots disposés tous les 125 mètres, le tout étant précédé de radars et de détecteurs de mouvement. Les tours de contrôle sont au nombre de 17 pour une dizaine de kilomètres à peine. Ce joujou technologique dénommé MIR (Muraille intelligente radicale), installé à partir de l’été 2006, a coûté la bagatelle de 20 millions d’euros, et laisse la sale besogne aux marocains, qui ont installé un poste militaire tous les 100 mètres d’où ils patrouillent mitraillettes en main et chiens à l’appui, financés par les fonds européens.
Nous aurions pu en rester là, avec la domination qui reprend le dessus dans cet épisode de la guerre sociale, si une information récente n’était pas venue nous rappeler que l’histoire n’est pas un continuum temporel qui se déroule avec son passé révolu et son éternel présent, mais qu’elle avance par bonds. Ces luttes d’exilés à base d’auto-organisation, de solidarité et de courage auraient ainsi pu rester cloisonnées en ce début d’automne 2005. Et pourtant… Les 21 et 22 juin 2008, deux nouvelles vagues de migrants d’Afrique subsaharienne ont à nouveau victorieusement forcé l’entrée de Melilla, réussissant à pénétrer dans l’enclave espagnole. Renouvelant l’attaque de juillet 2006 où c’est directement le poste frontière de Beni-Asnar (près de Nador) qui avait été visé, coûtant la vie à un assaillant, près de 70 d’entre eux ont affronté directement les gardes le 21 juin vers 4h30, munis de pierres et de bâtons. S’élançant en groupe compact, ils ont enfoncé les gardes marocains puis espagnols (en en blessant trois) et une cinquantaine est passée, déclenchant alors une vaste chasse à l’homme. Certains ont été retrouvés dans des arbres ou sous des voitures, tous ont été conduits en centre de rétention, prochaine étape vers une possible relaxe dans les rues du continent. Bien inspirés, d’autres, moins nombreux, ont réitéré l’opération le lendemain soir, 22 juin, profitant cette fois de la séance de tirs au but du quart de finale de l’Euro 2008 entre l’Espagne et l’Italie, à une heure plus avancée, vers 21h15, mais avec moins de réussite.
Ce nouvel épisode de fraîche date nous rappelle donc à point nommé que tant qu’existeront les États et leurs frontières, il n’y aura pas de mur assez solide, fut-il technologisé à outrance, qui pourra contenir la rage et l’espoir des dominés en quête d’une vie meilleure. Il y aura toujours des forêts et des montagnes d’où partiront les assauts contre ce monde de mort. Des confins des déserts au cœur des métropoles.
Un sans-patrie
Beau comme des centres de rétention qui flambent
Australie
L’Australie a connu du 27 au 30 décembre 2002 une vague d’émeutes et d’incendies qui ont ravagé cinq de ses sept centres de rétention. Si ce pays, comme beaucoup d’autres, possède une solide tradition de camps (des délinquants anglais déportés pour coloniser l’île-continent aux aborigènes jusque dans les années 60, en passant par les prisonniers allemands fournis par les États-Unis pendant la guerre), il offre la particularité d’incarcérer pendant des années les immigrants dans d’immenses centres de rétention jusqu’à la décision concernant leur cas - souvent des demandes d’asile.
Les camps de rétention
C’est le gouvernement travailliste qui a décidé en 1992 d’incarcérer dans des camps de rétention l’ensemble des demandeurs d’asile débarquant sans papiers. Près de 3000 personnes y végètent actuellement, dont environ 600 mineurs. Les réfugiés proviennent pour un tiers d’Afghanistan puis d’Irak et du Moyen-Orient, le reste étant originaire d’Asie. Depuis septembre 1997, leur gestion a été confiée à un groupe privé, l’Australasian Correctional Management (ACM), une filiale du groupe américain Wackenhut qui possède déjà 55 prisons dans sept pays. Bien entendu, ses employés ont tout loisir d’exercer leur cruauté avec la bénédiction de l’état australien. Cette firme a été absorbée en mai 2002 par le plus grand groupe mondial de sécurité privé, Group 4 Falck [4]. Ce dernier gère notamment les centres de rétention en Angleterre, dont celui de Yarl’s Wood (nord de Londres) qui a brûlé en février 2002 suite à une révolte. Il possède aussi la prison australienne de Port Philip (à Melbourne) où il est régulièrement mis en cause pour le taux de « suicide » élevé des prisonniers. Depuis le 23 décembre 2002, il a remporté le marché des camps de rétention de ce pays pour un montant de 100 millions d’euros par an, en offrant des prix encore inférieurs à ceux d’ACM. Le ministre de l’immigration, Philip Ruddock, a même tenu à préciser que Group 4 serait payé en fonction de son rendement « en termes d’émeutes et d’évasions ». Car dans cette situation de délais insupportables sans perspective, de conditions concentrationnaires (des tentes dans le désert comme à Woomera, entourées de barbelés électrifiés et blindées de matons-vigiles et de caméras), tortures, soins médicaux défaillants (comme ce témoignage d’un réfugié qui est resté quinze jours avec une jambe cassée avant d’être soigné), les révoltes se multiplient. En juin 2000, près de 700 réfugiés s’évadent des camps de Woomera, Curtin et Port Hedland puis se rendent dans les centres-villes pour protester contre leurs conditions. Suite à des manifestations depuis le 25 août devant le camp de Woomera, certains se révoltent, jettent des pierres contre les matons, incendient des bâtiments (réfectoire, école, nettoyage, « détente ») dont celui de l’administration. « Le 28 août, ils utilisaient les piquets de construction d’une seconde clôture comme des lances contre les matons tout en essayant de s’échapper à travers les trous dans la clôture ». En août 2000, des Chinois (principalement) fomentent une émeute qui blesse treize matons et cause des millions d’euros de dégâts en détruisant notamment trois bâtiments.
En janvier 2001, près de 180 réfugiés, pour la plupart du Moyen-Orient, attaquent les matons avec des briques et des barres de fer et prennent le contrôle du camp avant que la police intervienne. Le 27 février 2001, 40 réfugiés s’attaquent aux matons pour protester contre l’expulsion de trois des leurs vers le Moyen-Orient. Le 3 avril 2001, 200 réfugiés du camp de Curtin « abattent des clôtures intérieures, font des trous dedans, allument des feux et incendient entièrement deux préfabriqués » selon la police.
En novembre 2001, nouvelle émeute à Woomera, trois bâtiments sont incendiés.
Outre les tentatives d’évasion individuelles ou certaines immolations par le feu suite à un refus d’asile, près de 350 réfugiés de Woomera entament une grève de la faim qui durera seize jours en janvier 2002 pour obtenir que le dossier des Afghans soit examiné et qu’ils ne soient plus renvoyés « chez eux » suite à la chute des Talibans. Cinquante d’entre eux s’étaient en plus cousus les lèvres et l’un d’eux s’était volontairement jeté dans les barbelés du haut d’un grillage. Le gouvernement a cédé, pour une fois seulement.
Enfin, suite à des mobilisations en mars 2002 devant le camp de Woomera, l’attaque extérieure des clôtures et les affrontements entre manifestants et forces de l’ordre a permis à 35 sans-papiers de s’évader (15 sont toujours dans la nature) ; une cinquantaine s’échappera aussi le 27 juin 2002. Face à tout cela, l’Etat n’est cependant pas resté inactif. Le 19 octobre 2001, un bateau sombre au large de l’Australie mais dans les eaux internationales, avec à son bord 424 personnes (dont 150 mômes). Ce pays avait refusé l’accostage du Harapanindra et l’avait renvoyé vers l’Indonésie d’où il était parti. Des pêcheurs Indonésiens ne récupéreront que 45 survivants de ce rafiot de 19,5 mètres de long sur 4 de large, de nombreuses heures après. Un des responsables de la police fédérale australienne Mick Keelty a refusé de répondre à toute question d’une commission d’enquête sénatoriale bidon au nom de « l’intérêt public ». Deux mois avant, en août 2001, le gouvernement australien l’avait joué plus finement : après avoir empêché le cargo norvégien Tampa d’accoster sur les côtes australiennes de l’île Christmas avec 460 Afghans à son bord, il les a déportés vers le micro-état de Nauru (où ils poirotent toujours). Un premier groupe de 800 et un second de 400 demandeurs d’asile les ont ensuite rejoints dans cette déportation. C’est depuis cette date que la marine de guerre australienne empêche les bateaux de réfugiés de s’approcher, avec comme conséquence immédiate l’assassinat des centaines de personnes du Harapanindra deux mois après. Aujourd’hui, près de 2200 réfugiés (afghans, sri-lankais et irakiens) végètent dans des camps sur l’île de Nauru (12 000 habitants sur 12 km2), l’Alcatraz australien. Ce micro-pays s’est enrichi entre 1919 et 1968 par l’exploitation de mines de phosphore et, désormais à cours de ressources (sans terre cultivable mais paradis fiscal), a volontiers accepté le deal de son voisin : l’épongement de sa dette (déjà 18 millions d’euros et d’autres à suivre avec la construction de nouveaux camps) et tous frais payés pour le fonctionnement des camps. L’Australie a déjà versé 29 millions d’euros aux gouvernements de Papouasie-Nouvelle-Guinée (autre état qui a déjà accepté 1000 réfugiés dans des camps australiens) et de Nauru pour installer ses camps. Son budget total s’élève à 170 millions d’euros et 120 sont prévus chaque année pendant au moins cinq ans. Les îles de Kiribati, Palau et les Iles Cocos sont en pourparlers après le refus de Fidji. La marine australienne emploie désormais cinq navires de guerre et quatre avions de reconnaissance uniquement pour chasser les bateaux de sans-papiers, en plus de ses garde-côtes. Enfin, les travaillistes et les conservateurs unis ont durci les lois sur l’immigration en septembre 2001, autorisant la marine à remorquer de force les bateaux ancrés dans ses eaux territoriales, instituant un visa de résidence renouvelable tous les trois ans pour les immigrés entrés clandestinement (supprimant l’espoir d’obtenir un permis de résidence définitif) et interdisant le regroupement familial. Cette nouvelle loi, la déportation à Nauru et la chasse du Harapanindra au prix de 353 assassinés ont subsidiairement permis au premier ministre John Howard d’être réélu pour un troisième mandat le 10 novembre 2001. Le 11 septembre 2001 ou l’attentat de Bali le 12 octobre 2002 (192 morts dont 88 Australiens dans une boîte de nuit) n’ont ainsi que peu modifié la donne dans la continuité raciste de l’État australien. A une exception près : le gouvernement accuse maintenant en plus les camps d’ « héberger » des terroristes et a lancé une campagne anti-« terroriste » de trois mois le 29 décembre 2002.
Les belles émeutes de décembre
Le climat était donc à son comble lorsque cinq des sept camps se sont embrasés, lorsque les prisonniers ont décidé une nouvelle fois de prendre leur destin en main. Le vendredi 27 décembre, un premier incendie se déclenche au camp de Baxter, détruisant trois chambres et un bloc sanitaire du bâtiment Red 1. Les réfugiés sont transférés dans le bâtiment Red 2. Le camp de Baxter, situé à proximité de la ville de Port Augusta dans le sud de l’Australie, est en projet depuis le 23 août 2001 et sa construction a été achevée un an plus tard. Bâti dans l’enceinte d’un terrain militaire, il est de type prison de haute sécurité, avec barbelés électrifiés, vidéosurveillance 24h/24, mitard (où on peut rester menotté avec un bandeau sur les yeux), tabassages et règlement intérieur blindé : demande écrite pour circuler à l’intérieur du camp, politesse obligatoire, etc. « Depuis que l’on a comparé Woomera à un enfer, il n’y a plus de termes pour qualifier Baxter », selon un prisonnier. Le samedi 28 au soir, ce sont trois nouveaux feux allumés à partir des literies, du mobilier et des rideaux des bâtiments Red 2 qui embrasent le centre, détruisant cette fois partiellement le camp, 64 des 79 chambres (17 des 19 bâtiments) sont détruites ou endommagées. Le lendemain, un dernier incendie qui démarre à partir du réfectoire du quartier White 2 (où sont regroupés les détenus) tente d’achever le travail, 17 nouvelles chambres partent en fumée. Ce camp dernier-cri à peine construit pour une somme de 22,3 millions d’euros, subit là une première critique pratique pour le moins radicale de la part de ses 215 détenus (55 sont plus précisément accusés, ceux dont la demande de visa a été rejetée après appel) qui le rendent en grande partie inutilisable. 11 réfugiés et deux matons ont reçu des soins suite à l’inhalation de fumées toxiques, les premiers ayant été parfois obligés de demeurer à l’intérieur des bâtiments en feu par des gardes en tenue anti-émeute. La première réaction pleine de bon sens récupérateur est venue du directeur du bureau du développement local de Port Augusta, Andrew Eastick : « Bon, il y aura clairement des retombées économiques même s’il est tragique que nous pensions en ces termes. Mais il y a évidement un travail de reconstruction et de déblaiement qui doit être fait, et la majeure partie de ce travail échouera à des entreprises et des gens du coin. »
Le camp de Port Hedland (à l’ouest de l’Australie) est construit sur la base de bâtiments qui ont accueilli les célibataires des industries minières dans les années 60, à l’intérieur d’un quartier résidentiel. Il est devenu un camp de rétention en 1991, notamment à cause de la proximité d’un aéroport international permettant facilement les déportations. Le dispositif de sécurité a été considérablement renforcé en 2001 et le camp comptait 146 personnes réparties dans les 11 blocs au moment de l’émeute. Celle-ci débute dans la nuit du dimanche au lundi 30 décembre, suivant celle de Baxter. Le feu détruit un camion de pompiers, un énorme entrepôt (après effraction) et l’un des blocs d’habitation. Plusieurs maisons du voisinage ont dû être évacuées à cause de la fumée, deux matons soignés pour les mêmes raisons. 20 réfugiés sont spécifiquement sur la sellette. La moitié des 16 cellules du poste de police de South Hedland ont immédiatement été réservées par ACM (la boîte privée qui gère les camps), en attendant les premières enquêtes. En termes financiers, les dégâts sont plus importants qu’à Baxter (environ 1,7 millions d’euros).
Le troisième camp à s’embraser, après celui de haute sécurité de Baxter et celui qui sert de sas avant la déportation, Port Hedland, est Woomera (sud de l’Australie). Selon le ministère de l’immigration, les émeutes dans les camps de rétention avaient déjà causé près de 2,8 millions d’euros de dégâts au cours des 18 derniers mois, dont les ¾ sont attribués à celles de Woomera. Construit en plein désert à 500 km d’Adelaïde à la fin des années 50 pour abriter les travailleurs qui ont construit un complexe de bureaux, ce site est devenu un camp en novembre 1999, continuellement agrandi et avec des dispositifs de sécurité en constante augmentation. Deux premiers feux sont allumés le dimanche 29 décembre au matin dans le bloc sanitaire (5 bâtiments abritant les toilettes sont réduits en cendres). Le lendemain soir, ce sont deux quartiers d’habitation (37 bâtiments) et deux réfectoires qui sont incendiés et partiellement ou totalement détruits. Les pompiers mettent plus de quatre heures à les éteindre. Les 130 réfugiés, principalement du Moyen-Orient et d’Afghanistan, doivent être évacués vers un autre quartier inutilisé. Les dégâts sont encore supérieurs aux précédents, montant à 1,95 millions d’euros. 7 hommes sont immédiatement transférés en prison. Une vaste perquisition est menée dans le camp, pendant que les réfugiés passent deux jours assis et menottés sur le terrain de basket, sous le soleil brûlant de l’été et sans eau, de 10 heures du matin à 9 heures du soir. Les trois familles du camp sont transférées à Baxter alors que les autres, célibataires, subissent des pressions pour signer leur accord en vue d’une expulsion vers l’Iran ou l’Afghanistan (la plupart ont épuisé leurs recours, le tribunal ayant par exemple rejeté, au cours de sa session 2001-2002, 62 % des appels pour les Afghans et 87 % pour les Irakiens). Le téléphone a été coupé, les prisonniers interdits de courrier et sans possibilité de cantiner.
Le lundi 30 décembre, un soulèvement a lieu dans le camp de Perth. Un maton est blessé au visage. Au départ, la police a tenté de s’emparer de deux réfugiés qui devaient être conduits à l’aéroport pour y être déportés. Leur rébellion a provoqué la solidarité d’une quinzaine d’autres, ce qui a nécessité l’intervention de la police anti-émeutes. 4 personnes sont désormais accusées d’agression et de rébellion (à leur arrestation) et incarcérées.
Ce même jour, c’est un quatrième camp (après Baxter, Port Hedland, Woomera) de rétention qui prend feu. Le camp de Christmas Island est situé au large de l’Australie, à 2400 km à l’ouest de Darwin, et à 550 km au sud de l’Indonésie dans l’océan indien. C’est un bagne isolé où sont directement transférés les boat-people des bateaux arraisonnés dans les eaux australiennes (les autres sont repoussés par la marine de guerre australienne avant même de les atteindre ). La quarantaine (?) de prisonniers mettent le feu en deux endroits, dont le réfectoire, et prennent le contrôle du camp, armés de piquets de tentes et de tuyaux. Les pompiers doivent donc dans un premier temps rester à l’extérieur, tandis que les anti-émeutes affrontent les réfugiés. « Nous savons qu’aucun revolver n’a certainement pas été utilisé » a déclaré Jenny Hoskin, porte-parole du ministère de l’immigration, ce qui augure tout même de la vigueur de l’affrontement. Après le rejet de leurs demandes de visa, les boat-people avaient déjà enflammé une première fois un bloc d’habitations et le hall du réfectoire le 7 décembre dernier. Très peu d’informations ont filtré dans la presse australienne sur la révolte dans cette île.
La dernière émeute, la plus violente aussi peut-être de ce week-end, s’est produite dans le camp de Villawood situé à Sydney. Ce camp comporte la particularité d’incarcérer les personnes dont le visa a expiré, celles qui ne remplissent plus les conditions (en dehors du quota fixé par emploi et nationalité, condamnation, travail au noir) et celles qui ont été interceptées dans les aéroports et les ports. Les réfugiés sont tous en attente d’expulsion, le nombre officiel étant de 513 (393 hommes, 88 femmes, 32 enfants). Les dégâts ont été moins importants que dans les autres, 280 000 euros, mais la révolte plus offensive : après avoir allumé six feux autour d’équipements surveillés dans la nuit du 31 décembre vers 10h30, 35 détenus ont tenté de s’évader en volant un véhicule de matons pour s’en servir comme bélier. Ils auraient été stoppés par un véhicule de police bloquant les portes. Ils ont également attaqué les matons avec des barres de fer. Selon un porte-parole du camp, « environ 60 à 80 « détenus » ont également mené une émeute dans une autre partie de Villawood ». De nombreux dortoirs et un bloc consacré aux loisirs (sport ?) ont été détruits, les feux n’ont pu être éteints que trois heures après. 15 prisonniers ont ensuite été incarcérés dans les prisons de haute sécurité de Silverwater et Parklea (Sydney) pour émeute et tentative d’évasion. Leur nationalité montre notamment que la révolte peut dépasser les fausses divisions d’origine : Chine, Vietnam, Espagne, Turquie, Jordanie, Angleterre.
Le total des dégâts causés par les émeutes dans tous les camps est désormais estimé à au moins 4,7 millions d’euros.
Angleterre
L’émeute qui a rasé la moitié du plus grand centre de rétention d’Angleterre, Yarl’s Wood, le 15 février 2002 est devenue le symbole des révoltes dans ce pays. On notera cependant que d’autres révoltes lors de transferts ou par la grève de la faim, comme à Rochester de janvier à mars 1997, ont accompagné la mise en place des camps. Car contrairement à sa réputation, l’Angleterre n’a rien d’un havre de paix pour les immigrés sans-papiers. En juin 2001, il y avait 688 détenus dans les 10 centres de rétention et 1 142 sans-papiers dans les prisons, la grande majorité sur simple demande de la police de l’immigration. Certains attendent là le résultat de leur appel contre le refus d’une demande d’asile. Il s’agit en général de sections spéciales des prisons. Suite au scandale de sans-papiers incarcérés pour ce seul fait, de nouveaux centres de rétention ont été construits… et des quartiers de prisons transformés en centres. En mai 2002, il y avait en tout près de 3 500 places, soit un nombre de retenus facilement supérieur.
Le transfert d’un centre de rétention à la prison est souvent une mesure disciplinaire, et trois quarts des retenus ne sont pas en situation irrégulière mais demandeurs d’asile, dont une centaine incarcérés depuis plus d’un an en septembre 2000. Les demandeurs d’asile qui ne sont pas en prison sont assignés à résidence, de préférence dans un coin perdu. Ils doivent pointer périodiquement dans un enforcement center, où on en profite pour les fouiller. Ils n’ont pas le droit de travailler et, pour mieux les tenir, la misérable allocation qui leur est versée se fait presqu’exclusivement sous forme de bons valables uniquement dans certains magasins, sans rendu de monnaie. La grande bénéficiaire de cette méthode est la Sodexho française, qui émet les bons.
Un centre flambant neuf
Le centre de Yarl’s Wood, géré par le groupe privé Group 4 Falck a ouvert le 19 novembre 2001 dans le Bedfordshire, avec 900 places, en faisant le deuxième plus grand d’Angleterre. Dès le 10 décembre, il y a eu une série de grèves de la faim et de refus de repas, et massivement à partir du 18 janvier 2002, contre les conditions inhumaines de détention et notamment la pratique de menotter les retenus à tout bout de champ (comme lors des transferts à l’hôpital). Le 14 février, des gardiens menottent une femme de 55 ans, malade depuis trois jours sans médicaments, et la traînent par terre pour l’emmener à l’hôpital. Un groupe de retenus s’interpose, la protestation s’étend en un éclair et 200 retenus montent sur le toit (sur 383 de compte le centre à ce moment-là). Un incendie est allumé vers 20h dans le hall de réception, suivi de deux autres dans les ailes D (hommes) et C (mixte), qui brûlera la moitié du centre, pendant que se produiront de durs affrontements entre retenus et gardiens jusqu’à 7 heures du matin. Deux d’entre eux sont attaqués et leurs clés dérobées, quatre autres enfermés de force dans un bureau. Les détenus ont ensuite affronté les forces de police anti-émeute accourues au secours des gardiens privés, non sans penser à détruire les caméras de sécurité et la salle de contrôle high-tech qui contenait les enregistrements.
Les pompiers ont mis une heure à pénétrer dans le centre après leur arrivée, et de mauvaises langues prétendent qu’ils en ont été bien empêchés par quelques révoltés, le temps que le feu fasse son travail. Pendant ce temps, 20 prisonniers se sont échappés et seuls 8 ont été repris, malgré les deux hélicoptères et les chiens lancés dans les collines et les champs alentours pour les reprendre. Suite à l’incendie, les retenus ont été transférés à Campsfield House (Oxford), le centre a été fermé, puis réouvert et agrandi. Quand le Group 4 Falck a lancé une campagne de recrutement pour compléter ses effectifs en vue de la réouverture, chacun de ses rendez-vous a été contesté par des manifestations. Quant au verdict contre les onze inculpés d’émeute et incendie, il est tombé le 15 août 2003 : sept acquittements, trois condamnés pour violences et un pour émeute. Ils ont pris près de 4 ans ferme chacun.
Un rapport officiel publié en novembre 2004 précisera que ce centre tout neuf avait été construit à la va-vite en même temps que deux autres, pour remplir les objectifs fixés de 30 000 expulsions par an. Cela explique selon lui la vitesse de propagation de l’incendie sur du matériel de mauvaise qualité et l’absence d’extincteurs, alors qu’il est incapable de voir que la privation de liberté et des conditions de détention particulièrement insupportables, vu son objectif de simple centre de transit confié à une boîte privée en vue d’expulsions massives, ont fait l’essentiel. Ainsi, la plupart des retenus étaient en attente d’expulsion, tous leurs recours ayant été épuisés, et une petite partie arrivait de prison, où ils avaient été en punition. Il confirme par ailleurs qu’un gardien a été gravement blessé en sautant du deuxième étage pour échapper aux émeutiers auxquels il voulait barrer l’accès aux ateliers. Enfin, les dégâts finaux sont estimés à 100 millions de Livres, soit les deux ailes incendiées et une partie des autres saccagées jusqu’aux toits.
Harmondsworth prend le relais
Mais les émeutes et incendies n’allaient pas s’arrêter en si bon chemin. Après Yarl’s Wood en février 2002, c’est le centre de rétention de Harmondsworth qui allait faire parler de lui le 19 juillet 2004 puis le 29 novembre 2006.
Situé près de l’aéroport d’Heathrow (à l’ouest de Londres), ce centre de deux fois 550 places a ouvert en 2001 et était géré par l’entreprise privée Uk Detention Services (UKDS), en contrat pour huit ans avec le ministère de l’Intérieur, rebaptisée Kalyx Ltd suite à la première révolte. En mai 2004, éclate une première grève de la faim collective de 220 retenus, protestant contre la longueur des procédures et les violences des gardes. Le 19 juillet vers 20h, un demandeur d’asile kosovar de 31 ans est retrouvé pendu, sa demande venant d’être rejetée et son expulsion programmée pour le lendemain (il y a eu 17 suicides officiels en centre de rétention de 2001 à 2006 et 185 auto-mutilations rien que pour les 10 premiers mois de 2006). La nouvelle se diffuse alors comme une traînée de poudre et un groupe de Jamaïcains refuse de réintégrer les cellules vers 23h. L’affrontement avec les gardiens tourne à leur avantage et ces derniers se retirent. La révolte s’étend alors rapidement et les insurgés commencent à mettre le feu et à détruire la structure. Une petite centaine continuera jusqu’à 9h du matin, lorsqu’ils seront défaits face à la police, aux matons et à leurs groupes spécialisés anti-émeutes (les « tornado teams »). Le camp de Harmondsworth sera en partie fermé suite aux dégâts structurels (22 millions de Livres) et nombre de détenus seront transférés.
Suite à cette révolte, les conditions de détention se rapprocheront encore un peu plus de celles d’une prison de haute sécurité. A titre d’exemple, et en plus des tabassages punitifs, les matons ont institué le rapport disciplinaire, nommé I.P. dans leur jargon, sachant que plus de deux rapports envoyaient directement au mitard (une heure de promenade par jour et isolement total sans affaires personnelles). Les retenus ont raconté comment des I.P. étaient bien entendu totalement arbitraires, comme le fait d’adresser la parole à un garde « de manière maléduquée » ou pour « non-coopération ». Cet isolement qui va jusqu’à 45 jours avait été utilisé près de 129 fois à Harmondsworth rien que pour les six premiers mois de 2006. Un second facteur de l’explosion est liée au durcissement des conditions extérieures : en plus d’incarcérer les immigrés en attente de déportation ou en attente de révision de leur refus de permis de séjour, Harmondsworth a vu croître de façon exponentielle au cours des dix mois précédant la seconde révolte la quantité d’immigrés incarcérés suite à un passage en prison. Le ministre de l’Intérieur John Reid avait en effet multiplié les dispositifs pour accélérer l’expulsion de tout étranger ayant commis un délit, y compris lorsqu’ils avaient la citoyenneté britannique depuis des années (soit un permis de résidence). Nombre de fils d’immigrés ayant grandi en Angleterre se sont retrouvés ainsi pris dans les filets de la double-peine.
Si les causes conjoncturelles liées à la révolte n’ont pas filtré, l’enfermement suffit à expliquer que du 28 au 29 novembre 2006, c’est l’ensemble du centre et ses quatre ailes qui ont été cette fois saccagés pendant 18 heures par les 484 retenus : sanitaires, murs, fenêtres, caméras de surveillance. Initiée vers 12h30, la révolte s’est amplifiée à partir de 23h30 lorsque le feu est venu remplir son office ravageur, aidé ensuite par l’inondation générale provoquée par les détecteurs anti-incendie. Se servant de couvertures, certains révoltés ont également composé le texte géant « SOS FREEDOM » (Sos, Liberté) dans la cour, qu’un hélicoptère de la télé Sky News a diffusé, provoquant immédiatement le black-out du coin, décrété « zone d’opération avec interdiction de survol ». Enfin, une tentative de tractation a eu lieu pendant les affrontements dans l’aile C du centre : parlant au nom des autres, des retenus acceptaient l’expulsion immédiate des déboutés définitifs (« plutôt déportés que prisonniers à temps indéterminé [jusqu’à 3 ans] dans un méandre juridique ») en échange de la liberté conditionnelle pour tous les autres. Mais même ce réformisme revendicatif n’a suffi à éviter l’intervention des flics, pas plus qu’il n’a freiné la rage des autres (Jamaïcains, Iraniens, Irakiens, Kenyans, Nigérians,…), achevant la démolition entreprise deux ans auparavant.
Les retenus ont été transférés, et les dégâts se montent à plusieurs millions de Livres.
Campsfield House en révolte
Le centre de rétention de Campsfield House, d’une capacité de 218 places pour des demandeurs d’asile en cours de procédure mais aussi en attente de déportation, est situé à Kidlingtown, dans le Oxfordshire. Ouvert en 1993, il est géré depuis septembre 2006 pour trois ans par l’entreprise américaine GEO, prenant la suite de Group 4.
Le 20 août 1997, une gigantesque émeute causait près de 100 000 Livres de dégâts au centre, pendant qu’une manifestation de solidarité se déroulait à l’extérieur. 13 retenus furent arrêtés et 9 renvoyés en procès pour saccage et incendie volontaire (un Libanais et trois Caribbéens ont été sortis de l’histoire, ne laissant que neuf Africains de l’ouest face à la justice, alors de toutes les nationalités étaient présentes pendant l’émeute). Incarcérés dans les prisons de Bullingdon et Reading, ils seront tous acquittés le 18 juin 1998.
Ces derniers temps, de nombreuses révoltes ont à nouveau perturbé la normalité de l’inhumanité carcérale, la remettant au centre de l’actualité. En mars 2007, une émeute éclate vers 7h du matin, suivie d’un incendie, provoqués par l’expulsion « violente » d’un retenu. En juin 2004 déjà, une révolte similaire avait éclaté suite à l’expulsion d’un Algérien. Si les dégâts ne sont pas précisés, on relève neuf blessés, dont sept membres du personnel intoxiqués par les fumées. En août 2007, lors d’un incendie volontaire, près de 26 demandeurs d’asile parviennent à s’évader (8 sont toujours dans la nature). En décembre 2007, ce sont près de 120 retenus qui repartent en émeute lorsque les gardiens tentent d’extraire un des leurs de la cellule vers 5h30 en vue d’une expulsion. De brefs affrontements ont lieu, les installations électriques des couloirs sont détruites, tout comme les caméras de vidéosurveillance. Les toilettes sont bouchées et provoquent l’inondation désirée, en mettant une partie du centre hors service. Le 14 juin 2008, un nouvel incendie est déclenché, nécessitant l’intervention de 10 camions de pompiers et d’un hélicoptère.
Le 18 juin 2008, c’est une évasion collective de sept retenus qui a lieu tôt le matin. Quatre sont rapidement repris (un blessé aux chevilles est hospitalisé, et un autre caché dans le jardin botanique d’Oxford repris), tandis que deux Palestiniens et un Afghan courent toujours.
France
Si l’incendie volontaire et simultané des deux ailes du centre de rétention de Vincennes (Paris) qui a conduit à sa destruction le 22 juin 2008 est encore dans les mémoires, cette révolte qui a suivi le décès la veille d’un retenu dans le centre n’est pas isolée ces dernières années. Le 18 septembre 2006, sept retenus s’évadent du centre de rétention de Cornebarrieu (Toulouse-Blagnac). Cinq courent toujours. En décembre 2006, grèves de la faim collectives dans les centres de rétention de Vincennes, de Lyon et de Marseille. Le 24 janvier 2007, deux incendies éclatent dans chacun des bâtiments du centre de Vincennes, endommageant sérieusement l’un d’eux. Cinq retenus (malien, ivoirien, marocain et tunisien) sont accusés d’en être les auteurs. Le 27 juillet 2007, un Kurde incendie une partie du centre du Mesnil Amelot (20 places sur 120) à partir de son matelas. De décembre 2007 à avril 2008, de nombreux sans-papiers se mettent en grève de la faim et parfois s’affrontent aux flics dans les centres de rétention du Mesnil-Amelot, Vincennes, de Rennes et de Nantes. Le 23 janvier 2008, des retenus mettent le feu à une chambre à Vincennes. Le 27 janvier 2008, deux départs de feu nécessitent l’intervention des pompiers à Vincennes. Le 12 février 2008, nouvelle mise à feu de deux chambres à Vincennes.
Le 16 mars 2008, cinq retenus s’évadent du centre de rétention du Canet (Marseille), deux Algériens, deux Tunisiens et un Marocain. Deux courent toujours. Le 6 avril 2008, incendies de draps à Vincennes, projectiles contre la police et dégradations.
Dimanche 22 juin 2008 vers 14h45, plusieurs incendies sont allumés dans les deux bâtiments du centre de rétention de Vincennes. En quelques heures, les 280 places sont totalement détruites tandis que dehors se déroule un rassemblement. La veille, un retenu tunisien de 41 ans, Salem Essouli, y avait trouvé la mort, attendant de nombreuses heures avant d’être évacué vers l’hôpital.
Un retenu témoignera clairement de l’intérieur : « Moi, pour “centre de rétention”, je dis toujours “détention”, et les flics n’aiment pas ça. Mais pour moi, nous sommes en prison, on n’est pas libres. La manière dont les gens sont expulsés, le fait même que les gens soient expulsés, quand tu penses à tout cela, tu es démoralisé. C’est ça qui a créé ce sentiment de révolte. Comment le feu est arrivé ? Comment ils ont fait ? Franchement, je ne veux même pas savoir. C’est la mort du monsieur qui a suscité toutes ces violences-là, légitimes ou pas. Mais quand même, les révoltes, ça arrive partout. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des révoltes, même en ville, dans la vie courante, il y a toujours des révoltes et ça peut être avec des violences. Une révolte, c’est une révolte, d’une seule façon. »
Les retenus seront tabassés et parqués dans l’école de police attenante avant d’être évacués en bus ou TGV spécialement affrété vers les centres de Rouen-Oissel (22), Lille-Lesquin (54), Nîmes-Courbessac (100), Palaiseau (18), Mesnil-Amelot (10) et Paris-dépôt-Cité (40). Si quelques uns seront expulsés, la plupart seront libérés (93 retenus sur les 100 transférés à Nîmes par exemple), souvent débarqués au milieu de nulle part. Depuis, six sans-papiers sont incarcérés à Fleury ou Fresnes, accusés de « destruction de biens par l’effet d’incendie et violence à agent de la force publique ». Une campagne de solidarité a commencé en octobre. Le 10 novembre, c’est un nouveau centre de 60 places qui a été inauguré à Vincennes. Deux autres doivent suivre plus tard à côté du premier. Cette capacité moins importante a pour but évident de mieux contrôler les retenus, suivant en cela un rapport de la Cimade, l’organisation « humanitaire » religieuse qui cogère ces camps avec la police (un appel d’offre récent doit mettre son monopole en concurrence avec d’autres crapules).
Dimanche 20 juillet vers 18h30, c’est un Turc de 44 ans, expulsable depuis la veille, qui met le feu au centre de rétention administrative de Nantes à partir de sa cellule. Le centre est obligé de fermer provisoirement et, le lendemain, les sept autres retenus sont transférés au centre de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande après une nuit en garde-à-vue. Le 2 octobre, l’unique accusé sera condamné à 3 mois ferme.
Samedi 2 août, c’est au tour du centre de Mesnil Amelot, situé derrière l’aéroport de Roissy, de faire l’objet d’une tentative d’incendie. Deux chambres brûlent tandis que se déroulent des affrontements dans les bâtiments 1 et 4 aux cris de « Liberté », sans que le feu ne parvienne toutefois à consumer l’ensemble de la structure. Selon le témoignage d’un retenu : « Nous n’avons fait que crier avec les manifestants présents à l’extérieur. Alors, les policiers nous ont demandé d’arrêter et ont voulu nous faire rentrer sur le terrain de foot. Nous avons refusé, puis un incendie a éclaté. Les policiers ont alors insisté violemment, jusqu’à nous gazer et tabasser l’un des jeunes émeutiers. »
Ce qui est sûr, comme le proclame une affiche qui a commencé à circuler en novembre sur les murs de plusieurs villes, « c’est que l’enfermement est une raison suffisante en soi pour se rebeller contre les geôliers et leurs murs barbelés. Ce qui est certain, c’est que tout individu qui a encore le goût de la liberté et la rage au cœur ne peut que se reconnaître dans ces révoltes dévastatrices. »
Belgique
Fin juillet 1998, 31 personnes s’évadent du centre lors d’un rassemblement organisés par l’ancien Collectif Contre les Expulsions. Des manifestants avaient cisaillé le grillage, tandis que les prisonniers se sont affrontés aux gardiens et ont cassé des vitres pour s’évader. 7 personnes sont reprises lors de la chasse à l’homme, les autres sont toujours hors des griffes des chiens de la démocratie. Cet évasion a fait monter définitivement la tension dans et autour des centres fermés. En septembre 1998, Semira Adamu est assassinée lors d’une tentative de déportation, asphyxiée par deux policiers sur l’avion. Suite à des appels d’aller manifester devant le centre fermé 127bis de Steenokkerzeel, le gouvernement décide de vider le centre, c’est-à-dire de transférer les prisonniers considérés comme des complices ou des amis de Semira vers d’autres centres et de libérer les autres. Ces deux faits marquent la première période d’agitation autour des centres fermés. A ce moment-là, les camps étaient beaucoup moins renforcés – les évasions étaient très nombreuses. Avec la construction d’un nouveau centre fermé à Vottem, l’Etat choisit une autre direction : transformer les centres fermés en bastions sécurisés à l’égal des maisons d’arrêt. Tandis que dans la rue l’agitation descend et la lutte contre les centres commence à se transformer en une lutte pour la régularisation, l’état restructure les centres et leur gestion.
Dans les années de 2000 jusqu’à 2007, les émeutes et les évasions se font assez rares dans les centres. A l’extérieur, une coordination nationale des sans-papiers (l’UDEP) et leurs souteneurs essayent surtout de se construire une certaine crédibilité politique auprès de l’Etat pour obtenir des régularisations – il y a très peu d’attention pour ce qui se passe dans les centres.
A partir de 2007, la rage commence définitivement à montrer sa force dans les prisons belges. Les émeutes et incendies se succèdent et se répandent au fur et à mesure dans presque toutes les taules. Cette diffusion a certainement en partie été possible grâce aux transferts suite à des mouvements de rébellion de prisonniers considérés comme les meneurs. Ainsi, l’expérience de la révolte pouvait se répandre dans presque chaque taule de la démocratie belge. Les mutineries dans les prisons ont affecté la situation dans les centres fermés de deux manières. D’abord, le fait que même dans les pires conditions de « contrôle » éclatent des mutineries (et pas une, mais surtout leur continuation dans le temps et dans l’espace) a fonctionné comme une sorte de flambeau. Même avec tous les barreaux, tous les gardiens, les cellules d’isolement, les tabassages, se révolter restait possible. La peur laissait la place à la conscience que la rébellion dépend surtout de sa propre détermination. Deuxièmement, des prisonniers sans-papiers qui ont participé aux mutineries dans les prisons sont ensuite transférés dans les centres pour attendre leur éventuelle déportation. Il est à noter que la durée de cette détention administrative dans les centres peut aller facilement jusqu’à 6 mois, parfois même plus. Ces prisonniers avaient déjà une expérience de révolte dans les taules où les moments d’être ensemble à quelques dizaines sont assez rares (en fait, seulement pendant les promenades et les quelques activités comme le sport) tandis que dans les centres fermés, les prisonniers (à part les punis) sont tout le temps ensemble. Dans tous les centres, ils sont groupés dans des dortoirs de plus de 20 personnes – ce qui rend une émeute collective beaucoup plus facile.
En janvier 2007, des prisonniers du centre fermé de Merksplas attaquent les gardiens et en blessent quelques uns. Au même moment, une mutinerie très vaste a eu lieu à l’autre côté, dans la prison de Merksplas lors de laquelle plusieurs ailes ont été détruites et deux pavillons ont été incendiés. Un mois plus tard, quelques dizaines de prisonniers dans le centre fermé de Vottem se mutinent et détruisent la salle à manger et la salle de « récréation » pendant qu’un rassemblement se déroule à l’extérieur du camp. Les manifestants gueulent leurs slogans et… rentrent à la maison. En mars et en avril, plus de 40 personnes s’évadent des centres à différentes occasions. Tandis que la plupart des plans pour les évasions consistent à couper les barreaux et les grillages, cette fois-ci à Vottem, plusieurs prisonniers attaquent un gardien pour lui prendre ces clés et réussissent ainsi à s’évader. Le 25 avril 2007, une mutinerie éclate au centre fermé 127 bis à Steenokkerzeel. Le temps que la police intervienne, les révoltés avaient déjà détruit une bonne partie d’une aile, ce qui entraîne sa fermeture temporaire. Le 9 juin, les prisonniers du même centre s’affrontent aux gardiens pour empêcher la déportation d’un camarade. Les flics anti-émeute doivent charger plusieurs fois pour réussir à repousser les émeutiers vers les dortoirs. A la fin, ils réussissent à déporter la personne en question. Le 30 juillet 2007, une explosion dans une cabine d’électricité à côté du centre fermé de Merksplas coupe le courant dans ce camp. Quelques heures plus tard, des prisonniers refusent de quitter le préau. Quand la police intervient, les prisonniers sont repoussés vers les dortoirs. Le 29 septembre, suite au mort d’un prisonnier de 22 ans, une mutinerie éclate dans le 127 bis. Le prisonnier avait fait plusieurs années de prison pour un hold-up. Trois jours après son transfert de la prison de Lantin au 127 bis, il a été retrouvé mort. L’Office des Étrangers prétend que sa mort est due à l’usage de drogues. Les mutinés détruisent la salle de séjour et le sanitaire. Lors de l’intervention de la police, les mutinés résistent en s’engageant dans des affrontements qui durent plusieurs heures. Pendant toutes ces émeutes, le mouvement « formel » des sans-papiers et leurs souteneurs à l’extérieur ne bouge qu’à propos des régularisations… En octobre et novembre 2007, la police perquisitionne les centres de Vottem, Steenokkerzeel et Merksplas sur demande des gardiens qui ont peur que les prisonniers aient confectionné des armes ou préparent des évasions. La police retrouve effectivement des couteaux artisanaux, des scies, des pinces,… En 2007, au moins 80 personnes se sont fait la belle des cinq centres fermés de Belgique, tandis que des dizaines de tentatives échouent.
Ce n’est que le 6 janvier 2008 qu’une nouvelle émeute éclate. Des dizaines de prisonniers dans le centre de Merkplas se rebellent pour empêcher la déportation d’un camarade, ce qui cause des dégâts estimés à plus de 40 000 euros. Trois gardiens sont envoyés à l’hôpital. Leur camarade est libéré une semaine plus tard. En février 2008 commencent des grèves de la faim dans plusieurs centres, avec plus de 150 grévistes. La grève n’aboutit à rien de « concret ». Quand le 1 mai 2008, un prisonnier est retrouvé mort dans la cellule d’isolement du centre de Merskplas suite à une tentative ratée de déportation, quelques dizaines de prisonniers commencent à détruire tout ce qu’ils peuvent. Ils boutent aussi le feu à un dortoir. Onze prisonniers sont mis en isolement, un d’entre eux casse la cellule d’isolement le 10 mai avant d’être déporté. Le 10 juillet, la police fait de nouveau une perquisition dans le centre 127 bis de Steenokkerzeel. Huit prisonniers sont cagoulés et transférés vers d’autres centres. Le 21 juillet, le jour de la Fête Nationale, deux prisonniers montent sur le toit du centre fermé de Merksplas tandis que dans le centre une mutinerie éclate. La police doit charger plusieurs fois pour repousser les mutinés, qui détruisent beaucoup de vitres et de mobilier. Le 24 août, des prisonniers mettent le feu à plus de 8 endroits dans le centre de Steenokkerzeel, peu après minuit. La nuit retarde l’intervention de la police et des pompiers. Deux des trois ailes sont évacuées et brûlent entièrement. Un prisonnier réussit à s’évader. L’incendie réduit la capacité du centre à moins de 30 %. Une partie des détenus est alors transférée tandis que l’autre est libérée en toute discrétion parce qu’il n’y avait simplement plus de place.
A ceux qui ne sont pas restés au chaud pendant la tempête
Sur le procès contre les anarchistes de Lecce et la lutte contre les centres de rétention
Le 9 octobre 2008 a débuté à Lecce le procès d’appel contre douze anarchistes accusés – en plus d’une série d’actions contre certaines multinationales qui s’enrichissent sur la guerre et le génocide des populations du Sud – du crime d’avoir mené pendant des années une lutte constante et déterminée contre le lager pour immigrés de San Foca [5]. La base du procès est encore une fois l’article 270 bis sur l’« association subversive à but terroriste », avec lequel ont été incarcérés ces dernières années des dizaines de révolutionnaires, de rebelles ou de simples militants de gauche, sans le moindre début de preuve. Pour être accusé d’ « association subversive », il suffit désormais d’un simple tag sur un mur.
Mais ce n’est pas tellement cela que nous tenons à dire. Nous savons que les lois de l’État sont des toiles d’araignée pour le riche et des chaînes d’acier pour le pauvre, tout comme nous n’avons jamais cherché le sens de ce qui est juste parmi les articles du code pénal. Ce qui nous intéresse de souligner est ce qui rend ces anarchistes dangereux et ce qu’il y a d’universel dans leur lutte.
Il y a eu de grandes discussions ces derniers mois sur les « Centri di Permanenza Temporanea » (CPT, centres de rétention). Après que certains reportages de journalistes aient rendu compte des conditions inhumaines dans lesquelles survivent les femmes et les hommes internés dans ces structures, les diverses forces politiques se sont disputées à propos des res-ponsabilités d’une telle « gestion ». Mais la question n’est pas comment ils sont gérés, mais plutôt leur nature même. Introduits en Italie en 1998 par le gouvernement de centre-gauche avec la loi Turco-Napolitano (votée également par les Verts et Rifondazione Comunista), les CPT sont sous tous leurs aspects des lagers. Exactement comme les camps de concentration fascistes et nazis (et avant eux les camps coloniaux, à Cuba ou en Afrique du Sud), il s’agit de lieux dans lesquels on est enfermé sans n’avoir commis aucun délit et retenu à complète disposition de la police. Qu’à l’intérieur les conditions soient désespérées, la bouffe pourrie et les mauvais traitements constants en est une conséquence terrible, mais pas le centre du problème. Il suffit de peu pour s’en rendre compte.
Ce qui pour un italien n’est qu’un simple « délit administratif » (ne pas avoir de papiers), est devenu pour un étranger un délit passible d’internement. Comme nous l’apprend l’histoire – il suffit de penser aux lois racistes de tous les États entre la première et la deuxième guerre mondiale – , avant de créer de tels camps de concentration, il faut au préalable imposer l’équation étranger = délinquant. C’est en ce sens qu’on doit lire la législation – de droite comme de gauche – sur l’immigration en Italie (mais nous pourrions dire en Europe et partout). Si les mêmes critères qui président à l’obtention du permis de séjour pour les immigrés étaient appliqués aux soi-disant citoyens, nous serions des millions à être enfermés ou à vivre en clandestins. En effet, combien d’Italiens peuvent démontrer qu’ils ont un travail en règle ? Combien vivent à plus de trois dans un appartement de 60 mètres carrés ? Sachant que les contrats d’intérim ne sont pas valables pour obtenir le permis de séjour, combien d’entre nous seraient des « réguliers » ? Définir tout ceci comme un racisme d’État n’est pas de l’emphase rhétorique, mais bien un constat rigoureux.
Aujourd’hui, les CPT (mais plus généralement toutes les formes de rétention administrative : des centres d’identification aux « zones d’attente » dans lesquelles sont gardés les réfugiés ou les demandeurs d’asile) sont la matérialisation de ce racisme. Et c’est justement parce que le fil barbelé est le symbole des lagers et de l’oppression totalitaire depuis soixante ans que la cohérence involontaire du pouvoir a entouré ces nouveaux camps de fils barbelés. Tout comme ce n’est pas un hasard si la rétention administrative, depuis toujours un dispositif typique de la domination coloniale, se diffuse aujourd’hui partout dans le monde (des ghettos palestiniens à Guantanamo, des geôles secrètes anglaises où sont enfermés les immigrés « suspectés de terrorisme » aux CPT italiens). En même temps qu’on bombarde et qu’on massacre au nom des « droits de l’homme », des millions d’indésirables sont brutalement privés de tout « droit », détenus dans des camps gardés par la police et confiés aux « bons soins » de quelque « organisation humanitaire ».
Si les CPT sont des lagers – comme le disent désormais beaucoup de gens –, il est tout à fait logique de chercher à les détruire et d’aider les hommes et les femmes qui y sont enfermés à s’évader. Et il est tout à fait logique de frapper les collaborateurs qui les construisent et les gèrent. C’est ce que pensaient les anarchistes de Lecce. Ils ont alors dénoncé publiquement, dans l’indifférence générale, la responsabilité des gérants du CPT de San Foca – c’est-à-dire la curie de Lecce, à travers la Fondation « Regina Pacis » – et les conditions infâmes auxquelles étaient soumis les détenus ; ils ont recueilli des témoignages, des données, et se sont organisés. Ils sont devenus une épine dans le pied de la curie et du pouvoir local. En été 2004 déjà, un des leurs fut arrêté pour avoir essayé de favoriser la fuite de quelques immigrés au cours de la révolte qui a éclaté à l’intérieur du centre « Regina Pacis ». Ils sont allés dans les fêtes de village pour rendre publics les noms et prénoms des agents responsables des tabassages dans le CPT, des médecins qui les couvraient, du directeur qui frappait, séquestrait et contraignait certains musulmans à manger de la viande de porc. Tout ce, sans jamais perdre l’objectif de vue : fermer pour toujours ces lagers, et non pas les rendre « plus humains ». Pendant que se déroulait tout cela, quelques actions anonymes touchaient les banques qui finançaient le CPT, mais aussi les propriétés de la curie et du directeur de la fondation « Regina Pacis », don Cesare Lodeserto. Et ces anarchistes étaient prêts à les défendre publiquement. Les autorités ne pouvaient plus cacher le problème. Qu’ont-elles fait alors ? Elles ont d’abord incarcéré Lodeserto sous l’accusation de séquestration de personne, détournement de biens publics, violence privée et diffusion de fausses nouvelles tendancieuses (le prélat s’envoyait des messages de menace qu’il attribuait ensuite à la « malavita albanaise »). Puis elles ont fait fermer le C PT de San Foca. Lodeserto placé en résidence surveillée, puis remis en liberté, elles ont donc incarcéré les anarchistes afin de s’en débarrasser pour des années. Les gens qui comptent ont défendu le prêtre de façon tonitruante. En défense des anarchistes, il n’y a eu au mieux que d’honnêtes préjugés. Justice est faite…
Mais quelque chose ne tourne pas rond. Le château de carte de l’accusation contre les rebelles est maladroit et branlant, et, surtout, les luttes contre les CPT prennent de 1a vigueur dans toute l’Italie. En avril, les reclus du lager de via Corelli à Milan montent sur les toits, ils se taillent les veines et hurlent la plus universelle des revendications : la liberté. Suivis par les immigrés enfermés dans le CPT de corso Brunelleschi à Turin, la révolte s’étend à Bologne, Rome, Crotone. Des dizaines d’entre eux réussissent à s’évader, tandis que le soutien pratique à la lutte commence à s’organiser â l’extérieur. En même temps que des manifestations et des initiatives qui dénoncent les responsabilités de ceux qui s’enrichissent sur les déportations des immigrés (d’Alitalia à la Croix Rouge, des compagnies de transport aux entreprises privées impliquées dans la gestion des lagers), les petites actions de sabotage ne manquent pas. Et lors de cette convergence spontanée qui constitue le secret de toutes les luttes, les crimes imputés aux anarchistes de Lecce se diffusent.
C’est ce mouvement – encore faible mais croissant – qui a posé publiquement le problème des CPT, envoyant paître les politiciens de gauche dans leur tentative pathétique d’attribuer au seul gouvernement de droite la responsabilité des lagers.
Que tout cela foute le bordel est démontré par les déclarations du ministre de l’Intérieur Pisanu sur les anarchistes qui « incitent à la révolte » les immigrés (comme si les conditions inhumaines dans lesquelles ils vivent n’étaient pas en soi une incitation permanente) et sur la nécessité des CPT pour affronter le « terrorisme » (il est en effet connu que ceux qui veulent passer les contrôles de la police pour accomplir un attentat se promènent sans papiers). Pourquoi ?
Les CPT mettent à nu non seulement l’exclusion et la violence comme fondements de la démocratie, mais aussi le lien profond entre la guerre permanente, le racisme et la militarisalion de la société. Ce n’est pas un hasard si la Croix Rouge est présente dans les conflits militaires aux côtés des armées et en même temps impliquée dans la gestion de nombreux lagers en Italie. Comme ce n’est pas un hasard si elle participe aux « exercices antiterrorisme » avec lesquels les gouvernements voudraient nous habituer à la guerre et à la catastrophe.
La criminalisation de l’étranger -bouc émissaire du malaise collectif- est depuis toujours le trait distinctif des sociétés moribondes, et en même temps un projet d’exploitation bien précis. S’ils ne vivaient pas dans la terreur d’être enfermés et renvoyés au pays – où les attendent souvent la guerre, la faim, le désespoir –, les immigrés sans papiers ne travailleraient certainement pas pour deux euros l’heure sur les chantiers de quelque Grand’œuvre, pas plus qu’ils ne mourraient recouverts d’une coulée de ciment lorsqu’ils tombent des échafaudages. Le Progrès a besoin d’eux : c’est pour cela qu’on les clandestinise et qu’on ne les expulse pas tous, on les « accueille » dans des lagers, on les trie, on les sélectionne sur la base d’accords avec les pays d’origine, et selon leur docilité face au patron. Le sort qui les attend est le reflet d’une société en guerre (contre les concurrents économiques et politiques, contre les populations, contre ses propres li-mites naturelles).
Une des premières victimes de cette mobilisation totale est le sens des mots. Qu’aient pu entrer dans le vocabulaire courant des expressions comme « guerre humanitaire » – ou qu’on puisse nommer « centre d’accueil » un lager – en dit long sur l’écart entre l’horreur qui nous entoure et les mots qui la nomment. Cet écart est en même temps une anesthésie de la conscience. Ils appellent les CPT des « lagers » puis vont voter pour ceux qui les construisent, ils disent « massacres » mais se contentent de défiler tranquillement contre la guerre [les troupes italiennes sont engagées en Irak], pour qu’il ne se passe rien. Pendant que se déroulait à Milan la manifestation océanique du 25 avril [60e anniversaire de la Libération], les révoltés du centre de rétention de via Corelli étaient sur les toits en train de crier que la résistance n’est pas terminée, mais la rhétorique sur la « libération » n’a même pas secoué les manifestants, ils ont continué à faire la fête.
Peut-être quelque chose est-il en train de changer. Alors que la propagande d’Etat met sur le même plan l’ennemi intérieur – le rebelle, le « terroriste » – et l’étranger – le fanatique, le kamikaze –, les résistances s’arment et les « périphéries » à deux pas de chez nous explosent, là où les pauvres brûlent les dernières illusions d’intégration à cette société. Des jeunes généreux entendent dire lager lorsqu’ils disent lager, et s’organisent en conséquence, en tant qu’étrangers dans un monde étranger. Ils sont prêts à conquérir la liberté avec les autres, même au risque de mettre en jeu la leur. Ils haïssent les barreaux au point qu’ils ne les souhaitent pas même aux pires charognes (les trop nombreux Lodeserto). Ces formes d’insatisfactions actives dialoguent pour le moment à distance, mais sont déjà l’ébauche de quelque chose de commun. La fausse parole se mutine, et de nouveaux comportements libèrent de nouvelles paroles dans la réalité de la vie quotidienne.
N’abandonnons pas à la vengeance des juges ceux qui ne sont pas restés au chaud quand d’autres hommes étaient emportés par la tempête. En des temps tristes et serviles, il est un choix qui contient tous les autres : décider de quel côté rester.
Publié dans Cette Semaine n°88, mars 2006, et actualisé.
[1] Espagne : 405 000 en 2002, 578 000 sur 691 000 en 2005. Italie : 227 000 sur 250 000 en 1998 puis 634 000 sur 705 500 en 2002. Environ 500 000 en 2006 en Angleterre. France : 81 000 sur 143 000 en 1998 puis 23 000 en 2004 et 6 000 sur 21 000 en 2006.
[2] Les quotas nationaux liant strictement immigration et travail existent en Italie depuis 1998 et en Espagne depuis 2002, sachant que ces deux pays, grands demandeurs de main d’œuvre, ont aussi procédé à deux larges régularisations collectives ces dernières années. A titre d’exemple, l’Italie a fixé par décret la venue de 252 000 travailleurs étrangers pour 2007 : 4500 Albanais, Tunisiens, Marocains, 8000 Égyptiens, 6500 Moldaves, 3500 Sri Lankais, 5000 Philippins, 3000 Bengalis, 1500 Nigérians, 1000 Ghanéens, Algériens, Sénégalais, 500 sud-américains d’origine italienne plus 80 000 ressortissants de pays ayant des accords sur l’immigration et la coopération (pays de l’ex-Yougoslavie, Inde, Pakistan, Ukraine,…) ou tout immigré ayant eu un contrat de travail lors des trois années précédentes. Quant à l’Espagne, elle a fixé pour 2008 la venue de 40 000 travailleurs étran-gers pour des contrats de 4 à 9 mois : 16 200 Marocains, 12 000 Roumains, 4000 Bulgares, 3500 Polonais, 3000 Ukrainiens, 750 Sénégalais, 270 Philippins. Arguant de pénuries ponctuelles, d’autres pays européens ont déjà utilisé de tels dispositifs, comme l’Angleterre et l’Allemagne (20 000 « cartes vertes » de 5 ans maximum en 2001 pour des spécialistes des technologies de l’information). Les autres pays comme la France procèdent à des autorisations de travail basées en flux tendu sur la demande des entreprises, comme l’a encore confirmé la dernière réforme du Ceseda (code de l’entrée, séjour des étran-gers et demandeurs d’asile) de 2007 et ses circulaires. Cela n’empêche bien sûr pas en plus l’introduction de quotas selon les accords bilatéraux, comme 1000 titres de séjour dans 108 métiers pour des Sénégalais en 2008. Voir aussi le cas des bureaux de travail belges au Congo ou des agences d’intérim espagnoles en Amérique du Sud.
[3] Depuis des mois, des compagnons développaient depuis l’extérieur une solidarité avec Sémira qui n’a jamais cessé de se battre et d’encourager les autres à le faire. A la quatrième tentative de déportation, les policiers qui l’escortaient l’ont assassinée avec un coussin. (voir ci-après Beau comme des centres de rétention qui flambent)
[4] En 2004, le danois Group 4 Falck a fusionné avec le britannique Securitor, donnant naissance à Groupe 4 Securicor (GAS). Début 2008, c’était derrière Securitas le deuxième opérateur de sécurité privée en France.
[5] Le 12 juillet 2007, quatre de ces compagnons ont été condamnés pour « association de malfaiteurs » de 1 an et dix mois à 5 ans de prison ferme. Trois autres ont reçu des peines de 100 euros à 1 an de prison pour des délits spécifiques et les huit derniers sont acquittés. L’ « association subversive » n’a donc finalement pas été retenue, au profit d’un montage juridique plus complexe.
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (1.4 Mio)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (2.7 Mio)