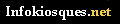F
Face à l’outil antiterroriste, quelques éléments pratiques
mis en ligne le 18 mai 2010 - anonymes
Voilà quelques éléments juridiques, historiques et policiers sur l’instrument antiterroriste en France. Méfiez-vous ! Ce texte n’a pas été écrit par des spécialistes en droit [1]. Il a été élaboré essentiellement à partir de manuels de vulgarisation du droit. Il y a sans doute des erreurs, mais on ne sait pas où… N’hésitez pas à les signaler en envoyant un mail à antiterro at riseup.net.
On choisit ici de parler d’antiterrorisme, histoire de mieux comprendre en quoi ça consiste. Afin de savoir à quoi s’attendre quand on en vient à le subir (tenter de moins se faire avoir, mieux préparer sa défense…), et d’être plus fins dans les critiques qu’on peut faire de cet outil.
Si on fait une brochure sur l’antiterrorisme, c’est que ce régime a des particularités. Mais on ne pense pas pour autant qu’il est ultra spécifique, comme l’explique le petit texte [2] qui suit :
Certains n’ont pas manqué de critiquer l’usage de l’outil antiterroriste, en raison de la disproportion entre le moyen utilisé et la nature des infractions poursuivies en avançant, par exemple, pour « l’affaire Tarnac », qu’il s’agissait de simples sabotages et non d’attentats. D’autres ont remis en cause l’existence même de cette législation qui serait contraire aux principes du droit démocratique. Des personnes, enfin, voient dans l’antiterrorisme et dans l’état d’exception devenu permanent un véritable « mode de gouvernement ». Toutes ces critiques ont en commun de présenter cette juridiction comme un extraterrestre, une exception dans le droit. Pourtant, l’antiterrorisme se distingue moins qu’il n’y paraît des autres procédures juridiques.
Dans les cas de l’association de malfaiteurs, du trafic de stupéfiants, des bandes organisées… les gardes à vue peuvent aussi durer 4 jours, la préventive est difficile à éviter et souvent longue, les peines encourues sont alourdies. Ces pratiques de répression, présentées comme des juridictions d’exception, sont en réalité couramment utilisées. Par ailleurs, d’autres catégories construites par l’État subissent elles aussi une répression féroce. Par exemple, les sans-papiers peuvent subir un “contrôle d’identité” de 32 jours en centre de rétention. Ils peuvent aller en prison pour avoir refusé d’embarquer, puis retourner au centre de rétention avant d’être expulsés. Et dans les faits, la juridiction antiterroriste n’entraîne pas forcément une répression plus importante que les juridictions communes. Même en antiterrorisme, les gardes à vue peuvent durer moins de 6 jours, il arrive que des personnes sortent de préventive avant leur procès, et, si les peines encourues sont souvent très élevées, cela ne veut pas dire que les juges vont les appliquer telles quelles.
Les procédures antiterroristes construisent des accusations sur la base d’intentions supposées, qu’elles soient ou non suivies d’actes. En antiterrorisme comme dans tout le droit pénal, les intentions doivent toujours être étayées par des éléments matériels. Plus l’intention est prépondérante dans l’accusation, plus des éléments matériels anodins pourront être utilisés à charge. Ces derniers, pris isolément, ne constituent pas nécessairement des infractions. Ce peut être la possession d’un pic à glace, un coup de fil passé à telle personne, avoir de l’argent en liquide… Mais accuser une personne de se préparer à commettre tel ou tel délit avant même sa réa-lisation est une pratique courante dans tout le droit pénal. Ainsi une personne peut être inculpée de complicité dans la préparation d’un meurtre qui n’a jamais eu lieu. Les intentions sont toujours prises en compte dans les condamnations : homicide volontaire ou involontaire, intention, ou pas, de voler, dégradations volontaires…
La spécificité de l’antiterrorisme tient dans le fait que le pouvoir attribue
aux personnes accusées des intentions à caractère politique. Il s’agit, en France, d’avoir « pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ». En Europe, c’est, entre autres, « gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale ». Un même acte peut donc relever soit du droit ordinaire, soit du terrorisme. Cette distinction repose seulement sur le type d’intention attribuée aux personnes inculpées : une infraction peut devenir un acte terroriste si les juges estiment que ses motivations sont politiques, au sens où elles s’attaquent à l’État dans ses fondements. C’est l’intention politique qui compte.
À trop souligner les particularités de l’antiterrorisme, on risque, même sans le vouloir, d’enfermer les quelques centaines de personnes qui subissent cette répression dans un cercle restreint. De renforcer une catégorie dont le pouvoir souhaite l’existence : celle des « terroristes ». Or cette étiquette, comme bien d’autres, sert à isoler, à faire en sorte que la répression antiterroriste soit perçue comme quelque chose de très spécifique, ce qui empêche d’élargir la solidarité à d’autres situations de répression.
Dans les imaginaires, le « terroriste », c’est l’homme sans visage toujours prêt à poser une bombe à clous au milieu de la foule. En réalité, les procédures antiterroristes correspondent à de multiples situations différentes, qui parfois n’ont d’ailleurs pas grand-chose à voir entre elles et sont dissemblables en leur sein même : des activités séparatistes basques ou corses, des actions contre les radars, des activités attribuées à ce que l’État résume sous les appellations « islamiste » ou « anarcho-autonome »… Évidemment, très rares sont les personnes qui se désignent d’elles-même « terroristes ». Ce sont les États qui collent cette étiquette à ce qui est pour eux opportun de réprimer à un moment donné. Au niveau international, en fonction d’intérêts géopolitiques fluctuants, des organisations peuvent entrer et sortir de listes noires de terroristes. L’ANC (African National Congress) de Nelson Mandela par exemple, a longtemps été classé terroriste par les États-Unis avant d’être encensé par tous les démocrates du monde. Les États montrent du doigt à certains moments quelques personnes, « ce sont des êtres monstrueux », et vident ainsi de leur sens politique d’origine des actions, des pratiques, des pensées. Ce n’est qu’une manière de désigner un ennemi intérieur à éliminer, contre lequel toute la population devrait se liguer. De fait, en disant « nous ne sommes pas des terroristes » ou « ces gens-là ne sont pas des terroristes », et, à un degré moindre, en disant « nous sommes tous des terroristes », on risque à chaque fois de réactiver et de valider la catégorie « terroriste » qui n’est profitable qu’aux États et à ceux qui les soutiennent. Il est problématique tant de se revendiquer du terrorisme que d’être prêt à tout pour s’en démarquer.
Mieux vaut montrer comment cette figure de grand méchant loup est agitée pour faire peur et justifier un contrôle toujours plus fort sur tous : c’est le plan Vigipirate, ce sont les militaires dans les gares, le fichage de nombreuses personnes, les contrôles d’identité de plus en plus fréquents… L’antiterrorisme témoigne et participe de manière spectaculaire d’un durcissement plus général de la législation, réponse à l’accentuation des contradictions sociales. Loin d’être réservé à certaines procédures « d’exception », ce durcissement s’applique au quotidien dans les rues, les commissariats, les tribunaux et les taules : déploiements policiers, relevés ADN systématisés, peines plancher, bracelets électroniques, préventive facilitée, Établissements Pénitentiaires pour Mineurs…
L’antiterrorisme est une des multiples formes de répression utilisées quotidiennement par le pouvoir. Elle obéit aux mêmes logiques : la classe dominante édicte les lois, décide de ce qui est légal et de ce qui ne l’est pas selon ses intérêts. L’appareil policier et juridique vise à maintenir l’ordre capitaliste en enfermant une partie des « classes dangereuses » pour mieux contraindre tous au travail. C’est pourquoi la justice condamne autant les actes que les profils sociaux des accusés, souvent en fonction de leur supposée dangerosité. Moins une personne a les moyens de présenter des garanties sociales et économiques, plus elle risque la prison. Et la justice ne se prive pas de condamner sans preuve. La justice repose sur cette certitude selon laquelle les flics disent vrai et les pauvres sont coupables. On ne se fait de toute façon aucune illusion sur la possibilité de l’existence d’une justice équitable, d’un État de droit qui défendrait les intérêts de chacun. La procédure antiterroriste est à évoquer comme un des outils du pouvoir face à ce qui le met en cause, pour écraser, stigmatiser ceux qui ne se soumettent pas assez à son goût, et notamment tenter ainsi d’étouffer les luttes sociales.
Vive la révolte !
Cette brochure ne concerne que la France. Il existe néanmoins une définition commune du « terrorisme » au sein de l’union européenne (d’ailleurs inspirée par la France) : sont terroristes divers agissements commis « dans le but de gravement intimider une population ou contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale ». (Décision cadre adoptée par le conseil de l’Union Européenne en juin 2002).
Un même acte peut donc soit relever du droit commun (régime ordinaire), soit du domaine du terrorisme. En France, c’est le ministère public (le parquet, représentant de l’Etat) qui est chargé de qualifier un acte matériel de « terroriste ».
1. Petite histoire de l’émergence du terme « terroriste » dans la loi française
Le régime antiterroriste est récent : jusqu’au début des années 80, le droit pénal ne fait aucune référence au terme « terroriste ». Mais il a toujours existé des dispositions pénales spéciales, comme lors de la guerre d’Algérie où sont utilisées des « lois relatives à la prévention des crimes contre la sûreté de l’Etat ».
La loi du 9 septembre 1986 marque le début de la prise en compte du terrorisme dans le droit pénal français. Cette loi met en place un titre relatif aux « infractions en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ». Des procédures et des peines spécifiques sont mises en place pour ceux qui seront classés « terroristes », ainsi qu’un système d’indemnisation des victimes. Cette loi reconnaît à des procureurs et à des juges d’instruction de Paris une compétence nationale : ce sont des juges et des procureurs spécialisés qui s’occuperont des affaires antiterroristes à Paris.
Puis vient la loi du 16 juillet 1987. Cette loi est prise afin de ratifier la Convention Européenne pour la répression du terrorisme, elle-même adoptée à Strasbourg en 1977. La France donne son accord pour faire entrer en vigueur cette convention. Ce texte conventionnel énumère un certain nombre d’actes pouvant être considérés comme terroristes et détermine les possibilités d’extradition des personnes accusées de tels actes.
En 1994 apparaît dans le Code Pénal un chapitre sur le terrorisme. Ainsi est justifié l’ensemble des règles dérogatoires au droit commun prévues par les dispositions antérieures. Autrement dit, ce texte légitime la particularité de ce régime juridique.
Puis ce texte est complété : les peines encourues augmentent, de même que les délais de prescription, des dispositions sont ajoutées quant à la détention provisoire, les perquisitions deviennent possibles la nuit, et les accusés peuvent êtres jugés dans d’autres lieux que les tribunaux, « si les circonstances sont exceptionnelles ». Ainsi, dans le cadre du procès Chalabi en 1998, 138 personnes accusées sous régime antiterroriste ont été jugées dans un gymnase.
En 1996 est créé le délit spécifique “d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste”.
En 2001 est adoptée la Loi sur la Sécurité Quotidienne (LSQ). Elle étend le champ des infractions terroristes : les infractions de blanchiment et de délit d’initiés peuvent être traitées en régime antiterroriste. Elle ajoute une nouvelle infraction : le financement d’actes terroristes. Et elle facilite certaines procédures, concernant les fouilles, les perquisitions, et la transmission de données de télécommunication (téléphone, internet...).
En 2006 sort la loi sur la lutte antiterroriste. Elle augmente les peines encourues et « assouplit » des procédures. Les garde à vue peuvent durer jusque 6 jours. Les actions des services de renseignement sont facilitées : contrôles téléphoniques et électroniques, développement de la vidéosurveillance, accès possible à de multiples fichiers (dont des fichiers de données personnelles, comme les trajets ferroviaires ou aériens…). Est créé un nouveau crime : celui de direction d’une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, qui est passible de 20 ans d’emprisonnement.
Au bilan, au fur et à mesure du temps, le régime antiterroriste est de plus en plus étendu (il s’applique à de plus en plus de situations) et les moyens de répression qui y sont liés augmentent.
Juridiquement, le régime antiterroriste n’est pas un droit d’exception, mais un droit spécialisé et dérogatoire comme d’autres, comme le sont par exemple le droit économique ou le droit de la criminalité organisée (le grand banditisme). C’est un aménagement des lois existantes, et non un régime complètement différent.
Du côté des juristes, il y a une oscillation entre la volonté de combattre le « phénomène terroriste » au moyen d’instruments juridiques ordinaires et la tentation d’instaurer en la matière un dispositif dérogatoire. Cela transparaît tant dans la loi que dans les services judiciaires et administratifs concernés.
2. Structure globale de la « lutte antiterroriste »
Le CILAT, c’est le Comité Interministériel de Liaison AntiTerroriste. Il a été créé en 1982 après l’attentat de la rue des Rosiers. Ce comité est sous la présidence du premier ministre ou du ministre de l’intérieur. Il réunit des membres du gouvernement. C’est un organe de coordination qui étudie les mesures à adopter pour « faire face aux risques d’attentat ».
L’UCLAT, c’est l’Unité de Coordination de la Lutte AntiTerroriste. Créée en 1984, elle est sous l’autorité du Directeur général de la police nationale. Sa mission est de réunir tous les services de l’Etat contribuant à la lutte antiterroriste. Elle a une vocation interministérielle. C’est un organe de circulation du renseignement, qui a en charge la mise en œuvre des plans Vigipirate et le Secrétariat du CILAT.
Au ministère de la Justice, il y a le Bureau de la lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme et le blanchiment (qui est à la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces). Il élabore des projets de textes en matière de lutte antiterroriste ainsi que les instructions générales de la politique pénale. Il assure le suivi de l’action publique (c’est-à-dire les poursuites mises en œuvre par le parquet), et développe la concertation avec l’UCLAT et le Secrétariat Général de la Défense Nationale (SGDN).
3. Services responsables de la prévention et de la répression du terrorisme
A. Pour la prévention et la répression des actes de terrorisme
Il existe deux dispositifs essentiellement destinés à effectuer un travail de renseignement et qui peuvent parfois agir sur le plan judiciaire.
D’abord, les services qui travaillent pour le ministère de l’Intérieur. Depuis juillet 2008, la DST (Direction de la Surveillance du Territoire) et la DCRG (Direction Centrale des Renseignements Généraux) ont fusionné : ils sont aujourd’hui appelés la DCRI, Direction Centrale du Renseignement Intérieur. Celle-ci est un service de renseignement du ministère de l’Intérieur, au sein de la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN). Son siège est au 84 rue de Villiers, à Levallois-Perret (92). Ce service a 8 sous-directions : protection économique, terrorisme (Michel Guérin), technologie du renseignement (Michel Pages), subversion violente (Françoise Bilancini), administration générale, supports, contre-espionnage et affaires internationales.
Les missions de la DCRI sont inspirées de celles anciennement confiées à la DST et aux RG :
— prévention et lutte contre les ingérences et les menaces étrangères (contre-espionnage)
— prévention et lutte contre le terrorisme et de tout acte « visant à porter atteinte à l’autorité de l’Etat, au secret de la défense nationale ou au patrimoine économique du pays »
— surveillance des communications et lutte contre le cybercrime
— surveillance des mouvements, groupes ou organisations subversifs violents et des phénomènes de société précurseurs de menaces.
A l’exception de l’analyse des mouvements sociaux, les missions de la DCRI sont considérées comme relevant du secret défense.
Du fait de l’autonomie historique de la Préfecture de Paris, il existe un service de renseignements spécifique à Paris. C’est la Direction du Renseignement de la Préfecture de Police, DRPP. Elle est divisée en différents services : terrorisme, économie souterraine, sécurité intérieure, hooliganisme, violences urbaines, milieux extrémistes violents, sectes, immigration clandestine, ordre public. Ce sont les “RG” de Paris.
Le deuxième dispositif est la mission de recherche de renseignements à l’étranger pour le Ministère de la Défense. En font partie :
— la DGSE : Direction Générale de la Sécurité Extérieure
— la DPSP : Direction de la Protection et de la Sécurité de Défense
— la DRM : Direction du Renseignement Militaire
B. Pour la répression :
Depuis 2006 existe la SDAT (Sous Direction de la lutte AntiTerroriste). C’est l’ex-DNAT (Division Nationale AntiTerroriste), elle-même ex-6e Division... La SDAT est un service de la DCPJ (Direction Centrale de la Police Judiciaire), qui dépend elle-même de la DGPN (Direction Générale de la Police Nationale).
La SDAT a une compétence nationale, elle s’appuie en province sur les sections criminelles des DIPJ (Directions Interrégionales de la Police Judiciaire). La SDAT a rejoint les locaux de la DCRI à Levallois-Perret, mais conserve son autonomie.
A Paris, c’est la Section AntiTerroriste (SAT) de la Brigade Criminelle. La Brigade Criminelle est un service de la DRPJ (Direction Régionale de la Police Judiciaire), qui dépend elle-même de la Préfecture de Police de Paris. C’est « la Crim’ », au quai des Orfèvres.
Du fait de cette division, les enquêtes concernant la “province” sont gérées par la SDAT tandis que celles concernant Paris sont confiées à la SAT. Si les faits qui sont reprochés ont eu lieu à Paris, les gardes à vue et convocations se feront au quai des Orfèvres à Paris. S’ils ont eu lieu en “province”, ce sera à Levallois-Perret.
Les BRI, ou Brigades de Recherches et d’Intervention, s’occupent aussi de surveillances, de filatures et d’arrestations.
Ces différents services travaillent sous la direction des magistrats spécialisés du ministère public du TGI de Paris regroupés au sein du SCLAT (Service Central de la Lutte AntiTerroriste : ex-14e Section du parquet de Paris), et avec les ma-gistrats chargés de l’instruction.
C. Pour les interventions (unités d’intervention)
Souvent, les arrestations sont réalisées par les services spécialisés eux-mêmes : DCRI et DCPJ.
Mais, s’il existe une technicité particulière (intervention en hauteur...), ces services font appel au GIGN, au RAID...
Le RAID n’effectue d’ailleurs pas que des interventions. C’est aussi une unité de surveillance et de filature spécialisée dans les milieux terroristes, à la disposition de tous les services policiers et œuvrant sous l’autorité de
l’UCLAT.
Pour autant, toutes les arrestations ne sont pas réalisées par des spécialistes, certaines sont réalisées par des brigades ordinaires.
D. Pour les services judiciaires
La spécificité de l’antiterrorisme est que tous les magistrats sont regroupés à Paris.
Il y a en tout 8 magistrats du parquet (procureurs) et 8 juges instructeurs (juges d’instruction).
Officiellement, ce regroupement à Paris est justifié d’une part, par la complexité des affaires, qui demanderait une professionnalisation (des magistrats sont spécialisés en antiterrorisme) et, d’autre part, par le fait que l’antiterrorisme est un enjeu national et qu’il serait donc logique de réunir toutes ces affaires dans la capitale.
Il y a donc une espèce de concurrence entre les juridictions locales et la juridiction parisienne (qui, elle, est antiterroriste).
Dans la tradition française, les auteurs de crimes sont jugés par une juridiction comportant un élément populaire (ce sont les jurés de la Cour d’Assises, des citoyens qui deviennent juges le temps d’un procès).
Mais il existe des dérogations. Dans la réforme du 21 juillet 1982, il est écrit que le jugement des crimes commis en matière militaire et en temps de paix est confié à une Cour d’Assises composée d’un président et de 6 assesseurs « lorsqu’il existe un risque de divulgation d’un secret de la défense nationale ».
C’est ce modèle qui a servi en matière d’antiterrorisme. En 1986 apparaît une Cour d’Assises spécialisée en matière de crimes terroristes. Elle a été justifiée par la crainte de la survenance d’un dysfonctionnement de l’appareil judiciaire dû aux possibles pressions que pourraient exercer des terroristes sur les jurés. En 1962, des jurés nîmois, effrayés par des menaces perpétrées par téléphone par des membres de l’OAS (l’Organisation de l’Armée Secrète), ont refusé de siéger.
Les juges de la Cour d’Assises spéciale sont désignés par le premier président de la Cour d’appel et non par l’Assemblée Générale de celle-ci.
Il existe une polémique au sein même du milieu judiciaire au sujet de cette Cour d’Assises spéciale : certains estiment qu’il s’agit d’une juridiction d’exception, un « monstre juridique », contraire aux Droits de l’Homme.
Les arrêts de la Cour d’Assises spéciale peuvent faire l’objet d’un appel devant une autre Cour d’Appel, également composée de 8 magistrats professionnels.
C’est sur le modèle de la Cour d’Assises antiterroriste qu’ont été mises en place des Cours d’Assises spécialisées en matière de stupéfiants. Par ailleurs, il existe aussi des chambres spécialisées compétentes pour juger d’infractions économiques et financières.
Au bilan, les services français antiterroristes sont caractérisés par la centralisation, la spécialisation et la dispersion, même si celle-ci est atténuée depuis la récente création de la DCRI à Levallois-Perret. Entrelacs de services, concurrence, qui parfois, dit-on, au lieu de complémentarité, entraîne une perte en efficacité...
4. Définition juridique d’un acte « terroriste »
Comme toutes les infractions, les actes terroristes comprennent un élément matériel et un élément intentionnel.
A. Les Actes
Il y a d’abord le « terrorisme classique ». Ce sont des infractions qui existent déjà dans le droit commun. « Constituent des actes de terrorisme (…) les infractions suivantes :
• atteintes à la vie, atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, enlèvement et séquestration ainsi que détournement d’un aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport (…)
• vols, extorsion, destruction, dégradation et détérioration ainsi qu’infraction en matière informatique (…)
• infractions en matière de groupes de combat et mouvements dissous (…)
• fabrication ou détention de machines, engins meurtriers ou explosifs (…)
• recel du produit de l’une des infractions ci-dessus
• infraction de blanchiment (…)
• délits d’initiés (…)
Toutes ces infractions peuvent être traitées soit en droit ordinaire, soit en régime antiterroriste. Ainsi, un vol, ou une dégradation, peut être considéré à certains moments comme une infraction terroriste, à d’autres comme une infraction ordinaire.
Il existe aussi des infractions spécifiques à l’antiterrorisme :
— le terrorisme écologique. Il apparaît en 1992 et est défini par « le fait d’introduire dans l’atmosphère, le sol, le sous-sol, les eaux, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel, lorsque ce fait est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ».
— le terrorisme par association de malfaiteurs. Le fait de « participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits, d’un des actes mentionnés aux articles précédents » (cf. liste des infractions ci-dessus).
L’incrimination de l’association de malfaiteurs au titre des infractions terroristes date de la loi du 22 juillet 1996.
Cette accusation d’association de malfaiteurs est très souvent utilisée en régime antiterroriste. La seule constatation de l’existence d’un ou plusieurs faits matériels qui démontreraient l’appartenance d’un individu à un groupement déclaré terroriste, suffit à le poursuivre sur le fondement d’association de malfaiteurs.
— le financement d’entreprise terroriste. « Financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés, ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés en tout ou partie, en vue de commettre l’un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d’un tel acte ».
— le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relation avec une ou plusieurs personnes se livrant à l’un ou plusieurs des actes prévus aux articles (cf. liste des infractions p.14).
B. Les intentions, l’élément intentionnel
Juridiquement, une seule chose distingue un acte « terroriste » d’un acte ordinaire : c’est une intention spécifique attribuée à la personne accusée. Si une personne est inculpée en régime antiterroriste, c’est qu’on lui reproche d’avoir certaines mauvaises intentions. Cette intention, ou mobile, est définie par la « relation [d’un] acte avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ».
En antiterrorisme (comme pour tout le droit pénal), l’ampleur des dégâts, les préjudices causés, importent peu pour qualifier une infraction. Avec la formule « en relation avec », qui est très floue, on comprend que ce qui compte pour qualifier un acte de terroriste, c’est la relation de cet acte avec une certaine intention. Et non, comme on peut parfois le croire, le fait que l’acte dont la personne accusée est très très grave.
La preuve de la relation entre un acte et ce qui est appelé « entreprise » (ayant pour but de troubler gravement l’ordre public...) est donc cruciale en antiterrorisme. Mais aucun texte juridique ne définit la notion d’entreprise. D’après certains juristes, ce terme ne peut donc que poser problème. Ce mot semble correspondre à la notion de préméditation. Mais cette dernière exige la prévision d’une infraction bien déterminée alors que l’entreprise terroriste ne nécessite pas un projet aussi précis. La preuve du dessein terroriste reviendrait à la constatation de l’existence d’une organisation minimum préalable et structurée en vue de commettre une des infractions de la fameuse liste (cf. liste des infractions p.14).
En mentionnant clairement « individuel ou collectif », la loi prévoit que le nombre d’individu importe peu. Un individu seul peut être accusé de terrorisme (comme cela a par exemple été le cas pour la personne accusée d’appartenir au Fnar, Front national antiradar).
Enfin, le but de l’entreprise serait de « troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ». On constate d’emblée un problème de taille. La définition du terrorisme est tautologique : le terrorisme est défini par la terreur ! De plus, les notions de « terreur » et d’ « intimidation » sont des conditions très subjectives.
Pour qu’un acte soit qualifié de terroriste, il faudrait pouvoir montrer que la personne aurait eu recours à des procédés inquiétant les populations, créant un sentiment permanent d’insécurité, ou un sentiment d’insécurité maximal. L’intimidation correspondrait à une angoisse d’ordre physique, la terreur à une angoisse d’ordre psychologique. Eléments par définition impossibles à mesurer.
Il faudrait aussi montrer que l’infraction engendre un trouble grave à l’ordre public. Mais le concept d’ordre public est difficile à cerner. Évidemment la loi ne tend pas à qualifier toute action violente de terroriste.
Au bilan, la qualification de terrorisme repose sur l’existence d’un mobile terroriste, d’une intention particulière, qui est éminemment subjective. Il n’est donc pas aisé de donner une définition claire du terrorisme, la loi restant floue à ce sujet, et cela n’est sans doute pas anodin... C’est d’ailleurs le cas pour l’ensemble du droit, où les termes utilisés restent flous, et sont donc sujets aux différentes interprétations des juges. Cela garantit au pouvoir une marge de manœuvre.
C. Basculements du régime antiterroriste au droit commun et vice-versa
Un même acte peut donc être qualifié à certains moments de terroriste, à un autre non. Il y a trois moments possibles de basculement d’une affaire entre le régime commun et le régime antiterroriste.
1) Lors de l’enquête préliminaire ou de flagrance [3]
Un crime ou un délit est flagrant quand il se commet actuellement, ou vient de se commettre. La définition de ce qui est flagrant est essentiellement temporelle : l’enquête « de flagrance » est commencée immédiatement après l’infraction. Elle ne peut pas durer plus de quinze jours : pendant ce temps elle est supervisée par le procureur et laisse aux flics une grande marge de manœuvre.
L’enquête préliminaire est décidée soit par les flics, soit par le procureur : elle peut concerner des crimes comme des délits, et elle échappe au contrôle d’un juge d’instruction. Elle donne en principe moins de pouvoir aux enquêteurs que la flagrance ou l’instruction, surtout pour les perquisitions, mais son intérêt pour le parquet est qu’elle est sous son contrôle, sans l’intervention d’un juge d’instruction supposé plus indépendant. Elle peut conduire directement à un procès correctionnel.
Les enquêtes de flagrance et les enquêtes prélimianires sont d’abord menées par la police judiciaire locale. C’est alors le procureur local qui assure leur direction. Il prend, ou non, la décision de centraliser la poursuite sous la direction du parquet de Paris. S’il pense que l’affaire relève de l’antiterrorisme, le procureur local informe le procureur de Paris (antiterroriste) [4] qui lui, informe la Chancellerie (le Ministère de la Justice). En cas de conflit entre le procureur local et le procureur de Paris, c’est la Chancellerie qui tranche.
Quand il est décidé que l’affaire bascule en antiterrorisme, les services policiers locaux travaillent avec un procureur antiterroriste (et non plus avec le procureur local, comme c’est le cas pour les enquêtes ordinaires).
C’est donc une procédure où on passe d’une affaire qui était au début ordinaire, et qui devient antiterroriste.
2) Pendant l’information (c’est-à-dire l’instruction, l’enquête)
Un procureur siégeant dans un tribunal local peut demander au juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction parisienne. Autrement dit, un procureur local peut estimer à un moment donné au cours de son enquête qu’il n’est plus compétent pour la diriger, et demande alors à un procureur antiterroriste de se substituer à lui.
C’est une procédure rapide.
a) Les parquets généraux concernés et la Chancellerie sont avisés et invités à formuler leurs observations.
b) Le juge d’instruction fait connaître sa position. Est appliqué le principe du contradictoire : les parties (le procureur local et les personnes accusées) sont informées et sont invitées à formuler leurs observations (« droit de la défense »).
c) Le juge d’instruction local se prononce par une ordonnance d’acceptation de dessaisissement ou de refus.
d) L’ordonnance rendue, quelle qu’elle soit, peut être contestée devant la chambre criminelle de la cour de Cassation.
A l’inverse, il est aussi possible qu’un juge antiterroriste ait été saisi pour des faits qu’il estime ne pas relever de l’antiterrorisme, et il peut alors faire l’objet d’une déclaration d’incompétence.
Pendant l’instruction, le basculement est donc possible dans les deux sens.
3) Au stade du jugement
Il existe des cas où au moment du passage devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris, il est établi qu’une affaire, pourtant instruite sous le régime antiterroriste, ne relève finalement pas de l’antiterrorisme (qu’elle devrait donc être jugée dans un tribunal local). Il existe alors une procédure de dessaisissement de ces juridictions. Elles se déclarent incompétentes et renvoient le ministère public à se pourvoir. Mais ces juridictions peuvent tout de même décerner un mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.
A l’inverse, il n’y a pas de solution lorsque ce sont les tribunaux locaux qui sont incompétents (qu’ils se rendent compte que l’affaire qu’ils jugent de manière ordinaire relèverait plutôt de l’antiterrorisme). Au moment du procès, une affaire peut donc sortir de l’antiterrorisme, mais ne peut pas basculer dans le régime antiterroriste.
5. Spécificités de la procédure antiterroriste
A. Contrôles et vérifications d’identité
Le contrôle et la vérification d’identité se déroulent de la même manière en droit ordinaire ou en antiterrorisme.
B. Garde à vue
En revanche, la procédure de garde à vue est différente en antiterrorisme.
D’abord, la durée maximale de la garde à vue est de 6 jours, soit 144h. Cette procédure n’existe qu’en antiterrorisme. Mais dans les faits, il semble que la plupart des gardes à vue, même en antiterrorisme, n’excèdent pas 96h (durée que subissent aussi régulièrement ceux qui sont accusés de trafic de stupéfiants, de bande organisée, de proxénétisme et de fausse monnaie).
Cette prolongation de la durée de garde à vue en antiterrorisme est officiellement justifiée par le fait que le terrorisme est par nature le fait de menées clandestines et est souvent international.
Ces prolongations ne sont possibles que pour des personnes majeures.
Ces prolongations sont soumises à l’autorisation donnée sur demande du procureur par le JLD (Juge des Libertés et de la Détention) s’il s’agit d’une enquête préliminaire ou d’un flagrant délit, ou par le juge d’instruction s’il s’agit d’une commission rogatoire.
En antiterrorisme (comme pour bande organisée, stupéfiants, proxénétisme et fausse monnaie), le gardé à vue ne peut voir un avocat qu’après 72 heures, soit 3 jours de garde à vue. Pour des procédures ordinaires, il peut le voir dès les premières 24 heures.
C. Perquisitions, visites domiciliaires, visites des véhicules et saisies
Officiellement, il existerait de fortes dérogations en matière d’antiterrorisme. Par exemple, les flics peuvent perquisitionner sans avoir l’assentiment de la personne concernée !!! Cela n’a évidemment rien d’exceptionnel. Il est extrêmement rare, quelle que soit la procédure en cours, que les flics demandent à quelqu’un son autorisation avant de perquisitionner son appart !
De plus, en antiterrorisme comme pour proxénétisme ou trafic de stupéfiants, les flics ont l’autorisation, depuis la Loi sur la Sécurité Quotidienne (LSQ) de 2001, de perquisitionner de nuit (c’était déjà le cas pour toutes les procédures en flagrant délit ou lorsqu’une information judiciaire était ouverte). Mais cette autorisation de nuit ne concerne pas les domiciles (où, comme en régime ordinaire, les flics ne peuvent commencer à perquisitionner qu’entre 6h et 21h), elle concerne par exemple les caves et les garages.
Ce qui vient aussi de la LSQ de 2001, c’est le droit pour les flics, sur réquisition du procureur, de fouiller des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public. D’où la possibilité pour les flics d’ouvrir les coffres. Officiellement, avant, seuls les douaniers pouvaient le faire. Mais en réalité, cela fait bien longtemps qu’il en est autrement.
En antiterrorisme comme en droit ordinaire, les procédures incidentes sont valables. Autrement dit, si les flics viennent pour chercher quelque chose (des explosifs) et qu’ils trouvent autre chose (une boulette de shit), ils peuvent te poursuivre pour cette dernière. Certains juristes dénoncent le risque de détournement de la procédure. Les flics utiliseraient officiellement une procédure antiterroriste pour avoir le droit de fouiller plein de bagnoles n’ayant aucun rapport avec cette procédure antiterroriste et donc poursuivre des gens pour plein d’autres choses. Un peu comme lorsque les flics utilisent le prétexte de rechercher des armes dans une zone donnée pour en fait réaliser une grande rafle de sans-papiers.
Enfin, il est précisé qu’en antiterrorisme, des agents de sécurité privée peuvent procéder, sous réserve de leur agrément par la préfecture et du consentement de la personne concernée, à des « palpations » et à des contrôles des bagages, dans les ports, les aéroports et dans les lieux recevant du public. Là, c’est clairement écrit dans les textes. Dans la vie ordinaire, cela se passe déjà quotidiennement. Le vigile fouille ton sac à la sortie du magasin sans te demander ton autorisation.
Il existe donc plusieurs dérogations qui ne concernent pas que les personnes directement touchées par l’antiterrorisme : elles sont prévues pour être extensibles.
D. Moyens modernes d’investigation matérielle
Depuis la LSQ de 2001, les fournisseurs d’accès Internet et les réseaux de télécommunication (téléphone par exemple) ont obligation de conserver les traces pendant un an. Les magistrats peuvent ordonner le déchiffrement des e-mails cryptés.
Les écoutes téléphoniques seraient prohibées. Mais évidemment, il existe deux exceptions : les écoutes judiciaires (prescrites par le juge d’instruction ou le procureur) et les écoutes administratives (prescrites par le premier ministre pour la sauvegarde d’un impératif d’intérêt national).
Il existe aussi un fichier automatisé concernant spécifiquement le terrorisme. Inspiré du fichier RG, il s’appelle d’abord « Violence ». Puis, en 1982 apparaît le fichier VAT « Violence Attentat Terrorisme », qui contient des informations sur des « menées internes et internationales » « terroristes ». Il facilite le recoupement méthodique des informations. Ce fichier permet l’identification des personnes (état civil, pseudonyme, nationalité). Il donne la possibilité d’identifier une personne à partir de ses habitudes de vie, de ses compétences ou d’une simple description physique. De plus, l’ensemble du fichier concerne non seulement les individus connus pour leurs « activités terroristes » ou leur soutien apporté à des « groupes terroristes », mais également des personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes avec les personnes fichées. Cette base de données était alimentée par le service des RG et différents services de l’antiterrorisme.
Depuis la création de la DCRI (fusion des RG et de la DST) en juillet 2008,
existe le fichier Cristina (Centralisation du Renseignement Intérieur pour la Sécurité du Territoire et des Interêts Nationaux). Ce fichier, classé secret défense, contient des données personnelles sur les personnes fichées, mais aussi sur leurs proches et leurs relations. Ce fichier n’est pas soumis au contrôle de la CNIL et est né entre autres de la fusion d’une partie du fichier RG et de celui de la DST.
A peu près à la même date, le fichier Gesterext (Gestion du terrorisme et des extrémismes violents) est venu remplacer le fichier Gester. Il s’agit d’un fichier de renseignement intérieur géré par le service chargé de la lutte contre le terrorisme et les extrémismes à potentialité violente de la DRPP (Direction Régionale de la Préfecture de Police de Paris).
Autrement dit, les RG de Paris travaillent avec le fichier Gesterext, alors que la DCRI travaille pour toute la France avec le fichier Cristina.
E. Préventive
En antiterrorisme, les durées possibles de détention provisoire (période pendant laquelle la personne est mise en prison dans l’attente de son procès), sont plus importantes qu’en régime ordinaire.
Ainsi, normalement si une personne est en mandat de dépôt correctionnel, elle peut être en préventive pour une durée de quatre mois renouvelable deux fois (soit au maximum un an, et, dans des circonstances exceptionnelles, un an et quatre mois). Mais en antiterrorisme, cette période peut durer jusque deux ans et quatre mois.
De même, si quelqu’un est en mandat de dépôt criminel, la durée standard est d’un an renouvelable. En régime ordinaire, si la personne encourt moins de 20 ans, la durée maximale est de deux ans (ou 2 ans et 8 mois dans des circonstances exceptionnelles[4]). Cette durée est de 3 ans (ou 3 ans et 8 mois toujours dans des circonstances exceptionnelles) lorsque la personne n’encourt pas moins de 20 ans.
En antiterrorisme, on peut rester en préventive jusque 3 ans (ou 3 ans et 8 mois) si la personne encourt moins de 20 ans. Si ce n’est pas le cas, la personne peut rester jusque 4 ans (ou 4 ans et 8 mois).
Ces dérogations existent pour d’autres cas que l’antiterrorisme.
En procédure correctionelle, il en est de même dès qu’une personne est accusée d’une infraction qui a été commise hors du territoire national ou pour les personnes accusées de trafic de stupéfiants, d’association de malfaiteurs, de proxénétisme, d’extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu’elle encourt une peine égale à dix ans d’emprisonnement.
En criminelle, il en est de même lorsque l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national. Et le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.
F. JAP (Juge d’Application des Peines)
Depuis la loi du 23 janvier 2006, il existe un principe de centralisation étendu à l’application des peines. Cela concerne donc toute la chaîne pénale : JAP du TGI de Paris, tribunal de l’application des peines du TGI de Paris, et la chambre de l’application des peines de la Cour d’Appel de Paris.
G. Prescription
Comme le stipule le texte du 8 février 1995, les prescriptions en matière de terrorisme sont différentes du droit ordinaire : les périodes sont plus longues. Cette dérogation n’est pas spécifique à l’antiterrorisme : il en est de même, entre autre, pour les trafics de stupéfiants.
Ainsi, par exemple, les délais de prescription de l’action publique et de la peine sont normalement de 20 ans pour les crimes. En antiterrorisme, c’est 30 ans.
H. Condamnations
La sévérité des sanctions encourues augmente lorsque l’on est sous le régime antiterroriste.
Les situations sont différentes pour les personnes physiques et les personnes morales (représentants d’associations, d’entreprises...).
1) Personnes physiques.
Il existe une division entres peines principales et peines complémentaires.
a) Peines Principales
• Concernant les peines pour des actes de terrorisme définis par référence à une infraction ordinaire (cf. liste des infractions p.14), le calcul se base sur les peines encourues au titre des infractions de droit ordinaire. Mais le maximum de la peine encourue est aggravé d’un degré lorsqu’il s’agit d’une peine privative de liberté (lorsque tu risques de la prison ferme).
Par exemple, tu risquais « normalement » jusqu’à 30 ans de réclusion criminelle, cela devient perpétuité si tu es en antiterrorisme.
Au lieu de 20 piges, c’est 30 ; au lieu de 15, c’est 20.
Et il en est de même en matière correctionnelle. Au lieu de 7 c’est 10 ; au lieu de 5, c’est 7.
S’il s’agit d’une peine de 3 ans au plus, la peine est multipliée par deux.
Donc les infractions constituant normalement des délits, lorsqu’elles sont punies de plus de 10 ans de taule, deviennent des crimes (un crime est une infraction où tu risques plus de 10 ans).
Des augmentations de peine existent aussi pour d’autres régimes spéciaux, comme le trafic de stupéfiants.
Quant aux peines pour des infractions terroristes spécifiques, cela dépend des infractions :
• association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.
En droit ordinaire, lorsque tu es accusé d’association de malfaiteurs, en fonction de la gravité des infractions préparées, tu risques soit 5 ans de prison et 75 000 euros d’amendes, soit dix ans et 150 000 euros d’amende. En antiterrorisme, si tu es accusé d’association de malfaiteurs, tu risques 10 ans de prison, mais la différence est que l’amende maximale est de 225 000 euros (au lieu de 150 000 en droit ordinaire).
• financement d’entreprise terroriste. C’est aussi 10 ans. Mais pour l’exécution des amendes, le JLD peut ordonner des mesures conservatoires sur les biens des personnes mises en examen (il peut demander à saisir des biens personnels).
Périodes de sûreté. Il y a une période de sûreté lorsque l’acte de terrorisme est puni de peines criminelles ou de 10 ans d’emprisonnement. Pendant cette période, les condamnés ne peuvent pas bénéficier de suspension ou de fractionnement de la peine, ni de semi-liberté ou de liberté conditionnelle, pas non plus de permis de sortie ou de placement à l’extérieur.
La durée de cette période est de la moitié de la peine ou de 18 ans pour la perpétuité.
Par décision spéciale, les juges peuvent aussi bien décider en-dessous de la moitié car il n’est pas prévu dans la loi de seuil minimum.
Cette période de sûreté est aussi appliquée à des personnes qui ne sont pas en procédure antiterroriste, lorsque celles-ci sont condamnées à des crimes ou à des délits punis de 10 ans d’emprisonnement.
b) Peines complémentaires communes.
Les peines facultatives sont applicables à tous les « terroristes », quelle que soit leur nationalité. Celles-ci existent aussi dans le cadre de procédures qui ne sont pas antiterroristes.
• interdiction de droits civiques, civils et famille.
Interdiction temporaire d’une durée maximale de 15 ans en cas de crime et de 10 ans pour un délit.
• interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale.
C’est lorsque l’acte a été commis dans ce cadre.
La durée de l’interdiction peut être définitive ou temporaire. Et si c’est temporaire, le maximum en terrorisme est de 10 ans (normalement, c’est 5 ans).
• interdiction de séjour. Pour 15 ans (d’habitude, c’est 10).
c) Peines complémentaires réservées aux étrangers.
Les étrangers encourent l’interdiction de territoire (apparemment très sévère en antiterrorisme).
En droit ordinaire, existent des restrictions concernant certaines catégories d’étrangers bénéficiant d’un lien privilégié avec la France. Cette restriction n’est pas prévue sous le régime de l’antiterrorisme. L’interdiction de territoire peut entraîner une reconduite à la frontière à l’expiration de la peine privative de liberté (après la prison, c’est l’expulsion), ce qui arrive aussi dans bien des cas en droit ordinaire.
2) Personnes morales
Une personne morale, c’est par exemple le représentant d’une association, d’un groupement politique, d’une société commerciale, d’une fondation…
Toute personne morale qui facilite des actes terroristes peut être sanctionnée pénalement.
Dans ce cas, l’amende est multipliée par 5 par rapport à une personne physique.
Une des peines peut être la dissolution de l’association, de la société…
Une autre est l’interdiction pour la personne d’exercer une ou plusieurs de ses activités sociales ou professionnelles (si l’infraction a été commise dans le cadre de ses fonctions). Cette interdiction ne peut excéder un an.
Les autre peines possibles sont des exclusions définitives ou temporaires des marchés publics, des interdictions d’émettre des chèques, et l’interdiction de l’affichage et de la diffusion de la condamnation prononcée.
Mais sont exclues de certaines peines les personnes morales de droit public, partis et groupements politiques, syndicats professionnels… !
[1] Dont Le terrorisme, Marie-Hélène Gozzi, Ellipses et Le terrorisme, J.-F. Gayraud et David Senat, Que sais-je ?
[2] Extraits légèrement adaptés de Contribution aux discussions sur la répression antiterroriste, disponible sur http://infokiosques.net
[3] Il existe trois sortes d’enquêtes en droit pénal : l’enquête en flagrant délit, l’enquête préliminaire et l’instruction.
L’instruction, comme son nom l’indique, se déroule sous le contrôle du juge d’instruction. Le juge peut donner des missions aux flics ; celles-ci s’appellent « commissions rogatoires ».
[4] D’où l’intérêt, par exemple, de la note du 13 juin 2008, où le ministère de la justice invite tous les procureurs locaux à tenir informés les procureurs antiterroristes dès qu’ils se retrouvent face à des personnes qu’ils soupçonnent d’appartenir à la mouvance anarcho-autonome (celle-ci étant définie notamment par certains types d’actions, comme des manifestations de soutien à des prisonniers ou d’étrangers en situation irrégulière). Une telle mesure facilite le basculement de certaines affaires en antiterrorisme.
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (251.7 kio)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (147.1 kio)