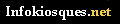Brochures
Dans le Brouillard
mis en ligne le 22 janvier 2016 - B. Traven / Ret Marut
Parfois, quand son esprit était disponible, le sergent Karl Veek se rappelait un rêve qu’il avait fait dans le passé. Il ne pouvait se souvenir qu’avec difficulté des détails de ce songe enchanteur. Il y était ingénieur civil vivant une vie d’oisiveté somptueuse, dans une maison magnifiquement aménagée qu’il possédait en ville. Il était marié à une épouse à la fois séduisante et cultivée, il avait une petite fille ravissante. Et il goûtait l’existence d’un homme consciencieux, paisible et totalement satisfait.
C’était un rêve. Peut-être, ce qui le rendait si enchanteur était qu’il se trouvait hors de portée, inaccessible. Car, en réalité, Karl Veek avait toujours été soldat aussi loin qu’il puisse s’en souvenir, au moins depuis trois ans. Il ne pouvait se rappeler avoir jamais fait autre chose qu’attendre l’ennemi, ici, dans la tranchée, son fusil à la main. De temps en temps, obéissant à des ordres n’admettant pas de critiques, il devait fixer sa baïonnette et livrer l’assaut à une position de l’ennemi, en chassant résolument toute pensée de son esprit. Sauf celle-ci : tout homme se dressant sur mon chemin, qui porte un uniforme différent du mien, me tuera si je ne le tue pas le premier. Et, au moindre bruit que j’entendrais - que ce soit le tonnerre ou la cannonade, le crissement des cailloux ou le bruissement des feuilles, le murmure d’une voix - en toute probabilité, cela signifiera… ma mort !
Son fusil devant lui, sur le parapet, il tâtonna vers sa poche. Il en tira une photographie et une lettre, trouvant bien étrange que celle-ci possède une lointaine ressemblance avec cette femme dont il avait rêvé qu’elle était son épouse. Et les mots contenus dans cette lettre, qui semblaient si impersonnels et sans aucune vie propre, lancèrent un appel résonnant dans tout son être pour lui rappeler les lèvres rouges de la belle femme de son rêve. Mais l’écho fut si soudain qu’il aurait pu s’agir du son de cloches d’argent magiques carillonnant doucement en bas du terrain où il se tenait.
- « Sergent Veek ! »
- « Ici, lieutenant ! »
Qu’est-ce que les rêves m’ont jamais apporté, pensait Veek, si ce n’est remplir ma tête de sottises ?
- « Présentez-vous immédiatement au commandant, sergent Veek. Le caporal Ehming va prendre votre poste. »
- « Très bien, lieutenant ! »
- Relevé par le caporal, il se dirigea en vitesse, le fusil à l’épaule, pour se présenter au commandant dans son abri.
- « Sergent Veek, j’ai là une mission difficile, une mission qui nécessite de l’intelligence. Vous êtes le seul homme pour cette tâche, je ne peux me séparer d’aucun de mes officiers. Vous pouvez donc voir à quel point j’attache de l’importance à cette opération. Il n’y a eu aucun tir d’en face depuis maintenant deux jours. Aucun mouvement d’aucune sorte n’a été observé. Trois hypothèses se présentent : soit la position a été évacuée, soit c’est un piège ou bien encore ils se préparent à quelque chose là-bas. Nous avons besoin de savoir ce qui se passe. Prenez deux soldats pour vous aider. Pas de fusils, seulement les couteaux et les revolvers. Je veux que personne, là-bas, ne sache que nous avons une patrouille en reconnaissance. Mangez un morceau et allez-y. Faites en sorte d’être revenu avant la tombée de la nuit. Des questions ? »
- « Non, commandant ! »
C’était le début de la matinée, le ciel était dégagé. Mais deux heures après que Veek fut sorti, un épais et pesant brouillard avait recouvert lentement le terrain. À ce moment, le brouillard s’était intensifié jusqu’à ce qu’il devienne aussi solide qu’un mur blanchi à la chaux. Maintenant Veek ne pouvait plus distinguer ce qu’il y avait à deux pas devant lui. Ordonnant aux deux hommes de rester où ils étaient, il continua seul, marquant son chemin pour le retour en appuyant sa botte dans le sol.
À petits pas hésitants, il commença à se frayer un chemin à travers le dense mur blanc qui était prêt à reculer d’un pas - juste pour le laisser avancer - et puis se refermait immédiatement après, aussi ferme derrière que devant, comme s’il était en ciment. Effrayé à l’idée de perdre ses repères, il sortit sa boussole et la tint contre une petite carte rudimentaire.
Ce fut quand il releva la tête qu’il vit, à moins de deux pas de lui, un officier français qui, croisant son regard, se figea sur place. Aucun d’eux ne ressentit de la peur, il n’y avait pas non plus de crainte dans leurs yeux, seulement un profond étonnement. Chacun regardait l’autre comme s’il avait été le seul et unique habitant de la planète jusqu’à ce qu’il se trouve tout à coup face à face avec le premier homme. Quand ils virent l’uniforme de l’autre, chacun pensa en même temps que maintenant ils devaient faire une chose bien précise, une chose plutôt habituelle, une chose banale, une chose qui les dominait presque avec la force d’une obligation à laquelle ils ne pouvaient échapper, une chose qui leur fermait toute issue. Mais aucun d’eux ne savait ce que c’était, ni ce que ce devoir irrésistible ordonnait d’eux. Il leur semblait qu’une voix intérieure hurlait : « Agis ! Tu sais ce que tu dois faire ! » Mais, durant toutes ces années, jamais l’un d’eux n’avait rencontré, si proche et si calme, si inattendu et si seul sur cette île déserte, un homme à habit différent du sien.
Chacun d’eux pouvait ressentir le souffle de l’autre, ils pouvaient même voir les lignes les plus délicates inscrites sur le visage de l’autre. Alors, ils restaient debout complètement stupéfaits et, tout à coup, ils n’arrivèrent plus à comprendre les manières de fonctionner du monde.
Au même moment, chacun d’eux leva lentement la main à son képi et adressa délibérément un salut - léger mais reconnaissable - en direction de l’autre.
L’expression de leurs visages était aussi sévère que la mort. Mais dans les profondeurs insondables de leurs yeux reposait une simple question que les hommes ne manquent jamais de comprendre. Ils rabaissèrent leurs mains et firent demi-tour pour s’en aller. Pendant un instant infiniment bref, une seconde d’éternité les enveloppa et les dépouilla de leurs uniformes, et sans y penser, obéissant à cette volonté puissante, ils s’avancèrent en même temps pour prendre la main de l’autre. Ils se serrèrent la main comme des amis qui doivent se séparer pour toujours. Tout aussi rapidement, ils relâchèrent la main de l’autre, et repartirent par le chemin qui les avait amené.
Quel autre comportement chacun d’eux aurait-il dû avoir, après qu’il eut reconnu que face à lui se trouvait un homme ?
Car, ils furent tous les deux soudainement rendus aveugles et ne virent pas l’ennemi.
Ret Marut, März (Berlin/Munich), 1916.
***
« Je ne me considère pas comme Allemand parce que je n’ai nul titre à y prétendre. Personnellement, je ne considère cela ni comme un honneur ni comme une honte, car je suis, comme la plupart des hommes, aussi peu responsable de ma nationalité que de ma date de naissance ou de la couleur de mes yeux. En revanche, mes vrais compatriotes, ce ne sont donc pas ceux auxquelles je me rattache par le hasard de mon lieu de naissance, mais bien ceux qui sont les miens au regard de ma conscience et de ma conception du monde, qui ne vivent pas enfermés à l’intérieur des frontières d’une nation particulière, même aussi loin qu’on veuille repousser ces frontières. »
B. Traven / Ret Marut, février 1928.
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (758.1 kio)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (725.6 kio)