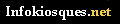R
Récit et impressions sur le mouvement dit « anti-CPE » à Montpellier
Printemps 2006
mis en ligne le 17 novembre 2007 - Nadarlana
Du milieu du mois de février au milieu du mois d’avril, l’Université Paul Valéry à Montpellier connaît une grève avec occupation des locaux. La mobilisation avait commencé près d’un mois auparavant et se poursuivra près d’un mois par la suite.
Les étudiants entendent s’opposer au « Contrat Première Embauche » (CPE) voté par le Parlement, qui prévoit une période d’essai de deux ans pour les moins de 26 ans qui signeront ce contrat. Plus largement, les étudiants s’opposent à l’ensemble de la « Loi sur l’Egalité des Chances » (LEC), dont le CPE fait partie, et qui comprend également des mesures comme la possibilité d’entrer en apprentissage dès l’âge de 14 ans et celle de travailler de nuit dès l’âge de 15. La LEC est alors présentée comme la réponse du gouvernement aux inquiétudes de la jeunesse dont la frange la plus populaire s’est soulevée plusieurs semaines durant, le mois de novembre précédent. Des milliers de voitures furent alors incendiées, des centaines d’institutions et de commerces brûlés.
Comme pour prendre le relais, c’est cette fois la frange la moins défavorisée de la jeunesse qui se mobilise, puisque celle-ci, pour la plupart, reste insérée dans le système scolaire. Les modes d’actions sont alors plus conventionnels, même si l’ensemble du répertoire diversifié propre aux nouvelles formes de militantisme va être mobilisé.
Le discours se voudra plus constructif : les jeunes s’opposent d’abord aux logiques « néolibérales » qui impliquent une flexibilisation du marché de l’emploi, c’est-à-dire, pour eux, une « précarité » accrue.
Ils s’opposent ensuite aux mesures « répressives » qui visent à criminaliser davantage la petite délinquance et, le cas échéant, l’action politique (on reconnaîtra l’analyse de Loïc Wacquant sur l’affaiblissement de l’Etat social et le renforcement de l’Etat pénal).
Une frange plus réduite met également en avant ses préoccupations écologistes, les principes productivistes étant rendus responsables de la dégradation de la planète. Certains parlent de « décroissance », d’autres sont plus radicaux encore, en articulant l’ensemble des préoccupations en un anti-capitalisme révolutionnaire.
Pour rendre compte du résultat de ce bouillonnement tel que j’ai pu l’observer, j’ai choisi de l’aborder sous un angle thématique plutôt que chronologique :
– Rapport aux médias
– Rapport aux syndicats
– Rapport aux « dégradations »
– Rapport à l’administration
– Actions et manifestations
– Vie quotidienne
Rapport aux médias
Il s’agit, selon certains étudiants expérimentés, du premier mouvement où l’on a pu observer une réelle méfiance à l’égard des médias. L’image qui est renvoyée du mouvement paraît déformée : seule la problématique du CPE est évoquée alors que les étudiants s’opposent à l’ensemble de la loi et votent en AG une multitude de revendications, la part belle est faite à la personnification du mouvement à travers quelques leaders syndicaux, la polémique autour du blocage de la faculté leur semble grossie et nombre d’actions menées n’apparaissent pas.
Certaines Assemblées Générales vont interdire l’accès aux journalistes, nombre d’étudiants vont refuser de leur parler, voire les agresseront verbalement. Un tag sur un mur extérieur de la fac ordonne : « Médias casse-toi » (sic).
Les opposants aux médias s’inspirent des analyses de Guy Debord, de Pierre Bourdieu, des films de Pierre Carles (qui viendra par deux fois projeter l’un de ses films), du journal de critique des médias PLPL, du site Internet Acrimed. Ils valorisent les alternatives comme les radios alternatives ou les sites Internet d’information comme Indymedia.
Il ne faudrait cependant pas croire que cette opposition faisait consensus. Le discours syndical, notamment, mettait en avant la nécessité de toucher l’opinion publique dans un sens favorable (argument de la « crédibilité » repris pour critiquer également l’élargissement des revendications, les dégradations, les violences en manifestation...).
J’ai également pu observer que cette relation d’« associés rivaux », propre aux mutations du militantisme, existait plus largement puisque la question des médias s’est posée lors des coordinations nationales auxquelles j’ai assisté à Poitiers, Dijon et Aix. A Poitiers, l’assemblée a d’abord voté contre la présence des médias puis, le bureau de l’assemblée cachant mal sa partialité, un autre vote a permis d’autoriser leur présence pour un unique point de l’ordre du jour dans lequel chaque ville faisait état du bilan de sa mobilisation. C’est ce compromis qui sera par la suite reconduit.
Il est intéressant de noter que les journalistes présents lors de ces assemblées où leur professionnalisme est mis en doute manifestent une totale incompréhension voire de l’hostilité, alors même qu’ils trouvent parfaitement normal de ne pas assister à un Conseil des Ministres. C’est pourtant précisément cette différence de traitement qui leur est reprochée.
Rapport aux syndicats
On sait que le modèle de militantisme propre aux syndicats, fondé sur l’absorption de l’identité individuelle du militant dans le « nous » collectif est remis en cause depuis les années 1970. L’affaiblissement de ce type d’engagement a été flagrant puisque si ce sont eux qui ont donné le coup d’envoi de la mobilisation, ils n’ont jamais été les seuls guides du mouvement.
C’est notamment l’UNEF qui a pâti de la méfiance générale à son égard d’une part parce que son leader national, Bruno Julliard, a été omniprésent dans les médias mais en renvoyant une image déformée des revendications ; d’autre part parce qu’un document présenté comme « fiche interne » du syndicat a beaucoup circulé à Montpellier comme dans d’autres villes. Ce document se présente comme une fiche pratique visant à contrôler les assemblées générales, les bureaux de grève et les relations aux médias en visant les positions-clés et en retenant des informations telles que les contacts avec la presse. De fait, l’UNEF n’a quasiment eu aucune influence sur la grève à l’Université Paul Valéry, se contentant d’apparaître lors de quelques assemblées générales, pour laisser l’occupation se dérouler seule.
Le syndicat SUD a eu plus de poids. Etant lui-même une forme de syndicat issu des nouvelles formes de militantisme qui sont apparues dans les années 80, il n’a pas, par exemple de bureau national et privilégie l’horizontalité. A l’inverse de l’UNEF, proche du Parti Socialiste, SUD compte de nombreux membres appartenant par ailleurs au Parti Communiste et à la Ligue Communiste Révolutionnaire. On peut dire que son influence sur les grévistes présents sur l’occupation était environ aussi grande que celle des personnes prêchant un discours radicalement opposé aux partis traditionnels auxquels il est notamment reproché la stratégie médiatique visant plus à toucher l’opinion publique que faire pression sur le gouvernement par des actions directes de blocage et de sabotage.
Comme je l’ai déjà dit, c’est la thématique de la « crédibilité » qui va diviser les grévistes, l’un ou l’autre « camp » l’emportant selon les questions et les moments.
Mais plus fondamentalement les deux groupes s’opposent sur la place du travail dans la société. Si les syndicats défendent les statuts et combattent la flexibilisation du travail, les autres remettent radicalement en cause le salariat qui reste pour eux tout aussi aliénant qu’au XIXe siècle. C’est donc même la position revendicatrice qui va être critiquée, selon le principe : « nous n’aurons que ce que nous prendrons ». Un slogan souvent repris reflétait cette pensée : « CPE on s’en fout, on n’veut pas bosser du tout ! » ou une banderole « CDI-Famille-Patrie ».
La coexistence de ces deux pôles au sein de l’occupation n’est pas sans rappeler celle qui existe au sein des squats « alternatifs » qui revendiquent à la fois le droit au logement et une certaine manière de vivre autrement : les pôles de réinsertion sociale et de transformation sociale. Cependant on peut penser que dans ces squats on trouve des personnes de chaque pôle mais qui partagent l’envie de mener un projet ensemble. Or, dans le cadre du mouvement plus large qui se déroulait à l’université on trouvait également des gens farouchement opposé au pôle adverse. On a ainsi pu voir, le premier Mai, certains « radicaux » se mettre en marge du cortège et tourner en dérision le rôle institutionnel de l’ensemble des syndicats : postés sur le trottoir comme pour suivre une course, chacun ayant son favori, ils les encourageaient à atteindre au plus vite la table des négociations en guise de ligne d’arrivée.
Rapport aux « dégradations »
Dans la bouche de ceux qui s’en offusquent les « dégradations » renvoient aux graffitis présentés de manière négative. Pour ceux qui les pratiquent, ils s’agit avant tout d’un mode d’expression, d’un détournement, d’une réappropriation de l’espace. Au demeurant, le fait que cela soit perçu comme « dégradation » par les autorités ne leur déplaît pas, mais au contraire cela leur paraît être un moyen d’action comme un autre inscrit dans leur répertoire. Mais il s’agit avant tout, la plupart du temps, d’un message souvent explicite et humoristique destiné à tous ceux qui évoluent dans l’environnement. L’université et plus particulièrement l’amphithéâtre occupé étaient recouverts de telles inscriptions et il serait impossible d’en faire un relevé, d’autant que les personnes qui s’y opposaient nettoyaient régulièrement les tables et les murs - sans jamais parvenir à enrayer le phénomène.
Au-delà du discours sur la « crédibilité », les critiques mettaient en avant l’idée selon laquelle il s’agissait en quelque sorte d’un coup porté à soi-même, puisque les étudiants abîmaient leur propre outil de travail. On retrouvait là la vieille question que s’est posé le syndicalisme autour de la thématique du sabotage. Au demeurant, le sabotage des élections du CROUS a été effectué avec enthousiasme par tous les syndicats qui craignaient - à juste titre - des mauvais scores du fait de n’avoir pas fait campagne à cause de la mobilisation et des conséquences de la décision de l’assemblée générale de boycotter l’élection en plus de la saboter. En revanche, il ne restait plus qu’une vingtaine d’étudiants non-syndiqués, au début du mois de mai, pour envisager le boycott et le sabotage des examens conformément à la décision de l’assemblée générale...
Si pour certains les dégradations du matériel scolaire nuit d’abord aux étudiants, celles-ci ne dérangeaient pas ceux qui les commettaient. Ils mettaient en avant une critique profonde du rôle de l’institution scolaire comme mode de sélection et de reproduction sociale. De plus, la relation inégalitaire professeurs-élèves était critiquée de même que le rôle des examens et des diplômes dans ce système.
Rapport à l’administration
Craignant sans doute des dégâts plus importants, l’administration de l’université affichait son soutien aux étudiants grévistes. Le Président de l’Université, après avoir envoyé une lettre au Premier Ministre lui demandant de suspendre l’application du CPE pour l’expérimenter d’abord, s’est ensuite prononcé en faveur du retrait de cet article de la loi.
Ce qui était interprété comme un soutien par les uns, le fut comme une manipulation par les autres. Un étudiant répètera plusieurs fois une formule avec beaucoup de succès : « si l’administration est derrière nous, c’est peut-être pour mieux nous en... tuber ».
Ainsi, la présence des vigiles dans l’Université a été renforcée et après avoir accordé des photocopies illimitées (suite au vote par l’assemblée de l’occupation de l’imprimerie), le Président reviendra sur sa décision... avant qu’une nouvelle menace d’entrer par effraction dans le local le pousse à accorder de nouveau des photocopies mais sous réserve de contrôler auparavant le contenu des tracts et affiches. On voit donc bien qu’il s’agissait moins d’une collaboration que d’un rapport de force.
L’atout principal du Président résidait dans son droit d’en appeler aux forces de l’ordre pour faire évacuer l’université - comme il finira par le faire interprétant le vote du déblocage de la faculté comme signifiant également la fin de l’occupation de l’amphithéâtre. Mais cela n’était pas aussi simple et s’il avait tenté l’évacuation plus tôt il se serait heurté à l’hostilité d’une grande partie des professeurs attachés au droit de grève et aux principes de la démocratie qui s’exprime à travers les assemblées générales. Sans parler de l’opinion publique, qui avait déjà bondi en faveur des manifestants au lendemain de l’évacuation de la Sorbonne. Beaucoup de personnes ont été étudiantes, ont ou ont eu des proches étudiants...
Actions et manifestations
Il est difficile de rendre compte de la réalité qui se cache derrière le terme « casseurs ». Ce terme médiatique entre surtout en jeu dans les stratégies de disqualification menées par les entrepreneurs de morale. A l’origine, cela vient de la loi « anti-casseurs » votée dans les années 1970 pour réprimer les pratiques en manifestation des « Autonomes » : bris des vitrines, pillage et émeutes. La loi permettait notamment des arrestations préventives et alourdissait sensiblement les peines encourues par les manifestants se livrant à ces actes.
De nos jours le terme renvoie toujours à ces manifestants, mais aussi aux franges les plus précaires de la population, habitant souvent les banlieues et qui profiteraient des manifestations pour se livrer à des agressions et des vols à la tire au milieu des cortèges. Des doutes sont émis par certains sur leur degré de manipulation de la part des forces de polices qui, selon certains témoignages, laisseraient faire ces actes en toute impunité pour se concentrer sur les « casseurs » s’attaquant aux commerces et aux lignes policières. D’autres expliquent que ces « jeunes des banlieues » n’ont pas tord de n’avoir que du mépris pour ces « gentils manifestants », qui sont pour la plupart étudiants et donc, dans leur esprit, représentants d’une classe favorisée qui s’est par ailleurs peu mobilisée lorsque des lois réprimant plus durement leur petite délinquance étaient votées.
En tout état de cause, il s’agit là d’un phénomène essentiellement parisien et les manifestations à Montpellier étaient plutôt calmes. Si des « jeunes des banlieues » étaient présents, c’était avec le reste des manifestants. Et si des incidents ont eu lieu, c’était face aux forces de police.
Ce que l’on a pu surtout observer c’est le nombre assez incroyable d’actions diverses qui ont été menées, en conclusion des manifestations (un vote en ce sens avait été fait en Assemblée générale) et les autres jours. Parfois plusieurs actions étaient menées le même jour, il serait ambitieux d’en faire un relevé exhaustif.
Notons plusieurs actions « péage gratuit », qui consistent à occuper un péage pour faire passer gratuitement les automobilistes que l’on informe et qui peuvent aussi donner quelques pièces (ce qui permet de financer le mouvement). Il y a aussi les blocages de routes qui peuvent être « filtrant », c’est-à-dire dans lesquels la circulation est seulement ralentie. Les manifestations nocturnes aux flambeaux avec des jongleurs ont de leur côté fait le lien avec le Carnaval qui avait subi une forte répression fin février, au début du mouvement.
Il y a également eu nombre d’occupations symboliques, accompagnées parfois du déménagement du mobilier sur la chaussée voire de dégradations (mais avec l’éternel conflit sur la « crédibilité ») et parfois de petits affrontements avec la police notamment lorsque l’occupation concernait le cortège post-manifestation qu’il s’agissait de disperser : UMP, MEDEF, Palais des Congrès, Centre commercial Polygone (avec des affrontements contre les vigiles), Chambre de Commerce et d’Industrie (où les occupants voteront l’abolition du commerce et de l’industrie), magasins Virgin (en lien avec la répression du téléchargement) et Mc Donalds (symbole de précarité, de « malbouffe » et d’impérialisme américain), les hôtels 4 étoiles du centre-ville, plusieurs tentatives avortées sur la gare...
Il y a aussi eu le blocage de la Poste Rondelet suivie d’une assemblée générale avec le personnel, une action consistant à menacer les commerçants du centre-ville de pillage s’ils ne fermaient pas leur rideau (« jeu des trente secondes »). N’oublions pas les actions beaucoup plus pacifistes comme le fait de tracter devant des grands magasins en demandant aux clients de faire un don de nourriture au retour et aussi les innombrables et quasi quotidiennes actions « culturelles » en ville et au sein même de la faculté.
On voit donc bien que le mouvement ne se limitait pas au blocage de l’université et aux manifestations hebdomadaires. Les plus radicaux, s’ils participaient voire impulsaient les occupations, se montraient frustrés de ne pas pouvoir « vivre l’émeute » en raison de la faiblesse du rapport de force et de l’inexpérience des manifestants. S’ils faisaient durer le plus possible les occupations et les multipliaient, ils évitaient de risquer leur arrestation par des actes irréfléchis. Ils tentaient d’informer au maximum les manifestants sur l’« utilité » de s’équiper de masques et de produits contre les gaz lacrymogène. En manifestation, ils tentaient de faire sortir le cortège du trajet prédéfinit en critiquant amèrement le service d’ordre (SO), lequel, selon eux, collabore avec les forces répressives jusqu’à permettre des arrestations au lieu, au contraire, de faire en sorte qu’il n’y ait pas d’arrestation.
Forts de l’absence de vote d’un service d’ordre légitime par l’Assemblée Générale (même s’il y avait tout de même un SO venu de l’autre faculté et une « brigade d’intervention clownesque » qui partie d’une volonté ludique a évolué vers un rôle de SO), ils prônaient la participation de tous les manifestants à la défense les uns des autres et l’absence de tout contact avec les forces de l’ordre. Ce conflit sur le service d’ordre s’est exprimé plusieurs fois lorsque les radicaux voulaient que le cortège dévie son trajet pour occuper la gare, tandis que le SO formait un cordon pour les en empêcher. Une fois, alors que la fin de la manifestation passait près du centre commercial Polygone, le SO en protégeait l’entrée. Mais ceux qui voulaient l’occuper ont réussi à passer en formant une file indienne coupant le cordon et entraînant la plupart des personnes qui voulaient continuer à manifester.
Vie quotidienne
« La lutte doit esquisser une autre forme de société et comme j’espère voir un jour une société sans police ni gouvernement, je ne comprend pas pourquoi nous aurions un service d’ordre ou un bureau de grève permanent. » Cet étudiant exprimait lors de l’assemblée générale l’essentiel de l’argumentation contre la mise en place d’une structure hiérarchisée qu’il voyait calquée sur une société qu’il critiquait dans son ensemble.
Le fait que l’Assemblée Générale ne vote jamais en faveur d’un service d’ordre et que la mobilisation fonctionna pratiquement toute sa durée sans bureau central indique que l’idée d’autogestion et de refus de la délégation était bien présente. Le fonctionnement passait par différentes commissions ouvertes à tous qui ont plus ou moins bien fonctionné.
Lorsqu’une AG vota en faveur d’un bureau central, le bilan qui en fut fait, 10 jours après, était que celui-ci avait seulement apporté de l’aide aux différentes commissions et surtout que l’un des membres de ce bureau, connu pour être anarchiste, n’avait jamais été prévenu des réunions de ce bureau par les autres membres syndiqués ou sympathisants ! Suite à ce « bug », il s’ensuivit un enchaînement de votes assez rocambolesque : après avoir voté pour la désignation d’un nouveau bureau, l’AG vota pour qu’il n’y ait pas de limitation dans le nombre de personne le composant. Puis après de longues secondes où personne ne daigna se présenter pour en faire partie, l’AG vota contre le bureau qui se présentait, dont la majeure partie des membres faisait partie de syndicats ! De fait, il n’y eu un bureau que pendant dix jours sur deux mois.
L’idée d’autogestion était très présente, au point que s’affichait la volonté d’autogérer l’université entière. Si l’on était loin de là, il faut signaler des initiatives fort intéressantes, comme l’amphithéâtre dans lequel les professeurs et les élèves venaient déposer les cours des différentes filières, afin que les étudiants puissent les photocopier et les lire à défaut de pouvoir assister à des cours. Par ailleurs, toujours dans la volonté de continuer la transmission du savoir, une bibliothèque de grève a été mise en place avec des livres, des brochures et des tracts. Il y a eu également nombre de projections et de conférences-débats, souvent avec la participation de professeurs.
Il faut également signaler que l’assemblée générale était ouverte à tous, que le fait d’être étudiant n’était pas requis, selon l’argument que tout le monde devrait avoir accès au savoir. Des jeunes ayant quitté l’université récemment étaient présents, des moins jeunes ayant connu des mouvements comme celui de 1994-95 également. On a aussi vu quelques personnes sans domicile venir dormir à l’université et participer activement à la mobilisation.
A noter, enfin, le conflit par rapport aux concerts que certains étudiants voulaient organiser. D’autres les craignaient et agissaient, parfois avec succès, pour les faire annuler, en expliquant qu’un concert provoquerait l’afflux de personnes alcoolisées incontrôlables qui provoqueraient nécessairement des incidents et donc, nécessairement, la décision par la Présidence de l’Université de l’évacuation de l’Université. Cette peur de la répression, souvent présente par ailleurs lors des différentes actions d’occupation, fut également mise en avant lorsque l’assemblée générale vota l’occupation du bâtiment administratif. L’idée que si cette occupation était effectuée les forces de l’ordre interviendraient s’est alors mise à circuler fortement. L’argument inverse était alors que les derniers mouvements étudiants (2001 et 2003) avaient occupé la salle du conseil d’administration et les bureaux de la présidence sans que la police intervienne pour autant. Le compromis trouvé, finalement, sera le blocage du bâtiment sans son occupation.
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (1.5 Mio)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (1.4 Mio)