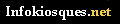C
C.O.P.E.L., tunnels et autres apports des groupes autonomes
Expériences de luttes dans les années 70 et 80 à Valence, Espagne
mis en ligne le 7 décembre 2007 - Quelques dingues incontrolé-e-s
C.O.P.E.L, tunnels et autres apports de Groupes Autonomes
A. Bon, il me semble, corrigez-moi si je me trompe, que la raison de
cette réunion, à part la paella, le plaisir d’être ensemble et tout ça, c’est
cet espèce d’intérêt négatif par rapport à la taule, n’est ce pas ? « Les
prisonniers dans la rue », « Destruction des prisons », etc.…En théorie,
en plus de faire quelque chose ensemble, même peu, on peut aussi
réfléchir à la question. Aujourd’hui, ce ne sera pas une causerie, mais
un rappel, comme illustration, en principe, d’histoires vécues il y a un
bail, dans les années 70 et 80… Des histoires d’ici, de Valence, de gens
qui luttaient contre les taules avec les moyens dont ils disposaient. Un
copain qui a participé à beaucoup de choses durant ces années est
venu, il n’aime pas beaucoup parler en public, je raconterai donc en
quoi consistaient ces histoires. Après, si vous voulez, vous pouvez lui
poser des questions. En partie, j’ai aussi vécu ces histoires.
Ces histoires… concrètement dans les années 70, il y avait une lutte,
en partie dans la rue et en partie des partis politiques, pour l’amnistie,
l’amnistie politique. Ce que recherchaient les bureaucraties politiques
et syndicales, c’était leur part du gâteau démocratique. Ils se
contentaient d’une amnistie politique qui sauverait les apparences
démocratiques de l’époque : pour les délits d’opinion, politiques…
Les libertés qui sous Franco constituaient un délit ont donc cessé de
l’être et les gens prisonniers pour ces mêmes délits n’avaient plus qu’à
être libérés. Il y avait beaucoup de monde surtout en prison, et dans
les quartiers leurs amis et leurs relations, à qui ça semblait bien peu.
Ils pensaient qu’en plus de l’amnistie politique, il devait y avoir une
grâce générale pour ceux qu’on appelait les prisonniers « sociaux »,
vu que s’ils s’étaient retrouvés au trou dans une situation socio-politique
qui supposément était en train de changer radicalement et de
s’améliorer, il fallait également leur donner une chance. Concrètement,
ce type d’actions… Lors des manifs et des mobilisations, pour l’amnistie, nous étions nombreux à réclamer une amnistie générale.
Quand les gens criaient « les prisonniers à la rue », nous autres on y
rajoutait les droit-commun, on faisait des pancartes et ainsi de suite.
Dans les quartiers, à Valence, à Madrid, à Barcelone et ailleurs, il y
avait des clubs de jeunes (bon, vous pourrez lui demander plus tard
ce dont il s’agissait). Dans ces lieux et d’autres, il y avait les comités
de soutien à la COPEL qui se consacraient à la solidarité, par la propagande ou par d’autres moyens dont nous reparlerons, avec le mouvement des prisonniers, concrètement avec la COPEL. Et puis, il y
avait d’autres groupes de gens qui ne faisaient pas forcément partie de
ces comités ou qui ne s’identifiaient pas exclusivement à la COPEL,
car ce n’était qu’un aspect de la situation, et ils faisaient d’autres choses.
Par exemple, ils jetaient des cocktails Molotov sur des banques
quand il se passait des choses dans les prisons. Ici à Valence, comme
dans d’autres villes, différents groupes de quartier se coordonnaient
et au jour et à l’heure convenus ils brûlaient simultanément 10 ou
12 banques. Ces actions se firent pour diverses raisons, entre autre
en solidarité avec les luttes des taulards. Les banques n’avaient pas
de vitres blindées à l’époque, on jetait les cocks directement sur les
vitres et tout cramait, c’était un régal (hi, hi, hi). On peut causer de
ces actions parce qu’il y a maintenant prescription. Elles eurent lieu
pendant un période appelée la « transition », une période d’affrontement direct avec l’État et de désobéissance, qui a duré un ou deux ans dans son climax, sa partie la plus importante. Quand ce mouvement s’est terminé, si on peut appeler ça un mouvement, ce fut la défaite suivie de ses conséquences. Alors, les gens qui avaient participé à tout ça se sont fait emprisonner, quelques uns de ceux qui y avaient participé de l’intérieur des prisons ont été libérés. Ceux qui n’ont pas
été libérés sont non seulement restés enfermés mais ont dû subir la
répression pour leurs actes dans les quartiers d’isolement de premier degré (aujourd’hui appelés FIES [1]). Le FIES n’est pas une invention récente mais il a toujours existé, c’est la prison dans la prison. À l’époque, l’article 10 du règlement de l’Administration Pénitentiaire, qui
est encore en vigueur à l’heure actuelle, fut créé pour légaliser ce
qui avait déjà été fait contre le mouvement des prisonniers contre
les prisons. C’est-à-dire qu’avant même que soit promulguée cette
loi, quasiment tous ceux qui avaient participé aux mutineries, aux
évasions et aux luttes de l’époque avaient déjà été mis à l’isolement.
Les prisons de haute sécurité n’existaient pas, c’étaient des vieilles
taules de premier degré, bien différentes de celles d’aujourd’hui, mais
qui avaient des départements d’isolement dans lesquels on trouvait
des réserves permanentes de flics anti-émeute chargés de recevoir les
prisonniers ayant levé la tête dans tout le pays et qui venaient recevoir
au minimum un tabassage quotidien pour leur apprendre. Ça, ça
se passait déjà en 1978 et 1979. Beaucoup d’individus qui s’étaient
battus dans la rue, en somme beaucoup de ceux qui avaient soutenu
la lutte des prisonniers, se retrouvaient eux-mêmes prisonniers, peu
sont restés à l’air libre. Ici à Valence, comme dans le reste du pays, ces
gens se réunissaient pour… ils n’avaient pas le choix vu que beaucoup
de leurs camarades étaient emprisonnés, alors ils continuèrent à lutter
contre les prisons, et ils tentèrent de les tirer de là. Et pas que leurs
copains d’ailleurs, car la lutte avait commencé contre les prisons en
général, c’était une de ses caractéristiques importantes, et ils n’ont
pas entrepris d’actions visant seulement à faire sortir les potes, mais à
favoriser toutes les évasions. Qu’ont-ils fait ? Par exemple, ils contribuaient au percement de tunnels, à des tentatives d’évasions menées de l’intérieur vers l’extérieur. Ils fournissaient les outils et organisaient l’infrastructure pour ces cavales si elles se produisaient, ce qui n’a pas toujours été le cas. Lorsque tout cela est devenu plus dur à cause de l’évolution de la situation pénitentiaire (ce qui n’a pas traîné), ils se sont mis à creuser des tunnels du dehors au dedans. Imaginez, ici à Valence, un grand groupe de personnes dispersées dans toute la ville ; qui se connaissent bien, comme c’est peut-être le cas ici-même, qui à
un moment donné se mettent à faire un tunnel tous ensemble pour
sortir les gens de la taule. Eh bien, c’est arrivé, ce fut tenté mais ça a
foiré. À Valence, de par les caractéristiques de cette histoire à laquelle
allait participer beaucoup de monde, c’était un truc très ouvert. Ça
a été critiqué par de nombreuses personnes d’ailleurs, mais c’est une
critique qui a été aussi une justification de leur passivité car il n’y avait
pas moyen de le faire autrement. Ça a foiré parce que la police l’a su
avant qu’on atteigne la prison. C’était une course de vitesse, essayer
d’arriver avant d’être découvert et si on était découvert, ben on avait
au moins essayé. Ici, à Valence, ça a échoué. Les mêmes personnes ont
aussi tenté le coup à Gérone où des copains s’étaient retrouvés au
trou, précisément pour avoir monté des braquages pour financer des
projets de libération de compagnons prisonniers. Ils étaient tombés à
Gérone. Donc, ces personnes se sont glissées en tenue de plongée dans
les égouts pour creuser mais les copains ont été transférés. Du coup,
ils ont remis ça à Barcelone. Là-bas, ils ont loué un rez-de-chaussée
à côté de la prison Modelo et ils se sont remis à creuser. Comme ils
ne pouvaient pas faire autrement, il a fallu stocker la terre dans l’appartement.
Il y en avait tant que les murs ont quasiment explosé. Et
alors le voisin d’à côté s’est demandé : « Mais enfin, qu’est-ce qui se
passe ici ? » et il a appelé la police. Et bon, ils avaient eu le temps de
déguerpir, mais la police a affirmé que comme il y avait des résidences
militaires proches, c’était ETA qui faisait un tunnel pour y placer une
bombe, ce qui a été repris par la presse.
Bon, un autre aspect des choses de l’époque ; c’était les gens qui
avaient réussi l’évasion ou qui s’étaient enfuis de l’armée ou encore
qui étaient en cavale pour X raisons. Il fallait leur trouver des planques
ou les aider à sortir du pays. À l’époque c’était plus simple de falsifier
des papiers ; et de leur en fournir…
B. À l’époque, les taules étaient plus près des villes.
A. La taule était juste sur l’allée Petxina, dans le vieil édifice qu’on
aperçoit : « La prison Modelo », ok ? Il y avait aussi des émeutes,
les gens qui s’y intéressaient et l’entendaient accourraient immédiatement.
La tactique la plus utilisée était de grimper sur les toits pour
y déployer une banderole, et foutre le feu à la taule, ce qui était joli à
voir. Ça pour ceux de l’intérieur. Dans les rues autour de la prison, il
y avait de temps en temps des affrontements avec les flics qui à l’époque
chargeaient directement. On élevait des barricades, par exemple
de pneus enflammés. Bon, voilà en quelque sorte l’ébauche des événements dont on est supposé causer. À partir de là, il vaut mieux que
vous posiez des questions.
G. La COPEL dont tu as parlé, en quoi ça consistait ?
E. La COPEL naît à partir des premières remises de peine accordées
par Franco, aux prisonniers politiques ; il y en a eu aussi pour les
droit-commun mais très petites. Alors, au fur et à mesure des grâces
qui oublient les droit-commun, ceux-ci commencent à se coordonner,
surtout à Carabanchel et naît la Coordination des Prisonniers En Lutte, la COPEL. D’après ce que je sais, car je n’étais pas en taule à l’époque, ça débute à Madrid et petit à petit, avec les transferts subis en représailles aux événements de Carabanchel, les gens se dispersent dans toutes les taules d’Espagne et des embryons se créent partout.
C’était le temps des mutineries qui revendiquaient l’amnistie pour
tous, parce qu’on ne la donnait qu’aux politiques – et en effet tous les
prisonniers politiques sont sortis. Ils commencèrent à se mutiner et à
créer l’organisation. Il y avait certes une organisation mais en même
temps, tous les prisonniers qui voulaient lutter ou se battre étaient
des prisonniers en lutte. Je veux dire par là que quand il y avait une
mutinerie et que les gens montaient sur les toits, ils étaient tous de
la COPEL à partir de cet instant, bien qu’à Valence, à l’époque, il n’y
avait que deux ou trois personnes de la COPEL (A. connaît mieux
les détails) mais lorsqu’on montait sur le toit, ceux qui l’occupaient
revendiquaient pour l’ensemble des prisonniers.
A. Une parenthèse : la COPEL n’était pas une organisation proprement dite. Elle surgit à Madrid et c’était une des manières de se faire entendre, une liste de revendications… Les gens s’y identifiaient et des groupes se revendiquaient COPEL. Mais par exemple, ici à Valence,
dans les années où j’y étais… à l’époque qui suivit « Dueso », quand
la COPEL avait émis un communiqué largement diffusé disant qu’il
fallait faire confiance au directeur de l’Administration Pénitentiaire
d’alors. Alors nous n’étions plus dans la mouvance COPEL car ils
avaient opté pour une tactique que nous jugions réformiste. Nous
avons donc foutu le feu à la taule et on emmerde la COPEL ! Ce que
je veux dire c’est que la COPEL n’était pas le mouvement des prisonniers, c’était un de ses aspects particuliers, significatif, qui a eu de l’influence tant positive que négative. C’était bien une minorité de petits
malins, de dirigeants, qui négociaient, qui se nommaient représentants sans autre mandats que leur bon vouloir, sans passer par aucune assemblée.
Ils ont eu un rôle pour le moins ambivalent, au début très positif,
de détonateurs vers une lutte généralisée, puis négatif, de syndicalistes,
c’est-à-dire de démobilisateurs.
G. Si je comprends bien, la COPEL c’était surtout des droit-commun ?
A. Absolument.
G. Et puis, il y avait les politiques ?
E. Non, à ce moment, il n’y en avait pratiquement pas.
G. Ils avaient été amnistiés…
E. Exactement, Ils avaient tous été amnistiés, les seuls politiques étaient ceux qui étaient entrés après l’amnistie, des prisonniers d’ETA et du GRAPO [2], qui fit son apparition à l’époque. Tous ceux qu’il y avait avant, ceux d’ETA, du GRAPO, du FRAP [3], les anarchistes, tous avaient été amnistiés.
G. Y avait-il une nette différence entre politiques et droit-commun ?
E. Oui, en effet. Quand je suis tombé ils faisaient encore la différence. Concrètement, à Carabanchel, il y avait des droit-commun d’un côté et des politiques de l’autre. À mon arrivée, j’étais toujours placé dans une coursive de droit-commun, on me demandait si j’étais un prisonnier politique ou un prisonnier social et moi je répondais que j’étais
un prisonnier normal ; je ne me suis jamais défini comme un prisonnier
politique. Toutefois jusqu’en 1984/1985, ils étaient différenciés
dans les taules, surtout là où il y avait beaucoup de politiques. J’ai été
enfermé longtemps à Valence et j’étais pratiquement seul, au mieux on
était trois ou quatre, là il n’y avait pas de distinctions, on était tous des
prisonniers un point c’est tout. À Barcelone ou à Madrid, à Carabanchel,
il y avait une différence entre les droit-commun et les politiques,
surtout avec l’ETA, le GRAPO, la CNT…
A. Ce n’est pas que les prisonniers politiques aient eu un statut spécial, explicite, reconnu mais ils étaient nombreux. Ils se serraient les coudes en prison comme à l’extérieur et luttaient pour être reconnus en tant que prisonniers politiques. Il y avait bien des présumés politiques qui ne jouaient pas à ça, nous ne jouions pas ce jeu, nous ne faisions pas de distinctions, nous nous opposions aux autres et nous critiquions le fait qu’ils se revendiquent politiques. Nous ne les suivions jamais dans
leurs histoires et c’est justement pour ça qu’on s’affrontait.
E. Non, mais le fait est que les prisonniers politiques à Carabanchel,
lors de mon passage (au début des années 80), avaient des privilèges. Ils les avaient conquis, c’est entendu, mais ils étaient privilégiés.
A. Car ils avaient le pouvoir de se retrouver, par exemple 150, comme les Milis, ou 80 ou 60 comme les Polimilis [4] ou les GRAPO et d’agir
à l’unisson en ayant derrière eux toute une organisation « terroriste » qui pouvait menacer les gardes ou des choses du genre. De plus, ils
défendaient leurs privilèges et leurs intérêts face aux autres prisonniers.
Ça créait donc une situation de toutes pièces. Bien sûr, il y a toujours eu discrètement une politique spéciale pour les prisonniers politiques. Aujourd’hui, il y a les FIES pour les prisonniers accusés de terrorisme, c’est-à-dire un statut spécial pour les politiques. À l’époque ce n’était pas explicite mais ça existait en pratique. Bon, de nos jours, c’est comparable, les FIES ne sont qu’une circulaire qui, en pratique, est devenue loi.
E. Tu n’as pas fait le rapprochement entre les FIES et Herrera. Je
les comparerais ; ce qu’était Herrera à l’époque, ce serait les FIES
d’aujourd’hui.
A. Les FIES de l’époque, c’étaient Ocaña, el Puerto, Burgos et Huesca, les quartiers d’isolement soumis à un régime spécial où on envoyait les gens souffrir ; où il y avait des compagnies d’antiémeutes en permanence.
Tu arrivais et à peine descendu du fourgon, où on t’avait
traîné sans crier gare, dans un bloc, tu devais traverser une haie d’antiémeutes et de matons qui te trimballaient dans tout le centre de
détention à coup de matraques. Normalement, il y avait un couloir
comme ça, puis un autre, etc. On te traînait d’abord dans un coin, on
te déshabillait, on te giflait, on te faisait faire des pompes, tout ça à
coup de matraques, pas vrai ? Après on te conduisait à ta cellule située
à l’autre bout du bâtiment, de la même manière. Ainsi, tu apprenais le
fonctionnement. Le tabassage quotidien n’était jamais oublié dans les
pires moments. C’était ce qui se passait dans les quartiers d’isolement.
Herrera, c’était comme qui dirait une expérience pilote qui commençait
ainsi et qui finissait par faire passer les gens par ce qui, à l’échelle du système pénitentiaire, aurait été les degrés de traitement. C’est de là que sont parties les bases de la réforme pénitentiaire. Tu déboulais en
premier degré, tu recevais plein de coups tous les jours et s’ils venaient
à bout de toi (car les gens pétaient les plombs, là, on le sait par des
copains qui y ont été), tu passais à la deuxième phase, à la troisième, à
la quatrième, et tu finissais en deuxième degré. Y compris, tu pouvais
sortir en régime ouvert mais je suppose que normalement on t’avait
brisé quelque chose à l’intérieur, ainsi qu’à l’extérieur.
G. En parlant d’Herrera, tu te réfères à la taule ?
A. Oui, à celle d’Herrera de la Mancha.
G. C’était un régime spécial ?
E. À Herrera, on mettait les indomptables des taules, c’est-à-dire, les chahuteurs, et puis surtout les bagarreurs et ceux qui avaient participé aux mutineries.
A. Les indomptables des taules allaient à Ocaña, au Puerto ou à Burgos, les fous à Huesca, avant l’ouverture d’Herrera. Lorsque García
Valdés a ouvert Herrera, en 1979, ils ont continué à remplir ces taules.
Seuls quelques cas spéciaux allaient à Herrera. Toujours pour diviser.
Quand il y avait des émeutes, sur dix prisonniers, un allait à Ocaña, un
à Burgos, un au Puerto, et de ceux-là un sur dix allait à Herrera. Par
exemple, ceux qui avaient été témoins de la mort d’Agustin Rueda,
« le Rat » et ces gens là qui, à chaque fois qu’ils étaient transférés à
Herrera, étaient torturés et obligés de revenir sur leurs déclarations.
De retour à Carabanchel, ils portaient plainte et dénonçaient leurs
tortures devant le juge, et « je maintiens ma déclaration initiale », alors
on les re-transférait à Herrera et on s’occupait à nouveau d’eux et ainsi de suite. C’était une prison pilote où ils envoyaient des gens triés
sur le volet qu’ils voulaient briser complètement avec un nouveau
système. Ocaña, el Puerto… c’était à l’ancienne, tandis qu’Herrera,
c’était le paradigme de la réforme, concentrant tous les traitements de
la nouvelle loi pénitentiaire dans l’espace et dans le temps. Bon, c’est
pas vraiment le thème de la discussion d’aujourd’hui, mais on pourrait
en reparler une autre fois…
G. Ce qu’on aurait voulu savoir, c’est comment vous faisiez pour faire parvenir ce que vous faisiez dehors à ceux qui étaient dedans, comment s’organisait la communication.
E. Ici nous n’étions pas nombreux. Nous étions des gens autonomes, indépendants, nous ne militions pas dans un parti communiste ni même à la CNT. On se connaissait du quartier, notre quartier c’était Orriols, on était un groupe de potes. À part ce groupe d’amis qui se connaissant du centre de jeunes, on fréquentait d’autres centres plus ou moins proches de nous, ici, à Benicalap, Benimaclet, Quart ou Mislata.
Au niveau personnel, on pouvait se retrouver à 20 ou 30, sensibilisés
et participants au soutien à la lutte des prisonniers. On organisait des
festivals, de la propagande, on mettait une pancarte sur la Vierge là-bas,
on faisait des débats, des colloques et en même temps des activités
plus combatives comme l’a raconté A., des jets de cocktails Molotov,
un engin explosif aux tribunaux… On soutenait au niveau du fric, de
la propagande et des avocats. On avait une amie avocate qui était très
impliquée et puis quelques autres. Par la suite, on a commencé à se
radicaliser un peu, surtout à partir du moment où des copains avec qui
on faisait des choses sont tombés, pour… bon, avec des armes et tout
ça. Et bien, fallait les sortir de là. C’est alors qu’on a commencé à voir
certaines choses. Le problème c’est qu’on manquait d’expérience, on
n’avait que de la bonne volonté. On a commencé à faire des choses, je
vous les raconterai plus tard.
A. Les contacts avec ceux qui luttaient de l’intérieur et les infos sur
ce qui se passait là-bas, au début ça passait par des avocats, c’est-à-dire, par cette femme assise là, si silencieuse, ce qu’il y a c’est qu’elle ne veut pas parler.
E. Par exemple, à l’intérieur ils ont fait un tunnel pour se barrer. Pour creuser, il leur fallait des outils et à cette époque, on pouvait faire
passer des trucs par les avocats. On leur a passé des pics et même un
talkie-walkie pour être en liaison. Nous on était dehors, en contact
avec eux pour qu’au moment de la sortie on leur file un coup de main.
Tout était très informel, des histoires de connaissances et d’affinités, il
n’y avait aucune organisation ou quoi que ce soit qui y ressemblait.
G. Bien sûr, tout par les avocats… Les familles aussi, non ?
A. À Barona, il y avait ce club, le 14/17… au début, c’était juste un
club paroissial, un truc du temps de Franco. Dans tous les villages et
les quartiers il y avait des clubs qu’on appelait les « clubs-télés ». À
l’époque, personne n’avait la télévision et ils l’ont mise dans des locaux
appartenant à l’Église, ça attirait la jeunesse, pour leur bourrer le crâne
ou quelque chose comme ça. Mais, avec le temps, ils ont perdu complètement le contrôle. Au début les chrétiens de base se réunissaient là, ceux de l’HOAC, de la JOC (des organisations ouvrières catholiques plus ou moins combatives), etc. parce que c’était dans des quartiers prolos, et puis aussi l’extrême gauche, les trotskistes, les maos, la LCR, le FRAP, AC, etc. Dans beaucoup de ces clubs ce sont d’abord les curés puis les bureaucrates qui ont perdu le contrôle et en fin de compte, il n’y restait que ceux qui les faisaient fonctionner, qui formaient une sorte d’assemblée. D’un côté il fallait maintenir le local et tout ça, et de l’autre on s’impliquait dans les luttes du quartier. Dans les quartiers il y avait beaucoup de gens qui étaient des délinquants, qui volaient, par exemple, qui entraient et sortaient de taule ; par leur intermédiaire, on avait pas mal de contacts. Il y avait pas mal d’évadés et là-bas on leur donnait un coup de main. Puis, nous avons commencé à aller nous-mêmes en taule. On avait déjà été dans les groupes de soutien à la COPEL, etc. et on connaissait des gens là-bas qui étaient censés être de la COPEL. En fait, tout ça était très relatif, ce n’était pas une organisation, c’était des groupes de gens à un moment donné. Par
exemple, à Madrid, ils étaient en contact avec un groupe de jeunes
avocats, ils ont réussi à monter une histoire qui a eu de grosses répercussions dans les médias, mais aussi en taule, et ça a servi d’exemple.
Les gens le suivaient et s’identifiaient à la COPEL. Toutefois, ceux
qu’on a rencontrés en prison n’étaient pas vraiment de la COPEL.
Il n’y en avait que quelques-uns qui venaient de Madrid et avaient
participé à sa fondation. Quand nous sommes arrivés, ceux qui étaient
plus ou moins disposés à lutter s’étaient retranchés dans la quatrième
coursive et s’autogéraient. Mais il y avait une certaine ambiguïté entre
ceux qui agissaient et ceux qui ne foutaient rien. Il y avait une menace
permanente de mutinerie. Les matons n’étaient pas rassurés par la
situation, et encore moins par les directives envoyées par Jesús Hadad
(directeur général de l’Administration Pénitentiaire, éliminé peu de
temps après par les GRAPO) qui menait une politique incohérente.
Donc, dans certaines parties de la prison, les prisonniers avaient pris
le pouvoir. Il y avait des assemblées mais surtout, ces espaces étaient
entre les mains des taulards Un certain groupe se revendiquait de la
COPEL mais on ne peut pas dire qu’ils y appartenaient. C’étaient
les meneurs. Par exemple : s’il y avait des abus entre prisonniers, c’est
eux qui allaient demander des comptes aux profiteurs. Quand on est
tombés, ils ne nous ont pas mis dans la quatrième coursive, là où ça
bougeait, mais deux dans la première et deux dans la troisième. On a
donc commencé par une grève de la faim pour être réunis. On a gagné
et on est allé à la quatrième. Et c’est là qu’on a commencé à creuser le
tunnel dont vous a parlé E. Des potes à lui ont obtenu les outils et ont
commencé à creuser dans leur cellule, et les autres s’y sont joints. La
coursive était pleine de terre, toutes les cellules des personnes impliquées, les couchettes étaient bourrées de terre et une mouche n’aurait pas pu voler. On contrôlait la coursive et ceux qui étaient prêts à
chauffer, on les calmait parce qu’on voulait se tailler. Par ailleurs, on
contrôlait le vin et on le répartissait. C’était ambigu, légèrement mafieux
mais ça avait un côté très combatif et courageux, on était prêts à
tout. Il y avait aussi beaucoup de personnalisme, un groupe dominant.
Beaucoup en avaient ras-le-bol qu’on essaye de les contenir. L’accord,
c’était que si le tunnel était découvert, la taule brûlerait. Et c’est ce
qui est arrivé : on a été découvert et on a mis le feu à la prison, on a
fait une mutinerie de tous les diables. C’était ça la COPEL à Valence
à cette époque. En fait, aucun de ceux qui avaient des contacts avec la
COPEL originelle n’ont participé à tout ça. Ils étaient dans d’autres
coursives et suivaient les directives de Madrid ou des diverses prisons
où avaient été transférés les membres de la première COPEL.
Après la COPEL de Carabanchel, un autre groupe du même nom a
surgi à Barcelone et disons que dans tout le pays il y a eu des mouvements revendicatifs qui se sont identifiés à ce sigle. Pendant quelques mois, surtout en 1977, il y avait des mutineries toutes les semaines, tous les jours, et partout ; des émeutes, des automutilations, des grèves de la faim… En réalité, les gens de base rejoignaient le mouvement car ils y voyaient la possibilité de sortir avec la revendication de grâce générale. Par la suite, le phénomène COPEL a été habilement manipulé par García Valdés, le directeur général arrivé après l’exécution
de Jesús Hadad, ainsi que par Tavera. Du temps de Hadad, ils avaient
mis tous les soi-disant meneurs au Centre de Dueso, en passant par
Burgos. Là, ils les tabassaient, ils leur piquaient tout, les foutaient à poil,
leur rasaient la tête, leur collaient une combinaison et les envoyaient
à Dueso. Là-bas, ils étaient enfermés en quartier d’isolement et recevaient des coups. Ce que c’était qu’un quartier d’isolement, c’est une
longue histoire, un peu macabre mais c’était un endroit où quand ton
pied mordait la ligne, on te tapait dessus. Lorsque Valdés est arrivé à la
tête de l’Administration Pénitentiaire, avec sa réputation de juriste démocrate et progressiste, il s’est présenté à Dueso ; auparavant ils avaient sorti tout le monde du quartier d’isolement et proclamé l’autogestion ; ils leur ont même donné l’administration de l’économat. Après est venu le coup de négocier la réforme pénitentiaire. Quelques-uns se sont fait avoir et d’autres, je suppose que ça les arrangeait bien. C’est alors qu’un communiqué est sorti, comme sortaient les communiqués de cette époque : par exemple, quelqu’un recevait par courrier un livre à la couverture cartonnée dont une partie avait été évidée et dans le trou se trouvait un papier, un communiqué authentifié par des signatures. Ce papier disait alors qu’il fallait faire confiance à García Valdés pour la réforme pénitentiaire. Notre réaction ainsi que celle de la majorité de la quatrième coursive a été de dire qu’on ne voulait pas
d’une cage dorée, qu’on voulait la liberté. Qu’ils aillent se faire foutre
avec leur réforme, ce n’est pas réformer les prisons qu’il faut faire, c’est
les détruire. Nous avons donc rompu complètement avec tout ça et
nous avons continué avec nos histoires ; et on a mis le feu à la prison
quand la COPEL avait demandé qu’on ne le fasse plus. À partir de ce
moment s’est produit ce que les criminologues appellent la bifurcation
: les méchants vont au FIES et les gentils en régime ouvert. Que les méchants pourrissent en taule et que les autres pourrissent dehors,
qu’ils s’institutionnalisent et passent par les escroqueries de la réadaptation qui n’est qu’un processus de dégradation et d’humiliation. Ça a commencé avec ceux qui étaient soi-disant de la COPEL, les gens qui bougeaient, les plus intelligents ou impétueux. Ceux qui s’adaptaient, qui négociaient, qui ont marché dans les propositions de « cogestion » menées dans divers centres pénitentiaires, ont été les premiers à sortir ; les autres allaient à Ocaña, à Burgos, à Huesca et finalement à Herrera. Voilà ce qui s’est passé.
G. C’était quoi les comités de soutien à la COPEL ?
E. Nous n’étions pas vraiment un comité de soutien à la COPEL,
nous soutenions la lutte des prisonniers. Ce qu’il y avait alors à l’intérieur, en théorie, c’était la COPEL. Donc, va pour la COPEL. Nous,
on sortait un canard où, plutôt que des articles à nous, on mettait des
textes provenant de prison, des coupures de presse et on appelait ça «
Ceux qui n’ont jamais eu la parole la prennent maintenant ». On l’a
repris d’une revue de Barcelone ou de Madrid. Avec ça on faisait un
peu de fric qu’on faisait parvenir via les avocats à des personnes bien
précises, avec qui on avait des contacts, des gens du quartier. À l’époque des mutineries, à ceux qui étaient au mitard, on leur faisait passer des choses, de la bouffe, des habits… souvent par l’intermédiaire de Presen, une prof ’ qui donnait des cours à la prison pour femmes puis
à celle pour hommes. Elle faisait partie de notre groupe de rue qui se
réunissait toutes les semaines pour faire des choses plus ou moins légales : des autocollants, des brochures, des revues, des festivals, des débats… la prof ’ était avec nous pour tout ça. C’était une nana passablement impliquée qui a donné un coup de main, assez légale et assez bien. C’était une fonctionnaire et tout ce qu’on peut en dire, c’est plutôt bien.
A. Tu peux nous raconter comment ont commencé les jets de cocktails ?
E. C’est parti à l’anniversaire des cinq dernières exécutions sous Franco, celles du 27 septembre 1975.
A. Je croyais que ça avait commencé avec l’exécution de Puig Antich…
E. Ben, nous, on a commencé pour l’anniversaire du 27 septembre,
en 1976. C’est à partir de là qu’ont commencé les histoires de lutte
des droit-commun, jusque là il n’y en avait pas eu. Ensuite ce fut en
soutien aux luttes des prisonniers, comme disaient les communiqués
qu’on ne signait pas : « À bas les murs des prisons ! » Comme disait A.,
en une nuit, il y avait 30 ou 40 personnes qui lançaient des cocks à la
même heure. Par exemple, on disait « à minuit » et à minuit il y avait
10 ou 15 banques qui cramaient, deux ou trois personnes par banque,
pour attirer l’attention et envoyer un communiqué, nous n’avions pas
d’autre intention. Ok, changer un peu le type de lutte, c’est-à-dire la
radicaliser. La lutte des droit-commun était totalement ignorée par les
partis et les syndicats, seuls quelques petits groupes d’extrême gauche
et de CNT y prenaient part et encore, ils se contentaient de passer
les communiqués dans leurs publications. Mais lors des mutineries,
lorsque les gens se manifestaient, etc., personne ne participait. Nous,
on a fait quelques appels pour des manifs et on s’est retrouvés 50 au
maximum. Alors on se donnait rendez-vous entre nous, les gens du
quartier et des environs…
G. Quelle était la relation entre les droit-commun et les politiques ?
A. À l’époque, au début, il n’y avait plus de prisonniers politiques
parce qu’ils étaient sortis à la dernière amnistie. Là, il faut distinguer deux choses : l’amnistie et la grâce. L’amnistie signifie que ce qui
était auparavant considéré comme un délit ne l’est plus, et c’était
alors le cas pour les délits d’opinion, d’association, etc., qui n’existaient
plus quand la dictature devint « démocratie ». La grâce, c’est
quand on supprime la peine à quelqu’un bien que la conduite pour
laquelle il avait été puni continue à être condamnée en général.
L’amnistie touchait exclusivement les prisonniers politiques. Les
droit-commun luttaient pour une grâce générale en considérant
discriminatoire que l’on pardonne aux politiques parce que la situation
politico-sociale avait changé sans leur donner, à eux, une
deuxième chance.
E. À l’époque, dehors, il y avait l’Association des Parents des Prisonniers Politiques, la FAP. Puis, ceux du FRAP avaient la leur,
l’AFAPE, mais rien pour les droit-commun, les parents étaient là
au niveau personnel. Bien sûr, il n’y avait pas de coordination entre
eux.
G. Alors quelle était la relation, à l’intérieur de la prison, entre ceux
qui avaient du soutien extérieur et les autres ?
E. Je ne peux pas parler du temps des mutineries, je n’étais pas enfermé. Je peux causer des années 80, quand j’y étais et en général il
y avait effectivement des différences. Les politiques restaient entre
eux et les sociaux aussi. Il y avait très peu de communication. Sauf
exceptions, ils ne se mélangeaient pas aux droit-commun. Ils se
comportaient comme s’ils étaient d’une autre classe.
A. En général, les politiques, tant « démocrates » que « terroristes
» méprisaient les droit-commun. Et par exemple, les GRAPO en arrivaient à dire : « lorsqu’on sera au pouvoir, on vous enverra construire des autoroutes ». Seuls quelques fêlés, comme nous, s’en foutaient d’être des politiques et passaient plus de temps avec les droitcommun.
E. Il y avait une différence de fond, au niveau social, entre des gens qui ont du temps pour penser, des personnes dont la vie est toute tracée, et puis des gens qui volent pour survivre.
A. Il faut distinguer, par exemple, un prisonnier politique du PC ou
des Commissions Ouvrières ou issu d’un parti ou d’un syndicat « démocratique », qui étaient la majorité à la mort de Franco et qui sont
sortis en 1976, de ceux qui se trouvaient là pour des actions armées,
qui sont sortis un peu plus tard (les derniers fin 1977) et qui n’ont
cessé d’y retourner par la suite. Ce genre de « démocrates » appartient
évidemment à la bourgeoisie, ce sont des gens du Capital, il ne faut
pas s’y tromper. Des gens du Capital pour lesquels à ce moment, malheureusement, les circonstances politiques étaient défavorables à leurs chefs. À l’arrivée de la démocratie, tous les politiques non catalogués « terroristes » sont sortis rapidement car leurs partis avaient besoin d’eux et ils sont allés se partager le gâteau avec les autres. Il restait les membres d’ETA, du GRAPO, du FRAP qui ont une vision autoritaire, étatiste, ils ne sont aucunement ennemis du système carcéral, c’est-à-dire qu’ils sont partisans de l’État et de la répression et ne font preuve d’aucune solidarité avec les droit-commun. Pour eux, les
droit-commun n’ont rien de comparable avec eux. Ils défendent leurs
privilèges un point c’est tout. J’ai vu des Grapos, à Carabanchel, attraper
un jeunot qui leur avait volé un radiocassette et le lyncher ;
ils voulaient le jeter du troisième étage. On disait, à l’époque, que ce
genre de choses se passait dans les commissariats, et bien les Grapos
aussi savaient le faire. Dans la troisième coursive de Carabanchel vivaient au troisième étage les politiques, au deuxième un mélange et au
premier les communs. Quand on a vu la scène, les gens sont montés
furieux et il allait y avoir un affrontement bestial. Résultat : le gamin est
parti au mitard ; c’était le lyncher ou le dénoncer. Cet exemple permet
de se faire une idée. D’autres ont une vision différente, celle-ci c’est
la mienne. J’ai eu des embrouilles et des bagarres avec les membres
de GRAPO ou d’ETA à ce sujet. À Carabanchel, comme les etarras
étaient en majorité, ils négociaient avec la direction ce qui leur passait
par la tête et nous-autres, la macédoine politique, les autonomes ou
ceux de la CNT, ou nous faisions ce qu’ils avaient décidé ou nous faisions
ce qu’ils avaient décidé, voilà l’alternative qui nous restait selon
eux. Et ils poussaient cela à l’extrême, par exemple : ils avaient décidé
de nettoyer par tours successifs, selon les blocs, nous on avait décidé
qu’on ne nettoierait pas en taule, plutôt crever ! Lorsque c’était notre
tour, ces fils de putes venaient nous obliger à nettoyer et il fallait se
battre avec eux pour dire non.
A. Faut voir que tout ça (les tunnels du dehors au dedans), ce fut, disons, une réadaptation de toute ces choses dont on a parlé, du quartier, des clubs, des comités de soutien à la COPEL … à une autre histoire, à une autre sorte de travail, à faire un tunnel.
E. Ça a commencé par votre tunnel qui a plus ou moins foiré en juin
1978. Puis, en été il y a eu ce que tu as raconté sur Gérone. Les gens
de Gérone sont tombés et ils nous ont fait passer le mot que c’était
jouable par les égoûts. On est restés là plusieurs mois pour tenter le
coup mais ça n’a pas été possible. En fait, je me suis trouvé sous la
prison dans un égoût très étroit mais c’était impossible d’y travailler
ou de faire quoique ce soit. On n’avait pas les moyens car on était à Barcelone et un copain et moi, qui étions ceux qui travaillaient le plus
sur cette histoire… eh bien, il fallait qu’on fasse le voyage à Gérone
en train, avec la tenue de plongée. Imaginez… pour aller à Gérone,
ça allait encore mais le retour avec l’odeur d’égoûts et en train… On
ne pouvait pas continuer comme ça. On n’avait pas d’appui sur place.
Nous sommes venus de Valence et c’est alors qu’on a étudié les possibilités d’agir ici. On a parcouru les égoûts proches de la prison, du
côté du fleuve et on a finalement vu la possibilité de creuser quelques
50 mètres de galeries, on s’est mis à bosser, on a travaillé deux ou trois
mois.
A. Vous avez bossé…qui, à combien, comment ?
E. On est partis à quatre ou cinq, mais il y en avait qui abandonnaient. Il manquait donc du monde. On a prévenu des personnes proches. Il n’y avait aucun type d’organisation ni rien de ce genre. On le proposait et la majorité des gens était d’accord pour participer. Certains venaient un jour, d’autres plusieurs jours, et ainsi de suite…
A. Combien de personnes en sont venues à travailler là ?
E. À Valence peu de gens, peut-être une douzaine de personnes.
A. Et combien soutenaient ? Combien de personnes étaient au courant ?
E. Ben, en théorie, les participants. Sauf, s’ils n’ont pas su tenir leur
langue et d’autres le savaient, mais théoriquement, rien que les participants…
G. Et quelqu’un a trop parlé ?
E. Non, la chute, n’est pas venue de là, c’est venu d’ailleurs, en vérité on ne le sait pas encore avec certitude. Ils étaient en contact avec un droit-commun. Le frère de ce dernier travaillait avec nous. En fait, il
a étudié l’affaire depuis le début et y a bossé jusqu’à la fin. S’il n’a pas
été pris, c’est parce que le jour où ils nous ont arrêté, il n’était pas là. Il
semblerait que la mère de ce gars et de son frère prisonnier avait une
relation avec un sergent de la Garde Civile détaché à la prison. Il y en a
pour affirmer que c’est venu de là. En fait, deux ou trois jours avant de
nous arrêter, ils nous attendaient. Non pas là où nous entrions et sortions des égouts normalement mais dans un rayon de deux kilomètres totalement quadrillé par la Garde Civile. Deux ou trois jours avant ils avaient fait une fouille très poussée dans la prison. D’après moi, l’info est sortie de prison, des prisonniers.
A. Mais avant la fouille, nous, on était dans la quatrième coursive, on attendait le jour J. Un jour, des gens de la troisième sont venus me
trouver et m’ont dit : « Dis-donc, qu’est-ce qui se passe ? Il y a une
rumeur sur un tunnel… » J’ai fait un tour dans la troisième pour causer
avec les uns et les autres et il y avait bien une vague rumeur qui
courrait. Ils ne savaient rien mais se doutaient de quelque chose. Avant
les arrestations, il y a eu une fouille générale dans la quatrième, pas
dans la troisième, une fouille vraiment poussée, et bien sûr, ils n’ont
rien trouvé. Ces jours-là X est tombé, il parlait trop : chaque fois qu’il
était arrêté, il y en avait trente-six qui tombaient avec lui. Je ne pense
pas qu’il en ait parlé au commissariat mais à son arrivée à la taule, il l’a
raconté à des gens de la troisième. Parce que tous les durs et les soidisant membres de la COPEL étaient dans la troisième.
E. Deux frères de X travaillaient au tunnel et ce mec s’est refait choper alors qu’il venait à peine de sortir. Ses frangins lui en auront sans doute touché un mot et il en aura parlé en prison, ça pourrait bien être l’explication. Pour notre défense, je veux dire que du côté des participants, y compris avant, à l’époque des jets de cocktails, il n’y a eu aucune fuite, c’était un groupe plutôt sûr.
A. C’était très ouvert comme truc et il n’y a jamais eu aucun problème, car c’étaient basé sur des relations personnelles, avec des gens de confiance, qui s’aimaient.
E. C’étaient des gens qui sortaient de l’époque franquiste, habitués aux règles de la clandestinité, à ne pas se vanter, à se taire. Je crois que ça a bien fonctionné. En fait, les choses qui nous ont fait tomber ne sont
jamais arrivées par mouchardage, ça a été par hasard.
A. Des membres de la CNT disaient que ce n’était pas très sérieux,
que trop de gens étaient au courant.
E. Ben ouais, je l’ai aussi entendu dire et c’est peut-être même vrai en partie. Mais comment pouvait-on faire autrement ?
A. Je crois que ce qu’ils font, c’est juste se justifier a posteriori parce
qu’à l’époque au lieu de prendre des risques, c’était plus facile de dire :
« Bah ! Quelle bande de bordéliques ! »
G. Et où se trouve l’endroit par lequel vous avez essayé de faire le
tunnel ?
E. On a commencé en direction de Mislata, à côté du fleuve, avec la
prison à notre gauche. Dans la rue qui va en droite ligne à Mislata, là
au milieu il y a une bouche d’égoût. De là on rejoint Mislata par les égoûts puis il n’y a plus d’autres égoûts jusqu’à la taule. C’est là qu’on
a commencé le tunnel. Et on avait creusé huit ou dix mètres avant
notre arrestation. On entrait au Campanar, au milieu d’un jardin, par
une trappe et on devait marcher deux kilomètres pour y parvenir. On
entrait très très loin de la taule. La nuit où ils nous ont chopés, la Garde
Civile était là-bas, ils nous attendaient depuis deux ou trois jours. Ils
avaient mobilisé tout le corps pour nous attendre. Ils ne savaient pas
par où on entrait, ils connaissaient l’emplacement du tunnel car ils
l’avaient probablement vu avant de nous arrêter mais ils ne savaient
pas où nous serrer.
G. Qui devait s’évader ?
E. En principe, c’était prévu comme une évasion générale ; essayer
que le maximum de personnes s’arrache. Mais je voulais que mes
potes sortent en premier. Un copain était tombé avec A. et il était à
Ocaña, j’ai dit à A. de lui faire passer le mot. Pour qu’il se débrouille
pour se faire transférer à Valence. Bon, à part ça, l’idée, c’était que
nous étions contre les prisons et pour la liberté des prisonniers, donc
évasion générale.
A. Le tunnel était pour la quatrième coursive. C’est là qu’étaient mis
tous les punis des émeutes précédentes. De la troisième, en principe, personne n’allait sortir mais de la quatrième tout le monde devait sortir.
Et puis, dehors, il y avait des gens comme elle, par exemple, qui nous
aurait passé un tank, si nécessaire. Parce qu’alors, les parloirs avec les
avocats se faisaient à travers des grillages, et elle prenait tous les risques pour passer par là tout ce qu’il fallait. Des infos par-ci, par-là, pour garder le contact, tout quoi !
G. Et vous, vous bossiez avec les droit-commun, non ?
A. Bien sûr ! Nous, on n’était pas des politiques, on était contre ces
divisions.
E. Le tunnel qu’ils ont creusé vers l’extérieur, tout le monde y a
participé.
A. Oui, ce sont Cefe, Crespo, Palomares et Chacon qui l’ont démarré. Nous, on l’a su après.
G. Mais vous, vous étiez des prisonniers politiques ?
A. Pas nous, non. On était comme des droit-commun. Ils savaient
qu’on avait quelque chose de politique mais on n’en voulait pas. Nous,
les quatre qui sont tombés en 78 à Valence, on ne s’est jamais présenté
comme des prisonniers politiques.
G. Ouais, mais, vous êtes tombés pour une histoire politique…
A. On est tombé parce qu’on s’est fait avoir bêtement et qu’ils nous
ont pris avec des armes.
G. Bon, mais ça faisait une différence dans la taule. Même si tu ne te
définissais pas comme un prisonnier politique, en réalité, tu savais que
tu étais là pour une histoire politique, n’est ce pas ?
A. La différence, c’est qu’ils avaient un peu peur de nous parce qu’ils ne savaient pas à quoi s’attendre… Nous étions quatre, alors les deux plus jeune, ils nous ont mis dans la première galerie, réservée aux mineurs, les deux autres dans la troisième. Mais c’était dans la quatrième que ça se passait. Dès le début, on voulait évidemment rester ensemble et puis se faire transférer à la quatrième coursive, parce que c’était là que ça se passait ; ailleurs on jouait aux cartes et nous, on voulait s’évader ou foutre le feu à la prison ou les deux. Nous avons entamé une grève de la faim pour exiger le regroupement, et comme ils ne nous écoutaient pas, quand l’occasion s’est présentée, on s’est échappés et réfugiés dans une cellule de la quatrième où nous nous sommes barricadés.
Ils nous ont fait sortir de force et nous ont tabassés et nous ont
envoyés au mitard où nous sommes restés 23 jours en grève de la faim ;
et puis finalement, ils nous ont mis dans la quatrième. Là, on connaissait
déjà des gens, voyons voir… Ce groupe qui d’une part était plus
ou moins prêt à lutter et d’autre part jouait un rôle de dirigeants, y
compris de manipulateurs dans un certain sens, entre une avant-garde
et une mafia. Ils nous respectaient en tant qu’anarchistes et en tant
que braqueurs, à l’époque il y avait encore très peu de braqueurs. Ce
n’était pas une question d’être politiques ou non, on ne se revendiquait
pas du tout politiques. Ce que nous cherchions, c’était les gens
que nous connaissions du dehors, untel ou untel avec qui on avait déjà
eu des contacts, ce qu’on cherchait, c’était de vivre avec eux, d’aller là
pour continuer la lutte.
G. Avant, il y avait aussi beaucoup de drogue en prison ?
A. Avant et maintenant. Mais dans les années évoquées, il y avait moins de dope, en prison comme dans la rue. Le premier junkie est entré à la taule de Valence précisément en 78. C’était une chose étrange. Et
c’était un pote à nous. On insistait auprès du boiteux (le psychiatre
de la prison) pour qu’il lui donne un traitement ou quelque chose
comme ça. Puis, dedans comme dehors l’héroïne a fait sont entrée à fond. Au début il y avait ceux qui allaient en Thaïlande et qui la ramenaient. C’était un truc d’initiés, d’une petite minorité, qui jouaient
aux hippies qui goûtent à tout, ils se tapaient les voyages, l’aventure,
quoi…le piège. À un moment donné, c’est la Garde Civile qui a commencé
à introduire de grandes quantités d’héroïne au Pays Basque, en Andalousie, partout ; par l’intermédiaire d’indics. Pourquoi ? Eh bien, parce ce que ça a justement commencé par les endroits où les gens luttaient le plus. Parce que, par exemple en Euskadi, il y avait une
situation explosive avec des combats de rue quotidiens et pas précisément pour des raisons nationalistes. Une désobéissance généralisée, des ouvriers qui ne voulaient pas être ouvriers mais qui voulaient donner du fil à retordre et qui cherchaient la bagarre tous les jours. Beaucoup ont fini junkies, beaucoup sont morts, d’autres en taule. Et on en revient à l’histoire des politiques et des droit-commun. En fait, c’est une différence complètement bidon. C’est l’époque où commence
une vague de braquages de banques, en 78, 79, 80… Jusqu’alors, personne n’en faisait à part des professionnels, des gens qui venaient de l’étranger… très peu de gens osaient faire des braquages. Et puis, à
un moment donné, ils se sont rendu compte que c’était facile. Et
c’est parti dans tout le pays, des hold-up, des braquages, comme s’il
en pleuvait. Ça, ce n’est pas de la délinquance commune contrairement
à… c’est un mouvement à mon sens politique, un mouvement
d’expropriation, un mouvement contre la propriété privée, un point
c’est tout ! En plus, ces gens ne le faisaient pas avec une éthique
typique de truands, de « moi, j’ai du pognon et… ». Car en réalité,
ces gens qui avaient plein de fric grâce aux braquages, qui étaient prêts
à tout, à un moment donné, ils faisaient aussi des choses comme celles
qu’on vient de raconter. Ils étaient prêts à aider leurs potes à s’évader,
à les couvrir s’ils y arrivaient par leurs propres moyens, à soutenir
la lutte par tous les moyens. Par exemple, il y a eu un truc appelé la
GAPEL, les Groupes de Soutien aux Prisonniers en Lutte… Tous les
mouvements, y compris celui auquel on avait participé, ont duré très
peu. Ils ont agi comme un détonateur au sein d’un mouvement plus
large, avec d’autres caractéristiques, plus complexe. Ce type de comportements, ces tendances et ces aspirations, qui comprenaient la lutte autonome des prisonniers, n’ont pas perduré. Et pas seulement entre les prisonniers, si en taule, un sur dix allait au mitard, et de ceux-là, un sur dix allait à Herrera ; dans la rue, un sur dix allait en taule, c’était aussi simple que ça. Les prisonniers sont issus d’un groupe social précis, ils sont un échantillon précis. Ce qui se produit dehors n’est pas
séparable de ce qui se passe dans les prisons. Et la composition de la
population pénitentiaire n’est pas séparable des conditions de vie de
la population en général. Par exemple, jusqu’en 1978, la majorité des
prisonniers sont là pour avoir fait ceci : avoir volé une 1430 (modèle
de voiture) l’avoir encastrée contre un magasin d’électroménager et
en avoir sorti des articles pour les revendre (ou une affaire semblable).
Trois ans auparavant, ceux qui faisaient ça appartenaient à des bandes
de quartier qui s’affrontaient entre elles dans les discothèques pour
marquer leurs territoires. Mais quatre ans plus tard, ceux qui n’étaient
pas morts ou en taule, ceux qui ne s’étaient pas mis à travailler dans le
bâtiment ou bien mariés… Eh bien, ceux-là étaient devenus des braqueurs. Et ça, c’est pas de la délinquance, c’est un secteur du prolétariat qui agit d’une manière précise, qui désobéit d’une manière précise.
Et qui n’est pas moins digne qu’une autre forme de désobéissance, y
compris c’est plus radical ou plus fort que d’appartenir, je sais pas moi,
aux Commissions Ouvrières, par exemple.
G. Je pense que quand tu finis par sortir de la prison, que tu bosses, pour en revenir aux gens qui travaillaient dans le bâtiment, s’il y a un braquage… Est-ce qu’ils ne viennent pas te chercher d’abord pour te remettre en taule sans savoir si c’est toi, ou comment ça se passait ?
A. Surtout sous Franco, ça se faisait beaucoup d’attraper un âne, et
lui faire avouer la mort de Manolete [5]. Comme ils n’attrapaient pas le
taureau, ils s’en prenaient à l’âne.
G. Une question que je voulais vous poser à tous les deux. Je ne sais pas si vous connaissez la situation des prisons pour femmes à l’époque. Tout ce que vous avez abordé, je crois que ça faisait référence aux prisons pour hommes.
E. Je peux parler un peu de mon époque ici à Valence. En fait, il y avait très peu de femmes, peut-être entre quatre et dix. À Valence, il n’y a rien eu de comparable avec la COPEL chez les hommes. Il me semble
qu’il y a eu quelque chose à Barcelone, où il y avait plus de prisonnières.
Mais dans les prisons, il y avait vraiment peu de prisonnières
en ce temps-là.
A. Les prisons pour femmes étaient gérées par des religieuses. C’est pas qu’elles étaient meilleures que celles des hommes, mais il y avait un truc très paternaliste, de contrôle, et ça te bouffait le moral. C’était comme un couvent.
G. C’est-à-dire que c’était plus de la répression psychologique que
physique.
A. Ouais, je pense, c’est l’idée que j’en ai. Dans le bouquin de Muturreko, celui des appels de Ségovie, il y a une histoire sur la prison de Trinidad [6].
E. Oui, mais c’est postérieur, c’est des années 80. À la fin des années 70, il y avait vraiment peu de prisonnières, là où il y en avait le plus c’étaient à Yeserias, à Madrid.
A. Aujourd’hui, il y a 60 000 prisonniers et prisonnières, il y en avait
alors douze ou treize mille et le pourcentage de femmes était bien
moindre. Depuis, il n’a fait qu’augmenter, même s’il reste relativement
bas. Mais à l’époque c’était encore moins. Dans les prisons pour femmes,
on ne respectait ni les droits humains ni la dignité, il y avait des
mauvais traitements et tout ce que vous pouvez imaginer, mais le style
était celui-ci : un couvent où les bonnes soeurs étaient des geôlières.
On trouvait ça à la Trinidad de Barcelone et ici aussi, je crois…
E. Imagine qu’à Valence il y avait 800 prisonniers et 8 ou 10 prisonnières.
A. Puis ça a évolué. Mais les prisonnières ont beaucoup de problèmes spécifiques, comme la maternité.
G. Je pense qu’ils faisaient avant tout ressentir aux femmes qu’elles
étaient des femmes scélérates et égarées, catégoriquement mal vues
pour avoir abandonné leurs enfants. Des marginales qui passaient la
nuit à faire la noce et qui avaient oublié leurs devoirs de femmes.
G. Il s’agissait plutôt d’une punition pour le fait d’être femme…
E. De nos jours, dans les prisons pour femmes, on trouve encore ce
genre de schéma.
(Quelqu’un parle du côté positif de certaines expériences menées à Valence, d’alternatives à la prison, d’appartements en milieu ouvert pour que des mères prisonnières puissent vivre avec leurs enfants. On n’entend quasi rien sur la cassette…)
A. Mais c’est impossible. C’est comme des brèches faites pour être
comblées. Le but de ces appartements, c’est de tenir les femmes par
là où ça leur fait le plus mal, c’est-à-dire leur enfant. C’est de la barbarie.
D’autre part, si on prend le cas des hommes, des prisonniers en
général, plus de la moitié sont des prisonniers volontaires, faut bien le
reconnaître. La taule est une chose très large, c’est comme un cercle : la
répression est très concentrée sur le noyau central, puis elle est diffuse.
Plus tu te trouves à la périphérie, plus la prison dépend de la subjectivité
de celui qui la subit, il est son propre geôlier. Ceux qui ne vont pas
en prison c’est pour deux raisons, soit parce qu’ils ne se font pas prendre, et ça c’est la minorité, soit parce qu’ils respectent la loi, et ceux
qui respectent la loi n’ont pas besoin de geôlier puisqu’ils le portent
en eux. Mais bon, allez E. raconte nous l’histoire de Barcelone.
E. Mais avant, je pense que le plus intéressant ce serait de faire le lien avec notre situation présente. Quelqu’un a demandé ce qu’on faisait comme soutien et je pensais à ce qu’on faisait, à part la propagande. Ben, nous étions quelques uns à faire ceci : on montait des braquages pour payer des cautions, pour envoyer de l’argent aux prisonniers et en plus du soutien aux luttes de l’intérieur par des actions symboliques comme les jets de cocktails ou les engins explosifs, on planquait les évadés ou les gens recherchés par la police ; il y avait une infrastructure au niveau personnel, au niveau relationnel, de gens autonomes qui étaient en désaccord avec le genre de lutte politique d’alors, celle menée par les partis. Qu’est ce qu’on pourrait faire maintenant ? Ce qui se faisait à l’époque était-il valide et le serait-il maintenant ? Serait-il possible…
A. Ou adéquat. Tout d’abord, ce n’était pas valide à l’époque. Il ne s’agit donc pas de savoir si ce qui se faisait alors serait valide aujourd’hui. Ce qu’on vous raconte, ce n’est pas une guéguerre, en fait, c’est presque une suite de défaites. Presque rien ne s’est bien terminé, on avait beaucoup de cœur mais en réalité peu de…
E. Mais si, il y a eu des bonnes choses. On a extrait des balles des corps de copains blessés lors d’affrontements avec la police car on avait des potes médecins. Il y avait des potes en tous genres qui ne faisaient peut-être rien d’autre mais que tu pouvais aller voir en disant : « j’ai besoin de planquer quelqu’un » et il n’y avait pas de problème, il y avait des baraques pour cacher n’importe qui. Ou un toubib, même peu expérimenté, qui était prêt à essayer d’extraire une balle pour ne pas devoir amener un blessé à l’hôpital. Et on a fait des hold-up pour avoir du pognon pour ça, pour avoir certaines choses préparées.
A. Il y avait une attitude de résistance très prononcée, une habitude d’aller contre la loi car on avait tous grandi sous le franquisme, et sous Franco tout était interdit. Et si tu voulais vivre, tu devais entrer dans la clandestinité d’une manière ou d’une autre. Il y avait aussi plus d’imagination, car elle n’était pas encore aussi colonisée par le capital, pour le dire d’une certaine manière. Tout ce qui nous passait par la tête… On avait une immense zone d’ombre et une fois passée la ligne, tu te trouvais là, sans limites, pour l’explorer. De nos jours ce n’est plus comme ça. De nos jours la domination agit avec la même brutalité, mais en y ajoutant des moyens plus sophistiqués, sur la subjectivité de chacun depuis l’enfance. Et aujourd’hui, d’une part… le contrôle des corps, des comportements, des mouvements de chacun… avant, le filet du contrôle avait des trous grands comme ça, tandis que maintenant, ils sont si petits qu’on ne les voit plus et les mailles sont si serrées qu’il est difficile de bouger sans être contrôlé. Et puis aussi, il se trouve que lorsque tu veux arriver quelque part, à une position de résistance, à une attitude de désobéissance, à une activité illégale et que tu y parviens, l’ennemi occupe le terrain depuis déjà longtemps. Tu vois ce que je veux dire ? Tu arrives là, et cet espace, ce comportement est déjà contrôlé et ce que tu allais faire est déjà prévu. Et pourquoi donc ? Parce qu’à l’époque… et c’est certainement vrai, même s’il faudra en discuter pour le démontrer. Mais dans les années 60 et 70, il y a eu tout au moins une vague de désobéissance, y compris d’agressivité contre le système, qui toucha toute l’Europe, l’Italie, la France, l’Allemagne, le Portugal, l’Espagne, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, les États-Unis… et qui a vraiment mis en difficulté les maîtres du monde. Il y eu alors des batailles décisives et, malheureusement, ce mouvement de désobéissance fut vaincu. Et il ne fut pas seulement vaincu en tant que sujet qui s’opposait, les conditions matérielles dans lesquelles ce sujet avait eu ses origines et s’était développé furent altérées, ou même supprimées, au point que les manières de se situer dans le monde d’alors, les idéologies, les visions stratégiques d’alors, se convertissent actuellement en pièges car l’espace où elles peuvent être appliquées a énormément changé. D’autre part, une des principales armes utilisée pour vaincre ce mouvement a été la mise en pratique d’un des principes essentiels de la domination qui est que là où se trouve un territoire avec une population dominée, mise en mouvement selon des critères et une idéologie identifiables, il y aura toujours des questions en suspens, des facteurs incontrôlables par nature. Mais, même incontrôlables, ils restent identifiables en tant que facteurs. Le principe consiste donc à ce que lorsqu’on détecte l’émergence d’un mouvement, d’une force pouvant se révéler périlleuse, il vaut mieux la faire avorter, ou plutôt la faire naître prématurément pour garder l’initiative, pour la diriger en sous-main, comme manipulateur, comme policier, comme militaire… Il s’agit de convertir les révolutionnaires en agents et les agents en révolutionnaires. Ce n’est pas de la poésie, c’est une chose très difficile à expliquer car pour ça il faudrait faire un bilan historique détaillé, c’est-à-dire, non seulement avec certaines thèses stratégiques – car pour moi, raconté comme ça, ça n’a aucune utilité – mais en racontant l’histoire comme histoire de la lutte des classes, et en outre, en y apportant des détails ; et chaque détail bien démontré et documenté, d’une manière réaliste. Sans ça, ces affirmations auront du mal à vraiment donner du sens. Mais c’est nécessaire. Si pour moi ça a un certain sens de venir ici raconter des histoires du passé, c’est justement pour ça ; parce que vous et nous, les vieux, nous ne sommes pas si différents, il n’y pas tant de choses qui nous séparent, ni même tant d’années. Et pourtant, vous ne saviez pas grand chose de ce qu’on vous a raconté, hein ? Ça s’est pourtant produit ici il n’y a pas si longtemps. On peut le considérer comme une anecdote, comme une histoire parmi tant d’autres qui n’était pas connue, et si on ne la connaît pas… Qu’est-ce que ça peut faire ? Si on ne sait rien de tout ça, ce ne sera pas bien grave. Mais si tout comme on ne sait rien de tout ça, on en sait encore moins, pour prendre un exemple, sur l’évolution des taules depuis lors. Une évolution qui en a fait une machine (quoique tous ceux qui ont eu affaire à la prison savent que c’est une merde) qui fonctionne très mal, mais qui, pour la finalité qu’elle a réellement en tant qu’appareil, fonctionne à merveille. Et elle s’est énormément sophistiquée, elle a atteint un degré d’efficacité extraordinaire depuis le temps où nous faisions toutes ces choses. En fin de compte, le premier objectif de la prison est de conditionner des êtres humains au point de les convertir en personnes prévisibles à cent pour cent qui ne feront jamais rien contre le système, même si ce sont des désobéissants prêts à enfreindre la loi. Il n’y a rien qui n’ait été prévu, pour lequel le système n’ait une réponse, y compris une réponse sophistiquée, par laquelle il parvient à ce que les actes de cette personne se retournent contre elle-même et lui bénéficient. Je ne sais pas si je me fais comprendre mais le système en arrive ainsi à faire croire qu’il est là depuis toujours et qu’il est éternel. Mais c’est faux, les choses ne sont pas les mêmes qu’il y a vingt ans, elles ont évolué malgré l’opposition de bien des gens qui avaient diverses consciences et plus ou moins de lucidité et qu’on a mentionné au cours de cette discussion. Elles ont évolué malgré leur opposition, en luttant contre eux et en les mettant en déroute lors de ces batailles. Et le monde tel qu’il est, s’est formé sur ces victoires. En connaissant ces histoires, on connaît mieux ce système, ça offre un point de vue sur l’essence de quelque chose : quand, où, à partir de quoi, comment c’est né et ça s’est développé pour en arriver là. Une autre perspective est celle d’explorer le présent. Enfin, le fait d’être contre la prison… Dans cette mouvance, que je ne sais nommer, on parle beaucoup d’être contre la prison, je suppose qu’on sent qu’on est contre les prisons. Mais imaginons que la prison soit un ennemi, un monstre, avec des dents, des griffes, une bouche pour te bouffer, un estomac pour te digérer et un cul pour te chier, quelque chose de menaçant, qu’on puisse maudire, à qui on peut lancer des petits cailloux mais que ça ne dérange pas, contre lequel on ne peut rien. Et pourtant, ce n’est pas la réalité, c’est une vision distordue, un produit de la suggestion. Ce monstre n’a ni dents, ni griffes, rien de rien, ce n’est qu’une machine sociale déterminée, avec des mécanismes et une manière de fonctionner déterminée et avec des failles et des faiblesses, des points vitaux attaquables. Il y a une différence entre l’attaquer symboliquement, verbalement, d’une manière quelque peu désespérée, mais avec un désespoir light. Il y a une différence entre ça et l’attaquer véritablement, même modestement, même si ce n’est pas de manière décisive, même en menant une petite guérilla, en harcelant un ennemi que tu ne peut pas achever, mais en ne lui laissant pas toujours l’initiative, en ne le laissant pas dominer ta vie, mais en la prenant de temps en temps en main et en en expulsant la domination. Bon, on peut combler cette distance, on peut s’attaquer au monstre et de diverses manières, mais il faut se donner la peine de faire des efforts adéquats. Pas l’effort pour l’effort, personnellement je méprise la militance, le sacrifice, l’abnégation, l’héroïsme, je me fous de tout ça. Mais moi, passionnément, pour être heureux, j’ai besoin de croire en la possibilité que ce qui m’emmerde vraiment, ce qui m’empêche de dormir, peut être vaincu. Et ce n’est pas quelque chose qui nait comme par enchantement ou d’un truc idéologique, stéréotypé. Il faut mener un affrontement lucide et concret, ouvert, en face à face avec le monstre pour l’étudier et chercher sincèrement, sans prétextes ou justifications où on peut l’attaquer. Aujourd’hui, c’est plus difficile qu’à l’époque car la situation est plus complexe, la domination plus forte, entre autre parce qu’elle n’a eu personne face à elle pendant quelques années. On assiste au réveil de bien des thèmes qui sont restés enfouis longtemps en conséquence de cette défaite, mais c’est pour l’instant un réveil qui n’a pas encore réveillé grand chose. C’était déjà difficile d’affronter un monstre alors plus faible moins coordonné avec la vie sociale en général. La société était bien moins carcérale qu’aujourd’hui, ils peuvent toujours mettre les prisons hors des villes, les villes ressemblent à des prisons, la prison ainsi que le contrôle sont à domicile bien plus qu’avant… Et c’est le propos de cette rencontre. Il faut bien sûr regarder vers l’avant, mais aussi regarder en arrière pour ces raisons.
E. Et il faut voir qu’actuellement, il y a plus de gens qui bougent et qui luttent de manière autonome qu’à l’époque où nous étions trois pelés. Les gens qui participaient à des choses étaient des militants issus de groupes ou de partis politiques, totalement dirigés ou téléguidés. Aujourd’hui, nous sommes beaucoup plus nombreux. La répression aussi a complètement changé, à l’époque c’était de la force pure, et très forte en plus. Nous par exemple, la police a mis sur pieds, spécialement pour nous, un groupe de mouchards qui lançaient aussi des cocktails Molotov la nuit pour entrer en contact avec nous et nous attraper. De tous les gens qui ont participé à ces choses, nous avons été trois pelés à payer, concrètement huit ou dix détenus contre lesquels ils avaient des preuves et c’est tout. Nous n’avons jamais entraîné une cascade d’arrestations. Ils en sont arrivé à créer une organisation appelée le GAR, Groupe Anarchiste Révolutionnaire, qui lançait des cocktails sur des banques pour entrer en contact avec nous, parce qu’ils savaient qu’il y avait des gens qui lançaient des cocks toutes les semaines et ils n’arrivaient pas à les localiser. Ça les empêchait de dormir.
A. Comme notre forme d’organisation était basée sur des relations personnelles, c’était très difficile de l’infiltrer, parce que, nous, on fonctionnait avec le cœur. Qu’auraient pu faire cette bande de mouchards, de délateurs, de chiens, même pas professionnels…
(Fin de la bande)
* * * * * * * * *
Groupes Autonomes de Valence durant la seconde moitié des années 70
En réalité, dans ces années-là il y eut une grande quantité de groupes
autonomes en tous genres, répartis, sans considérer d’autres
zones (Portugal, Italie, France, Allemagne, etc.), sur tout le territoire
de l’État espagnol. Des groupes de gens unis par des relations d’amitié
ou par des intérêts communs plus ou moins subjectifs : des projets
de vie en commun, d’activisme social et politique, d’une manière de
vivre différente de la dominante… Leur existence fut plus ou moins
éphémère. Par exemple, beaucoup d’entre eux, ou certains individus
qui les formaient, renoncèrent à leur autonomie en participant à la
reconstruction précipitée de la CNT à la mort de Franco, en s’intégrant
dans d’autres syndicats ou dans des groupuscules avant-gardistes
d’extrême gauche ; d’autres devinrent accro à l’héroïne, formèrent des
coopératives ou se firent musulmans ; d’autres encore devinrent de
simples voleurs ou trafiquants, des travailleurs normaux, ou des pères
et mères de famille. Parmi ceux qui continuèrent à résister, beaucoup
se retrouvèrent en taule, et quelques-uns furent tués par la police, les
matons, la drogue, la maladie ou des accidents de voiture ; quelques
autres se suicidèrent… Enfin, certains suivirent, simultanément ou
successivement, une somme plus ou moins grande de ces destins ou
d’autres similaires ; je ne sais pas si ce fut le résultat ou la cause de la défaite du mouvement auquel ils avaient participé, ou les deux à la fois.
Bien que la violence ou la « lutte armée » ne fût pas la seule manière
d’agir ni la plus importante, certains de ces individus et de ces
groupes recouraient occasionnellement, plus ou moins fréquemment,
à des actions plus ou moins violentes, en utilisant parfois des armes.
Des vols, des braquages, des sabotages, des attentats contre des banques, des casernes, des commissariats, des tribunaux, des maisons de redressement, des prisons, des agences pour l’emploi, des grandes surfaces, des infrastructures capitalistes… Mis à part les Commandos Autonomes Anticapitalistes d’Euskadi, qui, bien qu’avec des propositions théoriques et pratiques très ressemblantes, surgirent dans un contexte différent, la majorité de ces groupes, de par leur choix, leur manière de penser et d’agir, leurs relations et certaines des personnes qui les intégraient, étaient dans la lignée, par exemple, des Groupes Autonomes de Combat et du MIL (Mouvement Ibérique de Libération). Ceux-ci furent actifs à Barcelone, de 71 à 73, comme tentative de critique théorique et pratique contre l’avant-gardisme et le réformisme de la « gauche du capital », et d’appui à l’autonomie des luttes ouvrières, dont les partisans – depuis les commissions ouvrières et d’autres tentatives d’auto-organisation surgies à partir de celles-ci – avaient dû livrer un combat inégal contre la manipulation stalinienne et d’autres bureaucraties gauchistes. D’autres groupes encore se plaçaient dans la continuité des GARI (Groupes d’Action Révolutionnaire Internationalistes) qui agirent sur le territoire français et belge, en 74, en réponse à l’assassinat légalisé de Salvador Puig Antich et en défense des autres prisonniers du MIL sur lesquels pesait aussi une menace d’exécution. Ou de la multitude de groupes autonomes sans nom fixe qui surgirent au cours des campagnes contre la répression des précédents.
Groupes Autonomes Libertaires est le nom que la police utilisa, et
dont la presse se fit l’écho, pour étiqueter certaines personnes qui furent arrêtées à Madrid, Barcelone et Valence en 1978, accusées de
braquages, d’attentats et de détention d’armes et d’explosifs. Après,
quelques-unes d’entre elles, plus d’autres qui les rejoignirent à mesure
qu’elles étaient arrêtées, signèrent du nom de Groupes Autonomes
quelques appels écrits lancés depuis la prison. À la fin de 1980, quand
fut publié pour la première fois un recueil de ces communiqués, il y
avait dans les prisons de l’État espagnol quelques trente personnes qui,
regroupées par affinité personnelle, avaient effectivement réalisé, entre
75 et 79, des actions comme des jets de cocktails Molotov contre des
banques, des agences pour l’emploi, des grandes surfaces, des commissariats, des casernes de la Garde Civile et des objectifs similaires,
par exemple, en réponse à l’assassinat de Salvador Puig Antich, ou aux
dates anniversaires de celui-ci et des dernières exécutions du franquisme (en septembre 75), en réponse au massacre de Vitoria en 76, ou pour les assassinats de la police dans les rues d’Euskadi début 77.
En 77, une série d’attentats à la bombe ou avec des cocktails, contre
des entreprises allemandes quand plusieurs prisonniers de la RAF apparurent suicidés, contre des entreprises françaises contre l’extradition de Klaus Croissant – l’avocat de quelques-uns de ces derniers – et durant la grève de la faim d’Apala pour éviter son extradition, furent réalisés parfois simultanément à Madrid et à Barcelone, d’autres fois aussi à Valence, ou encore en coordination avec des groupes français. À la mi-78, à l’occasion de la visite de Giscard d’Estaing en Espagne, il y eux des engins explosifs et des jets de cocktails contre des entreprises françaises en Espagne et contre des entreprises espagnoles en France.
Ces actions se voulaient être une riposte solidaire internationaliste
contre la répression sans frontières du Capital. Le soutien aux luttes
ouvrières autonomes se manifesta par des attentats contre les succursales et les installations des entreprises : à Barcelone en 76, aux grèves de « Roca » et des transports « Mateu Mateu » ; à Madrid, aux grèves de la construction de 76, de « Roca » la même année et celle du Metro en 77 et, début 78, à nouveau contre le Metro et la hausse de ses tarifs. En soutien à la lutte des prisonniers, à Barcelone, à Madrid et à Valence, tout au long de 77 et début 78, de nombreux attentats furent commis contre des banques, des tribunaux, des prisons, des maisons de redressement et des tribunaux pour mineurs. En outre, un grand nombre
d’expropriations devaient servir à acheter des armes et d’autres ustensiles dont ils avaient besoin pour maintenir et étendre leur activité ; à formuler une critique directe de la propriété bourgeoise et à abolir
immédiatement le travail salarié au moins dans leurs propres vies. Il
n’y eut jamais de « dommages collatéraux ».
Dans la pratique, ces groupes étaient effectivement autonomes, y
compris ceux d’une même ville entre eux. Chaque individu et chaque
groupe décidait lui-même de ses actions sans accepter aucune autorité
ni hiérarchie. Ils se mettaient d’accord pour des actions concrètes et
partageaient aussi bien les armes et les autres moyens matériels que les techniques et les informations nécessaires. Entre eux, tout cela était
socialisé, à la disposition de tout groupe proche prêt à « se mettre de
la partie », c’est-à-dire, à agir à ses risques et périls, et à qui on pouvait
faire confiance, ce qui était évalué à partir des relations personnelles
et de la participation commune aux luttes du moment. Mais ils ne
formèrent jamais une organisation fixe et le nom de groupes autonomes
comme le mot autonomie étaient à peine utilisés, même dans la
revendication publique des actions et dans les discussions internes des
groupes. Je crois qu’il était courant de penser que plus quelqu’un parlait
d’autonomie – ou d’anarchie – ou prétendait la représenter, moins
il y avait de chances qu’il l’atteigne réellement et plus il était probable
qu’il devienne son ennemi. L’idée de « propagande par l’action » ne
leur était pas étrangère, mais ils ne faisaient pas les choses en vue de
leur répercussion spectaculaire. En effet, ils n’utilisèrent jamais de sigle
ni de nom fixes et il y avait des actions qu’ils ne revendiquaient même
pas. Ça ne les intéressait pas que le Spectacle les identifie en leur
accordant une importance dans son monde manipulé, comme il put
le faire après les avoir arrêtés. Ce qu’ils recherchaient, c’était à exprimer
leur rejet du système capitaliste à travers des actions significatives,
pour que ceux qui pensaient et sentaient la même chose sachent qu’ils
étaient là, dans l’espoir de les rencontrer dans la lutte. Démontrer,
comme le proposait le MIL, que le niveau de violence par lequel on
pouvait, et par conséquent devait, répondre à la violence capitaliste
était bien plus élevé que ce que l’on croyait communément. Il ne
s’agissait pas d’une option idéologique, mais d’une tendance pratique,
dont l’un des aspects principaux était la critique théorique et pratique
de toute idéologie, la tentative de théoriser leur propre pratique et de
mettre en pratique leurs idées et projets. Telles étaient les caractéristiques concrètes de certaines actions concrètes, dont l’expérience concrète entraîna une manière d’appréhender l’action et de s’organiser, et même de vivre, dans laquelle il n’y avait pas de séparation définitive entre le politique et le personnel. Et, surtout, il s’agissait de défendre cette façon d’agir et de vivre face aux impositions et manipulations en tout genre, c’est-à-dire, d’une attitude plutôt négative : anti-capitaliste, anti-étatique, anti-bureaucratique, anti-autoritaire, anti-hiérarchique, anti-avant-gardiste, anti-dogmatique… La partie affirmative, créative, était plutôt laissée à l’imprévu, à la liberté de chaque groupe et de chaque personne et, surtout, à l’auto-organisation de chaque lutte dans un processus de dialogue direct et de décision permanente entre les intéressés.
Une autre question était celle de l’autonomie des luttes qui déferlèrent
alors sur tout le territoire de l’État espagnol, une autonomie sur laquelle nous misions nos attentes révolutionnaires, que nous voulions soutenir et à laquelle nous désirions nous joindre, pas lui dire comment elle devait être ou ce qu’elle devait faire. En ces années-là, proliféraient les grèves sauvage au cours desquelles les travailleurs s’auto-organisaient en assemblées obligeant les patrons et l’État à négocier directement leurs revendications avec des délégués élus par ces mêmes assemblées et révocables à tout moment, laissant hors jeu les bureaucraties syndicales, franquistes ou démocratiques, et autres intermédiaires professionnels. Souvent, ces grèves s’étendaient spontanément, grâce à la solidarité et en s’organisant en coordinations de délégués, jusqu’à se généraliser et dépasser le cadre revendicatif où elles avaient débuté. Elles en arrivèrent à constituer un problème politique d’une grande magnitude : une conception pratique de la démocratie totalement opposée à celle que prétendait alors imposer la coalition de politiciens franquistes et « démocrates » qui entendaient se partager le gâteau résultant de la tentative de modernisation du régime de domination. Au même moment, les attentats directs à la propriété capitaliste se multipliaient, particulièrement les braquages de banques, des actions tendant à se libérer immédiatement du travail aliéné, à récupérer une partie du pouvoir que le Capital nous prend ; pendant que les prisonniers sociaux, revendiquant une grâce générale, étaient en train de littéralement détruire les prisons, par des incendies, des mutineries et des évasions, et s’auto-organisaient eux aussi en assemblées et au sein d’une Coordination de Prisonniers En Lutte (COPEL).
Beaucoup d’autres mouvements revendicatifs voyaient de la même
manière la pratique de la démocratie, dans les quartiers, dans les asiles
d’aliénés, dans les universités et les lycées, dans la rue… débordant de
toutes parts les prévisions du parti de l’ordre. Tout cela joua un rôle
non négligeable dans la fêlure du contrôle social qui se produisit alors.
La désobéissance se propageait, la gouvernabilité devenait impossible,
politiciens et journalistes se lamentaient tous les jours sur l’instabilité
sociale et politique.
Aux alentours de 1976, il y avait à Valence un certain nombre
de personnes d’origines très diverses : des ouvriers, des étudiants et
des gens qui n’avaient rien du tout, des individus et des groupes unis
par affinité personnelle et par une manière commune d’appréhender
la participation aux agitations sociales et politiques du moment et
l’action en général. Pour la plupart, nous préférions nous libérer dès
maintenant du travail salarié par nos propres moyens plutôt que d’attendre une hypothétique révolution qui, d’ailleurs, ne nous paraissait
pas vraiment imminente à l’échelle de toute la société. En effet, nous
étions quelques-uns à partager l’idée que les opportunités de « frapper
» qu’offrait l’instabilité découlant de la « Transition » n’allaient
durer que quelques années, et nous avions l’intention d’en profiter
tant que nous pouvions et de partir au Mexique, un peu avant que
ce délai n’arrive à son terme, pour échapper, au passage, au service
militaire. Pour nous, la révolution qui comptait, c’était celle que nous
arriverions à faire tous les jours dans nos propres vies et dans nos relations personnelles. Pour la plupart, nous en avions marre du dogmatisme idéologique et des méthodes autoritaires et manipulatrices des groupuscules d’extrême gauche et, bien que la moyenne d’âge fut très basse, beaucoup gardaient en mémoire les échos de la récupération des commissions ouvrières aux mains du PCE, ou celle des commissions et des assemblées de quartier, et les tentatives postérieures d’organisation autonome des luttes ouvrières, comme les plateformes anticapitalistes, récupérées elles-aussi par des groupuscules avant-gardistes, ainsi que des expériences de lutte armée autonome comme celles du MIL et des GARI. Les groupes de quartier foisonnaient, dont certains par exemple, s’étaient développés, à travers la participation à des luttes de quartiers, par le débordement des clubs paroissiaux, locaux où l’Église tentait de faire du prosélytisme juvénile dans les quartiers ouvriers et dont les curés, comme les bureaucrates gauchistes, finirent par perdre complètement le contrôle. Parmi ces gens, certains étaient des travailleurs avec de l’expérience en matière de grèves et de conflits du travail, d’autres étaient déserteurs ou fugitifs, d’autres vivaient au jour le jour en tentant d’échapper au travail, en survivant à base de magouilles, de vols dans des supermarchés, etc., d’autres participaient depuis un certain temps à des actions de solidarité avec les prisonniers autonomes, d’autres aux « comités de soutien à la COPEL » ou à diverses activités solidaires avec la lutte des prisonniers contre la prison, d’autres étaient sortis de taule depuis peu où ils avaient participé aux luttes du moment, d’autres étaient en cavale… On peut dire que nous fuyions tous quelque chose : le service militaire, l’usine, le chantier, les salles de cours, la famille, la religion, l’idéologie, la prison, la société…
Dans les manifs et les mobilisations en tout genre qui abondaient
à l’époque, nous étions toujours les derniers à nous retirer de la rue et
les premiers à affronter la police, les fachos ou les services d’ordre des
bureaucraties politiques et syndicales de la gauche. Au cours de cellesci
et des fêtes qui suivaient presque toujours, nous nous rencontrions
et faisions connaissance. Nous nous reconnaissions surtout par nos
attitudes antibureaucratiques, tendant à déborder les consignes modérées des « forces démocratiques », qui prétendaient à tout moment
canaliser dans les termes de la nouvelle légalité les énergies des conflits
sociaux, personnels, politiques, etc., survenant alors tous les jours et
partout et s’organisant presque toujours en assemblées, pour les amener aux Mairies, aux Parlements, aux tables de négociation, aux pactes de « consensus », et autres institutions « démocratiques ». Nous voulions, au contraire, que ces conflits continuent à se poser dans la rue,
dans les prisons, dans les quartiers, dans les usines et sur les chantiers,
jusqu’à leurs ultimes conséquences, sans que les assemblées et les individus ne perdent leur pouvoir. Pendant qu’eux veillaient au civisme
des masses et applaudissaient la police, nous leurs lancions des pierres
et des cocktails Molotov, ainsi qu’aux banques, aux grandes surfaces et
autres objectifs. Pendant qu’eux se contentaient de l’amnistie partielle
pour les modérés de leur bord, nous, nous exigions une amnistie totale
incluant les condamnés pour des délits violents – parmi lesquels il y
avait encore des gens du MIL et de groupes autonomes postérieurs,
la solidarité avec eux étant aussi un facteur d’unité pour nous. Pendant
qu’eux rejetaient les « prisonniers communs », nous exigions une
grâce générale et nous soutenions la destruction des prisons que les
prisonniers eux-mêmes étaient en train de réaliser. Pendant qu’eux
criaient « à bas la dictature » et « libertés démocratiques », nous criions
« mort au capital » et « pouvoir ouvrier ». En somme, pendant qu’eux
(syndicats, partis d’opposition, groupuscules de gauche, etc.) essayaient
en étroite collaboration avec le reste des forces de l’ordre de rediriger
ou de couper court à toute initiative prétendant aller au-delà du projet
de démocratisation du franquisme pactisé entre le régime et l’opposition,
nous exprimions et affirmions notre rage de liberté et notre désir de destruction de tout ce qui visait à nous exploiter ou à nous manipuler. En même temps, nous cherchions ceux qui pensaient, sentaient et agissaient comme nous pour nous unir à eux.
À partir de là, nous avons commencé à nous coordonner, par exemple, pour des jets de cocktails contre des banques, des agences pour l’emploi et des objectifs similaires : un même jour, à une même heure, à différents points de Valence, parfois pour une raison, d’autres fois pour une autre, aux moins dix ou quinze groupes de deux ou trois personnes lançaient quelques cocks, mettant le feu à leurs objectifs. En plusieurs occasions, nous nous sommes aussi coordonnés avec des gens de Madrid, de Barcelone, de France… tout comme nous l’avons raconté au début. Des actions comme celles-ci, nous ont permis de nouer des relations, de développer des habitudes et des modes de fonctionnement pour nous mettre d’accord sur des initiatives qui voulaient aller plus loin que le débordement impulsif des appels « démocratiques ». Avant, pendant et après, nous avons connu des gens plus expérimentés, qui nous ont appris des techniques comme l’utilisation d’armes et d’explosifs, la falsification de documents, le crochetage et le vol de voitures, etc. Nous avons commencé à faire des braquages, nous avons appris à poser des engins explosifs, notre action s’intensifiait. Mais au même moment, pratiquement sans que nous ne nous en rendions compte, la situation sociale avait commencé à changer et le sol commença à se dérober sous nos pieds. À mesure que nous nous faisions arrêter – ce qui commença à arriver au début de 78, quand, à la suite de l’affaiblissement du mouvement général, nous sommes devenus de plus en plus isolés, tandis que la police et son armée d’indicateurs pouvait nous prêter beaucoup plus d’attention – les compagnons qui restaient en liberté, à Valence et ailleurs, et quelques-uns qui arrivèrent à s’évader, se donnèrent pour objectif prioritaire la libération des prisonniers. Plusieurs tunnels furent creusés, du dehors au dedans et du dedans au dehors, il y eut des tentatives de libération durant les comparutions et les transferts aux procès ou dans les hôpitaux, et d’autres actions dont le pourcentage de succès ne fut pas très élevé, de sorte que des gens tombaient, au cours de ces tentatives ou pendant les expropriations nécessaires à leur financement, plus vite que les prisonniers n’arrivaient à sortir. Au bout du compte presque tout le monde finit entaulé ou grillé, tandis que le mouvement en général se retrouvait définitivement vaincu. C’est ainsi que nous nous plongeâmes dans les noires années 80, des années de désabusement et d’isolement pour nous et de toute-puissance du Capital et de l’État.
Pour nous, outre la destruction de l’État et de tous ses instruments
de violence et d’oppression, la révolution consistait principalement
en l’abolition du travail salarié. Plutôt que de fantasmer sur comment
se produirait un futur processus de libération du travail (ce n’est pas
qu’on ne le fit pas aussi de temps en temps), nous tâchions de nous
libérer tout de suite des rapports d’exploitation en général, en vivant,
par exemple , de vols, petits et grands, dont nous partagions autant
les émotions et les risques que les produits. Quant au futur, la révolution
devait être pour nous le début d’un processus permanent d’auto-transformation de la société par la participation libre et égale de tous les impliqués à toutes les décisions et les activités qui constituent la
vie sociale, de création constante des conditions de la liberté, la libération de la partie pénible du travail et la participation libre à la partie
créative, à la construction du monde humain. Comment cela se ferait,
ceux qui le feraient devraient en décider à partir du moment où ils
décideraient de le faire. C’est ce que nous tentions, à l’échelle de nos
propres vies, en partant de nos petites communautés et en cherchant
à nous coordonner avec d’autres semblables qui surgissaient ici et là
et que nous pouvions rencontrer, comme le mouvement ouvrier assembléaire et les autres mouvements désobéissants dont nous avons
déjà dit qu’ils constituaient pour nous un début de révolution. L’autonomie de fait, c’est-à-dire, les actes, les attitudes, les procédés comme les grèves sauvages, les assemblées de grévistes, les commissions de délégués élus et révocables à tout moment par celles-ci, la solidarité, les piquets, les groupes d’affinité ou les accords spontanés pris dans le feu de l’action, alors qu’on y coïncidait, tout cela était devenu une habitude pour beaucoup de gens, mais leurs ennemis étaient nombreux et bien organisés. Il était difficile que ces « bonnes habitudes » s’imposent contre les procédés des organisations bureaucratiques, dirigistes et manipulatrices, qui à tout moment tentaient de l’emporter
sur elles, puisque les organisations de la gauche, les partis et les syndicats, devaient démontrer leur pouvoir de mobilisation, et surtout, de démobilisation, leur contrôle des masses ouvrières, pour avoir quelque chose à vendre en échange de leur part du gâteau « démocratique », et ils pouvaient compter sur tous les moyens du pouvoir dominant, depuis le monopole et la manipulation de l’information jusqu’à l’intervention de la police.
L’ « autonomie » était alors un ensemble d’habitudes, de méthodes,
de tactiques, adoptées spontanément dans les luttes concrètes qui
se produisaient dans la rue, sur les chantiers, dans les usines, dans les
prisons, dans les quartiers, etc., en appliquant directement, souvent
intuitivement, les leçons du passé immédiat, sans que la majorité de
leurs protagonistes se demandent pourquoi ils faisaient les choses ainsi.
Ça tombait sous le sens, il n’y avait pas d’autre manière de les faire.
Le principal défaut fut peut-être bien ce manque d’une conscience
claire de ce qui se faisait, comment et pourquoi, de quels étaient les
ennemis de cette manière d’agir et des procédés qu’ils utilisaient pour
s’opposer à elle. Spontanéité inconsciente, absence de théorie critique,
d’un mode de penser stratégique suffisamment étendu. D’un autre
coté, les gens disposés à une lutte sans merci étaient une minorité,
le reste appartenait à ce que l’on appelait alors la « majorité silencieuse
», qui s’identifiait passivement avec le projet « démocratique »,
complètement éblouie par l’illusion de l’« État-providence » et de la
« société de l’abondance », sans se rendre compte que la société espagnole parvenait trop tard à tout cela, alors que c’était déjà en pleine décomposition. Il se peut qu’il n’y ait jamais eu un véritable « mouvement », un grand nombre de gens luttant d’un commun accord pour des objectifs communs qui leurs étaient propres. La majorité de ceux qui se mobilisaient, et même beaucoup de ceux qui défendaient les
assemblées, le faisaient pour des améliorations de leurs conditions de
travail et de consommation et autres revendications « particulières »,
parfaitement traduisibles au langage de l’État et du Capital. Peut-être
que la situation n’était pas aussi « révolutionnaire » que nous l’aurions
voulu. Pourtant, on peut dire que la vague assembléaire de 76-78 fut
d’une grande force, en arrivant à conditionner tout le développement
de la « Transition », et créant, tant qu’elle dura, une situation ingouvernable, s’étendant du travail à beaucoup d’autres cadres et mettant en danger à tout moment les bénéfices du Capital. De telle sorte que toute la « Transition » peut se voir comme un affrontement entre ceux qui voulaient canaliser les énergies libérées par l’affaiblissement du régime franquiste dans les cours « démocratiques » et nous qui voulions
les déborder.
Mais ces perspectives rebelles furent battues, ici comme dans le
reste de l’Europe, par l’action combinée de la violence policière, du
leurre politique et syndical et de la séduction spectaculaire. Puisque la
révolution ne gagna pas, la contrerévolution triompha. Comme une
réponse ironique à notre refus du travail, le Capital nous donna la
reconversion industrielle, le chômage, le travail au noir et l’emploi
précaire, la restructuration de la production, un reconditionnement
du territoire social basé surtout sur des critères de contre-révolution
préventive. Le Capital, le « devenir monde de la marchandise », a
aujourd’hui plus de vigueur que jamais. Outre le degré de développement qu’atteint la stupidité consumériste, le travail salarié continue d’être l’esclavage, la servitude de notre temps ; le fait concret, actuel, de l’aliénation ; le mode de relation sociale d’exploitation par lequel nous perdons la liberté en vendant notre énergie pour que le Capital produise et reproduise avec elle, selon ses propres modèles et intérêts, son monde-marché dans lequel nous sommes forcés de vivre sans avoir la moindre chance de l’altérer ou de lui donner forme selon nos propres désirs et besoin. Le développement technologique, diminuant l’importance de la force de travail humain dans le processus productif, a rendu le travail salarié de moins en moins nécessaire. De cette manière, il a pris la forme et le contenu d’une domination qui n’a de sens que pour elle-même, ceux de la toute-puissance, du sadisme des exploiteurs, et de la servitude volontaire quant aux exploités. L’ennui, c’est que nous continuons à être ses prisonniers, comme nos parents et nos grands-parents, mais que nous ne disposons plus de la force qu’avait la classe ouvrière d’antan, qui découlait de sa position dans le mode de production ainsi que de sa conscience de classe. Nous continuons à dépendre du Capital tandis que celui-ci dépend de moins en moins de nous. Il n’y a plus aucun critère humain effectif qui puisse juger et altérer le cours de l’histoire, c’est le courant du Progrès qui juge et décide de tout. La mégamachine exploiteuse, renforcée technologiquement, règne totalitairement comme un pouvoir parasitaire sur la vie, comme la substance absolue constitutive de toute réalité, empêchant d’infiniment de manières la formation de tout sujet individuel ou collectif qui puisse s’y opposer.
Je voudrais qu’il soit clair que ce récit n’a pas pour but de servir
aujourd’hui d’exemple à qui que ce soit. Au contraire, dans la narration
même de ce que nous pensions, ou de ce que je pense maintenant
que nous pensions alors, on peut distinguer certaines bêtises et illusions idéologiques sans autre fondement que l’aliénation – qui consiste au bout du compte en un éloignement de la réalité, même forcé –, et dans notre pratique beaucoup de faiblesses et quelques stupidités. Par exemple un certain fétichisme des pistolets, une espèce d’activisme armé, qui nous menait fréquemment à confondre la violence avec la radicalité, et nous éloignait, de par la spécialisation en actions et dynamiques clandestines, des luttes sociales réelles qui, évidemment, se déroulaient dans un champ beaucoup plus ample. Un contre-culturalisme immédiatiste qui, en mettant trop l’accent sur le quotidien personnel, nous faisait négliger la recherche de perspectives sociales, historiques, stratégiques. Un certain spontanéisme autosuffisant qui nous faisait oublier la nécessité de coordination pratique concrète des différentes luttes et de ceux qui luttaient. En réalité, nous conservions encore une grande partie de la foi déterministe dans le fait que le prolétariat devait fatalement faire sa révolution sociale, de telle sorte que nous pouvions le laisser faire, pendant que nous nous dédiions à notre révolution personnelle. Tout cela jouait en faveur des tendances dominantes sur tous les terrains – politique, travail, quartier, antirépression, etc. – qui, par la suppression de toute méthode ou occasion de dialogue direct, de réflexion, de décision, d’auto-organisation et d’action collectives, à commencer par les assemblées, et leur substitution par les mécanismes de médiation étatiques, marchands et finalement technologiques, et la réclusion de chacun dans sa vie privée, laissaient les individus, à commencer par nous-mêmes, isolés et à la merci de la police et du marché.
Ce qui était alors déjà erroné, parce que délirant et illusoire, le serait bien plus encore maintenant, vingt-cinq ans plus tard, dans une
situation beaucoup plus difficile et complexe et complètement différente
à certains égards essentiels. Il ne faut rien mythifier, ni personne.
Toute cette histoire n’a de sens que si elle sert à ceux qui la liront de
matériel pour comprendre le passé immédiat tel qu’il a contribué à
construire le présent, c’est-à-dire, dans la mesure où vous serez capables de juger de ce qui est dit ici, et de ce qui n’est pas dit, ce qui
suppose que vous disposiez de concepts construits par vous-mêmes à
partir de votre propre expérience pratique qui, s’ils servent à quelque
chose, doivent aussi servir à la juger… Dans un monde où toutes les
« réalités » et surtout la « réalité » en général, se constituent d’après ce
que dicte le fétiche marchandise, précisément ce qui apparaît comme
réel est par définition faux, un élément du mensonge dominant. Postuler
une vérité différente implique de défier celle qui nous est imposée, ce qu’il ne convient pas de faire si l’on ne dispose pas de forces suffisantes. Il faut d’abord construire cette force. Sinon, la défaite est assurée et les « réalités », petites et partielles, qui se déclarent contre le Capital, sont vaincues d’avance, et se convertissent aussi en marchandises, ou en fétiches et en rituels, consécration de l’impuissance, acclimatation, falsification de la révolte. L’ennemi a aussi beaucoup d’avance sur nous sur le plan de la conscience, il connaît beaucoup mieux que nous un territoire qui est le sien, et il nous connaît aussi mieux que nous ne nous connaissons nous-même. Tout cela suite à la défaite et à la consécutive dispersion d’un mouvement révolutionnaire qui fut interrompu durant des années, étant vaincu comme sujet, en même temps qu’étaient supprimées les conditions matérielles, objectives, de son existence. La reprise de ce mouvement n’est pas une simple question de Foi, idéologique, sentimentale ou quelque chose comme-ça. Il ne suffit pas non plus de la désirer, il faut reconstruire une conscience critique collective, reprendre une pratique consciente, entamer un processus de communication basé sur le rejet du mode de vie capitaliste et sur le désir et la lutte pour la liberté, la justice et la dignité, et trouver par cela de nouvelles bases pratiques, des leviers matériels pour faire face au Capital. Il faut aussi bien prendre le temps de réfléchir sur les véritables résultats de la lutte armée comme affrontement direct avec l’État de la part de groupes de plus en plus séparés et militarisés, dans la « contre-révolution » de la fin des années 70 et des années 80, surtout en ce qui concerne les manoeuvres de manipulation et de déformation, et sur les changements stratégiques qui ont eu lieu depuis lors sur le terrain de la guerre sociale. Agir d’une manière ou d’une autre sans avoir fait cela, en imitant de manière acritique et sans aucune préparation des attitudes qui, dans beaucoup de cas, furent déjà erronées en leur temps, c’est rendre la tâche trop facile à l’ennemi.
[1] Fichier Interne de Suivi Spécial. Le FIES est un régime spécial institué en 1991, dont le but était de mettre fin à la constante agitation dans les prisons espagnoles. C’est un régime d’isolement très sévère qui connait plusieurs variantes. Le FIES-1 est appliqué aux prisonniers sociaux considérés comme très dangereux, ils sont enfermés dans une sorte de bunker. (NdT)
[2] GRAPO : Groupes de Résistance Antifascistes Premier Octobre. Groupe armé marxiste-léniniste créé en 1975 et lié au PCE(r).(NdT)
[3] FRAP : Front Révolutionnaire Antifasciste et Patriotique. Groupé armé marxisteléniniste. (NdT)
[4] ETA (Euskadi Ta Askatasuna) se divise en 1973 entre ETA-militaire (les « milis ») et ETA-politico-militaire (les « polimilis »). (NdT)
[5] Manuel Laureano Rodríguez Sánchez dit « Manolete » était un célèbre matador espagnol, il fut grièvement blessé dans l’arène et est mort des suites de ses
blessures les 29 août 1974. (NdT)
[6] Comunicados de la Prisión de Segovia y otros llamamientos a la Guerra Social publié par Muturreko Burutazioak (avril 2000). Le communiqué relatif à la prison de Trinidad ne fut pas repris dans les Appels de la Prison de Ségovie publiés par Champ Libre en 1980.
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (445.5 kio)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (290.5 kio)