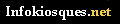U
"Urbaniser" pour dépolitiser
La rhétorique du spatialisme et du localisme
mis en ligne le 12 mai 2005 - Jean-Pierre Garnier
La “politique de la ville” porte bien mal son nom. Du moins si l’on entend par politique un champ et des pratiques qui ont partie liée avec la division et le conflit. Non pas que l’une et l’autre soient absents des préoccupations qui sont à l’origine de la dite politique. Bien au contraire, puisque sa raison d’être majeure, aussi inavouée soit-elle dans sa présentation officielle, est précisément de chercher coûte que coûte à neutraliser le conflit et à nier la division. Pour ce faire, il suffira de qualifier d’“ urbaine ” la question posée. Et de circonscrire à “la ville” les réponses qui lui seront apportées.
Cette question est celle de la (ou des) “violence(s)” et de “l’insécurité” qu’elle(s) engendre(ent). Mais pas n’importe lesquelles. On ne parlera guère, sinon sur le mode allusif, des violences d’ordre économique, institutionnel ou symbolique infligées aux couches populaires dans une société de plus en plus inégalitaire, pas plus que l’insécurité qui en résulte pour elles au plan matériel (professionnel, résidentiel, sanitaire, alimentaire...), mais aussi psychologique et existentiel. Cette violence sociale s’aggrave, pour les générations issues de l’immigration, des vexations racistes en tout genre (discrimination à l’embauche ou dans l’accès au logement, “contrôles d’identité” à répétition, jugements iniques dans les tribunaux, etc.) suscitées par leur “faciès” ou leur nom.
Seules seront retenues par les garants de l’ordre supposé républicain, des violences que l’on aura eu vite fait de dénommer “urbaines”, sous prétexte que les phénomènes désignés sous ce label prennent le plus souvent place en ville - comment en serait-il autrement dans un pays largement urbanisé ? - et, plus spécifiquement, dans les espaces publics urbains.
À défaut de résoudre un problème, on peut toujours “réguler” sa non solution. Tel est précisément le cas face à des actes et des comportements nés, d’une part, de la précarisation, la paupérisation et la marginalisation de masse engendrées par la “libéralisation” du capitalisme, et, d’autre part, de l’absence d’alternative politique - à ne pas confondre avec l’alternance politicienne - susceptible d’enrayer sinon d’inverser ces tendances. Plutôt que d’admettre le caractère social - au sens où un “problème de société” peut renvoyer à un modèle de société on eût pu envisager qu’il fasse lui-même problème - et mondial des déterminants à l’origine des faits classés dans la rubrique “violences urbaines”, et agir en conséquence, on opérera en prenant le “territoire” comme cadre de réflexion et d’action. Pour s’imposer, la “politique de la ville” élaborée dans ce cadre empruntera à deux régistres idéologiques complémentaires : le spatialisme et le localisme.
Le spatialisme postule un rapport causal direct entre formes spatiales et pratiques sociales, ce qui permet de transmuer des problèmes propres à un certain type de société en problèmes dus à un certain type d’espace, comme si le “cadre de vie” produisait et, donc, expliquait en grande partie les manières (bonnes ou mauvaises) de vivre. Ainsi imputera t-on la dégradation de la situation dans les cités de HLM à partir du milieu des années 70 à la configuration du bâti : d’“aliénants” durant les Trente Glorieuses, les grands ensembles vont devenir “criminogènes”, lorsque surviendra la “crise”, suivie des “mutations” provoquées par la “modernisation” et la “globalisalisation” de l’économie, façon de ne pas appeler par son nom un capitalisme en pleine restructuration.
Il en découle que les solutions seront, elles-aussi, spatiales, c’est-à-dire architecturales et urbanistiques : opérations “Habitat et vie sociale” sous Valéry Giscard d’Estaing, “Banlieues 89” sous François Mitterrand, “renouvellement urbain” avec Lionel Jospin et, maintenant, “rénovation du logement social” annoncée par le nouveau ministre de la ville, Jean-Louis Borloo. Mais les “réhabilitations” et autres “requalifications de l’espace habité” ont rapidement montré les limites de leurs efficacité. Les efforts accomplis pour le rendre plus accueillant n’ont pas rendu ses jeunes habitants plus conciliants. Malgré les milliards investis dans la “reconstruction des banlieues”, la “pacification” des quartiers “difficiles” se fait toujours attendre. Et cela d’autant plus que les fauteurs de troubles parqués dans ces zones de relégation multiplient les incursions dans les beaux quartiers.
Aussi l’intervention sur le bâti prend-elle, depuis peu, un tour de plus en plus disciplinaire avec la mise en œuvre d’une architecture dite de “prévention situationnelle”. Elle vise, selon ses promoteurs, à “aménager les lieux pour prévenir le crime”, c’est-à-dire à les “sécuriser” pour que les nouveaux barbares ne s’y sentent plus en terrain conquis. Le spatialisme atteindra son apogée - et le sommet du ridicule - avec la destruction systématique des tours et des barres, “terreau de l’insécurité, de l’incivisme et du repli sur soi”, selon le diagnostic d’une ministre “socialiste” du logement. Autrement dit, les problèmes disparaîtraient avec la disparition des bâtiments.
Face à la violence urbaine, une seule solution : la démolition !
Cette relation postulée de cause à effet entre espace et société évacue les rapports de domination qui, non seulement, structurent l’un comme l’autre, mais pèsent même sur les influences réciproques de l’un - ou l’une - sur l’autre. Le “pouvoir des lieux”, que l’on ne saurait évidemment nier, n’a de sens, en effet, que rapporté au pouvoir que tel ou tel groupe, classe ou catégorie d’agents sociaux exerce sur une autre. En ce sens, le spatialisme évacue la politique, c’est-à-dire les contradictions, les antagonismes et les conflits entre dominants et dominés, pour la rabattre sur le politique, c’est-à-dire l’étatique : en l’occurrence, le contrôle de certains espaces jugés “pathogènes” par les pouvoirs publics.
Complément du spatialisme, le localisme, quant à lui, consiste à formuler, étudier et traiter les problèmes là où ils se manifestent, ce qui revient à confondre problèmes dans la ville et problèmes de la ville. Sous cet angle, la “politique de la ville” peut se définir comme une entreprise de maintenance locale des conflits, une tentative toujours recommencée pour gérer sur place les turbulences sociales, alors que la situation “sur le terrain” trouve son principe tout à fait “ailleurs”.
Placé sous le signe de la “proximité”, ce traitement in situ “au plus près de la population”, selon la formule consacrée, ne s’en tient qu’aux facteurs et aux solutions qui sont “à portée de la main”. Or, ce primat accordé aux causes “locales” permet de maintenir le black out sur les causes délocalisées : structures, logiques, mécanismes, processus qui opérent à l’échelle nationale et, de plus en plus, planétaire. Le “nouvel ordre mondial” du capital a, en effet, un corrollaire : la nécessité pour les autorités d’instaurer un nouvel ordre local pour juguler “sur le terrain” les désordres sociaux engendrés par cet ordre lointain.
Outre la mise entre parenthèses de la dynamique globale et maintenant “globalisée” du mode de production capitaliste, le localisme conforte la vision concordataire, déjà véhiculée par le spatialisme, d’une “Cité” réconciliée sous le signe de l’“urbanité”. Les causes locales, en effet, sont aussi, si l’on prend ce terme dans sa seconde acception, des causes à défendre. Or, elles auraient pour vertu de rassembler - refrain : “la lutte contre l’insécurité urbaine est l’affaire de tous les citadins” - au lieu de diviser. Bref, des causes “citoyennes”, c’est-à-dire “apolitiques”. D’où le consensus dont bénéficie la “politique de la ville”. Si ses modalités fournissent encore matière à débats, le plus souvent “techniques”, sa finalité fait l’unanimité : la police de la ville.
Sous prétexte de faire face à la “violence urbaine”, ce que l’on s’échine à mettre en place, sous couvert de “politique de la ville”, est un ensemble de dispositifs destinés à éliminer toute figure de la dissidence. Par le biais de la lutte menée contre l’insécurité urbaine, et, en particulier contre les “conduites à risques” des jeunes habitants des quartiers populaires, on cherche à imposer l’image d’un monde où tout antagonisme serait susceptible d’être désamorcé pour peu qu’il fasse l’objet d’un “traitement” approprié.
Face à des jeunes gens qui rechignent à intégrer la salariat précaire auquel la plupart d’entre eux sont voués, c’est-à-dire à subir à leur tour l’insécurité économique et sociale où se débattent déjà leurs parents, les élites de gauche essaient maintenenant de dresser les seconds contre les premiers en érigeant la “sécurité”, dans sa version policière, en “deuxième priorité” de l’action gouvernementale. Si ce n’est en première, “péril terroriste” aidant. Ainsi le “ droit à la sécurité ” sera t-il mis en avant pour faire oublier le démantèlement continu des droits sociaux et, bientôt, de droits civils fondamentaux, si l’on en juge par le contenu liberticide de l’effarante loi sur la “sécurité quotidienne”. Il est vrai qu’il est plus facile de “lutter contre la violence urbaine” que de poursuivre le combat qui avait longtemps fondé l’identité de la gauche, en France et ailleurs : celui contre les inégalités.
“La ville” va se trouver ainsi instituée comme laboratoire d’une pratique du déni de la mésentente et du différend, dont le propre est d’activer un modèle général liquidateur de toute dimension politique des révoltes sociales. Et cela d’autant plus aisément, que faute de perspectives, c’est-à-dire d’espace politique où se déployer et de voie politique où s’engager, ces révoltes sont le plus souvent amenées à emprunter le chemin de la délinquance. Une criminalisation de fait qui ne peut que légitimer la criminalisation idéologique dont la rébellion et la résistance font a priori l’objet.
Cette “écologie de la peur” sert aussi à légitimer une conception pan-policière de la “gouvernance urbaine” où la “démocratie locale”, invoquée pour obtenir la “participation” ou l’“implication citoyenne” des habitants, c’est-à-dire leur collaboration avec les forces de l’ordre fonctionnera comme alibi. Sans doute la politique dite “de la ville” n’a t-elle jamais eu qu’une cible : certains habitants de certaines parties de la ville. Mais les médecines douces (caritativo-assistentielles, urbanistico-architecturales, ludico-culturelles...) utilisées pour guérir “le malaise des cités” ont été jusqu’ici inopérantes. Autant dire que le mot “cible” est désormais à prendre au pied de la lettre. Place, donc, à la thérapie de choc judiciaire et policière. Et, peut-être militaire, demain, comme le laissent prévoir les vigipirateries d’aujourd’hui.
Émergeant du brouillard conceptuel diffusé à satiété par une cohorte de penseurs à gages parés des plumes de la scientificité, l’enjeu réel de la focalisation de l’attention sur les “violences urbaines” et de leur dramatisation médiatique commence à se dessiner. Aux prises avec une forme nouvelle de conflictualité sociale, les Princes qui nous gouvernent, toutes obédiences politiciennes confondues, s’évertuent, avec l’aide de leurs conseillers-experts, à en empêcher toute saisie politique au profit d’une approche sécuritaire où la victime et le coupable (d’une agression, d’une déprédation, d’une incivilité, de l’insécurité en général) vont se susbtituer au sujet politique. À moins d’appeler “citoyen”, ce citadin apeuré et délateur enrôlé par des élus locaux bien intentionnés dans la “coproduction de sécurité”, en partenariat avec le juge et le policier. Grâce à cet agent bénévole et zélé des finalités de l’État, la société civile pourra se convertir - terme à prendre également avec sa connotation religieuse - en une société véritablement civique où le pouvoir exécutif aura fait, en quelque sorte, le plein de ses exécutants pour traiter ce qui “déborde”...
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (2.7 Mio)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (2.7 Mio)