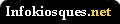I
Idée de Nature, humanisme et négation de la pensée animale
mis en ligne le 2 février 2014 - Yves Bonnardel
Nous avons vu que les sens et les intuitions, les différentes émotions et facultés,
comme l’amour, la mémoire, l’attention et la curiosité, l’imitation, la raison, etc., dont l’homme se vante,
peuvent être trouvés à l’état naissant, ou même pleinement développés, chez les animaux inférieurs.
Les animaux dont nous avons fait des esclaves, que nous ne voulons pas considérer comme nos égaux.
Charles Darwin, Carnet B (1837-1838) [1]
Lorsque nous parlons de prendre en compte les intérêts fondamentaux des autres êtres sensibles, sentients [2], nous nous heurtons systématiquement à l’idée de Nature. Celle-ci est invoquée pour nier que les animaux sont des individus conscients, voire qu’ils éprouvent des sensations et des sentiments/émotions. Ils seraient de simples spécimens interchangeables de leur espèce, les rouages d’un ordre naturel, programmés, soumis à des instincts, ne réagissant qu’automatiquement à des stimuli. Simples organismes « animés », on leur dénie ainsi toute subjectivité, toute intériorité, tous désirs propres (Olivier & Reus, 2005). Ils n’existent pas pour eux-mêmes, à la recherche de leurs propres satisfactions, mais sont des instruments d’une fin qui les dépasse, qu’il s’agisse de la bonne marche des écosystèmes ou de la survie de leur espèce. En fin de compte, ils sont au service du Tout, de la Nature, à laquelle ils sont censés appartenir. Ils en sont des parties et on ne leur reconnaît de valeur que relative, en fonction du rôle qu’ils sont censés y jouer.
Qu’est-ce que l’idéologie de la Nature ?
Qu’est-ce donc que la Nature ? Une notion qui désigne le monde comme totalité ordonnée, ou du moins équilibrée, où tous les éléments « naturels » auraient une place « naturelle », et contribueraient ainsi, en tenant leur rôle, à l’harmonie du Tout. Elle sert toujours plus ou moins de modèle, de norme. Il faut agir de telle ou telle manière pour que tout reste dans l’ordre ; sinon surgit le reproche d’être « contre-nature ». Les objets naturels doivent rester tels qu’ils sont, sous peine d’être dénaturés, dégénérés, et d’amener le chaos ou en tout cas une déperdition d’harmonie, de pureté, etc. Toute chose censée faire partie de la Nature (avec un grand « N » : il s’agit de la totalité) se voit attribuer dès lors une nature (avec un petit « n »), qui définit ce qui est essentiel en elle, ce qu’il faut respecter en elle. C’est sa nature qui la fait être ce qu’elle est, qui lui dicte son rôle, sa place, qui est programme ou code [3].
L’idée de Nature est tout autre que celle de réalité. La notion de réalité désigne ce qui est ; c’est une description de ce qui existe. La notion de Nature se donne comme une description, mais représente en fait ce qui doit être : c’est une prescription plus ou moins voilée, qui vise à faire l’économie d’une réflexion éthique sur le monde en lui substituant un rapport de type religieux. On quitte alors toute rationalité pour entrer dans le domaine de la mystique la plus commune, omniprésente de la Modernité (Rosset, 1973).
Le naturalisme est la croyance en l’existence de la Nature, en l’existence d’un ordre naturel. La Nature est censée être l’ensemble de ce qui existe – hormis les humains censés dénoter. Elle est la totalité, perçue comme une puissance, une sorte de vaste organisme, un ordre ou un équilibre fonctionnant harmonieusement. En tant que totalité, l’« ordre » se voit investi d’une valeur infiniment supérieure à celle accordée à chacun des « éléments » qui le composent. Toute chose prétendue faire partie de cet « ordre naturel » n’est plus considérée que par rapport à la totalité. Du coup, ces « choses naturelles », quelles qu’elles soient, toutes choses inégales par ailleurs, sont mises sur un plan d’équivalence : les individus animaux, les végétaux, l’humus, le relief ou le cycle de l’eau, tous concourent à leur manière (qui correspond à leur place naturelle dans cet ordre) au fonctionnement harmonieux de l’ensemble, et ne sont plus perçus que dans ce cadre. Ainsi, ils n’ont d’autre valeur à nos yeux que relative à la fonction qu’ils remplissent.
En voici une illustration (Hamburger, 1976) :
« … tout ce que la morale humaine réprouve avec force, l’injustice, l’inégalité, la cruauté, n’a, chez l’animal, aucun sens. Pour l’animal, la finalité semble bien différente : c’est avant tout la survie, survie individuelle et plus encore survie de l’espèce. Peut-être même l’animal est-il programmé en fonction d’un plus vaste dessein, à savoir un équilibre sur la Terre entre toutes les espèces vivantes. » [4] (p. 105)
Ou bien encore :
« Les zones humides forment donc un milieu bien équilibré, où chaque espèce tient son rôle. Si certains foisonnent, ce n’est, en fin de compte, que pour en alimenter d’autres, prédatrices. Ce cycle si bien ordonné de la Nature… » [5]
On voit à travers ces exemples combien les individus animaux sont réduits à n’être que de simples rouages de l’Ordre. Il sont au service du Tout, ils n’existent que par et pour le Tout. Ainsi on ne considère pas que leur propre vie leur importe et que cela est important, comme on le fait pour les humains. On ne considère pas leurs actions comme résultant de leurs propres désirs et aversions, comme on le fait pour les humains. Leur vie et leurs actes sont perçus uniquement dans leur rapport à la supposée totalité, comme ayant pour cause et pour but une participation à la totalité, à l’ordre.
Une telle vision du monde, lorsqu’elle est transférée dans l’ordre social, porte un nom : totalitarisme. Lorsque seule la Totalité (l’ordre social) est envisagée, lorsqu’elle seule se voit attribuer une valeur, lorsque les individus ne sont plus appréhendés qu’en tant qu’utiles à la communauté (Arendt, 1972)… On voit ici que cette idéologie sociale totalitaire trouve son exact parallèle dans l’idée de Nature moderne.
Toute vie subjective et personnelle évacuée
Depuis quelques années seulement, on n’ose plus guère invoquer la notion d’instinct : les animaux jusqu’à récemment agissaient par instinct, n’agissaient que par instinct [6]. La notion servait à nier qu’ils puissent éprouver quoi que ce soit : leurs réactions étaient proprement machinales et n’étaient pas du même ordre que les réactions humaines. Leurs désirs n’étaient pas de vrais désirs, individuels comme les nôtres, mais servaient un but étranger à l’individu lui-même. L’instinct était le relais de l’espèce en l’individu, la courroie de transmission de la Nature en l’individu, ce qui lui permet de bien remplir sa fonction au sein du Tout, de tenir son rôle naturel.
Depuis que les progrès de l’éthologie cognitive nous ont forcé de reconnaître tout de même l’existence de sensations animales et de désirs, on insiste volontiers sur l’adéquation des comportements des non-humains et de ce qu’ils ressentent au rôle qu’ils sont censés jouer dans la Nature. Si l’on veut bien parfois leur concéder quelques sensations, celles-ci ne leur donnent ainsi pas pour autant une importance en propre, une vie individuelle qui serait à elle-même sa propre fin : ces sensations sont elles aussi tout au plus l’instrument du destin naturel qui leur est assigné dans l’ordre du monde.
Les documentaires animaliers insistent beaucoup sur la prédation et la fornication animales, « fonctions vitales » par excellence, aisément reliées à la nécessité, à la survie de l’individu ou de l’espèce. S’ils peuvent difficilement faire l’impasse sur le fait que les tout jeunes mammifères sont extrêmement joueurs, le discours affirme de façon insistante que cette propension à s’amuser leur permet d’apprivoiser le monde et de se former à la dure lutte pour la vie. Que jouer soit aussi utile aux animaux est utilisé comme une sorte de négation de leur plaisir propre, personnel : leur comportement devient « instrumental », « programmé », « requis par la survie », « nécessaire »… et la motivation personnelle « jouissance » en est comme annulée. De même par exemple des comportements sexuels des bonobos : on insiste lourdement sur leur « fonction sociale d’apaisement des tensions », qui met l’accent finalement non plus sur les intérêts concrets et immédiats des individus sentients, mais sur une supposée fonction au sein d’entités plus abstraites comme le groupe social ou l’espèce.
Ce ne sont ainsi plus vraiment des arguments qui sont mobilisés contre la reconnaissance d’une subjectivité des animaux, mais plutôt des contournements : si l’on admet finalement du bout des lèvres qu’ils puissent ressentir sensations, sentiments et émotions, éprouver aversions et désirs, manifester une volonté, on met l’accent sur le fait que, au-delà des simples intérêts personnels de l’individu, ses comportements sont « utiles », « nécessaires », « instrumentaux », « fonctionnels » vis-à-vis d’exigences supérieures. Bref, toujours, l’individu animal reste un simple organisme naturel et n’existe fondamentalement pas « pour lui-même », mais pour « autre chose » qui le dépasse.
Comme le disait le philosophe Alain (1934) :
« Il n’est point permis de supposer l’esprit dans les bêtes, car cette pensée n’a point d’issue. Tout l’ordre serait aussitôt menacé si l’on laissait croire que le petit veau aime sa mère, ou qu’il craint la mort, ou seulement qu’il voit l’homme. L’œil animal n’est pas un œil. L’œil esclave non plus n’est pas un œil, et le tyran n’aime pas le voir. »
La nature des animaux : prédateurs et proies
Dans le cadre de cette vision du monde en terme de Nature, les choses ont une essence qui fait qu’elles sont ce qu’elles sont et pas autre chose, qu’elles ont telle ou telle propriété et pas d’autres. Cette « nature » qui leur est propre organise leurs caractéristiques, leur croissance, leur devenir et garantit qu’elles resteront à la place qui leur est assignée dans « l’ordre du monde », qu’elles y assureront leur rôle. « Mère Nature » est ainsi censée donner à chaque élément dit naturel, sa nature. On associe une finalité à cette supposée « nature » des choses, les êtres composant une catégorie « de même nature » sont faits pour quelque chose ou destinés à se comporter d’une certaine manière. Ce n’est qu’en accomplissant ce pour quoi ils sont faits qu’ils réalisent leur vraie nature. Un chat est ainsi censé réaliser sa nature de félin, ou de carnivore. S’il n’agit pas conformément à cette nature, il sera perçu comme « dégénéré » ou, si c’est en conséquence d’une action humaine, « dénaturé » [7]…
La croyance est ainsi omniprésente en des « natures » des êtres. Or, toutes les catégories d’êtres dominés ou stigmatisés, à un moment ou un autre de notre histoire occidentale, se sont vues rangées dans la case « Nature ». Cela ne concerne pas uniquement les animaux. Les discours sont légion qui affirment comme une évidence la « naturalité » des esclaves, des Noirs et des autres peuples colonisés, des femmes, des enfants, des animaux [8], mais aussi du peuple, des fous, des marginaux, des homosexuels… Leur caractère « naturel » signifie qu’ils ont à tenir une place naturelle dans l’ordre naturel, dans l’ordre des choses, qui est leur place adéquate. C’est en restant à leur place qu’ils sont parfaits, qu’ils jouent pleinement leur rôle, qu’ils réalisent leur essence, leur nature profonde. Cette place, ce rôle correspond toujours en fait à la fonction qui leur est imposée socialement par le système de domination ou de stigmatisation qu’ils subissent. Ainsi, les êtres naturels (c’est-à-dire, ici, les êtres vivants dominés) sont programmés par la « Nature » en général et par leur propre « nature » en particulier, à remplir leur rôle pour la plus grande gloire de l’harmonie du monde (Lindberg, 1976) [9] :
« Jamais je n’ai empêché un animal prédateur d’attraper un moineau, un rat ou un lapin, jamais je ne me suis indignée de voir un serpent manger un petit mammifère : la nature les a fait prédateurs, il faut qu’ils lui obéissent. » (p. 192)
Ou bien encore :
« Mais pourquoi en vouloir à Goupil de croquer un volatile, alors que nous ne nous choquons pas de voir une hirondelle gober une mouche ? Nous blâmons le premier et louons l’autre, pourtant tous deux ne font qu’exercer naturellement leur fonction de prédateur. » [10]
On voit bien comment la Nature, la fonction et l’utilité pour l’Ordre prétendent légitimer toute chose. Il semble bien aussi que la principale « fonction » des animaux, par nature, soit d’être des proies ou des prédateurs.
L’idéologie naturaliste est dangereuse. Pas seulement pour les non-humains. Pratiquement tous les mouvements réactionnaires font appel à l’idée de Nature, pour légitimer le patriarcat ou pour justifier le racisme, la monarchie ou le rétablissement des « hiérarchies naturelles », pour combattre la licence des mœurs, l’homosexualité, la perte du masculin et du féminin ou celle des valeurs éternelles… La référence à la prédation est centrale pour justifier nombre de dominations intra-humaines (Bonnardel, 1996 et 1998), comme l’illustre Lindberg (1976) :
« S’il en est ainsi forcément dans des civilisations comme les nôtres où aucune sélection naturelle n’élimine les faibles, les débiles mentaux, les contrefaits, qu’on garde jalousement en vie, il existe dans la nature une « injustice », une inégalité entre les êtres sans laquelle la vie serait impossible. » (p. 107)
et :
« Je suis un partisan inconditionnel de la sélection naturelle, car la Nature ne peut pas se tromper. » (p.167)
Le « chacun sa place » trouve tout naturellement sa solution chez les animaux puisque Nature agit directement en eux. La sélection naturelle fait le reste. Du fait de leur liberté, le « problème » ne peut se résoudre chez les humains que s’ils deviennent « sages », en apprenant à rester à leur « juste » place dans la hiérarchie sociale, désormais perçue aussi comme naturelle (Lindberg, 1976) :
« … il était un bon chef, un vrai chef, comme un roi devrait toujours être, comme ils le furent aux âges où la nature nous dictait encore ses lois et où tout n’était qu’« ordre et beauté », même tuer pour vivre, même être malade, même mourir. » (p. 152)
Ou bien :
« La répartition de la population d’un pays en différentes classes, n’est pas un effet du hasard, ni de conventions sociales, elle a une base biologique profonde… Il faut que chacun occupe sa place naturelle… La présence de groupes étrangers indésirables du point de vue biologique est un danger certain pour la population française. » [11]
Ou encore :
« Il n’y a pas de survie possible si l’Occident ne retrouve pas les sources de l’ordre naturel… » [12]
L’invocation de la Nature apparaît aussi de façon très systématique dans les discours contre le végétarisme, ainsi encore Lindberg (1976) :
« Si rien ne nous autorise à torturer, il ne faut pas tomber non plus dans les excès de certains doux rêveurs. L’homme est un prédateur. Nier cette vérité élémentaire relève d’une philosophie hors de la vie ou de la sensiblerie des mémères à chien-chien, qui ont fait tant de mal à la cause des animaux, car il n’est pas difficile de réfuter les théories des végétariens, des bouddhistes indiens, des vieilles folles frustrées, etc. » (p. 191)
Et Elsen (1970) :
« Que l’homme tue des animaux pour s’en nourrir, c’est une des lois de la nature qui l’a fait carnivore. » (p. 62)
Enfin :
« L’animal est nécessaire à la recherche, au même titre que le lapin est nécessaire à la survie du renard. L’espèce humaine lutte en utilisant d’autres espèces. » [13]
Je cite ci-dessus volontairement trois personnes qui affirmaient embrasser la cause des animaux. Ces personnes luttaient pour une amélioration des conditions d’exploitation des animaux, mais finalement contre la suppression de cette exploitation et du statut inférieur qui lui est lié. Il est très difficile de savoir si elles utilisaient la notion de Nature et la référence à l’existence de la prédation pour justifier leur point de vue spéciste, ou si au contraire elles étaient incapables de se départir de leur spécisme parce qu’elles restaient engluées dans leur divinisation de la Nature, paralysées par l’idée que les animaux font partie de la Nature et relèvent donc de ses « lois » (dont la prédation est l’emblème).
De façon plus générale, considérant que les animaux appartiennent à la Nature, les humains ont l’impression que ce sont des êtres qui n’interviennent pas dans (ou contre) le cours des choses comme le fait l’humanité, mais qu’ils sont et restent immergés en son sein ; qu’ils en sont prisonniers de fait, le subissant totalement mais sans le subir vraiment, puisqu’ils sont censés y être par nature adaptés.
L’animal et ses malheurs, l’animal et ses tribulations sont perçus d’un même monde, la Nature, un ordre de la fatalité et du destin, et en même temps de l’harmonie, qu’il serait dangereux de subvertir en s’en mêlant. Intervenir serait en outre s’immiscer dans cet autre ordre, qui n’est pas le nôtre, qui nous est étranger, et serait aussi illégitime que s’immiscer dans les affaires intérieures d’une autre Nation. Une telle conception du monde, lorsqu’elle n’est pas critiquée, fonde le réflexe de séparation qu’on retrouve volontiers chez des militants animalistes : le mieux à faire pour les animaux, de la part des humains, serait de ne plus entretenir aucun commerce avec eux, d’instaurer en quelque sorte un apartheid des espèces.
Les dominants, la liberté et la propriété
La sociologue féministe Colette Guillaumin a montré, dans une analyse magistrale de l’idée de Nature qui portait essentiellement sur le racisme et sur le sexisme, que dans nos sociétés, les rapports sociaux d’appropriation d’une classe d’êtres par une autre, tels que l’esclavage, produisent normalement une idéologie de la Nature [14].
Selon elle, certains rapports d’exploitation et de domination sont spécifiques tout en étant comparables : ce sont les rapports par lesquels toute une catégorie (classe) d’êtres se trouve appropriée par une autre. Les exemples qu’elle cite sont les rapports d’esclavage, ceux de servage et, c’est moins commun, ceux qu’elle appelle de sexage. Ce sont des rapports par lesquels des individus (de la catégorie dominée) sont propriété d’autres individus : ils leur appartiennent corps et âmes, sont leurs objets, doivent en toutes choses agir d’après la volonté de leur propriétaire, etc. Guillaumin argumente que jusqu’à récemment les femmes se trouvaient ainsi appropriées par les hommes, collectivement au niveau des rapports sociaux généraux, et individuellement, au sein des rapports familiaux [15]. Or, Guillaumin argumente que la forme mentale que prennent les rapports sociaux d’appropriation (ou : l’idéologie qui les accompagne) est toujours sensiblement la même :
« … le fait d’être traitée matériellement comme une chose fait que vous êtes aussi dans le domaine mental considérée comme une chose. De plus, une vue très utilitariste (une vue qui considère en vous l’outil) est associée à l’appropriation : un objet est toujours à sa place et ce à quoi il sert, il y servira toujours. C’est sa « nature ». […] Corollairement, les socialement dominants se considèrent comme dominant la Nature elle-même, ce qui n’est évidemment pas à leurs yeux le cas des dominés qui, justement, ne sont que les éléments pré-programmés de cette Nature. » (p. 49)
A ces rapports d’appropriation correspond donc une représentation des dominés comme « objets naturels », comme êtres « immergés dans leur nature », faisant « partie de la Nature ». Les dominés sont perçus comme des « corps », de la « matière », et leurs faits et gestes comme des émanations immédiates de leur « nature » (fonction), d’une Nature plus ou moins personnalisée dont ils ne sont plus que des modes spécifiques d’incarnation [16]. Les Noirs esclaves (ou plus tard colonisés) sont ainsi des corps vigoureux, mais dénués de subjectivité, de raison : animaux, grands enfants, irresponsables qu’il faut protéger d’eux-mêmes, etc. On observe un discours similaire à propos des enfants (les « mineurs »). Les femmes, elles, sont « le sexe » faible, intuitives et non rationnelles, illogiques et capricieuses, écervelées et instinctives, régies par leur utérus (hystériques) ou leurs ovaires (le cycle naturel des règles), etc.
C’est parce qu’un être est approprié, qu’il a un statut de chose, fonctionnelle comme le sont des outils, qu’il va (socio-psycho-)logiquement être perçu comme non individualisé, comme interchangeable, et comme dénué de subjectivité (de conscience, d’intérêts, de volonté propres), puisqu’il est soumis à la volonté et aux intérêts du propriétaire. Tout cela s’exprime donc idéologiquement par un discours naturaliste ; la nature d’une chose est sa fonction. Or les appropriés sont des choses, ne sont pas leur propre fin, qui réside dans leur propriétaire. Ils sont donc fonctionnels, ont donc une nature. Ils ne sont pas des individus, mais des incarnations particulières d’une essence (nature) commune : leur espèce, l’éternel féminin, leur race…
La liberté comme essence (pour les uns), et la détermination naturelle (pour les autres)
Si les appropriés sont dominés, c’est imputable à leur nature ; de même, les groupes dominants le sont par nature. Colette Guillaumin est très claire sur la question tant qu’il s’agit des rapports de domination au sein de l’espèce humaine,
« le naturalisme ne vise pas indifféremment tous les groupes impliqués dans les rapports sociaux ou, plus exactement, s’il les concerne tous, il ne les vise pas de la même façon ni au même niveau. L’imputation d’une nature spécifique joue à plein contre les dominés et particulièrement contre les appropriés. Ces derniers sont censés relever totalement et uniquement d’explications par la Nature, par leur nature ; « totalement », car rien en eux n’est hors du naturel, rien n’y échappe ; et « uniquement », car aucune autre explication possible de leur place n’est même envisagée. Du point de vue idéologique, ils sont immergés absolument dans le « naturel ».
Par contre, les groupes dominants, en un premier temps, ne s’attribuent pas à eux-mêmes de nature : ils peuvent, au terme de détours considérables et d’arguties politiques, se reconnaître, comme nous le verrons, quelque lien avec la Nature. Quelques liens, mais pas plus, certainement pas une immersion. Leur groupe, ou plutôt leur monde car ils ne se conçoivent guère en termes limitatifs, est appréhendé, lui, comme résistance à la Nature, conquête sur (ou de) la Nature, le lieu du sacré et du culturel, de la philosophie ou du politique, du « faire » médité, de la « praxis »… Peu importent les termes, mais justement du distancié par une conscience ou un artifice. » (pp. 70-71)
Cette différence de discours concernant les dominés et les dominants s’explique bien sûr par la différence des rapports qu’ils entretiennent. Les rapports entre dominants sont supposés être élaborés par les protagonistes eux-mêmes, librement qui plus est [17] : en tout cas, être agis, créés. Les rapports d’appropriation, eux, sont imposés aux appropriés, qui subissent leur situation. Ceux qui s’y refusent apprennent ce qui leur en coûte. Ce n’est qu’au sein du rôle qui leur est assigné et qui reste celui de dominés, qu’ils peuvent parfois (rarement) avoir quelque autonomie. Il n’y a pas d’ambiguïté : quoi qu’on en puisse penser, les propriétaires contractants peuvent bien avoir l’impression qu’ils nouent librement, individuellement et de façon autonome leurs propres relations. Qu’ils se créent ou s’aménagent eux-mêmes leur place dans leur société et dans le monde. Mais ils savent bien, en tout cas, qu’il n’en va pas ainsi pour leurs appropriés, dont la place est par contre toute définie. Les dominants se posent comme sujets de leurs rapports, ils ne peuvent que poser les appropriés comme objets de leurs rapports ; et ce sont eux qui, disposant également des moyens d’expression, élaborent le discours qui rendra compte des rapports d’appropriation. Il y a donc double discours, discours asymétrique : la nature des uns est détermination naturelle, l’essence des autres est liberté. L’idéologie ne fait que rendre compte, avec exactitude mais sous une forme mystificatrice, de la réalité des rapports sociaux.
« L’imputation d’être des groupes naturels qui est faite aux groupes dominés est donc bien particulière. Ces groupes dominés sont énoncés, dans la vie quotidienne comme dans la production scientifique, comme immergés dans la Nature et comme des êtres programmés de l’intérieur, sur lesquels le milieu et l’histoire sont pratiquement sans influence. Une telle conception s’affirme d’autant plus fortement que la domination exercée est plus proche de l’appropriation physique nue. Un approprié sera considéré comme ayant à voir avec la Nature alors que les dominants n’y viennent qu’en second mouvement. Mais plus encore les protagonistes occupent par rapport à la Nature une place différente : les dominés sont dans la Nature et la subissent, alors que les dominants surgissent de la Nature et l’organisent. » (p. 78)
Et Colette Guillaumin de conclure ainsi son analyse :
« Plus la domination tend à l’appropriation totale, sans limites, plus l’idée de « nature » de l’approprié sera appuyée et « évidente » » (pp. 81-82)
Et les « animaux » ? Appropriés et naturels !
Il n’aura bien évidemment échappé à personne que les citations des analyses de Guillaumin sont directement applicables à l’appropriation des non-humains. Cette constatation corrobore d’ailleurs fortement la justesse de ses thèses, puisqu’elle ne les a précisément pas élaborées en pensant les appliquer aux « animaux ».
C’est que ceux-ci sont bel et bien considérés comme des objets (c’est explicite tant dans le Code civil que dans le Code pénal), ils sont vendus et achetés en tant que marchandises, ils ont des propriétaires qui ont pratiquement tout pouvoir sur eux [18], bref, ils sont bel et bien appropriés. Et ils sont appropriés collectivement en tant que classe (catégorie générale correspondant à celle des êtres non-humains) par une autre classe (la catégorie des êtres humains) : tout humain, par exemple, peut pêcher ou chasser un animal, ce qui ne signifie rien d’autre que les animaux, pris en tant qu’ensemble, appartiennent de droit aux humains (à l’humanité dans son ensemble), et que pour qu’ils deviennent la propriété réelle et concrète d’un individu humain particulier, il suffit seulement que celui-ci arrive à s’emparer d’eux, par force ou par ruse. La loi désigne d’ailleurs un animal sauvage comme res nullius (« chose de personne »). Quant à la descendance d’un non-humain, tout comme ses autres productions, elle appartient ipso facto à son propriétaire.
De fait, pour tout le monde, « les animaux appartiennent à la Nature ». Et ils sont bien perçus également comme ayant « une nature » qui les détermine entièrement, perçus comme des êtres programmés, des spécimens indifférenciés de leur espèce, immergés dans la Nature et soumis à elle via leurs instincts, ou, comme le dit Guillaumin à propos des femmes, « des êtres clos, finis, qui poursuivent une tenace et logique entreprise de répétition, d’enfermement, d’immobilité, de maintien en l’état du (dés)ordre du monde. » (p. 76)
L’humanisme est un naturalisme
Dans son célèbre livre sur Les enfants sauvages, Lucien Malson (1964) nous donne un clair aperçu du discours humaniste (c’est-à-dire, spéciste) type, tel qu’on le rencontre en permanence puisqu’il correspond à l’idéologie actuelle, héritée du XVIIIe siècle et des Lumières, quoique puisant ses racines dans la plus profonde Antiquité :
« C’est une idée désormais conquise que l’homme n’a point de nature mais qu’il a – ou plutôt qu’il est – une histoire. »
« A la vie close, dominée et réglée par une nature donnée, se substitue ici l’existence ouverte, créatrice et ordonnatrice d’une nature acquise. »
« … aujourd’hui, se trouve au monde un être qui n’est pas, comme la totalité des autres êtres, un « système de montages » mais qui doit tout recevoir et tout apprendre… ». (pp. 7, 8, 9) [19]
Le journaliste Luc Ferry est le plus connu des opposants à une prise en compte des intérêts des non-humains. Il a écrit un opus contre l’idée d’égalité animale, Le nouvel ordre écologique (1992), qui illustre parfaitement les analyses de Guillaumin. Il est obligé pour sauver le suprématisme humain de recourir à de fort vieilles lunes. La thèse fondamentale que Ferry mobilise est l’argumentation traditionnelle suivante, dont il fait remonter la paternité à Rousseau et à Kant :
« … l’homme évolue par l’éducation en tant qu’individu, par la politique en tant qu’espèce. L’acte humain par excellence, c’est le mouvement. C’est précisément ce qui nous différencie des êtres de nature qui sont, eux, toujours rivés à un code : l’instinct pour les animaux, le programme pour les végétaux. […] Ils sont rivés à leur nature. Les animaux, eux, n’ont pas d’histoire. Seul l’homme en a une, parce qu’il est le seul capable de se dégager des déterminismes biologiques pour conquérir sa liberté. Le droit est antinaturel, le savoir scientifique est antinaturel. L’homme est un être d’anti-nature. C’est la base de l’humanisme. » [20]
C’est parce qu’il est libre, contrairement aux autres animaux, que « l’Homme » doit se voir accorder une dignité particulière, qui légitime que lui et lui seul possède des droits. C’est la révérence qu’on doit porter à la liberté (et non simplement à l’intelligence ou la raison), ou à l’humanité en tant qu’elle est synonyme de liberté, qui donne à « l’être » humain sa valeur singulière dans un monde par ailleurs dénué de toute subjectivité (Ferry & Vincent, 2000) :
« Le critère, pour Rousseau, est ailleurs : dans la liberté ou, comme il dit, dans la « perfectibilité », c’est-à-dire dans la faculté de se perfectionner tout au long de sa vie là où l’animal, guidé dès l’origine et de façon sûre par la nature, est pour ainsi dire parfait « d’un seul coup », dès sa naissance. La preuve ? Si on l’observe objectivement [souligné par nous], on constate que la bête est conduite par un instinct infaillible, commun à son espèce, comme par une norme intangible, une sorte de logiciel dont elle ne peut jamais vraiment s’écarter. La nature lui tient lieu tout entière de culture… »
Je ne vais pas m’appesantir ici sur la réfutation logique des thèses humanistes. Je renvoie pour cela à un petit livre Luc Ferry ou le rétablissement de l’ordre. L’humanisme est-il anti-égalitaire ? (2001) Notons simplement ici que l’on retrouve à la base de l’argumentation de Ferry la croyance naturaliste en une détermination étroite des animaux « par leurs gènes ». Ils n’ont ni individualité, ni véritable liberté ou volonté. Leur intelligence est en fait un instinct. La preuve ? Ils sont déjà en naissant ce qu’ils seront plus tard !
Il n’existe plus aujourd’hui d’éthologues et autres spécialistes des comportements des animaux qui oseraient dire, en reprenant les termes de Rousseau ou de Kant, c’est-à-dire des termes d’il y a plus de deux siècles, que les animaux sont « rivés à leur nature », « soumis entièrement à leur instinct », « programmés » pour agir de telle ou telle sorte (Burgat, 1997), etc. De fait, ces termes disparaissent des discours scientifiques contemporains, et les revues de sciences naturelles ou de sciences humaines insistent désormais couramment sur les cultures ou subcultures animales, sur l’innovation, l’apprentissage, l’éducation ou même les phénomènes de mode dans des sociétés d’oiseaux, de mammifères marins, de rats, et, bien évidemment, de singes.
Retenons surtout ceci : l’idéologie humaniste se donne comme un anti-naturalisme ; pourtant, on vient de le voir illustré ici, elle nécessite l’idée de Nature qui est utilisée comme repoussoir d’une part, comme toile de fond d’autre part, sur laquelle la liberté humaine et la dignité censée en découler peuvent faire relief et contraste.
Sans l’idée de Nature, que reste-t-il du statut spécifique et exclusif lié à l’Humanité ? Sans le support de l’idée de Nature, l’idée d’Humanité peut-elle toujours faire barrière à celle d’égalité ?
La libération animale
Si l’on pense, comme moi, que l’éthique impose de revoir fondamentalement notre façon de traiter les autres animaux, et que l’idée d’égalité par définition ne saurait se satisfaire de discriminations arbitraires comme le sont celles fondées sur les critères d’espèce ou d’intelligence (liberté, raison…) des individus, les analyses que j’ai esquissées ci-dessus impliquent quelques conséquences que je ne vais qu’énumérer comme autant de pistes à creuser :
– Démanteler le système d’appropriation d’êtres sentients : les animaux ne peuvent être propriété d’autrui parce qu’ils sont sentients, qu’ils ont leurs propres intérêts, leur propre conscience. Autant la critique de l’idée de nature peut aider à combattre le système d’appropriation spéciste des animaux, autant en retour, abolir leur appropriation favorisera la reconnaissance du fait qu’ils vivent une vie propre, une vie subjective riche qui vaut pour elle-même, de la même façon que nous vivons pour nous-mêmes et que notre vie subjective a – est – une valeur en soi. Le subjectif est objectif (Olivier, 2003).
– Critiquer l’idéologie de la Nature : l’idée de Nature en tant qu’ordre ou équilibre harmonieux, en tant que totalité et fonctionnalité [21] n’est pas justifiée scientifiquement et perdure pour des raisons idéologiques. De même de l’idée d’essence, de nature des choses et des êtres. La critique s’impose parce que l’idée de Nature sert à justifier la domination, l’ordre établi : les humains seraient par nature carnivores (ou : omnivores), et devraient donc le rester.
– Remplacer la distinction Humanité/Nature par celle entre choses inanimées et êtres sentients : s’il y a des différences radicales à établir dans le réel, elles ne résident pas dans les oppositions entre naturel et humain, naturel et social, naturel et artificiel, inné et acquis, etc. D’un point de vue scientifique, philosophique tout autant qu’éthique, ce n’est pas cette distinction entre supposés « êtres de liberté » et « êtres de nature » qui semble désormais pertinente, mais bien plutôt celle entre une matière sensible et une matière inanimée, entre ces choses réelles qui éprouvent des sensations, qui dès lors ressentent des désirs et de ce fait agissent en fonction de fins qui leur sont propres, et ces autres choses qui n’éprouvent rien, n’ont pas d’intérêts, auxquelles rien n’importe, qui ne donnent aucune valeur aux événements et aucun but à leur existence. Entre les êtres sensibles et les choses insensibles, entre les animaux, pour faire vite, et les cailloux ou les plantes.
– Opérer une révolution éthique : jusqu’à présent, l’exigence morale n’a guère osé s’affirmer en tant que telle, mais a toujours dû s’habiller des oripeaux de la religion, de la mystique (le naturalisme, tout particulièrement) de l’appartenance identitaire (valorisation de la race ou de l’humanité…) et de l’égoïsme qui l’accompagne (qu’il s’agisse de l’individualisme libéral humaniste ou du salut individuel chrétien)… L’éthique désormais semble pouvoir rompre avec l’adoration des « valeurs supérieures », l’Humanité, la Civilisation, la Liberté, etc., pour se courber vers la tourbe : nous. Nous, êtres sensibles, êtres de plaisirs et de douleurs, êtres de malheur et de bonheur. Contempler le ciel des idées a toujours permis de piétiner les intérêts concrets des uns et des autres. Il s’agit ni plus ni moins que de prendre en compte, enfin, la réalité…
– Critiquer les morales et systèmes hiérarchiques : la critique du spécisme rompt avec l’essentialisme hérité du Christianisme en refusant de considérer une quelconque échelle d’essence qui donnerait respectabilité ou supériorité, qui fonderait une hiérarchie (sous-êtres, sur-hommes…). Le mouvement égalitariste ne veut considérer que les intérêts (au sens de désirs, par exemple) des individus et non pas les évaluer sur une échelle de « dignité ». Ce qui importe moralement, c’est ce qui importe à l’individu sensible lui-même ; ce qui fait l’intérêt de sa vie, c’est ce qui lui fait l’intérêt de sa vie.
– Remettre en cause l’identité humaine : le mouvement vers l’égalité nécessite de repenser ce qui constitue le rapport inaugural de nos sociétés, ce piédestal sur lequel nous avons hissé notre appartenance à un groupe biologique : l’espèce. Il remet en cause l’évidence de la plus inaperçue – parce que perçue comme naturelle – de nos identités : l’humanité. Dans les sociétés contemporaines, l’humanisme s’est imposé sans partage ; il proclame l’humanité comme valeur suprême, qu’il s’agisse du groupe correspondant à l’ensemble des membres de l’espèce humaine, ou bien des valeurs dénommées humaines, censées exprimer notre commune humanité. L’idée d’une espèce supérieure (élue) fait tout autant obstacle à l’idée d’égalité que celle d’une race supérieure (élue)…
– Revendiquer un environnementalisme non spéciste : il ne s’agit plus de préserver la Nature, mais de mettre en avant tout autant les intérêts des autres êtres sensibles que ceux des humains à bénéficier d’un environnement faste, quel qu’il soit… (Bonnardel, 2001)
On le voit, si la question animale reste encore marginale, elle déborde pourtant de toute part le cadre étroit qui lui est alloué, prête à entr’ouvrir sous nos pas de nouveaux abîmes d’interrogations, portant à nos regards de très nouveaux (et souvent très anciens) horizons. Il semble vraisemblable qu’elle génère une onde de fond qui emporte sur son passage une grande part du monde que nous connaissons.
Il s’agit d’une question passionnante, fascinante. Mais elle concerne aujourd’hui avant tout les non-humains ; pour eux, qui vivent généralement des vies atroces et connaissent des morts épouvantables, la question est absolument vitale. De la façon dont nos sociétés l’affrontent dépend le sort de plus d’êtres chaque année qu’il n’a jamais existé d’humains à la surface de la terre… Cet enjeu-là est premier. En soi, il est colossal.
[1] Barrett, P. H., Gautrey, P. J., Herbert, S., Kohn, D., Smith, S. eds., 1987, Charles Darwin’s notebooks, 1836-1844 : Geology, transmutation of species, metaphysical enquiries. British Museum (Natural History) ; Cambridge : Cambridge University Press : Notebook B, Transmutation of species (1837-1838), p. 231 (Le Corail de la vie, Carnet B (1837-1838), Traduit de l’anglais par Maxime Rovere, Coll. Rivages Poche / Petite Bibliothèque, éd. Rivages , 2008, p. 179).
[2] Sentience : « […] le fait que certains êtres ont des perceptions, des émotions, et par conséquent […] des désirs, des buts, une volonté qui leur sont propres. » (Reus, 2005).
[3] Hier c’était le sang, aujourd’hui ce sont les gènes, qui sont censés être le support de la nature des êtres.
[4] Hamburger enchaîne avec un exemple de « régulation naturelle » par la prédation, qui, associée à des considérations de programmation et de finalité, ne signifie rien d’autre que le fameux : « ils se mangent entre eux, ils sont faits pour cela. » L’auteur était un scientifique bien connu et il est intéressant de retrouver chez lui cette fameuse croyance naturaliste que les choses qui existent répondent à un dessein, à un destin, vaste ou dérisoire, à un programme, et ont finalement un sens.
[5] « La vie agitée des eaux dormantes », Ça m’intéresse n°16, juin 1982, p. 50. En fait, la notion d’« équilibre écologique », l’un des plus omniprésents poncifs de la vulgarisation écologique, est très critiquée d’un point de vue scientifique, notamment par Botkins (1990).
[6] La notion d’instinct n’est plus utilisée par les éthologues car trop imprécise et ne rendant pas compte de la réalité ; on oublie que dès les années 1950 et les définitions données par Lorenz et Tinbergen, on ne pouvait plus opposer instinct et intelligence comme négation l’un de l’autre.
[7] Les essences sont essentielles ; on ne doit pas y toucher. Ainsi ne faut-il pas mélanger des choses déclarées de nature différente. Le même réflexe fait haïr les métissages.
[8] Les membres des groupes dominants ne se considèrent eux-mêmes comme « naturels » que lorsqu’il s’agit de justifier la domination, ainsi elle-même doublement naturalisée ; ainsi des pulsions sexuelles irrépressibles des violeurs, du carnivorisme des humains, de la maturité responsable des adultes, etc.
[9] Alika Lindberg était militante de la défense animale et du Front national.
[10] « Les animaux : que savent-ils d’eux-mêmes ? », Ça m’intéresse n°16, juin 1982, p. 19.
[11] Alexis Carrel, février 1943, cité par Richard Cœurde dans « Voyage en Lepénie : extrême-droite et écologie », Silence n°158, octobre 1992.
[12] Jean-Marie Le Pen, Les Français d’abord, éd. Carère/Lafont, 1984, cité par R. Cœurde, ibid.
[13] Jean-Claude Nouët, président de la Ligue Française pour les Droits de l’Animal, cité par Lea di Cecco, « Expérimentation : peut-on se passer des animaux ? », Science et Avenir n° 511, sept. 1989, p. 35. À propos de cette Ligue, lire Bonnardel (1992 et 1994a).
[14] Ces analyses ont été présentées initialement dans les n° 2 & 3 des Questions Féministes (février et mai 1978). Elles ont été republiées depuis, avec d’autres articles de la même auteure, dans Guillaumin (1992). C’est à cette édition que je me réfère.
[15] C’est ce rapport d’appropriation qui s’exerce à l’encontre des femmes qu’elle nomme « sexage ». Pour de plus amples développements sur ce sujet, je renvoie à son livre.
[16] Les Noirs sont ainsi des spécimens du Noir, les femmes, des incarnations de la Femme, etc., lorsque les hommes sont par contre des représentants individués de l’Humanité (Guillaumin, 2002). L’Humanité se caractérise – se distingue – justement idéologiquement par l’individualisation de ses « membres ». Les animaux, eux, apparaissent comme des spécimens indifférenciés de leur espèce…
[17] On sait ce qu’il peut en être en réalité, qu’il s’agisse du fameux contrat social, ou de la liberté de se salarier, par exemple. Mais ce n’est pas le lieu de discuter ici du discours que produisent les propriétaires eux-mêmes sur leur propre situation (Bonnardel, 1994b).
[18] Encore que cela puisse dépendre de la fonction sociale qui est assignée à l’espèce à laquelle appartiennent « naturellement » les individus, ainsi des « animaux de compagnie » qui, ayant une autre fonction, sont généralement mieux traités que les « animaux de boucherie », etc.
[19] Comme le dit Malson, cette non-naturalité humaine est effectivement « une idée désormais conquise », historique : ça a été la tâche de l’humanisme que d’étendre tendanciellement, au niveau concret, matériel, la reconnaissance progressive pour tous les humains de leur propriété d’eux-mêmes et, au niveau idéologique qui lui correspond, d’étendre la notion de liberté à quasiment tous (les enfants et divers fous ou malades, notamment, en restent exclus). L’avènement du capitalisme, rapport social qui se fonde sur la possibilité aussi étendue que possible de commercer (échanges marchands), nécessitait de ce fait la capacité de posséder et donc préalablement de se posséder soi-même (Guillaumin, 1992).
[20] L’Express du 24 sept. 1992, p. 108. Article paru à l’occasion de la sortie du Nouvel Ordre écologique.
[21] On trouvera une esquisse d’une telle critique globale dans Bonnardel (2007).
)
Bibliographie :
Alain, Les Dieux, liv. II, chap. IV., Paris, Gallimard, 1934, p. 180.
Hannah Arendt, Le système totalitaire. Les origines du totalitarisme, Paris, Essais, Points, éd. du Seuil, 1972
Yves Bonnardel, « Droits de l’animal, “version française” », Cahiers antispécistes n°2, 1992
Yves Bonnardel, « Pour un monde sans respect », Cahiers antispécistes n°10, 1994a
Yves Bonnardel, Une liberté qui subjugue, Lyon, 1994b (non publié, disponible à l’adresse 20 rue Cavenne, 69007 Lyon, contre 2,30 euros p. c.)
Yves Bonnardel, « La prédation, symbole de la Nature », Cahiers antispécistes n°14, déc. 1996
Yves Bonnardel, « Qui va à la chasse garde sa place », Cahiers antispécistes n°15-16, avril 1998 (téléchargeables sur www.cahiers-antispecistes.org)
Yves Bonnardel, « Contre l’apartheid des espèces », dans Yves Bonnardel, David Olivier, James Rachels et Estiva Reus, Espèces et éthique. Darwin : une (r)évolution à venir, Lyon, tahin party, 2001
Yves Bonnardel, Pour en finir avec l’idée de Nature et renouer avec l’éthique et la politique, Lyon, tahin party, 2007 (téléchargeable sur www.tahin-party.org)
Daniel B. Botkins, Discordant Harmonies. A New Ecology for the Twenty-first Century, New York, Oxford, Oxford University Press, 1990
Florence Burgat, Animal, mon prochain, Paris, Odile Jacob, 1997, p. 88
Claude Elsen, J’ai choisi les animaux, Paris, Stock, 1970
Luc Ferry, Le Nouvel ordre écologique, Paris, Grasset, 1992
Luc Ferry et Jean-Didier Vincent, Qu’est-ce que l’homme ?, Paris, Odile Jacob, 2000
Colette Guillaumin, Sexe, Race et Pratique du pouvoir : l’idée de Nature, Paris, côté-femmes, 1992
Colette Guillaumin, L’idéologie raciste. Genèse et langage actuel, Paris, Folio essais, Gallimard, 2002
Jean Hamburger, L’Homme et les hommes, Paris, Flammarion, 1976
Élisabeth Hardouin-Fugier, David Olivier, Estiva Reus, Luc Ferry ou le rétablissement de l’ordre. L’humanisme est-il anti-égalitaire ?, Lyon, tahin party, 2002
Alika Lindberg, Lorsque les singes hurleurs se tairont, Paris, Presses de la cité, 1976
Lucien Malson, Les enfants sauvages, Paris, coll. 10/18, UGE, 1964
David Olivier, « Le subjectif est objectif. Prendre la sensibilité au sérieux », Cahiers antispécistes n°23, déc. 2003
David Olivier, Estiva Reus, « La science et la négation de la conscience animale. De l’importance du problème matière-esprit pour la cause animale », Cahiers antispécistes n°26, nov. 2005
Estiva Reus, « Sentience ! », Cahiers antispécistes n°26, nov. 2005
Clément Rosset, L’Anti-Nature, Paris, Quadrige, Presses universitaires de France, 1973
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (401 ko)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (314.3 ko)