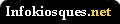P
Punks versus État socialiste : RDA, années 80
Too much future vol. 2
mis en ligne le 12 septembre 2012 - Collectif
Les textes qui composent ce second volume sont tous tirés de Too
much future – le punk en république démocratique allemande,
bouquin publié chez Allia en 2010.
PARTOUT OÙ TES PAS TE MÈNENT (1981)
Où que tes pas te mènent
On contrôle ton identité
Et à la moindre fausse note
Tu sais ce qui peut arriver
Partout où ton regard se pose
Des caméras t’observent
Elles t’accompagnent pas à pas
Et la Sécurité t’emboîte le pas
Il faut que quelque chose se passe
Car qui peut rester sans rien faire
Est-ce que tu es né
Pour te laisser soumettre
N’est-ce pas un grand pays
Que celui où tous sont libres ?
Planlos (Michael Boehlke alias « Pankow », Michael Kobs, Daniel « Kaiser », Bernd Michael « Lade », 1980-1983)
***************************************************************************************************
TOO MUCH FUTURE
En 1971, j’eus droit à mon premier cours d’allemand. Un stylo dans la main gauche, j’étais sur le point de tracer un semblant de lettre quand la maîtresse se rua sur moi. Ni une, ni deux, elle me plaça le stylo dans l’autre main avec, en guise d’explication, une sombre prophétie : « C’est aussi avec la main droite qu’il faudra plus tard piloter les machines ! » J’allais devenir un mutant hybride, mi-droitier mi-gaucher, dont la mystérieuse écriture serait sans relâche sanctionnée par le corps enseignant.
Je crois que j’eus à cet instant précis mon tout premier aperçu de ce que la marginalité pouvait signifier. Mais c’était surtout la première fois qu’on m’assignait un avenir. Ma maîtresse, conditionnée par les discours de son Parti-état, voyait naturellement ma vie future régie par la cadence des machines. Mais le pire, c’était moins cette vision que ce qu’elle révélait : une route déjà tracée, un CV programmé.
Du haut de mes six ans, je n’étais pas encore capable de saisir l’ampleur de la catastrophe. Mais les innombrables incidents qui jalonnèrent la suite de mon enfance et, plus encore, mon adolescence socialiste ne tardèrent pas à ancrer en moi la certitude angoissante que ce futur programmé n’était même plus à venir : il avait déjà commencé.
L’avenir, j’y étais depuis mon premier jour d’école, et c’était un présent perpétuel, une reconversion en droitier et un système social incontournable qui signifiait la mort lente et douloureuse de tout avenir.
En RDA, les étapes de votre chemin de croix correspondaient aux stades de développement de votre “personnalité socialiste’’ : à votre entrée à l’école, un rituel d’initiation faisait de vous un Jeune Pionnier. Trois ans plus tard vous étiez “consacré” Pionnier Ernst Thälmann [1]. A 14 ans, vous étiez “appelé’’ dans la Jeunesse Libre allemande (FDJ). Si vous étiez du sexe fort vous portiez encore, après ceux des organisations de jeunesse, “l’uniforme d’honneur” de la NVA, l’armée populaire nationale, pendant un an et demi (au minimum, car un service volontaire d’au moins trois ans était recommandé). Et puis, la “formation universelle” de “votre personnalité socialiste” étant achevée, on vous lâchait dans la fosse aux lions des entreprises du peuple. La compétition socialiste, destinée à améliorer la production, était féroce. La “rue des meilleurs” [2] ne supportait pas qu’on s’en écarte, sauf pour fonder une famille. Elle menait tout droit jusqu’à la retraite.
A l’âge de 60 ou 65 ans, vous étiez récompensé pour ce travail de forçat par la permission exceptionnelle de voyager à l’Ouest : finies les excursions dans deux ou trois “États frères”, vous pouviez admirer, sans un sou en poche, les merveilles de la zone non socialiste [3]. En adhérant au Parti, vos perspectives étaient parfois un peu moins tristes. Mais toujours à pleurer.
En RDA, je ne pouvais envisager plus qu’un CV standardisé. Il s’inscrivait dans un projet de société fondé sur un mensonge : en collectivisant l’individu, en lui dictant ses besoins pour n’en satisfaire au final qu’une infime partie, le socialisme dépasserait le capitalisme sur le plan économique comme sur le plan moral. Une “nouvelle société” allait naître, qui façonnerait à son tour un “homme nouveau” – ou réciproquement. Cette ambition prométhéenne exigeait évidemment beaucoup de notre système scolaire : la plus anodine des disciplines prenait une tournure idéologique. Seules les sciences naturelles étaient épargnées mais, d’instinct, je m’en méfiais encore, car leurs contenus, tout comme ceux de la Sainte doctrine socialiste, s’incarnaient dans des définitions froides et des formules éthérées, des équations toujours résolues et des expériences invariablement couronnées de succès. Face à une pédagogie aussi exigeante, mes performances scolaires se révélèrent extrêmement modestes. Mon rendement ne s’améliora pas pendant mon apprentissage, comme tout le monde l’avait espéré. Je ne le souhaitais plus moi-même. Ma formation de relieur de livres industriel (ou, selon l’expression consacrée, d’”ouvrier spécialisé dans le façonnage à l’unité”) me donna surtout un avant-goût de l’enfer de cinquante ans qui lui succéderait. C’était une représentation fictive, aussi abstraite qu’une double condamnation à vie, et la RDA se matérialisait comme une Église d’État dont la seule existence supposait la damnation éternelle.
Les abominables normes de production socialistes étaient l’ultime supplice de cet enfer sur terre : elles n’étaient satisfaites que lorsqu’elles étaient dépassées. Ce n’est pas faute d’avoir essayé de les atteindre au début de ma formation, mais je n’étais pas préparé à un tel calvaire. Je n’en voyais tout simplement pas le bout et la moitié du peu que je produisais était de toute façon à jeter à la poubelle. Je ne voulais pas saper notre économie nationale. J’ai donc cessé de m’acharner. Ne plus me soucier des objectifs me valut évidemment de nombreux blâmes publics et finalement un transfert disciplinaire : je devins liftier dans un monte-charge.
Jusqu’alors c’était Hans, un lilliputien, qui occupait ce poste. Après une croissance imprévue, il avait été renvoyé du cirque dans lequel il avait fait le clown pendant des années. Relégué dans la production, toujours mal luné et plus du tout d’humeur à plaisanter, il passait ses journées à monter et descendre sans que rien de plus ne bouge pour autant dans sa vie. Il tomba malade.
Pour moi au contraire, il y eut du mouvement dans l’air. Je découvris la faune obscure du monde de la manutention, dont mon entreprise n’avait pas dû recruter l’espèce la plus lumineuse : le système de référence de mes collègues mâles se résumait à des commentaires maudissant “ce putain d’Est” et à de subtiles déclarations de fond qui tournaient toutes exclusivement autour de la “baise”. Seules quelques femelles centaures (des femmes dont les jambes avaient depuis longtemps fusionné avec leurs machines) se montraient plus discrètes. Mais uniquement pour laisser entendre qu’elles, au moins, ne se bornaient pas à la théorie comme leurs collègues mâles. De temps en temps, elles entraient dans l’ascenseur – comme elles seraient entrées dans un confessionnal – et racontaient à voix basse les rendez-vous secrets qu’elles venaient de donner, depuis une fenêtre des étages supérieurs, aux travailleurs et aux chauffeurs des éditions Axel Springer, situées juste en face de notre entreprise, de l’autre côté du Mur et du no man’s land. (Elles n’avaient qu’à inscrire la date et l’heure sur de grands cartons.) A quelques mètres du poste frontière Baumschulenweg, elles étaient prêtes à tout [4]. En récompense de leurs efforts, elles obtenaient du café, des chocolats, des bas nylon et l’inestimable satisfaction d’avoir baisé l’Est en la personne d’un type de l’Ouest.
Je découvrais les résultats concrets de la subtile théorie que l’on m’avait serinée à l’école : le monde du travail s’avérait à mille lieues des sommets que promettait la planification de l’économie. Il était même profondément désillusionné.
On me garantissait une place dans ce monde. Cela suffisait à justifier que le travail soit obligatoire et que la libre disposition de soi ne figure pas dans le Masterplan de notre État idéal. Je n’avais donc pas d’incertitude face à l’avenir. Ce qui me minait au contraire, c’était la certitude de trop bien le connaître : une perspective sans perspective, un paysage d’apocalypse qui ne me laissait entrevoir aucun espoir de réaliser mes désirs ou mes aspirations, mais qui m’offrait à la place l’amitié indestructible de l’Union soviétique, l’unité du Peuple et du Parti, l’unité du Parti et de l’État, et le futur comme un présent sans fin.
En 1978, à la lecture d’un bref article dans un magazine quelconque de propagande, mon cœur se remit à battre. Dans le jargon habituel, prosélyte et paranoïaque, on expliquait qu’à Londres des jeunes gens mal influencés se paraient des symboles des pires régimes de l’Histoire, s’entretuaient sur scène, jetaient les cadavres dans les égouts et se nommaient “punks”. Le punk était présenté comme une mode occidentale anticapitaliste, une forme de contestation décadente et condamnée à l’échec, puisqu’elle ne reposait pas sur la doctrine marxiste-léniniste.
Pour affoler un adolescent, ils ne pouvaient pas trouver mieux. Je pressentis aussitôt qu’un mouvement dangereux et énorme était en marche. Sa vibration mystérieuse, émise de l’étranger, m’appelait au réveil. Une photo de deux punks londoniens sur King’s Road, connue à l’époque, illustrait l’article. Je n’avais jamais vu plus belles personnes que ces fantastiques créatures. La beauté et le danger s’entrechoquaient. Ce fut le coup de foudre.
Le contexte social des punks anglais n’était certes pas comparable au mien. J’avais du travail et, à seize ans, déjà un emploi pour la vie. En RDA, on n’avait pas besoin d’assurance-vie, le bonheur était un membre du Parti et le futur un caniche qui faisait le beau sur commande. Et pourtant le No future des punks anglais rencontrait chez moi un curieux écho. Il était en quelque sorte le négatif de mes expériences : j’étais, moi, pris dans l’étau d’un avenir prescrit, d’un excès d’avenir. Tous les jours, l’étau se resserrait sur moi, rongeait mes extrémités et menaçait de me transformer en copeaux de ferraille susceptibles d’être rassemblés et refondus en ce qu’on voulait faire de moi. Je décidai de sauver ma carcasse et de m’extraire intègre de ce monde. Cela ne se fit pas tout de suite et cela se passa sans que j’en eus conscience. Mais en 1979, alors que je ne mesurais pas immédiatement les conséquences des mes actes, le processus avait abouti.
L’ivresse des premières semaines et des premiers mois du punk a sans doute été partout la même, au-delà des systèmes politiques. Que l’on soit à Londres, l’épicentre du mouvement, ou à Berlin-Est, s’aventurer pour la première fois dans les rues, bardés de chaînes, affublés d’une non-coiffure et de fringues lacérées a sans doute engendré la même vibration. Remontés à bloc, on se cognait violemment à un monde identique mais transfiguré : on avait renversé la perspective. On avait repris l’initiative. On avait rompu les amarres, mais on maintenait fermement le cap. Ou du moins c’est ce que nous croyions. Car être punk signifiait déchaîner une tempête de bonheur. Cette tempête, charriant des vents incontrôlables, nous entraîna rapidement dans sa propre course et balaya bien vite nos illusions des premiers jours. Le même mouvement rencontra des vents très différents à l’Est et à l’Ouest, ne s’y développant pas du tout de la même manière.
En stylisant leur absence de perspectives et leur misère sociale en un No future retentissant, les punks anglais créèrent une puissante marque de fabrique (qui perdure aujourd’hui dans l’industrie et les codes de la musique, de la mode, de la vidéo et de la pub sous le label “punk rock”). Ils virent leur nihilisme atteindre un degré d’affirmation et d’acceptation qui alla jusqu’à la reconnaissance du grand public. “There’s no future in England’s dreaming” se révéla faux non seulement pour les Sex Pistols, mais pour le rêve punk en général. Ce chant d’adieu de Johnny Rotten déboucha finalement sur une véritable success story et apparaît avec le recul comme un investissement d’avenir. En RDA la contestation des punks resta toujours à demi asphyxiée par la répression massive de son expression publique, alors qu’elle trouva en Angleterre un écho politique, artistique et, ce qui n’est tout de même pas négligeable, commercial. Les punks de l’Est ne pouvaient que rêver d’un tel écho et de la liberté d’expression qu’il supposait. Comme leur rêve ne pouvait être vécu que dans des conditions extrêmes, ils le vivaient par procuration : l’Angleterre était la terre promise et toute l’attention se focalisait sur les groupes de Londres ou de Manchester. D’une manière révélatrice, la première génération de punks est-allemands – apparue en 1979 et pour différentes raisons presque disparue en 1984 – s’intéressa d’abord au punk anglais avant de se tourner vers la scène de Berlin-Ouest ou de la RFA. L’énergie du punk anglais, née dans un contexte social explosif, entrait bien davantage en résonance avec la leur. Et pour importer le punk dans le socialisme réel, mieux valait de toute façon s’inspirer de la version originale.
Les Anglais ont donc joué les premiers violons pour les punks de l’Est. Mais les groupes de Berlin-Ouest, de Düsseldorf ou de Hambourg, qui chantaient presque exclusivement en allemand, ont eux aussi élan donné un déterminant à la formation de leur scène. Le punk “allemand” est d’ailleurs toujours toujours resté synonyme de punk “ouest-allemand”. Cela tient essentiellement au contexte politique. Si le punk de l’Est n’a pas pu s’imposer dans la durée, c’est d’abord parce qu’il n’a pas été commercialisé.
Mais l’engagement des musiciens a aussi joué son rôle : c’est avant tout la subversion musicale qui intéressait les punks de l’Ouest ; leurs textes étaient en général plus abstraits, plus universels et plus ironiques que ceux de l’Est. Les punks est-allemands, de la première génération au moins – criminalisés et donc politisés qu’ils le veuillent ou non –, envisageaient avant tout la musique comme support de leurs textes qui étaient éminemment explicites, politiques et dirigés contre le système. Si le punk de l’Ouest est devenu grand public, le punk de l’Est est toujours resté une contre-culture. Un punk risquait gros en RDA. Il ne jouait pas seulement son présent mais aussi – à 16 ans par exemple – son avenir tout entier, si standardisé soit-il. Être punk à l’Est signifiait compromettre sa famille, sa scolarité, son apprentissage, et je ne parle même pas des études supérieures. Et dans la “Patrie des ouvriers et des paysans”, être sans profession ne signifiait pas, comme à l’Ouest, une vie à peu près tolérée en marge de la société, mais la persécution en tant qu’ “élément déviant” et bien souvent la prison. Comme les sanctions n’engageaient pas seulement l’avenir immédiat mais la vie tout entière, la menace qui pesait sur l’individu était en quelque sorte globale.
Un punk en RDA ne pouvait pas faire une carrière de pop-star. Les groupes jouaient sans le moindre espoir d’évolution ou de succès commercial. Ils jouaient avec la conscience aiguë des risques qu’ils encouraient, qui pouvaient aller jusqu’à des peines de prison drastiques. D’abord le Mur, puis les barreaux : les punks pouvaient se retrouver doublement séquestrés. Les fonctionnaires du Parti n’entendaient pas grand-chose à l’altruisme et exigeaient pour leurs cadeaux empoisonnés une gratitude qu’ils ne pouvaient plus attendre des punks. Or, en RDA, si l’on ne se montrait pas suffisamment reconnaissant envers les acquis sociaux imposés – une place assurée à l’école maternelle, une formation assurée, un emploi assuré, une paix assurée et tout cela dans des frontières assurées –, on était certain d’être assuré contre soi-même dans les centres de détention pour mineurs, en prison, à l’armée ou à l’air libre, rendu irrespirable par la surveillance passionnée de la Stasi [5]. Le ministère pour la Sécurité de l’État (MFS [6]) était l’expression géniale de cette sécurité érigée en fétiche. La sacro-sainte sécurité offerte par notre système social : voilà l’argument massue qu’on brandissait dès qu’une critique s’élevait pour dénoncer le manque de libertés élémentaires.
En neuvième [7], dans le cadre de notre cours préféré, le cours d’instruction civique”, une rédaction devait nous donner l’occasion de célébrer nos acquis sociaux et de condamner dans une litanie d’arguments spécieux et devenus, pour nous, quasi mantriques, la misère sociale et morale de la RFA. La rédaction confinait à la dictée car son intitulé en aiguillait le contenu : “Comment un citoyen de la RFA peut-il améliorer sa qualité de vie ?” J’ignorais ce qu’était une question orientée, mais cela me semblait quand même assez clair. Ingénument, sans doute influencé et quelque peu préservé par l’esprit critique de mes parents, je répondis qu’un citoyen de l’Ouest, pourvu qu’il en ait les moyens financiers, pouvait écouter les morceaux, lire les livres, voir les films et visiter les pays qu’il souhaitait. Ma professeur s’attendait sans doute à une tout réponse, car elle gratifia mon travail d’un zéro salé qu’elle pimenta d’une tirade incendiaire qui culmina avec un verdict sans appel : j’étais un “ennemi de l’État”. Je devinai qu’un lourd fardeau était associé à cette charge et qu’à 14 ans une écrasante responsabilité pesait sur mes épaules. Surtout quand mes camarades de classe, régulièrement cités pour leurs résultats nettement supérieurs aux miens, vinrent me trouver en cachette pour me féliciter et me taper dans le dos. Je pressentis que l’on pouvait se sentir très seul dans un groupe tout en étant au sommet de sa popularité. Cette intuition se mua en certitude quand je devins le tout premier et au départ seul et unique punk de mon lycée et que j’eus affaire aux élèves des classes supérieures. Alors que les enseignants se montraient plutôt ignares ou doucement moqueurs, ma métamorphose fit tout sauf rire les bluesers [8] pour la plupart des gars difficiles issus de familles nombreuses, qui eux-mêmes encaissaient les blâmes publics à répétition. Ils avaient du mal à comprendre qu’un privilégié comme moi, qui avait de la famille à l’Ouest et qui, de ce fait, avait accès à des produits de marque, puisse déchirer ses précieux jeans Levis ou ses Wrangler et les porter avec de vieilles vestes plutôt qu’avec les chemises de boucher en vigueur dans la scène blues. Le punk n’était pas encore une tendance et je compris ce que lancer une mode voulait dire.
De 1979 à 1981, les punks durent se passer d’une scène qui les aurait protégés des attaques. Ils pouvaient toujours se singulariser, ils faisaient partie d’une communauté socialiste dont les citoyens apprenaient l’obéissance à leurs enfants perdus à coup de pieds aux fesses, en leur souhaitant parfois d’”être gazés”. Une communauté impuissante cependant, car elle ne pouvait répudier ceux qui s’étaient déjà, d’eux-mêmes, exclus de la société. Provoquer ce sentiment d’impuissance et déclencher cette fureur de manière isolée était dangereux et rarement compatible avec le droit à l’intégrité physique, mais naturellement cela faisait aussi partie du plaisir. Et ce plaisir, c’était de voir à quel point il était agréable et positif d’être considéré comme un élément “ennemi-négatif” et d’être un grain de sable dans les rouages de la dictature. Les punks de l’Est ne défiaient pas seulement la tradition. Ils s’opposaient à une construction idéologique restée à jamais désincarnée, car la vie entière lui donnait tort. Notre État idéal n’avait pas du tout prévu dans son grand programme que des adolescents mépriseraient les uniformes des jeunesses socialistes ou la mode prévue pour eux. Et encore moins qu’ils créent leur propre style excentrique et n’entrevoient “pas d’avenir” dans ce “trop d’avenir”. La jeunesse n’était pour lui qu’une ressource naturelle destinée à apporter de la chair fraîche au Parti, dans un rôle rejoué jusqu’à l’écœurement. Forcés de s’aligner, quelques-uns sortaient du rang et tentaient constamment de dépasser les limites d’un système dont ils refusaient le contrôle. L’atterrissage d’extraterrestres – au fond, c’est seulement ce à quoi on peut comparer l’effet qu’eurent les premiers punks sur la Nomenklatura et la population est-allemandes dans les années 79-82. Et ce ne serait même pas exagéré. Avec leur look criard au milieu des couleurs anémiques de l’Est, leurs manières désinvoltes et agressives et leur musique chargée d’énergie (qui balayait les ballades rock est-allemandes diffusées par les autorités), ces gamins de 16 à 18 ans provoquaient un système qui voulait contrôler tout et tout le monde et qui se retrouva au final complètement dépassé. Les punks étaient fondus dans la masse des jeunes socialistes mais, dans leur tête ils n’en faisaient déjà plus partie. Ils s’étaient déjà expatriés. Ils se conduisaient exactement comme s’ils étaient à Londres, comme s’ils avaient déjà fui le pays, comme s’ils étaient déjà des “réfugiés de la République”. Ainsi on devenait un étranger dans son propre pays, où le seul “autre”, c’était le soldat russe qui restait enfermé dans sa caserne. La RDA a toujours gardé une mentalité provinciale. L’étranger n’a jamais fait partie de son quotidien. Amener l’étranger dans cette province – il y avait là un grand danger mais aussi un plaisir monstrueux.
Au début, même l’opposition fut désorientée par les punks, autant que pouvaient l’être le Parti et ses fonctionnaires. Il n’y eut jamais de véritable alliance. D’abord parce que le punk signifiait la fin de tout dialogue avec le pouvoir – dialogue que les groupes d’opposition s’imaginaient capables de cultiver avec une distance critique. Ensuite parce que les têtes de l’opposition étaient bien souvent faites dans le même moule bétonné que celles du système qu’elles prétendaient combattre.
Mon premier contact avec un acte de résistance politique eut lieu lors de ma première année d’apprentissage, dans un camp paramilitaire de la GST [9]. Le programme d’entraînement prévoyait le maniement d’une kalachnikov. En 1981, le mouvement d’opposition pacifiste est-allemand avait émis le mot d’ordre “de l’épée aux socs de charrue”. Quelques jeunes dans mon peloton refusèrent donc de prendre les armes et bientôt tout le peloton fit de même. À l’exception des quelques punks présents. Nous, on ne pouvait pas comprendre une chose pareille, et on a ramassé d’instinct les kalachnikovs, par curiosité. Cela ne nous aurait jamais traversé l’esprit de vouloir transformer une épée en un soc de charrue. Les bons petits camarades pacifistes ne nous ont pas compris non plus et nous ont condamnés comme un seul homme, en secouant la tête dans un même mouvement. La résistance politique m’apparut immédiatement comme une pression de groupe et, par conséquent, on a décidé de refuser de refuser. On avait chacun droit à trente-deux coups : seize tirs simples et seize en rafales continues. Nous avons immédiatement et tout naturellement – tiré à tort et à travers les trente-deux coups en continu, ce qui déclencha une pluie de cris d’orfraie et notre renvoi immédiat dans le plus grand déshonneur. Cet événement marqua la fin de ma carrière militaire, puisque la NVA ne fit heureusement jamais partie de mon CV. Ce refus de servir dans l’armée ne fut pas non plus motivé par des convictions pacifistes et je n’ai d’ailleurs jamais prétendu le contraire. Je ne me suis jamais abrité derrière un pacifisme à la mode, qui m’excédait d’ailleurs tout autant que la tiède complainte anarchiste de bon nombre de punks. N’avoir aucune conviction pouvait être salvateur en RDA. Ce qui influença de manière décisive mon refus ne fut certainement pas le snobisme politiquement correct d’un quelconque contestataire en chef, mais la rencontre d’un malfrat polonais qui était loin d’incarner un modèle de political correctness*. Je fis sa connaissance en marge d’un festival de cinéma d’avant-garde à Varsovie. Il me fit comprendre à mots couverts qu’il avait passé huit ans dans les geôles de la RDA pour contrebande de devises. Parler de la taule en RDA nous amena à parler de l’armée du peuple. Je lui dis la terreur que représentait pour moi le fait de devoir porter l’uniforme et d’être encaserné dans un devoir d’absolue obéissance. Sa réaction fut sobre mais saisissante. Il me mit la main sur l’épaule et prononça une phrase qui fut décisive par la suite : “Si tu ne veux pas rejoindre l’armée, tu n’as pas à le faire.” Cette phrase, si élémentaire qu’elle fût, me donna la confiance nécessaire pour m’assurer de ne jamais avoir à souffrir un an et demi sous les drapeaux et je fis alors tout ce qui était en mon pouvoir pour que cela n’arrive jamais. La révolte des pacifistes étroits d’esprit ne pouvait pas me donner une telle assurance. Car à la fin, c’étaient eux, les fous de la gâchette. Pour les punir, on les a assignés aux corvées de vaisselle et de ménage dans une caserne voisine. Quand ils furent embarqués de force dans les camions, le ridicule de leur protestation bruyante était manifeste.
Quel était l’intérêt de refuser les armes si l’on ne refusait pas l’humiliation consécutive à ce refus ? Je connus cette vague attitude contestataire après ma période punk dans les groupes d’opposition, en particulier au sein de “l’Initiative Paix et Droits de l’Homme”. Interrogés sur leur programme politique, les membres de ces cercles fantasmaient toujours quelque chose de l’ordre d’un “pluralisme socialiste” auquel ils aspiraient. Un oxymore, un concept qui se mordait la langue.
C’était en 1987. Faire partie de la scène punk n’était plus une aventure mais un risque calculé. Pour moi c’était du passé depuis trois ans. Encore que. Ce passé m’avait appris à rester sans foi. J’avais conservé un scepticisme qui me protégeait de toute illusion. Ne plaçant plus aucun espoir de changement dans une résistance qui cherchait un dialogue avec le pouvoir, je ne me trouvais plus seulement en opposition avec les dirigeants séniles de l’État, mais avec l’opposition elle-même. Contre un cercle de pseudo-intellectuels qui agissaient certes de manière subversive les uns contre les autres mais oubliaient surtout de se regarder dans un miroir. Cette RDA n’avait aucune perspective, d’où qu’on la regardât. L’avenir s’étendait devant elle comme une place de défilé déserte. A ses marges, dans les coulisses, des choses décisives se passaient. Le caractère explosif du punk en RDA provenait de la tension entre la dictature et la contre-culture. Cette tension connut bien sûr des aléas. Nombre d’anciens punks continuèrent de l’alimenter autrement, à travers des activités artistiques, aventureuses ou criminelles. “L’énergie ne peut pas se perdre.” C’est tout du moins ce que disent leurs biographes et ce qu’énonce la première loi de thermodynamique.
Henryck Gericke
* En anglais dans le texte.
***************************************************************************************************
BERND STRACKE SE SOUVIENT DE LA TRAHISON DE SON AMI IMAD, UN IM [10] INFLUENT. PANKOW L’A INTERVIEWÉ EN 2005.
Comment as-tu réagi quand tu as appris qu’Imad était un IM ?
J’ai été le premier à l’apprendre car j’ai été le premier à aller voir mon dossier à la chute du Mur. Il n’y avait pas qu’Imad, il y avait aussi Zappa qui jouait de la basse dans Wutanfall, donc il y a eu en fait deux IM dans deux de mes groupes.
Ça a d’abord été un choc, évidemment. Je ne m’y attendais pas du tout. Ni de l’un ni de l’autre. Dans mon dossier, il y avait énormément de rapports. Ça a été un coup de massue. Imad avait tout raconté sur nous, tout ce qu’on faisait. Tout. Et j’ai appris que certaines arrestations juste avant un concert par exemple, avaient eu lieu à cause de lui... Et puis il avait raconté en détail le mariage de Colonel... Tout... Il y avait aussi certains témoignages de Berry, un IM de Berlin, un autre bon ami, qui n’a pas fait de prison non plus. Et avec tout ça, la Stasi savait absolument tout. Chaque IM pouvait avoir l’impression qu’il avait dit le strict minimum mais, en fait, en recoupant les témoignages de 14 IM, forcément la Stasi avait une vision d’ensemble. Quand on lit tout ça, on se dit que le système fonctionnait bien et c’est assez... atroce.
Tu as revu Imad par la suite ?
Imad est venu chez moi peu de temps après, quand il a appris que avais lu mon dossier. Il a essayé de se justifier. Il m’a dit qu’il avait juste tenté de nous éviter des ennuis, qu’en fait il ne disait rien sur nous, qu’il ne rapportait que sur les imbéciles... Déjà je ne comprends pas de quel droit il se permet de distinguer les imbéciles des autres, ne l’ai pas du tout accepté. J’ai parlé assez longtemps avec lui mais, pour moi, c’était digne d’une agression. C’était une situation vraiment... étrange. J’ai décidé de rendre tout ça public. J’ai contacté un fanzine punk, le zap, dans le sud de l’Allemagne, et j’ai donné une interview avec un autre ancien bon ami d’Imad. J’ai sorti tous les documents de mon dossier pour prouver ce que j’avançais, et le zap les a publiés, et c’est en partie pour cette raison qu’Imad est venu chez moi pour tenter de se justifier.
Tu n’as plus de contact avec lui ?
Non, et je n’en ai pas du tout envie. Par la suite, j’ai appris des choses encore pires. Jusque-là, je n’avais lu que mon dossier, ça se limitait à mon histoire et à quelques autres. Mais j’ai une amie historienne qui a fait des recherches à Leipzig. Et elle, elle a découvert tout ce qu’il a fait, toutes les preuves, le fait qu’il a reçu de l’argent, tous ses rendez-vous avec la Stasi, l’influence qu’il avait... Je ne sais toujours pas s’il a fait ça pour assurer sa carrière... En tout cas, c’est ce qui s’est passé dans les faits. Il n’a jamais été à l’armée. Il n’est jamais allé en prison. Là où tant d’autres ont arrêté après l’armée ou la prison... Lui ça ne lui est jamais arrivé. C’était vraiment... horrible. Je ne sais pas du tout comment il le voit aujourd’hui. Je m’en fous de toute façon. Rien que d’y penser, ça me donne la nausée.
***************************************************************************************************
JE ME SUIS EFFORCÉ DE RÉINTÉGRER LES GENS DANS LA SOCIÉTÉ. INTERVIEW DE JÜRGEN BRESKI.
Jürgen Breski était un agent opérationnel “spécialiste” du mouvement punk de Berlin-Est. Pankow l’a rencontré en 2005.
Comment avez-vous été amené à travailler pour la Stasi ?
J’ai été recruté à 18 ans dans le régiment de garde Feliz Jachinsky [11]. Quand on obtient la promesse qu’on va rester à Berlin et qu’on va rentrer chez soi tous les soirs, on ne dit pas non au service militaire. Et à un moment donné, il s’est trouvé qu’on m’a intégré dans une unité opérationnelle. A l’époque, on se retrouvait à 20, 21 ans dans une unité opérationnelle et c’est comme ça que je me suis retrouvé dans la division 202.
Où exactement, dans la division 20 ?
Dans la division 20, il y avait différents services. J’ai atterri dans le service [12] qui était chargé entre autres du travail auprès de la jeunesse. Il était chargé de veiller à ce que les supporters de foot restent tranquilles et il s’occupait aussi de ceux qu’on appelait les groupes marginaux.
Dont les punks faisaient partie ?
Dont les punks faisaient partie, oui. Avec la scène heavy métal, les skins et toute la scène d’extrême droite, dont les supporters de foot. Tout ce qui se développait à l’époque, en fait.
Quand la Stasi a lancé l’offensive contre les punks, vous étiez donc assez jeune ?
Oui.
Quel âge aviez-vous ?
21, 22 ans.
Est-ce que votre âge a joué un rôle dans votre intérêt pour ce domaine en particulier ? Comment ça s’est passé, comment avez-vous été amené à faire ce travail ?
Eh bien... Il y avait bien sûr l’influence de la musique qui arrivait de partout, par plein de médias différents. Et c’était tout à fait normal qu’on s’en occupe à l’époque. Et puis, l’un des premiers lieux de rassemblement punks à Berlin, c’était Alexanderplatz. Et vu la symbolique d’Alexanderplatz, il y avait déjà eu tout un travail préliminaire pour identifier les punks.
Que représentait Alexanderplatz ?
Alexanderplatz, c’était le cœur de la RDA . De tous points de vue. D’un point de vue politique, évidemment et puis... Alexanderplatz était le plus haut lieu de tourisme des citoyens est-allemands. Et l’appareil de sécurité voyait d’un très mauvais œil que des gens qui ne voulaient manifestement rien avoir affaire avec la République se retrouvent sur cette place symbolique.
Et comment ça s’est passé ? Je veux dire, soudain on s’aperçoit que des extraterrestres bourlinguent sur Alexanderplatz et qu’est-ce qu’on fait ?
Et bien d’abord c’est la police qui s’en est aperçue et ils ont réagi de façon très incertaine parce qu’ils ne savaient pas du tout ce qu’ils devaient entreprendre ni même ce qu’ils devaient en penser. Et il faut ajouter qu’il y avait tout un tas de personnes âgées sur Alexanderplatz qui ne comprenaient rien à toute cette histoire... Et donc des actions ont été tentées, on a tenté par exemple d’interdire l’accès à Alexanderplatz, ce qui, évidemment, n’était pas vraiment réaliste.
Et c’est là que la Stasi est intervenue ?
Eh bien la Stasi en a peut-être pris connaissance à ce moment-là mais elle n’est intervenue que quand il se passait des choses plus intéressantes comme des concerts, des événements plus importants... Elle est intervenue pour tenter de... d’endiguer le phénomène de... faire en sorte que le problème en tant que tel soit... de réintégrer les gens dans la société, de reprendre un peu d’influence sur eux, pour qu’ils se comportent dans le sens de la société. C’était après tout le but de toute l’opération. Et plus tard, quand il y a eu des délits, on a bien sûr poursuivi et demandé des comptes à ceux qui avaient enfreint les lois de la RDA.
Quels étaient ces délits, par exemple ?
Eh bien on sait tous que, pendant les concerts, les paroles n’étaient pas spécialement tendres avec l’État et donc l’infraction pouvait être “le dénigrement public de l’État”. Il y avait aussi le délit d’“asociabilité”, vous savez bien que cela existait dans le code pénal de la RDA , et c’était une notion qu’on pouvait interpréter très librement. Et puis il y avait bien sûr tout ce qui entrait dans le cadre du vandalisme.
Qu’est-ce qui attire dans un tel travail ?
Que veut dire attirer ? Bon d’abord, c’était la même génération et on avait la mission de reprendre un peu d’influence sur ces personnes, pour que tout ça évolue dans le sens du système politique... Et puis, les groupes marginaux dans leur ensemble étaient une provocation pour le système. Et donc en fait on a essayé d’agir dans ce sens et de désintégrer ces mouvements. Et pour ce faire, on a utilisé les moyens des services secrets. Comme tous les services secrets, on avait nos sources, on récoltait des informations, et on tentait de répandre de la désinformation. Et quand des délits étaient constatés, ceux qui les avaient commis étaient poursuivis et parfois enfermés... Mais ça a quand même été plus ou moins l’exception.
Qu’est-ce qui était motivant dans ce travail ?
Eh bien, on est jeune, mais on remarque que l’on se fait vite une place dans la hiérarchie, que ce qu’on réalise joue un rôle dans la société. Qu’il y a une forme d’acceptation, de reconnaissance sociale pour ça. C’était la première motivation. Pour moi en tout cas.
Comment se manifestait cette reconnaissance ?
Eh bien, on remarquait à certains détails, qu’on prenait très en considération les informations qu’on avait obtenues, qu’on avait quelque part une certaine importance politique dans la hiérarchie.
Est-ce qu’on ne pourrait pas simplement parler de pouvoir ?
Oui. Non, je ne parlerais pas directement de pouvoir. Je dirais vraiment une importance politique.
Ce sont vos parents qui vous ont influencé politiquement ? Ou votre conscience politique s’est développée pendant votre scolarité ?
On est toujours influencé politiquement par ses parents. Mais ça s’est sûrement affirmé à l’école et après le bac, oui.
Revenons aux punks. Vous m’avez parlé d’un plan de mesures destinées à désintégrer le mouvement ou en tout cas à chasser les punks des rues. Comment ça s’est mis en place ? Comment ça se passait concrètement ?
Eh bien on connaissait les punks de nom grâce au travail que menait la police du peuple sur Alexanderplatz mais je ne crois pas que les punks importants auraient commis l’erreur de se faire contrôler. Mais grâce à nos informateurs, on regardait la personnalité de chacun et pour chacun on essayait de trouver quelque chose d’adapté. Le but c’était la désintégration de cette scène d’une manière ou d’une autre. Et comme c’étaient tous des jeunes, on pouvait mettre en place des mesures ciblées, par exemple... Quand des groupes de musique se formaient, on pouvait incorporer les membres dans la NVA [l’armée] et sur le court terme ils ne pouvaient plus donner de concerts. Ou ce genre de choses... Et puis, oui, pour certaines personnes on regardait d’un peu plus près, pour ce qui concernait éventuellement la preuve qu’il y avait un délit, comme je l’ai déjà dit. Et quand ça marchait, quand ce genre de choses s’avérait, les gens étaient incarcérés, mais je crois que pour le plus gros d’entre eux c’est l’incorporation ciblée dans l’armée qui a joué un rôle significatif. Et on essayait aussi de mettre hors du circuit les marginaux par ce qu’on appelait les organismes d’éducation, les professeurs, les associations sportives, ce genre de choses.
Vous avez un exemple en tête ?
Un exemple classique, c’est la messe blues, en 1983 [13]. Comme c’était un événement très important, toutes sortes d’unités s’en étaient occupées, il y avait beaucoup de sources à l’intérieur et elles ont entendu les paroles et les ont rapportées à la hiérarchie, si bien qu’il y a eu une réaction.
Quelle a été la réaction ?
Eh bien on a su qui était monté sur scène et donc on est allés les chercher très tôt le matin, on les a mis en garde à vue et ils ont été interrogés. On avait 24 heures pour ces interrogatoires, on les utilisait de manière intensive, bien sûr. Et quand il y avait des contradictions, ça pouvait aller vite, parce que les gens se contredisaient, ou en disaient trop. Ils ont en l’occurrence raconté ce qu’ils ont chanté et finalement ils se sont mouillés eux-mêmes à tel point que ça a suffi pour le procureur.
C’était quel groupe ?
Le groupe s’appelait... Namenlos.
Et qu’est-ce qui s’est passé ensuite pour Namenlos ?
En ce qui nous concerne, pour l’unité opérationnelle, l’histoire s’est terminée quand un mandat d’arrêt a été établi en vue d’une détention provisoire. A partir de ce moment-là, si plus rien de significatif ne se produisait, on n’avait plus aucun rapport avec l’histoire. Je n’étais pas du tout au courant de ce qui pouvait se passer après et donc on n’a pas suivi l’affaire.
Vous n ’étiez pas mis au courant des condamnations ?
Non, pourquoi ? Oh on aurait pu être mis au courant de l’issue du procès, mais... On n’avait pas vraiment le temps de nous en occuper. On ne s’en préoccupait pas, parce que de toute façon on avait des méthodes de fichage et donc, si les gens réapparaissaient, on avait un papier sur le bureau pour nous en informer.
Comment ça se passe concrètement d’ailleurs ? On trouve une note sur son bureau et dedans il est écrit “tel groupe a chanté ci ou ça” ? Et ensuite, quelle est la procédure ?
Eh bien dans ce cas précis, la Sécurité d’État avait déployé les grands moyens et la messe blues était observée de près par des gradés. Et quand ils entendaient ce genre de paroles ils avaient ordre d’en faire part, et ils l’ont fait. A la fin, si cela suffisait, la procédure hiérarchique classique était lancée et ils étaient référés à la division d’enquête et c’est elle qui décidait de faire ci ou ça. Et voilà, pour nous, c’était fini, le reste c’était à la division d’enquête de s’en occuper.
Comment ça s’est passé en l’occurrence ? Vous vous en souvenez ?
Ah mon Dieu, ah oui. Le risque, chez les jeunes punks, c’était qu’ils changent d’endroit du jour au lendemain. Donc, évidemment, on les a observés pendant 24 heures pour être sûrs de pouvoir les trouver le lendemain à 6 heures précises. C’est ce qui s’est passé pour trois des quatre, si je me souviens bien. L’un d’entre eux nous a quand même filé entre les pattes et on ne l’a retrouvé qu’à midi. Ensuite ils ont été amenés pour interrogatoire, dans la division d’enquête.
Vous ne meniez pas les interrogatoires ?
Non, on n’avait rien à voir avec ça. Comme je l’ai déjà dit, la Sécurité d’État était une maison très compartimentée. L’unité opérationnelle ne faisait que du renseignement classique. Il y avait une troupe d’observation, ceux qui faisaient les arrestations et ceux qui interrogeaient : c’était la division d’enquête. Là, il y avait des interrogateurs professionnels entraînés et formés psychologiquement.
Vous connaissiez leurs méthodes ?
Non, mais il ne se passait rien de grave. Bien sûr, tout ça, c’était une guerre psychologique. Et il ne faut pas oublier que celui qui était interrogé était tout seul, qu’il avait 20, 22, ou 24 ans et qu’il n’avait aucune expérience de ce genre de choses. Et ces méthodes psychologiques marchaient bien mieux que si un avocat avait été présent. Si, en l’occurrence, il y avait eu un avocat en l’occurrence tout serait tombé à l’eau.
Mmh...
A ce moment-là, si. Ils se sont contredits et ont raconté tout ce que les interrogateurs voulaient entendre.
Vous avez en tête d’autres groupes ?
Il y en a eu une quantité, si vous me donniez un nom je pourrais vous en parler mais directement comme ça... C’est difficile, je ne m’y intéresse plus depuis cette époque...
Quelle musique écoutiez-vous personnellement ?
Rien en particulier, des choses grand public, tout ce qui passait.
Et vous connaissiez la musique punk, ce qui se faisait, à tel et tel moment ?
Bien sûr. Bien sûr.
Comment faisiez-vous pour être à la page ?
On ne devait pas forcément être à la page pour la musique. Ça nous aurait fait trop de travail ! On s’occupait des gens. Et des paroles, du fond.
J’ai ici une copie du dossier de Namenlos, “traitement d’une formation punk illégale désintégrée par des mesures pénales”. L’objectif est très clair, là ? On a un objectif et on trouve le moyen de le réaliser ?
Non, ça c’est juste une transposition purement technique faite a posteriori. Normalement cela ne se passait pas comme ça. Le processus opérationnel était mis en marche quand il y avait un soupçon de délit, pour le prouver. Normalement on établissait le soupçon avant et on n’établissait pas la procédure a posteriori, mais dans ce cas précis tout est allé très vite, le processus est allé plus vite que la procédure écrite. Tout a été fait a posteriori et donc l’objectif, le moyen et la réalisation n’ont fait qu’un...
Mmh. Je lis encore “chercher les facteurs objectifs et subjectifs pour caractériser l’infraction”. Qu’est-ce que cela veut dire ?
Ça, c’est une formulation purement juridique. Il y avait les infractions objectives, certaines paroles avaient été chantées, et les subjectives, il fallait les prouver, il fallait prouver qu’ils l’avaient fait consciemment. C’était la préméditation. Les facteurs subjectifs devaient prouver la préméditation.
Et là, magnifique, j’ai l’objectif de l’opération : “Le ministre en charge de la Sécurité d’État a ordonné qu’on fasse preuve de rigueur envers le mouvement punk. Que soit mis un terme à son expansion”
(Rires). Oui, le ministre n’était plus tout jeune. Et quand des images ou n’importe quoi du genre le choquait, il s’énervait et il ordonnait de la rigueur et c’était plus ou moins un appel à intensifier les recherches pour élucider les délits, pour faire disparaître les gens de son champ visuel. C’était comme ça qu’il fallait le comprendre.
Et là : “Recherche d’informations pénales significatives en vue d’effectuer des emprisonnements”. Donc on peut quand même dire, en dehors du délit d’asociabilité, qu’il y a eu une sorte de criminalisation des punks, non ?
Non, je ne crois pas qu’on puisse dire ça. Je ne parlerais pas de criminalisation dans ce sens-là, non. Dans ce cas, c’était plutôt “essayons de voir si on ne trouve pas quelque chose”, là où d’habitude, on n’aurait rien fait.
Bon. “En l’absence de motifs d’inculpation, organiser un recrutement de sources ou de ‘sources leurres’ pour faciliter les mesures de désintégration dans le mouvement punk”.
Oui.
Qu’est-ce que ça veut dire ?
Ça veut simplement dire qu’il fallait toujours essayer de trouver de nouvelles sources, car l’âge des sources ou même des sources appâts n’était pas très élevé dans ce mouvement de jeunesse... Et si on ne pouvait pas trouver de motifs d’inculpation mais qu’on avait déjà parlé avec la personne, on essayait de la recruter comme source... Parce que, quand on avait déjà tenté d’exercer des pressions sur une personne, c’était tout à fait possible de la recruter comme IM... Il y avait des gardes à vue utilisées pour ça.
...Où vous mettiez la pression pour recruter des sources ?
Oui bien sûr. C’était monnaie courante. Mais c’était un genre de pression psychologique. Il n’y avait aucune menace de violence physique ou quoi que ce soit de ce genre. On leur faisait comprendre qu’il n’y avait pas d’alternative. S’il y avait déjà une situation de peur, si la personne ne savait pas si elle allait ou non être libérée, et bien on disait : “raconte- nous un peu et on te libère”. Une main lavait l’autre, en quelque sorte.
Les sources avaient-elles une autre fonction, en dehors de leur mission d’information ?
Oui, bien sûr. Elles étaient là pour propager de la désinformation aussi. C’était tout à fait normal et c’était une manière d’avoir de l’influence sur le cours de certains événements. Certaines petites manifestations se passaient dans le calme, ce qui n’aurait pas été le cas si elles avaient eu lieu spontanément, sans un contrôle préalable. Certaines petites excursions étaient contrôlées par les sources à travers ce qu’on appelait “les sources d’influence”. Par exemple, vous vous souvenez du dépôt de gerbe organisé sur la stèle commémorative d’Erich Mühsam [14] ? La stèle se trouvait plus ou moins devant la porte du commissariat d’Oranienburg et quand il y avait 30 ou 40 punks rassemblés devant la porte du commissariat, en général, cela ne se passait pas du tout dans le calme et cela aurait dégénéré si on n’avait pas pris le contrôle de la situation. Mais quand on était sûrs qu’il y avait suffisamment d’informateurs qui travaillaient dans le sens voulu, on pouvait dire “okay, on laisse faire”.
Mais justement, dans ce cas précis je crois me souvenir que beaucoup de gens n’ont pas pu descendre à la gare d’Oranienburg car elle était truffée de policiers ?
Oui, mais il n’y a pas eu de problème, la manifestation a quand même eu lieu. Et dans le calme. Il y a toujours des petites choses, tout le monde n’a pas pu s’arrêter partout, c’est normal quelque part dans ce genre de situation.
Est-ce que les fausses sources, les “sources leurres” comme vous dites, n’étaient pas là aussi pour répandre de la désinformation ?
Nous avons utilisé toutes sortes de désinformation, oui, mais ça fait partie du travail classique des services secrets. Oui et donc on disait que celui-ci ou celle-là était un IM, ou qu’il allait se passer ci ou ça. On envoyait les gens sur de fausses pistes, à travers les sources. Bien sûr.
Quelles étaient vos relations avec l’Église ?
Déjà on ne peut pas parler directement de l’Église. Il y avait des individus isolés qui s’occupaient des punkies [sic], ils leur proposaient des locaux où ils pouvaient écouter ou faire leur musique, il les prenaient un peu sous leur aile... C’est clair que ça passait mal du côté de l’État. Vous connaissez les relations entre l’Église et l’État à l’époque... Il y avait des espaces libres qu’on tolérait. Eh oui... et on est intervenus, quand l’État a dit... que ces espaces étaient devenus trop grands. Et à la fin, les années suivantes, on a vraiment essayé de reprendre de l’influence sur la situation. L’“Église d’en Bas” n’a pas éclaté pour rien...
Pourquoi elle a éclaté ?
Il y avait différents intérêts dans le groupe. Et c’était facile d’utiliser ces différents intérêts.
Est-ce que vous avez aussi utilisé ces stratégies de division auprès des punks ?
On a fait de la désinformation partout, oui mais, vous savez, c’est une méthode classique des services secrets. Quand on a différentes sources, on peut faire en sorte qu’elles entrent en conflit, sans que ni les uns ni les autres ne le sachent, il faut le souligner. On fait en sorte que des positions contradictoires soient représentées et que le groupe éclate pour cette raison... Tout simplement parce qu’il y a soudain des intérêts différents en jeu. Deux personnes se disputent et le reste prend parti. C’est une méthode de désintégration classique.
Et ici je lis : “Enlever ses gants de velours en cas d’indocilité manifeste, nous n’avons pas de raison de nous comporter de manière tendre avec ces individus.”
Oui, qu’est-ce que je peux ajouter, là ? Tout est dit, là...
Oui mais cela veut quand même dire...
Cela ne veut pas dire qu’on allait boire un café avec eux, c’est sûr. Mais cela ne voulait pas dire qu’on allait ou qu’on devait les frapper ou...
J’ai quand même l’impression, non (rires) ?
Mais cela ne s’est pas passé.
Bon. En tout cas, ça a été écrit comme ça, en conclusion, dans le dossier de Namenlos. Et cette... histoire avec Namenlos, ça a été rédigé par vous aussi. Tout est dans le dossier.
Oui...
Il y a votre nom, là.
Ah oui, peut être qu’il y a mon nom parce que, théoriquement, un collaborateur devait toujours signer à la fin et donc mon nom a peut-être été enregistré... Mais tout cela a été écrit plus de 24 heures après l’arrivée des suspects et en théorie on ne pouvait pas travailler 36 heures d’affilée donc... Je ne sais plus. Tout à l’heure, je crois avoir vu la signature de mon chef de l’époque, mon chef de service, donc je suppose que c’était lui en fait.
Bon. Vous, personnellement, vous restiez au bureau ou vous sortiez ?
Les deux. Les sources ne venaient pas à la Stasi pour faire leur rapport. Donc on allait dans la rue, et parfois aussi on allait près d’un événement ou d’un concert pour se faire une idée de ce qui se passait.
Vous aviez quelle allure à l’époque ?
J’avais l’air d’un type banal. Il y avait des jeans à l’époque. Donc un type banal en jeans.
Et vous avez participé à des concerts ou des événements punks ?
Non, non, ou alors de loin. Il ne fallait pas présumer de ses forces, il y avait quand même une limite (rires).
C’est-à-dire ?
Quand il y avait 20 gars avec une crête rassemblés quelque part, je ne pouvais pas me fondre dans la masse !
Ça n’aurait pas été une idée de vous faire une crête ?
Je ne crois pas.
Comment ça se passait quand il y avait des concerts ailleurs qu’à Berlin ? Comment se passait la collaboration avec les sections régionales de la Stasi ?
Ça, si vous voulez, ça se passait exactement comme pour les matchs de foot internationaux. Chaque section était chargée de son propre groupe, qui relevait de son propre périmètre de responsabilité, de son propre district. Et donc Berlin était chargée des Berlinois, qu’ils soient à Berlin ou ailleurs. Exactement comme pour les Anglais et les hooligans. Évidemment, ça ne fonctionnait pas toujours très bien mais quand même... Il y avait des consignes, quand quelque chose d’important se passait et que cela relevait de notre circonscription, on disait “on annule” et “vous devez empêcher les gens de venir à Berlin”. Et donc quand on avait les informations correspondantes, on envoyait la police des transports de la gare qui rassemblait les gens et les renvoyait chez eux après avoir contrôlé leur identité.
Combien de temps duraient ces interpellations ?
Dans les cas classiques, une heure, une heure et demie...
J’ai le souvenir que cela durait plus longtemps...
Ah bon ? Par exemple je me souviens d’une action que j’avais moi-même menée à la gare de Schöneweide, je crois que ça avait duré au maximum une heure et demi ou deux grand maximum. Pour moi, cela ne durait jamais longtemps parce qu’on voulait rentrer chez nous. On ne voulait pas empiéter sur notre temps libre, on ne travaillait pas 24 heures sur 24 non plus...
Mais je me souviens qu’on devait signer un protocole...
Seulement dans certains cas. Seulement dans certains cas. Dans bien des cas on disait juste : “dites-nous qui sont ces gens”... Et les protocoles, c’était juste quand on disait : “on s’intéresse à cette personne, demande-lui telle ou telle chose et fais signer”.
Mmh...
Quand on faisait signer un protocole, c’était vraiment qu’on avait un intérêt particulier.
Revenons aux mesures répressives. En dehors de l’incorporation dans l’armée, je lis ici qu’il y avait beaucoup de motifs délictueux pour sanctionner les punks. Par exemple, “atteinte aux règles de la vie commune ”, à côté des délits de “vol”, de “vandalisme”, de “rassemblement intempestif ”, de “résistance aux autorités”, de “dénigrement public de l’État”, de “non respect des prescriptions légales”... Ça aussi c’était des motifs récurrents pour sanctionner les punks...
Tout ce que vous avez cité ne constituait pas un délit...
Qu’est-ce qui ne constituait pas un délit par exemple ?
Par exemple le rassemblement intempestif, ce n’était pas à ma connaissance un délit en RDA. Et perturbation des règles de la vie commune, ou comment dites-vous ? Ce n’était pas un délit non plus.
Et la résistance aux autorités ?
Ça oui, c’était quand un policier demandait quelque chose et que la personne interpellée opposait une résistance active ou qu’elle essayait de fuir...
Et là : “ceux qui choquent, provoquent le public par leurs comportements et expriment leur révolte et leur besoin de se faire remarquer”.
Oui (rires). On ne parlait pas le même allemand il y a vingt ans.
Et là : “Pour ces différents motifs, des mesures pénales, disciplinaires et éducatives ont été prises au cours de l’année 1983 contre les membres de 5 des 17 formations punks existantes. Elles ont abouti à la désintégration des 5 formations.”
C’est tout à fait possible. Je ne me souviens pas trop mais oui, on comptait toujours tout ce qu’il était possible de compter.
Cela faisait partie de la réalisation des objectifs du plan ?
Oui, il fallait réaliser des objectifs, ce n’était pas si horrible mais il y avait une pression, oui... Et comme partout en RDA on comptait tout ce qu’on pouvait compter...
Pour réaliser les objectifs ?
Non, en général je veux dire, c’était comme ça dans toute la société. Les objectifs devaient être réalisés à 99, 100 ou 105 %, etc.
Et si on prenait du retard, il fallait trouver des gens pour se rattraper ?
Non, non, ça non, mais chacun avait son “plan de travail”, comme on l’appelait, oui. Et dedans il était décrit de manière réaliste ce qu’on pouvait réaliser mais toujours en fonction de ce qui existait... par exemple je ne sais pas... par exemple il fallait développer un ou deux processus opérationnels mais parmi ceux qui étaient déjà en cours... Il y avait ce genre de choses dans ce qu’on appelait le plan de travail annuel des collaborateurs, oui.
Et on envoyait aussi les punks à l’Ouest pour s’en débarrasser ? Ça faisait aussi partie de ces mesures, non ?
Ces mesures-là venaient d’un tout autre service. Et ça se faisait régulièrement à l’occasion de je ne sais quels anniversaires de la République... On regardait qui avait fait une demande de visa de sortie, qui avait quelque chose à dire et qui avait déposé une demande... Mais cela n’était pas de notre ressort direct à nous.
Mmh...
C’était des à-côtés, si on faisait ça, ça entrait dans le cadre d’un plan d’action plus général.
Quelles étaient les relations entre les différents organes, justement ? Là, par exemple, j’ai une note d’information de la Stasi adressée au gouvernement, aux plus hautes instances du Parti.
Comme je l’ai déjà dit, le but c’était vraiment la réintégration des marginaux, et ça, la Sécurité d’État ne pouvait pas le faire toute seule... Et donc c’était le rôle de ce qu’on appelait à l’époque les organismes d’éducation. Et ce genre de notes, c’était juste destiné à informer les autorités de ce qu’il se passait dans la ville. Je veux dire, c’est tout à fait habituel que les services secrets informent leur gouvernement sur ce qu’il est susceptible d’ignorer. Et grâce à ce genre de documents, les dirigeants pouvaient dire “ok, on va regarder plus attentivement ce qui se passe dans les établissements scolaires... On va influencer les professeurs, les organisations sportives, ce genre de choses”... Pour qu’il y ait aussi une désintégration de ce genre de groupes dans la société elle-même.
En juin 1984, il y a eu un important festival de jeunesse à Berlin, un rassemblement de la jeunesse “officielle”, en quelque sorte, la réserve naturelle du Parti, la jeunesse fidèle à la ligne du Parti. Il me semble qu’il y a eu encore un durcissement à ce moment-là des mesures contre les punks, non ?
Je ne le vois pas comme ça. Déjà, une jeunesse fidèle au Parti, c’était un peu prendre ses désirs pour des réalités. Car il y avait beaucoup de jeunes dont on ne pouvait pas garantir qu’ils étaient fidèles au Parti... Mais oui, on a essayé de prendre le contrôle de la situation. On a parlé à certaines personnes, on leur a dit de ne pas se montrer à tel ou tel endroit. Et donc on a dit “signe-moi ça, ça atteste que tu n’iras pas à tel ou tel endroit”. Et beaucoup de gens l’ont fait. Mais s’il y avait eu un avocat à côté, il se serait tordu de rire, il aurait déchiré le bout de papier !
Mais c’était difficile d’avoir un avocat en RDA...
Oui, oui, c’est un autre problème. Mais c’est juste pour dire qu’il y avait beaucoup de bluff pour obtenir certains résultats.
On raconte aussi souvent que l’issue du procès était déjà décidée avant la tenue du procès, que la justice n’était pas toujours, disons, respectée à 100 % en RDA.
Oui, mais nous, on était les services secrets classiques et, dès que l’affaire était transmise à la division d’enquête, c’était fini pour nous. On n’avait aucune influence sur ce qui se passait après, avec le juge ou le procureur. On n’avait plus aucun rapport avec l’histoire.
D’accord, mais si on dit d’en haut quasiment “on veut se débarrasser de telle ou telle personne”, que vous la trouvez et qu’après on s’en débarrasse avec une mesure pénale...
Oui, d’accord, mais c’était au juge de s’en occuper. Qu’est-ce que je peux dire, moi... Je n’avais pas d’influence là-dessus. Un agent opérationnel ne pouvait pas aller voir tin juge et lui dire “on veut ci ou ça”. Le procureur faisait peut-être un plaidoyer où il disait un truc, je ne sais pas, oui, “celui- là, on veut s’en débarrasser”, peut- être, et là le juge le suivait ou pas...
Est-ce qu’on peut dire qu’à partir de 1983-1984 il y a eu une réorientation de la politique vis-à-vis des punks ?
Oui. Pour moi c’est surtout à cause du resserrement des liens entre les punks et l’Église. Et il y en avait beaucoup plus aussi... Mais, en même temps, leurs liens étaient plus distendus. Ce sentiment d’appartenir au même groupe qui existait au début s’était un peu délité. Mais c’est sans doute tout simplement parce qu’il n’y en avait plus. Les gens n’étaient plus aussi conséquents.
Il y a aussi eu des groupes connus dont les chanteurs ou les membres se sont révélés IM à la chute du Mur...
Oui, oui.
Et comment ça s’explique, ça ?
On ne voulait pas forcément détruire tous les groupes sur la durée. Dès qu’on contrôlait un problème, on pouvait le tolérer. Exactement comme pour ce rassemblement à Oranienburg. Si j’ai la situation sous contrôle je peux laisser faire. Et si j’ai un groupe sous contrôle je peux le laisser chanter...
Et le laisser jouer en public ?
Oui, cela faisait aussi partie du travail de renseignement. Les concerts pouvaient être utilisés pour obtenir des informations.
Comment ça s’est terminé pour vous en 1989 ?
Ça s’est vraiment fini en février 1990. Ça s’est fini d’un coup. On nous a dit “trouvez-vous un autre boulot”. Et donc j’ai repris un commerce et voilà. Ça s’est fini du jour au lendemain.
Et vous étiez triste que ça se finisse ?
Qu’est-ce que ça veut dire, triste... bah... Ça aurait pu continuer comme ça, peut-être... Mais franchement j’ai trop de distance par rapport à cette époque...
Mais à l’époque, on se faisait quand même une idée de sa carrière, de son avenir... Vous aviez quel grade quand vous avez arrêté ?
J’étais premier lieutenant. Mais... J’étais encore jeune, et je ne crois pas que j’aie été obsédé par ma carrière, non.
Qu’est-ce que vous faites aujourd’hui ?
Je suis gérant d’une station service. Ça va, on en vit.
Est-ce qu’on éprouve des remords a posteriori par rapport au travail qu’on a fait ?
Non... De mon point de vue... Non. Moi je me suis efforcé de réintégrer les gens dans la société... On ne peut pas vraiment avoir de regret pour ça, pour un objectif comme celui-là. Mais je suppose que ceux qui ont atterri en prison pour cinq lignes pensent différemment.
Il faut répondre de ce genre de choses, non ?
Oui... Mais qu’est-ce que ça veut dire “répondre de ce genre de choses” ? Je dis toujours “chaque État a ses propres lois”. Et quand le juge dit “la loi est enfreinte”, la loi est enfreinte... Après coup, on peut toujours dire “la loi n’avait peut-être pas beaucoup de sens”. Et c’est sûr que certaines lois étaient, disons, pour rester très poli, fortement exagérées... Et oui, en RDA tout le monde ne pouvait pas dire ce qu’il pensait, mais ça, tout le monde le sait.
Vous l’avez vécu personnellement ?
Oui j’ai été exclu plusieurs fois de l’Université. Mais je suis bêtement retombé sur mes pieds.
J’ai une dernière question : est-ce qu’à force de côtoyer les punks on ne développe pas une certaine sympathie ou tout du moins une sorte de compréhension à leur égard ?
De la compréhension, oui... Mais il y avait quand même une distance. Je pouvais avoir de la compréhension pour certaines choses, et dire “ok, je comprends son point de vue”. Mais cela n’allait pas plus loin.
Vous ne vous êtes jamais dit : “celui-ci ou celle-là aurait pu être un ou une amie”, ou je ne sais pas, “j’aurais pu avoir un rapport avec cette personne dans d’autres circonstances” ?
Non je ne crois pas. Non. Une relation aussi proche non...
Merci beaucoup en tout cas, de nous avoir parlé aussi ouvertement.
Pourquoi pas ? Je peux regarder mon passé en face. Je ne veux rien cacher, en général, je veux dire. J’ai été dans la police secrète, mais j’ai fait un travail relativement ouvert et j’ai eu un objectif clair. Et cela ne me pose pas de problème...
***************************************************************************************************
À L’OUEST IL N’Y AVAIT PLUS RIEN À FAIRE. INTERVIEW DE MARIO SCHULZ
Mario Schulz (alias “Colonel”) était une figure punk incontournable de Berlin-Est. Michael Boehlke et Carsten Fiebeler l’ont interviewé en 2005.
Quand as-tu pris la décision de quitter la RDA ?
C’était en 1984. En fait, je n’ai jamais voulu partir, j’ai toujours voulu rester, je me disais “non ils ne m’arrêteront pas, non je ne fermerai pas ma gueule”... Mais un jour on est partis avec ma femme et des amis en vacances au bord de la mer, sur cette putain de mer Baltique, à Banzin, comme toujours, et on s’est encore fait arrêter par les flics, on n’avait pas le droit d’être dans le camping et on a tous été arrêtés, on s’est fait tabasser, les flics nous ont pris nos affaires et on a dû rentrer chez nous. On avait 24 heures pour pointer au commissariat et, si on ne le faisait pas, on allait encore aller en prison pour je ne sais quelle connerie de flics et ça a été la goutte d’eau... Cette idée de passer à l’Ouest, ça m’a rendu vraiment très triste, je n’étais pas complètement désespéré, mais enfin tu sais bien, on croyait que rien ne changerait jamais. A l’époque beaucoup de mes amis étaient en taule, à l’Ouest, ou à l’armée, ou je ne sais où, ou bien ils s’étaient fait mater et on ne pouvait plus les voir de toute façon. Et c’est là que je me suis dit : “je ne veux pas finir ma vie comme ça, je ne veux pas retourner à l’armée ou en prison ou me laisser fermer ma gueule”. Et je me suis dit : “je passe de l’autre côté. Je passe à l’Ouest”. Et j’ai déposé ma demande de visa de sortie.
Et ça s’est fait en quelle année ?
J’ai été incarcéré pour la dernière fois en 1985 et je suis passé à l’Ouest en avril 1986, directement à ma sortie de prison.
Ce n’était pas ta première peine de prison ?
Non, c’était la troisième. Enfin, la première fois, c’était dans un centre de détention pour mineurs mais c’était exactement la même chose, et là c’était la troisième fois, oui. J’avais été condamné à un an et quatre mois de prison pour “dénigrement public de l’État”.
Quel était le dénigrement ?
Je ne sais plus exactement. J’avais donné mon avis sur le SED, le Mur, la liberté d’expression... Et le plus grave, c’est que j’avais comparé le régime aux fascistes.
Tu étais déjà marié à l’époque. Ta femme a pu venir te voir en prison ?
Oui, mais pendant plus d’un mois, elle n’a pas su où j’étais, ils ne lui ont rien dit. Ils lui ont juste dit : “votre mari voulait passer à l’Ouest, de toute façon”. Et je ne l’ai revue qu’un mois et demi après mon arrestation, en préventive.
Ça soulage ou c’est encore pire ce genre d’entretiens ?
Ça remue beaucoup, quand même. Le truc, c’est que je ne savais rien, je veux dire, dans une prison normale, tu sais quand des gens viennent te voir et il y a une certaine régularité. Dans la prison de la Stasi on ne savait jamais rien. Je sais que tu le sais, je ne suis pas le seul à avoir vécu ça, beaucoup de gens l’ont vécu, on a dû te le raconter mille fois... Tu étais dans ta cellule. On ne t’appelait jamais par ton vrai nom mais “à gauche” ou “à droite” en fonction de la place de ton lit. Tu étais soit tout seul soit à deux. Ou alors on t’appelait juste “un” ou “deux”. Quand tu sortais de ta cellule, tu avais ton habit de prisonnier, tu avais des chaussons, personne ne pouvait entendre tes pas, tu ne voyais jamais d’autres prisonniers en dehors de ton éventuel codétenu Jamais je n’ai croisé ou aperçu un autre détenu. Et quand on te faisait sortir, on t’emmenait dans les étages supérieurs voir un interrogateur ou bien on t’emmenait voir un médecin... Et donc, au bout d’un mois et demi, on me dit “à gauche, sortez”, et on me conduit en bas dans une cellule, une cellule vide avec juste un cintre sur lequel mes vêtements civils étaient accrochés. J’étais très étonné, je me suis dit que j’allais voir un interrogateur à l’extérieur ou je ne sais quelle saloperie de procureur. On m’a juste dit “habillez-vous”, j’ai enfilé mes vêtements et, quelques minutes plus tard, des agents de sécurité sont venus me chercher. On a marché dans des couloirs et, d’un seul coup, on est arrivés dans une tout autre aile de la prison où il y avait du papier peint au mur et de la moquette... Et là une porte s’est ouverte, je suis entré et j’ai vu ma petite Marlies assise à une table, avec à côté d’elle mon connard d’interrogateur et un soldat de garde dans un coin. Et là, oui, on était contents. J’en revenais pas, on ne savait pas quoi dire, on ne s’était pas vus depuis un mois et demi, on n’avait eu aucune nouvelle l’un de l’autre... Et le truc, c’est que tu n’avais pas le droit de te toucher. Tu n’avais même pas le droit de dire bonjour, tu devais juste t’asseoir à la table. On était assis l’un en face de l’autre, c’était bouleversant, mais tu ne pouvais ni t’embrasser ni te toucher ni te prendre la main ni t’enlacer. Rien du tout.
Qu’est-ce que vous vous êtes dit ?
Et bien j’ai pris sur moi, j’ai un peu joué la comédie, j’ai essayé de dire des trucs drôles... A tel point que ce connard de soldat de garde n’arrêtait pas de glousser dans son coin. Et à chaque fois que je voulais lui raconter ce qui se passait, parce qu’elle me demandait sans arrêt “qu’est-ce qui se passe ici ? Qu’est-ce que tu fais toute la journée ?”, l’interrogateur disait “si vous continuez à parler de cet établissement, on interrompt tout de suite cet entretien et vous ne reverrez plus jamais votre femme”. Blablabla. Et ça a continué comme ça. Et voilà... Je ne savais jamais quand elle venait mais à partir de ce jour-là, quand on me faisait descendre et qu’il y avait mes affaires sur mon cintre, je savais que je la verrais...
Ils ont utilisé votre relation comme moyen de pression ? Pour te faire craquer par exemple pendant les interrogatoires ?
Oui, ils se servaient de ta famille, aussi. Par exemple... On n’avait le droit d’écrire qu’une seule lettre une fois par semaine. On te faisait sortir de ta cellule, on te mettait dans une cellule vide avec juste une table et sur la table il y avait une petite feuille A5 et un stylo. Quand tu avais fini tu sonnais, on te ramenait dans ta cellule et la lettre allait au contrôle... Et au début, ton courrier, c’était ton seul rapport avec le monde. Au début, pendant les premières semaines, pendant les deux premiers mois environ, tu étais en permanence en contact avec ton interrogateur. La Stasi avait conçu ça pour que tu développes une forme de confiance en lui, vu que c’était la seule personne à qui tu pouvais parler. Mais je n’avais rien à lui raconter. Je veux dire... Je n’étais pas un criminel ou un terroriste qui avait caché son butin ou ses explosifs quelque part. Et bref, un jour, ils m’ont emmené là-haut dans ma cellule d’interrogatoire, elles étaient toutes alignées, toutes pareilles, avec des murs capitonnés, tu sais, et ils ont ouvert la porte et mon interrogateur était déjà assis à son bureau et là il me dit “bonjour” et il se met à me lire une lettre, il lit la lettre comme ça et il rit “ah ah ah” et il feuillette la lettre et il dit “ah ah ah, c’est une lettre de votre femme mais malheureusement je ne peux pas vous la donner”. Donc oui, ils ont déjà essayé ce genre de moyens de pression, mais je crois qu’ils ont su très vite qu’ils ne tireraient rien de moi. Je ne disais rien, ils savaient déjà tout de toute façon, ils savaient où j’étais allé, tout. Et je répétais “qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il n’y a pas de punks en RDA de toute façon”. Et l’interrogateur disait : “si, Colonel, pour moi, si”.
Et tu te souviens de ton passage à l’Ouest ?
Oui... J’avais vraiment les boules de laisser tout le monde, tous mes amis, ma famille et ma Marlies qui, Dieu soit loué, m’a rejoint un mois après... Je me souviens quand je suis sorti de prison, quand j’ai pris le bus avec les autres prisonniers et qu’on est passés de l’autre côté, moi je pensais à ma famille, à mes amis, à tout ce que j’abandonnais et eux, ces gros péquenauds, ils regardaient par la fenêtre et ils disaient “ouah, regarde la Mercedes, ouah, t’as vu la Porsche ?” Moi j’en avais rien à foutre. Et j’en ai toujours rien à foutre d’ailleurs.
C’était l’Ouest auquel tu t’attendais ?
Quand on est arrivés, oui, enfin... Ça m’a vraiment surpris de voir tout ce que l’État, tout ce que qu’ils avaient raconté, qu’on serait directement au chômage, tout ça, c’étaient des grosses conneries ! Et je me suis dit, quelles conneries tout ça ! Avant la chute du Mur, la RFA était un état assez social quand même ! Et il l’est toujours aujourd’hui, comparé à d’autres pays. Il fallait tout prendre en main, évidemment ce n’était pas comme à l’Est où le Parti, un flic ou le Président du Parti s’occupait toujours de tout. C’était bien, mais... en même temps... je m’ennuyais... et mes amis me manquaient. Je suis allé voir des concerts, j’ai voyagé, bien sûr... Je me sentais bien mais, en même temps, je n’étais plus... je n’étais plus un guerrier, j’étais un peu comme un guerrier à la retraite... Et quand j’ai vu des punks de l’Ouest pour la première fois, qui faisaient la manche à Cotbusser Tor, je me suis dit “c’est des clochards habillés en punks mais ce ne sont pas des punks”. Il n’y avait plus aucune vie chez eux. Et il y avait toutes ces conneries : qui est de gauche, qui est de droite, ils étaient tous de gauche ou de droite, les uns étaient des nazis rouges, les autres, des nazis bruns, tu vois ? Et ça, ça m’a pas du tout fait envie.
Tu as été punk à l’Ouest ?
Je continuais d’aller voir des concerts, je faisais des manifs pour ce qui me semblait juste, mais les punks du genre “je squatte, je touche les allocs chômage et toutes les aides sociales et je gueule contre l’État” c’était pas trop mon truc. Je me suis occupé autrement. Notre appart s’est un peu transformé en camp de transit, tous les gens qui s’exilaient passaient par chez nous, chez Marlies et moi. On les aidait, certains ont habité chez nous... On les aidait dans leurs démarches administratives ou on les dépannait financièrement... Et ça a continué comme ça jusqu’à la chute du Mur.
Ça m’intéresse que tu parles de “guerrier à la retraite”. Pour toi, un punk est un guerrier ?
Oui, ok, si tu dis ça à un beauf il va penser “un guerrier, ça a un bouclier et une armure” et il va se dire que je me la raconte et que je me prends pour un héros... Mais pour moi, on était des guerriers, oui, en ce sens qu’on pensait rock’n’roll. On faisait notre chemin sans se laisser influencer, on était fiers, il fallait qu’on soit beaux, qu’on ait un style mais, en fait, ce qui était important, c’était le vivre ensemble. On voulait changer les choses, on voulait faire quelque chose de nouveau et on l’a fait un peu d’ailleurs. À l’Ouest, il n’y avait plus rien à faire... À part repenser au passé, consommer et voyager. Je veux dire... Évidemment que j’ai continué, je suis allé dans les manifs, j’avais une conscience politique, j’ai rencontré des gens bien aussi, mais voir tous ceux qui manifestaient et qui profitaient de l’État tout en crachant dessus, tout en étant complètement dépendants du système... Pour moi c’étaient des tricheurs...
Tu as pu revoir des gens de l’Est avant la chute du Mur ? Tu les voyais à Prague, sûrement, non ?
Oui, on s’est vus à Prague. Ou alors les classiques, dans les restoroutes, dans les zones de transit. Oui, on le faisait et on apportait toujours je ne sais quelles babioles. Et quand je voyais comme les gens s’émerveillaient des conneries que j’apportais, je me disais : “moi aussi j’aurais été comme eux.” Je suis toujours resté en contact avec mes amis... D’ailleurs, mes amis les plus proches sont toujours ceux de cette époque.
Tu vivais dans quel quartier à Berlin-Ouest ?
J’ai vécu à Kreuzberg jusqu’à la chute du Mur... Et là, ça m’a un peu dégoûté, je dois dire, de les voir tous hurler “Wir sind das Volk” [nous sommes le peuple]. D’un seul coup, ils étaient tous devenus des grands révolutionnaires... Et je me suis réinstallé dans mon quartier, à Prenzlauer Berg en 1991... C’est chez moi ici.
Tu as lu ton dossier ?
Oui.
Tu as découvert que des gens t’avaient trahi ?
D’abord, il faut dire que tous ces dossiers de merde et cette question de savoir qui a trahi qui, au début, cela ne m’a pas du tout intéressé. Tout le monde disait tout le temps : “j’ai lu mon dossier et lui c’était un IM, tu te rends compte ? Et lui c’était un IM” Aahhh... Ils se sont tous entre-déchirés. D’un seul coup, tout le monde était IM. Et puis, finalement, je me suis décidé en 1994. Je suis allé dans cette centrale gigantesque de la Stasi... J’y suis allé en moto, avec ma Harley et je dois dire que c’était assez jouissif ! Je suis arrivé là-dedans, j’ai demandé mon dossier et, là, une femme m’a parlé, elle a essayé de faire un peu de psychologie “monsieur truc, faites attention, il peut y avoir un membre de votre famille dans votre dossier... S’il y a un problème vous pouvez venir nous en parler”. J’ai dit “oui oui, oui oui” et j’ai attendu. Ça durait longtemps. Il y avait des gens qui hurlaient : “J’AI SOUFFERT 40 ANS DANS CE SYSTÈME, JE VEUX VOIR MON DOSSIER MAINTENANT, ÇA SUFFIT, C’EST QUOI CE BORDEL ? IL FAUT QUE J’ATTENDE ENCORE COMBIEN DE TEMPS ? J’AI ATTENDU 40 ANS !” Et eux, quand leurs dossiers arrivaient, c’étaient de tout petits dossiers épais comme ça. Moi, je me suis assis tranquillement et on m’a apporté un chariot énorme. Rempli à ras bords. Des centaines de dossiers. Une montagne de dossiers. J’ai commencé à lire et je me disais : “ils se sont donnés tout ce mal pour nous... on était si importants”. C’était assez exaltant, je dois dire. Il y a des choses qui m’ont un peu effrayé, ils avaient par exemple prévu de nous envoyer dans un camp de prisonniers... Mais bon, en fait, je ne l’ai pas lu en entier parce que c’est assez chiant, il y a des milliers de rapports qui racontent juste ce que tu as fait toute la journée et, en fait, ça se répète tout le temps. Parfois j’ai ri aussi, de trucs que j’avais oubliés.
Et les IM ?
_ J’ai vu qu’il y avait quelques IM, mais je m’en doutais déjà et ils n’étaient pas dans mon entourage immédiat. J’ai lu aussi qu’ils avaient essayé de me recruter comme IM quand j’étais en préventive à Rummelsburg. J’avais été envoyé à l’interrogatoire mais on m’avait emmené dans une pièce spéciale où il y avait une nappe, des cigarettes, du café et trois types en costume qui n’étaient clairement pas des flics. Ils m’avaient posé des questions très différentes de celles qu’on me posait tout le temps. Je ne sais plus, des milliers de questions sur plein de sujets. Et en lisant mon dossier, j’ai compris qu’ils avaient essayé de me recruter comme IM mais l’avis de ceux qui avaient fait le rapport, c’était que j’étais un “agent de perturbation actif”, que j’allais “perturber négativement la vie socialiste” et que je n’aurais pas été fiable. C’est clair que de ce point de vue je n’étais pas très intéressant ! (rires)
***************************************************************************************************
PAROLES (EXTRAITS) – NAMENLOS
Est-ce que ça vaut le coup de marcher au pas pour celui qui ne t’aime pas ?
Est-ce que ça vaut le coup de marcher au pas pour celui qui te piétine ?
Est-ce que ça vaut le coup de marcher au pas pour celui qui te hait ?
Est-ce que ça vaut le coup de marcher au pas pour celui qui t’enferme ?
Dis-le, raconte-le, crie-le, la vérité est si proche
Dis-le, raconte-le, crie-le, qu’est-ce qui peut se passer de plus de toute façon ?
Dis-le, raconte-le, crie-le, les journaux sont rouges,
Dis-le, raconte-le, crie-le, les citoyens sont des morts vivants
Dis-le, raconte-le, crie-le et les mouchards écoutez bien : si nous allons en prison pour ça, soyez certains qu’une fois sortis, on sera des terroristes.
Namenlos (Michael Horschig alias « A-Micha », Jana Schloßer, Frank Mash, Mita Schamal, 1983-1987)
[1] Ernst Thälmann (1886-1944) était une des principales figures antifascistes du panthéon est-allemand. Militant communiste, dirigeant du KPD à partir de 1925, il fut arrêté en 1933 lors de la répression qui suivit l’incendie du Reichstag et mourut à Buchenwald.
[2] Tableau d’honneur où figuraient les photos et médailles des travailleurs qui s ‘étaient distingués.
[3] Depuis les années 1970, l’Ostpolitik, politique de rapprochement entre la RDA et la RFA, rendit la frontière entre les deux un peu plus perméable. La RDA simplifia notamment les autorisations de voyage, en particulier pour les retraités, et autorisa les visites de courte durée d’Allemands de l’Ouest dans les régions frontalières.
[4] Litt. « allzeitbereit », clin d’œil à la devise des pionniers : « seid bereit, immer bereit ».
[5] Service de police politique, de renseignement, d’espionnage et de contre-espionnage de la RDA.
[6] Littéralement : Ministerium für Staatsicherheit.
[7] Équivalent de la troisième.
[8] Les « bluesers », amateurs de blues, de folk et de rock étaient en quelque sorte les hippies de la RDA. Leur look : barbe, cheveux longs, 501 (dans la mesure du possible), parka, chaussures en daim, chemises de travailleurs et sacs cousus main. Leurs idoles : Hendrix, Dylan, les Doors et, en RDA, des groupes comme Freygang, Engerling ou Monokel.
[9] Société pour le sport et la technique.
[10] indic
[11] Créé en 1954 en l’honneur de Feliks Dzierzynski (1877-1936), fondateur de la Tchéka (ancêtre du KGB). Cette division d’élite armée du MFS était chargée de la surveillance des institutions officielles et des annexes militaires comme du maintien de l’ordre, en particulier lors des grandes occasions (cérémonies officielles, déplacement des dirigeants, etc).
[12] Chargée de la surveillance de l’appareil d’État, des églises, du champ culturel et de l’activité politique souterraine.
[13] Dans l’église du Rédempteur.
[14] Anarchiste allemand, mort dans le camp de concentration d’Oranienburg.
)
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (1.5 Mo)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (1.5 Mo)